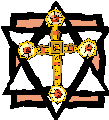LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE XIX. — AVENIR DES MISSIONS.
|
Tel était le monde que les missionnaires chrétiens entreprirent de convertir. On doit voir maintenant, ce me semble, qu'une telle entreprise ne fut pas une folie, et que sa réussite ne fut pas un miracle. Le monde était travaillé de besoins moraux auxquels la religion nouvelle répondait admirablement. Les mœurs s'adoucissaient ; on voulait un culte plus pur ; la notion des droits de l'homme, les idées d'améliorations sociales gagnaient de toutes parts. D'un autre côté, la crédulité était extrême ; le nombre des personnes instruites, très-peu considérable. Que des apôtres ardents, juifs, c'est-à-dire monothéistes, disciples de Jésus, c'est-à-dire pénétrés de la plus douce prédication morale que l'oreille des hommes eût encore entendue, se présentent à un tel monde, et sûrement ils seront écoutés. Les rêves qui se mêlent à leur enseignement ne seront pas un obstacle à leur succès ; le nombre de ceux qui ne croient pas au surnaturel, au miracle, est très-faible. S'ils sont humbles et pauvres, c'est tant mieux. L'humanité, au point où elle est, ne peut être sauvée que par un effort venant du peuple. Les anciennes religions païennes ne sont pas réformables ; l'État romain est ce que sera toujours l'État, roide, sec, juste et dur. Dans ce monde qui périt faute d'amour, l'avenir appartient à celui qui touchera la source vive de la piété populaire. Le libéralisme grec, la vieille gravité romaine sont pour cela tout à fait impuissants. La fondation du christianisme est, à ce point de vue, l'œuvre la plus grande qu'aient jamais faite des hommes du peuple. Très-vite sans doute, des hommes et des femmes de la haute noblesse romaine s'affilièrent à l'Eglise. Dès la fin du premier siècle, Flavius Clemens et Flavie Domitille nous montrent le christianisme pénétrant presque dans le palais des Césars[1]. A partir des premiers Antonins, il y a des gens riches dans la communauté. Vers la fin du IIe siècle, on y trouve quelques-uns des personnages les plus considérables de l'Empire[2]. Mais, au début, tous ou presque tous furent humbles[3]. Dans les plus anciennes Églises, pas plus qu'en Galilée autour de Jésus, ne se trouvèrent des nobles, des puissants. Or, en ces grandes créations, c'est la première heure qui est décisive. La gloire des religions appartient tout entière à leurs fondateurs. Les religions, en effet, sont affaire de foi. Croire est chose vulgaire ; le chef-d'œuvre est de savoir inspirer la foi. Quand on cherche à se figurer ces merveilleuses origines,
on se représente d'ordinaire les choses sur le modèle de notre temps, et l'on
est amené ainsi à de graves erreurs. L'homme du peuple, au premier siècle de
notre ère, surtout dans les pays grecs et orientaux, ne ressemblait nullement
à ce qu'il est aujourd'hui. L'éducation ne traçait pas alors entre les
classes une barrière aussi forte que maintenant. Ces races de Le christianisme naquit en dehors du monde officiel, mais
non pas précisément au-dessous. C'est en apparence et selon les préjugés
mondains que les disciples de Jésus étaient de petites gens. Le mondain aime
ce qui est fier et fort ; il parle sans affabilité à l'homme humble ;
l'honneur, comme il l'entend, consiste à ne pas se laisser insulter ; il
méprise celui qui s'avoue faible, qui souffre tout, se met au-dessous de
tout, cède sa tunique, tend sa joue aux soufflets. Là est son erreur ; car le
faible, qu'il dédaigne, lui est d'ordinaire supérieur ; la somme de vertu est
chez ceux qui obéissent (servantes, ouvriers, soldats,
marins, etc.) plus grande que chez ceux qui commandent et jouissent.
Et cela est presque dans l'ordre, puisque commander et jouir, loin d'aider à
la vertu, sont une difficulté pour être vertueux. Jésus comprit à merveille que le peuple a dans son sein le grand réservoir de dévouement et de résignation qui sauve le monde. Voilà pourquoi il proclama heureux les pauvres, jugeant qu'il leur est plus aisé qu'aux autres d'être bons. Les chrétiens primitifs furent, par essence, des pauvres. Pauvres fut leur nom[5]. Même quand le chrétien fut riche, au IIe et au IIIe siècle, il fut en esprit un tenuior ; il se sauva grâce à la loi sur les collegia tenuiorum. Les chrétiens n'étaient certes pas tous des esclaves et des gens de basse condition ; mais l'équivalent social d'un chrétien était un esclave ; ce qui se disait d'un esclave se disait d'un chrétien. De part et d'autre, on se fait honneur des mêmes vertus, bonté, humilité, résignation, douceur. Le jugement des auteurs païens est à cet égard unanime. Tous sans exception reconnaissent dans le chrétien les traits du caractère servile, indifférence pour les grandes affaires, air triste et contrit, jugement morose sur le siècle, aversion pour les jeux, les théâtres, les gymnases, les bains[6]. En un mot, les païens étaient le monde ; les chrétiens
n'étaient pas du monde. Ils étaient un petit troupeau à part, haï du monde,
trouvant le monde mauvais[7], cherchant à se garder immaculé du monde[8]. L'idéal du
christianisme sera le contraire de celui du mondain[9]. Le parfait
chrétien aimera l'abjection ; il aura les vertus du pauvre, du simple, de
celui qu ne cherche pas à se faire valoir. Mais il aura les défauts de ses
vertus ; il déclarera vaines et frivoles bien des choses qui ne le sont pas ;
il rapetissera l'univers ; il sera l'ennemi ou le contempteur de la beauté.
Un système où Une autre loi se montre dès à présent comme devant dominer
cette histoire. L'établissement du christianisme correspond à la suppression
de la vie politique dans le monde de L'importance donnée aux questions sociales est toujours à l'inverse des préoccupations politiques. Le socialisme prend le dessus, quand le patriotisme s'affaiblit. Le christianisme fut l'explosion d'idées sociales et religieuses à laquelle il fallait s'attendre dès qu'Auguste eut mis fin aux luttes politiques. Culte universel, comme l'islamisme, le christianisme sera au fond l'ennemi des nationalités. Il faudra bien des siècles et bien des schismes pour qu'on arrive à former des Églises nationales avec une religion qui fut d'abord la négation de toute patrie terrestre, qui naquit à une époque où il n'y avait plus au monde de cité ni de citoyens, et que les vieilles républiques, roides et fortes, d'Italie et de Grèce eussent sûrement expulsée comme un poison mortel pour l'État. Et ce fut là une des causes de grandeur du culte nouveau. L'humanité est chose diverse, changeante, tiraillée par des désirs contradictoires. Grande est la patrie, et saints sont les héros de Marathon, des Thermopyles, de Valmy et de Fleurus. La patrie, cependant, n'est pas tout ici-bas. On est homme et fils de Dieu, avant d'être Français ou Allemand. Le royaume de Dieu, rêve éternel qu'on n'arrachera pas du cœur de l'homme, est la protestation contre ce que le patriotisme a de trop exclusif. La pensée d'une organisation de l'humanité en vue de son plus grand bonheur et de son amélioration morale est chrétienne et légitime. L'Etat ne sait et ne peut savoir qu'une seule chose, organiser l'égoïsme. Cela n'est pas indifférent ; car l'égoïsme est le plus puissant et le plus saisissable des mobiles humains. Mais cela ne suffit pas. Les gouvernements qui sont partis de cette supposition que l'homme n'est composé que d'instincts cupides se sont trompes. Le dévouement est aussi naturel que l'égoïsme à l'homme de grande race. L'organisation du dévouement, c'est la religion. Qu'on n'espère donc pas se passer de religion ni d'associations religieuses. Chaque progrès des sociétés modernes rendra ce besoin-là plus impérieux. Voilà de quelle manière ces récits d'événements étranges peuvent être pour nous pleins d'enseignements et d'exemples. Il ne faut pas s'arrêter à certains traits que la différence des temps fait paraître bizarres. Quand il s'agit de croyances populaires, il y a toujours une immense disproportion entre la grandeur du but idéal que poursuit la foi et la petitesse des circonstances matérielles qui ont fait croire. De là cette particularité que, dans l'histoire religieuse, des détails choquants et des actes ressemblant à la folie peuvent être mêlés à tout ce qu'il y a de plus sublime. Le moine qui inventa la sainte ampoule a été l'un des fondateurs du royaume de France. Qui ne voudrait effacer de la vie de Jésus l'épisode des démoniaques de Gergésa ? Jamais homme de sang-froid n'a fait ce que firent François d'Assise, Jeanne d'Arc, Pierre l'Ermite, Ignace de Loyola. Rien n'est plus relatif que le mot de folie appliqué au passé de l'esprit humain. Si l'on suivait les idées répandues de nos jours, il n'y a pas de prophète, pas d'apôtre, pas de saint qui n'aurait dû être enfermé. La conscience humaine est très-instable, aux époques où la réflexion n'est pas avancée ; dans ces états de l'âme, c'est par des passages insensibles que le bien devient le mal et que le mal devient le bien, que le beau confine au laid et que le laid redevient la beauté. Il n'y a pas de justice possible envers le passé, si l'on n'admet cela. Un même souffle divin pénètre toute l'histoire et en fait l'admirable unité ; mais la variété des combinaisons que peuvent produire les facultés humaines est infinie. Les apôtres diffèrent moins de nous que les fondateurs du bouddhisme, lesquels étaient pourtant plus près de nous par la langue et probablement par la race. Notre siècle a vu des mouvements religieux tout aussi extraordinaires que ceux d'autrefois, mouvements qui ont provoqué autant d'enthousiasme, qui ont eu déjà, proportion gardée, plus de martyrs, et dont l'avenir est encore incertain. Je ne parle pas des Mormons, secte à quelques égards si sotte et si abjecte que l'on hésite à la prendre au sérieux. Il est instructif cependant de voir, en plein XIXe siècle, des milliers d'hommes de notre race vivant dans le miracle, croyant avec une foi aveugle des merveilles qu'ils disent avoir vues et touchées. Il y a déjà toute une littérature pour montrer l'accord du mormonisme et de la science ; ce qui vaut mieux, cette religion, fondée sur de niaises impostures, a su accomplir des prodiges de patience et d'abnégation ; dans cinq cents ans, des docteurs prouveront sa divinité par les merveilles de son établissement. Le bâbisme, en Perse, a été un phénomène autrement considérable[10]. Un homme doux et sans aucune prétention, une sorte de Spinoza modeste et pieux, s'est vu, presque malgré lui, élevé au rang de thaumaturge, d'incarnation divine, et est devenu le chef d'une secte nombreuse, ardente et fanatique, qui a failli amener une révolution comparable à celle de l'islam. Des milliers de martyrs sont accourus pour lui avec allégresse au-devant de la mort. Un jour sans pareil peut-être dans l'histoire du monde fut celui de la grande boucherie qui se fit des bâbis à Téhéran. On vit ce jour-là dans les rues et les bazars de Téhéran, dit un narrateur qui a tout su d'original[11], un spectacle que la population semble devoir n'oublier jamais. Quand la conversation, encore aujourd'hui, se met sur cette matière, on peut juger de l'admiration mêlée d'horreur que la foule éprouva et que les années n'ont pas diminuée. On vit s'avancer entre les bourreaux des enfants et des femmes, les chairs ouvertes sur tout le corps, avec des mèches allumées, flambantes, fichées dans les blessures. On traînait les victimes par des cordes et on les faisait marcher à coups de fouet. Enfants et femmes s'avançaient en chantant un verset qui dit : En vérité, nous venons de Dieu et nous retournons à lui ! Leurs voix s'élevaient éclatantes au-dessus du silence profond de la foule. Quand un des suppliciés tombait et qu'on le faisait relever à coups de fouet ou de baïonnette, pour peu que la perte de son sang, qui ruisselait sur tous ses membres, lui laissât encore un peu de force, il se mettait à danser et criait avec un surcroît d'enthousiasme : En vérité, nous sommes à Dieu et nous retournons à lui ! Quelques-uns des enfants expirèrent dans le trajet. Les bourreaux jetèrent leurs corps sous les pieds de leurs pères et de leurs sœurs, qui marchèrent fièrement dessus et ne leur donnèrent pas deux regards. Quand on arriva au lieu d'exécution, on proposa encore aux victimes la vie pour leur abjuration. Un bourreau imagina de dire à un père que, s'il ne cédait pas, il couperait la gorge à ses deux fils sur sa poitrine. C'étaient deux petits garçons, dont l'aîné avait quatorze ans, et qui, rouges de leur propre sang, les chairs calcinées, écoutaient froidement le dialogue ; le père répondit, en se couchant par terre, qu'il était prêt, et l'aîné des enfants, réclamant avec emportement son droit d'aînesse, demanda à être égorgé le premier[12]. Enfin, tout fut achevé ; la nuit tomba sur un amas de chairs informes ; les têtes étaient attachées en paquets au poteau de justice, et les chiens des faubourgs se dirigeaient par troupes de ce côté. Cela se passait en 1852. La secte de Mazdak, sous Chosroès Nouschirvan, fut étouffée dans un pareil bain de sang. Le dévouement absolu est pour les natures naïves la plus exquise des jouissances et une sorte de besoin. Dans l'affaire des bâbis, on vit des gens qui étaient à peine de la secte venir se dénoncer eux-mêmes, afin qu'on les adjoignît aux patients. Il est si doux à l'homme de souffrir pour quelque chose, que dans bien des cas l'appât du martyre suffit pour faire croire. Un disciple qui fut le compagnon de supplice du Bâb, suspendu à côté de lui aux remparts de Tébriz, et attendant la mort, n'avait qu'un mot à la bouche : Es-tu content de moi, maître ? Les personnes qui regardent comme miraculeux ou chimérique ce qui dans l'histoire dépasse les calculs d'un bon sens vulgaire, doivent trouver de tels faits inexplicables. La condition fondamentale de la critique est de savoir comprendre les états divers de l'esprit humain. La foi absolue est pour nous un fait complètement étranger. En dehors des sciences positives, d'une certitude en quelque sorte matérielle, toute opinion n'est à nos yeux qu'un à peu près, impliquant une part de vérité et une part d'erreur. La part d'erreur peut être aussi petite que l'on voudra ; elle ne se réduit jamais à zéro, quand il s'agit de choses morales, impliquant une question d'art, de langage, de forme littéraire, de personnes. Telle, n'est pas la manière de voir des esprits étroits et obstinés, des Orientaux par exemple. L'œil de ces gens n'est pas comme le nôtre ; c'est l'œil d'émail des personnages de mosaïques, terne, fixe. Ils ne savent voir qu'une seule chose à la fois, cette chose les obsède, s'empare d'eux ; ils ne sont plus maîtres alors de croire ou de ne pas croire ; il n'y a plus de place en eux pour une arrière-pensée réfléchie. Une opinion ainsi embrassée, on se fait tuer pour elle. Le martyr est en religion ce que l'homme de parti est en politique. Il n'y a pas eu beaucoup de martyrs très-intelligents, les confesseurs du temps de Dioclétien durent être, après la paix de l'Église, de gênants et impérieux personnages. On n'est jamais bien tolérant, quand on croit qu'on a tout II fait raison et que les autres ont tout à fait tort. Les grands embrasements religieux, étant la conséquence d'une manière très-arrêtée de voir les choses, deviennent ainsi des énigmes pour un siècle comme le nôtre, où la rigueur des convictions s'est affaiblie. Chez nous, l'homme sincère modifie sans cesse ses opinions ; en premier lieu, parce que le monde change ; en second lieu, parce que l'appréciateur change aussi. Nous croyons plusieurs choses à la fois. Nous aimons la justice et la vérité ; pour elles nous exposerions notre vie ; mais nous n'admettons pas que le juste et le vrai soient l'apanage d'une secte ou d'un parti. Nous sommes bons Français ; mais nous avouons que les Allemands, les Anglais nous sont supérieurs à bien des égards. Il n'en est pas ainsi aux époques et dans les pays où chacun est de sa communion, de sa race, de son école politique, d'une façon entière, et voilà pourquoi toutes les grandes créations religieuses ont eu lieu dans des sociétés dont l'esprit général était plus ou moins analogue à celui de l'Orient. Jusqu'ici, en effet, la foi absolue a seule réussie à s'imposer aux autres. Une bonne servante de Lyon, Blandine, qui s'est fait tuer pour sa foi, il y a dix-sept cents ans, un brutal chef de bande, Clovis, qui trouva bon, il y après de quatorze siècles, d'embrasser le catholicisme, nous font encore la loi. Qui ne s'est arrêté, en parcourant nos anciennes villes devenues modernes, au pied des gigantesques monuments de la foi des vieux âges ? Tout s'est renouvelé à l'entour ; plus un vestige des habitudes d'autrefois ; la cathédrale est restée, un peu dégradée peut-être à la hauteur de la main de l'homme, mais profondément enracinée dans le sol. Mole sua stat ! Sa masse est son droit. Elle a résisté au déluge qui a tout balayé autour d'elle ; pas un des hommes d'autrefois, revenant visiter les lieux où il vécut, ne retrouverait sa maison ; seul, le corbeau qui a posé son nid dans les hauteurs de l'édifice sacré n'a pas vu porter le marteau sur sa demeure. Étrange prescription ! Ces honnêtes martyrs, ces rudes convertis, ces pirates bâtisseurs d'églises nous dominent toujours. Nous sommes chrétiens, parce qu'il leur a plu de l'être. Comme en politique il n'y a que les fondations barbares qui durent, en religion il n'y a que les affirmations spontanées, et, si j'ose le dire, fanatiques, qui soient contagieuses. C'est que les religions sont des œuvres toutes populaires. Leur succès ne dépend pas des preuves plus ou moins bonnes qu'elles administrent de leur divinité ; leur succès est en proportion de ce qu'elles disent au cœur du peuple. Suit-il de là que la religion soit destinée à diminuer peu
à peu et à disparaître comme les erreurs populaires sur la magie, la
sorcellerie, les esprits ? Non certes. La religion n'est pas une erreur
populaire ; c'est une grande vérité d'instinct, entrevue par le peuple,
exprimée par le peuple. Tous les symboles qui servent à donner une forme au
sentiment religieux sont incomplets, et leur sort est d'être rejetés les uns
après les autres. Mais rien n'est plus faux que le rêve de certaines
personnes qui, cherchant à concevoir l'humanité parfaite, la conçoivent sans
religion. C'est l'inverse qu'il faut dire. Mais il est temps de revenir aux trois missionnaires, Paul, Barnabé, Jean-Marc, que nous avons laissés au moment où ils sortent d'Antioche par la porte qui conduit à Séleucie. Dans mon troisième livre, j'essayerai de suivre les traces de ces messagers de bonne nouvelle, sur terre et sur mer, par le calme et la tempête, par les bons et les mauvais jours. J'ai hâte de redire celte épopée sans égale, de peindre ces routes infinies d'Asie et d'Europe, le long desquelles ils semèrent le grain de l'Évangile, ces flots qu'ils traversèrent tant de fois en des situations si diverses. La grande odyssée chrétienne va commencer. Déjà la barque apostolique a tendu ses voiles ; le vent souille, et n'aspire qu'à porter sur ses ailes les paroles de Jésus. FIN DES APÔTRES |