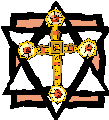LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE XI. — PAIX ET DÉVELOPPEMENTS INTÉRIEURS DE L'ÉGLISE DE JUDÉE.
|
De l'an 38 à l'an 44, aucune persécution ne paraît s'être appesantie sur l'Église[1]. Les fidèles s'imposèrent sans doute des précautions qu'ils négligeaient avant la mort d'Etienne, et évitèrent de parler en public. Peut-être aussi les disgrâces des Juifs qui, durant toute la seconde partie du règne de Caligula, furent en lutte avec ce prince, contribuèrent-elles à favoriser la secte naissante. Les Juifs, en effet, étaient d'autant plus persécuteurs qu'ils étaient en meilleure intelligence avec les Romains. Pour acheter ou récompenser leur tranquillité, ceux-ci étaient portés à augmenter leurs privilèges, et, en particulier, celui auquel ils tenaient le plus, le droit de tuer les personnes qu'ils regardaient comme infidèles à la Loi[2]. Or, les années où nous sommes arrivés comptèrent entre les plus orageuses de l'histoire, toujours si troublée, de ce peuple singulier. L'antipathie que les Juifs, par leur supériorité morale, leurs coutumes bizarres, et aussi par leur dureté, excitaient chez les populations au milieu desquelles ils vivaient, était arrivée à son comble, surtout à Alexandrie[3]. Ces haines accumulées profitèrent, pour se satisfaire, du passage à l'empire d'un des fous les plus dangereux qui aient régné. Caligula, au moins depuis la maladie qui acheva de déranger ses facultés mentales (octobre 37), donnait l'affreux spectacle d'un écervelé gouvernant le monde avec les pouvoirs les plus énormes que jamais homme eût tenus dans sa main. La loi désastreuse du césarisme rendait possibles de telles horreurs, et faisait qu'elles étaient sans remède. Cela dura trois ans et trois mois. On a honte de raconter en une histoire sérieuse ce qui va suivre. Avant d'entrer dans le récit de ces saturnales, il faut dire avec Suétone : Reliqua ut de monstro narranda sunt. Le plus inoffensif passe-temps de cet insensé était le souci de sa propre divinité[4]. Il y mettait une espèce d'ironie amère, un mélange de sérieux et de comique (car le monstre ne manquait pas d'esprit), une sorte de dérision profonde du genre humain. Les ennemis des Juifs virent quel parti on pouvait tirer de cette manie. L'abaissement religieux du monde était tel, qu'il ne s'éleva pas une protestation contre les sacrilèges du césar ; chaque culte s'empressa de lui décerner les titres et les honneurs qu'il réservait à ses dieux. C'est la gloire éternelle des Juifs d'avoir élevé, au milieu de cette ignoble idolâtrie, le cri de la conscience indignée. Le principe d'intolérance qui était en eux, et qui les entraînait à tant d'actes cruels, paraissait ici par son beau côté. Affirmant seuls que leur religion était la religion absolue, ils ne plièrent pas devant l'odieux caprice du tyran. Ce fut pour eux l'origine de tracasseries sans fin. Il suffisait qu'il y eût dans une ville un homme mécontent de la synagogue, méchant, ou simplement espiègle, pour amener d'affreuses conséquences. Un jour, c'était un autel à Caligula qu'on trouvait érigé à l'endroit où les Juifs le pouvaient le moins souffrir[5]. Un autre jour, c'était une troupe de gamins, criant au scandale, parce que les Juifs seuls refusaient de placer la statue de l'empereur dans leurs lieux de prière ; on courait alors aux synagogues et aux oratoires ; on y installait le buste de Caligula[6] ; on mettait les malheureux dans l'alternative ou de renoncer à leur religion, ou de commettre un crime de lèse-majesté. Il s'ensuivait d'affreuses vexations. De telles plaisanteries s'étaient déjà plusieurs fois renouvelées, quand on suggéra à l'empereur une idée plus diabolique encore ; ce fut de placer son colosse en or dans le sanctuaire du temple de Jérusalem, et de faire dédier le temple lui-même à sa divinité[7]. Cette odieuse intrigue faillit hâter de trente ans la révolte et la ruine de la nation juive. La modération du légat impérial, Publius Pétronius, et l'intervention du roi Hérode Agrippa, favori de Caligula, prévinrent la catastrophe. Mais, jusqu'au moment où l'épée de Chæréa délivra la terre du tyran le plus exécrable qu'elle eut encore supporté, les Juifs vécurent partout dans la terreur. Philon nous a conservé le détail de la scène inouïe qui se passa quand la députation dont il était le chef fut admise à voir l'empereur[8]. Caligula les reçut pendant qu'il visitait les villas de Mécène et de Lamia, près de la mer, aux environs de Pouzzoles. Il était ce jour-là en veine de gaieté. Hélicon, son railleur de prédilection, lui avait conté toute sorte de bouffonneries sur les Juifs. Ah ! c'est donc vous, leur dit-il avec un rire amer et en montrant les dents, qui seuls ne voulez pas me reconnaître pour dieu, et qui préférez en adorer un que vous ne sauriez seulement nommer ? Il accompagna ces paroles d'un épouvantable blasphème. Les Juifs tremblaient ; leurs adversaires alexandrins prirent les premiers la parole : Vous détesteriez, seigneur, encore bien davantage ces gens et toute leur nation, si vous saviez l'aversion qu'ils ont pour vous ; car ils ont été les seuls qui n'aient point sacrifié pour votre santé, lorsque tous les peuples le faisaient. A ces mots, les Juifs s'écrièrent que c'était là une calomnie, et qu'ils avaient offert trois fois pour la prospérité de l'empereur les sacrifices les plus solennels qui fussent en leur religion. Soit, dit Caligula avec un sérieux fort comique, vous avez sacrifié ; c'est bien ; mais ce n'est pas à moi que vous avez sacrifié. Quel avantage en retiré-je ? Là-dessus, leur tournant le dos, il se mit à parcourir les appartements, donnant des ordres pour les réparations, montant et descendant sans cesse. Les malheureux députés (entre lesquels Philon, âgé de quatre-vingts ans, l'homme peut-être le plus vénérable du temps, depuis que Jésus n'était plus) le suivaient en haut, en bas, essoufflés, tremblants, bafoués par l'assistance. Caligula, se retournant tout à coup : A propos, leur dit-il, pourquoi donc ne mangez-vous pas de porc ? Les flatteurs éclatèrent de rire ; des officiers, d'un ton sévère, les avertirent qu'on manquait à la majesté de l'empereur par des rires immodérés. Les Juifs balbutièrent ; un d'eux dit assez gauchement : Mais il y a des personnes qui ne mangent pas d'agneau. — Ah ! pour ceux-là, dit l'empereur, ils ont bien raison ; c'est une viande qui n'a pas de goût. Il feignit ensuite de s'enquérir de leur affaire ; puis, la harangue à peine commencée, il les quitte et va donner des ordres pour la décoration d'une salle qu'il voulait garnir de pierre spéculaire. Il revient, affectant un air modéré, demande aux envoyés s'ils ont quelque chose à ajouter, et, comme ceux-ci reprennent le discours interrompu, il leur tourne le dos pour aller voir une autre salle qu'il faisait orner de peintures. Ce jeu de tigre, badinant avec sa proie, dura des heures. Les Juifs s'attendaient à la mort. Mais, au dernier moment, les griffes de la bête rentrèrent. Allons ! dit Caligula en repassant, décidément ces gens-ci ne sont pas aussi coupables qu'ils sont à plaindre de ne pas croire à ma divinité. Voilà comment les questions les plus graves pouvaient être traitées sous l'horrible régime que la bassesse du monde avait créé, qu'une soldatesque et une populace également viles chérissaient, que la lâcheté de presque tous maintenait. On comprend que cette situation si tendue ait enlevé aux Juifs, du temps de Marullus, beaucoup de cette audace qui les faisait parler si fièrement à Pilate. Déjà presque détachés du temple, les chrétiens devaient être bien moins effrayés que les Juifs des projets sacrilèges de Caligula. Ils étaient, d'ailleurs, trop peu nombreux pour que l'on connût à Rome leur existence. L'orage du temps de Caligula, comme celui qui aboutit à la prise de Jérusalem par Titus, passa sur leur tête, et à plusieurs égards les servit. Tout ce qui affaiblissait l'indépendance juive leur était favorable, puisque c'était autant d'enlevé au pouvoir d'une orthodoxie soupçonneuse, appuyant ses prétentions par de sévères pénalités. Cette période de paix fut féconde en développements intérieurs. L'Église naissante se divisait en trois provinces : Judée, Samarie, Galilée[9], à laquelle sans doute se rattachait Damas. Jérusalem avait sa primauté absolument incontestée. L'Eglise de cette ville, qui avait été dispersée après la mort d'Etienne, se reconstitua vite. Les apôtres n'avaient jamais quitté la ville. Les frères du Seigneur continuaient d'y résider et de jouir d'une grande autorité[10]. Il ne semble pas que cette nouvelle Église de Jérusalem ait été organisée d'une manière aussi rigoureuse que la première ; la communauté des biens n'y fui pas strictement rétablie. Seulement, on fonda une grande caisse des pauvres, où devaient être versées les aumônes que les Églises particulières envoyaient à l'Église mère, origine et source permanente de leur foi[11]. Pierre faisait de fréquents voyages apostoliques dans les environs de Jérusalem[12]. Il jouissait toujours d'une grande réputation de thaumaturge. A Lydda[13], en particulier, il passa pour avoir guéri un paralytique nommé Énée, miracle qui, dit-on, amena de nombreuses conversions dans la plaine de Saron[14]. De Lydda, il se rendit à Joppé[15], ville qui paraît avoir été un centre pour le christianisme. Des villes d'ouvriers, de marins, de pauvres gens, où les Juifs orthodoxes ne dominaient pas[16], étaient celles où la secte trouvait les meilleures dispositions. Pierre fit un long séjour à Joppé, chez un tanneur nommé Simon, qui demeurait près de la mer[17]. L'industrie du cuir était un métier presque impur ; on ne devait pas fréquenter ceux qui l'exerçaient, si bien que les corroyeurs étaient réduits à demeurer dans des quartiers à part[18]. Pierre, en choisissant un tel hôte, donnait une marque de son indifférence pour les préjugés juifs, et travaillait à cet ennoblissement des petits métiers qui est, pour une bonne part, l'ouvrage de l'esprit chrétien. L'organisation des œuvres de charité surtout se poursuivait activement. L'Église de Joppé possédait une femme admirable nommée en araméen Tabitha (gazelle), et en grec Dorcas[19], qui consacrait tous ses soins aux pauvres[20]. Elle était riche, ce semble, et distribuait son bien en aumônes. Celte respectable dame avait formé une réunion de veuves pieuses, qui passaient avec elles leurs journées[21] à tisser des habits pour les indigents. Comme le schisme du christianisme avec le judaïsme n'était pas encore consommé, il est probable que les Juifs bénéficiaient de ces actes de charité. Les saints et les veuves[22] étaient ainsi de pieuses personnes, faisant du bien à tous, des espèces de bégards et de béguines, que les seuls rigoristes d'une orthodoxie pédantesque tenaient pour suspects, des fraticelli aimés du peuple, dévots, charitables, pleins de pitié. Le germe de ces associations de femmes, qui sont une des gloires du christianisme, exista de la sorte dans les premières Eglises de Judée. A Jaffa commença la génération de ces femmes voilées, vêtues de lin, qui devaient continuer à travers les siècles la tradition des charitables secrets. Tabitha fut la mère d'une famille qui ne finira pas, tant qu'il y aura des misères à soulager et de bons instincts de femme à satisfaire. On raconta plus tard que Pierre l'avait ressuscitée. Hélas ! la mort, tout insensée, toute révoltante qu'elle est en pareil cas, est inflexible. Quand l'âme la plus exquise s'est exhalée, l'arrêt demeure irrévocable ; la femme la plus excellente ne répond pas plus que la femme vulgaire et frivole à l'invitation des voix amies qui la rappellent. Mais l'idée n'est pas assujettie aux conditions de la matière. La vertu et la bonté échappent aux prises de la mort. Tabitha n'avait pas besoin d'être ressuscitée. Pour quatre jours de plus à passer en cette triste vie, fallait-il la déranger de sa douce cl immuable éternité ? Laissez-la reposer en paix ; le jour des justes viendra. Dans ces villes très-mêlées, le problème de l'admission des païens au baptême se posait avec beaucoup d'urgence. Pierre en était fortement préoccupé. Un jour qu'il priait à Joppé, sur la terrasse de la maison du tanneur, ayant devant lui cette mer qui allait bientôt porter la foi nouvelle à tout l'Empire, il eut une extase prophétique. Dans le demi-sommeil où il était plongé, il crut éprouver une sensation de faim, et demanda quelque chose. Or, pendant qu'on le lui préparait, il vit le ciel ouvert et une nappe nouée aux quatre coins en descendre. Ayant regardé à l'intérieur de la nappe, il y vit des animaux de toute espèce, et crut entendre une voix qui lui dirait : Tue et mange. Et sur l'objection qu'il fit que plusieurs de ces animaux étaient impurs : N'appelle pas impur ce que Dieu a purifié, lui fut-il répondu. Cela, à ce qu'il paraît, se répéta par trois fois. Pierre fut persuadé que ces animaux représentaient symboliquement la masse des gentils, que Dieu lui-même venait de rendre aptes à la communion sainte du royaume de Dieu[23]. L'occasion se présenta bientôt d'appliquer ces principes. De Joppé, Pierre se rendit à Césarée. Là, il fut mis en rapport avec un centurion nommé Cornélius[24]. La garnison de Césarée était formée, en partie du moins, par une de ces cohortes composées de volontaires italiens, qu'on appelait Italicœ[25]. Le nom complet de celle-ci a pu être cohors prima Augusta Italica civium romanorum[26]. Cornélius était centurion de cette cohorte, par conséquent Italien et citoyen romain. C'était un honnête homme, qui depuis longtemps se sentait de l'attrait pour le culte monothéiste des Juifs. Il priait, faisait des aumônes, pratiquait en un mot les préceptes de religion naturelle que suppose le judaïsme ; mais il n'était pas circoncis ; ce n'était pas un prosélyte à un degré quelconque ; c'était un païen pieux, un Israélite de cœur, rien de plus[27]. Toute sa maison et quelques soldats de sa centurie étaient, dit-on, dans les mêmes dispositions[28]. Cornélius demanda à entrer dans l'Église nouvelle. Pierre, dont la nature était ouverte et bienveillante, le lui accorda, et le centurion fut baptisé[29]. Peut-être Pierre ne vit-il d'abord à cela aucune
difficulté j mais, à son retour à Jérusalem, on lui en fit de grands
reproches. Il avait violé ouvertement L'Eglise de Jérusalem était encore exclusivement composée de Juifs et de prosélytes. Le Saint-Esprit se répandant sur des incirconcis, antérieurement au baptême, parut un fait très-extraordinaire. Il est probable que dès lors existait un parti opposé en principe à l'admission des gentils, et que tout le monde n'accepta pas les explications de Pierre. L'auteur des Actes[30] veut que l'approbation ait été unanime. Mais, dans quelques années, nous verrons la question renaître avec bien plus de vivacité[31]. On accepta peut-être le fait du bon centurion, comme celui de l'eunuque éthiopien, à titre de fait exceptionnel, justifié par une révélation et un ordre exprès de Dieu. L'affaire était loin d'être décidée. Ce fut la première controverse dans le sein de l'Eglise ; le paradis de la paix intérieure avait duré six ou sept ans. Dès l'an 40 à peu près, la grande question d'où dépendait l'avenir du christianisme paraît ainsi avoir été posée. Pierre et Philippe, avec beaucoup de justesse, entrevirent la vraie solution et baptisèrent des païens. Sans doute, dans les deux récits que l'auteur des Actes nous donne à ce sujet, et qui sont en partie calqués l'un sur l'autre, il est difficile de méconnaître un système. L'auteur des Actes appartient à un parti de conciliation, favorable à l'introduction des païens dans l'Eglise, et qui ne veut pas avouer la violence des divisions que l'affaire a soulevées. On sent parfaitement qu'en écrivant les épisodes de l'eunuque, du centurion, et même de la conversion des Samaritains, cet auteur ne veut pas seulement raconter, qu'il cherche surtout des précédents à une opinion. Mais nous ne pouvons admettre, d'un autre côté, qu'il invente les faits qu'il raconte. Les conversions de l'eunuque de la candace et du centurion Cornélius sont probablement des faits réels, présentés et transformés selon les besoins de la thèse en vue de laquelle le livre des Actes a été composé. Celui qui devait, dix ou onze ans plus tard, donner à ce débat une portée si décisive, Paul, ne s'y mêlait pas encore. Il était dans le Hauran ou à Damas, prêchant, réfutant les Juifs, mettant au service de la foi nouvelle autant d'ardeur qu'il en avait montré pour la combattre. Le fanatisme, dont il avait été l'instrument, ne tarda pas à le poursuivre à son tour. Les Juifs résolurent de le perdre. Ils obtinrent de l'ethnarque qui gouvernait Damas au nom de Hâreth, un ordre de l'arrêter. Paul se cacha. On sut qu'il devait sortir de la ville ; l'ethnarque, qui voulait plaire aux Juifs, plaça des escouades aux portes pour se saisir de sa personne ; mais les frères le firent échapper de nuit en le descendant, au moyen d'un panier, par la fenêtre d'une maison qui surplombait le rempart[32]. Échappé à ce danger, Paul dirigea ses yeux vers Jérusalem. Il y avait trois ans[33] qu'il était chrétien, et il n'avait pas encore vu les apôtres. Son caractère roide, peu liant, porté à s'isoler, lui avait d'abord fait tourner le dos en quelque sorte à la grande famille dans laquelle il venait d'entrer malgré lui, et préférer pour son premier apostolat un pays nouveau, où il ne devait trouver aucun collègue. Le désir de voir Pierre, cependant, s'était éveillé en lui[34]. Il reconnaissait son autorité et le désignait, comme tout le monde, du nom de Képha la pierre. Il se rendit donc à Jérusalem, faisant en sens contraire la route qu'il avait parcourue trois ans auparavant en des dispositions si différentes. Sa position à Jérusalem fut extrêmement fausse et
embarrassée. On y avait bien entendu dire que le persécuteur était devenu le
plus zélé des évangélistes et le premier défenseur de la foi qu'il avait
voulu détruire[35].
Mais il restait contre lui de grandes préventions. Plusieurs craignaient de
sa part quelque horrible machination. On l'avait vu si enragé, si cruel, si
ardent à pénétrer dans les maisons, à déchirer le secret des familles pour
chercher des victimes, qu'on le croyait capable de jouer une odieuse comédie
pour mieux perdre ceux qu'il haïssait[36]. Il demeurait,
ce semble, dans la maison de Pierre[37]. Plusieurs des
disciples restaient sourds à ses avances et se retiraient de lui[38]. Un homme de
cœur et de volonté, Barnabé, joua à ce moment un rôle décisif. En qualité de
Chypriote et de nouveau converti, il comprenait mieux que les disciples
galiléens la position de Paul. Il vint au-devant de lui, le prit en quelque
sorte par la main, le présenta aux plus soupçonneux et se fit son garant[39]. Par cet acte de
sagesse et de pénétration, Barnabé mérita au plus haut degré du
christianisme. Ce fut lui qui devina Paul ; c'est à lui que l'Église doit le
plus extraordinaire de ses fondateurs. L'amitié féconde de ces deux hommes apostoliques,
amitié qui ne souffrit aucun nuage, malgré bien des dissentiments, amena plus
tard leur association en vue de missions chez les gentils. Cette grande
association date, en un sens, du premier séjour de Paul à Jérusalem. Parmi
les causes de la foi du monde, il faut compter le généreux mouvement de Barnabé
tendant la main à Paul suspect et délaissé, l'intuition profonde qui lui fit
découvrir une âme d'apôtre sous cet air humilié, la franchise avec laquelle
il rompit la glace et abattit les obstacles que les fâcheux antécédents du
converti, peut-être aussi certains traits de son caractère, avaient élevés
entre lui et ses frères nouveaux. Paul, du reste, évita comme systématiquement de voir les apôtres. C'est lui-même qui le dit, et il prend la peine de l'affirmer avec serment ; il ne vit que Pierre et Jacques, frère du Seigneur[40]. Son séjour ne dura que deux semaines[41]. Certes, il est possible qu'à l'époque où il écrivit l'épître aux Galates (vers 56), Paul se soit trouvé entraîné, par les besoins du moment, à fausser un peu la couleur de ses rapports avec les apôtres, à les présenter comme plus secs, plus impérieux, qu'ils ne le furent en réalité. Vers 56, il tenait essentiellement à prouver qu'il n'avait rien reçu de Jérusalem, qu'il n'était nullement le mandataire du conseil des Douze, établi dans cette ville. Son attitude, à Jérusalem, aurait été l'allure haute et altière d'un maître qui évite les rapports avec les autres maîtres, pour ne pas avoir l'air de se subordonner à eux, et non la mine humble et repentante d'un coupable honteux de son passé, comme le veut l'auteur des Actes. Nous ne pouvons croire que, dès l'an 41, Paul fut animé de cette espèce de soin jaloux de garder sa propre originalité qu'il montra plus tard. La rareté de ses entrevues avec les apôtres et la brièveté de son séjour à Jérusalem vinrent probablement de son embarras, devant des gens d'une autre nature que lui et pleins de préjugés à son égard, bien plutôt que d'une politique radinée, qui lui aurait fait voir, quinze ans d'avance, les inconvénients qu'il pouvait y avoir à les fréquenter. En réalité, ce qui devait mettre une sorte de mur cuire les apôtres et Paul, c'était surtout la différence de leur caractère et de leur éducation. Les apôtres étaient tous Galiléens ; ils n'avaient pas été aux grandes écoles juives ; ils avaient vu Jésus ; ils se souvenaient de ses paroles ; c'étaient de bonnes et pieuses natures, parfois un peu solennelles et naïves. Paul était un homme d'action, plein de feu, médiocrement mystique, enrôlé comme par une force supérieure dans une secte qui n'était nullement celle de sa première adoption. La révolte, la protestation, étaient ses sentiments habituels[42]. Son instruction juive était beaucoup plus forte que celle de tous ses nouveaux confrères. Mais, n'ayant pas entendu Jésus, n'ayant pas été institué par lui, il avait, selon les idées chrétiennes, une grande infériorité. Or, Paul n'était pas fait pour accepter une place secondaire. Son altière individualité exigeait un rôle à part. C'est probablement vers ce temps que naquit en lui l'idée bizarre qu'après tout il n'avait rien à envier à ceux qui avaient connu Jésus et avaient été choisis par lui, puisque lui aussi avait vu Jésus, avait reçu de Jésus une révélation directe et le mandat de son apostolat. Même ceux qui furent honorés d'une apparition personnelle du Christ ressuscité n'eurent rien de plus que lui. Pour avoir été la dernière, sa vision n'en avait pas été moins remarquable. Elle s'était produite dans des circonstances qui lui donnaient un cachet particulier d'importance et de distinction[43]. Erreur capitale ! L'écho de la voix de Jésus se retrouvait dans les discours du plus humble de ses disciples. Avec toute sa science juive, Paul ne pouvait suppléer à l'immense désavantage qui résultait pour lui de sa tardive initiation. Le Christ qu'il avait vu sur le chemin de Damas n'était pas, quoi qu'il dît, le Christ de Galilée ; c'était le Christ de son imagination, de son sens propre. Quoiqu'il fût attentif à recueillir les paroles du maître[44], il est clair que ce n'était ici qu'un disciple de seconde main. Si Paul eût rencontré Jésus vivant, on peut douter qu'il se fût attaché à lui. Sa doctrine sera la sienne, non celle de Jésus ; les révélations dont il est si fier sont le fruit de son cerveau. Ces idées, qu'il n'osait communiquer encore, lui rendaient le séjour de Jérusalem désagréable. Au bout de quinze jours, il prit congé de Pierre et partit. Il avait vu si peu de monde qu'il osait dire que personne dans les Églises de Judée ne connaissait son visage et ne savait quelque chose de lui autrement que par ouï-dire[45]. Plus lard, il attribua ce brusque départ à une révélation. Il racontait qu'un jour, priant dans le temple, il eut une extase, qu'il vit Jésus en personne, et reçut de lui l'ordre de quitter au plus vite Jérusalem, parce qu'on n'y était pas disposé à recevoir son témoignage. En échange de ces endurcis, Jésus lui aurait promis l'apostolat de nations lointaines et un auditoire plus docile à sa voix[46]. Quant à ceux qui voulurent effacer les traces des nombreux déchirements que l'entrée de ce disciple insoumis causa dans l'Église, ils prétendirent que Paul passa un assez long temps à Jérusalem, vivant avec les frères sur le pied de la plus complète liberté, mais que, s'étant mis à prêcher les Juifs hellénistes, il faillit être tué par eux, si bien que les frères durent veiller à sa sûreté et le faire conduire à Césarée[47]. Il est probable, en effet, que, de Jérusalem, il se rendit
à Césarée. Mais il y resta peu, et se mit à parcourir |