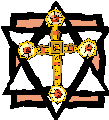LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE VII. — L'ÉGLISE CONSIDÉRÉE COMME UNE ASSOCIATION DE PAUVRES. - INSTITUTION DU DIACONAT. - LES DIACONESSES ET LES VEUVES.
|
Une vérité générale nous est révélée par l'histoire comparée des religions : toutes celles qui ont eu un commencement, et qui ne sont pas contemporaines de l'origine du langage lui-même, se sont établies par des raisons sociales bien plutôt que par des raisons théologiques. Il en fut sûrement ainsi pour le bouddhisme. Ce qui fit la fortune prodigieuse de cette religion, ce ne fut pas la philosophie nihiliste qui lui servait de base ; ce fut sa partie sociale. C'est en proclamant l'abolition des castes, en établissant, selon son expression, une loi de grâce pour tous, que Çakya-Mouni et ses disciples entraînèrent après eux l'Inde d'abord, puis la plus grande partie de l'Asie[1]. Comme le christianisme, le bouddhisme fut un mouvement de pauvres. Le grand attrait qui fit qu'on s'y précipita, fut la facilité offerte aux classes déshéritées de se réhabiliter par la profession d'un culte qui les relevait et leur offrait des ressources infinies d'assistance et de pitié. Le nombre des pauvres était, au premier siècle de notre
ère, très-considérable en Judée. Le pays est par sa nature dénué des
ressources qui procurent l'aisance. Dans ces pays sans industrie, presque
toutes les fortunes ont pour origine ou des institutions religieuses
richement dotées, ou les faveurs d'un gouvernement. Les richesses du temple
étaient depuis longtemps l'apanage exclusif d'un petit nombre de nobles. Les
Asmonéens avaient constitué autour de leur dynastie un groupe de familles
riches ; les Hérodes augmentèrent beaucoup le luxe et le bien-être dans une
certaine classe de la société. Mais le vrai Juif théocrate, tournant le dos à
la civilisation romaine, n'en devint que plus pauvre. Il se forma toute une
classe de saints hommes, pieux, fanatiques, observateurs rigides de On conçoit combien une association de secours mutuels, dans un tel état social, fut accueillie avec empressement. La petite Eglise chrétienne dut sembler un paradis. Cette famille de frères, simples et unis, attira de toutes parts des affiliés. En retour de ce qu'on apportait, on obtenait un avenir assuré, une confraternité très-douce, et de précieuses espérances. L'habitude générale était de convertir sa fortune en espèces avant d'entrer dans la secte[2]. Cette fortune consistait d'ordinaire en petites propriétés rurales peu productives et d'une exploitation incommode. Il n'y avait qu'avantage, surtout pour des gens non mariés, à échanger ces parcelles de terre contre un placement à fonds perdus dans une société d'assurance, en vue du royaume de Dieu. Quelques personnes mariées vinrent même au-devant de cet arrangement ; des précautions furent prises pour que les associés apportassent réellement tout leur avoir, et ne gardassent rien en dehors du fonds commun[3]. En effet, comme chacun recevait non en proportion de la mise qu'il avait faite, mais en proportion de ses besoins[4], toute réserve de propriété était bien un vol fait à la communauté. On voit la ressemblance surprenante de tels essais d'organisation du prolétariat avec certaines utopies qui se sont produites à une époque peu éloignée de nous. Mais une différence profonde venait de ce que le communisme chrétien avait une base religieuse, tandis que le socialisme moderne n'en a pas. Il est clair qu'une association où le dividende est en raison des besoins de chacun, et non en raison du capital apporté, ne peut reposer que sur un sentiment d'abnégation très-exalté et sur une foi ardente en un idéal religieux. Dans une telle constitution sociale, les difficultés administratives devaient être fort nombreuses, quel que fut le degré de fraternité qui régnât. Entre les deux fractions de la communauté, dont l'idiome n'était pas le même, les malentendus étaient inévitables. Il était difficile que les Juifs de race n'eussent pas un peu de dédain à l'égard de leurs coreligionnaires moins nobles. En effet, des murmures ne tardèrent pas à se faire entendre. Les hellénistes, qui devenaient chaque jour plus nombreux, se plaignaient que leurs veuves fussent moins bien traitées dans les distributions que celles des hébreux[5]. Jusque-là, les apôtres avaient préside aux soins de l'économat. Mais, en présence de telles réclamations, ils sentirent la nécessité de déléguer cette partie de leurs pouvoirs. Ils proposèrent à la communauté de confier les soins administratifs à sept hommes sages et considérés. La proposition fut acceptée. On procéda à l'élection. Les sept élus furent Stéphanus ou Etienne, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parniénas et Nicolas. Ce dernier était d'Antioche ; c'était un simple prosélyte, Etienne était peut-être de la même condition. Il semble qu'à l'inverse de ce qui s'était pratiqué dans l'élection de l'apôtre Matthia, on s'imposa de choisir les sept administrateurs, non dans le groupe des disciples primitifs, mais parmi les nouveaux convertis et surtout parmi les hellénistes. Tous, en effet, portent des noms purement grecs. Etienne était le plus considérable des sept, et en quelque sorte leur chef. On les présenta aux apôtres, qui, selon un rite déjà consacré, prièrent sur leur tête en leur imposant les mains. On donna aux administrateurs ainsi désignés le nom syriaque de Schammaschin, en grec Διάκονοι. On les appelait aussi quelquefois les Sept, pour les opposer aux Douze[6]. Telle fut donc l'origine du diaconat, qui se trouve être la plus ancienne fonction ecclésiastique, le plus ancien des ordres sacrés. Toutes les Églises organisées plus tard eurent des diacres, à l'imitation de celle de Jérusalem. La fécondité d'une telle institution fut merveilleuse. C'était le soin du pauvre élevé à l'égal d'un service religieux. C'était la proclamation de cette vérité que les questions sociales sont les premières dont on doive se préoccuper. C'était la fondation de l'économie politique en tant que chose religieuse. Les diacres furent les meilleurs prédicateurs du christianisme. Nous allons bientôt voir quel rôle ils eurent comme évangélistes. Comme organisateurs, comme économes, comme administrateurs, ils eurent un rôle bien plus important encore. Ces hommes pratiques, en contact perpétuel avec les pauvres, les malades, les femmes, pénétraient partout, voyaient tout, exhortaient et convertissaient de la manière la plus efficace[7]. Ils firent bien plus que les apôtres, immobiles à Jérusalem sur leur siège d'honneur. Ils furent les créateurs du christianisme en ce qu'il eut de plus solide et de plus durable. De très-bonne heure, des femmes furent admises à cet emploi[8]. Elles portaient, comme de nos jours, le nom de sœurs[9]. C'étaient d'abord des veuves[10] ; plus tard, on préféra des vierges pour cet office[11]. Le tact qui guida en tout ceci la primitive Église fut admirable. Ces hommes simples et bons jetèrent avec une science profonde, parce qu'elle venait du cœur, les bases de la grande chose chrétienne par excellence, la charité. Rien ne leur avait donné le modèle de telles institutions. Un vaste ministère de bienfaisance et de secours réciproques, où les deux sexes apportaient leurs qualités diverses et concertaient leurs efforts en vue du soulagement des misères humaines, voilà la sainte création qui sortit du travail de ces deux ou trois premières années. Ce furent les plus fécondes de l'histoire du christianisme. On sent que la pensée encore vivante de Jésus remplit ses disciples et les dirige en tous leurs actes avec une merveilleuse lucidité. Pour être juste, en effet, c'est à Jésus qu'il faut reporter l'honneur de ce que les apôtres firent de grand. Il est probable que, de son vivant, il avait jeté les bases des établissements qui se développèrent avec un plein succès aussitôt après sa mort. Les femmes accouraient naturellement vers une communauté où le faible était entouré de tant de garanties. Leur position dans la société d'alors était humble et précaire[12] ; la veuve surtout, malgré quelques lois protectrices, était le plus souvent abandonnée à la misère et peu respectée. Beaucoup de docteurs voulaient qu'on ne donnât à la femme aucune éducation religieuse[13]. Le Talmud met sur le même rang parmi les fléaux du monde la veuve bavarde et curieuse, qui passe sa vie en commérages chez les voisines, et la vierge qui perd son temps en prières[14]. La nouvelle religion créa à ces pauvres déshéritées un asile honorable et sûr[15]. Quelques femmes tenaient dans l'Église un rang très-considérable, et leur maison servait de lieu de réunion[16]. Quant à celles qui n'avaient pas de maison, on les constitua en une espèce d'ordre ou de corps presbytéral féminin[17], qui comprenait aussi probablement des vierges, et qui joua un rôle capital dans l'organisation de l'aumône. Les institutions qu'on regarde comme le fruit tardif du christianisme, les congrégations de femmes, les béguines, les sœurs de la charité furent une de ses premières créations, le principe de sa force, l'expression la plus parfaite de son esprit. En particulier, l'admirable idée de consacrer par une sorte de caractère religieux et d'assujettir à une discipline régulière les femmes qui ne sont pas dans les liens du mariage, est toute chrétienne. Le mot veuve devint synonyme de personne religieuse, vouée à Dieu, et par suite de diaconesse[18]. Dans ces pays, où l'épouse de vingt-quatre ans est déjà flétrie, où il n'y a pas de milieu entre l'enfant et la vieille femme, c'était comme une nouvelle vie que l'on créait pour la moitié de l'espèce humaine la plus capable de dévouement. Les temps des Séleucides avaient été une terrible époque
de débordements féminins. On ne vit jamais tant de drames domestiques, de
telles séries d'empoisonneuses et d'adultères. Les sages d'alors durent
considérer la femme comme un fléau dans l'humanité, comme un principe de
bassesse et de honte, comme un mauvais génie ayant pour rôle unique de
combattre ce qui germe de noble en l'autre sexe[19]. Le
christianisme changea les choses. A cet âge qui à nos yeux est encore la
jeunesse, mais où la vie de la femme d'Orient est si morne, si fatalement
livrée aux suggestions du mal, la veuve pouvait, en entourant sa tête d'un
châle noir[20],
devenir une personne respectable, dignement occupée, une diaconesse, l'égale
des hommes les plus estimés. Cette position si difficile de la veuve sans
enfants, le christianisme l'éleva, la rendit sainte[21]. La veuve
redevint presque l'égale de la vierge. Ce fut la calogrie
ou belle vieille[22], vénérée, utile,
traitée de mère. Ces femmes allant, venant sans cesse, étaient d'admirables
missionnaires pour le culte nouveau. Les protestants se trompent en portant
dans l'appréciation de ces faits notre esprit moderne d'individualité. Quand
il s'agit d'histoire chrétienne, c'est le socialisme, le cénobitisme, qui
sont primitifs. L'évêque, le prêtre, comme le temps les a faits, n'existaient pas encore. Mais le ministère pastoral, cette intime familiarité des âmes, en dehors des liens du sang, était déjà fondé. Ceci a toujours été le don spécial de Jésus, et comme un héritage de lui. Jésus avait souvent répété qu'il était pour chacun plus que son père, plus que sa mère, qu'il fallait pour le suivre quitter les êtres les plus chers. Au-dessus de la famille, le christianisme mettait quelque chose ; il créait la fraternité, le mariage spirituels. Le mariage antique, livrant l'épouse à l'époux sans restriction, sans contrepoids, était un véritable esclavage. La liberté morale de la femme a commencé le jour où l'Église lui a donné un confident, un guide en Jésus, qui la dirige et la console, qui toujours l'écoute, et parfois l'engage à résister. La femme a besoin d'être gouvernée, n'est heureuse que gouvernée ; mais il faut qu'elle aime celui qui la gouverne. Voilà ce que ni les sociétés anciennes, ni le judaïsme, ni l'islamisme, n'ont pu faire. La femme n'a jamais eu jusqu'ici une conscience religieuse, une individualité morale, une opinion propre que dans le christianisme. Grâce aux évêques et à la vie monastique, une Radegonde saura trouver des moyens pour échapper des bras d'un époux barbare. La vie de l'âme étant tout ce qui compte, il est juste et raisonnable que le pasteur qui sait faire vibrer les cordes divines, le conseiller secret qui tient la clef des consciences, soit plus que le père, plus que l'époux. En un sens, le christianisme fut une réaction contre la constitution trop étroite de la famille dans la race aryenne. Non-seulement les vieilles sociétés aryennes n'admettaient guère que l'homme marié, mais elles entendaient le mariage dans le sens le plus strict. C'était quelque chose d'analogue à la famille anglaise, un cercle étroit, fermé, étouffant, un égoïsme à plusieurs, aussi desséchant pour l'âme que l'égoïsme à un seul. Le christianisme, avec sa divine notion de la liberté du royaume de Dieu, corrigea ces exagérations. Et d'abord, il se garda de faire peser sur tout lé monde les devoirs du commun des hommes. Il vit que la famille n'est pas le cadre absolu de la vie, ou, du moins, un cadre fait pour tous, que le devoir de reproduire l'espèce humaine ne pèse pas sur tous, qu'il doit y avoir des personnes affranchies de ces devoirs, sacrés sans doute, mais non faits pour tous. L'exception que la société grecque fit en faveur des hétères à la façon d'Aspasie, que la société italienne fit pour la cortigiana à la manière d'Imperia, à cause des nécessités de la société polie, le christianisme la fit pour le prêtre, la religieuse, la diaconesse, en vue du bien général. Il admit des états divers dans la société. Il y a des âmes qui trouvent plus doux de s'aimer à cinq cents que de s'aimer à cinq ou six, pour lesquelles la famille dans ses conditions ordinaires paraîtrait insuffisante, froide, ennuyeuse. Pourquoi étendre à tous les exigences de nos sociétés ternes et médiocres ? La famille temporelle ne suffit pas à l'homme. Il lui faut des frères et des sœurs en dehors de la chair. Par sa hiérarchie des différentes fonctions sociales[23], l'Église primitive parut concilier un moment ces exigences opposées. Nous ne comprendrons jamais combien on fut heureux sous ces règles saintes, qui soutenaient la liberté sans l'étreindre, rendant possibles à la fois les douceurs de la vie commune et celles de la vie privée. C'était le contraire du pêle-mêle de nos sociétés artificielles et sans amour, où l'âme sensible est quelquefois si cruellement isolée. L'atmosphère était chaude et douce dans ces petits réduits qu'on appelait des Églises. On vivait ensemble de la même foi et des mêmes espérances. Mais il est clair aussi que ces conditions ne pouvaient s'appliquer à une grande société. Quand des pays entiers se firent chrétiens, la règle des premières Eglises devint une utopie et se réfugia dans les monastères. La vie monastique n'est, en ce sens, que la continuation des Eglises primitives[24]. Le couvent est la conséquence nécessaire de l'esprit chrétien ; il n'y a pas de christianisme parfait sans couvent, puisque l'idéal évangélique ne peut se réaliser que là. Une large part, assurément, doit être faite au judaïsme
dans ces grandes créations. Chacune des communautés juives dispersées sur les
côtes de Il y a une suprême injustice à opposer le christianisme au judaïsme comme un reproche, puisque tout ce qui est dans le christianisme primitif est venu en somme du judaïsme. C'est en songeant au monde romain qu'on est frappé des miracles de charité et d'association libre opérés par l'Église. Jamais société profane, ne reconnaissant pour base que la raison, n'a produit de si admirables effets. La loi de toute société profane, philosophique, si j'ose le dire, est la liberté, parfois l'égalité, jamais la fraternité. La charité, au point de vue du droit, n'a rien d'obligatoire ; elle ne regarde que les individus ; on lui trouve même certains inconvénients et on s'en défie. Toute tentative pour appliquer les deniers publics au bien-être des prolétaires semble du communisme. Quand un homme meurt de faim, quand des classes entières languissent dans la misère, la politique se borne à trouver que cela est fâcheux. Elle montre fort bien qu'il n'y a d'ordre civil et politique qu'avec la liberté ; or, la conséquence de la liberté est que celui qui n'a rien et qui ne peut rien gagner meure de faim. Cela est logique ; mais rien ne tient contre l'abus de la logique. Les besoins de la classe la plus nombreuse finissent toujours par l'emporter. Des institutions purement politiques et civiles ne suffisent pas ; les aspirations sociales et religieuses ont droit aussi à une légitime satisfaction. La gloire du peuple juif est d'avoir proclamé avec éclat
ce principe, d'où est sortie la ruine des États anciens, et qu'on ne
déracinera plus. La loi juive est sociale et non politique ; les prophètes,
les auteurs d'apocalypses sont des promoteurs de révolutions sociales, non de
révolutions politiques. Dans la première moitié du premier siècle, mis en
présence de la civilisation profane, les Juifs n'ont qu'une idée, c'est de refuser
les bienfaits du droit romain, de ce droit philosophique, athée, égal pour
tous, et de proclamer l'excellence de leur loi théocratique, qui forme une
société religieuse et morale. Mais les besoins qu'il représente dureront éternellement. La vie commune, à partir de la seconde moitié du moyen âge, ayant servi aux abus d'une Église intolérante, le monastère étant devenu trop souvent un fief féodal ou la caserne d'une milice dangereuse et fanatique, l'esprit moderne s'est montré fort sévère à l'égard du cénobitisme. Nous avons oublié que c'est dans la vie commune que l'âme de l'homme a goûté le plus de joie. Le cantique Oh ! qu'il est bon, qu'il est charmant à des frères d'habiter ensemble ![28] a cessé d'être le nôtre. Mais, quand l'individualisme moderne aura porté ses derniers fruits ; quand l'humanité, rapetissée, attristée, devenue impuissante, reviendra aux grandes institutions et aux fortes disciplines ; quand notre mesquine société bourgeoise, je dis mal, notre monde de pygmées, aura été chassé à coups de fouet par les parties héroïques et idéalistes de l'humanité, alors la vie commune reprendra tout son prix. Une foule de grandes choses, telles que la science, s'organiseront sous forme monastique, avec hérédité en dehors du sang. L'importance que notre siècle attribue à la famille diminuera. L'égoïsme, loi essentielle de la société civile, ne suffira pas aux grandes âmes. Toutes, accourant des points les plus opposés, se ligueront contre la vulgarité. On retrouvera du sens aux paroles de Jésus et aux idées du moyen âge sur la pauvreté. On comprendra que posséder quelque chose ait pu être tenu pour une infériorité, et que les fondateurs de la vie mystique aient disputé des siècles pour savoir si Jésus posséda du moins les choses qui se consomment par l'usage. Ces subtilités franciscaines redeviendront de grands problèmes sociaux. Le splendide idéal trace par l'auteur des Actes sera inscrit comme une révélation prophétique à l'entrée du paradis de l'humanité : La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et aucun d'eux ne regardait ce qu'il possédait comme lui appartenant, car ils jouissaient de tout en commun. Aussi n'y avait-il pas de pauvres parmi eux ; ceux qui avaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix aux pieds des apôtres ; puis on faisait la part de chacun selon ses besoins. Et, chaque jour, ils rompaient le pain en pleine concorde, avec joie et simplicité de cœur ![29] Ne devançons pas les temps. Nous sommes arrivés à l'an 36
à peu près. Tibère, à Caprée, ne se doute guère de l'ennemi qui croît pour
l'Empire. En deux ou trois années, la secte nouvelle avait fait des progrès
surprenants. Elle comptait plusieurs milliers de fidèles[30]. Il était déjà
facile de prévoir que ses conquêtes s'effectueraient surtout du côté des
hellénistes et des prosélytes. Le groupe galiléen qui avait entendu le
maître, tout en gardant sa primauté, était comme noyé sous un flot de
nouveaux venus, parlant grec. On pressent déjà que le rôle principal
appartiendra à ces derniers. A l'heure où nous sommes, aucun païen, c'est-à-dire
aucun homme sans lien antérieur avec le judaïsme, n'est entré dans l'Église.
Mais des prosélytes y occupent des fonctions très-importantes. Le cercle de
provenance des disciples s'est aussi fort élargi ; ce n'est plus un simple
petit collège de Palestiniens ; on y compte des gens de Chypre, d'Antioche,
de Cyrène[31],
et en général de presque tous les points des côtes orientales de |