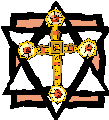LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE IV. — DESCENTE DE L'ESPRIT-SAINT. - PHÉNOMÈNES EXTATIQUES ET PROPHÉTIQUES.
|
Petits, étroits, ignorants, inexpérimentés, ils l'étaient
autant qu'on peut l'être. Leur simplicité d'esprit était extrême ; leur
crédulité n'avait pas de bornes. Mais ils avaient une qualité : ils aimaient
leur maître jusqu'à la folie. Le souvenir de Jésus était resté le mobile
unique de leur vie ; c'était une obsession perpétuelle, et il était clair
qu'ils ne vivraient jamais que de celui qui, pendant deux ou trois ans, les
avait si fortement attachés et séduits. Pour les âmes de rang secondaire, qui
ne peuvent aimer Dieu directement, c'est-à-dire trouver du vrai, créer du
beau, faire du bien par elles-mêmes, le salut est d'aimer quelqu'un en qui
luise un reflet du vrai, du beau, du bien. Le plus grand nombre des hommes a
besoin d'un culte à deux degrés. La foule des adorateurs veut un
intermédiaire entre elle et Dieu. Quand une personne a réussi à fixer autour d'elle
plusieurs autres personnes par un lien moral élevé, et qu'elle meurt, il
arrive toujours que les survivants, souvent divisés jusque-là par des
rivalités et des dissentiments, se prennent d'une grande amitié les uns pour
les autres. Mille chères images du passé qu'ils regrettent forment entre eux
comme un trésor commun. C'est une manière d'aimer le mort que d'aimer ceux
avec lesquels on l'a connu. On cherche à se trouver ensemble pour se rappeler
le temps heureux qui n'est plus. Une profonde parole de Jésus[1] se trouve alors
vraie à la lettre : le mort est présent au milieu des personnes qui sont
réunies par son souvenir. L'affection que les disciples avaient les uns pour les
autres, du vivant de Jésus, fut ainsi décuplée après sa mort. Ils formaient
une petite société fort retirée et vivaient exclusivement entre eux. Ils
étaient à Jérusalem au nombre d'environ cent vingt[2]. Leur piété était
vive, et encore toute renfermée dans les formes de la piété juive. Le temple
était leur grand lieu de dévotion[3]. Ils
travaillaient sans doute pour vivre ; mais le travail manuel, dans la société
juive d'alors, occupait très-peu. Tout le monde y avait un métier, et ce
métier n'empêchait nullement qu'on fût un homme instruit ou bien élevé. Chez
nous, les besoins matériels sont si difficiles à satisfaire, que l'homme vivant
de ses mains est obligé de travailler douze ou quinze heures par jour ;
l'homme de loisir peut seul vaquer aux choses de rame ; l'acquisition de l'instruction
est une chose rare et chère. Mais, dans ces vieilles sociétés, dont l'Orient
de nos jours donne encore une idée, dans ces climats, où la nature est si
prodigue pour l'homme et si peu exigeante, la vie du travailleur laissait
bien du loisir. Une sorte d'instruction commune mettait tout homme au courant
des idées du temps. La nourriture et le vêtement suffisaient[4] ; avec quelques
heures de travail peu suivi, on y pourvoyait. Le reste appartenait au rêve, à
la passion. La passion avait atteint dans ces âmes un degré d'énergie pour
nous inconcevable. Les Juifs de ce temps[5] nous paraissent
de vrais possédés, chacun obéissant comme un ressort aveugle à l'idée qui
s'est emparée de lui. L'idée dominante, dans la communauté chrétienne, au moment
où nous sommes, et où les apparitions ont cesse, était la venue de
l'Esprit-Saint. On croyait le recevoir sous la forme d'un souffle mystérieux
qui passait sur l'assistance. Plusieurs se figuraient que c'était le souffle
de Jésus lui-même[6].
Toute consolation intérieure, tout mouvement de courage, tout élan
d'enthousiasme, tout sentiment de gaieté vive et douce qu'on ressentait sans
savoir d'où il venait, fut l'œuvre de l'Esprit. Ces bonnes consciences
rapportaient, comme toujours, à une cause extérieure les sentiments exquis
qui naissaient en elles. C'était particulièrement dans les assemblées que ces
phénomènes bizarres d'illuminisme se produisaient. Quand tous étaient réunis,
et qu'on attendait en silence l'inspiration d'en haut, un murmure, un bruit
quelconque faisait croire à la venue de l'Esprit. Dans les premiers temps,
c'étaient les apparitions de Jésus qui se produisaient de la sorte.
Maintenant, le tour des idées avait changé. C'était l'haleine divine qui
courait sur la petite Église et la remplissait d'effluves célestes. Ces croyances se rattachaient à des conceptions tirées de l'Ancien Testament. L'esprit prophétique est montré dans les livres hébreux comme un souffle qui pénètre l'homme et l'exalte. Dans la belle vision d'Élie[7], Dieu passe sous la figure d'un vent léger, qui produit un petit bruissement. Ces vieilles images avaient amené, aux basses époques, des croyances fort analogues à celles des spirites de nos jours. Dans l'Ascension d'Isaïe[8], la venue de l'Esprit est accompagnée d'un certain froissement aux portes[9]. Plus souvent, toutefois, on concevait celte venue comme un autre baptême, savoir le baptême de l'Esprit, bien supérieur à celui de Jean[10]. Les hallucinations du tact étant très-fréquentes parmi des personnes aussi nerveuses et aussi exaltées, le moindre courant d'air, accompagné d'un frémissement au milieu du silence, était considéré comme le passage de l'Esprit. L'un croyait sentir ; bientôt tous sentaient[11], et l'enthousiasme se communiquait de proche en proche. L'analogie de ces phénomènes avec ceux que l'on retrouve chez les visionnaires de tous les temps est facile à saisir. Us se produisent journellement, en partie sous l'influence de la lecture du livre des Actes des Apôtres, dans les sectes anglaises ou américaines de quakers, jumpers, shakers, irvingiens[12], chez les Mormons[13], dans les camp-meetings et les revivals de l'Amérique[14]. On les a vus reparaître chez nous dans la secte dite des spirites. Mais une immense différence doit être faite entre des aberrations sans portée et sans avenir, et des illusions qui ont accompagné l'établissement d'un nouveau code religieux pour l'humanité. Entre toutes ces descentes de l'Esprit, qui paraissent avoir été assez
fréquentes, il y en eut une qui laissa dans l'Eglise naissante une profonde
impression[15].
Un jour que les frères étaient réunis, un orage éclata. Un vent violent
ouvrit les fenêtres ; le ciel était en feu. Les orages en ces pays sont
accompagnés d'un prodigieux dégagement de lumière ; l'atmosphère est comme
sillonnée de toutes parts de gerbes de flamme. Soit que le fluide électrique
ait pénétré dans la pièce même, soit qu'un éclair éblouissant ait subitement
illuminé la face de tous, on fut convaincu que l'Esprit était entré, et qu'il
s'était épanché sur la tête de chacun sous forme de langues de feu[16]. C'était une
opinion répandue dans les écoles théurgiques de Syrie que l'insinuation de
l'Esprit se faisait par un feu divin et sous forme de lueur mystérieuse[17]. On crut avoir
assisté à toutes les splendeurs du Sinaï[18], à une manifestation
divine analogue à celle des anciens jours. Le baptême de l'Esprit devint dès
lors aussi un baptême de feu. Le baptême de l'Esprit et du feu fut opposé et
hautement préféré au baptême de l'eau, le seul que Jean eût connu[19]. Le baptême du
feu ne se produisit que dans des occasions rares. Les apôtres seuls et les
disciples du premier cénacle furent censés l'avoir reçu. Mais l'idée que
l'Esprit s'était épanché sur eux sous la forme de pinceaux de flamme,
ressemblant à des langues ardentes, donna origine à une série d'idées
singulières, qui tinrent une grande place dans les imaginations du temps. La langue de l'homme inspiré était supposée recevoir une
sorte de sacrement. On prétendait que plusieurs prophètes, avant leur
mission, avaient été bègues[20] ; que l'ange de
Dieu avait promené sur leurs lèvres un charbon qui les purifiait et leur conférait
le don de l'éloquence[21]. Dans la
prédication, l'homme était censé ne point parler de lui-même[22]. Sa langue était
considérée comme l'organe de Il y avait en cela une pensée libérale ; on voulait dire
que l'Évangile n'a pas de langue à lui, qu'il est traduisible en tous les
idiomes, et que la traduction vaut l'original. Tel n'était pas le sentiment
du judaïsme orthodoxe. L'hébreu était pour le juif de Jérusalem la langue sainte ; aucun idiome ne
pouvait lui être comparé. Les traductions de Bientôt, du reste, le don des langues se transforma
considérablement et aboutit à des effets plus étranges. L'exaltation des
têtes amena l'extase et la prophétie. Dans ces moments d'extase, le fidèle,
saisi par l'Esprit, proférait des sons inarticulés et sans suite, qu'on
prenait pour des mots en langue étrangère, et qu'on cherchait naïvement à
interpréter[27].
D'autres fois, on croyait que l'extatique parlait des langues nouvelles et
inconnues jusque-là[28], ou même la
langue des anges[29]. Ces scènes
bizarres, qui amenèrent des abus, ne devinrent habituelles que plus tard[30]. Mais il est
probable que, dès les premières années du christianisme, elles se
produisirent. Les visions des anciens prophètes avaient souvent été accompagnées
de phénomènes d'excitation nerveuse[31]. L'état
dithyrambique des Grecs entraînait des faits du même genre ; L'histoire des sectes d'illuminés est riche en faits du
même genre. Les prédicants des Cévennes offrirent plusieurs cas de glossolalie[38]. Mais le fait le
plus frappant est celui des liseurs
suédois[39],
vers 1841-1843. Des paroles involontaires, dénuées de sens pour ceux qui les
prononçaient, et accompagnées de convulsions et d'évanouissements, furent
longtemps un exercice journalier dans cette petite secte. Cela devint tout à
fait contagieux, et un assez grand mouvement populaire s'y rattacha. Chez les
irvingiens, le phénomène des langues s'est produit avec des traits qui
reproduisent de la manière la plus frappante les récits des Actes et de saint Paul[40]. Notre siècle a
vu des scènes d'illusion du même genre qu'on ne rappellera pas ici ; car il
est toujours injuste de comparer la crédulité inséparable d'un grand
mouvement religieux à la crédulité qui n'a pour cause que la platitude
d'esprit. Ces phénomènes étranges transpiraient parfois au dehors.
Des extatiques, au moment même où ils étaient en proie à leurs illuminations
bizarres, osaient sortir et se montrer à la foule. On les prenait pour des
gens ivres[41].
Quoique sobre en fait de mysticisme, Jésus avait plus d'une fois présenté en
sa personne les phénomènes ordinaires de l'extase[42]. Les disciples,
pendant deux ou trois ans, furent obsédés de ces idées. Le prophétisme était
fréquent et considéré comme un don analogue à celui des langues[43]. La prière,
mêlée de convulsions, de modulations cadencées, de soupirs mystiques,
d'enthousiasme lyrique, de chants d'action de grâce[44], était un
exercice journalier. Une riche veine de cantiques, de psaumes,
d'hymnes, imités de ceux
de l'Ancien Testament, se trouva ainsi ouverte[45]. Tantôt la
bouche et le cœur s'accompagnaient mutuellement ; tantôt le cœur chantait
seul, accompagné intérieurement de la grâce[46]. Aucune langue
ne rendant les sensations nouvelles qui se produisaient, on se laissait aller
à un bégayement indistinct, à la fois sublime et puéril, où ce qu'on peut
appeler la langue chrétienne
flottait à l'état d'embryon. Le christianisme, ne trouvant pas dans les
langues anciennes un instrument approprié à ses besoins, les a brisées. Mais,
en attendant que la religion nouvelle se formât un idiome à son usage, il y
eut des siècles d'efforts obscurs et comme de vagissement. Le style de saint
Paul, et en général des écrivains du Nouveau Testament, qu'est-il, à sa
manière, si ce n'est l'improvisation étouffée, haletante, informe, du glossolale ? La langue leur
faisait défaut. Comme les prophètes, ils débutaient par l'a a a de l'enfant[47]. Ils ne savaient
point parler. Le grec et le sémitique les trahissaient également. De là cette
énorme violence que le christianisme naissant fit au langage. On dirait un
bègue dans la bouche duquel les sons s'étouffent, se heurtent, et aboutissent
à une pantomime confuse, mais souverainement expressive. Tout cela était bien loin du sentiment de Jésus ; mais
pour des esprits pénétrés de la croyance au surnaturel, ces phénomènes
avaient une grande importance. Le don des langues, en particulier, était
considéré comme un signe essentiel de la religion nouvelle et comme une
preuve de sa vérité[48]. En tout cas, il
en résultait de grands fruits d'édification. Plusieurs païens étaient
convertis par là[49]. Jusqu'au IIIe
siècle, la glossolalie se
manifesta d'une manière analogue à ce que décrit saint Paul, et lut considérée
comme un miracle permanent[50]. Quelques-uns
des mots sublimes du christianisme sont sortis de ces soupirs entrecoupés.
L'effet général était touchant et pénétrant. Cette façon de mettre en commun
ses inspirations et de les livrer à l'interprétation de la communauté devait
établir entre les fidèles un lien profond de fraternité. Comme tous les mystiques, les nouveaux sectaires menaient
une vie de jeune et d'austérité[51]. Comme la
plupart des Orientaux, ils mangeaient peu, ce qui contribuait à les maintenir
dans l'exaltation. La sobriété du Syrien, cause de sa faiblesse physique, le
met dans un état perpétuel de fièvre et de susceptibilité nerveuse. Nos
grands efforts continus de tête sont impossibles avec un tel régime. Mais
cette débilité cérébrale et musculaire amène, sans cause apparente, de vives
alternatives de tristesse et de joie, qui mettent l'âme en rapport continuel
avec Dieu. Ce qu'on appelait la
tristesse selon Dieu[52] passait pour un
don céleste. Toute la doctrine des Pères de la vie spirituelle, des Jean Climaque,
des Basile, des Nil, des Arsène, tous les secrets du grand art de la vie
intérieure, une des créations les plus glorieuses du christianisme, étaient
en germe dans l'étrange état d'âme que traversèrent, en leurs mois d'attente
extatique, ces ancêtres illustres de tous les hommes de désirs. Leur état moral était étrange ; ils
vivaient dans le surnaturel. Ils n'agissaient que par visions ; les rêves,
les circonstances les plus insignifiantes leur semblaient des avertissements
du ciel[53]. Sous le nom de dons du Saint-Esprit se cachaient ainsi les plus rares et les plus exquises effusions de l'âme, amour, piété, crainte respectueuse, soupirs sans objet, langueurs subites, tendresses spontanées. Tout ce qui naît de bon en l'homme, sans que l'homme y ait part, fut attribué à un souffle d'en haut. Les larmes surtout étaient tenues pour une faveur céleste. Ce don charmant, privilège des seules âmes très-bonnes et très-pures, se produisait avec des douceurs infinies. On sait quelle force les natures délicates, surtout les femmes, puisent dans la divine faculté de pouvoir pleurer beaucoup. C'est leur prière, à elles, et sûrement la plus sainte des prières. Il faut descendre jusqu'en plein moyen âge, à celle piété toute trempée de pleurs des saint Bruno, des saint Bernard, des saint François d'Assise, pour retrouver les chastes mélancolies de ces premiers jours, où l'on sema vraiment dans les larmes pour moissonner dans la joie. Pleurer devint un acte pieux ; ceux qui ne savaient ni prêcher, ni parler les langues, ni faire des miracles, pleuraient. On pleurait en priant, en prêchant, en avertissant[54] ; c'était l'avènement du règne des pleurs. On eût dit que les âmes se fondaient et voulaient, en l'absence d'un langage qui pût rendre leurs sentiments, se répandre au dehors par une expression vive et abrégée de tout leur être intérieur. |