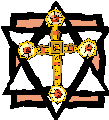LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
INTRODUCTION. — CRITIQUE DES DOCUMENTS ORIGINAUX.
|
Le premier livre de notre Histoire des Origines du christianisme a conduit les événements jusqu'à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Il faut maintenant reprendre les choses au point où nous les avons laissées, c'est-à-dire au samedi 4 avril de l'an 33. Ce sera encore durant quelque temps une sorte de continuation de la vie de Jésus. Après les mois de joyeuse ivresse, pendant lesquels le grand fondateur posa les bases d'un ordre nouveau pour l'humanité, ces années-ci furent les plus décisives dans l'histoire du monde. C'est encore Jésus qui, par le feu sacré dont il a déposé l'étincelle au cœur de quelques amis, crée des institutions de la plus haute originalité, remue, transforme les âmes, imprime à tout son cachet divin. Nous avons à montrer comment, sous celle influence toujours agissante et victorieuse de la mort, s'établit la foi à la résurrection, à l'influence du Saint-Esprit, au don des langues, au pouvoir de l'Église. Nous exposerons l'organisation de l'Église de Jérusalem, ses premières épreuves, ses premières conquêtes, les plus anciennes missions qui sortirent de son sein. Nous suivrons le christianisme dans ses progrès rapides en Syrie jusqu'à Antioche, où se forme une seconde capitale, plus importante en un sens que Jérusalem, et destinée à la supplanter. Dans ce centre nouveau, où les païens convertis forment la majorité, nous verrons le christianisme se séparer définitivement du judaïsme et recevoir un nom ; nous verrons surtout naître la grande idée des missions lointaines, destinées à porter le nom de Jésus dans le inonde des gentils. Nous nous arrêterons au moment solennel où Paul, Barnabé, Jean-Marc partent pour l'exécution de ce grand dessein. Alors, nous interromprons notre récit pour jeter un coup d'œil sur le monde que les hardis missionnaires entreprennent de convertir. Nous essayerons de nous rendre compte de l'état intellectuel, politique, moral, religieux, social de l'empire romain vers l'an 45, date probable du départ de saint Paul pour sa première mission. Tel est le sujet de ce deuxième livre, que nous intitulons les Apôtres, parce qu'il expose la période d'action commune, durant laquelle la petite famille créée par Jésus marche de concert, et est groupée, moralement autour d'un point unique, Jérusalem. Notre livre prochain, le troisième, nous fera sortir de ce cénacle, et nous montrera presque seul en scène l'homme qui représente mieux qu'aucun autre le christianisme conquérant et voyageur, saint Paul. Bien qu'il se soit donné, à partir d'une certaine époque, le titre d'apôtre, Paul ne l'était pas au même titre que les Douze[1] ; c'est un ouvrier de la deuxième heure et presque un intrus. L'état dans lequel les documents historiques nous sont parvenus nous fait ici une sorte d'illusion. Comme nous savons infiniment plus de choses sur Paul que sur les Douze, comme nous avons ses écrits authentiques et des mémoires originaux d'une grande précision sur quelques époques de sa vie, nous lui prêtons une importance de premier ordre, presque supérieure à celle de Jésus. C'est là une erreur. Paul est un très-grand homme, et il joua dans la fondation du christianisme un rôle des plus considérables. Mais il ne faut le comparer ni à Jésus, ni même aux disciples immédiats de ce dernier. Paul n'a pas vu Jésus ; il n'a pas goûté l'ambroisie de la prédication galiléenne. Or, l'homme le plus médiocre qui avait eu, sa part de la manne céleste était, par cela même, supérieur à celui qui n'en avait senti que l'arrière-goût. Rien n'est plus faux qu'une opinion devenue à la mode de nos jours, et d'après laquelle Paul serait le vrai fondateur du christianisme. Le vrai fondateur du christianisme, c'est Jésus. Les premières places ensuite doivent être réservées à ces grands et obscurs compagnons de Jésus, à ces amies passionnées et fidèles, qui crurent en lui en dépit de la mort. Paul fut, au premier siècle, un phénomène en quelque sorte isolé. Il ne laissa pas d'école organisée ; il laissa au contraire d'ardents adversaires qui voulurent, après sa mort, le bannir en quelque sorte de l'Église et le mettre sur le même pied que Simon le Magicien[2]. On lui enleva ce que nous regardons comme son œuvre propre, la conversion des gentils[3]. L'Église de Corinthe, qu'il avait fondée à lui seul[4], prétendit devoir son origine à lui et à saint Pierre[5]. Au IIe siècle, Papias et saint Justin ne prononcent pas son nom. C'est plus tard, quand la tradition orale ne fut plus rien, quand l'Écriture tint lieu de tout, que Paul prit dans la théologie chrétienne une place capitale. Paul, en effet, a une théologie. Pierre, Marie de Magdala, n'en eurent pas. Paul a laissé des ouvrages considérables ; les écrits des autres apôtres ne peuvent le disputer aux siens ni en importance ni en authenticité. Au premier coup d'œil, les documents, pour la période qu'embrasse ce volume, sont rares et tout à fait insuffisants. Les témoignages directs se réduisent aux premiers chapitres des Actes des Apôtres, chapitres dont la valeur historique donne lieu à de graves objections. Mais la lumière que projettent sur cet intervalle obscur les derniers chapitres des Évangiles et surtout les épîtres de saint Paul, dissipe quelque peu les ténèbres. Un écrit ancien peut servir à faire connaître, d'abord l'époque même où il a été composé, en second lieu l'époque qui a précédé sa composition. Tout écrit suggère, en effet, des inductions rétrospectives sur l'état de la société d'où il est sorti. Dictées de l'an 53 à l'an 62 à peu près, les épîtres de saint Paul sont pleines de renseignements pour les premières années du christianisme. Comme il s'agit ici, d'ailleurs, de grandes fondations sans dates précises, l'essentiel est de montrer les conditions dans lesquelles elles se formèrent. A ce sujet, je dois faire remarquer, une fois pour toutes, que la date courante, inscrite en tête de chaque page, n'est jamais qu'un à peu près. La chronologie de ces premières années n'a qu'un très-petit nombre de données fixes. Cependant, grâce au soin que le rédacteur des Actes a pris de ne pas intervertir la série des faits ; grâce à l'épître aux Galates, où se trouvent quelques indications numériques du plus grand prix, et à Josèphe, qui nous fournit la date d'événements de l'histoire profane liés à quelques faits concernant les apôtres, on arrive à créer pour l'histoire de ces derniers un canevas très-probable, et où les chances d'erreur flottent entre des limites assez rapprochées. Je répéterai encore, en tête de ce livre, ce que j'ai dit au commencement de ma Vie de Jésus. Dans des histoires comme celles-ci, où l'ensemble seul est certain, et où presque tous les détails prêtent plus ou moins au doute, par suite du caractère légendaire des documents, l'hypothèse est indispensable. Sur les époques dont nous ne savons rien, il n'y a pas d'hypothèses à faire. Essayer de reproduire tel groupe de la statuaire antique, qui a certainement existé, mais dont nous n'avons aucun débris, et sur lequel nous ne possédons aucun renseignement écrit, est une œuvre tout arbitraire. Mais tenter de recomposer les frontons du Parthénon avec ce qui en reste, en s'aidant des textes anciens, des dessins faits au XVIIe siècle, de tous les renseignements, en un mot, en s'inspirant du style de ces inimitables morceaux, en tâchant d'en saisir l'âme et la vie, quoi de plus légitime ? Il ne faut pas dire après cela qu'on a retrouvé l'œuvre du sculpteur antique ; mais on a fait ce qu'on pouvait pour en approcher. Un tel procéda est d'autant plus légitime en histoire que le langage permet les formes dubitatives que le marbre n'admet pas. Rien n'empêche même de proposer le choix au lecteur entre diverses suppositions. La conscience de l'écrivain doit être tranquille, dès qu'il a présenté comme certain ce qui est certain, comme probable ce qui est probable, comme possible ce qui est possible. Dans les parties où le pied glisse entre l'histoire et la légende, c'est l'effet général seul qu'il faut poursuivre. Notre troisième livre, pour lequel nous aurons des documents absolument historiques, où nous devrons peindre des caractères à vive arête et raconter des faits nettement articulés, offrira un récit plus ferme. On verra cependant qu'en somme la physionomie de celte période n'est pas connue avec plus de certitude. Les faits accomplis parlent plus haut que tous les détails biographiques. Nous savons très-peu de chose sur les artistes incomparables qui ont créé les chefs-d'œuvre de l'art grec. Mais ces chefs-d'œuvre nous en disent plus sur la personne de leurs auteurs et sur le public qui les apprécia que ne le feraient les narrations les plus circonstanciées, les textes les plus authentiques. Pour la connaissance des faits décisifs qui se passèrent
dans les premiers jours après la mort de Jésus, les documents sont les
derniers chapitres des Évangiles, contenant le récit des apparitions du
Christ ressuscité[6].
Je n'ai pas à répéter ici ce que j'ai dit dans l'introduction de ma Vie de
Jésus sur la valeur de tels documents. Pour celle partie, nous avons
heureusement un contrôle qui nous a manqué trop souvent dans Les Actes des Apôtres sont le document le plus important pour l'histoire que nous avons à raconter. Je dois m'expliquer ici sur le caractère de cet ouvrage, sur sa valeur historique et sur l'usage que j'en ai fait. Une chose hors de doute, c'est que les Actes ont eu le même auteur que le troisième Evangile et sont une continuation de cet Évangile. On ne s'arrêtera pas à prouver cette proposition, laquelle n'a jamais été sérieusement contestée[7]. Les préfaces qui sont en tête des deux écrits, la dédicace de l’un et de l'autre à Théophile, la parfaite ressemblance du style et des idées fournissent à cet égard d'abondantes démonstrations. Une deuxième proposition, qui n'a pas la même certitude, mais qu'on peut cependant regarder comme très-probable, c'est que l'auteur des Actes est un disciple de Paul, qui l'a accompagné dans une bonne partie de ses voyages. Au premier coup d'œil, cette proposition paraît indubitable. En beaucoup d'endroits, à partir du verset 10 du chapitre XVI, l'auteur des Actes se sert, dans le récit, du pronom nous, indiquant ainsi que, pour lors, il faisait partie de la troupe apostolique qui entourait Paul. Cela semble démonstratif. Une seule issue, en effet, se présente pour échapper à la force d'un tel argument, c'est de supposer que les passages où se trouve le pronom nous ont été copiés par le dernier rédacteur des Actes dans un écrit antérieur, dans des mémoires originaux d'un disciple de Paul, par exemple de Timothée, et que le rédacteur, par inadvertance, aurait oublié de substituer à nous le nom du narrateur. Cette explication est bien peu admissible. On comprendrait tout au plus une telle négligence dans une compilation grossière. Mais le troisième Évangile et les Actes forment un ouvrage très-bien rédigé, composé avec réflexion et même avec art, écrit d'une même main et d'après un plan suivi[8]. Les deux livres réunis font un ensemble absolument du même style, présentant les mêmes locutions favorites et la même façon de citer l'Écriture. Une faute de rédaction aussi choquante que celle dont il s'agit serait inexplicable. On est donc invinciblement porté à conclure que celui qui a écrit la fin de l'ouvrage en a écrit le commencement, et que le narrateur du tout est celui qui dit nous aux passages précités. Cela devient plus frappant encore, si l'on remarque dans
quelles circonstances le narrateur se met ainsi en la compagnie de Paul.
L'emploi du nous commence au moment où Paul
passe en Macédoine pour la première fois (XVI,
10). Il cesse au moment où Paul sort de Philippes. Il recommence au
moment où Paul, visitant On s'étonnera peut-être qu'une thèse en apparence si évidente ait rencontré des contradicteurs. Mais la critique des écrits du Nouveau Testament offre beaucoup de ces clartés qu'on trouve, à l'examen, pleines d'incertitudes. Sous le rapport du style, des pensées, des doctrines, les Actes ne sont guère ce qu'on attendrait d'un disciple de Paul. Ils ne ressemblent en rien aux épîtres de ce dernier. Pas une trace des fières doctrines qui font l'originalité de l'apôtre des gentils. Le tempérament de Paul est celui d'un protestant roide et personnel ; l'auteur des Actes nous fait reflet d'un bon catholique, docile, optimiste, appelant chaque prêtre un saint prêtre, chaque évêque un grand évêque, prêt à embrasser toutes les fictions plutôt que de reconnaître que ces saints prêtres, ces grands évoques se disputent et se font parfois une rude guerre. Tout en professant pour Paul une grande admiration, l'auteur des Actes évite de lui donner le titre d'apôtre[11], et il veut que l'initiative de la conversion des gentils appartienne à Pierre. On dirait, en somme, un disciple de Pierre plutôt que de Paul. Nous montrerons bientôt que, dans deux ou trois circonstances, ses principes de conciliation l'ont porté à fausser gravement la biographie de Paul ; il commet des inexactitudes[12] et surtout des omissions vraiment étranges chez un disciple de ce dernier[13]. Il ne parle pas d'une seule des épîtres ; il resserre de la façon la plus surprenante des exposés de première importance[14]. Même dans la partie où il a dû être compagnon de Paul, il est quelquefois singulièrement sec, peu informé, peu éveillé[15]. Enfin, la mollesse et le vague de certains récits, la part de convention que l'on y découvre, feraient penser à un écrivain qui n'aurait eu aucune relation directe ni indirecte avec les apôtres, et qui écrirait vers l'an 100 ou 120. Faut-il s'arrêter à ces objections ? Je ne le pense pas, et je persiste à croire que le dernier rédacteur des Actes est bien le disciple de Paul qui dit nous aux derniers chapitres. Toutes les difficultés, quelque insolubles qu'elles paraissent, doivent être, sinon écartées, du moins tenues en suspens par un argument aussi décisif que celui qui résulte de ce mot nous. Ajoutons qu'en attribuant les Actes à un compagnon de Paul, on explique deux particularités importantes : d'une part, la disproportion des parties de l'ouvrage, dont plus des trois cinquièmes sont consacrés à Paul ; de l'autre, la disproportion qui se remarque dans la biographie môme de Paul, dont la première mission est exposée avec une grande brièveté, tandis que certaines parties de la deuxième et de la troisième mission, surtout les derniers voyages, sont racontés avec de minutieux détails. Un homme tout à fait étranger à l'histoire apostolique n'aurait pas eu de ces inégalités. L'ensemble de son ouvrage eut été mieux conçu. Ce qui distingue l'histoire composée d'après des documents de l'histoire écrite en tout ou en partie d'original, c'est justement la disproportion : l'historien de cabinet prenant pour cadre de son récit les événements eux-mêmes, l'auteur de mémoires prenant pour cadre ses souvenirs ou du moins ses relations personnelles. Un historien ecclésiastique, une sorte d'Eusèbe, écrivant vers l'an 120, nous eût légué un livre tout autrement distribué à partir du chapitre XIII. La façon bizarre dont les Actes, à ce moment, sortent de l'orbite où ils tournaient jusque-là, ne s'explique, selon moi, que par la situation particulière de l'auteur et ses rapports avec Paul. Ce résultat sera naturellement confirmé si nous trouvons parmi les collaborateurs connus de Paul le nom de l'auteur auquel la tradition attribue notre écrit. C'est ce qui a lieu en effet. Les manuscrits et la tradition donnent pour auteur au troisième Evangile un certain Lucanus[16] ou Lucas. De ce qui a été dit, il résulte que, si Lucas est vraiment l'auteur du troisième Évangile, il est également l'auteur des Actes. Or, ce nom de Lucas, nous le rencontrons justement comme celui d'un compagnon de Paul, dans l'épître aux Colossiens, IV, 14 ; dans celle à Philémon, 24, et dans la deuxième à Timothée, IV, 11. Cette dernière épître est d'une authenticité plus que douteuse. Les épîtres aux Colossiens et à Philémon, de leur côté, quoique très-probablement authentiques, ne sont pourtant pas les épîtres les plus indubitables de saint Paul. Mais ces écrits sont, en tout cas, du premier siècle, et cela suffit pour prouver invinciblement que, parmi les disciples de Paul, il exista un Lucas. Le fabricateur des épîtres à Timothée, en effet, n'est sûrement pas le même que le fabricateur des épîtres aux Colossiens et à Philémon (en supposant, contrairement à notre opinion, que celles-ci soient apocryphes). Admettre qu'un faussaire eût attribué à Paul un compagnon imaginaire Serait déjà peu vraisemblable. Mais sûrement des faussaires différents ne seraient pas tombés d'accord sur le même nom. Deux observations donnent à ce raisonnement une force particulière. La première, c'est que le nom de Lucas ou Lucanus est un nom rare parmi les premiers chrétiens, et qui ne prête pas à des confusions d'homonymes ; la seconde, c'est que le Lucas des épîtres n'eut d'ailleurs aucune célébrité. Inscrire un nom célèbre en tête d'un écrit, comme on le fit pour la deuxième épître de Pierre, et très-probablement pour les épîtres de Paul à Tite et à Timothée, n'avait rien qui répugnât aux habitudes du temps. Mais inscrire en tête d'un écrit un faux nom, obscur d'ailleurs, c'est ce qui ne se conçoit plus. L'intention du faussaire était-elle de couvrir le livre de l'autorité de Paul ? Mais, alors, pourquoi ne prenait-il pas le nom de Paul lui-même, ou du moins le nom de Timothée ou de Tite, disciples bien plus connus de l'apôtre des gentils ? Luc n'avait aucune place dans la tradition, dans la légende, dans l'histoire. Les trois passages précités des épîtres ne pouvaient suffire pour faire de lui un garant admis de tous. Les épîtres à Timothée ont été probablement écrites après les Actes. Les mentions de Luc dans les épîtres aux Colossiens et à Philémon équivalent à une seule, ces deux écrits faisant corps ensemble. Nous pensons donc que l'auteur du troisième Evangile et des Actes est bien réellement Luc, disciple de Paul. Ce nom même de Luc ou Lucain, et la profession de médecin
qu'exerçait le disciple de Paul ainsi appelé[17], répondent bien
aux indications que les deux livres fournissent sur leur auteur. Nous avons
montré, en effet, que l'auteur du troisième Evangile et des Actes était
probablement de Philippes, colonie romaine, où le latin dominait[18]. De plus,
l'auteur du troisième Évangile et des Actes connaît mal le judaïsme[19] et les affaires
de Palestine[20]
; il ne sait guère l'hébreu[21] ; il est au courant
des idées du monde païen[22], et il écrit le
grec d'une façon assez correcte. L'ouvrage a été composé loin de A quelle époque peut-on rapporter la composition de cet écrit capital ? Luc paraît pour la première fois en la compagnie de Paul, lors du premier voyage de l'apôtre en Macédoine, vers l'an 52. Mettons qu'il eût alors vingt-cinq ans ; il n'y aurait rien que de naturel à ce qu'il eut vécu jusqu'à l'an 100. La narration des Actes s'arrête à l'an 63[28]. Mais, la rédaction des Actes étant évidemment postérieure à celle du troisième Évangile, et la date de la rédaction de ce troisième Évangile étant fixée d'une manière assez précise aux années qui suivirent de près la ruine de Jérusalem (an 70)[29], on ne peut songer à placer la rédaction des Actes avant l'an 71 ou 72. S'il était sur que les Actes ont été composés immédiatement après l'Évangile, il faudrait s'arrêter là. Mais le doute sur ce point est permis. Quelques faits portent à croire qu'un intervalle s'est écoulé entre la composition du troisième Évangile et celle des Actes ; on remarque, en effet, entre les derniers chapitres de l'Évangile et le premier des Actes une singulière contradiction. D'après le dernier chapitre de l'Évangile, l'ascension semble avoir lieu le jour même de la résurrection[30]. D'après le premier chapitre des Actes[31], l'ascension n'eut lieu qu'au bout de quarante jours, il est clair que cette seconde version nous présente une l'orme plus avancée de la légende, une forme qu'on adopta quand on sentit le besoin de créer de la place pour les diverses apparitions et de donner à la vie d'outre-tombe de Jésus un cadre complet et logique. On serait donc tenté de supposer que cette nouvelle façon de concevoir les choses ne parvint à l'auteur, ou ne lui vint à l'esprit, que dans l'intervalle de la rédaction des deux ouvrages. En tout cas, il reste très-remarquable que l'auteur, à quelques lignes de distance, se croie obligé d'ajouter de nouvelles circonstances à son premier récit et de le développer. Si son premier livre était encore entre ses mains, que n'y faisait-il les additions qui, séparées comme elles le sont, offrent quelque chose de si gauche ? Cela n'est cependant pas décisif, et une circonstance grave porte à croire que Luc conçut en même temps le plan de l'ensemble. C'est la préface placée en tête de l'Evangile, laquelle semble commune aux deux livres[32]. La contradiction que nous venons de signaler s'explique peut-être par le peu de souci qu'on avait de présenter un emploi rigoureux du temps. C'est là ce qui fait que tous les récits de la vie d'outre-tombe de Jésus sont dans un complet désaccord sur la durée de cette vie. On tenait si peu à être historique, que le même narrateur ne se faisait nul scrupule de proposer successivement deux systèmes inconciliables. Les trois récits de la conversion de Paul dans les Actes[33] offrent aussi de petites différences qui prouvent simplement combien l'auteur s'inquiétait peu de l'exactitude des détails. Il semble donc qu'on serait fort près de la vérité en
supposant que les Actes furent écrits vers l'an On comprend qu'un homme qui s'est mis par système dans une telle disposition d'âme est le moins capable du monde de représenter les choses comme elles se sont passées. La fidélité historique est pour lui chose indifférente ; l'édification est tout ce qui importe. Luc s'en cache à peine ; il écrit pour que Théophile reconnaisse la vérité de ce que ses catéchistes lui ont appris[38]. Il y avait donc déjà un système d'histoire ecclésiastique convenu, qui s'enseignait officiellement, et dont le cadre, aussi bien que celui de l'histoire évangélique elle-même[39], était probablement déjà fixé. Le caractère dominant des Actes, comme celui du troisième Evangile[40], est une piété tendre, une vive sympathie pour les gentils[41], un esprit conciliant, une préoccupation extrême du surnaturel, l'amour des petits et des humbles, un grand sentiment démocratique ou plutôt la persuasion que le peuple est naturellement chrétien, que ce sont les grands qui l'empêchent de suivre ses bons instincts[42], une idée exaltée du pouvoir de l'Église et de ses chefs, un goût très-remarquable pour la vie en commun[43]. Les procédés de composition sont également les mêmes dans les deux ouvrages, de telle sorte que nous sommes à l'égard de l'histoire des apôtres comme nous serions à l'égard de l'histoire évangélique, si, pour esquisser cette dernière histoire, nous n'avions qu'un seul texte, l'Évangile de Luc. On sent les désavantages d'une telle situation. La vie de Jésus dressée d'après le troisième Évangile seul serait extrêmement défectueuse et incomplète. Nous le savons, parce que, pour la vie de Jésus, la comparaison est possible. En même temps que Luc, nous possédons (sans parier du quatrième Évangile) Matthieu et Marc, qui, relativement à Luc, sont, en partie du moins, des originaux. Nous mettons le doigt sur les procédés violents au moyen desquels Luc disloque ou mêle ensemble les anecdotes, sur la façon dont il modifie la couleur de certains faits selon ses vues personnelles, sur les légendes pieuses qu'il ajoute aux traditions plus authentiques. N'est-il pas évident que, si nous pouvions faire une telle comparaison pour les Actes, nous arriverions à y trouver des fautes d'un genre analogue ? Les Actes, dans leurs premiers chapitres, nous paraîtraient môme sans doute inférieurs au troisième Evangile ; car ces chapitres ont probablement été composés avec des documents moins nombreux et moins universellement acceptés. Une distinction fondamentale, en effet, est ici nécessaire. Au point de vue de la valeur historique, le livre des Actes se divise en deux parties : l'une, comprenant les douze premiers chapitres et racontant les faits principaux de l'histoire de l'Église primitive ; l'autre contenant les seize autres chapitres, tous consacrés aux missions de saint Paul. Celte seconde partie elle-même renferme deux sortes de récits : d'une part, ceux où le narrateur se donne pour témoin oculaire ; de l'autre, ceux où il ne fait que rapporter ce qu'on lui a dit. Il est clair que, même dans ce dernier cas, son autorité est grande. Souvent, ce sont les conversations de Paul qui ont fourni les renseignements. Vers la fin surtout, le récit prend un caractère étonnant de précision. Les dernières pages des Actes sont les seules pages complètement historiques que- nous ayons sur les origines chrétiennes. Les premières, au contraire, sont les plus attaquables de tout le Nouveau Testament. C'est surtout pour ces premières années que l'auteur obéit à des partis pris semblables à ceux qui l'ont préoccupé dans la composition de son Évangile, et plus décevants encore. Son système des quarante jours, son récit de l'ascension, fermant par une sorte d'enlèvement final et de solennité théâtrale la vie fantastique de Jésus, sa façon de raconter la descente du Saint-Esprit et les prédications miraculeuses, sa manière d'entendre le don des langues, si différente de celle de saint Paul[44], décèlent les préoccupations d'une époque relativement basse, où la légende est très-mûre, arrondie en quelque sorte dans toutes ses parties. Tout se passe chez lui avec une mise en scène étrange et un grand déploiement de merveilleux. Il faut se rappeler que l'auteur écrit un demi-siècle après les événements, loin du pays où ils se sont passés, sur des faits qu'il n'a pas vus, que son maître n'a pas vus davantage, d'après des traditions en partie fabuleuses ou transfigurées. Non-seulement Luc est d'une autre génération que les premiers fondateurs du christianisme ; mais il est d'un autre monde ; il est helléniste, très-peu juif, presque étranger à Jérusalem et aux secrets de la vie juive ; il n'a pas touché la primitive société chrétienne ; à peine en a-t-il connu les derniers représentants. On sent dans les miracles qu'il raconte plutôt des inventions a priori que des faits transformés ; les miracles de Pierre et ceux de Paul forment deux séries qui se répondent[45]. Ses personnages se ressemblent ; Pierre ne diffère en rien de Paul, ni Paul de Pierre. Les discours qu'il met dans la bouche de ses héros, quoique habilement appropriés aux circonstances, sont tous du même style et appartiennent à l'auteur plutôt qu'à ceux auxquels il les attribue. On y trouve même des impossibilités[46]. Les Actes, en un mot, sont une histoire dogmatique, arrangée pour appuyer les doctrines orthodoxes du temps ou inculquer les idées qui souriaient le plus à la piété de l'auteur. Ajoutons qu'il ne pouvait en être autrement. On ne connaît l'origine de chaque religion que par les récits des croyants. Il n'y a que le sceptique qui écrive l'histoire ad narrandum. Ce ne sont pas là de simples soupçons, des conjectures d'une critique défiante à l'excès. Ce sont de solides inductions : toutes les fois qu'il nous est permis de contrôler le récit des Actes, nous le trouvons fautif et systématique. Le contrôle, en effet, que nous ne pouvons demander à des textes synoptiques, nous pouvons le demander aux épîtres de saint Paul, surtout à l'épître aux Calâtes. Il est clair que, dans les cas où les Actes et les épîtres sont en désaccord, la préférence doit toujours être donnée aux épîtres, textes d'une authenticité absolue, plus anciens, d'une sincérité complète, sans légendes. En histoire, les documents ont d'autant plus de poids qu'ils ont moins la forme historique. L'autorité de toutes les chroniques doit céder à celle d'une inscription, d'une médaille, d'une charte, d'une lettre authentiques. A ce point de vue, les épîtres d'auteurs certains ou de dates certaines sont la base de toute l'histoire des origines chrétiennes. Sans elles, on peut dire que le doute atteindrait et ruinerait de fond en comble même la vie de Jésus. Or, dans deux circonstances très-importantes, les épîtres mettent en un jour frappant les tendances particulières de l'auteur des Actes et son désir d'effacer la trace des divisions qui avaient existé entre Paul et les apôtres de Jérusalem[47]. Et d'abord, l'auteur des Actes veut que Paul, après l'accident de Damas (IX, 19 et suiv. ; XXII, 17 et suiv.), soit venu à Jérusalem, à une époque où l'on savait à peine sa conversion, qu'il ait été présenté aux apôtres, qu'il ait vécu avec les apôtres et les fidèles sur le pied de la plus grande cordialité, qu'il ait disputé publiquement contre les Juifs hellénistes, qu'un complot de ceux-ci et une révélation céleste l'aient porté à s'éloigner de Jérusalem. Or, Paul nous apprend que les choses se passèrent très-différemment. Pour prouver qu'il ne relève pas des Douze et qu'il doit à Jésus lui-même sa doctrine et sa mission, il assure (Gal., I, 11 et suiv.) qu'après sa conversion il évita de prendre conseil de qui que ce soit[48] et de se rendre à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant lui ; qu'il alla prêcher dans le Hauran de son propre mouvement et sans mission de personne ; que, trois ans plus tard, il est vrai, il accomplit Je voyage de Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas ; qu'il resta quinze jours auprès de lui, mais qu'il ne vit aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, frère du Seigneur, si bien que son visage était inconnu aux Églises de Judée. L'effort pour adoucir les aspérités du rude apôtre, pour le présenter comme le collaborateur des Douze, travaillant à Jérusalem de concert avec eux, paraît ici avec évidence. On fait de Jérusalem sa capitale et son point de départ ; on veut que sa doctrine soit tellement identique à celle des apôtres, qu'il ait pu en quelque sorte les remplacer dans la prédication ; on réduit son premier apostolat aux synagogues de Damas ; on veut qu'il ait été disciple et auditeur, ce qu'il ne fut jamais[49] ; on resserre le temps entre sa conversion et son premier voyage à Jérusalem ; on allonge son séjour dans cette ville ; on l'y fait prêcher à la satisfaction générale ; on soutient qu'il a vécu intimement avec tous les apôtres, quoique lui-même assure qu'il n'en a vu que deux ; on montre les frères de Jérusalem veillant sur lui, tandis que Paul déclare que son visage leur est inconnu. Le désir de faire de Paul un visiteur assidu de Jérusalem, qui a porté notre auteur à avancer et à allonger son premier séjour en cette ville .après sa conversion, semble l'avoir induit à prêter à l'apôtre un voyage de trop. Selon lui, Paul serait venu à Jérusalem avec Barnabé, porter l'offrande des fidèles, lors de la famine de l'an 44 (Act., XI, 30 ; XII, 25). Or, Paul déclare expressément qu'entre le voyage qui eut lieu trois ans après sa conversion et le voyage pour l'affaire de la circoncision, il ne vint pas à Jérusalem (Gal., I et II). En d'autres termes, Paul exclut formellement tout voyage entre Act., IX, 26 et Act., XV, 2. Nierait-on, contre toute raison, l'identité du voyage raconté Gal., II, 1 et suiv., avec le voyage raconté Act., XV, 2 et suiv., on n'obtiendrait pas une moindre contradiction. Trois ans après ma conversion, dit saint Paul, je montai à Jérusalem, pour faire la connaissance de Céphas, Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem... On a pu douter si le point de départ de ces quatorze ans est la conversion, ou le voyage qui l'a suivi à trois ans d'intervalle. Prenons la première hypothèse, qui est la plus favorable à celui qui veut défendre le récit des Actes. Il y aurait donc onze ans, au moins, d'après saint Paul, entre son premier et son second voyage à Jérusalem ; or, sûrement, il n'y a pas onze ans entre ce qui est raconté Act., IX, 26 et suiv. et ce qui est rapporté Act., XI, 30. Et le soutiendrait-on contre toute vraisemblance, on tomberait dans une autre impossibilité. En effet, ce qui est rapporté Act., XI, 30, est contemporain de la mort de Jacques, fils de Zébédée[50], laquelle nous fournit la seule date fixe des Actes des Apôtres, puisqu'elle précéda de très-peu de temps la mort d'Hérode Agrippa Ier, arrivée l'an 44[51]. Le second voyage de Paul ayant eu lieu au moins quatorze ans après sa conversion, si Paul avait réellement fait le voyage de l'an 44, cette conversion aurait eu lieu l'an 30, ce qui est absurde. Il est donc impossible de maintenir au voyage raconté Act., XI, 30 et XII, 35, aucune réalité. Ces allées et venues paraissent avoir été racontées par notre auteur d'une façon très-inexacte. En comparant Act., XVII, 14-16 ; XVIII, 5, à I Thess., III, 1-2, on trouve un autre désaccord. Mais, celui-ci ne tenant pas à des motifs dogmatiques, nous n'avons pas à en parler ici. Ce qui est capital pour le sujet qui nous occupe, ce qui fournit le trait de lumière à la critique en cette question difficile de la valeur historique des Actes, c'est la comparaison des passages relatifs à l'affaire de la circoncision dans les Actes (ch. XV) et dans l'épître aux Galates (ch. II). Selon les Actes, des frères de Judée étant venus à Antioche et ayant soutenu la nécessité de la circoncision pour les païens convertis, une députation composée de Paul, de Barnabé, de plusieurs autres, est envoyée d'Antioche à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens sur cette question. Ils sont reçus avec empressement partout le monde ; une grande assemblée a lieu. Le dissentiment se montre à peine, étouffé qu'il est sous les effusions d'une charité réciproque et sous le bonheur de se trouver ensemble. Pierre énonce l'avis qu'on s'attendrait à trouver dans la bouche de Paul, à savoir que les païens convertis ne sont pas assujettis à la loi de Moïse. Jacques n'apporte à cet avis qu'une très-légère restriction[52]. Paul ne parle pas, et, à vrai dire, il n'a pas besoin de parler, puisque sa doctrine est mise ici dans la bouche de Pierre. L'avis des frères de Judée n'est soutenu par personne. Un décret solennel est porté conformément à l'avis de Jacques. Ce décret est signifié aux Églises par des députés choisis exprès. Comparons maintenant le récit de Paul dans l'épître aux Galates. Paul veut que le voyage qu'il fit celte fois-là à Jérusalem ait été l'effet d'un mouvement spontané et même le résultat d'une révélation. Arrivé à Jérusalem, il communique son Evangile à qui de droit ; il a en particulier des entrevues avec ceux qui paraissent être des personnages considérables. On ne lui fait pas une seule critique ; on ne lui communique rien ; on ne lui demande que de se souvenir des pauvres de Jérusalem. Si Tite qui l'a accompagné consent à se laisser circoncire[53], c'est par égard pour des faux frères intrus. Paul leur fait cette concession passagère ; mais il ne se soumet pas à eux. Quant aux hommes importants (Paul ne parle d'eux qu'avec une nuance d'aigreur et d'ironie), ils ne lui ont rien appris de nouveau. Bien plus, Céphas étant venu plus tard à Antioche, Paul lui résiste en face, parce qu'il a tort. D'abord, en effet, Céphas mangeait avec tous indistinctement. Arrivent des émissaires de Jacques ; Pierre se cache, évite les incirconcis. Voyant qu'il ne marchait pas dans la droite voie de la vérité de l'Évangile, Paul apostrophe Céphas devant tout le monde et lui reproche amèrement sa conduite. On voit la différence. D'une part, une solennelle concorde ; de l'autre, des colères mal retenues, des susceptibilités extrêmes. D'un côté, une sorte de concile ; de l'autre, rien qui y ressemble. D'un côté, un décret formel porté par une autorité reconnue ; de l'autre, des opinions diverses qui restent en présence, sans se rien céder réciproquement, si ce n'est pour la forme. Inutile de dire quelle est la version qui mérite la préférence. Le récit des Actes est à peine vraisemblable, puisque, d'après ce récit, le concile a pour occasion une dispute dont on ne voit plus de trace dès que le concile est réuni. Les deux orateurs y tiennent des discours en opposition avec ce que nous savons par ailleurs de leur rôle. Le décret que le concile est censé avoir porté est sûrement une fiction. 8i ce décret, dont Jacques aurait fixé la rédaction, avait été réellement promulgué, pourquoi ces transes du bon et timide Pierre devant les gens envoyés par Jacques ? Pourquoi se cache-t-il ? Lui et les chrétiens d'Antioche agissaient en pleine conformité avec le décret dont les termes auraient été arrêtés par Jacques lui-même. L'affaire de la circoncision eut lieu vers 51. Quelques années après, vers l'an 56, la querelle que le décret aurait terminée est plus vive que jamais. L'Église de Galatie est troublée par de nouveaux émissaires du parti juif de Jérusalem[54]. Paul répond à cette nouvelle attaque de ses ennemis par sa foudroyante épître. Si le décret rapporté Act., XV, avait quelque réalité, Paul avait un moyen bien simple de mettre fin au débat, c'était de le citer. Or, tout ce qu'il dit suppose la non-existence de ce décret. En 57, Paul, écrivant aux Corinthiens, ignore le même décret et même en viole les prescriptions. Le décret ordonne de s'abstenir des viandes immolées aux idoles. Paul, au contraire, est d'avis qu on peut très-bien manger de ces viandes si cela ne scandalise personne, mais qu'il faut s'en abstenir dans le cas où cela ferait du scandale[55]. En 58, enfin, lors du dernier voyage de Paul à Jérusalem, Jacques est plus obstiné que jamais[56]. Un des traits caractéristiques des Actes, trait qui prouve bien que l'auteur se propose moins de présenter la vérité historique et même de satisfaire la logique que d'édifier des lecteurs pieux, est cette circonstance que la question de l’admission des incirconcis y est toujours résolue sans l'être jamais. Elle l'est d'abord par le baptême de l'eunuque de la candace, puis par le baptême du centurion Corneille, tous deux miraculeusement ordonnés, puis par la fondation de l'Eglise d'Antioche (XI, 19 et suiv.), puis par le prétendu concile de Jérusalem, ce qui n'empêche pas qu'aux dernières pages du livre (XXI, 20-21) la question est encore en suspens. A vrai dire, elle resta toujours en cet état. Les deux fractions du christianisme naissant ne se fondirent jamais. Seulement, l'une d'elles, celle qui garda les pratiques du judaïsme, resta inféconde et s'éteignit obscurément. Paul fut si loin d'être accepté de tous, qu'après sa mort une portion du christianisme[57] l'anathématise et le poursuit de ses calomnies. C'est dans notre livre troisième que nous aurons à traiter avec détail la question de fond engagée dans ces curieux incidents. Nous avons voulu seulement donner ici quelques exemples de la manière dont l'auteur des Actes entend l'histoire, de son système de conciliation, de ses idées préconçues. Faut-il conclure de là que les premiers chapitres des Actes sont dénués d'autorité, comme le pensent des critiques célèbres, que la fiction y va jusqu'à créer de toutes pièces des personnages, tels que l'eunuque de la candace, le centurion Corneille, et même le diacre Etienne et la pieuse Tabitha ? Je ne le crois nullement. Il est probable que l'auteur des Actes n'a pas inventé de personnages[58] ; mais c'est un avocat habile qui écrit pour prouver, et qui tâche de tirer parti des faits dont il a entendu parler pour démontrer ses thèses favorites, qui sont la légitimité de la vocation des gentils et l'institution divine de la hiérarchie. Un tel document demande à être employé avec de grandes précautions ; mais le repousser absolument est aussi peu critique que de le suivre aveuglément. Quelques paragraphes, d'ailleurs, même en cette première partie, ont une valeur reconnue de tous et représentent des mémoires authentiques, extraits par le dernier rédacteur. Le chapitre XII, en particulier, est de très-bon aloi, et paraît provenir de Jean-Marc. On voit dans quelle détresse nous serions, si nous n'avions pour documents en celte histoire qu'un livre aussi légendaire. Heureusement, nous en avons d'autres, qui se rapportent, il est vrai, directement à la période qui fera l'objet de notre livre troisième, mais qui répandent déjà sur celle-ci de très-grandes clartés. Ce sont les épîtres de saint Paul. L'épître aux Galates surtout est un véritable trésor, la base de toute la chronologie de cet âge, la clef qui ouvre tout, le témoignage qui doit rassurer les plus sceptiques sur la réalité des choses dont on pourrait douter, .le prie les lecteurs sérieux qui seraient tentés de me regarder comme trop hardi ou comme trop crédule de relire les deux premiers chapitres de cet écrit singulier. Ce sont, bien certainement, les deux pages les plus importantes pour l'étude du christianisme naissant. Les épîtres de saint Paul ont, en effet, un avantage sans égal en cette histoire : c'est leur authenticité absolue. Aucun doute n'a jamais été élevé par la critique sérieuse contre l'authenticité de l'épître aux Galates, des deux épîtres aux Corinthiens, de l'épître aux Romains. Les raisons par lesquelles on a voulu attaquer les deux épîtres aux Thessaloniciens et celle aux Philippiens sont sans valeur. En tête de notre livre troisième, nous aurons à discuter les objections plus spécieuses, quoique aussi peu décisives, qu'on a élevées contre l'épître aux Colossiens et le billet à Philémon ; le problème particulier que présente l'épître aux Éphésiens ; les fortes preuves, enfin, qui portent à rejeter les deux épîtres à Timothée et celle à Tite. Les épîtres dont nous aurons à faire usage en ce volume sont celles dont l'authenticité est indubitable ; ou, du moins, les inductions que nous tirerons des autres sont indépendantes de la question de savoir si elles ont été ou non dictées par saint Paul. On n'a pas à revenir ici sur les règles de critique qui
ont été suivies dans la composition de cet ouvrage ; car on l'a déjà fait
dans l'introduction de Comment, d'ailleurs, prétendre qu'on doit suivre à la lettre des documents où se trouvent des impossibilités ? Les douze premiers chapitres des Actes sont un tissu de miracles. Or, une règle absolue de la critique, c'est de ne pas donner place dans les récits historiques à des circonstances miraculeuses. Gela n'est pas la conséquence d'un système métaphysique. C'est tout simplement un fait d'observation. On n'a jamais constaté de faits de ce genre. Tous les faits prétendus miraculeux qu'on peut étudier de près se résolvent en illusion ou en imposture. Si un seul miracle était prouvé, on ne pourrait rejeter en bloc tous ceux des anciennes histoires ; car, après tout, en admettant qu'un très-grand nombre de ces derniers fussent faux, on pourrait croire que certains seraient vrais. Mais il n'en est pas ainsi. Tous les miracles discutables s'évanouissent. N'est-on pas autorisé à conclure de là que les miracles qui sont éloignés de nous par des siècles, et sur lesquels il n'y a pas moyen d'établir de débat contradictoire, sont aussi sans réalité ? En d'autres termes, il n'y a de miracle que quand on y croit ; ce qui fait le surnaturel, c'est la foi. Le catholicisme, qui prétend que la force miraculeuse n'est pas encore éteinte dans son sein, subit lui-même l'influence de cette loi. Les miracles qu'il prétend faire ne se passent pas dans les endroits où il faudrait. Quand on a un moyen si simple de se prouver, pourquoi ne pas s'en servir au grand jour ? Un miracle à Paris, devant des savants compétents, mettrait fin à tant de doutes ! Mais, hélas ! voilà ce qui n'arrive jamais. Jamais il ne s'est passé de miracle devant le public qu'il faudrait convertir, je veux dire devant des incrédules. La condition du miracle, c'est la crédulité du témoin. Aucun miracle ne s'est produit devant ceux qui auraient pu le discuter et le critiquer. H n'y a pas à cela une seule exception. Cicéron l'a dit avec son bon sens et sa finesse ordinaires : Depuis quand cette force secrète a-t-elle disparu ? Ne serait-ce pas depuis que les hommes sont devenus moins crédules ?[59] Mais, dit-on, s'il est impossible de prouver qu'il y ait jamais eu un fait surnaturel, il est impossible aussi de prouver qu'il n'y en a pas eu. Le savant positif qui nie le surnaturel procède donc aussi gratuitement que le croyant qui l'admet. Nullement. C'est à celui qui affirme une proposition de la prouver. Celui devant qui ou l'affirme n'a qu'une seule chose à faire, attendre la preuve et y céder si elle est bonne. On serait venu sommer Buffon de donner une place dans son Histoire naturelle aux sirènes et aux centaures, Buffon aurait répondu : Montrez-moi un spécimen de ces êtres, et je les admettrai ; jusque-là, ils n'existent pas pour moi. — Mais prouvez qu'ils n'existent pas. — C'est à vous de prouver qu'ils existent. La charge de faire la preuve, dans la science, pèse sur ceux qui allèguent un fait. Pourquoi ne croit-on plus aux anges, aux démons, quoique d'innombrables textes historiques en supposent l'existence ? Parce que jamais l'existence d'un ange, d'un démon ne s'est prouvée. Pour soutenir la réalité du miracle, on fait appel à des
phénomènes qu'on prétend n'avoir pu se passer selon le cours des lois de la
nature, la création de l'homme, par exemple. La
création de l'homme, dit-on, n'a pu se faire
que par une intervention directe de Sans doute, il s'est passé dans l'univers, à des époques reculées, des phénomènes qui ne se présentent plus, au moins sur la même échelle, dans l'état actuel. Mais ces phénomènes ont eu leur raison d'être à l'heure où ils se sont manifestés. On rencontre dans les formations idéologiques un grand nombre de minéraux et de pierres précieuses qui semblent ne plus se produire aujourd'hui dans la nature. Et pourtant, MM. Mitscherlich, Ebelmen, de Sénarmont, Daubrée ont recomposé artificiellement la plupart de ces minéraux et de ces pierres précieuses. S'il est douteux qu'on réussisse jamais à produire artificiellement la vie, cela tient à ce que la reproduction des circonstances où la vie commença (si elle a commencé) sera peut-être toujours au-dessus des moyens humains. Comment ramener un état de la planète disparu depuis des milliers d'années ? comment faire une expérience qui dure des siècles ? La diversité des milieux et des siècles de lente évolution, voilà ce qu'on oublie quand on appelle miracles les phénomènes qui se sont passés autrefois, et qui ne se passent plus aujourd'hui. Dans tel corps céleste, à l'heure qu'il est, il se produit peut-être des faits qui ont cessé chez nous depuis un temps infini. Certes, la formation de l'humanité est la chose du monde la plus choquante, la plus absurde, si on la suppose subite, instantanée. Elle rentre dans les analogies générales (sans cesser d'être mystérieuse), si on y voit le résultat d'un progrès lent continué durant des périodes incalculables. Il ne faut pas appliquer à la vie embryonnaire les lois de la vie de l'âge mûr. L'embryon développe, les uns après les autres, tous ses organes ; l'homme adulte, au contraire, ne se crée plus d'organes. Il ne s'en crée plus, parce qu'il n'est plus dans l'âge de créer ; de même que le langage ne s'invente plus, parce qu'il n'est plus à inventer. — Mais à quoi bon suivre des adversaires qui déplacent la question ? Nous demandons un miracle historique constaté ; on nous répond qu'avant l'histoire il a dû s'en passer. Certes, s'il fallait une preuve de la nécessité des croyances surnaturelles pour certains états de l'âme, on l'aurait dans ce fait que des esprits doués en toute autre chose de pénétration ont pu faire reposer l'édifice de leur foi sur un argument aussi désespéré. D'autres, abandonnant le miracle de l'ordre physique, se
retranchent dans le miracle d'ordre moral, sans lequel ils prétendent que ces
événements ne peuvent être expliqués. Certainement, la formation du
christianisme est le plus grand fait de l'histoire religieuse du monde. Mais
elle n'est pas un miracle pour cela. Le bouddhisme, le babisme ont eu des
martyrs aussi nombreux, aussi exaltés, aussi résignés que le christianisme.
Les miracles de la fondation de l'islamisme sont d'une tout autre nature, et
j'avoue qu'ils me touchent peu. Il faut cependant remarquer que les docteurs
musulmans font sur l'établissement de l'islamisme, sur sa diffusion comme par
une traînée de feu, sur ses rapides conquêtes, sur la force qui lui donne
partout un règne si absolu, les mêmes raisonnements que font les apologistes
chrétiens sur l'établissement du christianisme, et prétendent montrer là
clairement le doigt de Dieu. Accordons même, si l'on veut, que la fondation
du christianisme soit un fait unique. Une autre chose absolument unique,
c'est l'hellénisme, en entendant par ce mot l'idéal de perfection dans la
littérature, dans l'art, dans la philosophie, que J'espère qu'un intervalle de deux années et demie écoulées
depuis la publication de Il est des personnes pratiques, qui, à propos d'une œuvre
de science, demandent quel parti politique l'auteur s'est proposé de
satisfaire, et qui veulent qu'une œuvre de poésie renferme une leçon de
morale. Ces personnes n'admettent pas qu'on écrive pour autre chose qu'une
propagande. L'idée de l'art et de la science, n'aspirant qu'à trouver le vrai
et à réaliser le beau, en dehors de toute politique, leur est étrangère. Entre
nous et de telles personnes, les malentendus sont inévitables. Ces gens-là, comme disait un philosophe grec, prennent avec leur main gauche ce que nous leur donnons
avec notre main droite. Une foule de lettres dictées par un sentiment
honnête, que j'ai reçues, se résument ainsi : Qu'avez-vous
donc voulu ? Quel but vous êtes-vous proposé ? Eh ! mon Dieu ! le même
qu'on se propose en écrivant toute histoire. Si je disposais de plusieurs
vies, j'emploierais l'une à écrire une histoire d'Alexandre, une autre à
écrire une histoire d'Athènes, une troisième à écrire soit une histoire de Le premier principe de l'école critique, en effet, est que chacun admet en matière de foi ce qu'il a besoin d'admettre, et fait, en quelque sorte, le lit de ses croyances proportionné à sa mesure et à sa taille. Comment serions-nous assez insensés pour nous mêler de ce qui dépend de circonstances sur lesquelles personne ne peut rien ? Si quelqu'un vient à nos principes, c'est qu'il a le tour d'esprit et l'éducation nécessaires pour y venir ; tous nos efforts ne donneraient pas cette éducation et ce tour d'esprit à ceux qui ne les ont pas. La philosophie diffère de la foi en ce que la foi est censée opérer par elle-même, indépendamment de l'intelligence qu'on a des dogmes. Nous croyons, au contraire, qu'une vérité n'a de valeur que quand on y est arrivé par soi-même, quand on voit tout l'ordre d'idées auquel elle se rattache. Nous ne nous obligeons pas à taire celles de nos opinions qui ne sont pas d'accord avec la croyance d'une portion de nos semblables ; nous ne faisons aucun sacrifice aux exigences des diverses orthodoxies ; mais nous ne songeons pas davantage à les attaquer ni à les provoquer ; nous faisons comme si elles n'existaient pas. Pour moi, le jour où l'on pourrait me convaincre d'un effort pour attirer à mes idées un seul adhérent qui n'y vient pas de lui-même, on me causerait la peine la plus vive. J'en conclurais ou que mon esprit s'est laissé troubler dans sa libre et sereine allure, ou que quelque chose s'est appesanti en moi, puisque je ne suis plus capable de me contenter de la joyeuse contemplation de l'univers. Qui ne voit, d'ailleurs, que, si mon but était de faire la
guerre aux cultes établis, je devrais procéder d'une autre manière,
m'attacher uniquement à montrer les impossibilités, les contradictions des
textes et des dogmes tenus pour sacrés. Cette besogne fastidieuse a été faite
mille fois et très-bien faite. En 1836[60], j'écrivais ce
qui suit : Je proteste une fois pour toutes contre
la fausse interprétation qu'on donnerait à mes travaux, si l'on prenait comme
des œuvres de polémique les divers essais sur l'histoire des religions que
j'ai publiés, ou que je pourrai publier à l'avenir. Envisagés comme des
œuvres de polémique, ces essais, je suis le premier à le reconnaître,
seraient fort inhabiles. La polémique exige une stratégie à laquelle je suis
étranger : il faut savoir choisir le côté faible de ses adversaires, s'y
tenir, ne jamais toucher aux questions incertaines, se garder de toute
concession, c'est-à-dire renoncer à ce qui fait l'essence même de l'esprit
scientifique. Telle n'est pas ma méthode. La question fondamentale sur
laquelle doit rouler la discussion religieuse, c'est-à-dire la question de la
révélation et du surnaturel, je ne la touche jamais ; non que cette question
ne soit résolue pour moi avec une entière certitude, mais parce que la
discussion d'une telle question n'est pas scientifique, ou, pour mieux dire,
parce que la science indépendante la suppose antérieurement résolue. Certes,
si je poursuivais un but quelconque de polémique ou de prosélytisme, ce
serait là une faute capitale, ce serait transporter sur le terrain des
problèmes délicats et obscurs une question qui se laisse traiter avec plus
d'évidence dans les termes grossiers oi !i la posent d'ordinaire les controversistes
et les apologistes. Loin de regretter les avantages que je donne ainsi contre
moi-même, je m'en réjouirai, si cela peut convaincre les théologiens que mes
écrits sont d'un autre ordre que les leurs, qu'il n'y faut voir que de pures
recherches d'érudition, attaquables comme telles, où l'on essaye parfois
d'appliquer à la religion juive et à la religion chrétienne les principes de
critique qu'on suit dans les autres branches de l'histoire et de la
philologie. Quant à la discussion des questions purement théologiques, je n'y
entrerai jamais, pas plus que MM. Burnouf, Greuzer, Guigniant et tant
d'autres historiens critiques des religions de l'antiquité ne se sont crus
obligés d'entreprendre la réfutation ou l'apologie des cultes dont ils
s'occupaient. L'histoire de l'humanité est pour moi un vaste ensemble où tout
est essentiellement inégal et divers, mais où tout est du même ordre, sort
des mêmes causes, obéit aux mêmes lois. Ces lois, je les recherche sans autre
intention que de découvrir l'exacte nuance de ce qui est. Rien ne me fera
changer un rôle obscur, mais fructueux pour la science, contre le rôle de
controversiste, rôle facile en ce qu'il concilie à l'écrivain une faveur
assurée auprès des personnes qui croient devoir opposer la guerre à la
guerre. A cette polémique, dont je suis loin de contester la nécessité, mais
qui n'est ni dans mes goûts ni dans mes aptitudes, Voltaire suffit. On ne
peut être à la fois bon controversiste et bon historien. Voltaire, si faible
comme érudit, Voltaire, qui nous semble si dénué du sentiment de l'antiquité,
à nous autres qui sommes initiés à une méthode meilleure, Voltaire est vingt
fois victorieux d'adversaires encore plus dépourvus de critique qu'il ne
l'est lui-même. Une nouvelle édition des œuvres de ce grand homme satisferait
au besoin que le moment présent semble éprouver de faire une réponse aux
envahissements de la théologie ; réponse mauvaise en soi, mais accommodée à
ce qu'il s'agit de combattre ; réponse arriérée à une science arriérée.
Faisons mieux, nous tous que possèdent l'amour du vrai et la grande
curiosité. Laissons ces débats à ceux qui s'y complaisent ; travaillons pour
le petit nombre de ceux qui marchent dans la grande ligne de l'esprit humain.
La popularité, je le sais, s'attache de préférence aux écrivains qui, au lieu
de poursuivre la forme la plus élevée de la vérité, s'appliquent à lutter
contre les opinions de leur temps ; mais, par un juste retour, ils n'ont plus
de valeur dès que l'opinion qu'ils ont combattue a cessé d'être. Ceux qui ont
réfuté la magie et l'astrologie judiciaire, au XVIe et au XVIIe siècle, ont
rendu à la raison un immense service : et pourtant leurs écrits sont inconnus
aujourd'hui ; leur victoire même les a fait oublier. Je m'en tiendrai invariablement à cette règle de conduite, la seule conforme à la dignité du savant. Je sais que les recherches d'histoire religieuse touchent à des questions vives, qui semblent exiger une solution. Les personnes peu familiarisées avec la libre spéculation ne comprennent pas les calmes lenteurs de la pensée ; les esprits pratiques s'impatientent contre la science, qui ne répond pas à leurs empressements. Défendons-nous de ces vaines ardeurs. Gardons-nous de rien fonder ; restons dans des Églises respectives, profitant de leur culte séculaire et de leur tradition de vertu, participant à leurs bonnes œuvres et jouissant de la poésie de leur passé. Ne repoussons que leur intolérance. Pardonnons même à cette intolérance ; car elle est, comme l'égoïsme, une des nécessités de la nature humaine. Supposer qu'il se fonde désormais de nouvelles familles religieuses ou que la proportion entre celles qui existent aujourd'hui arrive à changer beaucoup, c'est aller contre les apparences. Le catholicisme sera bientôt travaillé par de grands schismes ; les temps d'Avignon, des antipapes, des clémentins et des urbanistes, vont revenir. L'Église catholique va refaire son XIVe siècle ; mais, malgré ses divisions, elle restera l'Église catholique. Il est probable que dans cent ans la relation entre le nombre des protestants, celui des catholiques, celui des juifs n'aura pas sensiblement varié. Mais un grand changement se sera accompli, ou plutôt sera devenu sensible aux yeux de tous. Chacune de ces familles religieuses aura deux sortes de fidèles, les uns croyants absolus comme au moyen âge, les autres sacrifiant la lettre et ne tenant qu'à l'esprit. Cette seconde fraction grandira dans chaque communion, et, comme l'esprit rapproche autant que la lettre divise, les spiritualistes de chaque communion arriveront à se rapprocher tellement qu'ils négligeront de se réunir tout à fait. Le fanatisme se perdra dans une tolérance générale. Le dogme deviendra une arche mystérieuse, que l'on conviendra de n'ouvrir jamais. Si l'arche est vide, alors, qu'importe ? Une seule religion résistera, je le crains, à cet amollissement dogmatique ; c'est l'islamisme. Il y a chez certains musulmans des anciennes écoles et chez quelques hommes éminents de Constantinople, il y a en Perse surtout des germes d'esprit large et conciliant. Si ces bons germes sont étouffés par le fanatisme des ulémas, l'islamisme périra ; car deux choses sont évidentes : la première, c'est que la civilisation moderne ne désire pas que les anciens cultes meurent tout à. fait ; la seconde, c'est qu'elle ne souffrira pas d'être entravée dans son œuvre par les vieilles institutions religieuses. Celles-ci ont le choix entre fléchir ou mourir. Quant à la religion pure, dont la prétention est justement
de ne pas être une secte ni une Église à part, pourquoi se donnerait-elle les
inconvénients d'une position dont elle n'a pas les avantages ? pourquoi
élèverait-elle drapeau contre drapeau, quand elle sait que le salut est
possible à tous et partout, qu'il dépend du degré de noblesse que chacun
porte en soi ? On comprend que le protestantisme, au XVIe siècle, ait été
amené à une rupture ouverte. Le protestantisme partait d'une foi
très-absolue. Loin de correspondre à un affaiblissement du dogmatisme, Sans doute, il est des positions où l'application de ces principes est difficile. L'esprit souffle où il veut ; l'esprit, c'est la liberté. Or, il est des personnes rivées en quelque sorte à la foi absolue ; je veux parler des hommes engagés dans les ordres sacrés ou revêtus d'un ministère pastoral. Même alors, une belle âme sait trouver des issues. Un digne prêtre de campagne arrive, par ses études solitaires et par la pureté de sa vie, à voir les impossibilités du dogmatisme littéral ; faut-il qu'il contriste ceux qu'il a consolés jusque-là, qu'il explique aux simples des changements que ceux-ci ne peuvent bien comprendre ? A Dieu ne plaise ! Il n'y a pas deux hommes au monde qui aient juste les mêmes devoirs. Le bon évêque Colenso a fait un acte d'honnêteté comme l'Église n'en a pas vu depuis son origine en écrivant ses doutes dès qu'ils lui sont venus. Mais l'humble prêtre catholique, en un pays d'esprit étroit et timide, doit se taire. Oh ! que de tombes discrètes, autour des églises de village, cachent ainsi de poétiques réserves, d'angéliques silences ? Ceux dont le devoir a été de parler égaleront-ils le mérite de ces secrets connus de Dieu seul ? La théorie n'est pas la pratique. L'idéal doit rester l'idéal
; il doit craindre de se souiller au contact de la réalité. Des pensées
bonnes pour ceux qui sont préservés par leur noblesse de tout danger moral
peuvent, si on les applique, n'être pas sans inconvénient pour ceux qui sont
entachés de bassesse. On ne fait de grandes choses qu'avec des idées
strictement arrêtées ; car la capacité humaine est chose limitée ; l'homme
absolument sans préjuge serait impuissant. Jouissons de la liberté des fils
de Dieu ; mais prenons garde d'être complices de la diminution de vertu qui
menacerait nos sociétés, si le christianisme venait à s'affaiblir. Que
serions-nous sans lui ? Qui remplacera ces grandes écoles de sérieux et de
respect telles que Saint-Sulpice, ce ministère de dévouement des Filles de Paix donc, au nom de Dieu ! Que les divers ordres de
l'humanité vivent côte à côte, non en faussant leur génie propre pour se
faire des concessions réciproques, qui les amoindriraient, mais en se
supportant mutuellement. Rien ne doit régner ici-bas à l'exclusion de son
contraire ; aucune force ne doit pouvoir supprimer les autres. L'harmonie de
l'humanité résulte de la libre émission des notes les plus discordantes. Que
l'orthodoxie réussisse à tuer la science, nous savons ce qui arrivera ; le
monde musulman et l'Espagne meurent pour avoir trop consciencieusement
accompli cette tâche. Que le rationalisme veuille gouverner le monde sans
égard pour les besoins religieux de l'âme, l'expérience de |