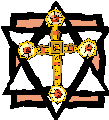LA VIE DE
CHAPITRE VIII.
Jésus à Capharnaüm.
|
Obsédé d’une idée de plus en plus impérieuse et exclusive, Jésus marchera désormais avec une sorte d’impassibilité fatale dans la voie que lui avaient tracée son étonnant génie et les circonstances extraordinaires où il vivait. Jusque-là il n’avait fait que communiquer ses pensées à quelques personnes secrètement attirées vers lui ; désormais son enseignement devient public et suivi. Il avait à peu près trente ans[1]. Le petit groupe d’auditeurs qui l’avait accompagné près de Jean-Baptiste s’était grossi sans doute, et peut-être quelques disciples de Jean s’étaient-ils joints à lui[2]. C’est avec ce premier noyau d’Église qu’il annonce hardiment, dès son retour en Galilée, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce royaume allait venir, et c’était lui, Jésus, qui était ce Fils de l’homme que Daniel en sa vision avait aperçu comme l’appariteur divin de la dernière et suprême révélation. Il faut se rappeler que, dans les idées juives, antipathiques à l’art et à la mythologie, la simple forme de l’homme avait une supériorité sur celle des chérubs et des animaux fantastiques que l’imagination du peuple, depuis qu’elle avait subi l’influence de l’Assyrie, supposait rangés autour de la divine majesté. Déjà dans Ézéchiel[3], l’être assis sur le trône suprême, bien au-dessus des monstres du char mystérieux, le grand révélateur des visions prophétiques a la figure d’un homme. Dans le Livre de Daniel, au milieu de la vision des empires représentés par des animaux, au moment où la séance du grand jugement commence et où les livres sont ouverts, un être semblable à un fils de l’homme s’avance vers l’Ancien des jours, qui lui confère le pouvoir de juger le monde, et de le gouverner pour l’éternité[4]. Fils de l’homme est dans les langues sémitiques, surtout dans les dialectes araméens, un simple synonyme d’homme. Mais ce passage capital de Daniel frappa les esprits ; le mot de fils de l’homme devint, au moins dans certaines écoles[5], un des titres du Messie envisagé comme juge du monde et comme roi de l’ère nouvelle qui allait s’ouvrir[6]. L’application que s’en faisait Jésus à lui-même était donc la proclamation de sa messianité et l’affirmation de la prochaine catastrophe où il devait figurer en juge, revêtu des pleins pouvoirs que lui avait délégués l’Ancien des jours[7]. Le succès de la parole du nouveau prophète fut cette fois décisif. Un groupe d’hommes et de femmes, tous caractérisés par un même esprit de candeur juvénile et de naïve innocence, adhérèrent à lui et lui dirent : Tu es le Messie. Comme le Messie devait être fils de David, on lui décernait naturellement ce titre, qui était synonyme du premier. Jésus se le laissait donner avec plaisir, quoiqu’il lui causât quelque embarras, sa naissance étant toute populaire. Pour lui, le titre qu’il préférait était celui de Fils de l’homme, titre humble en apparence, mais qui se rattachait directement aux espérances messianiques. C’est par ce mot qu’il se désignait[8]. Si bien que dans sa bouche, le Fils de l’homme était synonyme du pronom je, dont il évitait de se servir. Mais on ne l’apostrophait jamais ainsi, sans doute parce que le nom dont il s’agit ne devait pleinement lui convenir qu’au jour de sa future apparition. Le centre d’action de Jésus, à cette époque de sa vie, fut la petite ville de Capharnaüm, située sur le bord du lac de Génésareth. Le nom de Capharnaüm, où entre le mot caphar, village, semble désigner une bourgade à l’ancienne manière, par opposition aux grandes villes bâties selon la mode romaine, comme Tibériade[9]. Ce nom avait si peu de notoriété, que Josèphe, à un endroit de ses écrits[10], le prend pour le nom d’une fontaine, la fontaine ayant plus de célébrité que le village situé près d’elle. Comme Nazareth, Capharnaüm était sans passé, et n’avait en rien participé au mouvement profane favorisé par les Hérodes. Jésus s’attacha beaucoup à cette ville et s’en fit comme une seconde patrie[11]. Peu après son retour, il avait dirigé sur Nazareth une tentative qui n’eut aucun succès[12]. Il n’y put faire aucun miracle, selon la naïve remarque d’un de ses biographes[13]. La connaissance qu’on avait de sa famille, laquelle était peu considérable, nuisait trop à son autorité. On ne pouvait regarder comme le fils de David celui dont on voyait tous les jours le frère, la sœur, le beau-frère. Il est remarquable, du reste, que sa famille lui fit une assez vive opposition, et refusa nettement de croire à sa mission[14]. Les Nazaréens, bien plus violents, voulurent, dit-on, le tuer en le précipitant d’un sommet escarpé[15]. Jésus remarqua avec esprit que cette aventure lui était commune avec tous les grands hommes, et il se fit l’application du proverbe : Nul n’est prophète en son pays. Cet échec fut loin de le décourager. Il revint à Capharnahum[16], où il trouvait des dispositions beaucoup meilleures, et de là il organisa une série de missions sur les petites villes environnantes. Les populations de ce beau et fertile pays n’étaient guère réunies que le samedi. Ce fut le jour qu’il choisit pour ses enseignements. Chaque ville avait alors sa synagogue ou lieu de séance. C’était une salle rectangulaire, assez petite, avec un portique, que l’on décorait des ordres grecs. Les Juifs, n’ayant pas d’architecture propre, n’ont jamais tenu à donner à ces édifices un style original. Les restes de plusieurs anciennes synagogues existent encore en Galilée[17]. Elles sont toutes construites en grands et bons
matériaux ; mais leur style est assez mesquin par suite de cette
profusion d’ornements végétaux, de rinceaux, de torsades, qui caractérise les
monuments juifs[18].
A l’intérieur, il y avait des bancs, une chaire pour la lecture publique, une
armoire pour renfermer les rouleaux sacrés[19]. Ces édifices,
qui n’avaient rien du temple, étaient le centre de toute la vie juive. On s’y
réunissait le jour du sabbat pour la prière et pour la lecture de Avec l’extrême activité d’esprit qui a toujours caractérisé les Juifs, une telle institution, malgré les rigueurs arbitraires qu’elle comportait, ne pouvait manquer de donner lieu à des discussions très animées. Grâce aux synagogues, le judaïsme put traverser intact dix-huit siècles de persécution. C’étaient comme autant de petits mondes à part, où l’esprit national se conservait et qui offraient aux luttes intestines des champs tout préparés. Il s’y dépensait une somme énorme de passion. Les querelles de préséance y étaient vives. Avoir un fauteuil d’honneur au premier rang était la récompense d’une haute piété, ou le privilège de la richesse qu’on enviait le plus[24]. D’un autre côté, la liberté, laissée à qui la voulait prendre, de s’instituer lecteur et commentateur du texte sacré donnait des facilités merveilleuses pour la propagation des nouveautés. Ce fut là une des grandes forces de Jésus et le moyen le plus habituel qu’il employa pour fonder son enseignement doctrinal[25]. Il entrait dans la synagogue, se levait pour lire ; le hazzan lui tendait le livre, il le déroulait, et lisant la parascha ou la haphtara du jour, il tirait de cette lecture quelque développement conforme à ses idées[26]. Comme il y avait peu de pharisiens en Galilée, la discussion contre lui ne prenait pas ce degré de vivacité et ce ton d’acrimonie qui, à Jérusalem, l’eussent arrêté court dès ses premiers pas. Ces bons Galiléens n’avaient jamais entendu une parole aussi accommodée à leur imagination riante[27]. On l’admirait, on le choyait, on trouvait qu’il parlait bien et que ses raisons étaient convaincantes. Les objections les plus difficiles, il les résolvait avec assurance ; le charme de sa parole et de sa personne captivait ces populations encore jeunes, que le pédantisme des docteurs n’avait pas desséchées. L’autorité du jeune maître allait ainsi tous les jours grandissant, et, naturellement, plus on croyait en lui, plus il croyait en lui-même. Son action était fort restreinte. Elle était toute bornée au bassin du lac de Tibériade, et même dans ce bassin elle avait une région préférée. Le lac a cinq ou six lieues de long sur trois ou quatre de large ; quoique offrant l’apparence d’un ovale assez régulier, il forme, à partir de Tibériade jusqu’à l’entrée du Jourdain, une sorte de golfe, dont la courbe mesure environ trois lieues. Voilà le champ où la semence de Jésus trouva enfin la terre bien préparée. Parcourons-le pas à pas, en essayant de soulever le manteau de sécheresse et de deuil dont l’a couvert le démon de l’islam. En sortant de Tibériade, ce sont d’abord des rochers escarpés, une montagne qui semble s’écrouler dans la mer. Puis les montagnes s’écartent ; une plaine (El-Ghoueir) s’ouvre presque au niveau du lac. C’est un délicieux bosquet de haute verdure, sillonné par d’abondantes eaux qui sortent en partie d’un grand bassin rond, de construction antique (Aïn-Medawara). A l’entrée de cette plaine, qui est le pays de Génésareth proprement dit, se trouve le misérable village de Medjdel. A l’autre extrémité de la plaine (toujours en suivant la mer), on rencontre un emplacement de ville (Khan-Minyeh), de très belles eaux (Aïn-et-Tin), un joli chemin, étroit et profond, taillé dans le roc, que certainement Jésus a souvent suivi, et qui sert de passage entre la plaine de Génésareth et le talus septentrional du lac. A un quart d’heure de là, on traverse une petite rivière d’eau salée (Aïn-Tabiga), sortant de terre par plusieurs larges sources à quelques pas du lac, et s’y jetant au milieu d’un épais fourré de verdure. Enfin, à quarante minutes plus loin, sur la pente aride qui s’étend d’Aïn-Tabiga à l’embouchure du Jourdain, on trouve quelques huttes et un ensemble de ruines assez monumentales, nommés Tell-Hum. Cinq petites villes, dont l’humanité parlera éternellement autant que de Rome et d’Athènes, étaient, du temps de Jésus, disséminées dans l’espace qui s’étend du village de Medjdel à Tell-Hum. De ces cinq villes, Magdala, Dalmanutha, Capharnahum, Bethsaïde, Chorazin[28], la première seule se laisse retrouver aujourd’hui avec certitude. L’affreux village de Medjdel a sans doute conservé le nom et la place de la bourgade qui donna à Jésus sa plus fidèle amie[29]. Dalmanutha était probablement près de là[30]. Il n’est pas impossible que Chorazin fût un peu dans les terres, du côté du nord[31]. Quant à Bethsaïde et Capharnahum, c’est en vérité presque au hasard qu’on les place à Tell-Hum, à Aïn-et-Tin, à Khan-Minyeh, à Aïn-Medawara[32]. On dirait qu’en topographie, comme en histoire, un dessein profond ait voulu cacher les traces du grand fondateur. Il est douteux qu’on arrive jamais, sur ce sol profondément dévasté, à fixer les places où l’humanité voudrait venir baiser l’empreinte de ses pieds. Le lac, l’horizon, les arbustes, les fleurs, voilà donc
tout ce qui reste du petit canton de trois ou quatre lieues où Jésus fonda
son œuvre divine. Les arbres ont totalement disparu. Dans ce pays, où la
végétation était autrefois si brillante que Josèphe y voyait une sorte de
miracle, la nature, suivant lui, s’étant plu à rapprocher ici côte à côte les
plantes des pays froids, les productions des zones brûlantes, les arbres des
climats moyens, chargés toute l’année de fleurs et de fruits[33] ; dans ce
pays, dis-je, on calcule maintenant un jour d’avance l’endroit où l’on
trouvera le lendemain un peu d’ombre pour son repas. Le lac est devenu
désert. Une seule barque, dans le plus misérable état, sillonne aujourd’hui
ces flots jadis si riches de vie et de joie. Mais les eaux sont toujours
légère et transparentes[34]. La grève,
composée de rochers ou de galets, est bien celle d’une petite mer, non celle
d’un étang, comme les bords du lac Huleh. Elle est nette, propre, sans vase,
toujours battue au même endroit par le léger mouvement des flots. De petits
promontoires, couverts de lauriers roses, de tamaris et de câpriers épineux,
s’y dessinent ; à deux endroits surtout, à la sortie du Jourdain, près
de Tarichée, et au bord de la plaine de Génésareth, il y a d’enivrants
parterres, où les vagues viennent s’éteindre en des massifs de gazon et de
fleurs. Le ruisseau d’Aïn-Tabiga fait un petit estuaire, plein de jolis coquillages.
Des nuées d’oiseaux nageurs couvrent le lac. L’horizon est éblouissant de
lumière. Les eaux, d’un azur céleste, profondément encaissées entre des
roches brûlantes, semblent, quand on les regarde du haut des montagnes de
Safed, occuper le fond d’une coupe d’or. Au nord, les ravins neigeux de
l’Hermon se découpent en lignes blanches sur le ciel; à l’ouest, les hauts
plateaux ondulés de La chaleur sur les bords est maintenant très pesante. Le
lac occupe une dépression de deux cents mètres au-dessous du niveau de la
Méditerranée[35],
et participe ainsi des conditions torrides de la mer Morte[36]. Une végétation
abondante tempérait autrefois Ces ardeurs excessives; on comprendrait difficilement
qu’une fournaise comme est aujourd’hui tout le bassin du lac, à partir du
mois de mai, eût jamais été le théâtre d’une prodigieuse activité. Josèphe,
d’ailleurs, trouve le pays fort tempéré[37]. Sans doute il y
a eu ici, comme dans la campagne de Rome, quelque changement de climat, amené
par des causes historiques. C’est l’islamisme, et surtout la réaction musulmane
contre les croisades, qui ont desséché, à la façon d’un vent de mort, le
canton préféré de Jésus. La belle terre de Génésareth ne se doutait pas que
sous le front de ce pacifique promeneur s’agitaient ses destinées. Dangereux
compatriote, Jésus a été fatal au pays qui eut le redoutable honneur de le
porter. Devenue pour tous un objet d’amour ou de haine, convoitée par deux
fanatismes rivaux, Quatre ou cinq gros villages, situés à une demi-heure l’un de l’autre, voilà donc le petit monde de Jésus à l’époque où nous sommes. Il ne semble pas être jamais entré à Tibériade, ville toute profane, peuplée en grande partie de païens et résidence habituelle d’Antipas[38]. Quelquefois, cependant, il s’écartait de sa région favorite. Il allait en barque sur la rive orientale, à Gergésa par exemple[39]. Vers le nord, on le voit à Panéas ou Césarée de Philippe[40], au pied de l’Hermon. Une fois, enfin, il fait une course du côté de Tyr et de Sidon[41], pays qui devait être alors merveilleusement florissant. Dans toutes ces contrées, il était en plein paganisme[42]. A Césarée, il vit la célèbre grotte du Panium, où l’on plaçait la source du Jourdain, et que la croyance populaire entourait d’étranges légendes[43] ; il put admirer le temple de marbre qu’Hérode fit élever près de là en l’honneur d’Auguste[44] ; il s’arrêta probablement devant les nombreuses statues votives à Pan, aux Nymphes, à l’Écho de la grotte, que la piété entassait déjà en ce bel endroit[45]. Un juif évhémériste, habitué à prendre les dieux étrangers pour des hommes divinisés ou pour des démons, devait considérer toutes ces représentations figurées comme des idoles. Les séductions des cultes naturalistes, qui enivraient les races plus sensitives, le laissèrent froid. Il n’eut sans doute aucune connaissance de ce que le vieux sanctuaire de Melkarth, à Tyr, pouvait renfermer encore d’un culte primitif plus ou moins analogue à celui des Juifs[46]. Le paganisme, qui, en Phénicie, avait élevé sur chaque colline un temple et un bois sacré, tout cet aspect de grande industrie et de richesse profane[47], durent peu lui sourire. Le monothéisme enlève toute aptitude à comprendre les religions païennes ; le musulman jeté dans les pays polythéistes semble n’avoir pas d’yeux. Jésus sans contredit n’apprit rien dans ces voyages. Il revenait toujours à sa rive bien-aimée de Génésareth. Le centre de ses pensées était là ; là il trouvait foi et amour. |