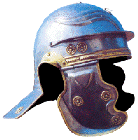|
Chapitre IX — Guerre Civile - Campagne d’Italie (49 av. Jésus-Christ)
I. Guerre civile. — II. César s’empare de l’Italie. — III. Observations.
I. Le 6 janvier (c’est-à-dire le 26 octobre
de notre calendrier), le sénat porta le décret que les consuls, les
préteurs, les tribuns du peuple et les proconsuls qui étaient près de Rome
veilleraient à ce qu’il ne fût fait aucun tort à la République. Lentulus
était consul ; Antoine et Cassius étaient tribuns. Après la publication de ce
décret, les citoyens prirent l’habit de guerre ; les consuls firent des
levées de troupes pour créer une armée à Pompée, qui avait déjà deux légions
en Italie. Il en avait six autres en Espagne ; il leur donna l’ordre de se
rendre à Rome. Mais César, instruit de toutes ces circonstances à Ravenne, où
il était, quoiqu’il n’eut auprès de lui que la 13e légion, prit
son parti : il la harangua, la trouvai dévouée à ses intérêts, partit
sur-le-champ, passa le Rubicon, petit ruisseau qui forme la limite de la
province des Gaules ; il surprit Rimini, où les tribuns du peuple Antoine et
Cassius, qui étaient sauvés de Rome, vinrent lui demander refuge dans son
camp. En passant le Rubicon. César avait déclaré la guerre civile et bravé
les anathèmes prononcés contre les généraux qui passeraient en armes le
Rubicon : ils étaient voués aux dieux infernaux. Pompée abandonna Rome et se
retira à Capoue, à cinquante lieues de là, quoiqu’il eût alors deux légions
et 30.000 hommes près de Rome ; il y fut rejoint par le sénat et les
principales autorités de la République. César laissa en Gaule trois légions
pour observer les Pyrénées, et se fit rejoindre par les six autres. Il s’empara
de Pesaro, de Fano, d’Andine et d’Urbino ; il envoya Antoine à Arezzo avec
cinq cohortes pour intercepter la route de l’Étrurie. Tous les peuples
étaient bien disposés pour lui ; Osimo, Ascoli ouvrirent leurs portes. Le
consul Lentulus, à ces nouvelles, évacua Rome et rejoignit Pompée.
Domitius Ahenobarbus avait pris position à Corfinium avec
trente cohortes. César campa sous les murs de cette ville, qui est située à l’embranchement
de plusieurs routes et à 6 milles de la ville actuelle de Sulmona. Il était
urgent que Pompée, qui était à Capoue, secourût cette importante place ; mais
il ne voulut pas se commettre avec une armée nouvelle contre les vieilles
bandes des Gaules. Aussitôt que la garnison fut instruite qu’elle était
abandonnée, elle se souleva, arrêta Domitius et se rangea du parti de César.
A cette nouvelle, Pompée résolut d’abandonner l’Italie ; il se retira à
Brindes. Les consuls, avec une partie de l’armée, s’embarquèrent,
traversèrent l’Adriatique et débarquèrent à Dyrrachium, en Épire. César investit
Brindes avec six légions ; il fit construire une digue pour fermer le pont,
et, dans l’endroit où les eaux étaient trop hautes, il établit des radeaux
amarrés par des ancres et couverts e terre pour garantir ses troupes ; mais,
le neuvième jour que ce grand travail était commencé, les régiments de Pompée
arrivèrent : il embarqua avec ses vingt cohortes et rejoignit son armée en
Épire. Ainsi, dans les premiers jours de mars, trois mois après avoir passé
le Rubicon. César se trouvait maître de toute l’Italie. La promptitude de sa
marche, l’hésitation de Pompée, sont un contraste. Les légions d’Espagne,
pendant ce temps, s’étaient réunies en Catalogne.
II. Il eût été
important que César suivît. Pompée pour l’empêcher de recevoir les secours qu’il
attendait de toutes les parties de 1’Asie : mais il n’était pas maître de la
mer ; il lui fallut plusieurs mois pour réunir les moyens nécessaires au
passage de son armée. Cependant il était menacé dans les Gaules par les six
légions d’Espagne, renforcées de beaucoup de troupes auxiliaires sorts les
ordres dés lieutenants de Pompée. Il prit toutes les mesures pour réunir des
navires à Brindes ; il envoya Curion en qualité de propréteur en Sicile,
forma trois légions des troupes de Corfinium, les lui confia ; il envoya
Valerius en Sardaigne et en Corse avec une légion : l’un et l’autre réunirent
les habitants des deux îles, qui renvoyèrent le lieutenant de Pompée et
reçurent en triomphe l’envoyé de César. Caton, qui commandait en Sicile,
évacua cette province et se rendit près de Pompée en Grèce. Après avoir ainsi
pourvu aux choses les plus pressantes, César se rendit à Rome ; il mit tout
en œuvre pour attirer dans la ville les personnages les plus considérables,
mais il échoua. Il proposa à son sénat d’envoyer une députation à Pompée pour
négocier un accommodement. Les affaires de Rome étant pleines de difficultés,
les principaux de la
République étaient contre lui ; le peuple, qui était
prononcé en sa faveur, était mené par des tribuns qui ne lui laissaient qu’une
autorité incertaine. Il quitta Rome avec plaisir, passa les Alpes, se
présenta devant Marseille. Il fit passer les Pyrénées à Fabius, son
lieutenant, avec les trois légions qui étaient en quartiers d’hiver à
Narbonne ; il y réunit un grand corps de cavalerie gauloise et des troupes
auxiliaires.
Au mois d’avril (janvier de notre calendrier), la Gaule, l’Italie, la Sardaigne, la Corse et la Sicile tenaient pour
César ; l’Espagne, l’Afrique, l’Égypte, la Syrie, l’Asie Mineure, la Grèce, tenaient pour
Pompée. Mais César dominait il Rome.
III. OBSERVATIONS. — Première
observation. — Pompée s’était trompé sur les dispositions des
peuples ; l’opinion des grands, des sénateurs, qui parlaient très haut et
étaient fort prononcés contre César, lui donna le change. Le peuple avait une
invincible inclination pour César.
Deuxième observation.
- Les six légions que Pompée avait en Espagne pouvaient le joindre à Rome et
peu de semaines, en s’embarquant à Carthagène, Valence et Tarragone, et en débarquant
à Naples ou Ostie.
Troisième observation.
- C’est Rome qu’il fallait garder ; c’est là que Pompée eût dû concentrer
toutes ses forces. Au commencement des guerres civiles, il faut tenir toutes
les troupes réunies, parce qu’elles s’électrisent et prennent confiance dans
la force du parti ; elles s’y attachent et s’y maintiennent fidèles. Si les
trente cohortes de Domitius eussent été campées devant Rome avec les deux
premières légions de Pompée ; si les légions d’Espagne, celles d’Afrique,
d’Égypte, de Grèce, se fussent portées par un mouvement combiné sur l’Italie
par mer, il eût réuni avant César lino plus grande armée quo celui-ci.
Quatrième observation.
— Ne pouvant se porter en Grèce, César se porta en Espagne ; il craignit avec
raison que les légions ne se rendissent par mer au camp de Pompée ou n’entrassent
en Gaule.

Chapitre X — Guerre Civile – Campagne d’Espagne (an 49 avant
Jésus-Christ)
I. Guerre de quarante jours, entre la Sègre et l’Èbre. — II. Affaires d’Andalousie. —
III. Siège de Marseille. — IV. Observations.
I. Je vais combattre une armée sans général, dit
César en partant pour l’Espagne, pour venir
ensuite combattre un général sans armée. Effectivement, les
vieilles légions de Pompée étaient en Espagne sous Afranius, Petreius et
Varron : le premier commandait sur l’Èbre, le second dans le royaume de Léon
et en Portugal, le troisième dans l’Andalousie. Afranius et Petreius
réunirent leurs cinq légions à Lérida, en Catalogne, avec quatre-vingts
cohortes et 5.000 chevaux espagnols ; Varron resta à Séville avec deux
légions. César, arrêté devant Marseille, fit prendre les devants à Fabius,
son lieutenant, avec trois légions et 18.000 Gaulois, dont 6.000 chevaux.
Arrivé en présence d’Afranius, devant Lérida, Fabius fortifia son camp, et
jeta des ponts sur la Sègre
pour assurer ses communications et pouvoir fourrager sur les deux rives. Les
fourrageurs des deux armées en venaient souvent aux mains. Un jour que Fabius
avait envoyé deux légions pour les protéger, un de ses ponts fut emporté par
la violence du courant ; Afranius accourut avec quatre légions pour profiter
de l’occasion, mais elles firent bonne contenance, se rangèrent en bataille
sur une éminence et soutinrent l’attaque de l’ennemi, jusqu’à ce que Fabius
arrivât avec deux autres légions, qui passèrent la Sègre sur l’autre pont, ce
qui mit fin au combat. Ce fut deux jours après cet événement que César arriva
à son camp avec 900 chevaux d’escorte. Il laissa six cohortes à la tête du
pont et marcha sur Lérida, vis-à-vis le camp d’Afranius, à qui il offrit la
bataille. Il assit son camp à 400 pas du pied de la montagne ; il employa la
troisième ligne à creuser un fossé de 15 pas de largeur, la protégeant par
ses deux premières lignes, qui restèrent en bataille. Ce travail étant
terminé, il fit entrer l’armée dans ce retranchement ; trois jours après il
fortifia son camp, y fit entrer ses bagages et rappela les six cohortes qu’il
avait laissées derrière lui. Ce camp et celui d’Afranius étaient séparés par
une plaine de 300 pas ; au milieu était un monticule, que César fit attaquer
par trois légions. Afranius le prévint ; un combat très vif s’engagea ; le
monticule resta à Afranius, qui le fit retrancher et mettre à l’abri de toute
insulte. Cependant la Sègre
et la Cinca
débordèrent, emportèrent les ponts de bateaux : l’armée de César se trouva
cernée par les inondations ; celle de Pompée était maîtresse du pont de
pierre de Lérida. On était au mois de juin, les blés étaient près de leur
maturité ; il ne restait plus de vieux blé dans les granges : le bétail avait
été enlevé par les paysans, qui s’étaient réfugiés dans les montagnes ; la
famine se fit sentir dans le camp de César. Les troupes légères espagnoles et
portugaises auxiliaires d’Afranius étaient munies d’outres, et accoutumées à
franchir les rivières et les inondations ; ce qui leur permit de fourrager
comme à l’ordinaire. Sur ces entrefaites, un convoi de plusieurs milliers de
chevaux, composé de cavalerie gauloise et d’archers de Rouergue, arriva
devant le camp de César ; il fut arrêté par la rivière. Afranius passa sur le
pont de Lérida avec trois légions pour attaquer ce convoi, qui fût obligé de
se retirer dans les montagnes, après avoir perdu quelques centaines d’hommes.
César se trouvait dans une position fâcheuse ; le bruit en répandit à Rome,
et l’on courut en foule chez la famille d’Afranius pour la féliciter.
Cependant la rivière baissa ; César fit construire des
bateaux d’osier couverts de cuir, remonta la Sègre à sept lieues, jeta une légion sur la
rive gauche, et en deux jours rétablit un pont de pontons ; ce qui ramena l’abondance
dans son camp. Quelques jours après, la cavalerie gauloise surprit une
cohorte d’Afranius et la tailla en pièces ; la cavalerie gauloise et
allemande prit un grand ascendant sur la cavalerie espagnole, qui n’osa plus
s’éloigner ni tenir la campagne. Sur ces entrefaites, les habitants de
Tarragone, ceux de Huesca, ceux de Calahorra, se soumirent à César ; ils l’approvisionnèrent
de blé. Le nouveau pont se trouvant trop éloigné de son camp, il prit le
parti de saigner la Sègre
et de la rendre guéable, Afranius craignait de se trouver son tour affamé, la
cavalerie de César étant fort supérieure à la sienne ; il résolut de porter
la guerre en Aragon. Il fit réunir à Mequinenza tous les bateaux nécessaires
pour construire un pont sur l’Èbre ; ce pont fut promptement achevé ; et,
laissant en garnison deux cohortes dans Lérida, il se dirigea sur Mequinenza,
dont il n’était qu’à sept lieues. César le fit poursuivre par sa cavalerie, qui
atteignit son arrière-garde ; au jour, il fit des cohortes des hommes les
plus faibles, qu’il laissa à la garde du camp, et avec le reste il passa la Sègre au gué qu’il venait
de faire, ayant de l’eau jusqu’au cou, et avant trois heures du soir, il
atteignit l’ennemi. A cette vue, Afranius rangea son armée en bataille entre
le camp qu’il occupait et Mequinenza. Il y avait des défilés difficiles. Le
lendemain, à la pointe du jour, les deux armées décampèrent ; César prit la
traverse dans l’espérance de gagner avant l’ennemi ces défilés ; il réussit
et se rangea en bataille, faisant face à l’ennemi, lui coupant le chemin sur
l’Èbre. Afranius, dans cette position difficile, abandonna la grande route.
Il voulut faire occuper une montagne par quatre cohortes espagnoles ; mais
elles furent environnées par la cavalerie gauloise et massacrées ; ce qui
consterna son armée. Les soldats de César demandaient à grands cris la
bataille ; mais, ayant des intelligences dans le camp d’Afranius, il espérait
soumettre cette armée par de bons procédés et par l’effet de ses
négociations. Afranius et Petreius rentrèrent dans le camp qu’ils avaient
occupé la veille, et César plaça le sien sur des hauteurs, en occupant les
chemins qui conduisaient à l’Èbre. Afranius et Petreius avaient deux partis à
prendre : ou retourner à Lérida, ou marcher sur Tarragone ; ils manquaient d’eau,
ils ne pouvaient aller à la rivière, ce qui les obligea à tirer des
retranchements depuis le camp jusqu’à l’eau. Pendant qu’ils présidaient
eux-mêmes aux travaux, les deux camps se mêlèrent, et les soldats d’Afranius
témoignèrent le désir de mettre un terme à la guerre ; mais Petreius fit
passer par les verges tous les soldats de César qui se trouvaient dans son
camp ; il rétablit l’ordre et la discipline. Enfin les ennemis se décidèrent
à retourner sur Lérida ; mais, poussé vivement, Afranius comprit l’impossibilité
d’opérer sa retraite ; il campa, employa plusieurs jours à se fortifier, mais
il n’avait pas d’eau. N’ayant plus de fourrage, il fit tuer les bêtes de
somme. Les camps n’étaient éloignés l’un de l’autre que de 2.000 pas ; les
armées en sortirent et se rangèrent en bataille : Afranius sur deux lignes,
les troupes auxiliaires formaient le corps de réserve ; César sur trois
lignes : la première, forte de vingt cohortes, quatre cohortes de chaque
légion ; la seconde, de trois, et la troisième, de trois ; les gens de trait
et les frondeurs étaient au milieu et la cavalerie sur les ailes. Sur le
point d’en venir aux mains, Afranius traita avec César, qui lui accorda la
paix, à la seule condition que l’armée serait sur l’heure même licenciée, que
les Espagnols rentreraient directement chez eux, et que les Italiens
repasseraient les Pyrénées et les Alpes sous son escorte.
II. Varron,
lieutenant de Pompée, commandait dans l’Espagne méridionale ; il leva dans sa
province trente cohortes auxiliaires ; il fit construire à Cadix dix galères
et plusieurs autres à Séville, mit six cohortes dans Cadix, envoya du blé à
Marseille ; il projeta de s’enfermer dans Cadix avec son armée. César, maître
de la Catalogne,
se rendit à Cordoue, y réunit les notables de l’Andalousie. Cordoue et
Carmona se déclarèrent pour lui et chassèrent les troupes de Varron, tant l’Andalousie
lui était affectionnée. Cadix s’étant déclaré en sa faveur, Varron se soumit
avec la légion qui lui restait. Ainsi toute l’Espagne se trouva pacifiée. Ce
succès fut dû aux sentiments des habitants du pays. Ayant ainsi pacifié
toutes ces contrées. César laissa Cassius avec quatre légions pour commander
la province ; il se rendit par terre à Narbonne, et de là devant Marseille.
III. Marseille
était une des plus puissantes villes de la Méditerranée ; elle
se déclara pour Pompée. Au commencement de mai de l’an 49, elle ferma ses
portes à César, qui manda quinze des principaux de la ville pour tâcher de
faire changer les dispositions des habitants ; mais ce fut vainement. Domitius,
celui qui avait rendu Corfinium, fort affectionné au parti de Pompée, entra
dans la ville avec quelques galérer et en fut déclaré gouverneur. Pendant ce
temps, Caius Trebonius, avec trois légions, investit la ville et commença le
siége ; en même temps, voulant tenir la mer, il fit construire en trente
jours douze galères à Arles, et en donna le commandement à Domitius Brutus.
Dix-sept galères marseillaises, dont onze étaient couvertes, et un grand
nombre de petites barques remplies d’archers et de montagnards d’Albi,
sortirent du port pour attaquer l’escadre de Brutus, qui était à l’ancre près
d’une des petites îles qui sont à l’entrée du golfe de Marseille. L’action fut
vive et opiniâtre. Les Romains furent vainqueurs ; les Marseillais perdirent
neuf galères. Trebonius, de son côté, forma deux attaques, l’une près du port
et l’autre du côté opposé ; Marseille était alors une presqu’île. Nasidius,
avec seize vaisseaux dont les éperons étaient d’airain, passant le détroit de
Sicile, entra dans le port de Marseille. Ce renfort rendit les Marseillais maîtres
de la mer ; ils mirent à la voile et mouillèrent dans la rade de Toulon :
Brutus les y attaqua et les défit. Quatre de leurs galères furent prises et
cinq coulées bas ; une se sauva avec les vaisseaux de Nasidius et gagna l’Espagne.
Trebonius éleva une tour de briques au bas des murailles ; elle avait 30 pieds de haut sur 30 pieds de diamètre ;
il établit une galerie de 60
pieds de long pour aller du bas de cette tour au bas
des murailles du rempart. Les Marseillais, craignant que leur ville ne fut
prise d’assaut, parlementèrent, obtinrent une trêve ; mais, ayant recours à
la trahison, ils profitèrent d’un grand vent, sortirent et brûlèrent toutes
les tours et les machines des assiégeants. Cette perfidie indigna ceux-ci sans
les décourager ; en peu de jours ils rétablirent toutes leurs machines ;
enfin, rebutés de tant de pertes, les assiégés résolurent de se soumettre :
ils étaient en proie à la plus affreuse famine. Ils sortirent et déposèrent
les armes aux pieds de César, qui était de retour d’Espagne. Il conserva leur
ville et y mit deux légions en garnison. Cette ville soutint six mois de
siège ; elle capitula en octobre.
César, arrivé à Rome, fut nommé dictateur ; il fit marcher
son armée sur Brindes. Cette timide fut bien employée : en juillet il passa
le Rubicon ; en août il était maître de toute l’Italie ; en octobre, de l’Espagne
et de Marseille ; en novembre il était à Rome dictateur.
IV. OBSERVATIONS. — Première
observation. — César réduisit une armée égale en force à la
sienne par le seul ascendant de ses manœuvres. De pareils résultats ne se
peuvent obtenir que dans les guerres civiles. Le travail important qu’il fit
exécuter, ce furent les saignées qu’il fit faire à la rivière en creusant
deux canaux de 30 pieds
de largeur ; ce qui la rendit guéable.
Deuxième observation.
— Lorsqu’il arriva devant Lérida, il fit creuser un fossé de 15 pieds de large sur 9
de profondeur, ce qui fait un déblai de 403 pieds cubes
par toise courante : sept hommes ont pu travailler à la fois dans l’espace de
chaque toise : il leur a fallu cinq heures pour creuser ce fossé. En Catalogne
les terres ont besoin de peu de
talus.

Chapitre XI — Guerre Civile – Campagne de Thessalie (an 48 avant
Jésus-Christ)
I. Opérations des armées en Épire jusqu’à la réunion d’Antoine. — II.
Combat de Dyrrachium. — III. Batailles de Pharsale. — IV. Observations.
I. César séjourna peu
de jours à Rome ; il se démit de la dictature et se rendit à Brindes, où
était réunie son armée, forte de douze légions.
Pompée, qui n’avait que cinq légions lors de son arrivée
en Épire, se trouva en avoir neuf ; il en avait tiré une de Sicile, deux d’Asie,
une de Crête ; il en attendait deux que lui amenait Scipion, son beau-père.
Il avait, en outre, un grand nombre de troupes auxiliaires : il était maître
de la mer ; sa flottte, composée des escadres d’Égypte, de Syrie, de Rhodes,
d’Illyrie, était sous les ordres de Bibulus, son amiral, qui croisait à l’entrée
de l’Adriatique avec cent dix galères pour empêcher César de passer la mer.
Celui-ci mit à la voile de Brindes, avec treize galères et un convoi de bâtiments
de charge portant 20.000 hommes, le 4 janvier (14 octobre de notre calendrier), et jeta l’ancre
le lendemain au milieu des rochers de la Chimère, en Épire. A peine débarqué, il renvoya
ses vaisseaux pour prendre le reste de son armée, que, sous les ordres d’Antoine,
il avait laissé à Brindes ; mais ils furent attaquas par Bibulus, qui en prit
et brûla une partie ; après quoi, il établit sa croisière d’Oricum (Erikho), port situé
près de la Chimère,
à Salone (Spolatro),
et parvint à couper toute communication entre César et Antoine. Pompée était
au fond de la Macédoine
lorsqu’il apprit que César avait passé l’Adriatique, que déjà il était maître
d’Oricum et de l’Épire, qu’il menaçait ses magasins de Dyrrachium : il y
accourut en toute diligence ; il se campa sur la rive droite de l’Apsus,
couvrant Dyrrachium vis-à-vis de César, qui couvrait Oricum. Les deux armées
n’étaient séparées que par la rivière ; ce qui donna lieu à des pourparlers,
qui firent momentanément espérer un rapprochement. Les affaires traînèrent
ainsi cinq mois, sans que Pompée profilât de sa supériorité ; il avait toute
son armée réunie, et celle de César était partie en Italie sous Antoine, et
partie sous lui en Épire.
Enfin Antoine se mit en mer avec trois légions de vétérans
et parut au matin devant Durazzo, poussé par le vent du midi ; il remonta dans l’Adriatique jusqu’au
cap de Medua. A peine eut-il atteint ce cap, que le vent changea ; ce qui
sauva son convoi, qui était chassé par seize galères et occasionna la perte
de celles-ci ; elles échouèrent sur la côte : soldats et matelots périrent.
Deux vaisseaux du convoi d’Antoine, restés en arrière, furent obligés de mouiller
devant Alessio, attaqués par plusieurs galères ennemies. Un de ces bâtiments,
qui était monté par des recrues, fut pris sans résistance ; l’autre, sur
lequel étaient des vétérans, s’échoua : ces braves gagnèrent terre, débarquèrent,
soutinrent un combat contre 400 cavaliers, et arrivèrent dans le vamp de
César sans avoir perdu un seul homme.
II. Pompée leva le premier
son camp pour marcher à la rencontre d’Antoine, et le battre avant que César
eût pu le joindre. Celui-ci remonte l’Apsus pour passer à un gué, ce qui lui
fit perdre un jour ; malgré ce retard, il fit sa jonction avec Antoine et prévint
Pompée, qui rétrograda et porta son camp à Asparagium. César ayant opéré sa
jonction avec Antoine se fit joindre par les garnisons qu’il avait laissées
sur la côte et se mit à la suite de Pompée. Le troisième jour de marche il
campa près de lui ; le lendemain il lui offrit en vain la bataille. Alors César
décampa et gagna une marche sur Pompée, se porte à tire-d’aile sur Durazzo,
afin de s’emparer de ce grand dépôt de vivres et de guerre : il l’investit,
mais Pompée accourut au secours de ses magasins et se campa sur une roche
élevée sur le bord de la mer, nommée Petra, où il y avait une anse et
un mouillage. Ainsi le camp de César était placé entre la ville de Dyrrachium
et le camp de Pompée ; il contenait dix légions, avec lesquelles il présenta
la bataille à Pompée, qui la refusa constamment, resta immobile dans son camp
; ce qui décida César à l’effrayer. Il prit alors le parti d’envelopper son
camp par des lignes : il fit construire vingt-six forts sur une
contrevallation de six lieues de tour, la gauche appuyée à son camp, près de
Dyrrachium, et la droite au bord de la mer, au delà de l’embouchure de l’Apsus[1]
; le camp de Pompée, l’anse de Petra, étaient enfermés par ces lignes. Il
obtenait par là plusieurs avantages : le premier, c’était de discréditer
Pompée, le second, de lui couper les fourrages et d’empêcher sa nombreuse
cavalerie de se nourrir et de courir la campagne. Pompe !e se laissa enfermer
et se contenta de se couvrir par une enceinte parallèle à celle de César ; il
bâtit vingt-quatre forts opposes aux vingt-six, sur une ligne de
circonvallation de cinq lieues : cela lui donnait l’avantage de se rendre maître
de cet espace intérieur ; il l’était de la mer, par où il recevait des
convois ; ce terrain était ensemencé, ce qui lui fournissait des fourrages en
quantité. Sa position étant plus centrale, il avait toutes sortes d’avantages
sur César ; il pouvait se porter en moins d’une heure, en suivant la mer, de
la droite à la gauche, et il en fallait six à César. La supériorité de
troupes de celui-ci, homme pour homme, était telle, quelles luttèrent
longtemps avec avantage contre la supériorité du nombre et la centralité de
la position de Pompée. Cependant les deux armées manquaient également :
César, n’ayant pas de blé, fut réduit à vivre de légumes et de chara, espère
de racine fort grossière ; Pompée manquait de fourrages, et sa nombreuse
cavalerie souffrit beaucoup ; l’eau même devenait rare : les maladies se
mirent dans son camp. On était au mois de juin. Pressé par le besoin de
fourrages, il forma un camp sur la rive droite de l’Apsus, débordant la
gauche de toute la ligne de César, afin de pouvoir fourrager dans la
campagne. César construisit à l’extrémité de sa ligne un camp à une portée de
trait de celui de Pompée ; les combats étaient journaliers : on en compta
dans un jour trois, un à Durazzo et deux aux lignes. Dans un de ces combats,
César gagna 6 drapeaux et fit perdre 2.000 hommes à son ennemi. Pompée, qui
avait une grande quantité d’hommes de trait, en ayant garni ses tours, fit
beaucoup de mal à son adversaire, qui, sentant le désavantage de sa position,
désira sortir de cette pénible situation par une bataille générale : il s’approcha
à cet effet jusqu’à une portée de trait du camp de Pompée ; mais celui-ci,
constant dans son système, resta dans son camp et préféra même renvoyer sa
cavalerie par mer, puisqu’il ne la pouvait plus nourrir, plutôt que de
risquer une bataille. S’il se refusa à un engagement général, il sut profiter
des avantages de sa position. Pour attaquer la droite de César, il ordonna à
ses troupes de se munir de fascines et de couvrir leurs casques de claies d’osier
pour être à l’abri des frondeurs. Pendant que soixante cohortes attaquaient
de front, avant le jour, une légion embarquée sur des vaisseaux de charge
débarquait, tournait et attaquait la droite de l’ennemi. Ce petit camp, qui
appuyait la droite de César, était occupé par la 9e légion ; il
consistait en un rempart de i10 pieds de haut et un fossé de 15 pieds. Pompée s’en
empara et mena battant les troupes de César ; mais Antoine arriva avec une réserve
de douze cohortes, et contint un peu l’ennemi. César s’y rendit lui-même : il
marcha sur le petit camp de Pompée, voulant prendre sa revanche ; il força le
camp ; mais Pompée marcha à lui avec sa 5e légion, le battit :
l’effroi, le désordre et la confusion furent extrêmes dans l’armée de César, qui
courut le risque d’être entièrement écharpée : il eut un millier d’hommes
tués et perdit 32 drapeaux. Ce succès valut à Pompée le titre d’imperator.
La fortune qui l’avait si bien servi ce jour-là, piquée qu’il n’eût pas su
profiter de ses faveurs, le quitta. César s’aperçut enfin combien le système
de guerre qu’il avait adopté était défectueux ; il reploya tous ses postes,
envoya tous ses bagages à Apollonie, sous l’escorte d’une légion, et commença
sa retraite à trois heures du matin, déposa ses blessés à Apollonie et se
dirigea sur la
Thessalie. Pompée le suivit, abandonnant les bords de la
mer, où sa nombreuse flotte lui donnait tant d’avantages.
III. Scipion,
envoyé comme proconsul de Brindes en Asie pour y réunir les légions et les
faire déclarer pour Pompée, se mit en marche avec deux légions pour joindre
Pompée, aussitôt qu’il fut instruit que César avait passé la mer. Il arriva
en Macédoine, qui s’était déclarée pour le dictateur ; il marcha contre
Domitius, son général. Les deux armées comparent l’une vis-à-vis de l’autre
sur l’Haliacmon, qui sépare la
Thessalie de la Macédoine. César arriva en Thessalie, appela à
lui Domitius, pendant que Pompée faisait sa réunion avec Scipion. Après des
marches et des contremarches, les armées se trouvèrent en présence dans les
plaines de Pharsale. L’armée de la République était fière de la cause qu’elle
défendait et des succès qu’elle venait de remporter à Dyrrachium ; celle du
dictateur était pleine de confiance dans la fortune de son chef et dans sa
propre supériorité : c’étaient ces vieilles légions toujours victorieuses.
Pompée, convaincu de la supériorité de l’armée de César, voulait éviter le
combat, mais il ne put résister à l’impatience des sénateurs ; ces pères
conscrits étaient impatients de rentrer dans les murs de leur Rome ; on
vantait la supériorité de sa cavalerie. Labienus, ancien lieutenant de César,
appelait la bataille de tous ses vœux, disant que les vieux soldats
vainqueurs des Gaulois étaient morts, que César n’avait plus que des recrues.
Pompée avait cent dix cohortes, qui faisaient 45.000 hommes romains sous les
armes. César avait 30.000 hommes. Les troupes alliées de part et d’autre
étaient très nombreuses. Les historiens diffèrent beaucoup d’opinion sur le
nombre d’hommes qui ont combattu à Pharsale, puisqu’il en est qui le font
monter de 3 à 400.000 hommes. Les 10e, 9e et 8e
légions de César formaient sa droite, sous les ordres de Sylla. Il avait
placé au centre quatre-vingts cohortes, ne laissant que deux cohortes à la
garde de son camp ; il tira une cohorte de chacune des légions qui
composaient sa troisième ligne pour en former un corps spécialement destiné à
s’opposer à la cavalerie. Il n’y avait entre les deux armées que l’espace
nécessaire pour le choc. Pompée ordonna de recevoir la charge sans s’ébranler.
Aussitôt que le signal fut donné, l’armée de César s’avança
au pas redoublé ; mais, voyant que la ligne ennemie ne bougeait pas, ces
vieux soldats s’arrêtèrent d’eux-mêmes pour reprendre haleine ; après quoi,
ils coururent à l’ennemi, lancèrent leurs javelots et l’abordèrent avec leurs
courtes épées. La cavalerie de Pompée, qui était à la gauche, soutenue par
les archers, déborda l’aile droite de César ; mais les six cohortes qui
étaient en réserve s’ébranlèrent et chargèrent cette cavalerie avec tant de
vivacité, qu’elles l’obligèrent à prendre la fuite. Dès ce moment, la
bataille fut décidée.
César perdit 200 hommes, dont la moitié officiers. Pompée
perdit 15.000 hommes, morts ou blessés sur le champ de bataille ; il ne put
pas même défendre son camp, que le vainqueur enleva le jour même. Les débris
de l’armée vaincue se réfugièrent sur un monticule, où César les cerna ; à la
pointe du jour suivant, ils posèrent les armes, au nombre de 24.000 hommes.
Les trophées de cette journée furent 9 aigles, c’est-à-dire toutes celles des
légions présentes, et 180 drapeaux.
Pompée se retira en toute hâte, vivement poursuivi. Arrivé
à Péluse, en Egypte, il se confia au jeune roi Ptolémée, qui était dans cette
ville à la tête de son armée, faisant la guerre à Cléopâtre, sa sœur ; il
débarqua sur la plage presque seul et fut assassiné par les ordres de
Ptolémée. César débarqua en Égypte peu de semaines après, et fit son entrée
dans Alexandrie à la tête de deux légions et de quelques escadrons de cavalerie.
Ainsi périt le grand Pompée, à l’âge de cinquante-huit
ans, après avoir, pendant trente-cinq ans, exerce les principales charges de la République. Il
avait fait dix-sept campagnes de guerre : celles de l’an 83, 82, 77, 48, 49
contre les Romains du parti de Marius et de César ; celles de 81 en Afrique,
de 76, 75, 74, 73, 72, 71 en Espagne ; celle de 67 contre les pirates ;
celles de 65, 64, 63 contre Mithridate. Il avait triomphé en 81 de l’Afrique,
en 71 de l’Espagne, en 61 de l’Asie. Il avait été trois fois consul : en 70,
en 55, ces deux fois avec Crassus, en 82 avec Metellus Scipion. Pompée, l’homme
que les romains out le plus aimé et qu’ils surnommèrent du nom de Grand lorsqu’il n’était encore âgé que
de vingt-six ans.
IV. OBSERVATIONS. — Première
observation. — Les douze légions que César réunit à Brindes
venaient d’Espagne, des Gaules ou des rives du Pô ; il semble donc qu’il eût
mieux fait de les diriger par l’Illyrie et la Dalmatie sur la Macédoine. De
Plaisance, point d’intersection des deux routes, la distance est égale pour
arriver en Épire. Son armée y serait arrivée réunie ; il n’aurait point eu à
traverser la mer, obstacle si important et qui faillit lui être si funeste,
devant une escadre supérieure.
Deuxième observation.
— Cet obstacle, il est vrai, était beaucoup moins fort alors qu’il ne serait
aujourd’hui. La navigation était dans l’enfance ; les vaisseaux n’étaient pas
propres à croiser ni à tenir le vent ; il paraît même qu’ils n’étaient pas
approvisionnés d’eau pour longtemps, puisque quelques jours de vents contraires
exposèrent la flotte de Bibulus à en manquer entièrement.
Troisième observation.
— Pompée, avec une armée aussi nombreuse, n’eût pas dû se laisser tenir en
échec par l’armée de César avant sa jonction avec Antoine, c’est-à-dire
pendant cinq mois.
Quatrième observation.
— Les manœuvres de César à Dyrrachium sont extrêmement téméraires : aussi en
fut-il puni. Comment pouvait-il espérer se maintenir avec avantage le long d’une
ligne de contrevallation de six lieues, entourant une armée qui avait l’avantage
d’être maîtresse de la mer et d’occuper une position centrale ? Après des
travaux immenses il échoua, fut battu, perdit l’élite de ses troupes, et fut
contraint de quitter ce champ de bataille. Il avait deux lignes de contrevallation,
une de six lieues contre le camp de Pompée et une autre contre Dyrrachium.
Pompée se contenta d’opposer une ligne de circonvallation à la
contrevallation de César : effectivement, pouvait-il faire autre chose, ne
voulant pas livrer bataille ? Mais il eût dû tirer un plus grand avantage du
combat de Dyrrachium ; ce jour-là il eût pu faire triompher la République.
Quand on considère avec attention les travaux que firent
les deux armées à Dyrrachium et ceux de César à Alise, que l’on met deux armées
modernes dans la même situation, on saisit d’abord toute la différence qui
existe entre les deux manières de faire la guerre. En effet, à Alise, César,
avec 80.000 hommes, fait une double ligne de circonvallation ; il cerne une
armée d’égale force et couvre son armée par une ligne de contrevallation de 5
ou 6 lieues de tour, ce qui le met à même de résister à plus de 200.000
hommes. Lors de l’attaque, il est évident que, sans le secours de ces fortifications
de campagne, il n’eût pas pu résister ; mais il profite des quarante jours qu’il
a devant lui, avant l’arrivée de l’armée de secours, pour se couvrir de fossés,
de remparts, de trous de loup, etc., et il se trouve inexpugnable. Aujourd’hui,
quelques considérables que fussent les travaux qu’une armée pourrait faire en
quarante jours, en la supposant organisée comme les armées romaines, ces
avantages disparaîtraient devant une grande supériorité d’artillerie de la part
de l’assaillant ; l’artillerie de l’armée dans ses lignes serait disséminée,
tandis que celle de l’armée de secours serait réunie sur le point de la
principale attaque, hormis ce qui serait nécessaire pour les fausses attaques
; alors l’artillerie de l’armée dans ses lignes serait sur-le-champ éteinte
par la grande supériorité de l’attaquant, et, soit qu’elle profitât du commandement,
soit qu’elle prit en enfilade ou en écharpe, l’armée assaillante, protégée par
une nombreuse artillerie, n’aurait que la peine de combler de fascines les
fossés, trous de loup, etc., et de faire des rampes aux ligues. Cet avantage,
les anciens ne l’avaient pas, parce que leurs armes de jet étaient trop
médiocres, et que leurs principales armes étaient des armes blanches : alors
l’obstacle du retranchement restait tout entier.
A Dyrrachium, les tours protégeaient la ligne : l’artillerie
les mettrait en ruine aujourd’hui en peu d’heures. Nos moyens d’élever des
fortifications sont restés les mêmes ; mais leur importance est diminuée dans
un rapport bien grand ; aussi la bêche et la pioche n’étaient-elles pas moins
nécessaires aux soldats romains ou grecs que le bouclier et l’épée, et les
modernes n’en font plus d’usage. Est-ce à tort, ou ont-ils raison ?
Cinquième observation.
— A Pharsale, César ne perd que 200 hommes et Pompée 15.000. Les mêmes
résultats, nous les voyons dans toutes les batailles des anciens ; ce qui est
sans exemple dans les armées modernes, où la perte en tués et blessés est
sans doute plus ou moins forte, mais dans une proportion de 1 à 3. La grande
différence entre les pertes du vainqueur et celles du vaincu n’existent
surtout que par les prisonniers : ceci est encore le résultat de la nature
des armes, les armes de jet des anciens faisaient en général peu de mal ; les
armées s’abordaient tout d’abord à l’arme blanche : il était donc naturel que
le vaincu perdit beaucoup de monde et le vainqueur très peu. Les armées
modernes, quand elles s’abordent, ne le font qu’à la fin de l’action et
lorsque déjà il y a bien du sang de répandu ; il n’y a point de battant ni de
battu pendant les trois quarts de la journée : la perte occasionnée par les
armes à feu est à peu prés égale des deux côtés. La cavalerie, dans ses
charges, offre quelque chose d’analogue à ce qui arrivait aux armées
anciennes : le vaincu perd dans une bien plus grande proportion que le vainqueur,
parce que l’escadron qui lâche pied est poursuivi et sabré, et éprouve alors
beaucoup de mal sans en faire.
Les armées anciennes, se battant à l’arme blanche, avaient
besoin d’être composées d’hommes plus exercés ; c’étaient autant de combats
singuliers. Une armée composée d’hommes d’une meilleure espace et de plus
anciens soldats avait nécessairement tout l’avantage ; c’est ainsi qu’un
centurion de la 10e légion disait à Scipion en Afrique : Donne-moi dix de mes camarades qui sont prisonniers comme
moi, fais-nous battre contre une de tes cohortes, et tu verras qui nous
sommes. Ce que ce centurion avançait était vrai : un soldat
moderne qui tiendrait le même langage ne serait qu’un fanfaron. Les armées
anciennes approchaient de la chevalerie : un chevalier armé de pied en cap
affrontait un bataillon.
Les deux armées à Pharsale étaient composées de Romains et
d’auxiliaires, mais avec cette différence que les Romains de César étaient
accoutumés aux guerres du Nord et ceux de Pompée aux guerres de l’Asie.
Sixième observation.
— Cette campagne de César, qui le rendit maître du monde, a duré dix mois. La
bataille de Pharsale a eu lieu un mois après la moisson, en juillet (de notre calendrier)
; la campagne a commencé à la mi-octobre (de notre calendrier), Pompée a été
assassiné à la fin de septembre (c’était le mois où il était né), un mois ou six semaines
après la bataille. Les historiens donnent peu de renseignements sur les dates
; on sait seulement qu’Antoine n’a rejoint César qu’à la fin de l’hiver, c’est-à-dire
en mars, ou, dans le calendrier d’alors, en mai ; que, pendant que les armées
étaient à Dyrrachium, les récoltes mûrissaient, que c’était par conséquent en
juin de notre calendrier ou à la fin de septembre du calendrier d’alors.

Chapitre XII — Guerre d’Alexandrie (an 47 avant Jésus-Christ)
I. Événements en Égypte. — II. Combat naval. — III. Bataille du Nil. —
IV. Observation.
I. César mouilla
dans le Port Neuf d’Alexandrie avec dix galères, deux légions et 800 chevaux,
occupa le palais royal, qui était situé vis-à-vis de l’isthme qui sépare les
deux ports près du cirque et du théâtre, qui était la citadelle. Les
Alexandrins murmurèrent de ce qui il se faisait précéder par ses licteurs, ce
qui était une marque de juridiction ; ils en vinrent à des voies de fait, et
plusieurs Romains furent tués. Le roi Ptolémée était mineur : l’eunuque Pothin
le gouvernait. Il était en guerre avec la reine Cléopâtre, sa sœur ; et,
comme le peuple romain était chargé de l’exécution du testament du feu roi,
le dictateur ordonna aux deux partis de comparaître devant son tribunal et de
cesser les hostilités. L’eunuque Pothin ordonna alors à l’armée du roi, qui
était à Péluse, de se rendre à Alexandrie : elle était de 20.000 hommes, dont
2.000 hommes de cavalerie ; Achillas la commandait. Une grande partie était
composée de Romains qui avaient servi dans l’armée de Gabinius. Aussitôt que
César sut qu’elle approchait d’Alexandrie, il se saisit de la personne du roi
et de celle du régent, et fit occuper militairement tout ce qui pouvait
ajouter à se sûreté. Achillas prit possession de toute la ville, à l’exception
de ce qu’occupaient les Romains, qui se trouvèrent bientôt bloqués du côté de
terre, et n’avaient plus de communication que par mer. Les Alexandrins se
portèrent au Port Vieux pour s’emparer de soixante et douze galères qui s’y
trouvaient ; cinquante étaient de retour de l’armée de Pompée, au secours
duquel elles avaient été envoyées, vingt-deux étaient la station d’Alexandrie
: si elles tombaient en leur pouvoir, c’en était fait de César ; mais, après
un combat fort chaud, il parvint à les brûler, et resta ainsi maître de la
mer. Il s’empara du Phare, situé à l’extrémité du Port Neuf ; il se trouva
maître de toute la côte de la mer : il fixa alors son attention du côté de
terre. Il avait besoin de fourrages : il s’empara de toutes les maisons qui
le séparaient de la porte du milieu et communiqua librement avec le lac
Mareotis, campagne d’où il tira des vivres et des fourrages. Il fit mettre à
mort l’eunuque Pothin. Peu de semaines après, la plus jeune des sœurs du roi,
la princesse Arsinoé, échappa du palais, gagna le camp d’Achillas, qu’elle
fit mourir et remplacer par l’eunuque Ganymède. Les Romains recevaient tous
les jours des vivres, des galères et des troupes, soit des archers qui
arrivaient de Crête et de Rhodes, etc., soit de la cavalerie d’Asie. César
avait expédié dans l’Asie-Mineure Mithridate, homme qui lui était dévoué,
pour réunir ses troupes, se mettre à leur tête, traverser la Syrie, le désert de Suez,
et venir le joindre par terre à Alexandrie.
De part et d’autre on travaillait avec activité à se
fortifier. Les Égyptiens avaient fermé toutes les issues par de grosses
murailles crénelées, et avaient établi un grand nombre de tours à dix étages.
Comme les canaux qui portaient l’eau du Nil à Alexandrie se trouvaient au
pouvoir de Ganymède, il fit boucher tous ceux qui donnaient de l’eau dans la
partie de la ville occupée par les Romains ; en même temps il fit élever par des
machines l’eau de la mer pour gâter les citernes du quartier des Romains : en
peu de jours l’eau devint si saumâtre, qu’elle ne fut plus potable. Les
Romains furent alarmés : mais ils tirèrent des eaux des fontaines qui sont
près du Marabout et de la tour du Phare ; ils creusèrent grand nombre de
puits au bord de la mer, qui leur donnèrent de l’eau douce. Dans ce temps la
37e légion, avec un grand nombre de bâtiments chargés de vivres,
armes et machines, qui était partie de Rhodes, mouilla prés de la tour des
Arabes, à l’ouest d’Alexandrie. Le vent d’est, qui règne en général dans ces
parages, à cette époque de l’année, l’empêchait de gagner le port d’Alexandrie
; le convoi était compromis. César partit avec sa flotte pour le sauver : ce
qui donna lieu à un combat naval dans lequel la flotte des Égyptiens perdit
une galère et fut contrainte de se sauver dans le Port Vieux. César fit
défiler son convoi en triomphe devant elle et rentra dans le Port Neuf.
II. Ganymède,
voyant l’insuffisance de ce moyen, sur lequel il avait tant compté, revaut de
nouveau au projet d’équiper une flotte ; il fit travailler avec la plus
grande activité à remettre en état dans le Port Vieux tous les bâtiments et
carcasses de galères qui s’y trouvaient ; il fit découvrir les portiques des
édifices publics pour en prendre les bois ; il lit venir des sept bouches du
Nil les bâtiments stationnaires qui les défendaient ; en peu de jours il eut
vingt-deux galères à quatre rangs, cinq à cinq rangs, et un grand nombre de petits
bâtiments de toute grandeur, le tout monté par d’habiles matelots. César
avait trente-quatre galères, savoir : neuf de Rhodes, huit de Pont, cinq de
Syrie et douze d’Asie Mineure, mais cinq seulement étaient ta cinq rangs de
raines, dix a quatre rings ; tout le reste était très inférieur. Il sortit cependant
du Port Neuf, doubla le l’hure et vint se ranger en bataille vis-à-vis du
Port Vieux. Les galères de Rhodes formaient sa droite, celles de Pont sui
gauche. A cette vue la flotte des Alexandrins appareilla. Les deux armées
étaient séparées par ce rang de rochers qui ferme le Port Vieux, et qui, sur
l’espace de 6.000 toises, n’offre que trois passages. L’armée qui
s’engagerait dans ces parages affronterait un grand danger et offrirait une
belle occasion à son ennemi. Euphranor, amiral des galères de Rhodes, indigné
de voir l’ennemi avoir tout l’assurance, proposa et obtint d’entrer dans le Port
Vieux : il se dirigea par le passage du milieu avec quatre galères ; le
combat devint terrible ; les Alexandrins furent battus : ils perdirent une
galère à cinq rangs et une à deux rangs ; le reste de leur flotte se sauva,
le long des quartiers de la ville, sous la protection des jetées et des
hommes de trait placés sur les toits des maisons.
Les Romains occupaient la tour du phare, mais non pas
toute l’île : ils s’en emparèrent après un combat opiniâtre, pillèrent le
gros bourg qu’elle contenait et firent 600 prisonniers ; mais les Alexandrins
restèrent maîtres du château qui forme la tête du pont de la jetée qui joint
cette île avec la ville. César voulut enlever ce poste important, il échoua :
après plusieurs tentatives où il perdit beaucoup de monde, il fut mis en
déroute et ne parvint à gagner ses galères qu’à la nage ; plusieurs d’elles
furent submergées par le grand nombre de fuyards qui s’y réfugiaient. Cependant,
quelque sensible que fût cette perte, elle n’eut pour lui aucune conséquence
Relieuse.
Le roi Ptolémée, quoique jeune, eut le talent de persuader
qu’il désirait employer son pouvoir à calmer l’insurrection, et qu’il
mettrait ainsi fin tenue a la guerre. César le mit en liberté ; mais,
aussitôt que cet enfant se trouva à la tête de son armée, il se servit de
toute son autorité pour exciter son peuple, et démasqua une haine implacable
contre les Romains.
Les Alexandrins, malgré l’échec qu’ils avaient reçu,
avaient ravitaillé et augmenté leur flotte. Les convois venaient par mer à
César du côté de l’Asie : ils se portèrent à Canope, dans la rade d’Aboukir,
pour les intercepter. L’amiral romain Néron y accourut à la tête de la flotte
: il eut un vif engagement avec la flotte égyptienne, où le brave Euphranor
périt avec sa galère.
III. Il y avait
huit mois que César était engagé dans cette malheureuse guerre, et rien n’annonçait
qu’elle dût avoir fine fin heureuse. lorsque enfin Mithridate arriva devant Péluse
avec l’armée qu’il avait réunie en Asie ; il s’empara d’assaut de cette
place, marcha a grandes journées, sur Memphis, où il arriva le septième jour
; de là il descendit le Nil par la rive gauche, se porta an secours de César
à Alexandrie. A cette nouvelle, le roi Ptolémée partit avec son armée, s’embarqua
sur le Nil et joignit le corps de son armée qui était opposé à Mithridate, à
peu près à la hauteur du Delta. César, de son côté, se rendit par mer à la
tour des Arabes ; de là il débarqua, et, tournant le lac Mareotis, il se
porta droit sur l’armée de Mithridate. Il la joignit sans combat ; elle était
campée le long du canal, il peu près à la hauteur d’A’lqâm. Ptolémée avait
plusieurs fois attaqué Mithridate et avait été repoussé ; César l’attaqua à son
tour et le battit : ce roi périt dans la déroute. César marcha sans s’arrêter
sur Alexandrie, où il arriva en peu de jours. cette immense ville se soumit :
les habitants vinrent à la rencontre de leur vainqueur en habits de
suppliants, portant avec eux tout ce qu’ils avaient de plus précieux pour
apaiser sa juste colère. Le dictateur les rassura, il rentra dans son
quartier en traversant les retranchements ennemis au milieu des acclamations
de ses troupes, qui le reçurent comme un libérateur. Il couronna reine d’Égypte
la belle Cléopâtre, chassa Arsinoé, sa sœur cadette, et, laissant en Égypte toute
son armée pour assurer la nouvelle autorité, il partit avec la 6e légion,
composée de vétérans, et se rendit par terre en Syrie.
Ainsi se termina la guerre d’Alexandrie, qui a duré la fin
de l’an 48 et une grande partie de 47.
IV. OBSERVATIONS.
- Première observation. — La
guerre d’Alexandrie donna neuf mois de répit au parti de Pompée, releva ses espérances
et le mit à même de tenir encore plusieurs campagnes ; ce qui obligea, l’année
suivante, César à faire la campagne d’Afrique, et, deux ans après, une
nouvelle campagne en Espagne. Ces deux campagnes, où il lui fallut son génie
et sa fortune pour en sortir vainqueur, n’auraient point eu lieu si, en sortant
de Pharsale, il se fût rendu de suite sur les côtes d’Afrique. Il eût prévenu
Caton et Scipion, ou si, se portant, comme il l’a fait, sur Alexandrie, il se
fût fait suivre par quatre ou cinq légions ; il ne manquait pas de bâtiments
pour les porter. A défaut de cela, il pouvait sans inconvénient se contenter
de l’apparente soumission de Ptolémée et ajourner sa vengeance d’une année.
Deuxième observation.
— Les deux légions de César et le corps de cavalerie avec lesquels il entra
dans Alexandrie ne formaient que 5.000 hommes ; les dix galères étaient
montées par 4.000 hommes. C’étaient des forcera bien peu considérables pour
lutter contre un grand roi et soumettre une ville comme Alexandrie ; mais
César eut deux bonheurs : le premier, de se saisir du palais, de la citadelle
et de la tour du Phare : le deuxième, de brûler la flotte des Alexandrins. Ce
ne fut qu’un mois après son arrivée que l’armée égyptienne partit de Péluse
et entra dans Alexandrie : peu après il reçut jusque vingt-quatre
galères de renfort chargées de troupes. Ainsi, tout bien considéré, il n’y a
dans toute sa guerre d’Alexandrie rien de merveilleux ; tous les plans que
les commentateurs ont dressés pour l’expliquer sont faux. Alexandrie avait
deux ports, comme elle les a encore aujourd’hui ; le Port Neuf, qu’occupait
César et dont l’entrée est défendue par la tour du Phare, et le Port Vieux,
qu’occupaient les Alexandrins ; mais celui-ci est une grande rade et ne
ressemble en rien au premier, qui est entouré par les quais de la ville,
tandis que celui-ci forme un arc dont la corde est de 6.000 toises jusqu’au
Marabout. La ville d’Alexandrie ne s’étendait pas, du côté de l’ouest, au
tiers de cette distance.
Troisième observation.
— César, dans la Guerre
des Gaules, ne dit jamais quelle était la force de son armée ni le lieu
où il se bat ; ses batailles n’ont pas de nom. Son continuateur est tout
aussi obscur ; il raconte, il est vrai, comment Mithridate prend Péluse, main
il ne dit rien de sa marche ultérieure ; au contraire, il est en contradiction
avec des auteurs contemporains, qui disent que de Péluse il se porta sur
Memphis, dont il s’empara ; après quoi il descendit sur Alexandrie par la
rive droite, en descendant le Nil : qu’il fut arrêté à peu près à la hauteur
d’A’lqâm par l’armée de Ptolémée. Le point où s’embranche dans le Nil le
canal dont on voit encore les traces serait, d’après ces renseignements, le
lieu où s’est donnée la bataille. Le commentateur appelle ce canal une rivière
: mais on sait bien qu’en Egypte il n’y a pas de rivière, qu’il s’y a que des
canaux. Les historiens nous laissent, selon leur usage, dans l’obscur sur l’époque
à laquelle s’est livrée cette bataille. Cependant il paraît qu’elle doit
avoir eu lieu à la fin de mai ou au commencement de juin : les eaux du Nil ne
sont pas alors tout à fait basses ; ce qui suppose que l’armée de Mithridate
avait passé le désert au mois d’avril.

Chapitre XIII — Guerre Civile - Campagne d’Égypte (an 47 avant
Jésus-Christ)
I. Pharnace attaque les alliés du monde romain. — II. César bat Pharnace,
Veni, vidi, vici. — III. Affaires d’Illyrie.
— IV. Guerre en Grèce. — V. Conduite de César à Rome. — VI. Observations.
I. Pharnace, ayant
été un des instruments dont s’était servi Pompée pour ne défaire de son père
Mithridate, avait, en récompense, obtenu le Bosphore. Lorsqu’il vit l’empire
romain en proie à la guerre civile, il Put l’ambition de réunir tous les
états de son père ; il d empara de la Colchide, du royaume de Pont, dont la capitale
était Sinope, le séjour favori du grand Mithridate ; enfin il se jeta sur la
petite Arménie et la
Cappadoce. Dejotarus, roi de la petite Arménie, et Ariobarzane,
roi de la Cappadoce,
implorèrent le secours de Domitius, commandant en Asie. Celui-ci n’avait sous
ses ordres que trois légions : obligé d’en envoyer deux a César. qui était
dans. Alexandrie, il ne lui en restait qu’une, la 36". Il y joignit une
légion levée ta la halte dans le royaume de Pont, et deux légions que
Dejotarus avait formées à la romaine, componées de ses sujets. Il réunit
cette armée à Comane, ville de Cappadoce. De Comane en Arménie on communique
par une chaîne de montagnes fort boisées. Domitius suivit cette crête et
assit son camp à deux lieues de Nicopolis. Le lendemain il s’approcha des
remparts de cette ville, et se trouva en présence de Pharnace, qui avait
rangé son armée en bataille sur une seule ligne, mais ayant trois réserves :
l’une derrière sa droite, l’autre derrière sa gauche et la troisième derrière
son centre. Domitius, quoique en présence de l’armée ennemie, continua à
fortifier sou camp, et, quand il l’eut achevé, il s’y campa tranquillement. Pharnace
fortifia sa droite et sa gauche par des retranchements, désirant tirer la
guerre en longueur, espérant que la nécessité où se trouvait César en Égypte
obligerait Domitius à s’affaiblir. Mais, peu de jours après, Domitius marcha
à lui : les deux légions de Dejotarus lâchèrent pied et ne rendirent aucun
combat ; la légion levée dans le Pont se battit mal, la 36e soutint
seule le combat ; mais, cernée de tous côtés, elle fut contrainte de battre
en retraite. Pharnace remporta une victoire complète ; il resta maître du
Pont, de la petite Arménie et de la Cappadoce. Domitius
se retira en toute hâte en Asie. Pharnace imita dans le Pont et dans la Cappadoce la conduite
de son père : il fit massacrer tous les citoyens romains et se porta sur
leurs personnes à des cruautés inouïes : il rétablit ainsi l’empire de sa
maison. Il croyait le dictateur perdu,
mais son triomphe ne dura que peu de mois.
II. César, après la
guerre d’Alexandrie, se porta en Syrie à la tête de la 6e légion,
s’y embarqua pour se porter en Cilicie ; il réunit à Tarse les députés d’une
partie de l’Asie Mineure. Sa présence était bien nécessaire à Rome ; mais il
jugea qu’il était plus urgent encore de réprimer la puissance renaissante de
ce rejeton de Mithridate. Il se porta à Comane avec quatre légions, la 6e,
la 36e et les deux de Dejotarus. Pharnace chercha à l’apaiser par
toute espèce de soumissions et d’offres ; il s’était campé avec son armée
sous les remparts de la place forte de Zela, lieu renommé par la victoire que
Mithridate, son père, avait remportée contre Triarius. César occupa un camp à
6 milles de lui, et, quelques jours après, il partit au milieu de la nuit et
s’en rapprocha à 1 mille. Pharnace, à la pointe du jour, aperçut avec
étonnement l’armée romaine qui se retranchait si prés de lui : il n’en était
séparé que par un vallon. Il rangea son année en bataille, descendit le
vallon, le remonta et attaqua l’armée de César, qui, méprisant les manœuvres de
l’ennemi, avait laissé des troupes dispersées dans les ateliers ; elles
eurent à peine le temps de prendre leurs armes et de se mettre en ordre de
bataille. La 6e légion, quoique réduite à 1.200 hommes, mais tous
vétérans, et qui tenait la droite, enfonça la gauche de l’ennemi, se jeta sur
son centre, repoussa l’armée ennemie dans le vallon et la poursuivit l’épée
dans les reins jusque dans son camp, qui fut forcé et devint la proie du
vainqueur : bagages, trésor, tout fut pris ; Pharnace eut à peine le temps de
se sauver de sa personne. Ce prince périt dans un combat contre un de ses
vassaux quelques mois après. La petite Arménie, la Cappadoce, le Pont, le
Bosphore, la Colchide,
furent le résultat de cette victoire. César donna le Bosphore à Mithridate de
Pergame. Ce fut après cette journée de Zela qu’il s’écria : Heureux Pompée, voilà donc les ennemis dont la défaite
vous a valu le nom de Grand ! Il écrivit à Rome : Veni, vidi, vici.
III. L’Illyrie se
composait de la Pannonie,
de la Liburnie
et de la Dalmatie
: la Pannonie
comprenait l’Autriche et une partie de la Hongrie, Vienne, Presburg et Belgrade ; la Liburnie comprenait l’Istrie
et la Croatie
; la Dalmatie
s’étendait jusqu’à la
Macédoine ; Salone, aujourd’hui Spalatro, en était la
capitale. Après la bataille de Pharsale, Octavius se porta en Illyrie avec
une partie de la flotte de Pompée. Cornificius y était avec deux légions
tenant pour César. Plus tard, César ayant appris que des débris de Pharsale
se ralliaient dans cette province, y envoya Gabinius avec deux légions de
nouvelles levées. Soit que Gabinius se conduisit avec imprudence, soit que
ses troupes, étant de nouvelles levées, n’eussent pas la consistance
nécessaire, il fut battu par les barbares et enfermé dans Salone, où il
mourut de maladie et de chagrin. Octavius, qui était maître de la mer,
profita de cet événement et soumit au parti de Pompée les trois quarts de la
province. Cornificius s’y maintint avec peine. César, renfermé dans
Alexandrie, ne pouvait lui donner aucun secours : mais Vatinius, qui
commandait le dépôt de Brindes, ayant sous ses ordres plusieurs milliers de
vétérans appartenant aux douze légions de César qui se trouvaient au dépôt,
sortant des hôpitaux pour joindre leurs légions, les embarqua sur des bâtiments
de transport et quelques galères, rencontra la flotte d’Octavius, la défit complètement.
Octavius se retira en Sicile. César domina dans l’Adriatique, et la province
d’Illyrie se soumit.
IV. Calenus, lieutenant
de César, assiégea Athènes, qui tenait pour Pompée, s’en empara après une
vive résistance. César fit grâce aux habitants de cette ville et dit à leurs
députés : Faudra-t-il donc que, dignes de périr,
vous deviez toujours votre salut à la mémoire de vos ancêtres ?
Mégare soutint un siège plus obstiné. Quand les habitants se virent poussés à
bout, ils lâchèrent des lions que Cassius avait réunis dans cette ville pour
être transportés à Rome et servir aux combats qu’il devait donner au peuple ;
mais ces bêtes féroces se jetèrent sur les habitants et en dévorèrent plusieurs
de la manière la plus horrible. Les habitants de Mégare furent faits esclaves
et vendus à l’encan. Un lieutenant de Pompée avait muré l’isthme de Corinthe,
ce qui empêcha Calenus d’entrer dans le Péloponnèse ; mais, après la bataille
de Pharsale, cet obstacle étant levé, Calenus s’empara de cette province, et,
à son arrivée à Patras, Caton, qui s’y trouvait avec la flotte de Pompée,
abandonna la Grèce.
V. Le lendemain de
la bataille de Zela, César partit avec une escorte de cavalerie pour se rendre
en toute diligence à Rome, où sa présence était nécessaire. La bataille de
Pharsale n’avait produit aucun changement dans cette métropole, qui lui était
soumise depuis le commencement de la guerre civile. Le consul l’avait nommé
dictateur comme il était dans Alexandrie, et Antoine son maître de cavalerie
; de sorte que, pendant l’an 47, il n’y eut point d’autres magistrats que le
dictateur et son maître de cavalerie. Celui-ci, qui était à Rome revêtu du
pouvoir souverain, se livra à toute espèce de débauches, scandalisa les
citoyens par ses mœurs et les opprima par ses rapines. Un jeune tribun du peuple,
Dolabella, amoureux des nouveautés, cherchant la renommée, et lui-même criblé
de dettes, proposa au peuple une loi pour l’abolition de toutes les dettes ;
ce qui, selon l’usage ordinaire, mit en combustion toute la République. D’un
autre côté, les vieilles bandes victorieuses des Gaules, mécontentes des
retards qu’elles éprouvaient pour recevoir les récompenses qui leur étaient
promises, se révoltèrent. La 2e légion refusa de se rendre en
Sicile ; toutes refusèrent de marcher. Mais César entra dans Rome. Pour se rendre
le menu peuple favorable, il fit une loi qui donnait la remise d’une année de
loyer à tous les citoyens qui payaient moins de 250 francs : il remit les
arrérages ou intérêts des dettes depuis le commencement des guerres civiles ;
il fit vendre tous les biens de ses ennemis ; il employa tout ce qui pouvait
lui procurer de l’argent ; les biens mêmes de Pompée furent vendus à l’encan
: Antoine les acheta ; il prétendait s’exempter d’en payer le montant, ce qui
excita un moment le mécontentement du dictateur. L’arrivée de César calma la
fermentation des légions ; mais, peu après, elles se mutinèrent avec plus de
fureur : tous les officiers qui se voulurent entremettre furent mis à
mort, et, par un mouvement spontané, elles arrachèrent leurs aigles et se
mirent en route sur la capitale, menaçant par leurs propos César même.
Celui-ci fit fermer les portes de la ville ; mais, lorsque les séditieux
furent arrivés au Champ de Mars, il sortit et monta sévèrement sur sa
tribune, leur demandant durement ce qu’ils voulaient. Nous sommes couverts de blessures, lui
répondirent-ils, il y a assez longtemps que nous
courons le monde et que nous versons notre sang : nous voulons notre congé.
Il leur répondit laconiquement : Je vous l’accorde.
Il ajouta peu après qu’il allait partir sous peu de semaines, et que, lorsqu’il
aurait triomphé avec de nouveaux soldats, il leur donnerait encore ce qu’il
leur avait promis. Il se levait et allait les quitter ainsi ; mais ses
lieutenants le sollicitèrent d’adresser quelques paroles de douceur à ces
vieux compagnons avec qui il avait acquis tant de gloire et surmonta tant de
dangers. César se rassit et leur dit : Citoyens,
contre son usage, qui était de les appeler soldats ou compagnons. Un murmure
s’éleva dans tout le rang : Nous ne sommes point
des citoyens, nous sommes des soldats. Enfin le résultat de cette
scène touchante fut d’obtenir de continuer leur service. César leur pardonna,
hormis à la 10e légion ; mais celle-ci s’obstina, suivit César en
Afrique, soi-disant sans en avoir reçu un ordre positif.
VI. OBSERVATIONS.
— Première observation. — Les
succès de Pharnace contre Domitius font connaître quelle était la différence des
bonnes aux mauvaises troupes. Trois légions ne résistent pas un moment contre
des barbares, et une seule parvient à faire sa retraite sans perte.
Deuxième observation.
— La conduite de la 6e légion. À la bataille de Zela, qui enfonce
tout devant elle, quoique composée de 1.200 vétérans seulement, fait voir de
quelle influence est une poignée de braves, cette influence était plus
marquée chez les anciens, tout comme elle est plus marquée, chez les
modernes, dans la cavalerie que dans l’infanterie.
Troisième observation.
— La victoire navale de Vatinius, avec des vaisseaux de charge, contre Octavius,
qui commandait des galères, est remarquable. Les batailles navales n’étaient
que des combats de pied ferme, et les vétérans romains, les plus braves de
tous les hommes, l’épée à la main, étaient presque toujours assurés de
vaincre sur terre comme sur mer. Les armes à feu, qui ont produit une si
grande révolution sur terre, en ont fait une très grande dans la marine ; les
batailles s’y décident à coups de canon, et, comme l’effet du canon dépend de
la position qu’on occupe, l’art de manœuvrer et de prendre cette position
décide des batailles navales. Les troupes les plus intrépides ne peuvent rien
dans un genre de combat où il est presque impossible de s’aborder ; la
victoire est décidée par deux cents bouches à feu, qui désemparent, brisent
les manœuvres, coupent les mâts et vomissent la mort de loin. La tactique
navale a donc acquis une tout autre importance. Les combats de mer n’ont plus
rien de commun avec les combats de terre. L’art du canonnier est soumis à l’art
de la manœuvre qui remue le vaisseau, donne aux batteries des positions d’enfilade
ou le présente aux boulets de la manière la plus avantageuse : si, à cette
tactique particulière de chaque vaisseau, vous joignez le principe de
tactique générale que tout vaisseau doit manœuvrer de la manière la plus
convenable dans la position, dans la circonstance où il se trouve, pour
attaquer un vaisseau ennemi, lui lâcher le plus de boulets possible, vous
aurez le secret des victoires navales.
Les galères étaient des bateaux à rames fort longs, ayant
peu de mâture et peu de voiles, n’étant pas propres à tenir le vent et ne
pouvant ni bloquer ni croiser. La supériorité sur mer ne donnait pas les
mêmes avantages qu’elle donne aujourd’hui ; elle n’empêchait pas celui qui
était inférieur de traverser les mers, soit l’Adriatique, soit la Méditerranée. César,
Antoine, passent l’Adriatique, de Brindes en Épire, devant des flottes
supérieures ; César passe en Afrique de Sicile, et, quoique Pompée eût été
presque constamment maure de la mer, il n’en tira que peu d’avantages. Ce n’est
pas de la marine des anciens qu’il eût fallu dire : Le trident de Neptune est le sceptre du monde
; maxime qui est vraie aujourd’hui.

Chapitre XIV — Guerre Civile - Campagne d’Afrique (an 46 avant
Jésus-Christ)
I. Opérations de Curion en Afrique pendant l’année 49. — II. Le parti de
Pompée se rallie en Afrique pendant les années 49, 48 et 47. — III.
Opérations de César pendant janvier. — IV. Opérations jusqu’à la réunion de
son armée. — V. Bataille de Thapsus. — VI. Observations.
I. Après la prise
de Corfinium, César forma deux légions des troupes de Domitius ; il est donna
le commandement à Curion et lui confia le gouvernement de la Sicile et de l’Afrique.
Curion s’embarqua avec deux légions et 500 chevaux, escorté par dix galères ;
il resta deux jours et trois nuits à la mer, et il aborda en Afrique au mois
de juin de l’an 49, au port d’Aquilaria, à sept lieues de Clypea (cap Bon), dans une
bonne rade foraine située entre deux caps ; il y débarqua, se mit en marche,
et le troisième jour il arriva sur la rivière du Bagrada (aujourd’hui Medjerdah),
qui se jette dans la mer entre Utique et Carthage. Ces deux villes sont
éloignées de trois lieues. Le camp de Scipion était situé entre elles, à l’embouchure
de ce fleuve, sur un rocher très escarpé qui commande la mer, allant en pente
douce du côté d’Utique, dont il n’était éloigné que d’un mille. Varus, qui
commandait pour Pompée, était campé sous les murs d’Utique ; une de ses ailes
était couverte par la ville, l’autre par un grand théâtre bâti en avant. Deux
cents vaisseaux marchands étaient mouillés dans le port ; Curion leur fit
ordonner, sous peine d’être regardés comme ennemis, de se rendre devant le
camp de Scipion ; ce qui ils firent sur-le-champ. Le lendemain il campa près
d’Utique. Il était encore à retrancher son camp lorsque l’avant-garde du roi
Juba parut ; ce qui donna lieu à un engagement où ce prince fit une perte
considérable. Les deux armées restèrent ainsi en présence pendant plusieurs
jours, s’occupant de part et d’autre à chercher à suborner les soldats du
parti opposé. Mais enfin, dans le courant de septembre, elles en vinrent aux
mains : Varus fut repoussé et perdit 2.000 hommes ; il abandonna son camp et
se réfugia derrière les remparts de la ville, que Curion investit. Dans ce
temps arrivèrent les nouvelles d’Espagne qui annonçaient les grands succès
que César venait d’obtenir contre Afranius. Cependant le roi Juba se mit en
marche avec une armée considérable pour dégager Utique. On conseilla à Curion
de prendre position au camp de Scipion et d’attendre l’arrivée des deux
légions qui étaient en Sicile. Il se rendit à ce parti ; mais, comme il se
mettait en marche, il eut avis que Juba était retourné dans son royaume, et
que Sabura seul s’approchait avec une partie de l’armée ; cela le décida à
marcher à lui. La cavalerie des deux armées se rencontra sur la rivière de
Medjerdah ; l’engagement fut vif ; celle de Sabura fut battue, son camp
surpris ; il perdit beaucoup de monde. Mais Juba était derrière. Curion,
continuant pendant cinq lieues à suivre son ennemi, fut arrêté par la
cavalerie de l’armée du roi, qui attaqua des troupes fatiguées. Après une
bataille très opiniâtre, Curion fût cerné par la cavalerie numide ; voyant la
bataille perdue, il chercha à gagner les montagnes, mais il ne le put : toute
son armée fut massacrée ; il resta lui-même mort sur le champ de bataille.
Rufus, qu’il avait laissé avec cinq cohortes à la garde du camp, donna l’ordre
de s’embarquer pour gagner la
Sicile ; mais une terreur panique s’empara des matelots ;
la flotte gagna le large et les cinq cohortes furent massacrées.
II. Pendant les
années 48 et 47, l’Afrique resta au pouvoir et sous les ordres de Varus,
lieutenant de Pompée. Les anciens divisaient l’Afrique en huit contrées : 1° La Mauritanie tingitane,
qui s’étendait depuis les côtes de l’Océan, vis-à-vis des Canaries, jusqu’à
celles de la
Méditerranée, vis-à-vis de Malaga : c’était la patrie de
Syphax ; elle était appelée le royaume de Bogud. C’est aujourd’hui le
royaume de Maroc et de Fez. 2° La Mauritanie césarienne, qui est le pays actuel d’Alger.
3° L’Afrique proprement dite, qui comprenait la Numidie, les états de
Carthage : c’est aujourd’hui Constantine et les états de Tunis et de Tripoli
; elle s’étendait jusqu’à la grande Syrte ; depuis la prise de Carthage, les
Romains tenaient un préteur à Utique ; ils ne pénétrèrent en Mauritanie que
sous Claude. 4° La
Cyrénaïque est le pays actuel de Derne, qui comprenait la Pentapole ; la ville
de Cyrène a été bâtie par les Lacédémoniens ; ce pays a été puissant ; les
habitants eurent des démêlés avec Carthage, au temps de sa grandeur, pour les
limites, qui furent placées aux Philænes, où étaient deux autels. 5° La Marmarique finissait
à la ville de Catabathmus, où commence une vallée profonde qui va en Égypte,
qui a été jadis arrosée par les eaux du Nil. 6° L’Égypte. 7° La Libye. 8° L’Éthiopie.
Juba régnait en Numidie ; il était attaché à Pompée. Scipion mena en Afrique
les débris de l’armée de Pharsale ; Labienus s’y rendit de son côté. Caton
commandait à Dyrrachium pendant la bataille de Pharsale ; il se retira,
après, avec la flotte à Cyrène ; de là, avec 10.000 hommes, il traversa par
terre le désert de la grande Syrte ; il lui fallut trente jours. Il fit
porter l’eau sur des ânes. Il hiverna à Leptis, ville très riche, y joignit
Scipion, Varus, Labienus et les fils de Pompée. Juba affectait la suprématie
sur eux. Caton se contenta du gouvernement d’Utique ; Scipion, qui était
consulaire, fut reconnu comme le général. Il y avait, en 47, dix légions,
beaucoup de cavalerie et des troupes légères. Juba avait quatre légions
armées à la romaine et de la cavalerie numide sans freins. Ces forces étaient
tellement redoutables, que les ennemis de César en Italie attendaient Scipion
à Rome ; il était maître de la mer ; sa flotte était très considérable. Trois
années avaient fait oublier les désastres de Pharsale ; les destins du monde
pouvaient encore changer. Mais Scipion était sans talent et n’avait pour lui
qu’un nom illustre.
III. César se
réveilla au bruit du danger ; il quitta Rome, passa en Sicile, campa si près
des bords de la mer que l’eau mouillait sa tente, s’embarqua avec six légions
et 2.000 hommes de cavalerie, mit à la voile le 27 décembre (7 octobre de notre
calendrier). Après trois jours de navigation, il atteignit le cap de
Mercure (cap Bon)
; il mouilla le lendemain sur les plages de Ruspina, près d’Adrumettum, qui
avait une garnison de Scipion ; il resta plusieurs jours à la mer pour
rallier son convoi, dispersé par un coup de vent, qui s’avait pu doubler le
cap Bon et errait à l’aventure le long des côtes d’Afrique. Lorsqu’il
débarqua, il n’avait avec lui que 4.000 hommes ; il se campa près de la petite
ville de Ruspina. Ce fut sur cette même plage qu’Annibal, de retour d’Italie,
aborda pour se porter à Zama ; c’est près des plages de Clypea, au cap Bon,
que s’embarqua Regulus dans la seconde guerre punique. Ruspina est à 40
lieues d’Utique et à 20 lieues au sud du cap Bon. César fit le tour des
murailles d’Adrumettum ; il n’avait pas assez de forces pour bloquer cette
ville. Scipion était à Utique avec son armée ; sentant le danger de sa position,
il descendit au sud pour s’éloigner de lui. La ville libre de Leptis lui
ouvrit ses portes ; il s’empara de l’île de Cereina, qui lui fournit des blés
: plusieurs châteaux et plusieurs villes, au bruit de son arrivée, se soumirent
: c’étaient de faibles avantages, qui ne pouvaient dominer ses inquiétudes. Tout
son convoi errait en danger d’être pris par les nombreuses flottes de l’ennemi
; il se trouvait exposé, avec une poignée de monde, à tout ce que Scipion
voudrait faire. Dans cette critique position, il prit un parti extrême, mais
conforme à l’état de ses affaires : il plaça ses troupes en garnison à Leptis
et à Ruspina, et s’embarqua avec sept cohortes pour éviter Labienus, qui
marchait sur lui, et voulut essayer de rallier sa flotte ou aller chercher le
reste de son armée en Sicile. Il passa toute la nuit embarqué ; mais, à la
pointe du jour, lorsqu’il donnait l’ordre de lever l’ancre, on signala une
partie de son convoi, celle dont il était le plus inquiet. Il débarqua alors
et se porta à son camp devant Ruspina, qu’il fortifia ; il en sortit le
surlendemain, avec trente cohortes pour ramasser des vivres ; mais il ne
tarda pas à se trouver en présence de Labienus, qui l’attaqua avec des forces
considérables. savoir : 1.600 chevaux gaulois, 8.000 Numides et 30.000 hommes
d’infanterie. La journée fut chaude et critique ; César fut cerné par la
cavalerie ennemie ; mais il perça le centre de Labienus, ce qui lui permit de
rejoindre son camp, quoique poursuivi par les Numides et non sans avoir couru
de grands dangers. Ce combat eut lieu le 4 janvier (14 octobre de notre calendrier), huit
ou neuf jours après le départ de Sicile.
Cependant, aussitôt que Scipion avait appris l’arrivée de
César à Ruspina, il avait réuni toute son armée sur Utique ; il avait suivi
Labienus et le rejoignit peu de jours après le combat, et se campa avec toute
son armée près d’Adrumettum. César se trouva bloqué dans son camp, ses
fourrageurs ne pouvaient plus sortir. Les cavaliers nourrissaient leurs chevaux
avec de l’algue marine qu’ils faisaient détremper dans l’eau douce. Il était
à craindre que Scipion ne le coupât de la mer ; le camp en était éloigné d’une
demi lieue. César couvrit ses communications de retranchements, et de tours
jusqu’au rivage ; il fit débarquer les équipages de la flotte, dont il se
servit comme d’archers et d’hommes de trait pour le service des machines dont
il couvrit ses retranchements, auxquels il travailla avec la plus grande activité.
Scipion, fier de sa grande supériorité, lui offrait tous les jours la
bataille. Les Gétules, qui étaient nombreux dans l’armée de Scipion et qui
conservaient les sentiments de la plus vive reconnaissance pour Marius,
étaient affectionnés à César, qui était son parent, et qui marchait à la tête
du parti populaire ; ils désertaient fréquemment et se rendaient à César. La
ville d’Acilla, située au sud de Ruspina, se donna à lui ; la petite ville de
Tirsa mit à sa disposition un magasin de 300.000 boisseaux de blé. Tout cela
ne remédiait pas à sa position, lorsque son second convoi parti de Sicile,
sur lequel étaient embarqués les 13e et 14e légions, 1.000
hommes de trait et 800 cavaliers gaulois, mouilla sur la plage vis-à-vis de
son camp, après quatre jours de navigation. Un secours aussi important
changea l’état des choses. On était à la lin de janvier : il avait nouvelle
que la plus grande partie des bâtiments avec lesquels il était parti erraient
encore battus au gré des vents, mais qu’aucun de ces bâtiments n’était tombé
au pouvoir des ennemis.
IV. Peu de jours
après l’arrivée de ses renforts, César, sorti de son camp, longea la mer au
sud, traversa une plaine de quinze milles et se campa près de Scipion, qui
occupait les hauteurs ; sa cavalerie eut un engagement avec celle de
Labienus, où il eut l’avantage. Scipion, attendant chaque jour l’arrivée de
Juba, refusa une bataille et s’enferma dans son camp ; il tirait ses vivres
et une partie de son eau de la ville d’Uzita. César approcha de cette ville
par des retranchements qu’il poussa jusqu’à une portée de trait des remparts.
Cependant le roi Juba arriva avec trois légions, une grande quantité de
cavalerie sans freins et 800 chevaux réguliers. Dès le lendemain Scipion
sortit de son camp, rangea son armée derrière 60 éléphants. Voyant que César
s’approchait toujours par des retranchements de la ville d’Uzita, Labienus se
mit en embuscade dans un vallon qu’il fallait traverser pour arriver à une
colline que César voulait occuper. Il y eut encore là un engagement assez
vif, d’où César sortit vainqueur. L’eau était très rare, et, en approchant
ses retranchements d’Uzita, César avait l’avantage de pouvoir profiter de
plusieurs puits qui lui furent d’un grand secours. Diverses escarmouches
avaient lieu tous les jours autour d’Uzita, lorsque enfin les 9e
et 10e légions arrivent de Sicile. Ce renfort n’empêcha pas Scipion
de présenter la bataille. Les deux armées sortirent de leur camp. La gauche
de Scipion s’appuyait à la ville d’Uzita, dont il renforça la garnison afin d’inquiéter
la droite de son ennemi, qui y était appuyée. L’armée de César était composée
de dix légions.
Les deux armées restèrent toute la journée à 200 toises l’une
de l’autre sans eu venir aux mains.
Varus sortit enfin d’Utique à la tête de cent cinq
vaisseaux, afin d’intercepter les convois de Sicile et d’Italie. Les quarante
galères de César étaient devant Thapsus ; treize s’étaient séparées et
mouillaient près de Leptis ; elles furent prises et incendiées par Varus.
Aussitôt que César apprit cette nouvelle, il partit de son camp, qui était à
deux lieues de Leptis, monta sur un brigantin, joignit le gros de sa flotte,
poursuivit Varus et le força de se réfugier dans Adrumettum ; il lui prit
plusieurs galères et lui brilla tous ses transports. Comme les subsistances
étaient difficiles, César, pour s’en procurer, fit partir deux légions avec
la cavalerie, qui se portèrent dans la nuit à dix milles, trouvèrent des
fosses chargées de blé, qu’elles transportèrent au camp ; mais tous ces
moyens étaient insuffisants. Il leva son camp d’Uzita à trois heures du matin,
se porta sur la ville d’Agar ; Scipion le suivit et campa en trois camps à
deux lieues de César, qui éprouvait un grand besoin de blé : il n’hésita pas
à faire une marche de flanc de six lieues pour se porter à Zeta, où Scipion
avait réuni des magasins. Il réussit à s’emparer de la ville ; mais, à son
retour, il fut vivement attaqué et eut beaucoup de peine à gagner son camp,
ce qu’il ne fit que fort tard dans la nuit. Labienus avait adopté la manière
de se battre des Numides ; sa cavalerie était beaucoup plus nombreuse, ses
soldats armés à la légère et ses hommes de trait étaient très braves et très
adroits ; ils accablèrent les légionnaires de traits. Lorsque ceux-ci,
impatientés, s’avançaient au pas de charge, ils se dispersaient sur-le-champ,
s’éloignant en toute hâte, et revenaient aussitôt que le légionnaire avait
repris son rang. La cavalerie de César n’osait se commettre contre celle de l’ennemi,
qui l’entourait d’un grand nombre d’hommes de trait qui tuaient les chevaux.
Cette manière de faire la guerre était inquiétante : si les légions de l’ennemi
étaient aussi bonnes que son infanterie légère, le succès de cette guerre serait
chanceux et la victoire difficile.
Scipion et Juba avaient aussi un grand nombre d’éléphants,
ce qui ne laissait pas de faire impression sur l’esprit du soldat. César fit
venir d’Italie des éléphants et familiarisa son armée avec la vue de ces
monstrueux animaux, lui enseignant le lieu où il fallait les frapper. Les
soldats comparaient la guerre qu’ils soutenaient à celle des Gaules, où ils
avaient affaire à un ennemi brave, mais franc ; ici, au contraire, ils
étaient toujours en danger de tomber dans quelques embuscades.
Le 21 mars (2 janvier de notre calendrier) César fit la revue de son
armée : jamais il n’en avait eu de plus belle et de plus nombreuse ; 6.000
hommes des dépôts d’Italie, composés de vétérans qui étaient restés malades,
étaient venus le joindre. Il sortit à huit lieues de son camp pour présenter
la bataille à Scipion, qui à son tour la refusa. Voulant cependant en venir à
un engagement général, le défaut de vivres, la difficulté de l’eau, la
manière de faire cette petite guerre et l’esprit de ruse de son ennemi lui
étant également à charge, il partit le 4 avril (14 janvier de notre calendrier) de son
camp d’Agar ; à trois heures du matin il arriva devant Thapsus, qu’il investit.
Thapsus était une ville de la plus haute importance pour Scipion ; il résolut
de tout risquer pour la secourir. Il suivit César par les hauteurs et établit
deux camps à trois lieues du sien en avant de Thapsus. Il y avait des salines
éloignées de 1.200 toises de la mer : Scipion essaya d’y pénétrer pour
secourir la ville, mais César y avait pourvu en y faisant construire un fort.
Scipion campa à 1.200 toises des lignes de César et du fort, et commença les
travaux pour retrancher son camp. Aussitôt que César en eut avis, il se mit
en marche, voyant l’occasion favorable pour finir la guerre par une bataille
décisive. L’armée de Scipion était rangée en bataille à la tête des
retranchements qu’il commençait à élever ; les éléphants étaient sur les deux
ailes. César rangea son armée sur trois lignes : la 10e légion et
la 3e tenaient la droite ; la 8e et la 9e tenaient
la gauche ; cinq légions étaient au centre. Il mêla son infanterie légère
avec sa cavalerie ; il réunit deux corps, chacun de cinq cohortes d’élite,
auxquels il joignit beaucoup d’hommes de trait, qu’il chargea spécialement d’attaquer
les éléphants.
V. A la vue de l’armée
ennemie, celle de Scipion témoigna de l’étonnement. César, de son côté,
trouva qu’elle était dans une position formidable. Ces 64 éléphants surmontés
de tours, qui protégeaient ses ailes, sa nombreuse cavalerie, cette nuée de
gens de trait dont il avait éprouvé la bravoure et l’adresse, le voisinage de
sa ligne de bataille, de son camp déjà couvert de retranchements, tout cela lui
imposait. Il tarda à donner le signal ; on l’entendit s’écrier : Cette manoeuvre d’attaque ne me plaît point. Mais
ses troupes, pleines du sentimentale leur supériorité, ne partagèrent point
son hésitation : En avant ! s’écria
la 10e légion en contraignant le trompette de sonner la charge ;
en même temps toute la droite s’ébranla malgré toutes les représentations des
officiers. César alors monta à cheval, donna pour mot d’ordre bonheur
et marcha droit à l’ennemi. Les deux corps chargés d’attaquer les éléphants
commencèrent l’action ; ils les accablèrent de traits. Irrités par le
sifflement des pierres et des flèches, ces animaux firent volte-face et se
tournèrent contre leur propre armée, et foulèrent aux pieds leurs légions,
qui étaient serrées, se dirigeant en toute hâte sur camp, dont ils
encombrèrent les portes. La cavalerie maure, qui avait compté sur l’appui des
éléphants, déconcertée par cet événement inattendu, lâcha pied. En peu d’heures
l’armée de Scipion et de Juba fut mise en déroute, et ses trois camps
successivement enlevés. Les fuyards se dirigèrent sur le camp qu’ils avaient
quitté la veille ; mais, poursuivis par le vainqueur l’épée dans les reins,
ils furent cernés sur une hauteur. Ils implorèrent la clémence de leur
vainqueur, mais vainement ; les vétérans, transportés de fureur, les
passèrent tous au fil de l’épée ; le carnage continua malgré les ordres et
les prières de leur général, qui non seulement ne put sauver les vaincus, mais
même voulut vainement protéger plusieurs citoyens romains qui étaient dans
son camp, et contre lesquels l’opinion de l’armée était prononcée. 10.000
hommes restèrent sur le champ de bataille ; César perdit 50 hommes. Le
lendemain celui-ci somma la ville de Thapsus en faisant défiler sous ses
murailles les 64 éléphants armés de tours qui étaient le trophée de sa
victoire ; mais ce fut vainement : il laissa alors trois légions pour en
faire le siège, et se porta de sa personne sur Utique. Caton commandait dans
cette grande ville. Aussitôt qu’il apprit la perte de la bataille, il mit tout
en œuvre pour engager les habitants à se défendre ; mais ils étaient portés d’affection
pour César. Tout ce qu’il put obtenir d’eux fut qu’ils protégeraient le
départ de ce qu’il y avait de fuyards attachés au parti de Pompée qui se
dirigeaient sur l’Espagne ; quant à lui, il se donna la mort en se passant
son épée au travers du corps. Juba se présenta avec quelques fuyards devant Zama,
sa capitale ; les habitants lui en fermèrent les portes. Il se retira à sa
maison de campagne, où il se donna la mort. Scipion s’était embarqué avec
quelques galères : il cinglait pour l’Espagne ; mais, arrêté par la flotte de
César à la hauteur de Bone, il périt dans le combat. De devant Thapsus, César
se porta devant Adrumettum, dont il s’empara sans coup férir ; il y trouva le
trésor de Scipion : de là, il fit son entrée dans Utique, aux flambeaux. Il
reçut, le lendemain, la nouvelle que Thapsus s’était rendu. Il partit, le
surlendemain, pour Zama, réduisit les états de Juba en province romaine, retourna
à Utique, imposa des contributions à plusieurs villes, pourvut au
gouvernement du pays, parti d’Utique le 13 juin (23 mars de notre calendrier), débarqua à
Cagliari après trois jours de navigation, en partit le 29 juin, et arriva à
Rome dans le courant de juillet (avril de notre calendrier), ayant terminé cette guerre importante
en moins de six mois.
VI. OBSERVATIONS.
— Première observation. — L’écrivain
de la Guerre
civile prétend que César n’avait point donné de rendez-vous à sa flotte
en partant de Sicile : il en fournit pour raison qu’il ignorait quel point
des côtes d’Afrique leur donner qui fût à l’abri des flottes ennemies. Cette
assertion est si absurde, qu’elle ne mérite aucune réfutation.
Ce n’est point la seule preuve d’ineptie que l’on trouve
dans l’histoire de la Guerre
civile, qui est écrite par un homme aussi médiocre que l’histoire de la Guerre des
Gaules est écrite par un homme supérieur. Scipion était à Utique ; il
était maître de toute la côte du nord jusqu’aux états du roi Juba. Le rendez-vous
qu’a donné César à son armée a été les côtes du sud du cap Bon jusqu à la
grande Syrte ; toute cette côte était exempte d’ennemis, et dans une saison
où il n’était pas possible aux escadres ennemies de maintenir leurs croisières
; mais sa flotte fut dispersée par un coup de vent et jetée ensuite au nord
du cap Bon, et ne se rallia insensiblement que plus tard et peu à peu.
Deuxième observation.
— Pendant tout janvier sa position était fort critique, et il n’a dû son
salut qu’aux fortifications de son camp et à l’impuissance des armes
offensives anciennes pour forcer des retranchements, ressources que n’aurait
pas un général moderne.
Troisième observation.
— Quatre jours après son débarquement, n’ayant encore que peu de monde réuni,
il laissa garnison dans les deux seules villes qu’il avait sur la côte, et,
pour éviter Labienus, il reprit la mer avec ses cohortes, lorsqu’une grande
partie de son convoi le rallia.
Quatrième observation.
— Dans un combat qu’il soutint quelques jours après, il eut évidemment le
dessous, quoi qu’en dise l’historien de la Guerre civile. La manière de
combattre de Labienus fut celle que les Parthes avaient employée contre
Crassus, d’attaquer les légions, non avec des armes de main, genre de combat
où elles étaient invincibles, mais avec une grande quantité d’armes de jet ;
adroits, dispos, aussi braves qu’intelligents, sachant se soustraire à la
poursuite du soldat pesamment arme, mais retournant l’accabler de leurs
traits aussitôt qu’il avait repris son rang dans la légion. Quelques
imparfaites que fussent alors les armes de jet, en comparaison de celles des
modernes, lorsqu’elles étaient exercées de cette manière, elles obtenaient
constamment l’avantage.
Cinquième observation.
– L’armée de César était réussie dans le mois de mars, il tarda trop
longtemps à donner la bataille : il parut se méfier de son destin ; il augura
défavorablement de plusieurs rencontres difficiles où il s’était trouvé
engagé ; mais cela ne concluait rien pour la bataille générale, et les légions
de Scipion et de Juba étaient, dans une journée décisive, trop inférieures
aux siennes pour pouvoir leur tenir tête.
Sixième observation.
- La conduite de Caton a été approuvée par ses contemporains et admirée par l’histoire
: mais à qui sa mort fut-elle utile ? à César ; à qui fit-elle plaisir ? à
César : et à qui fut-elle funeste ? à Rome, à son parti. Mais, dirait-on, il
préféra se donner la mort que fléchir devant César. Mais qui l’obligeait à
fléchir ? Pourquoi ne suivit-il pas ou la cavalerie ou ceux de son parti qui
embarquèrent dans le port d’Utique et rallièrent le parti en Espagne ? De
quelle influence n’eussent point été son nom, ses conseils et sa présence au
milieu des dix légions qui, l’année suivante, balancèrent les destinées sur
le champ de bataille de Munda ! Après cette défaite même, qui l’eût empêché
de suivre sur mer le jeune Pompée, qui survécut à César et maintint avec
gloire encore longtemps les aigles de la République ? Cassius,
et Brutus, neveu et élève de Caton, se tuèrent sur le champ de bataille de
Philippes. Cassius se tua lorsque Brutus était vainqueur, par un malentendu,
par ces actions désespérées, inspirées par un faux courage et de fausses
idées de grandeur, ils donnèrent la victoire au triumvirat. Marius, abandonné
par la fortune, fut plus grand qu’elle : exclu du milieu des mers, il se
cacha dans les marais de Minturnes ; sa constance fut récompensée ; il rentra
dans Rome et fut une septième fois consul. Vieux, cassé et arrivé au plus
haut point de prospérité, il se donna la mort pour échapper aux vicissitudes
du sort, mais lorsque son parti était triomphant. Si le livre du destin avait
été présenté à Caton, et qu’il y eût vu que, dans quatre ans, César, percé de
vingt trois coups de poignard, tomberait dans le Sénat au pied de la statue
de Pompée ; que Cicéron y occuperait encore la tribune aux harangues et y ferait
retentir ses Philippiques contre Antoine, Caton se fut-il percé le sein ?...
Non, il se tua par dépit, par désespoir. Sa mort fut la faiblesse d’une grande
âme, l’erreur d’un stoïcien, une tache dans sa vie.

Chapitre XV — Guerre Civile - Campagne d’Espagne (an 45 avant
Jésus-Christ)
I. Affaires d’Espagne pendant les années 48, 47 et 46. — II. Le jeune
Pompée soulève les Espagnes ; il y réunit une grande armée. — III. César
passe les Pyrénées. Bataille de munda. — IV. Observations.
Les grecs nommaient l’Espagne Ibérie ; ils l’appelaient
aussi Hespérie, parce qu’elle se trouvait, par rapport à eux, au
couchant. Les Carthaginois entrèrent en Espagne par Cadix, Malaga et Carthagène.
Les Romains la divisèrent en trois parties : 1° la Bétique, 2° la Lusitanie, 3° la Tarragonaise. La
Bétique avait au nord la
Guadiana, au midi
la Méditérannée
et l’Océan, au levant la
Tarragonaise ; ce sont aujourd’hui les provinces de
l’Estrémadure, de l’Andalousie, de Grenade et de Malaga : on y comptait
deux cents villes. La
Lusitanie s’étendait depuis la Guadiana jusqu’au
Duero ; c’est aujourd’hui le Portugal. La Tarragonaise
comprenait le royaume de Murcie, de Valence, l’Aragon, la Catalogne, la Navarre, les Asturies,
le royaume de Léon, la Galice
et une partie de la
Vielle Castille.
I. En quittant l’Espagne
après l’avoir conquis, à la fin de l’an 49. César y avait laissé comme
propréteur Cassius Longinus, homme avide et corrompu, qui avait malversé dans
la place de questeur qu’il avait précédemment occupée dans cette même
province : il indisposa l’esprit des habitants, qui, de concert avec une
partie des troupes, conspirèrent contre lui ! il fut frappé de deux coups de
poignard, mais il y survécu, rallia une partie des troupes et fit mettre à
mort les conjurés. Le roi Bogud traversa les mers, et, des bords de la Mauritanie, vint au
secours de Cassius. Lepidus, qui commandait pour César dans la Tarragonaise, passa
les montagnes et se porta sur le Bætis, avec trente-six cohortes, au secours
de son collègue, d’un autre côté, le questeur Marcellus se mit à la tête du
parti opposé à Cassius et le rallia à César.
II. César, après
Pharsale, envoya Trebonius dans le gouvernement des Espagnes pour rétablir l’ordre,
en qualité de proconsul ; Cassius s’embarqua, remonta les côtes d’Espagne, fit
naufrage à l’embouchure de l’Èbre et périt avec ses richesses, fruit de ses
rapines. Mais, peu de mois après, le fils aîné de Pompée débarqua eu Espagne,
chassa Trebonius. Après la défaite de Scipion en Afrique, Sextus Pompée, son frère,
Labienus et Varus le joignirent avec les débris de l’armée d’Afrique ; ce qui
le mit à même de former treize légions. Il devenait de la plus haute importance
de ne point laisser accroître une armée déjà si redoutable. César partit de Rome,
arriva en vingt-trois jours sur les bords du Bætis, au moment où le jeune
Pompée assiégeait la ville d’Ulia, la seule qui fut encore contre lui dans
toute la Bétique.
César secourut cette place, s’avança vers Cordoue ; Sextus
Pompée, qui y commandait, effrayé, appela à son secours son frère, qui
accourut en levant le siège d’Ulia. L’année 46 se termina sur ces
entrefaites.
III. Dans le
commencement de 45, César assiégea Alegria, qui ouvrit ses portes dans les
premiers jours de février (novembre de notre calendrier) ; il désirait terminer la
guerre par une grande bataille. Après diverses manœuvres, le jeune Pompée,
reculant toujours pour l’éviter, se trouva enfin acculé à l’extrémité de la presqu’île
de Malaga, près de la ville de Munda ; il se résolut à recevoir la bataille
dans une position avantageuse ; il y attendit son ennemi de pied ferme. Sa
ligne de bataille était de treize légions ; César l’attaqua avec huit. La
victoire se déclarait pour Pompée, César paraissait perdu ; il chargea alors
à la tête de la 10e légion sans pouvoir rétablir ses affaires,
lorsque le roi Bogud, avec ses Numides, alla attaquer le camp de Pompée.
Labienus détacha cinq cohortes au secours du camp. Ce mouvement rétrogradé,
dans un instant si critique, décida la victoire. Les vétérans crurent que l’ennemi
était est retraite et redoublèrent d’ardeur. Les troupes de Pompée crurent que
l’on se retirait, et se découragèrent : 30.000 hommes restèrent sur le champ
de bataille, parmi lesquels Labienus et Varus, et 3.000 chevaliers romains. Les
aigles des treize légions, la plus grande partie des drapeaux, 17 officiers
du premier rang, furent les trophées de cette journée, qui coûta aux
vainqueurs 1.000 morts et 500 blessés. César avait coutume de dire que partout il avait combattu pour la victoire, mais qu’à Munda
il a avait battu pour sauver sa vie. Cneius Pompée fut tué peu de semaines
après, et sa tête promenée en triomphe. Sextus,
son frère, qui commandait à Cordoue lors de la bataille, erra dans les
montagnes, survécut à la perte de son parti, dont il releva les étendards par
la suite. Toute la Bétique
se soumit ; le parti de Pompée fut entièrement détruit, tout l’univers romain
reconnut la loi du vainqueur. Le jeune Octave, depuis Auguste, figure pour la
première fois dans cette campagne, où il fit ses premières armes sous les
yeux de son oncle, qui l’affectionnait beaucoup.
IV. OBSERVATIONS.
– Première observation. — César
mit vingt-trois jours pour se rendre par terre de Rome à la Sierra-Morena : il
y a 450 lieues il en faudrait aujourd’hui, en poste, marchant nuit et jour,
douze.
Quel service n’aurait pas rendu Caton, s’il se fût trouvé
à Cordoue, au milieu du camp des jeunes Pompée, dont le parti, vaincu à
Pharsale, à Thapsus, renaissait de ses cendres, tant il était puissant dans l’opinion
des peuples ! La mort de cet homme de bien fut donc un malheur pour le Sénat
et la République
; il manqua de patience, il ne sut pas attendre le temps et l’occasion.
Deuxième observation.
— Munda est une des circonstances où César attaqua et donna bataille malgré
la bonne position de son ennemi ; aussi faillit-il y être vaincu. Le
mouvement de Labienus, qui en soi était bon, décida de la journée. Il est un
moment, dans les combats, où la plus petite manœuvre décide et donne la
supériorité : c’est la goutte d’eau qui fait le trop plein.
Troisième observation.
— A la bataille de Pharsale, César a perdu 200 hommes ; à celle de Thapsus,
50 ; à celle de Munda, 1.000 ; tandis que ses ennemis y avaient perdu leurs
armées. Cette grande disproportion de pertes, dans des journées si disputées
entre le vainqueur et le vaincu, n’a pas lieu dans les armées modernes, parce
que celles-ci se battent avec des armes de jet, et que le canon, le fusil
tuent également des deux côtés ; au lieu que les anciens se battaient avec l’arme
de main. Jusqu’à la victoire il y avait peu de pertes, les boucliers paraient
les traits, et ce n’était qu’au moment de la défaite que le vaincu était
massacrer ; c’était une multitude de duels où les battus, en tournant le
dos, recevaient le coup de mort.
Les généraux en chef des armées anciennes étaient moins
exposés que ceux des années modernes ; ils paraient les traits avec leurs
boucliers. Les flèches, les frondes et toutes leurs machines de jet étaient
peu meurtrières : il est des boucliers qui ont paré jusqu’à 900 flèches.
Aujourd’hui le général en chef est obligé tous les jours d’aller au coup de
canon, souvent à portée de mitraille, et à toutes les batailles à portée de
fusil, pour pouvoir reconnaître, voir et ordonner : la vue n’a pas assez d’étendue
pour que les généraux puissent se tenir hors de la portée des balles.
L’opinion est établie que les guerres des anciens étaient
plus sanglantes que celles des modernes : cela est-il exact ! Les armées
modernes se battent tous les jours, parce que les canons et les fusils
atteignent de loin ; les avant-gardes, les postes se fusillent et laissent
souvent 5 ou 600 hommes sur le champ de bataille de chaque côté. Chez les
anciens les combats étaient plus rares et moins sanglants. Dans les batailles
modernes, la perte faite par les deux armées, qui est, par rapport aux morts
et aux blessés, à peu près égale, est plus forte que la perte des batailles
anciennes, qui ne tombait que sur l’armée battue.
On dit que César fut sur le point de se donner la mort
pendant la bataille de Munda ; ce projet eût été bien funeste à son parti :
il eût été battu comme Brutus et Cassius !... Un magistrat, un chef de parti,
peut-il donc abandonner les siens volontairement ? Cette résolution
est-elle vertu, courage et force d’âme ? La mort n’est-elle pas la fin
de tous les maux, de toutes contrariétés, de toutes peines, de tous travaux,
et l’abandon de la vie ne forme-t-il pas la vertu habituelle de tout
soldat ? Peut-on, doit-on se donner la mort ? Oui, dit-on, lorsque
l’on est sans espérance. Mais qui, quand, comment peut-on être sans espérance
sur ce théâtre mobile, où la mort naturelle ou forcée d’un seul homme change
sur-le-champ l’état et la face des affaires ?

Chapitre XVI — Mort de César (an 44 avant Jésus-Christ)
I. Dernière année de la vie de César. — II. Guerre contre les Parthes. —
III. Assassinat de César. Il n’a jamais pensé à se faire roi.
I. César, de retour
d’Espagne, arriva à Rome dans le mois d’octobre de l’an 45 (le calendrier était
réformé alors) ; il fut assassiné au mois de mars de l’an 44. Il a été
six mois maître du monde ; il triompha du fils de Pompée, nouveauté qui fut
trouvée bien odieuse. Jamais Marius ni Sylla n’avaient triomphé d’aucun citoyen.
Le Sénat le déclara empereur et dictateur perpétuel ;
depuis ce temps il porta toujours une couronne de laurier et la robe
triomphale aux jours de fête. Il créa un grand nombre de sénateurs et de patriciens,
il avait réformé le calendrier ; il fit travailler à la rédaction du code
civil, criminel, pénal. Il fit dresser des projets pour embellir Rome de plusieurs
beaux édifices. Il fit travailler à la confection d’une carte générale de l’empire
et à une statistique des provinces ; il chargea Varron de former une
nombreuse bibliothèque publique. Il annonça le projet de dessécher les marais
Pontins, de creuser un nouveau lit au Tibre, depuis Rome jusqu’à la mer, et à
Ostie un port capable de contenir les plus gros vaisseaux ; il parla de
percer l’isthme de Corinthe. Il envoya des colonies pour relever Corinthe et
Carthage.
Il pardonna sincèrement à tous les restes de la faction de
Pompée et appela aux plus hautes charges les chefs des principales maisons
patriciennes ; il obéissait à un sentiment de générosité qui lui était
naturel, mais aussi aux conseils de la politique. C’est à la tête du parti
populaire qu’il avait passé le Rubicon ; c’est avec son aide qu’il avait
vaincu l’orgueilleuse aristocratie ralliée autour de Pompée. En effet, qu’eût-il
pu faire avec deux ou trois légions ? Comment eût-il soumis l’Italie et Rome,
sans sièges et sans combats, si la majorité des bras des Romains et des Italiens
n’eût été pour lui ? Pompé, au commencement de la guerre civile, avait
deux vieilles légions et 30.000 hommes aux portes de Rome ; il avait trente
cohortes à Corfinium : mais le peuple était contre lui : il dut, sans
combattre, abandonner la ville éternelle, et passa les mers pour courir à la
rencontre des légions d’Asie, il s’y forma une année, se trouva en Grèce
environné du sénat et de la majorité des patriciens. Mais César, dès le
début, fut maître de Rome.
Après les triomphes de Pharsale, de Thapsus, de Munda, le
parti de Pompée étant détruit, le parti populaire et les vieux soldats haussèrent
leurs prétentions, firent entendre leurs voix. César en fut inquiet, il eut
recours à l’influence des principales maisons pour les contenir. Chez les
peuples et dans les révolutions l’aristocratie existe toujours : la détruisez-vous
dans la noblesse, elle se place aussitôt dans les maisons riches et puissantes
du tiers état : la détruisez-vous dans celles-ci, elle surnage et se réfugie
dans les chefs d’atelier et du peuple. Un prince ne gagne rien à ce
déplacement de l’aristocratie : il remet au contraire tout en ordre en la
laissant subsister dans son état naturel, en reconstituant les anciennes
maisons sous les nouveaux principes. Cet ordre de choses était plus nécessaire
à Rome encore, qui, commandant à l’univers, avait besoin, pour maintenir sa
supériorité, de cette magie attachée aux noms des Scipion, des Paul-Émile,
des Metellus, des Clodius, des Fabius, etc. qui avaient conquis, gouverné et
tant influé depuis plusieurs siècles sur les destinées de l’Europe, de l’Asie,
de l’Afrique.
II. Crassus avait
péri avec son armée sur les bords de l’Euphrate : les aigles de ses légions
étaient encore entre les mains des Parthes. Le peuple romain réclamait une
vengeance que les guerres civiles retardaient depuis six ans. César, dans les
premiers jours de l’an 44 , annonça son dessein de passer la mer, de
soumettre les Parthes et de venger les mânes de Crassus. Pendant tout l’hiver
il fit travailler aux préparatifs de cette grande expédition, que réclamait
la gloire de Rome et l’intérêt de César. En effet, après une guerre civile
aussi acharnée, il fallait une guerre étrangère pour amalgamer les textes de tous
les partis et recréer les armées nationales.
La guerre contre les Parthes avait deux difficultés : 1° La
manière de combattre de ces peuples, qui étaient tous armés d’armes de jet d’une
nature supérieure aux armes ordinaires. Les flèches des Parthes perçaient les
boucliers des légionnaires ; ils n’attendaient pas le choc des pesamment
armés, mais ils les accablaient de loin. Labienus avait employé ce goenre de
guerre avec succès en Afrique. Il est probable que César en eût triomphé en
leur opposant un grand nombre de gens de trait tirés de Crète, des îles
Baléares, d’Espagne et d’Afrique. 2° La seconde difficulté était la nature du
pays. En pénétrant par la haute Arménie, il fallait longtemps faire la guerre
dans les pays de montagne ; en pénétrant par l’Euphrate et la Mésopotamie, on
rencontrait des marais, des inondations et des déserts arides. Tous ces
obstacles n’étaient point au-dessus du génie de César. Une nombreuse flottille
sur l’Euphrate et le Tigre eût triomphé des obstacles des eaux, et un grand
nombre de chameaux chargés d’outres eussent fait disparaître l’aridité du
désert. Il est donc probable qu’il eût réussi et eût porté l’aigle romaine
sur les bords de l’Indus, si toutefois la fortune, qui pendant treize
campagnes l’avait favorisé, lui fût encore restée constante. Elle a favorisé
Scipion pendant cinq campagnes. Alexandre pendant onze campagnes ; elle n’a
abandonne Pompée qu’à sa seizième campagne, et Annibal qu’à la dix-septième,
et sans pouvoir espérer de captiver encore un an cette cruelle.
III. Pendant que ce
grand homme se préparait à remplir de si hautes destinées, les débris du
parti de l’aristocratie, qui devaient la vie à sa générosité, conjurèrent contre
se vie : Brutus et Cassius étaient à la tête. Brutus était stoïcien, élève de
Caton. César l’affectionnait et lui avait deux fois sauvé la vie ; mais la
secte dont il était n’admettait rien qui le pût fléchir. Plein des idées enseignées
dans les écoles grecques contre la tyrannie, l’assassinat de tout homme qui
était de fait au-dessus des lois était regardé par lui comme légitime. César,
dictateur perpétuel, gouvernait tout l’univers romain ; il n’y avait qu’un
simulacre de Sénat : cela ne pouvait pas être autrement, après les proscriptions
de Marius et de Sylla, la violation des lois par Pompée, cinq ans de guerre
civile, un aussi grand nombre de vétérans établis en Italie, attachés à leurs
généraux, attendant tout de la grandeur de quelques hommes, et rien de la République. Dans
un tel état de choses, ces assemblées délibérantes ne pouvaient plus gouverner
; la personne de César était donc la garantie de la suprématie de Rome sur l’univers,
et faisait la sécurité des citoyens de tous les partis : son autorité était
donc légitime.
Les conjurés n’eurent pas de peine à réussir : César avait
confiance en eux : Brutus, Cassius, Decimus, etc. étaient ses amis et ses familiers.
César était confiant ; il les croyait tous intéressés à la conservation de sa
personne : car il protégeait tout ce que Rome avait de grands et d’hommes élevés,
malgré les murmures du parti populaire et de l’armée.
Pour justifier, depuis, un lâche et impolitique
assassinat, les conjurés et leurs partisans ont prétendu que César voulait se
faire roi, assertion évidemment absurde et calomnieuse, qui cependant s’est
transmise d’âge en âge et passe aujourd’hui pour une vérité historique. Si
César avait eu affaire à la génération qui avait vu Numa, Tullus et les
Tarquins, il eût pu avoir recours, pour consolider son pouvoir et mettre un
terme aux incertitudes de la
République, à des formes de gouvernement vénérées, et
auxquelles on eût été accoutumé ; mais il vivait chez un peuple qui, depuis
cinq cents ans, ne connaissait pas d’autre autorité que celle des consuls,
des dictateurs, des tribuns : la dignité des rois était bien méprisable,
avilie : la chaise curule était au-dessus du trône. Sur quel trône eût pu s’asseoir
César ? sur celui des rois de Rome, dont l’autorité s’étendait à la
banlieue de la ville ? sur celui des rois barbares de l’Asie, vaincus par les
Fabricius, les Paul-Émile, les Scipion, les Metellus, les Clodius, etc. ? C’eût
été une étrange politique. Quoi ! César eût cherché de la stabilité, de
la grandeur, de la considération, dans la couronne que portaient Philippe,
Persée, Attale, Mithridate, Pharnace, Ptolémée, que les citoyens avaient vus traînés
à la suite du char triomphal de leurs vainqueurs ? Cela est trop absurde
! Les Romains étaient accoutumés à voir les rois dans les antichambres de leurs
magistrats.
On a dit que ce n’était pas roi de Rome qu’il voulut se
faire proclamer, mais roi des provinces : comme si les peuples de la Grèce, de l’Asie Mineure,
de la Syrie,
conservaient plus de respect pour le trône renversé sur lequel s’étaient
assis Persée, Antiochus, Attale et Ptolémée, que pour la chaise curule de
Lucullus, de Sylla, de Pompée et de César même ! Ce projet est dont tout
aussi dénué de raison.
César a toujours affecté, jusqu’au dernier moment de sa
vie, les formes populaires : il ne faisait rien que par un décret du Sénat ;
les magistratures étaient nommées par le peuple, et, s’il arrogea la réalité du
pouvoir, il avait laissé subsister toutes les formes républicaines : il
marchait sans gardes, comme un simple citoyen ; sa maison était sans faste ;
il allait journellement dîner chez ses amis ; il était assidu à la tribune
aux harangues, aux assemblées du peuple et au Sénat. La première action de
César, s’il eût voulu être roi, eût été de s’environner d’une bonne garde ;
il n’en fit rien, et se refusa constamment à la sollicitation de ses amis,
qui, entendant frémir la faction vaincue, croyaient une garde nécessaire à la
sûreté de sa personne. Quoique dictateur, il voulut être consul cette même
année avec Antoine ; il partagea tous les devoirs de cette charge. Les
statues de Pompée ayant été renversées, il les fit relever avec éclat. Il n’introduisit
aucun changement dans l’esprit de son armée, qui constamment resta
républicaine et dévouée au parti populaire et démocratique.
Quelles sont les preuves qu’allèguent ses accusateurs ?
Ils citent quatre anecdotes, probablement fausses ou mal rendues, car
Cicéron, Florus, Velleius, n’en parlent pas ; mais, admettez-les comme
vraies, elles ne prouvent, rien. Ils disent, 1° que, le 26 juin, revenant du
mont Albain avec l’honneur de l’ovation, il fut salué par quelqu’un du peuple
du nom de roi, mais que la multitude resta muette et consternée, et qu’il
répondit alors qu’il n’était pas roi, mais César ; 2° que, dans ce même temps,
un homme du peuple mit sur sa statue une couronne de laurier avec un bandeau
royal ; 3° que, célébrant les Lupercales, le consul Antoine, qui était un des
Luperques, s’approcha de César, qui était assis sur la tribune aux harangues,
vêtu de sa robe triomphale et sa couronne de laurier sur la tète, qu’il lui
présenta un diadème ; que celui-ci, au lieu de le mettre sur sa tête, l’envoya
au Capitole, disant que Jupiter était le seul roi des Romains ; ces fêtes
Lupercales étaient des fêtes extravagantes ; les Lupercales couraient la
ville nus, avant en main des fouets de cuir dont ils frappaient les passants
; les dames les plus qualifiées présentaient leurs mains pour en recevoir les
coups ; le préjugé était que cela les rendait fécondes ; 4° que Lucius Cotta,
l’un des prêtres commis à la garde des livres sibyllins, disait que les
Parthes ne pouvaient être vaincus que par un roi. On a été plus loin pour
indisposer les Romains : on a dit que César roi devait porter le siège de l’empire
à Alexandrie ou à Ilion.
Voilà pourtant les misérables fondements sur lesquels le
bon Plutarque, le libelliste Suétone et quelques écrivains du parti, ont bâti
un système si peu vraisemblable. Si César eût trouvé quelque avantage pour
son autorité à s’asseoir sur le trône, il y fût arrivé par les acclamations
de son armée et du Sénat avant d’y avoir introduit la faction de Pompée. Ce n’était
pas en se faisant saluer du nom de roi dans une promenade par un homme ivre,
en faisant dire aux Sibylles qu’un roi pouvait seul vaincre les Parthes, en
se faisant présenter un diadème dans les Lupercales, qu’il pouvait espérer d’arriver
à son but. Il eût persuadé à ses légions que leur gloire, leurs richesses,
dépendaient d’une nouvelle forme de gouvernement qui mit sa famille à l’abri
des factions de la toge ; c’eût été en laissant dire au Sénat qu’il fallait
mettre les lois à l’abri de la victoire et de la soldatesque, et les
propriétés à l’abri de l’avidité des vétérans, en élevant un monarque sur le
trône. Mais il prit une voie contraire : vainqueur, il ne gouverna que comme
consul, dictateur ou tribun ; il confirma donc, au lieu de les décréditer,
les formes anciennes de la République. Après les succès qui ont suivi le
passage du Rubicon, César n’a rien fait pour changer les formes de la République. Auguste
même, longtemps après, et lorsque les générations républicaines tout entières
étaient détruites par les proscriptions et la guerre des triumvirs, n’eut
jamais l’idée d’élever un trône ; Tibère, Néron après lui, n’en ont jamais eu
la pensée, parce qu’il ne pouvait pas entrer dans la tète d’un maître d’un
grand état de se revêtir d’une dignité odieuse et méprisée. Si la couronne royale
eût été utile à Auguste et à ses successeurs, ils l’eussent placée sur leur
tête ; mais César, qui était essentiellement Romain, populaire, et qui, dans
ses harangues et dans ses écrits, employait toujours la magie du peuple
romain avec tant d’ostentation, ne l’eût fait qu’avec regret.
César n’a donc pas pu désirer, n’a pas désiré, n’a rien
fait, a fait tout le contraire de ce dont on l’accuse. Certes, ce n’est pas à
la veille de partir pour l’Euphrate et de s’engager dans une guerre
difficile, qu’il eût culbuté les formes en usage depuis cinq cents ans pour
en établir de nouvelles. Qui aurait gouverné Rome dans l’absence du roi ? Un
régent ! un gouverneur ! un vice-roi ! tandis qu’elle était accoutumée à l’être
par un consul, un préteur, un sénat, des tribuns.
En immolant César, Brutus céda à un préjugé d’éducation qu’il
avait puisé dans les écoles grecques ; il l’assimila à ces obscurs tyrans des
villes du Péloponnèse qui, à la faveur de quelques intrigants, usurpaient l’autorité
de la ville ; il ne voulut pas voir que l’autorité de César était légitime,
parce qu’elle était nécessaire et protectrice, parce qu’elle conservait tous
les intérêts de Rome, parce quelle était l’effet de l’opinion et de la
volonté du peuple. César mort, il a été remplacé par Antoine, par Octave, par
Tibère, par Néron, et après celui-ci toutes les combinaisons humaines se sont
épuisées pendant six cents ans ; mais ni la république ni la monarchie royale
n’y ont paru, signe certain que ni l’une ni l’autre n’étaient plus
appropriées aux événements et au siècle. César n’a pas voulu être roi, parce
qu’il n’a pas pu le vouloir ; il n’a pas pu le vouloir, puisque, après lui,
pendant six cents ans, aucun de ses successeurs ne l’a voulu. C’eût été une
étrange politique de remplacer la chaise curule des vainqueurs du monde par
le trône pourri, méprisé, des vaincus.
FIN DES GUERRES CIVILES ET AUTRES GUERRES
|