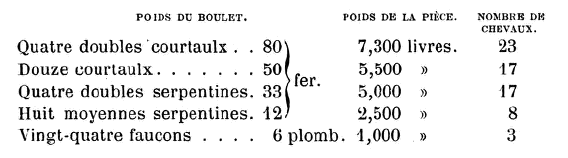L'EMPEREUR CHARLES-QUINT ET SON RÈGNE
TROISIÈME SECTION. — RÈGNE DE CHARLES-QUINT - 1506-1555
CHAPITRE VI. — SITUATION INTÉRIEURE DE LA BELGIQUE SOUS LE GOUVERNEMENT DE MARGUERITE D'AUTRICHE. DERNIÈRES ANNÉES DE CETTE PRINCESSE, SA COUR, SON INFLUENCE SUR LES LETTRES ET LES ARTS.
|
Les années que nous venons de parcourir, absorbées par des guerres continuelles, — guerre contre les communeros d'Espagne, guerre dans le nord des Pays-Bas, guerres en France et en Italie, — avaient coûté cher à la Belgique. Le gouvernement de l'empereur, toujours à court d'argent, avait été obligé de pressurer ses peuples pour tenir tête à tant d'ennemis sur un si grand nombre de territoires différents. Ce gouvernement était alors aux mains d'une femme d'un esprit remarquable, d'un caractère viril, l'une de ces têtes puissantes du XVIe siècle, a dit un écrivain national[1], où tout, dans notre patrie, fut grand, les hommes et les choses, les chefs et les peuples. Née à Bruxelles le 10 janvier 1479, Marguerite était fille de l'archiduc, puis empereur Maximilien, et de Marie de Bourgogne. Elle avait perdu sa mère, morte, on se le rappelle, d'une chute de cheval dans une partie de chasse, deux années après sa naissance. Jeune femme, elle avait passé par d'étranges et nombreuses vicissitudes. Destinée dès son enfance pour épouse au dauphin, fils de Louis XI, elle fut élevée à la cour de France, puis renvoyée ignominieusement à son père, à la suite du mariage du dauphin, en 1491, avec Anne de Bretagne. Revenue en Belgique, Marguerite devint, en 1497, la femme de Jean, fils de Ferdinand le Catholique et d'Isabelle de Castille. Veuve la même année, elle se remaria, en 1501, avec Philibert le Beau, duc de Savoie, qui mourut en 1504, et à qui elle fit élever le superbe mausolée qui décore l'église de Brou en Bresse. Son père la nomma, en 1506, gouvernante des Pays-Bas, qu'elle administra jusqu'à la fin de sa vie avec un grand renom d'habileté et de vigueur, non sans avoir été mêlée, d'une façon très active et très influente, aux négociations diplomatiques et aux événements politiques les plus considérables de son temps. A l'époque où nous sommes arrivé, la tendance générale des gouvernements les poussait vers le développement de leur autonomie, la centralisation administrative, et, il faut bien le dire, l'affaiblissement et la ruine des libertés de leurs sujets et particulièrement des franchises religieuses et communales, Charles-Quint partageait, sur ce point, toutes les idées des princes de son temps, et il fut toujours énergiquement soutenu, en Belgique, par sa tante Marguerite, qui, sur ce chapitre, n'était pas plus endurante que son neveu. Après avoir confirmé cette princesse dans le gouvernement de nos provinces et lui avoir adjoint un conseil, Charles-Quint s'était embarqué pour l'Espagne à la fin de septembre de l'an 1546, et il ne fit plus depuis, parmi nous, que de courtes apparitions. L'avènement de Charles-Quint au trône de son aïeul Ferdinand le Catholique et sa prise de possession du comté de Flandre, avaient été célébrés, dans les Pays-Bas par des manifestations enthousiastes de la joie populaire, dont nous nous faisons difficilement une idée aujourd'hui. C'étaient, dit l'écrivain que je citais tout à l'heure, c'étaient des fêtes, des fêtes augustes et solennelles que ces glorieux avènements des princes de Belgique, alors qu'ils se transportaient dans les principales villes du pays, pour recevoir, au milieu de cérémonies pompeuses, le serment sacré des habitants et pour jurer ensuite eux-mêmes de garder et de faire respecter les franchises et les libertés des communes et des provinces. Comme esquisse d'une de ces inaugurations, nous transcrirons après lui une description de la joyeuse entrée de Charles-Quint à Douai, où l'avait accompagné sa tante Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Le 15 mai 1516, Charles, roi des Espagnes et comte de
Flandre, ayant fait à Douai sa joyeuse entrée, devait se rendre le lendemain à
la halle pour les serments, à ce respectueusement
invité par les échevinages qui lui parlèrent à genoux. Le parvis de la halle
fut richement tendu tant de drap d'or que de velours. Après avoir entendu la
messe, le roy y vint associé de sa tante, madame Marguerite d'Autriche, et de
sa sœur aisnée, madame. Il flst le serment en tel cas requis, et
semblablement tout le commun à luy, ainsi qu'il s'en suit : Serment du commun. Nous jurons et promettons
de vous estre loyaulx et obéis-sans subjects et garder vostre estat et
personne, vos pays, droits, hauteur et seigneurie, et de vous servir envers
et contre tous. Serment du roy. Sire, vous jurez et
promettez garder et tenir les privilèges, franchises, usages et coutumes,
bonnes et louables de vostre ville de Douay, ainsy que vos prédécesseurs,
contes et contesses de Flandre, ont faict en temps passé. A quoi nostre dit seigneur respondit : ainsi le jure et promets tenir. Et ce faict, fut rué les deniers du roy, or et argent, sur ledit peuple, qui, de courage, grans et petits, crièrent : vive Bourgogne ! et luy-même roy en jeta par deux grosses peignies (poignées) en présence de ses dictes tante et sœur, voyant la bonne vœuille (volonté) dudit commun, dont il se réjouyssoit, et jamais prince n'avoit jeté or ny argent comme il fist[2]. On sait néanmoins, ajoute l'écrivain auquel sont empruntés ces détails, comment ce grand démolisseur des libertés communales demeura fidèle à son serment. Ces paroles sont trop sévères sans doute, mais ce qu'on ne peut nier, c'est que Charles-Quint était partisan déclaré du pouvoir fort, et disposé à restreindre, autant qu'il était en lui, ces libertés. Malheureusement, il faut bien le reconnaître aussi, ces vieilles franchises, héritage de nos pères, étaient poussées à l'excès, se combattaient mutuellement et tendaient souvent à substituer des intérêts égoïstes, des volontés ambitieuses, des prétentions anarchiques, au bien commun et au respect des droits du prince et de chacun des membres de l'état. Au moment où Charles-Quint, après un court séjour en
Belgique, allait partir pour ceindre la couronne impériale en Allemagne, il
confirma Marguerite dans le gouvernement des Pays-Bas, par lettres patentes
données à Maëstricht le 19 octobre 1520. Considérant,
disait-il, que sa très chère dame et tante, dame
Marguerite, avoit apporté, durant sa précédente absence, bon et grand devoir
à la conduite de ses affaires, et vu la peine, travail et diligence qu'elle
avoit pour ce pris, s'étant si grandement et vertueusement acquittée de ses
fonctions de régente et de gouvernante, qu'à son retour de ses royaumes
d'Espagne, elle lui avoit rendu bon et loyal compte de toute son
administration, remis ses pays et sujets en ses mains en bonne union,
sujettion vraie et due obéissance, à son apaisement et contentement, il
l'institua et l'établit derechef régente et
gouvernante générale des Pays-Bas, en la même forme et manière qu'elle
l'avoit été jusques à son retour d'Espagne. Par ces lettres
Charles-Quint institua également un conseil privé qui n'eut plus en réalité
qu'un caractère consultatif[3]. L'évêque de
Liège, Érard de la Marck[4] et Philippe de
Bourgogne, évêque d'Utrecht, furent appelés à en faire partie avec les
princes du sang et les chevaliers de la Toison d'or. Au nombre des
conseillers ordinaires figuraient Gérard de Pleine, Jean de Sauvage, Jean
Hannaert, seigneur de Liedekerke, vicomte de Lombeke ; Philibert Naturel, Antoine
de Ligne, les sires d'Arenberg, de Rogendorff, de Goemignies, de Berlaimont,
de Montbaillon et de Dormans. Parmi les maîtres des requêtes on comptait
Claude de Boisot, docteur en droit et archidiacre d'Arras ; Louis de
Maranches, seigneur de Saint-Aubin ; Antoine de Metteneye, Hugues de Marenne,
Liévin de Pottelsberghe et Antoine de Waudripont, Philippe Hanneton,
Guillaume des Barres, Laurent du Blioul, Jean de Marnix, Remacle d'Ardenne,
Jean le Sauch, Georges d'Esplechin, Alexandre de Herbais remplissaient les
fonctions de secrétaires. Le conseil privé devait suivre partout la gouvernante et s'assembler en tel lieu et chaque fois qu'elle le jugerait convenable. Le chef du conseil, Jean Caulier, et les maîtres des requêtes étaient tenus de siéger deux fois par jour pour expédier les affaires courantes, et de lui adresser annuellement un rapport. Marguerite avait exclusivement la signature des lettres closes, la garde des sceaux, le pouvoir de convoquer les états. C'était à elle que les états comme les particuliers avaient à recourir pour toutes leurs communications avec le gouvernement. Le comte de Nassau, maintenu dans sa charge de capitaine général des gens d'armes, lui était subordonné dans l'exercice de son commandement. Le grand conseil de Malines, le conseil souverain de Brabant, les autres cours et tribunaux étaient placés sous l'autorité de la gouvernante et du conseil privé ; il leur était expressément défendu de dépêcher aucune lettre de grâce, de placet, de commissions, de pardon, de sureté, de répit ou autres semblables. Ces différentes dispositions, dit M. Altmeyer parlant de ces corps, étaient autant d'infractions à leurs privilèges : cela est vrai, mais il est juste de remarquer que ces privilèges ils les tenaient du gouvernement lui-même. Après la prise de Tournai, Charles-Quint, s'appuyant sur une demande des chefs de la bourgeoisie, abrogea, le 14 février 1522, les règlements de 1340 et 1371, qui avaient donné lieu, disait-il, à des abus préjudiciables aux bourgeois, occasionné des dettes excessives, porté les gens de métier à négliger leur travail pour rechercher les offices de jurés, échevins ou eswardeurs, cause de ruine pour eux et pour leurs familles. Il était ainsi arrivé, ajoutait-il, que les eswardeurs, au lieu d'élire les bourgeois les plus notables, les plus vertueux, les plus sages, les plus riches et les plus expérimentés, avaient, la plupart du temps, appelé à composer la loi, et même nommé aux charges de judicature simples gens de mestiers ne sachant ni lire ni escripre. Il y substitua un nouveau règlement qui réduisait de vingt membres à quatorze le collège des jurés. Ces quatorze membres, deux prévôts et douze jurés, étaient à la nomination du souverain, ainsi que les deux mayeurs et les échevins, qui de quatorze n'étaient plus que douze. A ces deux corps furent dévolus l'administration de la ville et le jugement des affaires criminelles, sous le ressort du conseil de Flandre et du grand conseil de Malines. Pour les affaires d'importance, ils étaient tenus d'appeler dans leur sein le gouverneur et le grand bailli, ou leurs lieutenants, et de décider à la pluralité des voix. Plus tard même, un règlement du 4 août 1551, déterminant la manière de compter les suffrages dans les assemblées des magistrats où assisteraient ces deux hauts fonctionnaires, prescrivit de recueillir les voix par tête, et en attribua trois au gouverneur, et deux au grand bailli. Enfin, enlevant à la démocratie toute influence politique, le règlement de 1522 laissa seulement aux doyens et aux sous-doyens la connaissance des affaires de leurs métiers et des infractions à leurs statuts. Quant aux métiers ou bannières, ils ne furent plus appelés qu'à consentir les levées d'argent, l'établissement d'impôts, les accords d'aides[5]. C'était-là, dit M. Henne, un redoutable avis annonçant aux communes des Pays-Bas le sort réservé à leurs constitutions[6]. Vers la fin de l'année 1521, les états généraux des Pays-Bas avaient été convoqués à Gand. La session s'ouvrit le 23 décembre. A la séance d'ouverture, Charles-Quint leur exposa que la guerre, provoquée par le roi de France et le sire de Sedan, lui avait imposé de si fortes dépenses, qu'il était endetté de cinq cent mille florins, bien qu'il y eût employé cinq cent mille écus venus d'Espagne. Or, disait-il, il allait être obligé de se rendre dans cette partie de ses domaines, où sa présence était impérieusement exigée par la gravité des événements, et ce voyage lui coûterait au moins deux cent mille écus. Il annonçait en même temps qu'il avait résolu de lever, aux frais du pays, deux mille chevaux et six mille hommes de pied, dont l'entretien exigerait une dépense de soixante mille florins par mois. Il requérait donc les états de voter les aides nécessaires à cet effet[7]. Les députés, sans se prononcer sur ces propositions, se séparèrent pour en référer à leurs principaux. Au mois de janvier suivant, la Flandre accorda cent mille livres ; le Hainaut, trente-deux mille ; Valenciennes, huit mille. Mais cet exemple ne fut suivi que par la Hollande, qui accorda soixante mille livres (mars 1522), et par la Zélande, qui en accorda trente-cinq mille payables en trois ans[8]. Les Pays-Bas étaient loin de se trouver, en ce moment, dans une situation prospère. Des épidémies désolaient nos provinces ; les relations commerciales avec la France étaient rompues ; les Frisons se maintenaient en état d'insurrection, et leurs pirates, aidés par ceux de la Gueldre, causaient de grands dommages à la Hollande et à la Zélande ; l'imminence enfin d'une guerre avec le Nord tenait dans l'anxiété nos provinces maritimes menacées dans leur commerce et dans leurs intérêts les plus graves. Christiern II, roi de Danemark et de Norvège, avait épousé Isabelle, sœur de Charles-Quint. Mauvais époux, prince cruel, il était en lutte avec le clergé et la noblesse de ses états. Charles-Quint déjà lui avait fourni six vaisseaux de guerre. avec lesquels, et en s'aidant pour lever des troupes des premiers fonds provenant de la dot d'Isabelle, il était parvenu à faire rentrer dans le devoir une partie de ses états insurgés. Le 1er juillet 1521, il était arrivé à Anvers accompagné d'un nombreux cortège, et y avait été reçu avec de grands honneurs[9]. Il venait réclamer le reste de la dot de sa femme, et proposer à Charles-Quint une alliance offensive contre son oncle Frédéric, à qui il contestait les duchés de Schleswig et-de Holstein, et contre les villes maritimes de la Baltique, Lubeck surtout, qui soutenaient contre lui ses sujets révoltés[10]. Charles-Quint ne s'était pas montré éloigné d'accueillir cette proposition ; il avait même soumis aux états de Brabant et de Hollande un projet de confédération avec le Danemark. Mais une guerre avec les villes maritimes du Nord, c'était, comme résultat immédiat, une hausse énorme dans le prix des grains c'était la ruine du commerce des Pays-Bas. Marguerite et le conseil privé insistèrent sur ces dangereuses conséquences ; ils firent ressortir les tendances de Christiern vers la réforme, et réussirent à écarter le projet d'alliance. Le roi quitta sur le champ les Pays-Bas, et, rentré dans ses états, non content S'exhaler sa colère en termes furibonds, il fit saisir les ambassadeurs de son beau-frère et les jeta en prison au mépris du droit des gens. Charles-Quint usa de représailles, et fit incarcérer les ambassadeurs danois au château de Vilvorde[11]. Les relations entre le roi de Danemark et les Pays-Bas allaient malheureusement avoir des résultats plus graves et plus sérieux que ces querelles domestiques. L'absence de Christiern avait favorisé les progrès de l'insurrection en Suède, et les Lubeckois, à la nouvelle de ses projets contre leur indépendance, avaient pris les armes. La guerre avait à peine éclaté, que déjà les Pays-Bas en éprouvaient le funeste contrecoup. La Hanse, en possession du monopole du trafic du Nord, tenant par le Sund le Danemark et les Pays-Bas dans sa dépendance, voyait avec une jalouse appréhension les progrès du commerce de nos provinces. Ces progrès étaient favorisés par les rois de Danemark, impatients de secouer le joug des villes hanséatiques. Déjà, en 1427, le roi Éric avait accordé aux marchands des Pays-Bas des privilèges particuliers qui avaient considérablement agrandi leur action dans les mers du Nord et particulièrement dans la Baltique. Le mariage de Christiern II avec Isabelle avait paru une occasion toute naturelle d'étendre ces avantages ; les Hanséates alarmés s'étaient rangés avec acharnement du côté des ennemis du roi, et n'avaient rien omis pour nuire au commerce des Pays-Bas. A diverses reprises déjà cette malveillance avait failli entraîner une rupture complète ; dès 1514, il avait fallu toute la modération des ambassadeurs de Marguerite, Corneille de Scheppere, Gaspard de Halmalle et Jacques de Voocht, pour prévenir une guerre déclarée. L'alliance projetée entre Christiern et son beau-frère la fit éclater immédiatement : sans autre déclaration, les Lubeckois saisirent dans la Baltique deux cents navires chargés de céréales, et interdirent au commerce des Pays-Bas la navigation des mers du Nord[12]. Cette brusque agression jeta le trouble dans les affairés et causa une hausse extraordinaire dans le prix des grains[13]. Dans plusieurs villes, à Louvain, à Vilvorde, la cherté du blé excita des mutineries de femmes[14]. Pour apaiser les esprits il fallut recourir à des mesures inusitées. Il fut défendu, sous peine de confiscation et correction arbitraire, d'exporter les céréales et de les vendre ailleurs qu'aux marchés francs. Afin de pourvoir au désordre de la cherté du prix des blés et de subvenir au pauvre peuple, on ordonna le récollement de tous les grains se trouvant dans les greniers des abbayes, monastères, couvents, hostels-Dieu, nobles, bourgeois, rentiers, censiers, marchands, et autres tenans blés[15]. Ces mesures furent exécutées avec une extrême sévérité dans toutes les provinces[16]. Elles furent cependant modérées en faveur des Malinois, grime sans doute à la présence de Marguerite. Il leur fut permis de se procurer des grains dans les autres provinces, et ils en exprimèrent leur reconnaissance au chancelier de Brabant, Jérôme Vanderfoot, auquel ils firent don d'une coupe de vermeil[17]. On recourut en même temps aux négociations. Le gouvernement et les états de Hollande s'empressèrent de désavouer toute participation aux projets de Christiern II. Charles-Quint, intéressé d'ailleurs à étouffer une querelle qu'eût exploitée la France, appuya ces démarches. Il pressa son beau-frère de restituer aux Lubeckois les biens qui leur avaient été enlevés et de leur rouvrir le commerce de ses états. Mais, loin d'avoir égard à ces demandes, l'irascible Danois accabla de vexations les marchands des Pays-Bas, et leur occasionna plus de trois cent mille florins de pertes[18]. Les réclamations du gouvernement eurent plus de succès auprès des Hanséates : la paix fut momentanément rétablie, et elle amena tout de suite une baisse dans le prix des céréales[19]. Quelque pressé que fût l'empereur de se rendre en Espagne, où son autorité était méconnue depuis deux ans, il ne voulut point quitter les Pays-Bas avant d'avoir mis ordre tant aux affaires publiques qu'à ses intérêts propres et à ceux de sa famille. Il avait notamment à régler les parts d'héritage de son frère Ferdinand et de sa tante Marguerite. Celle-ci renonça à tous ses droits à la succession de son père Maximilien en faveur de Charles, l'aîné de ses neveux, moyennant une somme de deux cent cinquante mille livres de quarante gros payable en dix années. Les droits de Ferdinand comprenaient une part dans les états et seigneuries échus aux fils de Philippe le Beau. Le conseil privé et la chambre des comptes du Brabant furent consultés sur la qualité, la nature et la condition des pays de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, d'Outre-Meuse et du territoire de Malines en matière de succession[20]. Dans un mémoire du 6 décembre 1521, ces conseils estimèrent que ces pays ne pouvaient être ni démembrés, ni divisés, et devoient revenir intacts au fils allé du souverain, avec charge toutefois d'allouer à ses frères et sœurs un revenu suffisant pour leur entretien, sans grande charge ni diminution pour le domaine[21]. Ferdinand était le 10 décembre 1521 à Bruxelles ; il renonça, au profit de son frère aîné, à tous les droits à la succession de son père aux Pays-Bas en échange des états allemands de leur commun héritage, c'est-à-dire, de l'Autriche, de la Carinthie, de la Carniole, de la Styrie et du Tyrol. De cette époque date la division de la maison d'Autriche en deux branches, la branche aînée, ou maison d'Autriche espagnole, dont Charles-Quint fut le chef ; la branche cadette, ou maison d'Autriche allemande, dont Ferdinand fut le premier rameau, et qui s'agrandit bientôt par l'avènement de ce prince aux couronnes de Bohème et de Hongrie. Durant l'hiver de 1521 à 1522, l'empereur visita quelques-unes de nos provinces, et y régla plusieurs points de haute importance. La tentative des Français sur Liège avait rattaché indissolublement Érard de la Marck à la cause de l'empereur, et il l'avait prouvé en fournissant à son allié de l'argent, des soldats et des canons. Charles-Quint, de son côté, avait non seulement confirmé, le 27 juillet 1521, le privilège du 24 juin 1518, qui avait déchargé les Liégeois de porter devant la chambre impériale les causes n'excédant point la valeur de six cents florins d'or du Rhin en matière réelle et immobilière, ou de trois cents florins en matière mobilière et personnelle, mais il avait porté au double le taux fixé par Maximilien pour le dernier ressort. Il obtint ensuite de Léon X la pourpre romaine pour le prince-évêque, et voulut en remettre lui-même les insignes au nouveau cardinal. Il se rendit à cet effet à Liège, au mois de janvier 1522, et, ayant remonté la Meuse avec Érard, il procéda à cette cérémonie en l'église de Saint-Aubin à Namur, le 22 janvier. Cette solennité fut rehaussée par la création de plusieurs chevaliers, et le magistrat de Namur, à. la suite d'un somptueux banquet, donna à. ses illustres hôtes le spectacle d'un combat d'échassiers, si cher à la population namuroise. Ce fut alors, parait-il, que les brasseurs de Namur obtinrent la faculté de fabriquer leur bière sans payer aucun droit ni gabelle, privilège dont ils se montrèrent depuis fort jaloux[22]. Érard de la Marck, appelé dans le conseil privé, comme nous le disions tout à l'heure, lia de plus en plus l'intérêt de ses états à celui de nos provinces. Mais il fallait penser à l'avenir. Charles-Quint usa de tout son ascendant pour l'amener à se désigner un successeur dévoué à la maison d'Autriche. La chose rencontra de sérieux obstacles de la part du chapitre de Saint-Lambert, qui y voyait une atteinte à ses prérogatives, et qui ne céda qu'après de longues négociations. L'empereur chargea sa tante de cette mission d'autant plus ardue qu'il s'agissait de vider, en même temps, les interminables différents avec l'évêché, au sujet des juridictions diocésaines et de Maëstricht. L'habile princesse conduisit ces négociations avec infiniment d'adresse et parvint à obtenir la coadjutorerie pour Corneille de Berghes, d'une famille notoirement dévouée à l'empereur[23]. Charles-Quint n'avait rien négligé pour s'attacher cette cité de Liège naguère si hostile à sa maison. Le 14 août. 1521, il avait alloué une pension de mille livres de quarante gros, monnaie de Flandre, aux bourgmestres, jurés et conseil de Liège, tant et si longuement que l'alliance et confédération estant entre lui et ses pays avec les états et pays de Liège seroit maintenue[24], et en attendant qu'on eût examiné la question de l'exemption des droits et tonlieux qu'ils sollicitaient en Brabant, en Hollande et en Zélande[25]. Un grand nombre de notables reçurent, en outre, des pensions spéciales[26]. A la même époque, un traité de libre commerce et de sûreté de voyage fut renouvelé entre les duchés de Lorraine et de Bar et le Luxembourg[27]. Nous l'avons dit, dans l'administration des Pays-Bas à l'époque où nous sommes, un système récent de centralisation tendait à se substituer à la puissante organisation des communes. C'était un moment de transition, et le gouvernement en souffrait sur beaucoup de points. Charles-Quint voyait le mal et il y mit obstacle autant qu'il était en lui, mais sa présence était impérieusement réclamée en Espagne ; il n'avait ni le temps ni les moyens d'y appliquer des remèdes efficaces et définitifs. Il dut se borner à donner des instructions à Marguerite, pour appeler toute l'attention de cette princesse sur une situation, qui exigeait, avec une vigilance exceptionnelle, l'étude approfondie des choses et des hommes. Après la mort de Charles le Téméraire, un grand nombre de seigneurs s'étaient mis au service de la France et avaient transporté dans ce pays le siège de leurs intérêts. Charles-Quint recommanda expressément à la -gouvernante de ne point perdre de vue les familles nobles dont les biens étaient situés à proximité de la frontière, et de ne rien omettre pour mettre obstacle à la transmission de ces biens à des héritiers étrangers. Informé de la fin prochaine de Louis de Rollin, sire d'Aimeries, l'empereur prescrivit des mesures pour empêcher ses biens de tomber en des mains exotiques[28]. Au premier avis de la mort de ce seigneur, Marguerite devait faire occuper ses places fortes et surtout son château d'Aimeries, dans l'intérêt de la sûreté du prince et de ses pays, et afin de les garder au profit de celui ou de ceux qui y auroient droit. Puis, tout en les gardant, on traiterait de leur acquisition avec les héritiers légitimes. Charles-Quint érigea donc en principe, principe consacré par des ordonnances postérieures[29], la défense de vendre ou de transporter aucune terre située sur les frontières sans l'autorisation du gouvernement. Les guerres particulières, ce triste legs de la féodalité, n'étaient pas entièrement éteintes, non seulement entre les villes et les seigneurs, mais même entre les particuliers et les villages[30]. Ce recours à la violence extra-légale était surtout, fréquent dans les provinces wallonnes. Charles-Quint enjoignit à ses officiers de prévenir et de réprimer les voies de fait par tous les moyens en leur pouvoir. Les différends éclatant entre seigneurs, villes ou provinces devaient être immédiatement soumis à des arbitres chargés de vider le débat en appointant sommairement les parties. Ensuite il défendit formellement d'édifier des maisons fortes sans son autorisation. Toutes les instructions données aux gouverneurs des provinces continrent la défense de permettre à personne, de quelque qualité ou condition qu'il fût, d'élever aucun fort ou d'augmenter les fortifications des forts existants, sans y être spécialement autorisé par lui ou par la régente[31]. Durant tout son règne, le gouvernement s'appliqua aussi à défendre le commun peuple contre les entreprises des seigneurs féodaux. Ainsi nous le voyons, en 1521, intenter un procès à Baudouin, seigneur de Carnières, pour certaines insolences, foules et outrageux maintiens faits à l'encontre de ses manants dudit Carnières[32]. Il ne pouvait échapper à l'intelligence d'un prince doué
au plus haut degré du talent de discerner le mérite, remarque un de ses
récents historiens[33], auquel nous
sommes redevable de la plupart de ces détails, que la bonne administration
tient plus au choix des fonctionnaires qu'à la perfection des règlements.
Aussi ses instructions recommandent-elles, sur ce point, de n'avoir égard
qu'au mérite et proscrivent toute faveur personnelle afin
de sauvegarder ainsi son honneur et sa conscience. Les commissaires du
gouvernement chargés de procéder au renouvellement des magistratures
municipales eurent ordre de rechercher et commettre
gens de bien, idoines et suffisants tant pour le bien de l'empereur que pour
le bien de la justice et du pays. L'empereur prescrivit en particulier
à sa tante de bien s'assurer de l'aptitude comme de la fidélité des officiers
des villes, des places fortes et des châteaux, et l'autorisa à remplacer
provisoirement, jusqu'à disposition ultérieure, les incapables et les
suspects. Sur toutes choses icelluy seigneur empereur vouloit et entendoit le fait de la justice estre entretenu en bon ordre. A cet effet, il chargea Marguerite de rechercher les améliorations à introduire dans l'organisation judiciaire, et de pourvoir, après information, aux omissions, abus ou inconvénients, qui se présenteraient. Il prescrivit l'exacte observation des lois, sous peine, pour les officiers, d'être destitués de leurs offices ; pour les particuliers, d'être punis arbitrairement, sans faveur ni exception, et en exemple pour tous. Les procès où il était intéressé devaient être vidés le plus promptement possible, et il ordonna de modifier le tribunal auquel ils étaient déférés, le Camergericht du Brabant, afin que la justice du domaine fût mise en bon ordre. Une ordonnance du 2 mai 1522 attribua au conseil de Malines le droit de désigner, en cas de vacance, trois personnages vertueux, de bonnes mœurs, experts, idoines et suffisants à l'état de conseiller, pour que l'empereur en prit l'un et le pourvût dudit état[34]. Cette disposition, on l'a remarqué avec raison, était digne du prince qui préludait à l'affranchissement du pouvoir judiciaire, lorsqu'il écrivait au même conseil : S'il m'arrivoit par importunité ou ignorance de signer aucunes lettres pour délayer ou différer le train de justice, ou pour donner loy et forme de procéder ès causes pendantes audit grand conseil, chose dont je me garderai tant que je pourrai, je veux qu'à telles lettres ne soit aucunnement acquiescé ni obéy, mais que, nonobstant et sans avoir égard à icelles, lesdits du conseil fassent aux parties bonne et briève expédition de justice, sans faveur ou dissimulation, gardant ordre, stile et forme de procéder comme en bonne justice et équité faire se doit[35]. L'administration des finances réclamait de promptes réformes : elle fut l'objet de recommandations spéciales. Il fut enjoint à Marguerite de réviser l'état des pensions, et d'aviser aux moyens de racheter les parties du domaine engagées. On devait commencer par les terres du pays d'Outre-Meuse, dont les états venaient d'allouer à cet effet une somme de vingt mille florins d'or. L'inégale valeur des monnaies dans les diverses provinces donnait lieu à de fâcheuses perturbations dans les relations d'affaires et de commerce ainsi qu'à des troubles lors de la perception des impôts. Charles-Quint invita sa tante et ses ministres à étudier avec soin toutes les questions se rattachant à une réforme en cette matière et à l'organisation des nombreux établissement monétaires du pays. Voyant une cause de ruine dans le luxe de la noblesse qui vivoit magnifiquement, tenoit table ouverte et dépensoit plus qu'elle n'avoit de rentes[36], l'empereur annonça l'intention d'y mettre un frein. Le conseil privé eut ordre de préparer des règlements somptuaires défendant, entre autres choses, de porter robes et habilements de drap, d'or et d'argent, satins brochés, cramoisy et aultres semblables. Gêné dans ses projets par les privilèges des communes et surtout par la Joyeuse-Entrée du Brabant, dont il étoit adverti que quelques articles qu'il avoit jurés, estoient non raisonnables, il recommanda à sa tante de recouvrer ces articles, par bon et discret conseil, pour les faire examiner et redresser s'il y avoit lieu. Il défendit les réunions d'états, les alliances de villes, non autorisées par le gouvernement, sous peine de rébellion et de châtiment arbitraire. Bien décidé à limiter toutes les influences distinctes de l'action politique et administrative du souverain, il chargea Marguerite d'envoyer à Rome un homme de bien pour y poursuivre les affaires des Pays-Bas. Toute opposition au gouvernement devait être réprimée sur le champ, si elle venait des laïques, en les faisant appréhender au corps et par la saisie de leurs biens ; si elle avait pour auteur des gens d'église, il fallait mettre la main sur leurs possessions temporelles. Toute résistance devait être promptement et énergiquement réprimée, soit par bonne et aspre justice, soit par la force. Il laissait la régente libre d'agir par tous moyens et expédients raisonnables, comme il le ferait lui-même, pour gagner les gens par des dons, des promesses ou d'autre manière, afin d'éviter de plus grands inconvénients ; mais, dans le cas où il serait nécessaire de recourir à la rigueur et force secrète, il lui était prescrit de consulter son conseil. Ces projets de réorganisation intérieure ne détournaient point l'empereur de l'étude des mesures propres à la défense du pays. Il s'occupa spécialement des moyens d'augmenter la marine. Il engagea les provinces maritimes, et en particulier la Hollande et la Zélande, à équiper des navires pouvant servir à la fois contre l'ennemi en temps de guerre, et transporter des marchandises en temps de paix. Il ordonna de soumettre à l'examen d'hommes compétents les règlements des amirautés de France, d'Angleterre et d'Espagne ; il fit étudier de même celui qui avait été donné aux Pays-Bas du temps de monsieur de Ravenstein, afin de formuler une loi maritime répondant à tous les besoins. Par ses ordres, on dressa l'inventaire de l'artillerie, de la poudre, des autres munitions de guerre emmagasinées dans les arsenaux et garnissant les places fortes et châteaux. Il fut recommandé à Marguerite de s'approvisionner de salpêtre, de soufre et des autres substances nécessaires à la fabrication de la poudre, ainsi que de boulets de calibre pour les divers engins en usage. Les canons démontés ou hors d'état de service furent remontés sur leurs affûts, et Jean Poppinger reçut l'ordre de fondre à Malines de nouvelles bouches à feu[37]. Il fut prescrit aux gouverneurs et aux officiers des villes frontières d'engager les communes et les corps de métiers à se pourvoir de pièces de gros calibre, en leur promettant de les aider par des subsides. Ces officiers devaient veiller à ce que chaque bourgeois fût muni au moins d'une arquebuse à croc, et à ce que les places soumises à leur commandement ne manquassent jamais d'artillerie, de poudre et de munitions de guerre. On enjoignit aussi aux habitants des villes frontières de faire des provisions de blés, de lard, de viandes salées, de vin, de cervoise pour un an ou six mois au moins ; en cas de refus, les gouverneurs et les capitaines étaient autorisés à les y contraindre. Les magistrats des villes de Brabant et ceux de Malines furent invités à établir des ponts-levis, à curer et à approfondir les fossés, à tenir leurs fortifications en bon état, à être en un mot constamment en mesure de résister à toute attaque. C'est ici le lieu, pensons-nous, d'entrer dans quelques détails sur notre organisation militaire, telle qu'elle existait immédiatement avant Charles-Quint et au commencement de son règne ; nous passerons successivement en revue, d'une manière succincte, les principaux points de cette organisation. Au commencement du XVe siècle, nos institutions militaires étaient encore à la fois féodales et communales. Si Philippe-le-Bon avait commencé à tenir sur pied des corps de troupes permanentes, ni lui ni ses successeurs n'avaient renoncé à l'emploi des anciennes milices nationales. L'on avait vu, dans les temps les plus récents, les Français chassés du Luxembourg par les bonnes gens du comté de Namur, le Hainaut défendu par les milices de ce comté et du Brabant, la bataille de Guinegate (1479) gagnée par les communiers flamands, qui se battirent comme des héros. Aussi Philippe le Beau et Charles-Quint se gardèrent-ils bien de se priver de cet appui[38] ; on les voit même quelquefois encore, recourant aux levées en masse, appeler à la défense du pays tous les hommes de dix-huit jusqu'à quarante et cinquante ans[39] et au delà[40] en état de porter les armes. Les serments de Bruxelles, qui avaient pris une part glorieuse au siège de Tournai, eurent d'autres occasions de se distinguer, et ce fut sans doute pour en tirer de meilleurs services que Charles-Quint convertit, le 2 octobre 1531, les soixante confrères du serment des archers de Namur en une compagnie de cent arquebusiers[41]. Dans ses instructions de 1522 à Marguerite, ce prince si habile et si prévoyant lui prescrivit d'établir les rôles de tous les hommes propres au service et d'engager les grandes villes à lever à leurs frais, et, suivant l'importance de leur population, un certain nombre de soldats. Jusqu'à la fin de son règne, on trouvera des appels adressés aux milices féodales et communales ; fréquemment aussi on verra les paysans des frontières et les bourgeois des villes, conduits par leurs officiers, combattre vaillamment l'invasion étrangère et faire essuyer aux agresseurs de sanglantes défaites. Déjà cependant les milices ne constituaient plus que la partie secondaire de l'armée ; elles n'étaient même plus généralement appelées à agir que dans les contrées auxquelles elles appartenaient. L'armée proprement dite était formée de corps réguliers, au sujet desquels nous devons entrer dans quelques détails spéciaux. Nous allons donc nous occuper successivement de l'organisation de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et de ce que l'on appelle aujourd'hui le génie militaire. A l'origine le prince ne tenait à sa solde, d'une manière permanente, que quelques corps peu nombreux de fantassins. Jusqu'en 1508, ces corps ne dépassaient pas le chiffre de deux mille hommes, mais on résolut alors de le porter à dix mille. Les autres corps levés en temps de guerre étaient engagés au mois, licenciés à la conclusion de la paix, souvent môme plus tôt, quand l'argent manquait. Le recrutement s'effectuait principalement dans les Pays-Bas, et c'est à tort que l'on n'a vu trop souvent que des Allemands, des Espagnols, des Italiens, dans ces vaillantes légions, si redoutables pour la France, qui devinrent la souche des vieilles bandes illustrées par la guerre de Trente ans, de ces intrépides régiments wallons si justement renommés et dont les glorieux services, dit avec raison M. Henne, ont laissé des souvenirs encore vivants en Espagne et en Autriche[42]. Lorsqu'une levée avait lieu dans les campagnes et dans les
villes féodales, les officiers du gouvernement désignaient les hommes les
plus aptes au service jusqu'à concurrence du nombre fixé. Lorsqu'un
contingent était demandé à la province, la répartition s'établissait entre
les paroisses au prorata de leur part dans les aides. Au premier appel du
tambour ou de la cloche, chaque homme désigné pour le service était tenu de
rejoindre son enseigne, sous peine de la hart, en cas de désobéissance.
Lorsque les levées avaient lieu par enrôlements volontaires, des commissions
étaient délivrées à des capitaines envoyés dans des localités déterminées.
Des messagers du gouverneur rassemblant, au son du
tambourin ou de la cloche, les manans et habitants, leur disaient : que tous
ceulx qui vouldroient servir l'empereur et gagner gages, se trouvassent au
logis de l'officier du lieu, où on leur donnerait un philippus sur la main ;
qu'ils seraient conduits ensuite à leur destination. Il était prescrit
aux recruteurs de n'admettre que les hommes dispos
et idoines à la guerre ; de repousser les
impotens, principalement en leurs bras et mains, ou notoirement noyseux et
mal conditionnés. Avant de se mettre en marche, les recrues juraient Dieu leur père créateur, et sur dampnation de leur âme,
qu'elles serviraient loyalement et fidèlement leur prince envers et contre
tous ; qu'elles ne quitteroient leur corps ou lieu de garnison, sans le su,
gré et passeport de leur capitaine, à peine d'être punies comme parjures et
désobéis-sans ; davantage qu'ayant bon payement de leur soldée, elles ne
mangeroient, pilleroient, ni n'adommageroient les sujets du pays leur faisant
ou pourchassant quelque outrage, à peine de la hart[43]. Il n'existait pas d'organisation uniforme pour l'infanterie des milices. Les piétons des villes étaient soumis à des règlements émanant de leurs magistrats. Ils marchaient séparément, en nombre indéterminé, sous leurs bannières, commandés soit par leur châtelain, soit par l'amman, l'écoutète, le bailli ou le prévôt de leur cité. Les milices féodales, formées de vassaux et de tenanciers astreints à une prestation militaire, étaient conduites par les officiers du souverain ou par leurs chefs héréditaires. L'infanterie régulière était organisée en enseignes et en corps spéciaux directement affectés à la garde des places fortes ; ces derniers constituaient en réalité la seule infanterie permanente. Les enseignes, formées d'hommes appartenant aux mêmes localités ou aux mêmes provinces, étaient désignées sous la dénomination générique de Bas-Allemands et de Wallons, tout en conservant néanmoins les noms spéciaux des provinces ou même des villes qui les avaient fournies, Flamands, Artésiens, Luxembourgeois, Namurois, Bruxellois, Anversois, Malinois, etc. Les Bas-Allemands — Nederlandschen — comprenaient les piétons fournis par les contrées de la langue teutonique : le Limbourg et les cantons allemands du pays d'Outre-Meuse, la Hollande, la Zélande, la Frise, l'Overyssel, le pays d'Utrecht et la Gueldre ; les Wallons, ceux que fournissaient l'Artois, le Hainaut, le comté de Namur, les quartiers wallons du Brabant et d'Outre-Meuse, Lille, Douai, Orchies, Tournai et le Tournaisis. La Flandre et le Brabant n'entraient point dans cette division ; leurs soldats conservaient le nom de Flamands et de Brabançons. Il y avait entre les corps de Bas-Allemands et de Wallons des différences tranchées : les premiers rappelant le système allemand ; les seconds se rapprochant du système français. Jusque vers les dernières années du règne de Charles-Quint, l'enseigne constitua l'unité de corps ; sa composition numérique varia à l'infini, depuis deux cents hommes jusqu'à cinq cents. L'enseigne wallonne comptait d'abord ce dernier nombre. Ses cadres comprenaient un capitaine, un lieutenant, un porte-enseigne, deux trabans, un fourrier, cinq sergents de bande — centeniers —, cinquante rotmeesters — dizainiers —, un clerc des montres, un chirurgien, deux tambourins et deux fifres. L'enseigne des Bas-Allemands comptait quatre cents ou quatre cent vingt-cinq hommes. Elle était composée de la manière suivante : un capitaine, un porte-enseigne, un sergent de bataille — velt weyffel —, un chapelain, un clerc des montres, deux sergents ou guidons — weyffels —, un fourrier, un chirurgien, un tambour, un fifre, quatre ou huit hallebardiers pour la garde du capitaine. Les enseignes brabançonnes avaient l'organisation des Bas-Allemands, mais les enseignes flamandes ne contenaient généralement que trois cents hommes. Elles avaient un capitaine, un porte-enseigne, deux sergents — weyffels —, un fourrier, un chirurgien, un tambourin, un fifre, un clerc des montres, deux hallebardiers[44]. Outre la division de l'enseigne en fractions de cent et de dix hommes on en trouve une autre en demi-centuries ou escadres, commandées par des gentilshommes ou principaux soudards[45]. Ce nom d'escadre, dont on a fait escouade par corruption, fut en usage jusqu'à la fin du XVIIe siècle, mais dans un sens administratif. Vers 1540, commença l'organisation partielle des enseignes en régiments. Ce fut seulement en 1552 que pour ranger les enseignes en meilleur ordre, pour donner plus d'action au commandement, pour mettre un terme aux querelles des capitaines qui se considéraient comme des chefs de corps indépendants, l'unité de régiment fut définitivement établie. Ce système, rendu général alors pour les Bas-Allemands, ne le fut pour les Wallons qu'en 1556. Il ne fut même appliqué, sous Charles-Quint, qu'aux enseignes placées sous les ordres du duc d'Arschot et du sire de Trélon. Le régiment fut composé d'abord d'un nombre indéterminé d'enseignes, cinq, huit, dix, quinze, seize, mais plus généralement dix. En 1552, on s'arrêta au nombre de huit, et ce chiffre devint la base uniforme de la nouvelle organisation. Sur la proposition du comte de Lalaing, les enseignes furent réduites à deux cent cinquante et plus tard à deux cents hommes seulement. Ramenées à ce chiffre, disait Lalaing[46], elles seroient plus d'effet pour combattre ; on ne seroit si empesché pour les loger ; les capitaines connoistroient mieulx leurs gens ; les soudards craindroient plus d'estre cassés ; ils auroient meilleur moyen de vivre, car tous les picquenaires pourroient avoir traitement et estre armés, et les harquebusiers auroient pour le moins manches de mailles. Mais malgré l'organisation générale en régiments, il resta toujours des enseignes en dehors de ces corps et plus spécialement affectées à la garde des villes ; on les appelait enseignes libres. On trouve encore, à la fin du XVIIe siècle, cinq compagnies wallonnes portant le nom des cinq compagnies ordinaires de Charles-Quint. L'état-major et les cadres d'un régiment bas-allemand comprenaient : un colonel, huit hallebardiers pour sa garde, un chapelain, un clerc ou secrétaire, un tambourin, un fifre ; le lieutenant du colonel, quatre hallebardiers pour sa garde ; un écoutète, un hallebardier, un prévôt, le lieutenant du prévôt, un clerc de justice — richt schryver —, un sergent de justice — richt weiffel —, six hallebardiers, six à huit exécuteurs des sentences ou bâtonniers — stocknechten —, un geôlier ou cipier, un maître des hautes œuvres, son valet, un chapelain, un sergent ayant la police des mœurs — hoerweiffel —, un maître du guet, un quartier-maître ou clerc des montres, un chirurgien. L'état-major et les cadres des régiments wallons du duc d'Arschot et du seigneur de Trélon, formés chacun de dix enseignes, comprenaient, outre le colonel, huit hallebardiers pour sa garde ; un lieutenant-colonel et six hallebardiers ; un prévôt, six hallebardiers, et deux varlets pour appréhender, un pourvoyeur des vivres, deux hallebardiers ; un chef du guet, un maréchal des logis, un garde-bagages, un fifre, un tambourin, un clerc, un maître des hautes œuvres et son valet. Les commissions délivrées aux colonels indiquaient les hauts officiers dont ils avaient la nomination, la solde de chacun d'eux, et le personnel qui leur était attaché. Les capitaines, commissionnés au nom de l'empereur, avaient la nomination des officiers subalternes, à l'exception des sergents et des fourriers ; ceux-ci étaient élus par les piétons, qui avaient la faculté de les changer à volonté, ou de mois en mois. De même que les milices, les soldats levés dans le pays s'équipaient et s'armaient primitivement à leurs frais. Pour obtenir plus de régularité dans l'armement, le gouvernement se décida, vers la fin du règne de Charles-Quint, à s'en charger lui-même. Une ordonnance du 5 avril 1551 statua que la distribution des piques, lances, demi-lances, arquebuses, harnois, et autres parties de l'armement des gens de guerre de pied et de cheval serait attribuée aux conducteurs de l'artillerie. Ces fonctionnaires remettaient au trésorier des guerres la note des armes distribuées ; le prix leur en était remboursé par le payeur des troupes, à moins que le capitaine général n'en décidât autrement[47]. La poudre était remise par les officiers d'artillerie aux commandants des enseignes, avec recommandation d'être économes dans les demandes, parce que les piétons gaspilloient beaucoup de poudre sans besoin[48]. Les piétons touchaient une indemnité pour leur habillement, qui était renouvelé chaque année[49]. Ils portaient généralement les couleurs de leur capitaine, du chef qui les avait levés, de leur ville ou de leur province ; tous avaient la croix rouge de Saint-André sur la poitrine et sur le dos. Dans les premières années du XVIe siècle, il y avait encore une grande diversité dans l'armement des troupes d'infanterie. Les milices s'accoustroient de cranekins, arcs à main, piques, espées, hallebardes, brighandines et salades. Ailleurs on nous apprend qu'elles s'embastonnoient de demi-corsetz, hautbergeons, brigandines, piques de quinze pieds de long et plus, arbalestes, coulevrines et aultres bastons[50]. L'obligation de s'armer à leurs frais n'était pas une lourde charge pour des gens tenant de leurs pères le droit de porter les armes pour la défense de leurs libertés. Aussi voit-on dans les mains des habitants mêmes des campagnes des armes de toute espèce. L'usage des armes à feu fut de bonne heure généralement répandu. Les milices des villes, plus régulièrement armées d'abord de longues piques ou de hallebardes et de courtes épées, d'arbalètes, d'arcs et de couleuvrines, modifièrent leur armement quand les perfectionnements apportés par les Espagnols et les Allemands aux armes à feu eurent rendu ces armes plus maniables ; alors dans toutes les grandes villes se formèrent des serments d'arquebusiers[51]. A l'époque où nous sommes, bien qu'on eût renoncé pour
l'infanterie à l'arc et à l'arbalète, ces armes, la pique aussi, étaient
jugées par beaucoup de gens préférables aux armes à feu. Ces dernières, à
l'origine, étaient fort pesantes, peu maniables et inutiles en temps de
pluie. Quant aux arquebusiers, dit un écrivain militaire du XVIe siècle, ils n'osoient pas coucher en joue, leurs bastons étant
gros, pétards courts, pesans et mal aisés à manier, comme épais et trop
renforcés qu'ils estoient, au prix de leurs balles fort minces plus assez que
d'une pistolle — pistolet — où ils mettoient
le feu avec la main, tournant en effroi et sursaut le visage d'un aultre
costé en arrière, avec par avanture plus de peur que ceux n'en devoient avoir
à qui le coup s'adressoit, si que c'eust esté un bien grand malheur s'il y
eut donné, puisque la mire ne s'y adressoit pas[52]. Plus tard
Charles-Quint regretta, devant Tunis et devant Alger, de n'avoir plus ses
archers et ses arbalétriers à cheval pour repousser les Arabes, et riposter
aux archers maures et turcs[53]. L'emploi des
armes à feu n'en prévalut pas moins. Du jour où ils entraient en activité, les piétons fournis par les villes ou par les campagnes étaient à la solde du souverain ; les communes avançaient ordinairement cette solde pour quinze jours et déduisaient l'avance ainsi faite de leur part dans les aides. Pour ceux des corps réguliers, la paye commençait du jour de la montre et de la prestation de serment. Après le licenciement des armées, le gouvernement conservait à son service les capitaines et les cadres de leurs compagnies ; il leur était alloué un traitement de non-activité s'élevant à 150 ou 200 livres pour les capitaines ; à 40 pour les enseignes ; à 30 pour les sergents de bande ; à 18 pour les fifres et les tambours. Les milices et les enseignes d'infanterie nationale étaient commandées par des capitaines du pays, et généralement pris dans la localité même où elles étaient levées. Nos provinces et la Franche-Comté en produisirent un nombre considérable que les événements mirent plus d'une fois glorieusement en scène. Lors de la formation des régiments, le commandement en fut également donné à des seigneurs du pays, et nos armées elles-mêmes, surtout dans les premières années du règne de Charles-Quint, eurent presque toujours pour chefs des généraux appartenant aux Pays-Bas. Tous le servirent, dit M. Henne, sinon avec une haute intelligence, du moins avec une fidélité inébranlable, avec un courage à toute épreuve, et il eut lieu de regretter plus d'une fois de leur avoir plus tard préféré des étrangers. S'il n'eût eu d'autres que de notre nation, disait le comte Charles de Lalaing, il eût peut-être fait plus grand exploit qu'il n'a fait ; ses affaires auroient mieux marché s'il avoit eu autant de confiance en nous que dans les étrangers et nous n'aurions pas fait moins que nos prédécesseurs[54]. Ce furent nos contrées aussi, ajoute l'historien cité, qui produisirent l'homme le plus versé de son temps dans l'art de la guerre, Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein. Si l'auteur des Instructions de toute manière de guerroyer tant par mer que par mer[55] ne joua pas un rôle actif dans les guerres du XVIe siècle ; si la part qu'il avait prise aux troubles de la Flandre et du Brabant sous Maximilien, l'écarta des armées du fils et du petit-fils de ce prince, il ne resta pas moins réputé un des plus habiles et des plus judicieux capitaines de son époque[56]. L'infanterie étrangère que Charles-Quint employa dans ses armées des Pays-Bas, se composait. de lansquenets — landsknechten — ou Hauts-Allemands, d'Espagnols et d'Italiens. Ces derniers y figurèrent toujours en petite quantité ; les Espagnols étaient peu nombreux aussi dans le principe, mais Charles-Quint en augmenta le nombre, dès qu'il eut à redouter le contact des mécontents de nos provinces avec les protestants d'Allemagne. On adjoignit assez souvent des lansquenets aux milices pour faire la poincte auxdits piétons ou former tête de colonne. Ces corps étaient fractionnés selon les exigences du service, et une compagnie fournissait souvent des détachements à plusieurs petites places de guerre. L'infanterie allemande ne comprenait plus guère que deux espèces de soldats, des piquiers et des couleuvriniers ou des arquebusiers. Les piques des Allemands, comme celles des Suisses, étaient plus longues que celles des autres nations ; mais ces derniers tenaient leur arme à deux mains par le milieu, tandis que les lansquenets la tenaient par l'extrémité de la hampe et la manœuvraient avec une grande habileté[57]. Quant aux qualités de ces diverses troupes, nous citerons le jugement de l'ambassadeur vénitien Michel Surriano. L'infanterie espagnole, dit ce diplomate, par sa circonspection et la patience avec laquelle elle supporte les fatigues, se plie facilement aux lois de la discipline ; elle surpasse toutes les autres, lorsqu'il s'agit de dresser une embuscade, de défendre un défilé, de faire une retraite, de soutenir un siège. L'infanterie italienne, plus hardie, excelle dans les charges, dans les escarmouches, dans les assauts et dans les rencontres où l'on combat à la légère. Les Wallons se battent bien, surtout en rase campagne, et se font remarquer par leur belle ordonnance. Il en est de même des Allemands[58]. Ces étrangers, troupes mercenaires dont la solde était
plus forte que celle des troupes nationales, loin de rendre plus de services
que ces dernières, furent au contraire, l'occasion de nombreux revers, non
faute de valeur, mais faute de discipline. Cupides et débauchés, ils se
signalèrent plus souvent, par le pillage que par leurs exploits[59]. C'est chose incroyable, dit un contemporain parlant
des Allemands au service de Charles-Quint[60], que l'insolence des gens de cette nation. Non seulement
ils sont pleins d'impiété, mais leur prochain même est en butte à leurs
outrages. Je les ai vus, dans la guerre de France, faire des églises des
écuries pour les chevaux, et jeter au feu les images de Jésus-Christ notre
Sauveur. Je les ai vus désobéissants, arrogants, enclins à l'ivrognerie, et
enfin, incapables de rien faire de bon... Ils
ne craignent pas la mort, mais ils n'ont aucune prévoyance, et au siège des
villes, où il faut à la fois de la bravoure, de l'intrépidité, de l'agilité,
de l'adresse, ils ne rendent aucun service. En somme, ce sont les pires
soldats qu'on puisse avoir. Ils ne prennent point de part aux escarmouches ;
ils traînent à leur suite un attirail qui donne beaucoup d'empêchements ; ils
ne peuvent supporter la faim, ni la soif ; ils veulent toujours être payés au
temps convenu ; leurs capitaines s'opposent à ce que la montre se fasse plus
d'une fois, et prétendent qu'on leur paye jusqu'à la fin de la guerre le même
nombre de gens, alors même que peu de ceux-ci leur restent. Passons à la cavalerie. Si les écrivains étrangers, dit M. Henne, ont omis de signaler l'infanterie belge dans les grandes luttes du XVIe siècle ; s'ils ont donné le nom d'Espagnols à ces bandes wallonnes, qui, couvertes des lauriers d'un siècle de victoires, trouvèrent leur tombeau dans les plaines de Rocroi[61], il leur a été impossible d'étouffer la renommée de nos valeureuses bandes d'ordonnances. Après s'être réconcilié avec la France, Philippe le Bon avait conservé la majeure partie de ses hommes d'armes ; ils devinrent le noyau des troupes permanentes sous le nom d'ordonnances, nom qui subsista encore pendant deux siècles. Après la rupture du traité de Conflans, les états généraux accordèrent à Charles le Téméraire un subside annuel de vingt mille écus, qui lui permit de les maintenir en permanence et de les porter à huit cents lances[62]. En 1470, le prince obtint des états un nouveau subside annuel de cent vingt mille écus pour trois ans, et il s'en servit pour lever douze cent cinquante lances, chaque lance accompagnée de trois archers à cheval et autres gens de pied. Il établit un conducteur en chef pour cent lances et les archers et les gens de pied. Plus tard, les états ayant porté le subside à cinq cent mille écus pour un terme de six ans, le duc éleva le chiffre de ce corps à deux mille deux cents lances, présentant un effectif de dix-huit mille combattants, dont huit mille cavaliers[63] ; en 1473, il lui donna une organisation définitive, qui est restée un des plus remarquables monuments de son administration[64]. Ainsi, continue M. Henne, s'établit et s'organisa insensiblement cette véritable légion de Mars[65], qui devint la plus belle milice de l'Europe[66]. Détruite en grande partie à Grauson, à Morat, à Nancy, elle ne fut cependant ni anéantie ni licenciée, comme on l'a dit à tort, mais il fallut beaucoup de temps pour combler les vides faits par les hallebardes des Suisses, et le nombre des bandes d'ordonnances resta fort restreint. En 1505, on voit rappeler sous leurs enseignes tous les hommes d'armes de ces compagnies, et, dans les guerres de 1506 à 1508, figurent les bandes du comte de Nassau, des seigneurs de Chièvres, de Fiennes et d'Aimeries. Ces bandes, portées au nombre de cinq par le partage de celle d'Englebert de Nassau entre Philippe de Bourgogne et le seigneur d'Ysselstein, présentaient un effectif de mille chevaux, entretenus, à la charge du prince, pour la garde des frontières, et, en 1508, il fut résolu de doubler ce nombre. Dans le traité de 1518, il est stipulé que Robert de la Marck recevra une compagnie des vieilles ordonnances des Pays-Bas. En 1516, après avoir obtenu des états généraux une aide de cinquante mille Philippus d'or pour fournir à l'entretenement de deux cents hommes d'armes et de quatre cents archers à cheval à ordonner et mettre sus pour la défense du pays et la sûreté des routes, le gouvernement organisa en effet quatre nouvelles bandes. Ces quatre compagnies, mentionnées dans les lettres patentes du 23 juillet 1517 instituant le conseil privé, furent placées sous le commandement général du comte de Nassau, ainsi que toute la gendarmerie des Pays-Bas, pour les mener et conduire, par l'avis du conseil, partout où besoin seroit. En 1519, Charles-Quint, approuvant le projet de traité à conclure avec le duc de Gueldre, promit de donner à ce prince une bande d'ordonnances de cinquante hommes d'armes, à prendre dans les six compagnies qu'il se proposait de lever à son retour dans les Pays-Bas. Il n'exécuta pas immédiatement ce projet, car les lettres du 19 octobre 1520, maintenant Marguerite dans le gouvernement général, ne mentionnent encore que les quatre compagnies de la dernière levée. En 1519, nous voyons le sire d'Ysselstein engager la gouvernante à appeler les bandes d'ordonnances sous les armes[67] ; l'année suivante, nous les trouvons en Frise, puis à Thionville et dans d'autres places du Luxembourg. Au mois d'août 1522, les hostilités commencent par un ordre donné aux hommes d'armes de ces compagnies de se rendre à Valenciennes, et, dans un édit du 27 janvier 1522, nous retrouvons les gens de guerre à cheval des ordonnances. En 1522, avant de quitter les Pays-Bas, Charles-Quint entreprit de réorganiser la gendarmerie formée par Charles le Téméraire. Par un édit conçu pour le fait et conduite des gens d'armes, dont il entendoit estre servy durant son prochain voyage d'Espagne, il prescrivit d'entretenir huit compagnies, fortes chacune de cinquante hommes d'armes et de cent archers, dont il nomma capitaine-général le sire d'Ysselstein, Florent d'Egmont, devenu comte de Buren par le décès de son père Frédéric. Ces huit compagnies avaient pour capitaines le comte de Buren, le sire de Ravenstein, le comte de Nassau, le prince d'Orange, le marquis d'Arschot, le comte de Gavre, les sires d'Hoogstraeten et de Lannoy, vice-roi de Naples, ensemble ; le sire de Rœulx, Ferry de Croy. Les capitaines avaient l'obligation de résider avec leurs compagnies aux lieux qui leur étaient assignés par le capitaine général, à moins qu'ils ne fussent chargés de services spéciaux par l'empereur ou par la gouvernante. Ils étaient tenus d'obéir aux ordres du capitaine général sous peine de destitution. Celui-ci avait pleine autorité de punir les hommes d'armes et les archers s'absentant sans congé, et il était interdit aux capitaines de reprendre ceux qu'il aurait cassés. Il était prescrit à tous, capitaines, officiers et gens de loi des villes des Pays-Bas, de lui bailler entrée et sortie, et de lui obéir en toutes choses relatives à la guerre, aux fortifications et aux mesures de sûreté, mais il lui était interdit de se mêler des affaires de justice et de finances sans ordre exprès de la gouvernante et sans l'avis du conseil privé. En lui donnant entière latitude d'agir, s'il y avait urgence, dans l'intérêt de l'honneur du prince et de la garde du pays, l'empereur recommandait au capitaine général de se conduire, dans les choses d'importances, d'après les instructions de la régente et l'avis du conseil[68]. Le règlement de 1473 avait composé les compagnies d'ordonnances de cent hommes d'armes chefs de lance, de trois cents archers à cheval, de trois cents piétons, d'un coutelier et d'un page pour chaque homme d'armes, de volontaires ou surnuméraires s'instruisant au métier de la guerre. Le nombre de ces surnuméraires faisait parfois monter l'effectif d'une compagnie à douze ou quinze cents hommes. Après la mort du Téméraire, une diminution considérable s'opéra dans cet effectif. Il n'y eut bientôt plus rien d'uniforme à cet égard. Les anciennes bandes étaient composées de vingt-cinq, trente, quarante ou cinquante lances ; l'effectif variait à l'infini, même pour les nouvelles bandes, dans les premières années du règne de Charles-Quint. Un règlement de 1547 ramena enfin l'uniformité si désirable dans l'organisation militaire. Les bandes d'ordonnances, dit Nény, furent l'école militaire de la noblesse. La plupart des hommes d'armes étaient en effet gentilshommes ; beaucoup d'archers même appartenaient à la noblesse. En cas de vacances ou de formation de nouvelles compagnies, les capitaines choisissaient des hommes instruits au métier des armes, ayant l'âge et la force nécessaires pour supporter les fatigues du service militaire. Il était prescrit aux commissaires des montres de s'enquérir si dans ces corps il n'y avoit nulz gens mal conditionnés, notés ou suspects d'hérésie, mutinerie, ou autres délits, et, le cas échéant, d'en avertir les capitaines pour y pourvoir[69]. Ils devaient s'assurer aussi de l'état de l'instruction militaire des hommes d'armes, des archers, des pages, des couteliers[70]. Les recrues n'étaient admises définitivement qu'après la montre, et après avoir prêté, entre les mains du commissaire aux revues, le serment de fidélité à l'empereur. Les compagnies étaient ordinairement formées d'hommes d'armes de la même province ; il était facultatif à ceux-ci de fournir eux-mêmes leurs archers. Il était formellement interdit d'enrôler des étrangers, le gouvernement voulant entretenir et nourrir les gentilshommes et autres gens de service de la subjection de Sa Majesté et natifs des Pays-Bas[71]. Aucun homme d'armes ne pouvait passer d'une bande à une autre sans l'autorisation de son capitaine, ni aucun valet changer de maitre sans la permission de l'homme d'armes qu'il servait[72]. Il était prescrit aux commissaires aux revues de veiller à ce que les capitaines n'enrôlassent pas dans les compagnies sous leurs ordres leurs serviteurs, valets de chambre, secrétaires, clercs, cuisiniers, couteliers ou autres menus officiers. Il était défendu aux personnes étrangères aux bandes d'ordonnances de les suivre, sous peine d'être livrées au prévôt des maréchaux et punies comme vagabonds[73]. Les hommes d'armes, les archers, les piétons des ordonnances s'habillaient, s'équipaient, s'armaient à leurs frais. Il était prescrit à tous, chefs et gens des ordonnances d'être toujours prêts à servir, pour pouvoir se rendre là où il seroit commandé, faisant en ce si bon devoir que le pays, par leur faute et négligence, ne tombât en inconvénient[74]. Le règlement de 1473 leur assignait pour armes la cuirasse complète avec tassettes, genouillières, hausse-col, brassards, cuissards, grèves et faites ; la salade à gorgerin surmontée de plumes ; un long estoc roide et léger ; un couteau taillant pendant au côté gauche de la selle, et au côté droit une masse d'armes à une main. Chaque homme d'armes avait trois chevaux de selle : un cheval de bataille couvert d'une selle de guerre, d'un chanfrein orné de plumes, et, autant que possible, de bardes ; et deux autres de moindre valeur pour son page et son coutelier. Les archers n'avaient qu'un cheval. Ils portaient la salade à gorgerin sans visière, une chemise de mailles ou brigandine sans manches. Leurs armes étaient l'arbalète ou l'arc avec une trousse contenant trente flèches ; une épée à deux mains longue et bien tranchante ; une dague d'un pied et demi de longueur. Les couteliers devaient avoir une demi-lance ; pour le reste, ils étaient armés comme les archers. Les piétons, arbalétriers, piquiers et couleuvriniers, de même que les couteliers, étaient vêtus de brigandines ou de corselets fendus sur le côté ; de salades à gorgerin ; de faites ou braies d'archers, de garde-bras et de gantelets. Les piétons, outre l'arme principale qui les distinguait, avaient une épée à deux mains. Les hommes d'armes, les archers, les piétons étaient à la solde du souverain, mais les couteliers étaient payés par l'homme d'armes ; les pages n'avaient droit à aucune paye. En principe, la solde des bandes d'ordonnances devait être payée, par anticipation, tous les trois mois en temps de paix ; tous les mois en temps de guerre. Mais le mauvais état des finances de Charles-Quint ne lui permit jamais de se conformer à ce principe ; tous les comptes parlent des arrérages dus à ces compagnies et des à-compte payés successivement pour les acquitter. Après chaque campagne, et même en temps de guerre pendant l'hiver, les hommes d'armes et leurs archers rentraient, généralement ou partiellement, dans leurs foyers. Ils y recevaient une paye appelée petits gages en opposition avec les grands gages qu'ils touchaient lorsqu'ils faisaient leur service. Les hommes d'armes, pendant ces congés temporaires, laissaient à la Compagnie leur équipement et leur meilleur cheval. Les bandes d'ordonnances étaient spécialement affectées au service des Pays-Bas, pour la garde et défense des frontières, pour assister à la justice, pour garder et assurer les chemins et les marchands hantans et fréquentans ces pays, ou autrement, ainsi qu'il étoit advisé pour le mieux[75]. Néanmoins, quoiqu'elles ne pussent, à la rigueur, sortir du pays sans le consentement des états, elles furent employées, en plusieurs circonstances, à de lointaines expéditions. Ainsi elles prirent part aux guerres dont l'Italie et l'Allemagne furent le théâtre, et nous les voyons fournir des contingents à l'armée du connétable de Bourbon, à celle que l'empereur conduisit en Italie lors de son couronnement, à celle qu'il dirigea en personne contre Soliman, à celle qui assiégea Marseille, à celle enfin qui triompha de la ligue protestante. D'importants privilèges furent accordés à ces compagnies par Charles-Quint et par ses successeurs. Les hommes d'armes étaient exempts de toutes tailles, gabelles, maltôtes, contributions pour les biens qu'ils possédaient en propre. Comme les ecclésiastiques, les nobles et les autres privilégiés, ils étaient exclusivement soumis aux charges extraordinaires. Même pour les biens tenus à ferme et soumis aux aides ordinaires et extraordinaires, leur demeure domiciliaire et une étendue de terrain de trois bonniers, réputée nécessaire à la nourriture de leurs chevaux, restaient franches de toute imposition. Souvent des hommes d'armes, rendus incapables de continuer leur service par l'âge ou par les infirmités, obtenaient, à titre de récompense, la continuation de ces privilèges et de ces exemptions. Les bandes d'ordonnances n'étaient point les seuls corps de cavalerie fournis par les Pays-Bas ; on en levait d'autres pour des usages spéciaux. Tels étaient les deux cent cinquante combattants à cheval, recrutés, en 1506, par le comte de Nassau, pour la garde du Brabant et du comté de Namur ; la troupe de cavalerie formée, en 1507, par le seigneur d'Aimeries, pour la défense du Hainaut ; les deux mille gendarmes levés, l'année suivante, par Marguerite ; les trois mille cinq cents fournis, en 1513, à Henri VIII ; les combattants à cheval, commandés, en 1523, par les sires d'Épinoy, d'Arenberg et de Rochefort. Le gouvernement de Charles-Quint préférait les gendarmes des Pays-Bas à la cavalerie allemande, qui lui coûtait beaucoup plus cher et lui rendait moins de services[76]. La plupart des succès remportés par la gendarmerie impériale furent dus à la cavalerie des Pays-Bas. Au XIVe siècle déjà, un historien italien appelait les Brabançons les meilleurs cavaliers du monde[77], et, trois siècles après, on entend un de ses compatriotes répéter : Les gens d'armes de Flandre sont les meilleurs qui soient au monde ; non seulement ils ont pu résister à la cavalerie française, qui a une si grande réputation, mais encore ils l'ont rompue et dissipée deux fois en peu de temps[78]. L'ambassadeur Marin Cavalli, qui parle avec la même admiration des bandes d'ordonnances, engagea vivement le sénat de Venise à introduire dans les armées de la république une partie des règlements de cette excellente milice[79], et Charles-Quint lui-même chercha à introduire leur organisation en Allemagne. Au rapport de Robertson, ce prince considérait la gendarmerie des Pays-Bas et l'infanterie espagnole comme ses meilleures troupes. Vers le milieu du règne de Charles-Quint, l'art militaire, transformé par l'usage des armes à feu, agrandit le rôle de l'infanterie et diminua celui de la cavalerie, qui ne fut plus guère employée que pour seconder les mouvements de la première. C'est alors qu'on voit restreindre le nombre des hommes d'armes pour accroître le chiffre des corps des chevalseurs, chevaucheurs ou chevau-légers, et des arquebusiers à cheval, formant la cavalerie légère. Ce fut une révolution dans l'organisation des armées, car ainsi que le disait Charles-Quint lui-même : C'est aultre manière de guerroyer avec chevau-légers qu'avec hommes d'armes[80]. Toutefois aux Pays-Bas on recruta toujours plus de gendarmerie que de cavalerie légère, grâce à la stature des hommes, en général grands et vigoureux, et particulièrement à la forte encolure des chevaux[81]. Il ne faut faire d'exception que pour les Ardennes, le Namurois et une partie du Hainaut, où la race chevaline offrait les qualités propres à la cavalerie légère. Les arquebusiers à cheval et les chevau-légers n'avaient point, comme les gens d'armes, des suivants. Formés, en grande partie, d'hommes du peuple ou de tenanciers, ils soignaient eux-mêmes leurs chevaux, qu'on nommoit alors cavallins parce qu'ils estoient de légère taille. La cavalerie légère avait le morion, les manches de maille, qu'on portait fort de ce temps-là, l'arc, l'arbalète ou l'arquebuse, la lance et l'épée. Le chevau-léger, ainsi que l'arquebusier, devait produire aux montres un cheval armé. La majeure partie de la cavalerie légère employée dans les Pays-Bas était fournie par l'Allemagne. Les cavaliers allemands étaient généralement appelés noirs harnais ou harnois, parce que les harnats qu'ils portoient, estoient noirs, avec manches de maille, et certains morions couverts, ou reîtres, par corruption de reuters. D'autres reçurent le nom de pistoliers de l'usage introduit vers 1544 d'employer les pistoles, qui sont petites harquebuzes n'ayant qu'environ un pied de canon, et tiroit l'on avecques une main, donnant le feu avecques le rouet[82]. Outre les troupes d'infanterie et de cavalerie que nous venons d'énumérer, il y avait certains corps spéciaux et mixtes, attachés à la personne du souverain. Tels étaient les cinquante archers à cheval de la garde, troupe d'élite que Philippe le Beau avait organisée et exclusivement composée de gentilshommes ; les archers de corps de l'empereur servant alternativement à pied et à cheval, ceux de la gouvernante générale ; les hallebardiers de la garde, employés plus d'une fois à la garde des forteresses et accompagnant le prince dans ses expéditions. Ces compagnies étaient sous les ordres d'officiers choisis, parmi lesquels nous citerons Claude de Bouton, qui reçut, en 1508, le commandement des archers de la garde ; Maximilien de Lannoy, seigneur du Jardin, capitaine des archers de corps ; Pirotin de la Fontaine, capitaine des hallebardiers de Marguerite ; François de Marche, capitaine de ses archers, auquel elle confia souvent d'importantes missions militaires ; Jean de la Thonnière, seigneur de Beauregard, qui commanda également ses archers ; Adrien de Longueval, seigneur de Vaux, capitaine des hallebardiers de Charles-Quint ; Jean, sire de Marcinelle, appelé au commandement de ses archers, après avoir été son panetier et lieutenant d'une bande de cinquante hommes d'armes. Passons à l'artillerie. L'invention de la poudre n'avait point produit, jusqu'au commencement du XVIe siècle, des changements considérables dans l'art militaire. La première moitié de ce siècle est une époque de transition, où il eût été bien difficile à un observateur superficiel de se rendre compte de la complète révolution qui se préparait. Écoutons un écrivain militaire du temps : L'artillerie et l'arquebuserie servoient plutôt de montre et ostentation pour faire peur aux simples personnes, que d'effet à la guerre qui Fust de grande importance ; car pour le regard de l'artillerie, les batteries qu'on faisoit lors estoient d'un petit nombre de pièces, et encore de mauvais calibre et mal équipées ; cinq ou six volées entre deux soleils, de bien loin et à coup perdu, ou bien de je ne sais quels basilics et mortiers, inutile dissipation de poudre sans peu d'effet, sinon pour intimider de lâches courages non encore éprouvés encontre ces plutôt piaffeuses menaches que réelles exécutions[83]. Maximilien avait déjà introduit des améliorations dans la fonte des canons, mais c'est seulement vers 1530, et à partir des dernières guerres de Charles-Quint, que l'artillerie entra dans une voie réellement progressive. Marguerite écrivait cependant, en 1511, ces paroles vraiment remarquables pour le temps : L'objet principal c'est l'artillerie ; tous les capitaines et gens au fait de la guerre disent qu'on ne peut rien sans cela[84]. Avoir une bonne artillerie et de bons artilleurs, disait quarante et un ans plus tard le comte de Rœulx[85], c'est le vrai secret de la guerre. Charles-Quint ne s'y trompait pas : Le fait de l'artillerie s'augmente journellement[86], disait-il. Aussi il ne négligea rien pour organiser dans ses divers états une artillerie uniforme et bien montée ; nul effort ne lui coûta pour la renforcer sans interruption. Au commencement de son règne, l'artillerie des champs aussi bien que l'artillerie des murailles, l'artillerie de campagne aussi bien que celle de batterie offraient encore un système très compliqué de pièces de différents calibres. Telles étaient les haquebutes à croc[87], les couleuvrines, les doubles couleuvrines, les bâtardes, les faucons, les fauconneaux, les serpentines, les doubles courtauds, les canons, les demi-canons, les sacres, etc. Il y avait, en outre, d'autres grosses pièces tirant d'énormes boulets de pierre. En 1542, les remparts d'Anvers furent armés de sept canons ayant chacun vingt-deux pieds de longueur[88]. D'autre part, au combat de Renty, en 1544, on remarqua, dans l'armée impériale, de petites pièces de campagne surnommées les pistolets de l'empereur ; elles étaient montées sur avant-train, et, conduites par deux chevaux, manœuvraient au galop. Philippe de Clèves détaille de la manière suivante un parc d'artillerie[89] fondu à Malines par Jean Poppinger :
L'empereur Charles-Quint, écrivait en 1628 l'ingénieur anglais Robert Norton, trouvant un grand inconvénient à cette confusion de formes, assembla son conseil de guerre et chercha des améliorations. Il fut décidé que le diamètre, pour les canons ordinaires, devait être le dix-huitième de la longueur, le poids de sept mille livres et le boulet de quarante-cinq ; pour les canons de rempart, le diamètre serait d'un huitième de la longueur à la culasse, des onze seizièmes au milieu, et des sept seizièmes à la gueule ; le poids était fixé à huit mille livres[90]. On prétend que ce prince adopta de plus forts calibres que ceux en usage chez ses ennemis, afin de pouvoir utiliser leurs projectiles, tandis qu'il les mettait dans l'impossibilité de se servir des siens[91]. Quoiqu'il en soit, de nombreuses expériences eurent lieu, par ses ordres, à Bruxelles, en vue de déterminer les proportions les plus convenables pour les bouches à feu. Ces études, interrompues par les événements, furent reprises en 1535, et à la suite des résultats obtenus, on fondit à Malaga des pièces soignées dans toutes leurs parties, et qui servirent longtemps de types perfectionnés pour les gros canons d'Espagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie et même d'Angleterre[92]. Quant à nos fonderies de Belgique, leur supériorité est constatée par des faits nombreux. Notre pays fournit de nombreuses pièces d'artillerie à l'Espagne, au Portugal et à l'Angleterre. C'est à Malines que furent fondus pour Henri VIII ces douze beaux engins de métal, appelés les douze apôtres et employés par lui dans sa première campagne contre la France. L'Espagne et la Flandre à cette époque, dit un écrivain militaire[93], de tous les états de Charles-Quint et peut-être de l'Europe, étaient les plus avancés en artillerie. Dans les premières années du XVIe siècle, la fabrication des bouches à feu était encore abandonnée à l'industrie privée ; on voit le gouvernement et les villes s'en pourvoir chez les marchands. Il y avait des marchands de canons, comme il y avait des marchands de boulets et des marchands de poudre. On comprenait cependant, dès lors, ce qu'un pareil système avait de vicieux, et, à partir de 1510, le gouvernement eut à sa solde un maitre fondeur et bombardier. Toutefois Jean Poppinger ou Popperinter, qui fut appelé à ces fonctions, conserva son établissement privé. Enfin, en 1521, l'état acheta à messire Arnoul van Diest, trésorier de Malines, une maison avec ses dépendances, pour y loger son artillerie et y établir sa principale fonderie de canons. Il y en eut aussi dans d'autres villes : ainsi l'on en trouve une, en 1521, à Luxembourg, et l'on voit Marguerite y envoyer un fondeur pour en prendre la direction ; quelques années plus tard, on constate la même chose à Valenciennes. Quant aux boulets, on en tirait beaucoup alors des forges existantes près de Ciney et de Dinant. La principale fabrique de poudre était établie à Malines, et dirigée par Jacques de Morville, de Namur, assisté de quelques salpêtriers. L'arsenal de Malines était le principal de l'État, mais il n'était pas exclusivement destiné à l'artillerie, et l'on y déposait des armes de toute espèce. Bruxelles en avait, un de moindre importance, qui devint par la suite un musée d'armures et de trophées. C'est là que fut placé le grand étendard de France pris à Pavie[94]. Les pièces d'artillerie étaient traînées par des chevaux, les munitions chargées sur des chariots pris en réquisition dans le plat pays ou fournis par les monastères[95]. Ces réquisitions constituaient des charges si ruineuses que pour s'y soustraire beaucoup de fermiers et censiers cassèrent leurs chariots et estropièrent leurs chevaux. Pour empêcher ce fait, un édit de 1543 commina la confiscation des chariots et des chevaux, outre une amende de vingt-cinq carolus, contre quiconque n'obtempérerait pas aux ordres de réquisition. Tout prouve qu'on se servait beaucoup plus alors des canons contre les places que dans les batailles. Le transport des nombreuses pièces de siège, que les armées traînaient à leur suite, causait d'énormes dépenses. Les munitions aussi étaient fort chères, et l'on calculait les frais d'une campagne à un tiers pour l'infanterie, un tiers pour la cavalerie et un tiers pour l'artillerie. Le service de l'artillerie était assimilé à un art mécanique. Les canonniers, comme les bombardiers et les artificiers, avaient à prouver leur instruction par des certificats d'apprentissage. Cet apprentissage consistait dans la manœuvre des différentes pièces d'artillerie et dans le tir à la cible. Les princes ou les villes qui acceptaient leurs services, à la suite de cette épreuve, leur faisaient délivrer des patentes sous forme de contrat. En les recevant, ils s'engageaient, sous la foi du serment, à tenir leur art secret et à ne l'enseigner à d'autres qu'avec autorisation. Les canonniers et les bombardiers étaient assez nombreux dès lors dans les Pays-Bas pour que les souverains alliés leur en empruntassent, et c'est ainsi qu'on voit Charles-Quint en mettre cent à la disposition de Henri VIII pour sa campagne d'Écosse. L'artillerie formait un corps tout-à-fait spécial, que Charles-Quint réorganisa en 1551[96]. A la tête de ce corps était le grand maître de l'artillerie, charge qui, sous ce prince, fut successivement remplie par Philippe de Lannoy, seigneur de Molemhais, mort le 22 septembre 1543 ; Frédéric de Melun, seigneur de Hellemont, mort en 1550 ; Philippe de Stavele, seigneur de Glazon. Sous le commandement du grand maître étaient placés un maître de l'artillerie, un lieutenant, des officiers appelés gentilshommes de l'artillerie, des receveurs, un commis garde, un prévôt, des maîtres bombardiers, des bombardiers, des maîtres canonniers, des canonniers, des aides canonniers ou servants, des conducteurs à pied et à cheval, des pionniers et des ouvriers de différents états. L'ordonnance de 1551 prescrivit de dresser un état de toutes les bouches à feu, grandes et petites, que l'empereur possédait dans les Pays-Bas, avec indication de la quantité de poudre, ainsi que du nombre de boulets, de piques, de lances, de demi-lances, de harnais, pieux, pelles, hoyaux et autres objets servant au train de l'artillerie. L'ordonnance prescrivait de même le dénombrement des gentilshommes, des conducteurs à pied et à cheval, des canonniers et de leurs servants, des pionniers, des chevaux, etc. Des copies de ces états, dont l'original était signé par l'empereur, devaient être remises au maître de l'artillerie, à son lieutenant, au contrôleur et au garde de l'arsenal. A la fin de chaque campagne, on veillait à ce que le matériel de l'artillerie fût remis en bon ordre ; on dressait le relevé des munitions employées ou perdues, le surplus était placé en lieu de sûreté. Les gentilshommes, pris souvent parmi les hommes d'armes,
avaient, avec les canonniers, la conduite et la garde spéciale des bouches à feu.
Ils devaient être expérimentés et avoir hanté,
conversé et mené le fait de l'artillerie ; la conduire aux champs et armées ;
faire approcher icelle devant villes et châteaux ; la faire mener aux
tranchées et partout ailleurs où besoin étoit. Ils étaient présents et joindants la pièce à toutes batteries, et
illecq faisoient tout ce qui leur étoit commandé par le maitre de
l'artillerie ou par son lieutenant. Lorsque l'armée était licenciée,
ils se retiraient dans les villes frontières, à
savoir un gentilhomme avec un conducteur à cheval dans chaque place, pour
illecq prendre regard sur les artilleries et munitions, faire mettre en ordre
celles en lesquelles ils trouvoient nécessité en en donnant avis au maitre de
l'artillerie ou à ses officiers. Le nombre des gentilshommes, comme
celui des conducteurs à cheval, fut fixé à treize par un règlement du 9 mars
1544[97]. Il y avait deux canonniers à chaque pièce[98]. Ils étaient appuyés de quelques fantassins ayant charge de rester près de l'artillerie, et assistés par les servants ou aides canonniers, et par des pionniers. Les premiers avaient pour principal emploi de manœuvrer les chièvres, machines compliquées dont on se servait pour placer les pièces de gros calibre sur leurs affûts ; les pionniers aidaient à la manœuvre des bouches à feu, exécutaient les travaux de terrassement et de gabionnage nécessaires pour les mettre en batterie, élargissaient ou aplanissaient les chemins pour faciliter la marche de l'artillerie. Le maitre de l'artillerie en levait autant qu'il lui en fallait, les prenant tant parmi les vagabonds que parmi les manœuvriers. Les officiers leur distribuaient des bêches, des pioches, des houes et tous les autres outils exigés pour leur service ; les pionniers en étaient responsables et les restituaient lors de leur licenciement[99]. On leur donnait un capitaine particulier, à qui il était défendu de s'absenter, dans la crainte qu'ils ne se débandassent, ce qui arrivait fréquemment, et retardait l'artillerie dans sa marche et partant les opérations de l'armée[100]. Aussi les traitait-on avec une extrême sévérité. Les déserteurs étaient condamnés à faire amende honorable, fustigés[101] et même pendus[102]. A la fin du règne de Charles-Quint, il fut arrêté que toute désertion serait punie de mort. L'organisation définitive du corps des pionniers remonte à l'année 1544. Un règlement du 12 mars de cette année établit un chef et général de pionniers, ayant un lieutenant, six hommes à cheval pour l'assister, six hallebardiers, un écrivain et un prévôt avec deux hallebardiers. On régla la levée des pionniers d'après les proportions suivantes, en prenant pour base le chiffre de trois mille : cinq cents de l'Artois, cinq cents de la Flandre, quatre cents du Hainaut, quatre cents du Brabant, quatre cents de Namur, quatre cents de Liège et du Luxembourg, quatre cents du Limbourg. Pour chaque contingent, divisé en centuries ayant chacune un capitaine, un écrivain, un tambourin, deux conducteurs, dont l'un portait son pennon, on désigna un gentilhomme du pays, et on lui donna un porte-enseigne et un chapelain. Chaque contingent avait un uniforme de couleur distincte avec la croix de Saint-André sur la poitrine et au dos. Un signe distinctif placé à la manche ou à la jaquette indiquait la centurie. Les enseignes et les pennons, de la couleur de l'uniforme des contingents, portaient une bêche et une pioche en sautoir. A leur entrée au service, les pionniers juraient d'être bons et loyaux à l'empereur et au chef et capitaine
général ; de ne refuser aucune chose qui, par eux, leur seroit commandée,
sous ombre ou couleur que ce fût ; de ne point abandonner leurs enseignes
sans congé, sous peine de la vie et de douze écus d'or à recouvrer sur leurs
biens, meubles et immeubles : d'indiquer exactement, sous peine de la vie,
leurs noms, prénoms, lieux de naissance et de domicile ; d'obéir à leurs
capitaines particuliers ; de travailler aux approches, tranchées, travaux
d'artillerie et des mines, confection de gabions et de claies ; d'accompagner
l'artillerie soit en batterie, soit aux champs ; de faire esplanades, ponts,
chemins, abatis ; d'étancher et épuiser rivières, fossés et étangs ; de
fortifier les camps ; d'exécuter, en un mot, tous les travaux ressortissant à
leur service ; de ne point passer sous une autre enseigne ; de ne jamais
aller à la maraude. Il était strictement défendu à leurs chefs de les
maltraiter ; leurs plaintes, au sujet d'outrages ou de mauvais traitements de
la part des conducteurs ou d'autres, devaient être portées devant les
capitaines ou les chefs de leurs contingents[103]. Le nombre d'ouvriers employés au service da l'artillerie était considérable. Les harnacheurs graissaient, attelaient, mettaient en ordre les bouches à feu ; escortaient les convois de munitions, et dans les sièges étaient employés au même service que les conducteurs à cheval. Les charpentiers, les scieurs, les cuveliers, les forgerons, les maréchaux, les charliers ou charrons, les gorliers ou bourreliers, les selliers, les mandiers, les cordiers, se tenaient près des pièces ou des chariots de munitions, afin de remédier immédiatement aux accidents qui survenaient[104]. Nous arrivons à ce qui constitue aujourd'hui le génie militaire ou l'art des fortifications. La forme bastionnée, destinée à jouer un rôle si important dans la défense des places, avait pris naissance avec le XVIe siècle. L'ancien système des tours laissait devant elles un espace inaperçu de la place, permettant ou d'attacher le mineur au pied de l'escarpe[105], ou de tenter l'escalade. Ce vice radical fut rendu évident par l'usage de la poudre, et l'on reconnut en même temps la nécessité de flanquer toutes les parties d'une enceinte par d'autres parties. On imagina alors de remplacer la face antérieure des tours par un redan[106] dont les faces prolongées allaient tomber sur la courtine[107]. L'ensemble des deux faces du redan et des deux flancs de la tour pentagonale fut appelé bastion ; deux demi-bastions, unis par une courtine, formèrent le front. Il restait à couvrir l'espace prolongé en avant des bastions et les portes pratiquées au milieu de la courtine. Pour atteindre ce but les fronts se couvrirent de ravelins ; ces ravelins agrandis prirent le nom de demi-lunes, et leurs faces dirigées sur les saillants des bastions latéraux leur donnèrent des fronts rapprochés. Suivant le Vénitien Badoaro, les places fortes des Pays-Bas étaient fortifiées à l'antique et réparées à la moderne[108]. On voit en effet l'ancien système de fortifications dominer encore dans la reconstruction des châteaux ; plusieurs sont restés de curieux échantillons de l'architecture militaire de cette époque. Mais, pendant la dernière moitié du règne de Charles-Quint, sous l'influence devenue décisive de l'artillerie, le système fut changé et la méthode italienne domina définitivement[109]. L'art des sièges était encore peu avancé[110]. Tout se bornait encore à la tranchée de première circonvallation, laquelle avait reçu, depuis les temps les plus antiques, fort peu de perfectionnements. La sape et la mine étaient fréquemment employées dans l'attaque des places, mais sans succès marqué. L'étude des moyens d'attaque et de défense des places n'était point arrivé jusqu'alors à l'état de science ; aussi n'existait-il aucun corps spécialement affecté à cette étude. Aux officiers et aux soldats de l'artillerie appartenaient la plupart des opérations et des travaux aujourd'hui du ressort exclusif du génie militaire. Non seulement ils conduisaient, avec le maître des tranchées, les approches des places, les terrassements et les gabionnages, mais ils étaient fréquemment chargés de la construction même des fortifications. Ainsi l'on voit un canonnier diriger les travaux du château de Henri VIII à Tournai[111] ; un maître bombardier édifier et restaurer les bastions de Marche[112] ; le maître de l'artillerie, Jean de Termonde, appelé à faire le plan des nouvelles fortifications d'Utrecht[113]. Le maître des tranchées est le seul officier spécial qui figure dans l'organisation d'alors ; encore est-il probable qu'il était rangé parmi les officiers subalternes. Un peu plus tard, vers le milieu de ce siècle, on voit les grands travaux de construction des places fortes généralement confiés à des ingénieurs, ou ingéniaires[114], comme on disait aux Pays-Bas, avec lesquels le gouvernement passait des espèces de contrat, et qui la plupart étaient architectes. Ainsi l'architecte Sébastien Van Noen exécuta ou dirigea, en qualité d'ingéniaire de l'empereur, la plupart des nouvelles fortifications des villes du Luxembourg, de l'Artois, de Cambrai, de Renty (1553-1555) ; ce fut lui aussi qui édifia Philippeville. Le célèbre Rombaut van Mansdale, dit Keldermans, maitre des ouvrages du seigneur empereur, fut employé aux fortifications de Montfort et de Fauquemont. Après eux, il faut citer encore maître Donatien de Bonny, qui dirigea les travaux de la citadelle de Gand et fit le plan de Charlement ; Adrien de Blois, seigneur de Warelles, bailli d'Avesnes, qui fortifia Luxembourg et Maëstricht ; le célèbre Jean de Locquenghien, à qui Bruxelles doit son beau canal de Willebroeck, et le bourgmestre de cette ville Jean Pipenpoy, lesquels dirigèrent, en 1552, les travaux exécutés à Maëstricht, avec le drossard de Grimberghe, Englebert d'Oyenbrugghe ; Pierre Adrien, qui conduisit les tranchées lors du siège de Térouanne en 1553. Occupons-nous maintenant de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le nom d'état-major[115], c'est à dire, de la hiérarchie existant au sein de l'agrégation des officiers, desquels émane la direction militaire ou administrative d'une troupe quelconque. Après le capitaine général, le principal officier était le maréchal de l'Ost ou maréchal de camp. C'était lui qui remplissait les fonctions actuelles de chef d'état-major, réglant les étapes, s'occupant des détails des campements et des fourrages, rédigeant les plans de campagne, remplaçant, au besoin, le chef du corps d'armée, administrant souverainement la justice militaire. A chaque corps d'armée étaient attachés un lieutenant du capitaine général ; ses officiers d'administration et de justice ; un chef de l'avant-garde, un chef ou capitaine des chevaucheurs et un chef de l'artillerie. Parmi les hauts-officiers on comptait le maréchal des logis de l'empereur, qui devoit le suivre en ses guerres et armées ; les maréchaux des logis attachés au corps d'armée et aux régiments ; le chef des écoutes ; le maitre des chemins ; le maître des chariots et le maitre des guides. Le maréchal des logis était chargé de veiller aux marches et aux subsistances, de choisir le lieu du campement ; de visiter les avenues du camp et d'en assurer la sécurité ; de désigner, en choisissant gens suffisans, les chefs du guet et ceux des divers postes ; de parcourir, au moins une fois par jour, le camp pour voir ce que l'on y faisoit et disoit, et d'en faire rapport au maréchal de l'ost, qui en avertissoit le lieutenant général. Le chef des écoutes assistait le maréchal des logis dans la visite du camp et des avenues du camp. Le chef du guet assurait la marche de l'armée ou du corps, et surveillait les gardes et les sentinelles[116]. A cet effet il tenoit rôle des gens de cheval et de pied, pour connoître qui devoit aller au guet et aussi pour savoir qui devoit aller à l'avant-garde, bataille et arrière-garde, et conduire les vivres. A chaque corps d'armée étaient attachés un ou plusieurs chapelains pour dire messe, confesser et prescher quelquefois. La tactique[117] de cette époque, dit M. Henne, consistant presque exclusivement à arrêter la marche de l'ennemi par les sièges des places fortes, la défense de ces places était d'une grande importance, et Charles-Quint recommandait à sa tante d'apporter le plus grand soin dans le choix des officiers des forteresses et des châteaux. Les commandants des forteresses portaient différents noms : gouverneur, surintendant, châtelain, capitaine, etc. Ils avaient pour attributions non seulement le commandement de la garnison, le soin de veiller à l'entretien de la forteresse, et, au besoin, de pourvoir à sa défense, ils exerçaient encore des fonctions judiciaires, et avaient la charge de faire appréhender tous les malfaiteurs, gens de guerre et autres, et iceulx faire punir et corriger. Beaucoup de places avaient des châtelains ou capitaines héréditaires ce qui n'empêchait pas le gouvernement d'y envoyer, en cas de danger, clos officiers supérieurs pour en prendre le commandement. Malgré l'introduction des canons et des armes à feu portatives, dit toujours M. Henne, on comptait presque encore exclusivement, dans les grandes actions, sur l'effet des armes blanches : aussi l'ordre profond[118] restait-il toujours usité, et les armées de Charles-Quint conservèrent l'ancien mode de trois batailles défini par Philippe de Clèves[119] de la manière suivante : Prenez que je veuille combattre avant-garde, bataille, et arrière-garde : je voudroys avoir trois bons osts de gens de pied, en la façon que l'on combat à ceste heure, et trois bons osts de gens de cheval mis en point à la façon d'Allemagne. Et voudroys avoir mon artillerie devant mon avant-garde, et assise en tel lieu où elle pourroit le plus grever à mon ennemi. Et si les ennemis marchoient pareillement en trois batailles, voudroys aborder chaque bataille à la bataille, assavoir : l'avant-garde à l'avant-garde, la bataille à la bataille, et l'arrière-garde à l'arrière-garde ; au surplus on laisse à Dieu à donner la victoire là où il lui plairoit. Si vos ennemis ne viennent qu'à deux batailles, je serai d'opinion que vos deux batailles abordassent, et que la tierce demourast coy jusqu'à ce qu'elle vit que vous eussiez quelque peu de pire ; car alors elle pourroit marcher et donner dedans, et me semble qu'elle en auroit bon marché. Les piquiers continuèrent longtemps, comme avant l'emploi de la poudre, à se former sur six ou huit rangs ; les arquebusiers, remplaçant les archers et les arbalétriers, se disposaient sur le front et sur les flancs de cette infanterie de ligne. Plus tard on introduisit les arquebusiers dans l'ordre de bataille ; ils prirent place dans les rangs des piquiers. La cavalerie se formait sur quatre rangs. L'artillerie était mise en avant pour engager l'action, les petits calibres placés derrière les pelotons d'infanterie et de cavalerie. Dans les marches rapprochées de l'ennemi, l'artillerie, avec les chariots, occupait le centre ; l'infanterie la droite, la cavalerie la gauche. La castramétation se bornait généralement à ranger les chariots de manière à former une enceinte. La forme des parcs[120] se modifia souvent, tantôt arrondie, tantôt en serpent. On entourait les camps de fossés dont les terres, jetées vers l'intérieur, formaient des parapets abritant l'artillerie. Lorsque l'armée acceptait le combat, elle se portait contre l'ennemi dans l'ordre de campement : les pièces de campagne au premier rang ; celle de gros calibre au second. Les chevaucheurs, les arquebusiers, les archers, les arbalétriers à cheval étaient opposés à la cavalerie légère ; les hommes d'armes à la gendarmerie. Les chariots, qui avaient formé l'enceinte, étaient couverts par toute l'armée. Ces voitures, affectées au transport des munitions, des grosses pièces d'artillerie, des bagages et des vivres, étaient en nombre immense et ralentissaient la marche des troupes, qui rarement faisaient des étapes de plus de trois à cinq lieues. La transition entre les armes anciennes et les armes nouvelles arrêta nécessairement les progrès de l'art militaire. Charles-Quint et François Ier eurent de vaillants capitaines ; ils n'eurent guère de grands généraux. Il est impossible pourtant de contester la supériorité des généraux de Charles-Quint sur ceux de son rival. Disposant presque constamment de forces inférieures ; obligés de garder des frontières d'une grande étendue ; fréquemment attaqués de divers côtés à la fois, les généraux de Charles-Quint surent le plus souvent arrêter de formidables invasions. Les Français ne pénétrèrent qu'une seule fois profondément dans le pays, tandis qu'à mainte reprise Buren, Nassau, de Rœulx, firent trembler Paris. Les deux défaites qu'ils avaient essuyées à Guinegate semblaient avoir dégoûté les Français de livrer bataille aux armées des Pays-Bas ; durant de longues années, la tactique de leurs généraux se borna à arrêter l'ennemi devant des villes, et, en l'épuisant, à amener le licenciement d'armées levées à grands frais. Cette tactique fut déjouée plus d'une fois, mais les journées de Saint-Quentin et de Gravelines prouvèrent surabondamment par la suite que c'était celle qui convenait alors le mieux aux armées françaises[121]. Disons un mot aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intendance militaire[122]. Les troupes s'armant, s'équipant, se remontant, se nourrissant en général à leurs frais, les officiers de l'artillerie étant exclusivement chargés de tous les soins du matériel, des armes, des munitions, on comprend que les attributions du service administratif étaient très secondaires. C'était, en effet, la plus imparfaite de toutes les branches de l'organisation militaire. La plupart des opérations de guerre étaient arrêtées par la disette ou par les maladies résultant de l'imprévoyance. Sur son territoire, le gouvernement réunissait bien des magasins aux lieux d'étapes ; obligeait les habitants des villes frontières à se pourvoir de blés, lards, viandes salées, vins, cervoises et autres provisions de bouche pour un an ou six mois au moins ; contraignait les cultivateurs des environs à y amener leurs blés en leur défendant de les vendre ailleurs ; accordait aux marchands des exemptions de droit pour le transport des denrées ; mais sur le territoire ennemi, les armées en étaient réduites à vivre de ce qu'elles trouvaient. Il suffisait dès lors de ruiner le pays pour les arrêter. Le temps seul devait apprendre que pour faire mouvoir les armées, il faut avant tout les mettre à l'abri du besoin et assurer leur subsistance. Chaque corps d'armée avait un officier supérieur nommé commissaire des monstres ou revues. Cet officier était chargé d'inspecter les divers corps, de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline, de remplir les vides laissés par les malades, les blessés et les morts. L'inspection avait lieu tous les trois mois, en temps de paix, pour les troupes permanentes ; il y en avait d'extraordinaires, ordonnées à l'improviste, pour prévenir ou pour constater les fraudes. Avant d'entrer en campagne, les différents corps étaient passés en revue par des commissaires chargés de s'assurer de la présence sous les armes des contingents fixés. Une revue générale précédait le licenciement. Jusqu'en 1543 il n'y eut qu'un trésorier des guerres. Une ordonnance du 4 juin 1542 l'autorisa à percevoir le centième denier sur tous les payements faits aux bandes et garnisons ordinaires, et le deux-centième sur la solde des autres troupes[123]. Pour garder ses deniers, recouvrer ses retenues, tenir en ordre ses rôles et ses acquits, il lui fallait, en temps de guerre, jusqu'à dix à quinze clercs ou commis. Une ordonnance du 9 janvier 1543 institua trois trésoriers des guerres un pour les pays de Flandre, d'Artois et de Hainaut ; un pour les pays de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Namur, de Juliers et d'Outre-Meuse ; un pour les pays de Hollande, de Zélande, d'Utrecht, d'Overyssel, de Frise et de Groningue. Chaque corps avait son fourrier chargé d'assurer ses logements et de répartir les fonds qu'il recevait du trésorier des guerres pour le payement de la solde et les allocations accordées pour les vivres. Aux termes du règlement du 12 octobre 1547, relatif aux bandes d'ordonnances, il était défendu à ces troupes, sous peine de la vie, de s'écarter du chemin indiqué et de se loger ailleurs qu'aux lieux d'étape fixés par les chefs. La peine de la hart était comminée contre les fourriers ou autres qui prendraient soit argent, soit présents d'espèce quelconque pour favoriser une localité, et changeraient, à cet effet, l'ordre des étapes. Les gens de guerre avaient la faculté de se chauffer gratuitement au foyer de leurs hôtes ; mais s'ils voulaient feu plus grand ou particulier, ils devaient payer le combustible. Il leur était défendu, sous peine de correction arbitraire, de brûler aucun bois, charpente, bois ouvré, arbres croissants, haies vives ou aultres. Quiconque endommageait ou foulait les habitants était puni de mort[124]. Mais nonobstant ces règlements, les logements ruinaient les populations plus que la guerre elle-même : les comptes des officiers de justice signalent, à toutes les pages, les foules et les oppressions, des piétons et des gens de cheval qui mangeoient le pauvre peuple. Lorsque en 1540 Gand fut occupé par les lansquenets et les hommes d'armes de Charles-Quint, beaucoup d'habitants, autrefois dans l'aisance, furent réduits à la plus profonde misère. — Devant l'ennemi, l'armée campait sous des pavillons et des tentes ; à ce service étaient préposés des officiers nommés tentiers. Sur le territoire ennemi, le soldat vivait généralement de maraude et de pillage. Près de chaque corps d'armée, il y avait un commissaire ou surintendant des vivres, et dans chaque province occupée par les troupes, un commissaire général surintendant de l'étape des vivres. Ce dernier fonctionnaire envoyait ses commis dans les villes et les villages pour prescrire aux officiers, justiciers, gens de loi, sujets, vassaux, d'enjoindre à tous marchands, bouchers, boulangers, brasseurs, taverniers, cabaretiers et autres que besoin, de transporter, chaque semaine, à l'armée, telle quantité de viande, pain, vins, cervoise, fourrages, avoine et autres denrées... Il avait pouvoir d'obliger les boulangers à cuire le pain et les brasseurs à fabriquer les bières nécessaires ; de se faire ouvrir tous greniers ; de contraindre les habitants à vendre les blés et les fourrages qui s'y trouvaient à prix raisonnable. Pour faciliter les opérations des vivandiers approvisionnant le camp, on leur fournissait des chariots dont le gouvernement payait les chevaux aux réquisitionnaires. Chaque corps avait, pour le transport de ses bagages, un nombre déterminé de chariots. Les bandes d'ordonnances en avaient à quatre chevaux, répartis dans la proportion d'un chariot par dix cavaliers. Les chariots employés pour le service général de l'armée provenaient de réquisitions. Les abbayes ou les villages qui cherchaient à se soustraire à ces charges ruineuses, y étaient contraints par le pouvoir discrétionnaire des commissaires de montres. L'organisation du service de santé pour les armées était à peine ébauchée. Il paraît toutefois qu'on formait des hôpitaux ou des ambulances dans les villes voisines du théâtre de la guerre, mais ce n'étaient sans doute que des établissements temporaires, comme l'était le service des praticiens qui suivaient les armées. Chaque corps avait son chirurgien ou médecin particulier. En outre à l'état major général ou à ce qui en tenait lieu étaient attachés un médecin ou chirurgien et un apothicaire ; quelquefois il y avait deux chirurgiens, un chirurgien de corps et un chirurgien des champs. La plupart des ordonnances militaires du temps prescrivaient de réprimer les buveries superflues, puttaineries, blasphèmes, folles paroles, combats, noises, rioltes et aultres désordres ; un grand nombre d'édits particuliers défendaient aux gens de guerre de manger le bonhomme ; enjoignaient aux officiers de contraindre les soldats à se retirer en leurs maisons, en se gardant de piller, oppresser ou endommager les sujets, le tout à peine de la hart et de confiscation de corps et de biens. Mais les règlements les plus rigoureux n'étaient le plus souvent que d'impuissantes barrières contre les débordements d'une soldatesque habituée à trouver dans la carrière militaire une licence effrénée et les profits du pillage. Il faut reconnaître aussi que trop souvent le soldat peu ou point payé était contraint pour vivre de rançonner les populations[125]. Charles le Téméraire, le roide justicier, comme l'appelle Chastelain, avait cherché à maintenir une discipline sévère dans ses armées, et, à cet effet, il avait créé un prévôt des maréchaux pour aller partout déchassant les vicieux malfaiteurs ; punissant les cas mauvais ; conduisant les marchands et mettant les vivres à prix ; tenant la justice parmi l'ost, tant criminelle comme civile ; jugeant et exécutant criminellement ; appointant et jugeant les causes civiles, sans appeler à autre personne s'il ne lui plaisoit[126]. Mais, après la mort de ce prince, la sévérité s'était relâchée, et les armées de Charles-Quint, formées d'éléments hétérogènes tirés de nations diverses, soumises à des règlements différents, ne prêtaient que trop le flanc aux plus regrettables excès. L'empereur fit tout ce qui était en lui pour réprimer ce mal destructeur. Si le succès ne couronna point ses efforts, la faute en fut, dit M. Henne, aux circonstances, non à ses mesures. Les règlements publiés sous son règne sont empreints du véritable esprit qui doit guider la justice militaire, et les principes qu'ils proclament se sont maintenus à peu près intacts. L'édit du 12 octobre 1547 distingua les matières criminelles des affaires civiles, et dans celle-ci, les affaires réelles des affaires personnelles[127]. Ce règlement fit ainsi la part des juges civils et celle des magistrats militaires. Ceux-ci restaient juges des actions personnelles dirigées contre leurs subordonnés. Le prévôt des maréchaux ou le gouverneur du lieu, et, en son absence, le juge provincial, assisté des chefs et des capitaines connaissait des délits perpétrés pendant les marches ou dans les logements, et des crimes punissables de mort. En matière civile, le juge ordinaire avait la connaissance des dettes et obligations antérieures à l'admission dans les compagnies, des actions réelles, hypothécaires et de succession. Quelques dispositions de cette ordonnance soulevèrent des conflits entre les juges militaires et la justice ordinaire, et donnèrent lieu à un édit interprétatif du 13 novembre 1549. Cet acte, reproduit textuellement dans le règlement organique du 21 février 1552, statua que la juridiction criminelle serait exercée par le prévôt des maréchaux, sous l'autorité du maréchal de l'ost ; en son absence, sous celle du gouverneur, et à défaut de ce dernier, sur l'avis du conseil provincial. D'un autre côté, le règlement de 1552, étendant les prérogatives du juge ordinaire, conféra à ce juge le pouvoir de procéder à l'arrestation des gens de guerre, même aux lieux de garnison et sous les drapeaux, dans les cas de crime capital, à la charge de les remettre à leurs capitaines pour être livrés au prévôt des maréchaux. Les règlements de 1547 et de 1552, spéciaux d'abord aux bandes d'ordonnances, furent généralement rendus applicables aux autres corps. Le 2 juin 1555, un nouvel édit renouvela les dispositions précédentes, et y en ajouta d'autres destinées à former tout à la fois un code pénal militaire et un règlement de discipline et de service pour les armées en campagne. Cet édit consacra l'usage de les soumettre à un conseil composé d'officiers, comme chose qui se fonde sur bonne raison et équité, et qui, en grande partie, avoit été observée et usitée ci-devant, par gens cherchant los et pris de chevallerie, et convoiteux d'honneur et de vertu, de sorte que quasi portout elle étoit tenue et réputée pour droit de guerre. A cet effet il organisa des tribunaux purement militaires, suivant partout les armées. Ces tribunaux étaient présidés par le maréchal de l'ost ou par l'officier général qui le remplaçait, et composés de colonels, capitaines, lieutenants, auditeurs et autres principaux officiers, en nombre suffisant pour écarter tout soupçon de partialité ou de précipitation[128]. Terminons cet exposé par quelques indications relatives à la marine militaire. Cette marine était presque exclusivement fournie par les provinces et par les villes maritimes, qui armaient de nombreux vaisseaux de guerre pour la protection de la pêche et de leurs intérêts commerciaux. Quand il étoit question de faire quelque équipaige de mer ou de faire apprester navires de guerre, où Sa Majesté devoit supporter les despens, dit une ordonnance un peu postérieure au règne de Charles-Quint[129], quelque personnage du conseil privé, ou bien quelque autre officier, étoit délégué pour avoir la superintendance dudit équipaige. Il lui estoit despechez amples instructions : comment il se devoit conduire, avec autorisation de faire tous marchez tant de navires, munitions de vivres et de guerre, matelotz et aultres ; de signer ordinaires, rôles et acquits au commis chargé de tenir le compte des deniers ordonnez pour ledit équipaige. Les contrats de location stipulaient pour les propriétaires des navires l'obligation d'y recevoir, selon leurs capacités tel capitaine et tel nombre de gens surnuméraires qu'il seroit ordonné, et de fournir à ceux-ci, en la forme accoutumée, les dépens de bouche, savoir : quatre fois de la viande par semaine, s'il n'y avoit jeûne, et trois fois la semaine du poisson, bière, fromage, pottage et bonne boisson, à raison de six gros et demi par tête[130]. Il y avait d'autres moyens plus sommaires, quand le gouvernement était pressé d'armer une flotte. Des lettres patentes autorisaient alors l'amiral de la mer à lever dans les provinces maritimes des matelots, des pilotes, des artilleurs ; à saisir les navires qu'il jugeait propres à l'expédition ; à prendre, après en avoir dressé l'inventaire, les pièces d'artillerie, la poudre, les boulets, toutes les autres munitions de guerre des navires armés se trouvant dans les ports du pays[131]. Dans des circonstances moins urgentes, on voit le gouvernement inviter les états de Hollande, de Zélande, de Flandre, de Brabant, et ceux des villes hantans et fréquentans la mer à équiper des navires de guerre, et à les fournir de vivres, de munitions et d'artillerie[132]. L'art nautique avait fait des progrès marquants, et, depuis le XVe siècle, on avait commencé à construire de plus grands vaisseaux. Au lieu de clouer les planches les unes sur les autres, on les joignait par des rainures ; les vides étaient calfatés avec des étoupes ; les bâtiments devenaient ainsi plus solides et plus durables. Un autre progrès fut la création des sabords, ouvertures pratiquées dans les murailles des bâtiments pour donner des embrasures aux canons, que l'on plaçait auparavant sur le pont unique du navire et qui tiraient par dessus bord. Les constructions navales avaient pris de tels développements aux Pays-Bas que les Anglais venaient eux-mêmes y acheter des vaisseaux, comme ils s'y fournissaient d'artillerie et de munitions[133]. On y fabriquait des navires de diverses espèces, tels que les galions, galiotes, galères, nefs, caraques, caravelles, etc., usités chez les diverses nations. Mais une variété plus spécialement employée par les Flamands et par les Hollandais, était le heu ou hui, sorte de caravelle appelée aussi hulque. C'était un navire de grandeur moyenne, n'ayant qu'un mât comme les sloops et les cutters de ce temps-ci. Citons quelques exemples pour faire apprécier la force des vaisseaux de guerre d'alors. Une flotte équipée en 1544 comprenait, outre deux navires espagnols, l'Ursule et la Trinité, le premier monté par l'amiral de 250 tonneaux ou tonnelades[134] dans le langage de l'époque, et le second de 230 : le Salvator de 135 tonneaux ; la Marie de la Vère de 110 ; le Cygne de 120 ; la Louise de 100 ; l'Adolphe de 55 ; le Boot de 40 ; le Henri de Merckere de 65 ; le De Cuyper de 115 ; la Bonne Aventure de Middelbourg de 100 ; la Marie de Middelbourg de 90 ; la Romaine de 90. Une autre flotte, équipée en 1556, était formée du Faucon, vaisseau amiral, portant deux cents gentilshommes, officiers, marins et gens de guerre, et des navires suivants : la hulque l'Éléphant, commandée par le vice amiral Gérard de Merckere, de 196 tonneaux ; la hulque le Vennsberg de 150 ; le Chevalier de mer de 148 ; la hulque 'Twilde Woudt de 140 ; la hulque la Cateline de 138 ; la hulque les Quatre fils Aymon de 127 ; la hulque le Saint-Pierre de 123 ; la hulque le Saint-Martin de 120 ; la Marie de 114 ; le Bocq de 90 ; la hulque le Isaac de 88 ; le Dragon de 88 ; le Salvator de 87 ; la hulque le Saint-Jean-Baptiste de 80 ; l'Aigle de 80 ; le Cerf-volant de 80 ; le Tigre de 60 ; et la Licorne de 45[135]. Dans une description du vaisseau La Julienne, que monta Philippe le Beau en 1506, il est dit qu'il avait trois mâts et deux huniers[136], que l'appartement du roi était sur le devant et se composait de quatre chambres, deux en bas et deux en haut ; qu'au dessus de ces chambres il y avait un château garni de gens et d'artillerie, et que, sur le derrière, il y avait un autre château pour les officiers[137]. Une guerre avec l'Écosse provoqua, en 1550, un règlement sur l'armement des navires et le personnel des équipages[138], règlement qui fut retouché et augmenté l'année suivante[139]. Aux termes de ces ordonnances, l'équipage d'un navire de guerre se composait, outre le capitaine et son second, d'un nombre de matelots et de soldats déterminé d'après le tonnage du navire ; le nombre des canons et autres engins de guerre l'était également. Dans tous les ports les officiers spéciaux étaient chargés de l'inspection des navires en partance. Il leur était prescrit de s'assurer s'ils étaient bien armés, en état de tenir la mer, fournis de munitions et d'équipages suffisants, des approvisionnements et des outils nécessaires. Une seconde inspection de la mâture, de la cargaison, de l'artillerie, des munitions et des hommes avait lieu au moment où le navire allait mettre à la voile. Les matelots prêtaient serment de ne point abandonner leur navire ; s'ils se parjuraient, ils étaient punis de mort. Dans aucune circonstance il n'était permis d'enlever ni d'abaisser le pavillon de l'empereur. Étaient considérés comme écumeurs de mer tous vaisseaux ayant à bord divers pavillons, amis et ennemis. L'artillerie de marine était placée sous les ordres d'un chef appelé connétable. La composition des équipages de guerre resta longtemps un amalgame formé d'éléments très peu recommandables. Les rameurs étaient fournis par la justice criminelle ; la plupart des matelots était le produit de la presse des vagabonds et des mendiants valides qu'un simple ordre du gouvernement faisait transporter sur les galères de l'empereur. Pour chaque flotte il y avait un prévôt chargé de la poursuite des coupables et de l'exécution des arrêts prononcés par l'amiral ou par le vice-amiral. Jusqu'au XVIe siècle, il n'y eut point, à proprement parler, de législation maritime. L'usage avait établi, pour la sûreté des transactions commerciales, des règles qui suppléaient en partie à l'absence de lois écrites. Philippe le Bon avait promulgué quelques dispositions pour accélérer les jugements dans les affaires de commerce nautique[140]. Par une ordonnance du 8 janvier 1488, Maximilien et Philippe le Beau avaient créé un lieutenant général du prince par la mer et grèves d'icelle ; ils lui avaient attribué juridiction, connoissance et jugement, par lui ou par ses lieutenants, de tous crimes, délits ou excès y commis ; des contrats de fret des navires, des gages des mariniers[141]. Nous avons dit que Charles-Quint, jugeant ces mesures insuffisantes, avait prescrit à sa tante, en 1522, de soumettre à l'examen d'hommes compétents les ordonnances navales de France, d'Angleterre et d'Espagne, à l'effet de préparer pour les Pays-Bas un projet de règlement aussi complet que possible. Cet examen, s'il fut entrepris, n'aboutit pas. Par un règlement du 27 décembre 1540, l'empereur confirma l'ordonnance de 1488, et la reproduisit presque littéralement. La compétence de l'amiral de la mer fut cependant restreinte quant aux affaires pénales et aux prises ; il fut permis de se pourvoir directement au conseil privé et au grand conseil de Malines, contre les jugements de cet officier et de ses lieutenants. Ce règlement statue que l'amiral de la mer sera désormais,
en cette qualité, lieutenant général et souverain
officier en mer et sur les grèves ; il aura par lui, ou par ses
lieutenants, connoissance, juridiction et décision
pour tout cas y commis, sur des vaisseaux de guerre, à l'occasion de la
guerre. A cet effet, il établit, où il le juge convenir, un lieutenant
et des officiers de justice, soit selon les coutumes des lieux, soit, à
défaut de coutumes, selon les dispositions du droit
commun écrit. Il est enjoint à l'amiral de ne nommer à ces fonctions
que gens notables, de bonne vie, sages et bien
renommés, qui jureront solennellement de juger sans faveur ni corruption.
Le règlement donne la raison de cette prescription : c'est parce que, si l'amiral commettoit pour ses lieutenants e officiers,
des gens de petit état et d'infime condition, ils pourroient, par corruption
ou par convoitise, s'entendre avec les preneurs de prises, ou bien faire le
dixième de l'amiral plus grand, en déclarant de bonne prise choses ne l'étant
pas. Le produit des amendes est partagé par moitié entre le souverain et l'amiral. L'amiral a la faculté d'enfermer ses prisonniers dans les places fortes, mais avec l'assentiment des capitaines de vaisseaux. Dans les expéditions, il a, de même que ses lieutenants, le droit de justice sommaire, sans devoir attendre le retour des navires. En temps de guerre, l'amiral veille à ce que les guets et les fanaux des côtes soient toujours bien établis ; il punit la négligence des autorités chargées de les entretenir. Nul ne peut mettre en mer un navire de guerre sans autorisation du souverain, et sans s'être préalablement présenté à l'amiral ou à son lieutenant. Ceux-ci sont tenus de s'assurer que le navire est dans les conditions voulues, bien armé et bien équipé. Il leur est prescrit de s'enquérir de la moralité du chef du navire ; il faut que ce chef soit habitant du pays ou qu'il y ait des biens ; qu'il jure de ne piller ni rober les sujets de l'empereur, ni ses alliés, ni les vaisseaux munis de sauf-conduits ; il doit répondre de ses gens et livrer à l'amiral ceux qui se rendraient coupables de quelque méfait. L'amiral enjoint à l'équipage d'obéir au capitaine et à son quartier-maitre, sous peine de châtiment exemplaire. Outre ses bannières, pennons et étendards, tout navire de guerre porte ceux de l'amiral ; les contraventions à cette disposition sont punies de 25 carolus d'amende pour la première fois ; de 50 pour la seconde ; de ban ou autre punition arbitraire pour la troisième. Ces amendes sont au profit de l'amiral. L'amiral fait la répartition du butin, et perçoit un dixième de toutes les prises effectuées par les navires de guerre. Seul il donne des lettres de sûreté aux prisonniers faits en mer ou sur les grèves ; les lettres de sauf-conduit accordées à des sujets de l'ennemi ne sont délivrées que par le souverain. Toutes les captures sont remises à l'amiral ou à son lieutenant ; il ordonne la restitution de celles qui ont été indûment faites, sous peine de 50 carolus d'or pour la première fois ; de 100 pour la seconde ; de ban ou autre punition arbitraire pour la troisième. Ces amendes reviennent à l'amiral ainsi intéressé à l'exécution de la loi. Les navires pris et délaissés par leurs équipages sont abandonnés à qui les a capturés, après constatation qu'ils appartenaient à l'ennemi. Dans le cas où ils seraient la propriété de l'empereur ou de ses alliés, ils sont mis sous bonne garde pour être restitués. Il est interdit à toute personne ayant licence de mer d'enfoncer les coffres, de détruire les papiers, de défaire les ballots de marchandise se trouvant sur les vaisseaux capturés. Il est enjoint, sous peine d'être châtié comme voleur, de les ramener à terre pour que l'amiral ou son lieutenant les examine. C'est à cet édit que remonte l'établissement des juges de l'amirauté ou tribunaux maritimes, qui reçurent, en 1590, une plus complète organisation[142]. Comme chef militaire, l'amiral avait pouvoir absolu en tout ce qui concernait le service et les opérations de guerre ; il exerçait gouvernement, justice et commandement sur tous ses subordonnés, capitaines, gentilshommes, gens de guerre, maronniers, matelots et autres. Son état-major, si l'on peut employer ce mot inusité alors, comprenait douze officiers et serviteurs principaux, vingt gentilshommes, un chapelain, un maître chirurgien principal et un aide, un secrétaire principal, un trucheman sachant l'anglais, le français et le flamand, un prévôt, douze hallebardiers, six stocknechten. Chaque province maritime avait son amiral. Les fonctions d'amiral de Hollande et de Zélande, réunies en la personne de Philippe de Bourgogne, furent séparées après sa mort ; les Pays-Bas eurent alors trois amiraux ou vice-amiraux : le comte d'Hoogstraeten pour la Hollande, le seigneur de la Vere, Maximilien de Bourgogne, pour la Zélande, et le comte Charles de Lalaing, pour la Flandre. Toutefois le titre et les fonctions d'amiral de la mer restèrent héréditaires dans la famille de Philippe de Bourgogne, qui eut pour successeur, sous le règne de Charles-Quint, son fils Adolphe et ensuite son petit-fils Maximilien. On voit quelquefois investir momentanément des fonctions d'amiral des officiers des armées de terre ; c'est ainsi qu'on voit figurer, en cette qualité, le sire d'Ysselstein, Florent d'Egmont, un des capitaines les plus célèbres des guerres de Gueldre et de Frise. Nous reprenons maintenant notre récit interrompu, et, après avoir suivi pendant quelque temps notre grand empereur au dehors, après avoir assisté aux opérations de ses armées en France et en Italie, après avoir exposé les phases diverses de sa politique franche et habile tout ensemble, nous allons concentrer nos regards sur les vicissitudes intérieures du pays, le mouvement de ses affaires et les changements qui se produisirent dans notre état social jusqu'à la fin du gouvernement sage et actif, mais un peu absolutiste, de la tante dévouée de Charles-Quint, Marguerite d'Autriche. Au moment de quitter les Pays-Bas pour de longues années, l'empereur avait renouvelé, par lettres patentes du 21 mars 1522, les pouvoirs du conseil privé institué à la veille de son départ pour l'Allemagne. Le 15 avril suivant, il en nomma chef-président Jean de Carondelet, seigneur de Champuans. Cet homme d'état, né à Dôle en 1469, appartenait à la Franche-Comté par son origine, mais sa famille était établie en Belgique depuis le XVe siècle. Son père avait servi avec distinction Charles le Téméraire et Maximilien ; il avait été ministre du premier et chancelier de Bourgogne sous Maximilien. Lui-même, après avoir étudié à Louvain, avait obtenu, grâce à un mérite exceptionnel, de riches et nombreux bénéfices. Il avait été successivement élu chanoine de Cambrai, haut-doyen de la métropole de Besançon, chanoine de Saint-Sauveur d'Harlebeke, de Saint-Donat à Bruges et d'Anderlecht, enfin abbé commendataire de Mont-Benoit, au comté de Bourgogne. En 1520, il fut nommé archevêque de Palerme et primat de Sicile, puis prévôt de Saint-Donat, ce qui équivalait à la dignité de chancelier perpétuel de Flandre. Il fit un usage généreux de ses riches revenus au profit des lettres et des arts. C'est ainsi qu'on le voit, entre autres, orner d'un vitrail l'église de Scheut, et achever de ses deniers le collège de Saint-Donat à Louvain. On le voit. aussi se signaler par quelques productions littéraires et entretenir des relations avec Érasme et les savants les plus célèbres de son époque[143]. De nouvelles lettres patentes du 22 mai suivant séparèrent les fonctions de chef et celles de président ; ces dernières furent confiées au sire d'Aigny. D'autres lettres patentes, datées aussi du 15 avril, avaient confirmé Marguerite dans sa charge de régente et gouvernante des Pays-Bas. Ces lettres prescrivaient de lui obéir comme à l'empereur lui-même. Une garde de vingt hallebardiers et de vingt archers fut affectée à son service, ainsi qu'à celui du conseil privé et du collège des finances. Ce collège resta composé d'un chef des finances, d'un trésorier général, d'un receveur général, d'un greffier et de deux huissiers. La teneur de la commission donnée à la régente lui confiait des pleins pouvoirs pour la direction du gouvernement. Toutefois des instructions du 23 mai 1522 lui enjoignirent de se conduire en toutes choses par bon avis et mûre délibération du conseil privé, et, en matière de finances, de se conformer à l'avis des personnes commises à cette branche de l'administration. Il lui était prescrit aussi de suivre, pour la collation des bénéfices ecclésiastiques, le rôle dressé par l'empereur ; c'était seulement, après avoir épuisé ce rôle, qu'elle était autorisée à nommer personnages, idoines et suffisans, comme bon lui semblerait. Il lui était recommandé d'appeler aux dignités abbatiales et autres tels et si bons personnages que les églises fussent pourvues de bons pasteurs à la louange de Dieu, à la prospérité des dites églises, au bien et à la sûreté du pays. Quant aux offices civils, l'empereur se réservait la nomination des gouverneurs de la Flandre, de l'Artois, de la Hollande, du Luxembourg, du comté de Namur ; des capitaines d'Arras, de l'Écluse, de Lille ; du président du conseil privé ; des chefs des collèges de justice ; des présidents des conseils de Malines, de Flandre, de hollande ; du chancelier de Brabant ; des baillis de Hainaut et de Bruges. Enfin le monarque conservait exclusivement le droit de grâce pour les crimes de lèse-majesté et de bien grande importance, et l'octroi des privilèges perpétuels[144]. Les états généraux avaient été convoqués à Bruxelles, le 10 mars, pour le mois d'avril suivant. Dans cette réunion, le grand chancelier Gatinara porta la parole au nom du prince. L'empereur, leur dit-il, avoit un extrême désir de demeurer dans les Pays-Bas. Contraint d'y renoncer par des affaires de la plus haute importance, il n'a pas voulu s'en éloigner avant d'avoir pourvu à votre sûreté. A cet effet il a conclu de bonnes alliances avec le roi d'Angleterre, qui a promis d'être le gardien de ces pays pendant son absence. Le chancelier engagea ensuite les états à seconder de tous leurs efforts la régente, laquelle par cy-devant s'estoit si bien et vertueusement acquittée au gouvernement et administration, que Sa Majesté et eux estoient tenus à elle pour son bon règne et conduite avec le fervent zèle et naturel amour qu'elle leur portoit. Après avoir remercié les députés du pays de l'ardeur qu'en toute circonstance ils avaient déployée pour le service du souverain, l'orateur terminait par cet appel à la concorde : Sa Majesté vous requiert et ordonne que selon vos loyaultés et fidélités accoutumées, veuillez, durant son absence, vivre entre vous paisiblement et sans noises ; vous aider, secourir et assister les uns aux autres en vos nécessités ; demeurer et persévérer en si bonne union et intelligence entre vous, sans vous desjoindre ou séparer aucunement, afin que la vertu et force demeurent unies, ayant souvenance de l'exemple qui vous fut l'autre fois baillé, à l'assemblée d'Anvers, de la trousse des flesches bien liée[145]. Le moment de quitter ses fidèles sujets des Pays-Bas étant arrivé, l'empereur se mit en chemin et s'arrêta quelques jours à Bruges. De graves pensées le préoccupaient et le déterminèrent à y écrire son testament le 22 mai. Il déclarait que s'il mourait en Espagne, il voulait être enterré à Grenade à côté de son père et de ses ancêtres maternels ; si c'était dans les Pays-Bas ou pendant la traversée à son retour, dans l'église de Notre-Dame, à Bruges, près de son aïeule Marie de Bourgogne, à moins toutefois que le duché de ce nom ne fût rentré sous son obéissance, auquel cas il prescrivait que l'inhumation se fit à Dijon, dans l'église des Chartreux, où reposaient Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon. Ses obsèques devaient être célébrées avec piété, mais sans luxe. Il léguait quarante mille ducats d'or à des œuvres de bienfaisance, savoir, dix mille aux pauvres couvents, dix mille aux pauvres estropiés, dix mille à l'instruction des enfants pauvres, dix mille en dot à de jeunes filles pauvres. Enfin il ordonnait l'exécution du testament de son père, et désignait pour ses exécuteurs testamentaires Henri de Nassau, Charles de Lannoy, Antoine de Lalaing, son confesseur Jean de Glapion, et le greffier de l'ordre de la Toison d'or Laurent du Blioul[146]. Le 27, il s'embarqua à Calais pour l'Angleterre. Le licenciement des armées, après la campagne de 1521, n'avait pas amené une complète cessation des hostilités, et l'on avait vu avec quelque inquiétude François Ier arriver inopinément à Amiens à la tête de sept cents hommes et de dix-huit mille fantassins. Charles-Quint ne s'en émut pas[147], et tout se borna en effet, après la retraite du roi, à des surprises et des pillages. Robert de la Marck et ses maraudeurs gueldrois avaient recommencé leurs déprédations. Les agents de la France entretenaient l'agitation dans le pays, où éclatèrent quelques troubles sans gravité[148], mais les excès de nos propres troupes n'aidaient pas peu à irriter les esprits. Après la prise de Tournai, il avait été ordonné aux gens d'armes licenciés de rentrer dans leurs foyers sous peine de mort. Le 15 janvier suivant, un nouveau mandement avait défendu, à peine de la hart, à tous gens d'armes de prendre prisonniers ou de rançonner, sous ombre de guerre, les habitants du Hainaut, alors même qu'ils seraient natifs de France, du moment où ils auraient résidé dans le pays l'espace de deux ans avant la guerre. Une ordonnance du 27 du même mois avait enjoint à tous les gens de guerre, non aux gages et ordonnances de l'empereur, de se retirer chascun en leur maison, sans fouler les sujets, sous peine de la hart et de confiscation de biens, et il avait été prescrit aux autorités de les y constraindre par le son de la cloche ou aultrement[149]. Mais toutes ces ordonnances restaient impuissantes devant la licence de la soldatesque. Des deux côtés de notre frontière du midi, les incursions des garnisons voisines ne laissaient nul repos aux malheureux habitants. Le jour de l'Annonciation, 25 mars 1522, douze cents lansquenets impériaux, ayant passé l'Authie près de Dourlens, pillèrent Bernaville et les villages voisins. Surpris par d'Estrées, gouverneur de Dourlens, ils perdirent une partie de leur butin, non sans avoir opposé une vigoureuse résistance et fait mordre la poussière à plusieurs capitaines français. Le comte Jean de Salm-Reifferscheid s'avança, avec deux cents cavaliers, jusque dans les environs de Reims, mais assailli par des forces supérieures, il fut fait prisonnier et ne recouvra la liberté qu'au prix d'une rançon de dix mille écus d'or. Les impériaux emportèrent de vive force le château de Rémilmont. Le comte de Buren, à la tête d'une division formée de troupes prises dans les garnisons de l'Artois, faillit surprendre Dourlens. Le 19 mars, il attaqua cette ville du côté d'Amiens ; repoussé une première fois, il allait revenir à la charge, lorsqu'une querelle éclata entre les soldats wallons et les lansquenets qui se disputaient l'honneur de monter les premiers à l'assaut. Elle n'était pas encore apaisée, quand Buren fut prévenu de l'approche du comte de Saint-Pol, accourant au secours des assiégés avec les garnisons de Hesdin, de Montreuil, de Corbie, de Péronne et d'autres places voisines. Il se retira en bon ordre et rentra à Arras sans être inquiété[150]. De leur côté, les Français pénétrèrent dans le Luxembourg, et se montrèrent jusque dans les environs de Paliseul et de Saint-Hubert, mais ils se retirèrent à l'approche de douze cents piétons namurois, dirigés en toute hâte sur les points menacés[151]. Ces hostilités incessantes avaient fini par épuiser le
trésor ; la pénurie des finances était extrême. Charles-Quint n'avait pas
encore quitté l'Angleterre, quand Marguerite lui dépêcha Jean de le Sauch,
avec des instructions où étaient exposés en détail les périls et les
difficultés de la situation. Nous ne saurions nous-même en donner une
meilleure idée qu'en mettant sous les veux du lecteur ce tableau d'une
énergique simplicité : Madite dame tient bien
avertie Sa Majesté en quel état et nécessité de deniers ont été laissés les
pays de par deçà, par suite de la grande et excessive dépense résultant de la
guerre. Pour y pourvoir, on a anticipé les revenus des domaines et les aides
; contracté plusieurs emprunts, qui courent à grands frais à la charge de Sa
Majesté et qu'on a promis de rembourser en bref temps. Dernièrement encore,
quand a échoué la négociation entamée à l'effet de lever cent mille florins
destinés à payer les troupes de terre et de mer et à équiper la flotte, il a
fallu, pour garder l'honneur de Sa Majesté, envoyer en toute hâte à Anvers le
comte d'Hoogstraeten et le receveur général Jean Micault, et ils ont éprouvé
les plus grandes difficuités à se procurer de l'argent. Madite dame avoit
remis au comte la plus grande partie de ses baghes et de ses joyaux, ainsi
que les deux licornes et le riche drageoir que sa Majesté a délaissés de par
deçà, et il ne s'est trouvé personne qui ait rien voulu prêter sur les dites
baghes ; seulement sur les chaînes d'or et la vaisselle d'argent on a obtenu
dix mille livres. Or, comme cette somme étoit de beaucoup insuffisante, le
comte d'Hoogstraeten a dû vendre mille livres de rente sur le meilleur et le
plus clair de ses biens, dont il s'est dessaisi au rachat du denier seize. Il
s'est, en outre, constitué garant, en son propre et privé nom, envers la
ville d'Anvers, pour une somme de vingt mille écus, et, de cette manière
seulement, on est parvenu à acquitter le billet fait par Sa Majesté à Don Hugues
de Moncade et à payer les trois milles piétons allemands du seigneur de
Rogendorff. Journellement encore viennent de nouvelles charges, et il est impossible d'y satisfaire, car on ne trouve plus personne qui veuille prêter un denier en aucune manière du monde, soit par vente de rente, engagère, ni autrement. Les raisons en sont que la guerre est en France et dans les pays de Gueldre et d'Utrecht, et qu'elle a interrompu le commerce, qui est le fondement de la prospérité des Pays-Bas. D'autre part, les états de Flandre ayant mis la main aux deniers de l'aide, pour payer directement les gens d'armes chargés de la garde de leur pays, les prêteurs, quelque promesse qu'on leur fasse, craignent d'être difficilement remboursés et présupposent que les autres pays, par succession de temps, suivront l'exemple de la Flandre ; à cette cause n'y a espoir désormais de savoir rien trouver. Pour la troisième raison qui est la plus péremptoire, c'est que l'on connoit à présent les grands deniers ci-devant levés pour Sa Majesté, tant pour les affaires de ses pays d'Allemagne que d'Espagne, et l'on sait que les obligations créées à cet effet n'ont pas été acquittées ; en suite de quoi les intérêts courants à la charge de l'empereur sont énormes aujourd'hui, et ses créanciers, même ceux d'Anvers, sont en voie, s'ils ne sont brièvement payés, de faire tous banquerotte et de perdre leur crédit. Le comte d'Hoogstraeten, qui s'est trouvé en bien grande extrémité pour se procurer de l'argent, et qui a dû doubler l'intérêt pour en obtenir, est au bout de son crédit : si tout devoit se perdre pour dix mille florins, ils ne seraient pas à présent recouvrables. Il importe donc que Sa Majesté avise à quelque bon moyen pour rembourser les précédents emprunts et pour décharger le comte et tous ceux qui se sont engagés pour elle, sinon ils demeureront perpétuellement détruits et déshonorés, ce qui seroit très mauvais guerdon de bon service et fort mauvais exemple pour ci-après en avoir encore. Madite dame a offert au comte de lui laisser ses baghes en mains jusqu'à ce qu'il soit acquitté et déchargé des dernières sommes qu'il a fournies ; mais il a si grande confidence en Sa Majesté et il a usé de telle honnêteté, qu'il ne les a voulu retenir. Puis, non seulement pour ces raisons, mais pour les autres grandes charges délaissées par deçà. et devenues inévitables, il est indispensable de trouver argent, sinon bien facilement se pourroit élever une conjuration et mutinerie ès pays de par deçà. Sentant leur prince absent et non si prêt à revenir, voyant leurs biens diminués par suite de la guerre, les vivres fort chers et les récoltes de mauvaise apparence, si Dieu n'y pourvoit, ils seroient tous portés et prêts de ce faire. Or, ce seroit d'autant plus pestiféré danger et périlleux inconvénient, que la guerre est présente et la chose fort difficile à réparer. Madite dame et son conseil feront toujours de leur mieux pour y obvier ; mais ils désirent que Sa Majesté connoisse l'état des choses, afin que le mal qui pourroit en advenir ne leur soit point imputé : laisser grandes charges et peu de revenus en un pays tel que celui-ci, est bien mal conduisable pour le tenir en telle sûreté, obéissance et pacification que l'on voudroit[152]. Au milieu de ces embarras, et en attendant la résolution de son neveu, Marguerite essaya d'agir sur les pays de Brabant, de Hainaut et de Hollande, pour les engager à se charger d'une partie de l'entretien des bandes d'ordonnances à l'exemple de la Flandre, qui avait consenti à entretenir à ses frais les cinq compagnies placées sur les frontières de ce comté et de l'Artois, ainsi qu'un corps de huit cents fantassins, qui fut ensuite porté à treize cents. Cette combinaison n'eut guère de succès. La gouvernante ne réussit pas mieux dans le Luxembourg, où Jean de Trazegnies et Adolphe van der Noot, seigneur d'Oignies, demandèrent en vain de sa part aux états de prendre à leur solde les hommes d'armes du prince d'Orange, qui refusaient de marcher avant d'avoir touché leurs arriérés, et quelques enseignes d'infanterie destinées à protéger la frontière contre les incursions de l'ennemi. Marguerite fut obligée de reconnaitre elle-même qu'il était impossible d'imposer de nouvelles charges à cette province déjà si fort éprouvée par la guerre. Elle songea alors à convoquer les états généraux, mais elle renonça à cette idée dans la prévision d'une opposition pleine de périls. Force lui fut enfin de se tourner vers les états de quelques provinces, à l'effet d'y pratiquer argent tant par nouvelle aide que par vente de rentes et par anticipation sur les aides, pour fournir des gages aux gens de guerre et remplir les engagements pris envers les marchands et autres qui lui avoient avancé des fonds, afin de conserver son crédit[153]. Le 49 juin, les états du Hainaut furent invités à se
réunir à Mons, le 24, pour entendre ce qui leur
seroit exposé par madame la régente, laquelle devoit s'y trouver en personne.
Cette province, l'une des plus désolées par les maux de la guerre, avait fait
déjà des sacrifices considérables. Tout récemment les villes de Mons et de
Valenciennes avaient créé, la première mille livres, la seconde six cents
livres de rentes héritables et viagères, dont le produit avait été affecté
aux dépenses militaires et à l'armement de la flotte en partance pour
l'Espagne. Néanmoins les nobles et les villes ne résistèrent point à
l'éloquent ascendant de l'habile princesse, et consentirent une aide de
quarante mille livres de quarante gros de Flandre[154] (Juillet 1522). Les prélats, à leur tour, et moyennant lettres de non-préjudice, accordèrent
neuf mille livres ; Tournai suivit ces exemples, et donna quatre mille
livres. Les aides ainsi votées par les nobles, les villes et les prélats du
Hainaut furent affectées au payement d'un corps de six cents hommes de pied
et de cinq cents chevaux des bandes d'ordonnances d'Arschot et de
Hoogstraeten, chargés de la défense du comté, dont le sire de Trazegnies
venait d'être nommé capitaine général en l'absence du marquis d'Arschot. Les autres provinces ne se montrèrent pas d'aussi facile composition. Namur persista dans ses précédents refus. Le Brabant était entré dans une voie de résistance, qui n'était pas sans périls. Marguerite, tenant peu compte des répugnances générales devant ces demandes répétées de subsides, se plaignait vivement des états du duché, peu pressés de se réunir à l'accoustumée, disait-elle. Quand ils furent enfin réunis, on leur demanda cent vingt mille livres destinées à l'entretien des garnisons des villes frontières du Hainaut, du Luxembourg, et, au besoin, du Brabant, s'il était menacé par les Gueldrois, ainsi qu'à l'acquittement partiel des dettes et des obligations contractées par l'empereur à. l'occasion de la guerre et s'élevant à plus de neuf cent mille livres. Cette pétition fut si froidement accueillie, que le gouvernement y substitua aussitôt celle d'une vente de quinze mille livres de rentes hypothéquées sur le duché et rachetables en dix années, durant lesquelles vingt-quatre mille livres, prises sur les aides courantes, seraient annuellement affectées à l'amortissement. Les prélats ne consentirent qu'avec peine à une vente de sept mille livres de rente seulement[155]. On se plaignit fort, dans l'entourage de Marguerite, de ce que les abbés, dérogeant, parait-il, à un usage reçu, s'étaient contentés, de notifier leur décision aux deux autres membres, sans s'être préalablement concertés avec leurs collègues de l'état noble, disposés, semble-t-il, à plus de générosité. Voici comment la gouvernante elle-même s'exprimait, dans une communication à l'empereur sur le compte des prélats : D'ancienneté et de coutume, lorsque les prélats avoient arrêté leur opinion, ils la communiquoient aux nobles afin, si possible, de convenir d'opinion avec eux.... Mais iceulx prélats demourèrent fermes en leur propos, voire à proprement parler obstinez.... Mais si, objectoient quelques nobles, du rejet de la pétition, inconvénient advenoit, et que les ennemis, que Dieu ne voulusisse ! entroient au pays, la faute n'en seroit leur, mais aux prélats, les opposants bien arrogamment dirent et protestèrent que si mutinerie advenoit au pays de Brabant, ce serait à l'occasion de trop charger le peuple et en seroit la faute aux nobles... Que si les nobles n'étoient de la cour et n'y avoient si grand crédit, ils trouveroient bien leur opinion bonne et s'accorderoient avec eux. Marguerite ajoute qu'elle a mandé elle-même les prélats pour leur faire plusieurs remontrances, en intention de les amener à consentir à la demande, mais, dit-elle, ce fut pour néant[156]. L'opposition des villes n'était pas moins vive. Marguerite avait appelé leurs députés au palais pour les engager à. ne pas suivre l'obstinée et abusive détermination des prélats, et à se conformer à celle des nobles, mais les députés refusèrent de se prononcer avant d'avoir de nouveau consulté leurs commettants. Là dessus, Jean de Berghes et Adolphe van der Noot furent envoyés, l'un à Louvain, l'autre à Bois-le-Duc, pour pratiquer ceux de ces villes, pendant que le chancelier de Brabant pratiquoit ceux de Bruxelles, mais ils échouèrent l'un et l'autre devant d'invincibles résistances. On était à bout de ressources. Plusieurs membres du conseil privé proposèrent alors que madame la première, ceux dudit conseil, les chevaliers de l'ordre et autres bons personnages, les officiers, bourgeois, marchands et autres aiants de quoi, comme de bonne volonté, prissent à leur charge le payement d'un nombre de gens de cheval et de pied, chacun selon sa faculté, pour un demi an ou autre terme. La gouvernante s'empressa de déclarer qu'elle vouloit être la première et montrer le chemin aux autres[157]. Malheureusement l'exécution du plan présentait de telles difficultés qu'il fallut y renoncer. Dans l'intervalle, il avait été convenu, à la demande des députés des chefs-villes, qu'une nouvelle réunion des états aurait lieu, le 4 août, à Bréda. Dans cette nouvelle assemblée, l'opposition se montra plus nette encore que précédemment. Les commissaires de Marguerite, à bout de ressources, avaient engagé la princesse à se rendre de sa personne au sein des états. On l'attendait quand, dit-elle, ung matin, sans congé ni dire adieu au chancelier, avec lequel le soir avant ils avoient soupé, se retirèrent où bon leur sembla. Marguerite, qui était déjà arrivée à Anvers se montra fort offensée. Elle essaya de son ascendant sur les députés des villes, les convoqua itérativement (novembre), elle n'en put rien obtenir. Bruxelles et Bois-le-Duc surtout se montrèrent intraitables, et leur opposition neutralisa les votes plus favorables d'Anvers et de Louvain. En ce moment même, les hostilités s'accentuaient de plus en plus à la frontière. Les Anglais, attendus depuis longtemps, arrivèrent enfin au mois d'août. Le comte de Buren, qui avait réuni mille chevaux des ordonnances, trois mille fantassins et un nombreux parc d'artillerie, opéra sa jonction, entre Ardres et Saint-Omer, avec le comte de Surrey et les seize mille Anglais débarqués à Calais. Les deux généraux résolurent de former le siège de Hesdin. Dans leur marche sur cette ville, ils brûlèrent Dourlens, que le comte de Saint-Paul avait évacué à leur approche, saccagèrent et détruisirent un grand nombre de villages. Mais ils eurent lieu de se repentir de cette dévastation : ils étaient en proie à la disette avant même d'être arrivés à leur destination. Un mandement du 1er septembre 1522 exempta de tous droits de tonlieu, de chaussée et autres quelconques, les marchands, et les particuliers qui leur amèneraient des vivres par eau ou par terre. Cette mesure fut insuffisante. Un édit du 7 septembre enjoignit aux officiers de faire conduire de force vivres au camp des Anglois et autres gens de guerre deschendus en Picardie. La difficulté de réunir des approvisionnements était d'autant plus grande que l'arrivage des grains du nord n'avait point encore fait baisser le prix des denrées. Elles étaient alors à un prix exorbitant, et il en était résulté de nouvelles émeutes à Malines et à Louvain. La populace, dans ces deux villes, avait pillé les marchands de blés[158]. Ce mouvement populaire parut si sérieux dans la première de ces villes que l'on crut devoir retirer le port d'armes aux habitants. Durant le siège de Hesdin, qui fut levé au bout de six semaines, les Français ravagèrent, à diverses reprises, les frontières du Hainaut. La régente, craignant une attaque plus sérieuse, enjoignit, par un mandement du 21 septembre, à tous les laboureurs de ce comté ayant grains en gerbes, de les faire battre et de les amener dans les villes et forts, parce qu'on craignoit que les ennemis ne fissent quelque grosse course dans le pays. Vers le même temps, le bruit se répandit que le roi de France venoit faire grosse assemblée de gens à Attigny pour assaillir le Luxembourg ou le pays de Liège. L'apparition de quelques courriers ennemis, qui eurent avec les milices de Thionville un engagement assez vif, donna de la consistance à ce bruit. Ces rumeurs inquiétantes étaient propagées par les émissaires de Robert de la Marck, qui entretenait des intelligences avec les lansquenets portés à l'indiscipline par le défaut de payement de leur solde arriérée de quatre mois. Le marquis de Bade, qui commandait dans le Luxembourg, ne cessait de s'en plaindre et de représenter à Marguerite les dangers d'un tel état de choses. Il n'avait que trop raison. Les la Marck, après une première attaque sur le château de Pauly, investirent avec quatorze cens gens de cheval et dix mille piettons françois et ennemys à l'empereur, le château de Bouillon récemment remis à l'évêque de Liège. Le 1er octobre, Marguerite ordonna à Jean de Berghes d'envoyer au secours de cette place les douze cents hommes levés dans le pays de Namur. Réunis à ces braves Namurois, les comtes de Rochefort, de Nieuwenaar, de Salm, le seigneur de Houffalize, à la tête de leurs vassaux ; les milices de Virton, de Montmédi, d'Yvoy, de Bastogne, de Marche, de La Roche, d'Arlon, de Chiny, de Neufchâteau, d'Orchimont, marchèrent à l'ennemi et l'obligèrent à la retraite. Comme on craignait quelque nouvelle entreprise sur Thionville, on y fit entrer les hommes de fief du quartier, et les milices d'Arlon ainsi que des prévôtés reçurent l'ordre de s'y jeter au premier signal d'alarme. On atteignit ainsi péniblement la fin de l'année 1522. Les besoins d'argent devenaient de plus en plus considérables ; on était en présence d'un arriéré énorme, et la nation se montrait singulièrement fatiguée de tant de sacrifices toujours à recommencer. Partout il avait fallu augmenter les impôts ou en asseoir de nouveaux ; partout aussi des propos séditieux, des émeutes même attestaient le mécontentement du pays. Ne pouvant entrer dans tous les détails de cette malheureuse situation financière, nous plaçons en note un tableau où sont relevés les chiffres principaux des dépenses et des recettes[159]. Le 31 décembre 1522, Marguerite exposa à Charles-Quint les cruels embarras de sa situation. Dans sa réponse du 23 mars 1523, l'empereur l'engagea à pratiquer les états en général et en particulier par le moyen des nobles, des chevaliers de la Toison d'or et des membres de ses conseils, afin d'en tirer les plus grosses aides possibles. C'est ce qu'elle n'avait pas manqué de faire, mais fort inutilement dans ces derniers temps. A bout de ressources, assiégée de réclamations par les pensionnaires de l'État, liée par des engagements auxquels elle ne pouvait satisfaire, quoiqu'elle en eût, la régente renvoya tout au conseil privé. Le conseil fut d'avis de révoquer toutes les pensions, et Charles-Quint ordonna de surseoir au payement. H étendit cette mesure à toutes les dettes, et n'admit d'exception que pour les pensions des vieux officiers sans fortune, pour les personnes se trouvant à l'armée et pour celles qui n'avaient aucun autre moyen de subsistance. Pour dédommager Marguerite autant qu'il était en lui, il lui fit délivrer une gratification de quatre mille livres. L'active et courageuse princesse persista à faire tous les efforts possibles, à user de tous ses moyens d'influence, pour obtenir de nouveaux subsides des villes et des états des provinces. Grâce à des démarches sans cesse répétées, elle obtint de la ville d'Anvers un nouveau prêt de septante mille livres, garanti par le produit des tonlieux du Brabant et de la Zélande ; les états de Flandre avaient consenti à payer encore cent cinquante mille livres pour l'entretien des troupes placées à la frontière, mais toujours à la condition expresse de répartir eux-mêmes ces deniers ; le comté de Namur, après de grandes résistances, avait fini par octroyer la faculté de vendre, sous sa garantie, une rente de six cents livres, à amortir avec le produit des aides ordinaires, mais dans le Brabant la proposition de vendre quinze mille livres de rentes rencontrait une opposition inflexible, particulièrement du côté des villes. La gouvernante, irritée surtout contre Bruxelles et Bois-le-Duc, demanda à Charles-Quint des lettres retirant à ces villes aucunes grâces et octrois dépendant de sa volonté. L'empereur, eu acquiesçant à cette demande, recommanda à sa tante de bien adviser avant d'user de ces lettres, et de le faire au temps convenable et sans esclandre. Il faut aussi penser, ajoutait-il, si par ce, au lieu de les adoucir à accorder aides, on ne les rendra pas plus rétifs, et si on ne les portera pas à faire pis, vu que vous me prévenez que quelques-uns entre le populaire commencent à semer mauvaises paroles, et que vous craignez qu'en l'assemblée des états, ils ne tendent à autre fin et conclusion que nous ne voudrions[160]. Quoique Marguerite fût moins patiente que son neveu, elle
comprit la nécessité d'user de ménagements. Dans leur assemblée du 24 janvier
1523, les états de Brabant avaient réduit la vente demandée de nouvelles
rentes de quinze mille livres à cinq mille ; la régente se décida, bon gré
mal gré, à signer l'acte d'acceptation[161]. Mais en
présence de tant de besoins, toutes choses considérées
et longuement débattues avec les principaux personnages et le conseil privé,
malgré la difficulté procédant de la misère de ces pays et du peu
d'inclination d'une partie des sujets à bien fournir aux affaires, elle
dut prendre la résolution de recourir aux états généraux. Les gens et les choses sont en tel état,
écrivait-elle à Charles-Quint, que si je n'obtiens
de cette assemblée de nouvelles aides, je ne vois moyen de tenir les troupes
en leurs garnisons[162]. Les états se
réunirent à Malines à la fin de février. Le président du grand conseil, Josse
Lauwereys, parce qu'il étoit plus éloquent que M. de
Palerme, leur soumit les propositions du gouvernement. Ces
propositions tendaient à obtenir des états qu'ils se chargeassent, durant six
mois, de l'entretien de quatre mille gens d'armes, de dix mille hommes de
pied et d'un corps d'artillerie. La dépense était évaluée à six cent huit
mille livres, et l'orateur usa de toute son éloquence pour les mouvoir et incliner à la défense de ces pays et d'eulx
mêmes. — Comme toutes ou la plupart des
villes étoient chargées outre leur revenus ; que la pauvreté du plat pays en
divers quartiers faisoit présumer qu'il seroit impossible de recouvrer les
deniers de l'aide en la manière accoutumée, on laissait aux provinces l'option de recouvrer leur portion chacun en son quartier
comme mieux leur sembleroit, sur gens de tous états, par vente de rentes, par
impôts sur les maisons, sur les blés, les vins, les bières et autres
boissons, ou autrement[163]. A cette demande, les états, tout en protestant qu'il leur convenoit de se bien défendre, ce que tous vouloient
faire, déclarèrent unanimement que la chose était au dessus de leurs
forces, et que le gouvernement devait prendre sa part des sacrifices exigés
par la situation. Avant de tant travailler ses
pauvres sujets pour avoir aide, s'écrièrent les députés du Brabant, de
la Flandre et de la Hollande, l'empereur est tenu
d'exposer en vente son domaine. On eut beaucoup de peine à leur faire
abandonner cette idée, en leur produisant, sans rien oublier, l'état des
charges supportées par la caisse impériale, et en leur prouvant ainsi que le
domaine n'était déjà que trop obéré[164]. Alors les
députés du Brabant proposèrent à leurs collègues de former une union et intelligence par laquelle ils s'obligeroient
à s'entr'aider et à se secourir mutuellement dans la présente guerre et dans
celles qui éclateroient à l'avenir ; à supprimer toutes les barrières
existantes entre les provinces et à pourvoir au désordre des monnoies.
C'était la liberté du commerce, et particulièrement du commerce des grains à
l'intérieur, qui était ainsi mise sur le tapis. Les députés du Hainaut, de
l'Artois, de la Hollande, accueillirent la proposition sans trop de défaveur,
mais ceux de la Flandre, bien qu'ils fussent, dirent-ils, délibérés à être bons, loyaux et obéissants sujets envers
l'empereur, à vivre en bonne amitié et bon voisinage avec le Brabant et les
autres provinces, se prononcèrent contre la liberté du commerce des
céréales. Si nous avons interdit la sortie des
grains crus dans notre pays, dirent-ils, ce
sont les Brabançons et les Hollandois qui nous en ont donné occasion, en nous
empêchant de tirer de chez eux les blés que nous avions achetés. Or cette
prohibition nous est aujourd'hui profitable ; les provinces qui suivront
notre exemple l'éprouveront elles-mêmes, attendu que la mesure qui
antérieurement se vendoit d'ordinaire soixante sous tournois, s'obtient
aujourd'hui pour vingt-cinq. Du reste, malgré les ordonnances défendant
l'exportation des grains, quand nos voisins nous le demanderont, nous serons
toujours prêts à les aider selon nos facultés. Une nouvelle réunion des états généraux devenait nécessaire ; elle fut fixée au 15 mars. Mais au jour fixé, la plupart des provinces n'avaient point encore arrêté leur décision, et l'on fut forcé d'ajourner la convocation au mois d'avril suivant. En Flandre, ceulx de Gand, connoissant la lenteur des états de Brabant, sembloient disposés à attendre leur décision avant de tenir collace ; or toute la Flandre écoutoit et attendoit pour se déclarer, que la cohue de Gand eût pris une résolution[165]. Dans le Brabant, les opinions s'étaient partagées. Les abbés et les députés des villes étaient revenus sur leur projet d'union en insistant particulièrement sur l'opportunité d'assurer la liberté du commerce des grains. Au moyen de plusieurs remonstrances et par de bonnes raisons exposées avec douceur, le comte d'Hoogstraeten, le seigneur de Berghes et Laurent du Blioul parvinrent à écarter les motions des prélats et à les ranger à l'opinion des nobles. Ceux-ci avaient accueilli la pétition, en réduisant de cent soixante mille livres à cent cinquante mille la part du duché. Les villes paraissaient divisées ; le gouvernement comptait, que Louvain et Anvers suivraient l'exemple des prélats et des nobles, mais l'on n'était pas rassuré sur les dispositions de Bruxelles et de Bois-le-Duc, ces deux communes toujours récalcitrantes. Les états généraux s'assemblèrent enfin au mois d'avril. La plupart des députés non sans grosse difficulté, rapportèrent le consentement de leurs principaux à l'entretien, pendant six mois, de quatre mille gendarmes et de dix mille piétons avec la munition de l'artillerie, suivant l'état dressé par le comte de Buren, en présence des seigneurs entendus au fait de la guerre. Les sommes accordées étaient de beaucoup insuffisantes pour les nécessités du moment, si le gouvernement n'obtenait pas l'aide du Brabant. Tout fut mis en œuvre pour y arriver. Le 22 avril, Louvain, Bruxelles et Anvers s'étaient rangés à l'opinion des deux premiers membres, si avant toutefois que les députés de Bois-le-Duc eussent semblable charge, mais ceux-ci accordèrent seulement la moitié de l'aide et encore sous certaines réserves, dont ils exigeaient préalablement l'acceptation. Marguerite avait épuisé tous ses moyens. Le conseil privé l'engagea à proroger l'assemblée de six ou sept jours, dont on profiterait pour travailler les esprits. Elle y consentit sans grande confiance, et écrivit à l'empereur : A la longue, je ne vois conduisable le fait de la guerre en ces pays, et vous supplie d'y penser et, tant qu'en vous sera, d'y pourveoir[166]. L'empereur comprit qu'il était temps d'intervenir. Il
chargea son maître d'hôtel, Antoine de la Barre, seigneur de Mouscron, de se
présenter en son nom aux états des Pays-Bas, avec des instructions, datées du
30 avril 1523, où, dans un langage des plus affectueux, il leur donnait
l'assurance d'une paix prochaine et de l'envoi de secours efficaces. Après
avoir remercié de très bon cœur les états de
leurs nombreux sacrifices pour la garde des frontières, qui, grâce à Dieu et à leur bonne assistance, n'avoient pas été
entamées ; après avoir exprimé plus particulièrement sa gratitude pour
ceux qui, par leur empressement à voter les aides, avoient
eu singulier regard à son honneur et au bien de ses pays, Charles-Quint
continuait ainsi : Chacun et toute la chrétienté a
vu et connu que nous sommes entré en guerre contre notre gré, que nous y
avons été contraint par les invasions du roi de France, alors que nos
royaumes d'Espagne étoient en mutation et révolution, et qu'il sembloit que
nous pourrions mal nous défendre. Jamais nous n'avons eu le désir ni la
volonté de continuer la guerre pour accroitre nos états ; nous ne prétendons
user des moyens que Dieu a mis en notre puissance que pour préserver la
chrétienté des ennemis de notre sainte foi, pour maintenir nos pays en sûreté
et état raisonnable. Notre saint père le pape, comme bon pasteur de l'Église
universelle et se montrant envers Dieu et la chrétienté tel qu'il doit être,
nous a requis de condescendre à la paix ou à une trêve. Nous avons accueilli
cette ouverture, car notre plus ardent désir est de rétablir l'harmonie entre
tous les princes chrétiens, pourvu que les conditions de la paix ne soient
pas à la foule de notre honneur ou à notre gros dommage, et que nous ayons
l'assentiment de notre allié le roi d'Angleterre. Il ne nous est pas permis
de traiter sans ce monarque, mais nous ne formons aucun doute sur ses
dispositions : nous savons combien il recherche le bien de la chrétienté,
ainsi que notre honneur et profit. Si la médiation du pape n'a pas encore
produit ses fruits, il faut uniquement l'attribuer à l'indisposition de la
mer et des vents, et à notre éloignement de l'Angleterre et de Home. Que les
états soient bien convaincus, du reste, que nous apprécions les preuves
d'amour qu'ils nous ont données, et les lourdes charges qu'ils se sont
imposées. Aussi nous nous efforçons de préserver nos sujets de toute
invasion. Pour empêcher l'ennemi de se jeter sur les Pays-Bas, nous avons
envoyé de fortes sommes d'argent en Allemagne et en Italie ; en déjouant les
entreprises concertées par les François avec les Suisses et les Italiens,
nous détournerons la guerre de ces provinces. Nos royaumes d'Espagne se
montrent actuellement très enclins à nous servir de corps et de biens ; ils
nous ont accordé déjà une grosse aide et une puissante armée, et, grâces à
Dieu, depuis que nous avons châtié les principaux séducteurs du peuple et
pardonné aux autres, tous sont en vraie obéissance et plein de bon vouloir[167]. Néanmoins, outre les charges qui nous incomboient pour
entretenir nos armées en Espagne et en Italie, il nous a fallu vendre et
engager diverses parties de notre domaine royal et des rentes de notre
couronne[168], afin de donner assistance aux peuples des Pays-Bas, que
nous tenons pour nos principaux et bien aimés sujets. Il importe donc qu'eux
aussi pourvoient aux nécessités de la guerre et nous aident pour que l'été
prochain, nous soyons de toutes parts en mesure de nous défendre ou
d'offendre, seul moyen d'en venir promptement à quelque raisonnable paix ou trêve.
Déjà, à cet effet, nous avons requis notre bon frère et bel oncle[169] le roi d'Angleterre, en lui exposant la grosse puissance
que nous comptons mettre sus, de dresser, de son côté, une forte armée, qui
se joindra à nous ou descendra directement en France. Nous attendons
incessamment sa réponse. Cette campagne, décisive sans doute, nous imposera
de grands sacrifices. Comme il nous sera impossible de subvenir à l'entretien
de l'armée des Pays-Bas sans le concours de nos provinces, nous leur
demandons, pour la singulière amour et affection que leur portons sur tous
autres nos sujets, de nous bailler aide et secours. En revanche, afin
d'alléger leurs grosses dépenses, nous avons résolu d'engager notre propre
domaine ; nous autorisons, dès ce moment, notre tante à emprunter, dès qu'il
en sera besoin, une grosse somme d'argent. Cet emprunt servira à lever
l'armée destinée à se joindre aux Anglois, et à enrôler des gendarmes, en
attendant que les états préparent les secours que nous en espérons. Pour
mieux encore montrer à nos sujets des Pays-Bas notre bon vouloir, nous avons
aussi donné ordre d'employer sur le champ l'argent provenant de cet emprunt à
lever des troupes, si les François venoient à assiéger quelque place de ces
provinces en les envahissant avec une grosse armée. Nous prions donc
affectueusement les états de tenir compte de nos sacrifices pour les
secourir, garder et défendre, et de contribuer, de leur côté, par quelque
bonne aide, au payement des troupes qui se joindront aux Anglois, ou à
l'entretien de celles qui seront chargées de la défense des frontières. En
agissant de la sorte, ils se montreront à notre égard bienveillants sujets ;
ils conserveront à perpétuité l'ancienne renommée de leur loyauté envers
leurs princes, et nous n'oublierons jamais ni ce bon service, ni ceux qu'ils
nous ont continuellement rendus[170]. Enfin, après deux mois de résistance, malgré tant de
promesses, de menaces, de prières, les villes brabançonnes arrêtèrent leur
décision le 7 juin, et cette décision fnt adoptée par les deux autres
membres, le 23 du même mois. Mais cet acte était loin de répondre à l'attente
du gouvernement. Au lieu de cent cinquante mille livres accordées d'abord par
les prélats et par les nobles, il n'en était alloué définitivement que la
moitié. La situation devenait donc de plus en plus inquiétante. D'une part,
trois ou quatre mois de solde dus à l'armée devaient être payés à la fin de
juillet, et sans argent une catastrophe paraissait inévitable. D'autre part,
tous les moyens de réunir des fonds semblaient épuisés. Toutes les villes étoient à l'arrière, et il ne leur étoit
possible de fournir à leur portion en la manière accoutumée. Obtenir de
l'argent par emprunt, n'y avoit espoir ; le prendre par assiette capitale,
n'étoit conduisabie. Le Hainaut, la Hollande, la Zélande, le comté de
Namur, le Luxembourg avoient donné plus qu'ils
n'avoient jamais accordé, et il étoit impossible d'en rien tirer d'important.
La Flandre, rendue plus difficile par l'exemple du
Brabant, semblait plus disposée à réduire ses subsides qu'à les
augmenter. La gouvernante avait été secrètement avertie qu'en Flandre on semoit le bruit que si longtemps que les états
donneroient argent pour la guerre, on ne parviendroit à avoir paix ni autre traité.
— Il faut, disaient les mécontents, refuser le payement des troupes ; opposer l'état de
pauvreté aux demandes d'aides. Envoyons des députés à l'empereur pour
l'informer de la situation du pays et pour le requérir de nous procurer la
paix. Usons de nos droits. Si, en 1482, nous avons conclu une paix fendue[171], présentement il ne nous convient d'en faire une trouée.
Marguerite s'inquiétait d'autant plus de ces rumeurs, qu'elle était certaine que si les Brabançons et ceux des autres pays en
oyoient le bruit, sans difficulté ils se joindroient à ceux de Flandres. Au milieu de ces préoccupations et de ces embarras, la régente ne vit qu'une ressource, recourir de nouveau aux états du Brabant. Le jour même où elle signa l'acte d'acceptation de la somme insuffisante accordée par eux, elle prit le parti de les convoquer de nouveau, et de leur demander encore septante-cinq mille livres, qui ne seraient dépensées qu'au besoin, et dont l'emploi serait strictement réservé aux dépenses des mois de juillet, août et septembre. L'opposition éclata dès les premières ouvertures du gouvernement. Les prélats ne voulaient accorder que vingt-cinq mille livres, somme, disaient-ils, qui portait à cent mille livres l'aide précédemment accordée et suffisante pour six mois, à l'avenant de ceux de Flandre. En vain les nobles firent-ils appel au patriotisme du premier ordre, alléguant qu'appelés les premiers à voter, c'était aux prélats de donner l'exemple, que le Brabant avait moins souffert de la guerre que les autres provinces, dont quelques-unes étaient comme entièrement détruites ; que la Flandre spécialement, quoique bien déclinée, avait contribué aux charges générales plus que le Brabant, les abbés restèrent sourds à ces paroles. Marguerite, poussée à bout, défendit aux députés brabançons de se séparer, et les manda au palais pour essayer de son influence personnelle sur les opposants. Cette démarche échoua. La princesse était si mécontente des prélats qu'elle voulait loger ses hommes d'armes dans les maisons des plus durs et difficiles. Elle proposa aussi à Charles-Quint d'en mander un ou deux vers lui, d'en envoyer une partie vers le saint père en quelque légation, un ou deux en Autriche vers l'empereur Ferdinand, de les y laisser jusqu'à ce qu'ils fussent devenus sages, et de ne leur plus accorder ni grâce ni modération dans les aides et tailles[172]. L'opposition n'était pas moins persévérante du côté des villes. Les mois de juillet et d'août s'écoulèrent en stériles tentatives pour obtenir le consentement de Bruxelles et de Bois-le-Duc. On se vit sur le point de devoir licencier une partie des bandes d'ordonnances, au moment même où elles étaient appelées à se joindre aux Anglais. Le seigneur de Mouscron avait bien apporté une somme de quarante-huit mille ducats, à compte des cent mille affectés par l'empereur au contingent destiné à renforcer l'armée anglaise, mais la nécessité avait contraint d'employer à d'autres usages une grande partie de cet argent. Des membres du conseil privé en vinrent à proposer d'adopter l'avis des prélats du Brabant et de mettre en vente le domaine. Marguerite ne goûta pas ce conseil. Selon elle, il n'y avoit rien de clair en Brabant, et partant rien à vendre. Le domaine de Flandre n'étoit pas grand et se prenoit le principal sur impositions indirectes, telles que sur les bières, harengs et autres choses non assurées, autrefois d'un bon rapport, mais sur lesquelles il n'y avoit présentement homme qui osût ou voulût s'avancer de les vendre ou charger. Du reste, ces revenus étaient déjà engagés pour une année, et, la gouvernante, détournant l'empereur de cette extrémité, lui disait non sans raison : Quand vous n'aurez plus de domaine, vous n'aurez plus de seigneurie, ni d'obéissance, ni conséquemment d'aides[173]. Charles-Quint, sans s'irriter et sans se décourager, répondit aux doléances de sa tante qu'il n'ignorait pas que de tout temps il avait été fort difficile d'arracher des aides aux peuples des Pays-Bas, et qu'il comprenait fort bien que les circonstances augmentaient grandement ces difficultés. Néanmoins, ajoutait-il, considéré l'état des affaires en quoi nous sommes, il faut s'efforcer par toutes voyes et moyens, d'induire et de pratiquer nos sujets à se vouloir encore aider avant de se laisser tomber en plus grande ruine et destruction. Donnez leur à connoitre que nous sommes en train, par le moyen d'une forte guerre, de venir à la fin de notre entreprise et que, le plus tût qu'il sera possible, par façon de force ou autrement, désirons les mettre en paix ou trêves[174]. Tant de douceur, d'habileté et de bonnes raisons, il faut bien l'avouer, finirent par triompher. Les villes elles-mêmes acceptèrent les propositions du gouvernement ; seulement elles exigèrent que nul ne fût exempt du payement de cette nouvelle aide, ni clergé, ni maison-Dieu, ni hospices, ni confréries[175]. Mais c'était toujours à recommencer. On était arrivé à se mettre d'accord au mois de septembre. Au mois de novembre suivant, Marguerite rappela les états de Brabant à Lierre, et leur demanda quatre-vingt mille livres pour entretenir, pendant six mois, mille chevaux et autant d'hommes de pied. Les prélats, les nobles, les villes même, consultés séparément, ne se montrèrent pas trop opposés à cette nouvelle demande, mais, dans la réunion générale des trois corps d'état, de nouvelles difficultés surgirent. Les prélats réclamaient, pour les religieux, le droit de succéder, comme autres personnes, à leurs parents, et d'acquérir toutes manières de biens ; ils exigeaient de plus le prélèvement sur l'aide d'une somme de trois mille livres pour payer la pension allouée à Érard de la Marck sur l'abbaye de Saint-Michel, à Anvers[176]. L'abbé de Parc, Ambroise Van Engelen, déclara nettement que si l'on n'accordait ces trois mille livres à son collègue de Saint-Michel, il se retirerait de l'assemblée et n'y viendrait plus ; que l'empereur avait alloué cette pension et que la raison voulait qu'il en eût la charge. La ville d'Anvers, de son côté, souleva de nouvelles réclamations, et les trois membres reculèrent le payement de la somme votée jusqu'à la Saint-Jean (24 juin) de l'année 1524. Marguerite, voyant que par remontrances il n'y avoit rien à gagner, et que, pour pourvoir au payement des gens de guerre jusqu'à la Saint-Jean Baptiste, elle n'avoit de quoi, prorogea l'assemblée jusqu'au 9 janvier. Pour cette nouvelle réunion elle convoqua à Bruxelles tous les prélats du duché et les nobles qui étoient de quelque estime ; elle enjoignit aux villes, où s'était introduit l'usage de députer seulement un pensionnaire, d'envoyer quatre ou dix des principaux et des plus suffisants d'icelles. Il leur fut remontré bien au long de la situation des affaires de l'empereur ; les grâces qu'il avait convenu accorder aux prélats et aux villes, et qui avoient réduit la dernière aide à cinquante quatre ou cinquante six mille livres ; les arrérages dus aux gens de guerre, le danger qu'il y auroit à ne pas les promptement payer, et autres choses, sous espoir que entre tant de gens de bien y en auroit aucuns de sain entendement qui, pour l'honneur de leur prince, pour l'amour de leur pays, et pour leur propre sûreté, accorderoient les moyens de pourvoir aux frontières, afin de prévenir les plus grands malheurs et d'amener les choses à bonne conclusion. La nécessité était évidente, elle parlait plus haut que tous les discours. Après plusieurs remontrances, communications et difficultés, les députés, qui s'étoient rendus en bon nombre à l'assemblée, accordèrent, le 23 janvier 1524, les quatre-vingt mille livres demandées[177]. Quel que fût le dévouement de la noblesse à l'empereur,
elle ne laissait pas, elle aussi, d'avoir ses griefs et ses mécontentements.
Marguerite, d'allure un peu hautaine, supportait difficilement la
contradiction. Elle s'était arrogée l'entière direction des affaires, et
c'était à peine si elle consultait le conseil privé, dont elle traitait les
membres, semble-t-il, assez cavalièrement. Le comte de Buren, les seigneurs
de Ravenstein, de Beveren et du Rœulx se plaignirent à l'empereur que la
gouvernante ne leur communiquât qu'une partie des affaires, et que, quand ils
se présentaient chez elle, elle les obligeât de faire antichambre, ce qui, disaient-ils, leur
donnoit peu d'envie de s'y représenter. Charles-Quint, toujours
patient et circonspect, répondit qu'il ne pouvait croire que sa tante en usât
de telle sorte, mais des instructions particulières, remises au seigneur de
Mouscron, recommandèrent à Marguerite d'appeler au
conseil les seigneurs des Pays-Bas, de leur communiquer toutes les affaires,
et de ne rien traiter à leur insu[178]. Au reste, les
griefs étaient réciproques. Les nobles opposaient assez souvent à Marguerite
des résistances, accompagnées de défauts de formes, qui irritaient vivement
son âme fière et un peu absolue. Ainsi, dans le Luxembourg, le marquis
Philippe de Bade ne tenait nul compte de ses ordres ni de ceux de l'empereur.
Le marquis Philippe, écrivait-elle à son
neveu[179],
a juré de garder votre hauteur et vos droits, et il
est le premier qui les veut usurper. Je sais,
disait-elle à l'empereur dans une autre circonstance[180], qu'on ne peut lui enlever ce gouvernement, puisque
l'argent manque pour payer sa créance ; mais si l'on n'y porte prompt remède,
vous perdrez dans ce duché toute autorité et toute juridiction. A
l'occasion de quelques difficultés survenues entre les agents du gouvernement
et les sires de Ravenstein et Jean de Berghes touchant des conflits
d'autorité, ces deux seigneurs manifestèrent le plus bruyant mécontentement ;
ils firent agir les chevaliers de la Toison d'or et les membres du conseil
privé. Tant de bouche que par requête, ils
déclarèrent à la régente qu'elle leur avoit causé grand tort, injure et honte
; qu'elle avoit grandement touché à leur honneur ; que les prédécesseurs de
l'empereur et leurs officiers, qui étoient aussi sages, vertueux et capables
que les siens, les avoient toujours laissés en jouissance du droit d'octroyer
rémission ou autres grâces en leurs terres de Wynendaele et de Beveren. Après
plusieurs autres et semblables paroles, et telles et de la sorte que gens
courroucés savent et ont accoutumé dire, de bouche et par requête écrite, ils
requirent réintégration et réparation. Toutes les remontrances de
Marguerite, jointes à celle du cardinal de Liège, Érard de la Marck, échouèrent
contre leur obstination. Ils persistèrent dans leurs
propos tant et de telle sorte que, de l'avis du cardinal, du conseil privé et
du collège des finances, et considérant le temps et les affaires, la régente
fut obligée de suspendre l'effet des mesures prises par le gouvernement, sous
le bon plaisir de l'empereur et jusqu'à ce qu'il en eût décidé. Ce
succès ne suffit même pas aux nobles réclamants. Le dispositif de l'acte
portait que voulant de la part de l'empereur, user
de bénignité envers les impétrants, par l'entreparler de monseigneur le
cardinal et de l'avis du conseil, madite dame avait consenti à la chose
; ils repoussèrent cette rédaction. Les mots user
de bénignité remportent ou sentent rémission, dirent-ils, et nous n'avons pas méfait, mais usé de notre droit.
Ils ne voulurent pas non plus des mots de l'avis du conseil, et pour prévenir
de nouvelles difficultés, il fallut céder sur tous les points[181]. Ces embarras intérieurs ont détourné nos regards des affaires de la guerre, qui n'eurent pas grande importance d'ailleurs dans les derniers mois de 1523. Nous n'avons guère à signaler qu'un coup de main tenté avec succès par les Français sur Avesnes, à la fin de cette année. Dans la nuit du 13 décembre, quatre à cinq cents hommes, profitant de la négligence de la garnison et secondés par des traitres, dont quelques uns furent pendus plus tard, surprirent les postes avancés, égorgèrent les soldats qui les occupaient, pénétrèrent dans la ville et la livrèrent au pillage. Il n'y eut de résistance que devant une tour, où s'était retranché, avec quelques bourgeois, un homme d'armes de la bande d'ordonnances du marquis d'Arschot. Ce brave, appelé de Maigret, repoussa toutes les attaques qui lui furent livrées et garda sa position. L'événement mit l'émoi dans le pays, et l'on courut aux armes de tous côtés. Les nobles du Hainaut, assemblés en ce moment à Mons, regagnèrent à la hâte leurs châteaux et les places de leur commandement. Le marquis d'Arschot, sans tarder un moment, marcha sur Avesnes avec toutes les troupes qui lui tombèrent sous la main. Les Français n'eurent rien de plus pressé que d'abandonner leur conquête à l'approche des Impériaux. Serrés de près, ils abandonnèrent dans leur fuite fardeaux, bêtes et bagages[182]. Dans le nord, la trêve conclue en 1517 avait laissé le champ ouvert aux négociations. A la fin de 1517, Marguerite avait déterminé Érard de la Marck à servir d'intermédiaire à un arrangement définitif. Ce prince s'employa à cette œuvre avec zèle ; il engagea le gouvernement des Pays-Bas à se montrer conciliant et à faire des concessions à Charles d'Egmont. Le conseil privé accueillit ses avis, et un projet de traité fut arrêté, après de longs débats, entre les deux parties. Malheureusement Charles-Quint, en l'approuvant le 1er septembre 1519, y apporta des modifications qui détruisirent l'œuvre des négociateurs. On se borna à renouveler la trêve, qui n'avait jamais été bien observée et qui ne le fut pas davantage par la suite. Des deux parts, on semblait d'accord pour fermer les yeux sur les entreprises de quelques capitaines qui continuaient à guerroyer. Les partisans de Charles d'Egmont s'entendirent telle-nient, grâce à cette impunité, qu'une bande de Gueldrois et de Frisons, étant parvenue à surprendre Nieuport et Schoonhoven, pilla ces deux villes et y mit le feu. Cette fois pourtant le châtiment fut prompt et terrible. Atteints dans leur retraite, les bandits essuyèrent un sanglant échec, et ceux d'entre eux qui tombèrent aux mains des assaillants, sans distinction de gentilshommes ou de roturiers, périrent ignominieusement sur la roue[183]. Les eaux des marais formés par l'extraction de la tourbe avaient transformé en rivière un ruisseau nommée l'Eau noire, qui traversait la ville de Zwolle et se jetait dans la Zuiderzée. Les navires de commerce prirent aussitôt cette nouvelle voie pour éviter le bureau de péage établi à Campen. Campen invoqua son droit acquis des évêques d'Utrecht sur le péage des eaux de l'Eau noire, mais Zwolle repoussa cette prétention, et de leurs discussions sortit la guerre. L'autorité de l'évêque fut méconnue, la médiation de Marguerite écartée, et Zwolle réclama l'appui du duc de Gueldre, qui s'empressa de le donner. Les Gueldrois occupèrent bientôt la plupart des villes voisines, et leurs corsaires recommencèrent leurs courses sur le Zuiderzee. L'évêque d'Utrecht, Philippe de Bourgogne, ne parvint pas à arrêter leurs progrès, et les villes de l'Overyssel maintinrent à Charles d'Egmont la possession des places dont il s'était emparé. Le gouvernement des Pays-Bas, ainsi mis en demeure, ne perdit pas un instant. Il envoya des renforts en Frise, augmenta les fortifications des villes-frontières et enjoignit aux villes maritimes de la Hollande de pourvoir à leur défense. L'empereur somma le duc de Gueldre de se présenter à Worms où il était en ce moment, et où les députés frisons étaient venus le trouver. Charles d'Egmont n'ayant point comparu, il enjoignit aux capitaines gueldrois d'évacuer les villes de la Frise. Marguerite accordait en même temps à Philippe de Bourgogne un subside de dix-neuf mille livres, défendait toutes relations de commerce avec la Gueldre et l'Overyssel, et interdisait même le cours de leurs monnaies. Le gouverneur de la Frise, Guillaume de Rogendorff, accablé d'embarras et abreuvé de dégoûts, venait d'obtenir sa démission sollicitée depuis longtemps[184] et était parti pour l'Allemagne[185], où il allait s'illustrer dans la guerre contre les Turcs[186]. Il avait été remplacé (1524) par le drossard de Vollenhove, Georges Schenck, baron de Fautenbourg, capitaine d'une aventureuse audace. C'était, au jugement de Rogendorff, l'homme qui pourroit mieux servir que nul autre en ce quartier. Schenck, justifiant cet éloge, se mit aussitôt en campagne, et, renforcé par la gendarmerie de l'évêque d'Utrecht, porta une guerre désastreuse dans l'Overyssel, les cantons insurgés de la Frise et la seigneurie de Groningue. Ses succès réveillèrent partout la confiance et le courage ; les Hollandais détruisirent une flottille de corsaires, et Charles d'Egmont n'essaya pas même de secourir les contrées qu'il avait soulevées. En ce moment, il avait les yeux tournés, vers la France. Ce fut seulement à la fin de la campagne de 1521 que, prenant à sa solde un corps nombreux de lansquenets licenciés du service de François Ier, il recommença à son tour les hostilités. La Frise et l'Overyssel éprouvèrent alors toutes les horreurs d'une guerre d'extermination. Les villes furent prises, reprises, pillées, saccagées, livrées aux flammes ; et les campagnes laissées en friche, dévorées par la famine, abandonnées à la soldatesque, n'étaient défendues par personne. Ainsi les reitres de Philippe de Bourgogne, mutinés dans les derniers jours de janvier 1522, incendièrent le Kuinderdyk, et les Gueldrois achevèrent l'œuvre de destruction, sous prétexte que les habitants avaient favorisé les Impériaux. De nouveaux subsides de Marguerite[187] ayant ramené au devoir la gendarmerie d'Utrecht, elle traversa la Drenthe comme une trombe, et vint s'établir aux portes de Groningue, semant au loin la ruine et la désolation. A l'approche du comte de Meurs, lieutenant de Charles d'Egmont, qui accourait au secours de Groningue, elle se retira vers le Dollart, mais fut coupée dans sa retraite et dispersée. Malgré cet échec, Schenck parvint à dompter une partie de l'Overyssel et de la Frise. Une forte division, jetée dans cette dernière province par Charles d'Egmont, fut taillée en pièces. Blessé dans le combat d'une arquebusade au bras, Schenck n'en poursuivit pas moins ses succès. Une diversion, tentée le 17 mars 1522, dans l'Overyssel par le comte de Meurs échoua complètement. Sneek, la plus importante des places occupées par les Gueldrois, ouvrit ses portes aux Impériaux ; Schenck débarqué à la tête de quinze cents hommes près de Hasselt, emporta les forts de Korfhuisen et investit Guelmuyden. Charles d'Egmont, à la vue de la ruine imminente de son parti dans l'Overyssel, accourut alors en personne et fit rançonner le Texel et Pile de Wieringen par ses corsaires. Schenck, obligé de se retirer devant des forces supérieures, s'embarqua à Hoorn, et surprit Stavoren au moment ou l'hiver de 1522 à 1523, sans suspendre les hostilités, venait arrêter toutes les opérations importantes. Au commencement de 1523, une intrigue faillit enlever Schenck à son gouvernement ; il fut appelé à Bruxelles avec quelques membres du conseil de Frise, pour répondre à de graves imputations mises à sa charge par des nobles ralliés à la maison d'Autriche. Mais d'accusé il se fit accusateur, et avec tant de raison qu'un de ses principaux ennemis, Jancke Douwena, fut incarcéré au château de Vilvorde, où il mourut en 1530[188]. L'absence de Schenck avait suffi pour ranimer le courage des Gueldrois et de leurs partisans ; ils agirent avec tant de vigueur que le comte d'Hoogstraeten fut obligé par les états de Hollande de négocier un armistice. A la faveur de cet armistice, les Gueldrois surprirent Steenwyk, dans l'Overyssel, et élevèrent un fort à Workum, où un parti d'Impériaux était venu incendier quelques vaisseaux. La guerre restreinte jusqu'alors à la Frise et à l'Overyssel, allait prendre plus d'extension. Déjà, au mois d'avril 1522, des maraudeurs gueldrois étaient venus brûler Orthen, près de Bois-le-Duc ; le 25 décembre suivant, quatre bouchers d'Anvers avaient été enlevés dans les environs d'Hérenthals, et peu de jours après des marchands de Hollande et de Bois-le-Duc avaient été arrêtés près de Gorcum et conduits en Gueldre. Les magistrats d'Anvers se plaignirent au duc de Gueldre de ces actes hostiles, en invoquant l'assurance de commerce existant entre les deux pays. Je ne sais ce que c'est, répondit le duc, je m'en enquerrai et y ferai ce que bonnement il conviendra. Il ajouta qu'il était au courant de l'assistance donnée par les Anversois aux Hollandais contre ceux de Zwolle, de Frise et des villes qu'il avait au pays d'Utrecht. Mieux vaudroit, dit-il en terminant, une guerre ouverte que telles simulées communications ou conversations, dans lesquelles les sujets des deux partis se trouvent surpris et détruits. Les Anversois réclamèrent vivement du gouvernement des lettres de marque ou d'arrêt contre les Gueldrois, mais Marguerite, par conseil et doute de cheoir en guerre, en laquelle, à son avis, encore qu'on ne voulût, on viendroit bientôt, refusa d'user de représailles[189]. Quant aux prisonniers, ils ne recouvrèrent la liberté qu'au prix d'excessives rançons. Cependant, à la nouvelle de la prise de Steenwyk, la princesse s'était empressée de renvoyer Georges Schenck en Frise. Il fut successivement rejoint par mille hommes de pied du Brabant, par Jean de Wassenaar et par le seigneur de Castre, qui lui amenèrent, l'un neuf cents fantassins, l'autre des gens d'armes des ordonnances. Ces braves capitaines ramenèrent la fortune sous les drapeaux de Charles-Quint. Le 15 janvier 1522, Schenck aborda devant Workum, et, à la suite de combats acharnés, s'empara de cette place. Blessé dans une rencontre, dès qu'il put reprendre les armes, il investit Bolsward, qui ne tarda pas à lui ouvrir ses portes. Alors les trois capitaines impériaux portèrent la guerre dans les quartiers encore insoumis de la Frise. Ils forcèrent les habitants à prêter serment de fidélité, et se jetèrent ensuite sur la seigneurie de Groningue, dont ils ravagèrent et rançonnèrent les campagnes. Dokkum succomba au mois de septembre, et entraîna la soumission de la Frise entière. Après une vaillante résistance, l'importante forteresse de Sloten se rendit à Wassenaar, qui y fut blessé d'un coup de mousquet et mourut à Leeuwarden, le 4 décembre, payant ainsi sa conquête de sa vie. Dans le même temps, Steenwyk fut abandonné par sa garnison. Schenck y bâtit un fort, qui coupa les communications de l'Overyssel avec la Gueldre. Les Frisons se soumirent enfin à la nécessité. Dans une réunion des états tenue à Stavoren, ils résolurent de reconnaître les comtes de Hollande comme seigneurs du pays, sous la vassalité de l'empire. Au mois de juin 1524, Josse, seigneur de Cruninghen, et le conseiller Gérard Mulart procédèrent à la réception de cette seigneurie, et les privilèges que Charles-Quint lui accorda, le 25 novembre suivant, achevèrent la pacification de cette contrée. A partir de cette date, la Frise resta intimement unie à la Hollande, dont elle partagea les destinées[190]. L'empereur récompensa dignement les éminents services de Georges Schenck ; il voulut être le parrain de son fils, et lui envoya à cette occasion une coupe de vermeil[191]. La soumission de la Frise n'arrêta point les hostilités du duc de Gueldre. Redoublant de vigueur au contraire, il porta le ravage dans la Hollande, en dépit des renforts qu'avaient reçus les garnisons du comté. Ses bandes pénétrèrent ensuite dans le pays d'Outre-Meuse, brûlèrent Moppertingen, Vlytinghe, Rosmeer ; tinrent un moment Maëstricht bloqué et faillirent surprendre Bois-le-Duc. Le 2 avril 1524, le capitaine de Thiel vint prendre position à Othent, il commençait à répandre dans la contrée le pillage et l'incendie, quand le comte de Buren accourut avec cent lances des ordonnances et quelques piétons.. Tombant à l'improviste sur les Gueldrois, il leur tua beaucoup de monde. Renforcé par de nouvelles troupes, Buren entra alors dans le Bommelerweerd, où les Brabançons exercèrent de terribles représailles. Le moment était venu d'en finir avec un indomptable adversaire. Pour cela, il fallait de nouveaux sacrifices d'argent, et Marguerite convoqua les états de Hollande et de Brabant, que l'intérêt de leur propre sûreté semblait devoir incliner à la générosité. L'aide demandée ne fut cependant pas accordée sans difficultés et sans quelques restrictions. La gouvernante s'en contenta et mit de nouvelles forces sur pied. Un dernier vote des états de Brabant, de Hollande et de Zélande annonçait la résolution d'agir avec vigueur jusqu'au bout. Charles d'Egmont comprit alors le danger où il se trouvait, et demanda le renouvellement de la Crève de 1517. Le gouvernement des Pays-Bas, heureux. de pouvoir employer ailleurs des forces dont on avait grand besoin alors, se rallia sans difficultés à cette proposition. Une nouvelle trêve d'un an fut conclue à Heusden, le 14 juin 1524, et, selon l'usage, on convint aussi d'ouvrir des conférences, le 1er septembre suivant, pour la discussion d'un traité de paix définitif[192]. La soumission de la Frise et la trêve de Heusden causèrent une vive joie dans nos provinces. Le pays était rudement éprouvé depuis quelque temps. Des maladies contagieuses et un hiver fatal aux récoltes avaient ajouté aux souffrances des populations. Celles-ci étaient sans cesse sous le poids de nouvelles demandes d'argent ; les aides successivement accordées étaient le plus souvent absorbées d'avance pour une bonne part. C'étaient donc toujours de nouvelles exigences d'un côté, de nouvelles résistances de l'autre, et une lutte incessante interrompue seulement par des concessions arrachées péniblement à la pénurie des provinces et avec lesquelles on ne pouvait parvenir à combler un gouffre toujours béant. Le principal foyer de l'opposition était dans le Brabant, et particulièrement au sein des villes et de l'ordre ecclésiastique. Bruxelles, Louvain, Malines même, malgré son attachement à la gouvernante qui y résidait, résistaient et se laissaient aller à un mécontentement non dissimulé, L'agitation était grande en Flandre aussi, quoique le comte de Grave y exerçât une salutaire influence sur les états. Ceux-ci attribuaient aux dilapidations des ministres les demandes réitérées d'argent qui leur étaient faites depuis le départ de Charles-Quint ; ils s'étaient réservé la question des produits de leurs aides et en disposaient sans l'intervention de la régente. Dans le Luxembourg et dans le Limbourg c'était pis encore. En 1524, le gouvernement avait demandé au premier de ces duchés une aide de quatorze à quinze mille florins, et les états l'avaient accordée, en stipulant que la ville de Luxembourg y participerait malgré l'opposition de ses députés. Les bourgeois de Luxembourg, se prétendant exempts d'aides, refusèrent de se soumettre à cette condition et repoussèrent à main armée les collecteurs de l'impôt. Marguerite écrivit sur le champ au marquis de Bade de chatier les plus coupables de cette désobéissance, mais celui-ci, toujours en assez mauvais termes avec la princesse, ne tint aucun compte de cet ordre. Dans le Limbourg, les habitants chassèrent aussi les collecteurs, et établirent des veilleurs dans les clochers des églises, de sorte qu'à l'apparition des agents du fisc le tocsin retentissait dans les villages. Il fallut recourir à la force pour faire justice de cette résistance et assurer la levée de l'aide[193]. Une pareille situation était intolérable[194]. La question du domaine revint alors sur le tapis. Les états du Brabant, de la Flandre et de la Hollande, chacun d'eux à part en leurs conclaves assemblés, remontrèrent à Marguerite l'impossibilité, pour la plupart des villes, de continuer leurs sacrifices : le povre peuple, disaient-ils, étoit si travaillé des aides et des gens de guerre, tant amis qu'ennemis, qu'il ne pouvoit plus rien fournir. Ils insistèrent donc sur la nécessité d'hypothéquer le domaine pour suppléer à la pénurie du trésor. La régente s'opposa énergiquement à cette proposition. C'étoit, disait-elle, aliéner les meilleures des parties de ce domaine, et le souverain, n'en conservant que les produits les plus odieux — les tonlieux, les droits sur les harengs, la cervoise, etc. —, s'exposeroit à perdre l'affection des sujets, son honneur, sa réputation et l'estime de ses Pays-Bas, qui avoient toujours été de si grande renommée. Ses efforts parvinrent à écarter cette dangereuse motion, et à force de remontrances appuyées par l'actif concours de bons serviteurs, elle finit par obtenir une grande partie des aides sollicitées. Une autre source de calamités s'était rouverte pour les Pays-Bas durant ces années d'épreuves. Christiern Il, fuyant devant l'orage soulevé par sa déplorable administration, s'était embarqué, le 14 avril 1523, avec sa femme, ses enfants, ses trésors, et était venu, le 1er mai, avec quatorze vaisseaux, débarquer à la Vère, après avoir perdu, dans la traversée, le navire chargé des dépouilles de la couronne de Danemark. On n'avait oublié, dans nos provinces, ni ses violences ni ses vexations, et loin d'y obtenir des secours, il se vit refuser une anticipation sur le restant de la dot de sa femme. Isabelle elle-même intercéda vainement en faveur de son indigne époux ; son frère et sa tante restèrent inflexibles. Après avoir fait un voyage en Angleterre pour y mendier des secours, et où il n'obtint que de vagues promesses, Christiern revint dans les Pays. Bas, où il apprit que ses ennemis avaient mis le siège devant Copenhague. Laissant alors ses enfants à Malines[195], il partit pour l'Allemagne, où l'assistance de quelques princes lui permit de lever une petite armée. Après de vaines tentatives pour délivrer Copenhague et d'infructueuses démarches d'isabelle pour emprunter l'argent nécessaire au payement de cette armée, qui ne lui obéissait plus et voulait mettre la main sur lui, il revint de nouveau dans les Pays-Bas, où l'on n'étoit non plus argenteux, ni sans grandes charges pour les guerres de France, de Gueldre et de Frise. Sa présence parmi nous devint bientôt une source d'embarras et de dommages pour le pays. Malgré les assurances pacifiques de Marguerite, une ligue fut négociée entre les villes de la Hanse, Frédéric de Holstein, le roi de Pologne, les ducs de Poméranie, de Lunebourg, de Juliers, de Clèves et l'évêque de Munster, qui firent fermer la navigation des mers du nord au commerce des Pays-Bas. Usant de représailles, les Hollandais saisirent, dans leurs ports, les biens des Hanséates, et la guerre fut sur le point d'éclater. Il fallut toute l'habileté de l'empereur et de Marguerite pour conjurer les hostilités. Les Hollandais, arrêtés dans leur commerce et privés des grains de la Baltique, se montrèrent bientôt plus conciliants. Mais beaucoup de bâtiments lubeckois, capturés par des corsaires, avaient été conduits soit à Anvers, soit dans les ports de la Zélande ; et quand le sénat de Lubeck demanda, pour première condition d'un arrangement, la restitution de ces navires, les Brabançons et les Zélandais refusèrent d'abandonner leurs prises et de prendre part aux négociations. Heureusement Marguerite prit sur elle la promesse de les contraindre à observer les conventions qui seraient arrêtées, et, sur cette assurance, une trêve fut conclue à la fin de 1524. Malgré les ordres de la régente, les villes maritimes du Brabant et de la Zélande refusèrent longtemps d'accepter cette convention, qui fut ratifiée par elles seulement au mois d'août 1526. Marguerite était vivement inquiète de la présence d'un hôte si turbulent et si dangereux : elle voulut l'interner dans une ville où elle n'aurait à redouter ni ses manœuvres politiques, ni son prosélytisme au profit des doctrines luthériennes, dont il était imbu et dont Isabelle elle-même s'était laissé infecter. Le 18 octobre 1524, elle écrivit à Charles-Quint que le roi de Danemark, alors aux eaux d'Aix-la-Chapelle, avait manifesté l'intention de s'établir à Gand. La gouvernante, avec beaucoup de gens sages, désapprouvait cette idée, et elle conseilla à l'empereur de lui assigner pour résidence le château de Genappe. Elle se plaignait fort de la lourde charge qu'imposaient au pays le luxe de Christiern et d'Isabelle ainsi que l'inconduite de leurs gens. On avait alloué à ces princes cinquante livres par mois pour leur entretien, outre deux mille livres par an pour les menus plaisirs de la reine[196], et ils en dépensaient plus de huit cents par mois ; Marguerite leur avait dépêché son maître d'hôtel, Philippe de Sonastre, pour mettre quelque ordre dans leur maison, et la chose avait été impossible. Charles-Quint craignit de voir détruire sa chasse de Genappe, et manifesta sa préférence pour Lille ou Bruges ; il fit augmenter la pension du roi en regard que la reine estoit sa sœur. Le conseil privé trouva que les villes indiquées par le roi présentaient aussi des inconvénients, et résolut de loger Christiern et sa famille à Lierre[197]. Cette décision irrita un hôte aussi irascible qu'incommode, et il ne s'y soumit qu'après de violentes récriminations (1525). Les succès inouïs de l'empereur en Italie vinrent faire une heureuse diversion en Belgique, et rendirent au gouvernement la force et le prestige qui ne commençaient que trop à lui manquer. Les Belges ont une part glorieuse à revendiquer dans ces succès et particulièrement dans la glorieuse victoire de Pavie. Après Charles de Lannoy, qui reçut l'épée du roi captif, on vit figurer avec éclat, dans cette journée et dans les combats qui précédèrent, le seigneur de Boussu, le comte d'Egmont qui reçut, le 17 février, un coup de couleuvrine au visage ; le comte de Salin, qui blessa le cheval du roi ; le seigneur de la Vère, qui commandait la réserve du vice-roi de Naples ; un autre de la Vère et Jacques de Croix, seigneur de la Havarie, qui furent tués à Pavie ; le seigneur de Bellaingr, Jacques de Sucere, que Montluc appelle un grand capitaine ; son frère, Philibert de Sucere, qui devint gouverneur de Milan ; les capitaines Locquenghien et Escalignes qui, peu de jours avant la bataille, avaient vaillamment ravitaillé Pavie[198] ; Etienne de Grospin, capitaine des chevau-légers, que Lannoy envoya à Marguerite pour faire le récit de la bataille[199]. Parmi les prisonniers français se trouvait Fleuranges, dont nous connaissons la haine indomptable, égale à celle de son père, pour la maison d'Autriche. Lannoy l'envoya sur le champ à Marguerite pour se rendre prisonnier sur parole où elle l'ordonneroit. L'empereur prescrivit de le bien garder afin qu'il ne se meslât pas d'autres pratiques. Fleuranges fut remis à la garde spéciale du sire de Beauffremy, Charles de Saint-Pol, lieutenant du capitaine du château de l'Écluse, où fut construite une cage de bois, forte et bien ferrée, pour cou-chier de nuit icelluy seigneur de Fleuranges, pour estre tant plus asseuré de sa personne (3)[200]. C'est là, paraît-il, que le célèbre adventureux écrivit ses mémoires. La première nouvelle de la victoire de Pavie avait été apportée à Marguerite, le 6 mars, par un serviteur du duc de Milan. Le 13, arriva l'écuyer Étienne de Grospin, porteur de lettres de Charles de Lannoy et du duc de Bourbon. La princesse s'empressa de faire célébrer ce grand évènement par des Te Deum, des feux de joie, des processions et autres marques de l'allégresse publique ; les morts ne furent pas oubliés, des services funèbres furent ordonnés à leur intention. Le succès était si considérable, si inouï, que beaucoup de personnes eurent d'abord de la peine à y croire, et il fallut charger les gouverneurs de publier des circulaires confirmant, avec des détails, les premiers récits de la bataille. Pendant que l'Italie devenait de plus en plus le théâtre principal de la lutte, la guerre avait continué, avec des chances diverses, aux frontières des Pays-Bas. Prévenue que le duc de Guise préparait une entreprise sur le Luxembourg, Marguerite avait ordonné, le 15 février 1525, aux officiers de ce duché et à ceux du comté de Namur d'estre pretz au son de la cloche au reboutement des ennemis franchois. L'avis était donné à point. Le duc, en effet, après avoir cherché à détourner l'attention des Impériaux par le bruit de prochaines tentatives sur Florennes et Walcourt, passa brusquement la Meuse et entra dans le Luxembourg, à la tête de deux cents chevaux et de deux mille hommes de pied. Mais il s'aperçut bien vite que les Impériaux étaient sur leurs gardes, et, à l'approche de Guillaume de Nassau qui accourait à sa rencontre, il se retira sur Beaulieu. Mais, dans la prévision d'un retour offensif, le marquis de Bade demanda à l'évêque de Trèves des canonniers pour renforcer l'artillerie des villes les plus exposées, et dirigea toute sa gendarmerie sur la frontière. L'évènement ne tarda pas à justifier ces précautions. Par une marche rapide, le duc de Guise parut inopinément devant Virton ; il avait été rejoint par une bande d'aventuriers connue sous le nom de Blancs-Bonnets, et il assaillit sur le champ la place qu'il comptait aisément vuider, gagnier et robier. Il n'y réussit pas, et opéra sa retraite le même jour. On eut bientôt l'explication de ces marches et contremarches du duc de Guise, opérées uniquement pour détourner l'attention d'une entreprise beaucoup plus grave. La régente de France, Louise de Savoie, avait pris à son service les lansquenets levés par Charles d'Egmont, et les courses du duc de Guise tendaient uniquement à favoriser le passage de ces étrangers en France. Peu de jours après la tentative infructueuse du duc sur Virton, des émissaires accoururent vers le marquis de Bade, lui annonçant qu'une forte division de soldats allemands venant de la Gueldre, par la chaussée de Tongres, avait passé la Meuse au dessus de Liège, et se dirigeait vers le Luxembourg. Le marquis porta immédiatement de ce côté une partie de ses forces, et les Français profitèrent de la diversion pour se jeter sur Charancy, où ils n'essayèrent cependant pas de se maintenir. Pendant ce temps, les lansquenets, faisant volte-face et redescendant à droite, repassèrent la Meuse et entrèrent par la chaussée au pays de Brabant, et de là en la comté de Namur. Ils estoient en nombre de huit mille hommes, gens de fait, bien en point. Marguerite, informée par Thierri de Brandebourg, seigneur de Château Thierry sur Meuse, et lieutenant de Jean de Berghes, qu'ils tiroient sur la chaussée vers Namur pour passer la rivière de Sambre, et, ne les croyant sans doute pas aussi nombreux, ordonna de ruer jus, tuer ou faire pendre les Allemands qui estoient sur le pays faisans grands desroys et dommages. C'était plus facile à dire qu'à faire. Thierri de Brandebourg prit une mesure plus efficace, et envoya au pays de Hainaut à messieurs les marquis d'Aerschot et seigneurs de Barbançon et de Trazegnies les avertir afin d'èstre pretz et semoncer leurs sujets. Les Allemands cependant poursuivirent leur marche. Le jour de Pâques fleuries, ils passèrent la Sambre au pont d'Auvelois, et s'établirent à l'abbaye de Broigne (Saint-Gérard). Ils y séjournèrent quelques jours, faisans force desroys, mengeans et buvans tous les biens de l'abbaye et du village, emportans avec les reliques et joyaulx de l'église, vingt chevaux et autres grands biens, que depuis rendirent, non le tout. Ils errèrent ensuite quelque temps puis chà, puis là, et tellement qu'ils vinrent au quartier de Florennes, repassèrent la rivière à Auvelois et s'en furent embuschier en un petit bois, auprès de Corroy[201]. Alors Thierri de Brandebourg fit sonner la cloche, et cuidant trouver aux champs le comte de Buren, le marquis d'Aerschot et autres gens de guerre, il mena le plus grant nombre de Namurois qu'il put trouver, tant de pied que de cheval, avec artillerie. Iceux Namurois — ils étaient sept à huit cents avec quatre canons — suivirent lesdits Allemands, qui estoient en grand nombre de huit mille, bien équipés et gens de guerre, en intention de leur deflendre le passge. Les Namurois firent tirer artillerie après eux, mais les Allemans se retournèrent sur eux tellement qu'ils en ruèrent jus et mirent à mort un bien grand nombre. Y eut des morts cinq cens et soixante sept ; les autres prirent la fuite, ôtant leurs chaussures pour courir plus vite. Cette circonstance fit donner au combat de Corroy le nom de journée des savates[202]. Échappé au désastre, Thierri de Brandebourg envoya hastement vers le marquis d'Aerschot, le seigneur de Barbançon, le seigneur de Trazegnies et autres les pressant de se joindre aux Namurois, afin d'empescher le chemin desdits Allemans. En attendant, il recommanda aux officiers des villes et des châteaux du comté de tenir leurs places bien closes, sans négliger l'occasion d'inquiéter l'ennemi, dont il importait de retarder la marche jusqu'à l'arrivée des renforts. Bientôt serrés de près par Buren, menacés par les bandes d'ordonnances d'Arschot et d'Aimeries, qui accouraient du Hainaut, les Allemands craignirent d'être enveloppés, et, précipitant leur marche, gagnèrent la Lorraine. Mais, dans l'intervalle, la situation générale avait changé, et le gouvernement français en désarroi refusa de prendre ces étrangers à son service. Les Allemands alors déchargèrent leur fureur sur la malheureuse Lorraine qu'ils occupaient. Beaucoup de leurs maraudeurs rentrèrent en Belgique et s'y joignirent aux brigands nombreux qui infestaient nos campagnes[203] ; ils finirent par en partager les rigoureux et justes châtiments. Marguerite eût voulu profiter de la captivité de François Ier pour conquérir sur les François avec une armée de ce quartier, et elle requit gracieusement les états de Brabant d'accorder à cette fin quelque bonne somme d'argent, outre l'accoustumée. Les états de Brabant refusèrent tout net, et elle comprit dès lors que c'étoit peine perdue que de le proposer en Flandres et ailleurs. Du reste, elle savait si bien elle-même que le pays n'était pas en position de songer à des conquêtes qu'elle écrivait à l'empereur[204], le 12 avril : Je vous prie de croire que vos sujets sont las de la guerre, et toutes les villes sont si obérées, par suite des grosses aides et des rentes créées pour les payer, que malgré tout le bon vouloir de leurs gouverneurs, elles ne pourront plus rien fournir ni pour la guerre ni pour votre service. Charles-Quint, trop sage pour pousser les choses à l'extrême, prescrivit à sa tante de ménager un accommodement qui permit de suspendre les hostilités. La régente de France, instruite de ces bonnes dispositions, s'empressa d'envoyer à Bruxelles son secrétaire, Pierre de Warti, et l'on convint de conclure une trêve pour s'entendre sur la rançon du roi captif et les autres conditions de la paix. Par suite de cette convention, des conférences s'ouvrirent à Breda, et, en attendant l'issue, un armistice suspendit les hostilités. Le 14 juillet 1525, pour éviter les rigueurs de la guerre et les exécrables et inestimables maléfices qui, durant et sous couleur d'icelle, se commettoient, une vraie, sincère et entière abstinence de guerre et dépôt d'armes, par terre, par eau douce et par mer fut conclue entre les Pays-Bas et la France. Cette trêve prenait cours le 26 juillet pour finir le 31 décembre suivant, et, durant ce temps, il était permis aux deux pays de vaquer à leurs négoces et affaires. Il fut stipulé que sûreté et protection au besoin seraient assurées à la pêche du hareng, et la mer fut déclarée libre pour le transport de toutes espèces de marchandises, excepté les munitions de guerre. Dans ce traité furent compris, du côté de l'empereur, le roi d'Angleterre, le duc de Clèves et de Juliers, le cardinal-évêque de Liège ; du côté de la France, le roi d'Écosse et le duc de Gueldre[205]. Marguerite, qui s'était rendue à Bréda pour suivre les négociations, ratifia la trêve le 16 juillet, et se tenant pour bien heureuse d'un résultat que lui avaient imposé la nécessité et les ordres de l'empereur, elle la fit publier immédiatement. Par un traité particulier, Charles d'Egmont renouvela pour un an la trêve de Heusden, et, à la suite de négociations spéciales ouvertes avec Robert de la Marck, il fut convenu que le seigneur de Sedan serait compris avec les places qu'il tenoit, en ladite abstinence, mais qu'il ne se retourneroit aux places que lui avoit prises l'empereur[206]. Les dangers de la guerre étaient ainsi momentanément écartés, mais il en existait d'autres non moins redoutables. L'accroissement incessant des impôts, la cherté des subsistances, la ruine du commerce, les désordres des gens de guerre, la fermentation des nouvelles doctrines religieuses, sur laquelle nous aurons bientôt à appeler l'attention de nos lecteurs, tout cela avait jeté dans le pays un mécontentement qui ne se cachait plus, une agitation qui se manifestait de temps à autre par d'alarmants symptômes ; cette situation inquiétante allait s'aggraver encore par la nécessité urgente de pourvoir à de nouvelles dépenses. Les Brabançons et la commune de Gand persistaient dans leur opposition aux mesures financières proposées par la gouvernante. Dans les premiers jours d'avril, Marguerite avait convoqué à Malines les états de Brabant, et leur avait proposé de remplacer l'aide pétitionnée par la création d'une rente de douze mille livres, au denier seize. Les nobles d'abord, les prélats ensuite adoptèrent cette proposition, mais elle fut fort mal accueillie par les villes. Marguerite, toujours peu endurante écrivait à son neveu dans le langage altier dont elle usait trop souvent : Dieu sait les termes que tiennent les états de Brabant. D'eux-mêmes, comme vous le savez, ils sont forts difficiles et longs, surtout les prélats, qui ne se sont rangés à l'opinion des nobles' qu'à grande difficulté. Je soupçonne même plusieurs d'entre eux de retarder le consentement des villes, et il est certain, du moins, qu'ils leur soufflent des nouveautés intolérables. Après plusieurs remontrances, Bruxelles et Anvers ont accordé l'aide à condition que les autres villes suivroient : or Louvain et Bois-le-Duc se rendent très difficiles, et n'ayant point eu guère d'espoir d'obtenir l'accord, vendredi dernier j'ai dû proroger l'assemblée à la fin de ce mois. Si vous aviez affaire de par delà d'une paire d'abbés, au lieu de maistres de requestes, en les mandant, vous en donneriez exemple aux autres et adresse aux affaires du pays[207]. La gouvernante, comme on le voit, était fort montée contre les prélats, qui combattaient, avec une énergie persévérante, les tendances absolutistes d'un gouvernement peu respectueux des franchises de la nation, tout en faisant continuellement appel à ses ressources presque complètement épuisées. L'abbé-de Parc, Ambroise Van Eggelen, celui de Tongerloo, Antoine T'Sgrooten, celui de Sainte Gertrude à Louvain, Antoine Van Nieuwenhoven, lui étaient particulièrement odieux. Elle alla jusqu'à mettre la main sur le temporel de ces abbés, qui, à l'entendre, de pervers et mauvais courage, révoquoient publiquement leur accord (touchant l'aide), faisaient diverses scandaleuses protestations et séduisaient ceux qui vouloient bien faire, prélats et villes. — Si l'abbé de Parc n'est pas puni, écrivait-elle à Charles-Quint, le mauvais exemple gagnera les autres prélats. Elle voulait qu'on l'appelât promptement en Espagne, et s'il refusait de s'y rendre, qu'on l'y conduisît de force. Il vaudrait mieux encore, ajoutait-elle, sans écrire à l'abbé, le jeter dans un navire et l'emmener en bonne sûreté ; ce seroit le plus expédient. En cas de réussite, elle était disposée à appliquer la même mesure aux abbés de Tongerloo et de Sainte Gertrude, qui n'étoient pas moins pleins de désobéissance[208]. L'opposition des provinces et des communes, qui s'accentuait de plus en plus, inspirait à Marguerite des inquiétudes plus sérieuses que celle qui lui était faite par les prélats. Elle se plaignait à son neveu du mauvais estat des affaires de ces provinces, où la désobéissance des sujets étoit manifeste, et d'où il n'étoit plus possible de tirer argent pour la guerre. Des troubles sérieux s'étaient produits à la Roche, et les pays de Limbourg estoient toujours en grosse commotion. A Bruxelles, le magistrat n'avait prévenu l'émeute que par l'abolition spontanée du droit de mouture — mollaige —, qui rapportait six mille livres par an. A Bois-le-Duc, l'agitation, dirigée à la fois contre le gouvernement, contre le clergé et contre les couvents, prit une tournure singulièrement grave. L'évêque de Liège crut devoir mettre la ville en interdit, et, durant tout le carême, les habitants furent privés de la célébration publique des offices religieux. Des réunions séditieuses se tenaient dans les cimetières situés alors à l'intérieur des villes ; les métiers s'organisèrent en sections, et exigèrent, à. l'exemple des Bruxellois, l'abolition du droit de mouture et une diminution de quatre sous par tonneau sur l'accise de la bière. Il fallut obtempérer à ces exigences. On demanda ensuite que le clergé régulier fût soumis non seulement au payement des tailles et des accises, mais qu'il indemnisât la commune des exemptions dont il avait joui jusqu'alors. Les couvents qui résistèrent — c'étaient les dominicains, les chartreux et les guillelmites — furent assaillis à main armée, envahis et saccagés, à l'exception toutefois de celui des chartreux, qui avaient cédé devant la violence et ouvert leurs portes[209]. Le magistrat les bourgeois eux-mêmes finirent par comprendre que, sous peine de tout compromettre, on ne pouvait tolérer plus longtemps de pareils désordres. Le magistrat leva quelques forces, et manda à l'hôtel de ville les chefs des sections populaires, auxquels il interdit, au péril de leur tête, de se remettre à la tête du peuple, qui, effrayé à son tour, ne tarda pas à se dissiper. Mais ces excès réclamaient une répression plus éclatante. Marguerite, préoccupée surtout de l'audace avec laquelle les émeutiers s'étaient permis d'envoyer des députés aux autres chefs-villes du Brabant, convoqua à Bréda les états du duché. Après avoir sommé en vain, à trois reprises, les représentants de la commune de venir lui exposer leurs griefs et se justifier devant elle, elle résolut, avec l'approbation du conseil privé et du conseil des finances, de recourir à des mesures promptes et sévères. En conséquence, elle révoqua la remise qu'elle avait accordée aux habitants de Bois-le-Duc du payement de leurs arrérages, déclara leur ville en état de blocus, et ordonna la saisie de tous leurs biens situés dans le territoire de l'empire. Tous les habitants, trouvés dans d'autres localités, furent arrêtés, et aucuns de la bourgeoisie, les six hommes, les doyens, les jurés et autres de la commune, reconnus les plus coupables, furent ajournés devant le conseil de Brabant, à peine de ban et de confiscation. L'autorité ainsi engagée et dans l'impossibilité de reculer, la régente se rendit à Heusden pour mieux surveiller les événements, et le comte de Buren vint prendre position à Vugt, le 25 juillet, avec un millier de piétons et trois cents gens d'armes des ordonnances. Dès les premiers jours de son arrivée, il s'empara d'une grande quantité de marchandises arrivant d'Anvers en destination de Bois-le-Duc, mais il lui fut spécialement recommandé de s'abstenir de toute agression, s'il n'était attaqué lui-même, d'empêcher ses troupes de fourrager dans la mairie et de payer tout ce qui leur serait fourni. De son côté la commune n'avait pas hésité un instant. A la force elle résolut d'opposer la force. Les portes de la ville furent soigneusement fermées, et les remparts, armés de canons, tinrent à distance les troupes chargées du blocus. A ces mesures de défense Marguerite répondit par un décret portant confiscation de corps et de biens de tous les habitants. Devant cette mesure extrême, la fière commune se sentit ébranlée, et envoya une députation à la princesse. Celle-ci refusa de l'entendre avant qu'on eût remis entre ses mains les pillards des couvents. A cette nouvelle, un cri unanime se fit entendre : Nous avons tous pris part à cette exécution ; l'un n'est pas plus coupable que l'autre. Et comme la ville était complètement investie par les troupes du comte de Buren, ils résolurent de se frayer, s'il le fallait, un passage à travers les assiégeants pour chercher un refuge ailleurs. Heureusement alors intervint un homme aussi sage que dévoué. Jean van Vladeraken, seigneur de Geffen et l'un des plus riches bourgeois, parvint à calmer les esprits. Il remontra avec douceur à ses concitoyens les affreux malheurs qu'ils se préparaient. Bloquée longtemps, la ville serait ruinée ; prise de force, elle serait mise à sac. Quant à percer les lignes des assiégeants, ceux qui y parviendraient ne seraient-ils pas atteints dans leur retraite et n'y périraient-ils pas misérablement ? Et si même ils échappaient, n'auraient-ils pas perdu la patrie pour toujours ? Ce langage fit une salutaire impression, et de nouveaux députés furent envoyés par le magistrat à Marguerite. La régente consentit à les recevoir, et chargea le comte de Buren, le président du grand conseil, Josse Lauwereys, et l'audiencier Laurent du Blioul, de conférer avec les délégués de la ville. Les conférences aboutirent, le 31 juillet, à, un traité de pacification, accordant une amnistie complète, mais payée par d'humiliantes et onéreuses conditions. La commune ratifia ce traité le 2 août. Le 5, les magistrats, les jurés, les six hommes, les conseillers et autres officiers, et les bons hommes de la ville, têtes nues et sans ceintures, se rendirent à la rencontre de Marguerite jusqu'au dernier arbre de la banlieue ; là, à genoux devant un de ses commissaires, ils demandèrent grâce et pardon pour les méfaits commis envers la majesté de l'empereur et la très miséricordieuse régente. Ensuite les doyens et les jurés des métiers, au nombre de cent cinquante, tous habillés de noir, têtes nues et des cierges à la main, vinrent attendre, au pied de l'arbre le plus prochain de la ville, la princesse qui s'avançait entourée d'un imposant cortège. Dès qu'elle parut, ils s'agenouillèrent implorant merci à leur tour, et quand elle leur eut permis de se relever, ils la conduisirent à la maison préparée pour la recevoir. De là ils se rendirent à l'église Saint-Jean, où ils déposèrent leurs cierges, après avoir fait une dernière amende honorable. Conformément au traité, toutes choses furent rétablies sur le pied où elles étaient antérieurement au 12 juin, les assemblées de cimetière furent supprimées, et la régente se réserva de donner à la ville un nouveau règlement d'administration. La commune s'engagea à restituer, moyennant remboursement, les diverses parties du domaine qu'elle avait achetées depuis 1505, à voter l'aide et à payer une amende de douze mille livres de quarante gros, en trois termes, échéant, le premier, dans les trois semaines ; le second, avant Noël ; et le troisième, avant la Saint-Jean 1526. Enfin il fut stipulé qu'en tout temps la régente aurait le droit d'entrer dans la ville avec tel nombre de gens de pied et de cheval qu'il conviendrait à sa grâce princière. Le nouveau règlement, qui fut publié peu après, plaça l'administration communale dans l'entière dépendance de la cour et annula complètement l'élément populaire. Le droit de mouture fut non seulement rétabli, mais porté de huit à dix sous ; un corps de quatre cents archers fut organisé pour contenir la multitude, et, malgré l'amnistie, des poursuites criminelles furent dirigées contre les fauteurs du désordre. L'opposition était brisée, l'autorité triomphait, mais à son profit. Non seulement le clergé resta étranger à toutes ces réparations, mais le chapitre et les couvents furent obligés de consentir à participer, pendant trois ans, aux charges de la ville, et aucune indemnité ne fut stipulée en leur faveur. Marguerite eut soin de convoquer à Bois-le-Duc même les états de Brabant ; la soumission de cette commune rendait unanime le consentement à ses demandes. Le 11 octobre, une rente de douze mille livres, à amortir sur les aides à venir, fut constituée. Malgré tous ces succès, Marguerite trouva une nouvelle occasion de se plaindre de l'abbé de Parc, qui arrivé au jour fixé pour la convocation et n'ayant pas trouvé la gouvernante, laquelle était en retard, s'était retiré en disant qu'il avait satisfait. Elle écrivait à Charles-Quint, le 9 octobre : Si vous ne pourvoyez à la présomption de cet abbé, plusieurs l'imiteront, feront pis encore, et l'obéissance se perdra en ce pays[210]. Un orage plus redoutable, mais qui ne devait éclater que plus tard, se préparait en ce moment à Gand. La collace de cette ville, dans deux réunions successives, avait rejeté l'aide de cent cinquante mille écus, accordée par les autres membres du comté. La régente néanmoins avait accepté l'accord comme universel pour autant que la plupart l'avoient consenti. Elle avait ordonné ensuite au receveur des aides d'envoyer des billets de taxe à ceux de cette ville comme aux autres, bien qu'elle tint et sût que lesdits de Gand n'en payeroient rien, et qu'il ne se fût jamais vu qu'ils eussent payé s'ils n'avoient accordé. Elle avait ses vues en procédant ainsi : Je désire, disait-elle à son neveu, conduire la chose de manière qu'ils demandent grâce de leur portion, ce qui seroit à votre avantage. Les Gantois eurent soin de n'en rien faire. Leur exemple devenait contagieux. Les communes et les châtellenies du quartier de Gand n'osoient ni ne vouloient payer l'aide. Ils font difficulté de payer, écrivait Marguerite à l'empereur[211], sous couleur du refus de ceux de la ville, et n'y a moyen d'y recouvrer autre aide, et ne conseillent nuls de la demander. Charles-Quint connaissait les Gantois ; il comprit ce qu'il y avait de délicat dans la situation, et recommanda d'éviter les moyens de rigueur. Il fallait cependant, disait-il, s'enquérir secrètement des instigateurs du refus, et les attirer, sous un prétexte quelconque, dans un lieu où l'on pourrait se saisir de leurs personnes, et leur infliger ensuite un châtiment qui servirait d'exemple. Marguerite, du reste, ne pensait pas autrement. Par ses ordres, des membres du conseil privé se rendirent à Gand, et, en présence du comte de Gavre et des délégués du magistrat, se firent ouvrir le coffre aux privilèges qu'on nommait le secret, et y prirent connaissance des actes invoqués par les Gantois pour empêcher, dans les châtellenies, la levée des aides refusées par eux. Puis, sur leur rapport sans doute, le jour même de son entrée à Bois-le-Duc, 5 août 1525, elle ordonna au receveur général de Flandre de lever l'aide sur les villes, châtellenies, bourgs et villages du quartier de Gand, et, quant à la quote-part de cette ville, de la tenir en réserve jusqu'à ce que l'empereur en eût autrement décidé. Informé de cette mesure, la commune gantoise s'assembla. Elle requit le comte de Gavre de lui donner conseil, et de l'aider, comme il y était obligé, à faire au moins tenir en surséance les ordres d'exécution lancés contre les habitants des châtellenies. Elle voulait convoquer une assemblée générale des députés du quartier ; et, dans une réunion où figuraient beaucoup de notables, on alla même jusqu'à proposer d'inviter tous les nobles et les principaux personnages adhérités au quartier de Gand, tels que les seigneurs de Ravenstein, de Beveren, de Montmorency, de Rassenghien et autres, jusqu'au nombre de soixante ou quatre-vingts. Le comte de Gavre rebouta avec douceur la commune de ces propos comme déraisonnables et choses non vues ; il fit si bien que les Gantois se contentèrent de décider l'envoi à la régente de députés en grand et notable nombre, pour lui demander de surseoir à la levée de l'aide et de leur permettre de tenir collace. Marguerite reçut la députation à Malines, le 28 octobre, en présence des principaux seigneurs du pays. Après avoir entendu leurs remontrances et doléances, elle leur fit répondre verbalement d'abord, par écrit ensuite, avec injonction de remettre sa réponse aux membres du magistrat, qu'elle maintenait son acte du 5 août, et qu'il leur était loisible, s'ils se croyaient fondés dans leurs réclamations, de se pourvoir en justice devant le grand conseil de Malines. Les conseillers de Marguerite et le comte de Gavre lui-même, qui s'était rendu à Malines nonobstant quelque douleur de jambe, semblaient croire à un succès complet et considéraient la chose comme arrangée, mais ils ne gardèrent pas longtemps cette illusion. Les Gantois trouvèrent la réponse de la régente chose bien étrange ; ils refusèrent pertinemment de soumettre leur affaire au tribunal de Malines. Sourds aux promesses, impassibles devant les menaces, ils persistèrent dans leurs réclamations et maintinrent obstinément leur refus. Après plusieurs mois de vaines tentatives, Marguerite résolut d'agir directement, et se rendit elle-même à Gand dans le courant du mois de mai 1526. La commune fut flattée de cette démarche, et, tout en restant inébranlable dans le refus de l'aide en ce qui la concernait elle-même ; elle consentit à ne plus s'opposer à l'exécution de l'acte du 5 août. Par suite de cette résolution, l'aide fut enfin payée par les villes et châtellenies du quartier de Gand. Marguerite s'applaudit de cette solution ; elle eut soin de s'en prévaloir auprès de son neveu, dont elle avait, disait-elle, gardé la hauteur et vuidé la chose à son grand honneur. Charles-Quint, de son côté, loua fort sa tante, et se tint bien content des termes qu'elle avoit tenus avec lesdits de Gand et autres villes de par delà. Des troubles qui se produisirent à Mons vers la même époque montrent bien le peu de cas que faisait par moment le gouvernement de Marguerite des sentiments populaires et sa tendance à empiéter sur les attributions du pouvoir ecclésiastique. Les marghiseurs et paroissiens de l'église Saint-Germain, mus par le désir de décorer cette église et d'accroître le service du saint patron, avoient résolu, de concert avec les maires et les échevins, d'y ériger une tour dont les cloches appelleroient les paroissiens aux offices et les feroient s'y trouver aux heures à ce ordonnées. Les fondements de cette tour étaient jetés lorsque les chanoinesses de Sainte-Waudru invoquèrent leurs privilèges et intimèrent défense de poursuivre les travaux. La bâtisse resta suspendue quelque temps, mais le magistrat profita du séjour de Charles-Quint à Mons en 1521 pour l'intéresser à sa cause, et en obtint, le 17 novembre de cette année un mandement autorisant l'érection du clocher. Les chanoinesses persistant dans leur opposition, appelèrent de cette décision, qui ne fut confirmée que trois ans plus tard. L'empereur, dans des lettres du 17 décembre 1524, considérant que cette tour n'occasionnoit aux dames de Sainte-Waudru ni dommage ni préjudice, et désirant, sur toutes choses, l'augmentation et accroissement du service divin en ses pays et seigneuries, enjoignit aux chanoinesses de cesser toute opposition, autorisa formellement l'érection d'un monument qui était destiné, disait-il, à orner l'église ainsi qu'à embellir la ville, et permit de plus d'y établir telles cloches qu'il seroit jugé convenir pour l'honneur de Dieu et du service divin. Le magistrat ne se contenta pas de cette décision, et s'adressa au saint siège. Le pape Clément VII accueillit favorablement sa demande, déclara l'opposition des chanoinesses mal fondée, et chargea le prieur des écoliers de Mons d'assurer l'exécution de la bulle pontificale. Celui-ci fit remettre la main. à l'œuvre sans autres formalités. Les chanoinesses dénoncèrent aussitôt le fait à la régente, et le procureur général lui signala cet acte comme attentatoire aux ordonnances concernant l'exécution des bulles apostoliques. Sur son rapport, Marguerite, contrairement aux récentes décisions de l'empereur lui-même, fit défense au magistrat, au curé, aux marguilliers, aux paroissiens de Saint-Germain et aux ouvriers de poursuivre les travaux, comminant de grosses peines contre ceux qui contreviendraient à ses ordres. En même temps un mandement du 25 février 1525 confirma les ordonnances défendant de mettre à exécution aucune bulle ou provision émanée de Rome, sans avoir obtenu préalablement du souverain lettres de congé sur placet en bonne et due forme. Le peuple s'émut à Mons, des attroupements se formèrent, le magistrat refusa d'entendre le secrétaire Georges d'Esplechin envoyé sur les lieux par Marguerite et ordonna de continuer les travaux. Un huissier, chargé de signifier à l'autorité locale les défenses de la régente, fut hué et repoussé avec de rudes paroles. La régente alors ordonna des poursuites judiciaires, et le procureur général assigna les magistrats de Mons, le curé de Saint-Germain et le prieur des écoliers devant le conseil souverain de Hainaut. Les accusés ayant comparu, il conclut contre eux comme sujets séditieux, et la cour ordonna qu'ils tiendraient prison dans leur logis, pour y être interrogés et examinés par deux membres du conseil privé. Ils ne furent rendus à la liberté, le 12 avril 1525, qu'à la condition de faire démolir sur le champ la partie du clocher construite depuis le jour où les défenses de la régente leur avaient été intimées, et de se présenter à la première réquisition du procureur général, sous peine d'être traités en séditieux. Le débat ne fut définitivement clos qu'en 1531. Environ le 25e jour de juin, l'empereur autorisa de nouveau l'érection du clocher, et stipula que pour reconnoissance et permission de cette érection, chaque année, à perpétuité, au jour de fête et solennité du trépas de madame sainte Waudru, qui escheit au mois d'avril, à l'heure de l'offertoire de la grande messe en l'église de Sainte-Waudru, le curé de Saint-Germain, ou son vicaire, avec un chanoine, si longtemps que la cure demeurerait annexée au chapitre de Saint-Germain, accompagnés de deux mambours de ladite église, et, pour la première fois, de deux échevins, seroient tenus de présenter aux dames chanoinesses une platine d'argent pesant une once, à la charge de la fabrique de Saint-Germain[212]. Les états eux-mêmes n'étaient pas à l'abri des animadversions de Marguerite, qui supportait avec peine leur contrôle et s'irritait de les voir se poser en protecteurs des citoyens lésés par les agents du pouvoir. Elle s'en plaignit à Charles-Quint qui lui répondit. Pour ce que nous avons esté adverti que aucuns de nos sujets de par delà, dès qu'ils ne peuvent obtenir de nous, de notre tante ou de nos consaulx ce qu'ils désirent, prennent leur train d'en faire doléance aux états de nos dits pays, et leur en requièrent provision, nous déclarons que nous voulons que droit et raison soient faits à tous, mais que si aucuns s'avançaient faire telles doléances, ils soient tenus et réputés pour séditieux, qu'il soit procédé contre eux par façon que ce soit exemple à tous[213]. Le traité de Madrid fut publié dans les Pays-Bas le 11 février 1526 ; il y fit naître la joie la plus vive, et des réjouissances publiques célébrèrent le retour de la paix. On s'en promettait de grands bienfaits ; il semblait qu'une ère nouvelle allait commencer. Mais ces illusions ne tardèrent pas à se dissiper. Le 6 mars suivant, Marguerite écrivait à l'empereur[214] : Au temps de la guerre, je vous ai souvent dit les perplexités où me jetoit l'impossibilité de payer les armées ; j'esperois alors que la paix me tireroit de ces embarras. Mais je me trouve à cet égard plus perplexe que jamais. Les gens de guerre licenciés, les hommes d'armes des ordonnances réclament leur solde arriérée ; la ville d'Anvers, créancière de quatre cent mille florins ; des particuliers dont les créances dépassent seize cent mille livres, ne me donnent plus de répit. Le trésor est épuisé, et aujourd'hui que la guerre ne sert plus d'excuse, nous ne leur savons que dire. L'empereur ne montra pas la moindre disposition à lui venir en aide dans ces circonstances. Il semble qu'on ne se rendait pas bien compte autour de lui des dures conditions où était placé le pays[215] ; on parlait même d'appeler en Espagne les membres du collège des finances pour se faire rendre compte de leur conduite. Ne sachant comment trouver les soixante mille livres demandées, ne voyant nul moyen de charger davantage le domaine ni les provinces, Marguerite prit le parti de souscrire en son propre nom et sous la garantie du seigneur de Berghes, exigée par les prêteurs, une obligation de vingt mille livres. Ayant ainsi montré le chemin aux autres, elle obtint, pour le reste de la somme et pour les intérêts de cet emprunt, des obligations de quinze mille livres chacune, des comtes de Gavre et d'Hoogstraeten ; de quatre mille de l'archevêque de Palerme ; de deux mille du président du grand conseil ; de quatre mille du trésorier général ; de trois mille chacune du receveur général et de l'audiencier, sans avoir ni savoir moyen de descharge, mais sous ferme espoir et entière confiance que l'empereur les déchargeroit, sitôt qu'il en trouverait le moyen et que les affaires le permettroient[216]. Il avait fallu enfin renoncer à tout crédit à Anvers : le gouvernement s'était tari cette ressource, parce qu'il avoit failli à promesse par diverses fois, tant envers la commune qu'envers les marchands, auxquels il devait plus de deux cent mille écus[217]. La somme qu'on venait de se procurer par ces moyens extraordinaires était loin de suffire aux besoins de la situation. Heureusement la nouvelle de la conclusion du traité de Madrid avait disposé plus favorablement les états. Ceux du Brabant se résignèrent à voter successivement deux nouvelles aides, l'une de cent cinquante mille livres le 27 février, l'autre de trois cent mille le 3 mars suivant. Marguerite comptait bien tirer parti de ces bonnes dispositions, et se préparait à solliciter des provinces quelque gracieuse somme de deniers comptant, pour le paiement et contentement des gens de guerre, lorsqu'elle reçut l'ordre de l'empereur de convoquer les états généraux pour le 23 mars afin de leur faire connaître la souvenance qu'il avoit eue d'eux et le bien que par la paix il leur avoit fait. Il défendait en même temps de leur demander aide. Cet ordre bouleversa les projets de Marguerite, d'autant plus qu'une indiscrétion avait ébruité la décision impériale. Les états en témoignèrent toute leur satisfaction. L'empereur, disaient-ils, comme bon et vertueux prince, a considéré les charges que nous avons supportées durant la guerre, et il a décidé de les alléger en les supportant lui-même pendant quelque temps. Nous n'avons donc plus d'aides à accorder pour le moment ; si nous en accordions, évidemment qui les manieroient, s'en feroient riches. Marguerite était aux abois. Comment payer la solde des gens de guerre ? écrivait-elle à son neveu, comment les entretenir, comment acquitter les dettes ? Vous n'ignorez pas que les affaires ne sont conduites qu'avec l'assistance de vos sujets, et, certes, vous n'avez pas entendu vous fourclore de demander des aides. Je vous supplie que vous m'en signifiiez votre intention au contraire. Qu'il vous plaise, monseigneur, m'envoyer en extrême diligence ceste despêche, car sans l'avoir je ne puis bonnement convoquer la généralité des états. Elle crut pouvoir différer quelque peu la réunion des députés des provinces, mais forcée de passer outre, sans avoir reçu de réponse d'Espagne, elle les appela, le 6 avril, à Malines, pour leur communiquer le traité de Madrid. Granvelle, récemment arrivé aux Pays-Bas, fut chargé par la régente de leur parler au nom de l'empereur. Marguerite savait la confiance que cet homme habile inspirait aux états, et elle était sûre qu'il sauroit bien et élégamment exposer sa charge. Tous les députés démontrèrent grande joie du traité, et après en avoir derechef rendu grâces à Dieu, ils déclarèrent être fort obligés à l'empereur de sa souvenance et de ce qu'il avoit fait pour eux. Ils requirent la régente de l'en remercier, de les recommander à sa bonne grâce et de l'advertir que si, par le passé, ils lui avoient été bons et obéissants sujets, ils y vouloient continuer. A l'issue de cette séance, ils assistèrent en corps à une messe solennelle d'actions de grâces. Les ordres de l'empereur ne permettaient pas de pétitionner une aide générale ; aussi Marguerite se contenta-t-elle de s'adresser à quelques états en particulier. Elle demanda cent mille écus à la Flandre, six mille livres au comté de Namur, seize mille à Tournai et au Tournaisis, quatre-vingt mille à la Hollande. Le Hainaut venait de lui accorder quarante mille livres, Valenciennes cinq mille, et le clergé du comté était saisi, depuis le mois de mars, d'une demande de dix mille livres accueillie par lui au mois de novembre suivant ; elle ne réclama donc rien de cette province, ni du Brabant, dont le dernier vote était trop récent, ni de la Zélande, où la précédente pétition rencontrait encore une opposition insurmontable. Bruges, Ypres et le Franc ne firent pas difficulté d'adopter la proposition du gouvernement ; Gand résista d'abord, mais dans une dernière collace tenue le 30 mai, la commune se rallia au vote émis par les trois autres membres, et le consentement fut rendu complet le 13 juin suivant. Les états de Namur réduisirent la somme qui leur était demandée, à cinq mille livres ; Tournai à deux mille ; le Tournaisis à six mille ; Malines accorda trois mille livres, et les châtellenies de Lille, Douai et Orchies, cinq mille. Selon toute apparence, les Hollandais seraient restés sourds aux prières de la gouvernante, si des dispositions menaçantes du duc de Gueldre n'étaient venues arracher aux états un vote longtemps refusé. On a vu plus haut avec quel cynisme de mauvaise foi François Ier, une fois libre, se refusa à exécuter les clauses du traité de Madrid. A la mauvaise foi succéda bientôt la malveillance. Le commerce des Pays-Bas ne tarda pas à être entravé sous toute sorte de vains prétextes par les Français, qui mettaient en avant les plus inqualifiables prétentions. Marguerite prévint l'empereur des nouvelles hostilités qui menaçaient le gouvernement des Pays-Bas[218]. En présence de ces dispositions agressives, il était impossible de rester inactif, et les actes de mauvais voisinages posés par la France provoquèrent sur le champ des représailles. Toutes les mesures prohibitives furent rétablies, et l'on en poursuivit l'exécution avec une grande rigueur. Les ordonnances interdisant l'exportation des chevaux attirèrent particulièrement l'attention du gouvernement ; l'empereur ordonna de punir de confiscation de corps et de biens quiconque enfreindrait ces ordonnances. La pénurie du trésor exigeait, à la veille de la reprise des hostilités, que tout faisait pressentir, de nouveaux appels aux sacrifices d'un peuple à peine délivré de la guerre, et si durement éprouvé par la licence de la soldatesque, la disette et les épidémies. On commença par les états de Namur, ce comté dévoué jusqu'à l'héroïsme. Le 6 août 1526, Jean de Berghes demanda aux prélats, nobles, officiers et autres des estats du comté de Namur, que ils volsissent accorder à l'empereur une grande et grosse aide, et lesdits des estats luy accordèrent, nonobstant les grandes charges du pays, la somme de trente mille livres de quarante gros, à payer en dedans six ans, à deux termes et payements chacun an[219]. Lille, Douai et Oreilles consentirent aussi à fournir annuellement douze mille livres pendant quatre ans. Mais dans la plupart des autres provinces, les pétitions de la régente rencontrèrent d'insurmontables obstacles. Ce fut dans le Brabant, comme la régente s'y attendait, que l'opposition fut la plus forte. Les débats durèrent plus d'une année. Marguerite craignait de vives résistances de la part des prélats. Le gouvernement avait violé, à leur endroit, des engagements acceptés solennellement par l'empereur et jurés par lui lors de sa réception au pays de Brabant. Ils se plaignaient qu'on ne leur tenoit foi, promesse ni fidélité en rien. Or, dit M. Henne, si peu favorable d'ailleurs au clergé, ce reproche était fondé, et la régente le reconnaissait elle-même[220]. Elle résolut donc de recourir à l'intimidation, et fit ajourner l'abbé de Parc devant le conseil de Brabant, du chef des excès et désobéissances à justice par lui commis, et déclara qu'elle traiterait de même les collègues de ce prélat, qui ne se rangeraient à la raison. Cette menace, loin d'effrayer des gens forts de leur droit, les remplit d'indignation, sans cependant les faire sortir des bornes du devoir et de la modération. Les états de Brabant avaient été convoqués, au mois de septembre, à Berg-op-Zoom ; on leur demanda une aide de cent cinquante mille écus par an, durant quatre années. L'état noble réduisit l'aide à cent mille écus, et sa durée à deux ans. Les prélats se rangèrent à cette opinion, en y mettant pour condition expresse qu'après avoir pris les avis des gens du conseil et de la chambre des comptes du Brabant, sur leurs réclamations au sujet des dimes, on y appointât ce que de droit et de raison on trouveroit convenable. Mais les villes, sur lesquelles pesaient les charges les plus lourdes, rejetèrent la demande du gouvernement à l'unanimité, et résistèrent pendant plusieurs mois à toutes les démarches, à toutes les instances des agents de Marguerite. Pendant qu'on travaillait l'opinion des villes, les prélats crurent bon de renouveler leurs protestations contre la violation des immunités du clergé, et persistèrent notamment à réclamer le doit d'élection aux dignités monastiques, et à contester le droit de collation que s'arrogeait le gouvernement. Après avoir chargé son conseil d'examiner promptement ces réclamations, Marguerite convoqua les abbés à Malines, au mois de mars 1527. Le chancelier de Brabant, Jérôme van der Noot, leur demanda alors une résolution définitive au sujet de l'aide pétitionnée par le gouvernement. Ils répondirent bien arrogamment, au rapport de Marguerite, que l'on ne leur tenoit chose qu'on leur avoit promise, et que si l'on ne vuidoit toutes leurs réclamations, ils n'estoient délibérer procéder plus. avant au fait de ladite aide. Marguerite les appela ensuite devant elle, le 22 avril, et les reçut entourée des principaux membres du conseil privé et du collège des finances. Le chancelier renouvela ses représentations, que la princesse appuya de sa parole. Alors l'abbé de Villers, Denis de Zeverdonck, déclara avec franchise, au nom de ses collègues, que puisque au fait des dîmes, ainsi que de divers points et articles contenus en la Joyeuse Entrée, ni en quelconques autres choses, on n'avoit rempli les promesses qu'on leur avoit faites, ni observé les engagements qu'on avoit pris, eux aussi n'entendoient être tenus ni obligés d'obéir, servir, assister, complaire, ni accorder aucune aide ou autre chose quelconque[221]. On s'exprima des deux parts avec une netteté fort énergique, et la rudesse des formes ne répondit que trop à l'irritation des esprits. Comme les prélats s'exprimaient en flamand, Marguerite les invita, à deux reprises, à parler en français ; ils s'y refusèrent. A proposition en thiois, dit l'abbé de Villers, je réponds en thiois. Cette réponse honore son auteur. On ne peut voir qu'avec une satisfaction patriotique le clergé, en présence d'une administration si peu respectueuse des traditions nationales, maintenir fermement, avec ses autres droits, celui de traiter les affaires du pays dans la langue du pays. Au sortir de l'audience, les prélats demandèrent un
entretien particulier au chancelier, et l'abbé de Villers lui dit au nom de
ses collègues : Nous avons appris que l'on a ordonné
de tenir note des choses intervenues entre les nobles et nous. Nous vous
requérons de les avoir en bonne mémoire, pour les rapporter exactement, afin
que l'on ne nous impute point choses que nous n'aurions ni dites ni faites[222]. N'oubliez pas que vous êtes aussi bien aux états qu'à
l'empereur, et que vous nous avez prêté serment tout comme à lui. Ils
se rendirent ensuite au refuge de l'abbaye de Tongerloo, où un notaire dressa
acte de leurs griefs[223]. Deux
conférences qu'ils tinrent avec les nobles, le 21 et le 22 mai, restèrent
sans résultat. La régente alors, ne se possédant plus, crut devoir en venir
aux mesures extrêmes. Jugeant que les dites manières
de faire sentoient désobéissance, et étoient trop au contempt, méprisement et
irrévérence de l'empereur et de sa personne, à grande et mûre délibération et
de l'avis des seigneurs du sang, des chevaliers de l'ordre, du conseil privé
et du collège des finances, elle lança un décret provisionnel de
saisie des biens temporels des prélats du Brabant. Ce décret, daté du 22 mai
1527, mettait ces biens réalement et de fait en la
main de l'empereur, pour être sous icelle régis et gouvernés jusqu'à ce qu'il
en eût autrement décidé, nonobstant toutes appellations faites ou à faire, et
sans préjudice d'icelles. Il fut sur le champ procédé à l'exécution de
la mesure, et la régente commit gens à la direction
de la saisie, en leur prescrivant de vendre les biens périssables, tels que
blés, et les produits des bois, aux temps ordinaires des coupes[224]. Les prélats ne fléchirent pas. Ils s'adressèrent aux députés des quatre chefs-villes, assemblés à Bruxelles, les requérant de ne pas se disjoindre d'eux, ni sans eux accorder ou consentir quelque aide. En outre, dans une requête présentée au conseil de Brabant, délaissant le chancelier comme suspect, ils signalèrent les infractions commises à la Joyeuse Entrée, et protestèrent contre le décret du 22 mai. Marguerite, prévenue qu'en l'absence du chancelier, le conseil de Brabant se montrait disposé à accorder aux prélats relief de leur appel, avec les clauses qu'ils avoient sollicitées, elle défendit à cette cour de passer outre, lui permettant seulement de délivrer relief d'appel, sous clauses, comme en cas d'appel des ordonnances des princes, on étoit accoutumé de faire. Le conseil de Brabant n'en était pas moins résolu à donner suite, sans restriction, à l'appel des prélats. Alors intervint le procureur général. Ce magistrat déclara que la matière touchoit si fort l'autorité et les droits du souverain, qu'il ne s'y vouloit ingérer, entreprendre procès, ni répondre aux conclusions sans avoir d'abord averti l'empereur de l'importance et des difficultés de l'affaire, et entendu son bon plaisir et ses ordres. Il réclama en conséquence un acte de surséance, et par lettres d'état datées de Gand, le 18 août, il fut ordonné de surseoir à toutes les procédures commencées et pendantes, tant sur la question principale que sur la question provisionnelle et autres, durant un terme de six mois. Cet acte d'arbitraire, comme l'appelle à juste titre M.
Henne, produisit un si mauvais effet sur le conseil de Brabant, que
Marguerite craignit de voir cette cour souveraine passer outre, sans tenir
compte de sa défense. Elle s'avisa d'un nouveau moyen d'intimidation, et fit
notifier, le 27 septembre, aux conseillers que s'ils
étoient assez téméraires que de rendre sentence ou appointement en la cause
des prélats, au préjudice des lettres d'état et de surséance, la régente
savoit ce qu'elle en auroit à faire[225]. Ses
commissaires ne cachèrent pas aux conseillers le sens de cette menace. Ils
leur apprirent que la régente était décidée à déporter
du conseil ceux qui seroient refusant de lui obéir, et qu'eux-mêmes avoient
plein pouvoir et autorité de leur interdire immédiatement l'exercice de leur
état. Cette perspective d'exécution sommaire mit fin à toute
opposition de la part du conseil. Cependant les prélats avaient résolu d'envoyer une
députation directement à l'empereur, pour lui exposer leurs griefs. Ils se
plaignirent surtout de l'inexécution de la convention de 1522[226], et rappelèrent
qu'on avait promis alors de les laisser en jouissance de leurs droits,
jusqu'à décision des arbitres nommés par les deux parties. Or, ajoutaient les
prélats, au mépris de cette promesse, on avait, à diverses reprises, attenté
à des constitutions garanties par la Joyeuse Entrée, et l'on semblait si peu
s'occuper de la sentence arbitrale, qu'un des arbitres, Jean Glapion, étant
décédé, on ne l'avait pas remplacé. Ces réclamations reçurent un accueil
favorable de l'empereur, toujours plus modéré et plus intelligent de la
situation que sa tante. Des lettres du 20 août 1527 enjoignirent à la régente
et au conseil privé de remplacer l'arbitre défunt par
quelque autre bon personnage, et recommandèrent de remplir les engagements
pris par l'empereur. Il vouloit, disait-il, pour l'acquit de sa conscience, que leur effet fût
entièrement gardé, observé et entretenu, et davantage que dudit différend une
fin fût faite, le tout selon que raison et équité le requéroient.
Quant aux autres questions pendantes, il désirait qu'elles fussent également
résolues, d'une manière raisonnable et convenable le
plus tôt possible[227]. Les prélats donnèrent alors une grande preuve de déférence
envers la gouvernante. Tout en maintenant leurs doléances, ils lui présentèrent
des excuses pour ce qui avait pu l'offenser dans les formes employées par
eux, et la supplièrent humblement de retirer les lettres d'état du 18 août. Les suppliants, c'est ainsi qu'ils s'exprimaient,
n'entendent aucunement avoir mesdit ou offensé la Majesté impériale ni Votre
Hauteur et Clémence, et ils aimeroient mieux non être vivants que de ce avoir
fait ou pensé. Ce qui peut par eux avoir été dit dans leurs réunions,
remonstrances et doléances, a eu lieu selon la cou-turne et manière de faire,
et comme on le faisoit, par ci-devant, aux princes et états du pays, pour la
défense et conservation de leurs droits et privilèges. Si les choses vous ont
été autrement rapportées, c'est qu'elles ont été mal entendues ; si quelque
chose a été dit qui ne fût en tel honneur et révérence qu'il étoit
convenable, ils déclarent que ce leur déplaît grandement, priant votre
Clémence et Bénignité de se vouloir d'eux contenter et le leur pardonner
bénignement. Ce langage si humble ne fléchit point Marguerite.
Contrariée par son neveu, plus enclin aux ménagemens
qu'à la rigueur, considérant le temps qui couroit, trompée, il faut le
croire, par de faux rapports, attachant une importance exagérée à des paroles
plus imprudentes que coupables, elle conjura l'empereur de n'avoir plus égard aux requêtes que les prélats lui
adresseroient encore, s'ils ne réparoient les grandes injures dont ils
s'étoient rendus coupables envers l'impériale majesté, sa propre personne, le
conseil privé et le conseil de Brabant. Elle voulait qu'on baillât un nouveau règlement à ce membre des états, et
surtout qu'il lui fût interdit à l'avenir de s'opposer aux pétitions d'aides,
dont il auroit à payer son entière portion, selon le taux et assiette de la
chambre des comptes. Enfin, pour donner plus
de terreur et de crainte, elle pressa l'empereur d'écrire aux prélats
qu'informé des grandes offenses commises contre son
autorité, il leur ordonnoit, sous peine d'encourir son indignation, de lui
envoyer les abbés de Villers, de Parc et de Tongerloo, qui étoffent les
principaux coupables. — Si désirez jamais
réduire lesdits abbés et retenir obéissance en ces pays, disait-elle[228], je vous adjure de ainsi le faire, et, en oultre,
d'enjoindre au chancelier et aux gens de votre conseil en Brabant, de se
conformer aux lettres d'état obtenues par votre procureur général.
Dans son ressentiment, selon M. Henne, l'altière[229] princesse ne se
borna même pas à ces menaces de déportation ; on lui prêta l'intention de
faire coudre dans un sac et jeter à l'eau les abbés les plus récalcitrants[230]. L'empereur n'en persista pas moins dans ses idées de
modération et d'apaisement. Il engagea de nouveau sa tante, dans une dépêche
du 3 février 1528, à vider le différend à l'amiable. Érard de la Marck
intervint, dans le même sens, au nom des prélats. Ceux-ci s'humilièrent de
nouveau devant la régente. Vaincue enfin par toutes ces invitations, sans
renoncer à sa colère[231], elle leur
accorda la main levée de leurs biens, sous promesse
de se mieux conduire à l'avenir et de s'acquitter de leurs devoirs envers
leur prince. Ses vrais sentiments ne se montrent que trop dans sa
dernière lettre à l'empereur sur ce sujet : J'entends
assez que la plupart d'eux — les prélats —
n'ont esté inventeurs de ce qu'ils ont par ci-devant mal fait, et que le
principal a été l'abbé de Parc. Or, bien que de votre part je lui aie
pardonné comme aux autres, et que même davantage, à la requête de tous les
prélats, je lui aie fait grâce d'une rébellion qu'il avoit faite à
l'exécution de vos deniers à l'encontre de vos officiers, il persévère
néanmoins à mal faire où il peut, et s'il ne s'en déporte, je serai
contrainte de vous l'envoyer, ou quelque autre part en ambassade[232]. Après cette réconciliation plâtrée, pour employer l'expression de M. Henne, les prélats votèrent l'aide que les villes avaient fini par accorder, et le consentement des états fut complet. Le gouvernement obtint donc ainsi, au mois de mars 1528, les deux cent mille écus pétitionnés pour les années 1526 et 1527, et depuis longtemps dépensés par anticipation. De plus le Hainaut avait accordé quarante-huit mille livres, Valenciennes, douze mille, le clergé de ce comté, huit mille (16 mars 1527) ; l'Artois, près de soixante-dix mille, payables en trois années (25 février 1527) ; Malines, trois mille ; Tournai, quatre mille cinq cents ; le clergé du Tournaisis, mille, et la Flandre, après de nombreuses difficultés, cent cinquante mille écus, le 16 juillet 1527. Mais de tout cela il ne restait plus rien ; c'était le tonneau des Danaïdes, et la nécessité de nouveaux sacrifices brillait d'une lumière sinistre à l'horizon. Des complications imprévues s'annonçaient visiblement : une alliance hostile entre la France et l'Angleterre se préparait pour un avenir prochain. Il fallait donc, quoiqu'on en eût, aviser aux ressources nécessaires pour y faire face. Charles-Quint avait envoyé à sa tante de pleins pouvoirs pour vendre ou hypothéquer le domaine, s'il devenait impossible de se procurer de l'argent autrement. Mais c'était là un expédient auquel l'habile princesse ne voulait recourir qu'à la dernière extrémité[233]. D'ailleurs, le domaine était tellement réduit que, comme le disait Marguerite elle-même, l'empereur ne demeureroit bientôt plus que le seigneur et maître des chemins ; et, en outre, si l'on avait eu quelque chose à vendre, on n'aurait point trouvé d'acheteur. Elle proposa donc de retarder, pendant un ou deux ans, le payement de tous gages et pensions. Ce serait à la vérité, elle le reconnaissait, chose de grosse criée et murmures, mais il vaut mieux les endurer que d'en venir à l'aliénation du domaine. Dans le conseil privé, on émit l'avis d'employer, pendant un ou deux ans, les deniers versés dans l'épargne à fortifier et à armer les places frontières, et de suspendre la liquidation des legs de Philippe le Beau. On faisait remarquer que la plupart des legs faits en faveur de pauvres fonctionnaires avaient été acquittés, et que les détenteurs de grosses obligations pouvoient bien, pour un temps, avoir la patience. Enfin la régente conseilla d'arrêter l'exécution de tous les travaux de luxe, tels que ceux de la chapelle du palais de Bruxelles, qui étoit alors hors de terre plus de dix pieds[234]. Avant de se prononcer, Charles-Quint voulut se rendre un compte exact de la situation des Pays-Bas. Il y envoya à cet effet le seigneur de Praet, avec ordre de s'enquérir de l'état de ces provinces, d'aviser aux moyens d'en tirer plus de ressources, et de remédier aux désordres qui avaient été signalés. Dans les instructions données à son envoyé, l'empereur manifestait l'intention de diminuer les traitements des plus hauts et des plus riches fonctionnaires, de ceux-là particulièrement qui avaient reçu de grands biens de lui et de ses prédécesseurs. Il se montrait disposé aussi à diminuer de moitié les gages des membres et des employés du conseil privé, jouissant, à d'autres titres, de gros traitements ou pensions, et à suspendre, jusqu'à la paix, la liquidation des pensions n'estant pas fort raisonnables. Le sire de Praet était chargé aussi de recommander à la régente de veiller à ce que la justice fût administrée bonne et brève, de manière à ne donner occasion de plainte ni au riche ni au pauvre, et que pour avoir faveur, don, haine ou passion particulière, il ne fût permis aux juges de causer tort à personne. L'envoyé impérial proposa aussi de convoquer les états généraux pour leur demander assistance et conseil contre les Turcs, mais Marguerite et ses ministres estimèrent qu'il ne fallait songer à pétitionner de nouvelles aides que pour la défense du pays[235]. L'objet le plus délicat de la mission du sire de Praet concernait la cour de la régente, au sujet de laquelle l'empereur avait reçu des plaintes de divers genres. Ainsi on l'accusait d'user de passions et d'inimitiés ; au lieu de charrier droit un chacun à même fin pour le service du souverain, l'un pour complaire à sa bande et l'autre à la sienne, prétendoient à traverses et gastoient les affaires. Des seigneurs s'étaient plaints de la princesse elle-même, prétendant qu'elle leur faisoit garder l'huys dehors et qu'il étoit impossible d'en obtenir audience pour lui remonstrer l'absence de justice dans le grand conseil de Malines, ou le tort que leur causoit le collège des finances, tandis que ses favoris avoient faveur et support en tout, que rien ne pouvoit s'accomplir, même les ordres de l'empereur, sans qu'ils n'eussent été d'abord contentés. Enfin on reprochait à Marguerite d'employer de préférence de petites gens qui n'avoient rendu et ne rendroient jamais à l'empereur les services qu'il avoit eus de sa noblesse, et d'user envers ceux qui n'avoient point ses bonnes grâces de mauvaises ou de piquantes paroles. Se conformant aux ordres de son maitre, de Praet remontra aux uns et aux autres qu'un des principaux moyens et fonde-mens pour la bonne direction des affaires du pays, est la bonne union et concorde de tous les officiers et serviteurs du prince. L'empereur, leur dit-il, veut que les divisions et picques cessent, et il est fermement résolu à ne plus dissimuler, mais à y pourvoir de manière que ce soit exemple. Puis il avertit à part la régente qu'elle voulût, avec sa grande prudence et bonne expérience, pourvoir et remédier à ces abus, et avoir ainsi, dans les seigneurs aujourd'hui mécontens, tant meilleurs secours, aide, obéissance et assistance[236]. Blessée de ces observations, Marguerite dépêcha sur le
champ en Espagne son maître d'hôtel, Pierre, seigneur de Rosimbos, pour
rappeler à son neveu les importants services qu'elle lui avait rendus. Si Sa Majesté pense bien, lui disait-elle dans un
langage tendre et fier tout ensemble, certes elle ne
se trouvera avoir été ainsi servie dans ses autres états. Il n'a rien été
vendu du domaine ; pas un pied de terrain n'a été perdu, et ses pays, au
contraire, se sont agrandis par des conquêtes ; l'autorité et la juridiction
souveraine ont été sauvegardées contre l'ambition des grands et contre la
mutinerie des villes. Qui auroit de tel cœur mené les affaires de l'empereur
que nous, qui le réputons non seulement pour notre seigneur et neveu, mais
pour notre frère, pour notre seul et unique héritier ; qui avons employé
diverses fois nos propres deniers au succès de ses entreprises ; qui avons
laissé arriérer, pendant deux et trois ans, le payement de notre pension, et
avons même, quand la nécessité l'a requis, engagé pour son service nos bagues
et notre vaisselle ? Vis-à-vis de ces seigneurs dont il écoute les plaintes,
notre seul tort a été de nous opposer aux tentatives contre les droits et les
juridictions sur lesquels ils vouloient empiéter, tant au fait de leurs biens
et domaines qu'en leurs offices. Si nous avons réussi à apaiser ces
différends, soulevés par leurs prétentions, à entretenir la noblesse en la
meilleure union et amitié que possible, il nous en a conté des peines
infinies ; c'est encore le travail de tous les jours, travail plus pénible
que celui qu'exigent les propres affaires de l'empereur. En agissant de la
sorte, nous avons maintenu intacts ses droits et son autorité, et chaque fois
qu'on y a attenté, nous avons réprimé l'attentat sans acception de personnes.
Aussi nous sommes à mauvais gré à plusieurs, et ils se sont plaints aucunes
fois par delà ; mais nous n'en persisterons pas moins à maintenir intacts les
droits de notre neveu, sur lesquels voudrions moins souffrir être entrepris
que sur les nôtres propres. En remémorant ces services, c'est ainsi qu'elle
terminait, ne les faisons pas dire et remonstrer à Sa Majesté pour reproche,
mais afin que si notre personne est loin de la sienne, au moins nos services
soient prochains de sa mémoire[237]. Rosimbos était
chargé de voir aussi l'impératrice et de l'assurer que si, par adventure, en exerçant le gouvernement du pays de
par deçà, madame n'a pu toujours complaire à chascun, est de besoin que Sa
Majesté le prenne de bonne part, car elle cuide avoir fait toutes choses pour
le mieulx et au bien et honneur de Sa Majesté, et à la conservation de ses
droits et haulteurs, et voudroit bien que, entre Sa Majesté et elle, n'y eût
jamais a.ultre moyenneur que ladite dame impératrice, car par ce elle
connoistroit de quelle affection madame a servi et sert Sa Majesté[238]. Ce langage
était sincère, et Marguerite, il faut lui rendre cette justice, avait droit
de le tenir. On ne pouvait pas, en effet, porter plus loin qu'elle le
faisait, le dévouement, l'activité, le désintéressement, dans tout ce qui
concernait les intérêts de son neveu. En ces dernières années de son administration, les difficultés se multipliaient autour de l'infatigable princesse. En 1527, elle eut à prévenir un conflit sérieux, qui fut sur le point de s'élever entre les deux importantes provinces de Brabant et de Flandre au sujet de la propriété des eaux de l'Escaut[239]. L'année suivante un grave démêlé éclata entre la magistrature gantoise et l'abbé de Saint-Pierre-lez-Gand. Les agents de la commune avaient enfoncé les portes de la geôle de l'abbaye, enlevé un prisonnier, et, après l'avoir transféré au Gravesteen, avaient provoqué contre le malheureux une sentence capitale. Il en résulta un long procès entre la commune et l'abbé. Enfin, le 3 février 1534, le conseil de Flandre, appelé à prononcer en dernier ressort, déclara l'abbé demandeur fondé en sa réclamation, le bris des portes de la prison et l'enlèvement du prisonnier abusifs. La cour condamna le bailli à payer à l'abbé cent florins carolus pour être distribués en aumônes ; les échevins devaient en payer trente, le sous-bailli six cents, au profit de l'empereur, en punition des effractions et des violences qu'il avait commises avec ses sergents. Tous étaient tenus solidairement aux frais et dépens[240]. D'autres conflits d'un ordre supérieur étaient nés des intrigues malfaisantes du roi de Danemark, Christiern II, le mauvais génie du nord à cette époque. De sa retraite forcée de Lierre, il n'avait cessé d'entretenir d'actives relations avec ses partisans ; suscités par lui et entraînés par l'appât du gain, de hardis corsaires s'étaient élancés, des ports de la Hollande et de la Zélande, sur les mers du nord. Les Hanséates avaient armé de leur côté, et Frédéric de Holstein avait fermé le Sund aux navires des Pays-Bas. Marguerite s'était hâtée d'intervenir, sur l'invitation de l'empereur, et, après des négociations infructueuses pour rétablir la paix et régler le payement des dommages respectifs, un congrès avait dû s'ouvrir à Cologne le 1er avril 1528[241]. Ces démêlés avaient fait renchérir les grains et ajouté ainsi une nouvelle calamité aux épreuves du pays. Marguerite avait engagé Christiern à renoncer à des entreprises si préjudiciables au peuple qui lui donnait une généreuse hospitalité ; ce prince dénaturé ne daigna pas même répondre à ses instances. La malheureuse Isabelle était morte, le 17 janvier 1526, au château de Zwynaerde. Son indigne époux voulut alors quitter la ville de Lierre, pour s'établir à Gand avec ses enfants. La régente, résolue de ne pas tolérer son séjour dans une ville peuplée de mécontents, mit tout en usage pour le détourner de ce dessein, et l'empêcher, au besoin, de l'exécuter. Le roi obstiné se déchaîna contre elle, et, dans sa fureur, éleva toutes sortes de nouvelles prétentions. Après avoir cherché en vain à s'aboucher ailleurs avec lui, elle se rendit elle-même à Lierre, avec l'intention, s'il persistait dans son obstination, de lui enlever ses enfants et de les conduire de Malines, pour les y élever conformément aux ordres de l'empereur. Il fallut d'abord payer les dettes contractées pour ses dépenses de bouche qui s'élevaient à deux mille florins[242], sans compter ensuite sept mille florins dus pour les obsèques (l'Isabelle. Il restait quatorze mille florins d'autres dettes. Il fut stipulé que cette somme serait liquidée à de longs termes et en déduction du restant de la dot d'Isabelle, qui faisait retour aux enfants de la feue reine. Enfin le roi détrôné, toujours persistant dans des projets qui devaient le conduire à sa perte, quitta les Pays-Bas, laissant ses enfants aux soins de Marguerite, qui s'en chargea avec une affection toute maternelle[243]. François Ier, de son côté, après avoir violé d'une façon si déloyale le traité de Madrid, ne cachait pas ses dispositions hostiles pour l'avenir. Il réunissait des troupes sur sa frontière du nord, et le Luxembourg était fréquemment parcouru par ses capitaines et par ses alliés de la famille de la Marck. Malgré d'incessantes réclamations, les marchands des Pays-Bas étaient pillés et rançonnés ; les choses allèrent même si loin que Marguerite autorisa le gouverneur du comté de Namur à user de représailles. Elle lui envoya des troupes et chargea le comte d'Hoogstraeten de veiller à la répression de ces brigandages ; les villes reçurent l'ordre de se bien garder, et les places les plus menacées furent ravitaillées. Un parti français essaya de surprendre Yvoy ; des bandes de lansquenets, encouragés par les partisans de la France, tels que le seigneur de Modave, qui tout autant que les François molestoit les sujets de l'empereur, traversèrent sans obstacle le Luxembourg, où l'on songea moins à les arrêter qu'à se garantir contre leurs agressions et leurs brigandages. Vers la même époque, une conspiration faillit rendre Tournai à la France. Les chefs d'un faction française existante dans cette ville, prétextèrent un pèlerinage à Saint-Nicolas de Varengille, en Lorraine, pendant les premiers jours de janvier 15e, et se rendirent à Guise où commandait un Tournaisien, le capitaine Montbrun, qui avait sous ses ordres une partie de l'ancienne garnison de Tournai. Ils s'entendirent avec lui, et il fut convenu entre eux que les Français, au nombre de dix à douze mille, tourneraient Valenciennes et Condé pour se porter dans le bois de Breuse, où ils attendraient le signal des affidés qui s'étaient chargés de leur livrer le château. Heureusement un Tournaisien de la garnison de Guise, nommé Jacques Dumonceau, s'effraya des dangers de sa ville natale, et vint dévoiler la trame à Philippe de Lannoy. Les conjurés furent aussitôt arrêtés ; le capitaine Montbrun ne poussa pas plus loin l'entreprise. Après une minutieuse instruction, seize accusés, reconnus coupables, subirent le dernier supplice. Les chefs furent écartelés, leurs membres attachés à des poteaux dressés aux abords de Tournai, et leurs têtes exposées sur des piques plantées à la galerie du beffroi et aux portes de la ville. Beaucoup d'habitants, entre autres l'ancien grand prévôt, Jean Charnoi, compromis dans la conspiration, furent bannis des terres de l'empire et leurs biens furent confisqués. On prit d'énergiques mesures pour prévenir le retour de semblables entreprises, et l'on changea les serrures de toutes les portes de la ville[244]. C'est ainsi, qu'en faisant faire, chaque semaine, des prières et des processions pour le maintien de la paix, le gouvernement des Pays-Bas se préparait à une guerre, que tout annonçait devoir être prochaine. Reportons un instant nos regards au dehors. Nous avons vu, dans les pages qui ont précédé celles-ci, la déloyauté de François let une fois délivré de captivité, les tergiversations du roi d'Angleterre, les difficultés sans nombre dont était entouré Charles-Quint, mais aussi toute l'énergie de ce prince, sa magnanimité, l'active habileté avec laquelle il avait reformé ses armées d'Italie, où figuraient les plus grands capitaines de l'Allemagne, de l'Espagne et des Pays-Bas[245]. Le 22 janvier 1528, deux hérauts de France et d'Angleterre étaient venus solennellement, au palais de Burgos, déclarer la guerre à Charles-Quint, au nom de leurs maîtres. Dès le mois de février suivant, les Français avaient franchi les frontières sur plusieurs points, volant, fouillant, adommageant les sujets. Ils avaient pris et mené prisonniers en France plusieurs d'iceux, saisi des marchands et autres, corps et biens, commis dégâts et entreprises de toute espèce, sans défiance précédente ni signification de guerre[246]. C'est ainsi qu'ils avaient pillé Fumay, et emporté le château de Beaulieu, dont le seigneur fut tué[247]. Marguerite retrouva toute son énergie en présence du danger. Une grande activité fut aussitôt imprimée aux mesures de défense. Une circulaire du 13 février ordonna d'incontinent et sans délai arrêter tous François, marchands et autres, de saisir leurs biens, denrées, marchandises, lettres, dettes, obligations et actions, quelque part qu'ils se trouvassent, afin d'indemniser et de garantir les sujets des Pays-Bas, qui avoient été pris et adommagés[248]. D'autres mandements enjoignirent aux sujets de l'empereur habitant la France, d'en sortir dans les trente jours, et défendirent, sous peine de confiscation de corps et de biens, de prendre du service à l'étranger. Les garnisons des places frontières furent renforcées, des troupes levées. Antoine de Ligne, notamment, accourut bientôt avec un corps nombreux de lansquenets et de reîtres, recrutés en Allemagne. Malheureusement le vieux mal se remontrait toujours. Les hostilités étaient à peine commencées que, dans le Luxembourg, les gens de guerre voulurent abandonner leurs garnisons, s'ils n'avoient paye[249]. Et en ce moment même, le nouveau maréchal de la noblesse, Ernest Schenck, insistait pins que jamais sur la nécessité d'y envoyer des renforts et de l'artillerie, de réparer et d'augmenter les fortifications des places de guerre, si l'on ne voulait tout abandonner à l'ennemi. Et cet ennemi n'était pas loin. Le gouverneur d'Orléans, le duc de Guise, le seigneur de Fleuranges et d'autres capitaines étaient venus s'établir dans les environs de Mézières et de Sedan, avec douze à treize cents chevaux et mille hommes de pied, à l'intention que on ne savoit[250]. Le comte Guillaume de Nassau vint fort à propos offrir ses services à Marguerite, et fut aussitôt envoyé dans le Luxembourg, pour en prendre le commandement en l'absence du marquis de Bade. A peine arrivé, il leva de nombreux pionniers pour travailler aux fortifications d'Yvoy et des places les plus menacées, sollicita l'autorisation de faire des recrues dans le pays de Trèves, et engagea des canonniers allemands et un corps de lansquenets licenciés par le landgrave de Hesse. La vigueur qu'il déploya lui valut les éloges de Marguerite ; elle écrivit à l'empereur qu'elle et son conseil ne connaissaient pas d'homme plus convenable pour le gouvernement de cette province, où le marquis de Bade ne cessait, au contraire, de lui donner de graves sujets de mécontentement[251]. Nassau fut, du reste, efficacement secondé par de braves officiers, tels que Guillaume de Le Lys, capitaine de Damvillers, Jacques, seigneur de Mercy-le-Château, Gilles de Sapoigne, capitaine d'Yvoy et de Charancy ; celui-ci, à la tête d'une troupe de chevaucheurs et de piétons, défendit valeureusement la frontière. Avec l'Angleterre il n'y eut pas d'hostilités proprement dites ; des mesures prohibitives signalèrent seules la rupture des anciennes relations. Avertie que les marchands, maronniers et autres bonnes gens sujets de par deçà estoient prins en Angleterre par manière de guerre, Marguerite ordonna sur le champ de prendre et arrester les Anglois marchands, maronniers et autres gens d'Angleterre qu'on trouveroit dans les Pays-Bas. Ensuite, par une ordonnance du 28 mars 1528, elle frappa d'un droit d'entrée les laines anglaises[252]. Cette mesure, qui atteignait les intérêts les plus intimes de la nation, provoquèrent le mécontentement populaire d'abord contre Wolsey, qu'on accusait de ruiner le royaume pour satisfaire ses rancunes, des émeutes ensuite chez les ouvriers en laine. Cédant devant une opposition qui devenait redoutable, Henri VIII fut le premier à proposer à Marguerite une trêve entre l'empereur, l'Angleterre et la France. Marguerite s'empressa d'envoyer en Angleterre Guillaume des Barres et Jean de la Sauch. Charles-Quint, pressé par les instances de sa tante, leur adjoignit l'évêque de Burgos, don Ynigo de Mendoça, et, le 15 juin 1528, une trêve de huit mois fut conclue à Hampton-Court entre les trois puissances. Ce traité stipulait la délivrance des prisonniers et la restitution des vaisseaux, marchandises, effets et biens capturés depuis la rupture[253]. Du côté de la France, la guerre maritime n'avait guère, du reste, été bien sérieuse. Tout s'était borné à un combat livré, devant Dieppe, à une escadrille française par quelques navires de l'Écluse. Bien qu'il eût perdu son mât principal, le chef flamand roula bas le vaisseau de l'amiral ennemi monté par un grand nombre de gentilshommes, et ce fait décida de la victoire[254]. La trêve permit au gouvernement des Pays-Bas de retirer des frontières françaises une partie de ses forces pour les porter dans les provinces du nord, où s'étaient produits de graves événements. Compris dans le traité de Bréda, le duc de Gueldre avait, par une convention particulière, prolongé d'un an la trêve de Heusden. Mais le repos lui pesait, et une occasion favorable lui avait permis une nouvelle intervention dans les contrées voisines. L'évêque d'Utrecht, Philippe de Bourgogne, était mort le 7 avril 1524, et le crédit de Charles-Quint lui avait fait donner pour successeur Henri de Bavière, second fils de l'électeur palatin. Au moment de son installation, le nouvel évêque avait promis aux états d'Utrecht de retirer des mains de Charles d'Egmont les villes encore occupées par les Gueldrois, et le duc s'y prêta sans difficulté, attendu que la plupart des cantons de l'Over-Yssel, désabusés de ses promesses, s'étaient soustraits à sa domination. Seulement on ne s'entendit point sur l'exécution de l'accord intervenu. Le duc voulait toucher le prix du rachat avant la remise de ces villes, mais Utrecht ne le voulait pas, et de ce dissentiment sortit une révolution. Les nouvelles doctrines s'étaient fait beaucoup d'adhérents dans l'évêché, et une opposition menaçante s'était formée contre le prélat. La majorité des états avait fini par accorder les fonds demandés pour satisfaire le duc de Gueldre, mais la commune résista, et, en présence des mesures prises pour l'y contraindre, une émeute terrible éclata le soir de l'Ascension en l'an 1526. L'évêque fut obligé de se retirer à Wyck. Après avoir été repoussé dans une tentative armée pour rentrer dans sa capitale, il érigea un fort à Oostbrœk et mit garnison dans le château d'Abcoude. Menacés d'un blocus, les insurgés invoquèrent l'assistance de Charles d'Egmont, qui leur envoya son lieutenant, le comte de Meurs, et prit possession d'Utrecht. Les partisans de l'évêque furent chassés et leurs biens confisqués[255]. A la suite de ces événements, le comte de Buren réclama la mise sous les drapeaux des milices de la Hollande, et Marguerite invita les principales villes du comté à pourvoir à leur sûreté. Les villes ne virent dans cette démarche qu'un prélude à de nouvelles demandes d'argent, et répondirent que puisqu'elles avaient voté les fonds pétitionnés pour la garde de leurs frontières, c'était à l'empereur à les défendre. Marguerite envoya alors sur la frontière du pays d'Utrecht trois à quatre cents hommes de pied et deux cent cinquante chevaux. Le seigneur de Castre, Jacques de Thiennes, dont les Gueldrois avaient souvent éprouvé la valeur, fut nommé lieutenant du comte d'Hoogstraeten retenu à Malines. Les appréhensions de la régente n'étaient que trop fondées. Après s'être affermi dans Utrecht, Charles d'Egmont s'empara de Rhenen et du château de Horst, surprit Harderwyck, et se vengea des habitants de Campen, de Zwolle et de Deventer, qui avaient déjoué ses menées ambitieuses, en ravageant cruellement leurs territoires. Dans l'impuissance de les secourir, Henri de Bavière autorisa les villes de l'Over-Yssel à se donner à l'empereur, et se montra disposé à prendre le même parti pour lui-même. Marguerite n'eut garde de laisser échapper ce moyen inespéré d'atteindre un but depuis longtemps poursuivi par le gouvernement des Pays-Bas. Elle chargea les comtes de Buren et d'Hoogstraeten, le chancelier de Brabant et le président du conseil de Hollande, de traiter avec l'évêque, et la négociation fut rapidement conduite. Les chanoines d'Utrecht. se montrèrent faciles à accorder à l'empereur la souveraineté temporelle du haut et du bas évêché. Un traité, conclu à Schoonhoven, le 15 novembre 1527, les lui céda à titre de comte de Hollande. L'empereur s'engageait à défendre les habitants du pays d'Utrecht et de l'Over-Yssel comme ses autres sujets, et à rétablir Henri de Bavière sur son siège épiscopal[256]. Outre une mense considérable affectée à l'exercice de l'autorité spirituelle, l'évêque reçut quarante-cinq mille livres pour cette cession[257]. Dès que la convention eut été ratifiée par l'empereur, Georges Schenck entra dans l'Over-Yssel, et reçut le serment de fidélité des habitants. En attendant le retour de la bonne saison, le gouvernement avisa aux moyens de pousser avec vigueur les opérations militaires. Il fut résolu de porter la guerre au cœur même de la Gueldre, pour forcer Charles d'Egmont à évacuer Utrecht et à voler au secours de ses propres états. Les sires de Buren et d'Hoogstraeten, chargés, avec Laurent de Bioul, de communiquer le traité de Schoonhoven aux états de Hollande, leur exposèrent les avantages de ce plan, et leur demandèrent une aide de quatre-vingt mille florins pour en assurer l'exécution. Pareille demande fut faite aux états de Brabant. La demande fut mal accueillie des deux côtés, mais Charles d'Egmont se chargea lui-même, par un audacieux coup de main, de changer leurs dispositions. Voulant détourner l'invasion qui menaçait ses états, le duc de Gueldre tenta à son tour d'appeler les forces ennemies sur un autre point. Par ses ordres, le maréchal de Gueldre, Martin Van Rossem, réunit secrètement à Utrecht deux mille hommes de pied et cinq cents cavaliers, leur fit prendre la croix de Bourgogne et les enseignes impériales, passa avec eux devant Montfoort et Wœrden, et cheminant, sans être inquiété, sous le canon de Leyde, parut inopinément devant La Haye, le 6 mars 1528, le jour même où l'on publiait, dans les Pays-Bas, un placard prononçant la confiscation des biens saisis sur les Français et sur ceux de Gueldre et d'Utrecht. La Haye était sans murailles. Les Gueldrois y pénétrèrent de trois côtés à la fois, la pillèrent et ne s'abstinrent d'y mettre le feu que moyennant une rançon de vingt mille florins. Cela fait, Martin Van Rossem revint tranquillement à Utrecht, chargé de butin, et en mettant à contribution un grand nombre de villages qui se trouvaient malheureusement sur sa route. Il n'en fallut pas davantage pour obtenir sans conditions l'aide demandée aux états de Hollande. On leva aussitôt trois mille hommes de pied et cinq cents chevaux, et l'on vit bientôt accourir une partie des milices du Brabant et des bandes d'ordonnances. L'indignation avait succédé à la terreur. C'était le gouvernement qui pour l'heure était accusé d'inertie, et les états de Hollande, prétendant que l'âge avait affaibli l'énergie de Jacques de Thiennes, lui subsituèrent, de leur autorité privée, Pierre de Bailleul, seigneur de Saint Martin, gendre de Jean de Wassenaar, auquel Marguerite donna pour remplaçant le comte de Rennenberg. Les provinces semblaient vouloir s'attribuer le soin de leur défense. La Flandre et la Hollande se liguèrent pour la protection de leurs pêcheurs ; la Hollande proposa au Bralant d'entretenir une armée à frais communs. Anvers et Bois-le-Duc adhérèrent à ce projet, mais il n'en fut pas de même de Bruxelles et de Louvain Enfin, dans une assemblée tenue à Malines le 29 mai, il fut arrêté qu'outre l'artillerie nécessaire, le Brabant entretiendrait douze cents cavaliers et cinq mille deux cent cinquante fantassins ; la Hollande, cinq cents cavaliers et cinq mille fantassins, à partir du le r juin jusqu'au 31 août. Anvers et Bois-le-Duc allouèrent, à cet effet, quarante-huit mille florins par mois ; la Hollande, trente-deux mille, et le gouvernement se chargea provisoirement de la quote-part de Louvain et de Bruxelles. Le comte de Buren reçut le commandement des forces qu'on allait ainsi mettre sur pied. Bientôt Georges Schenck et Buren entrèrent en campagne. Secondés par la colère des populations, ils eurent de rapides succès. Schenck enleva d'assaut les forts de Hœburg, Wilsen et Zwartendyck, dont la prise amena la reddition de Hasselt, la seule ville de l'Over-Yssel encore occupée par les Gueldrois. Le vaillant capitaine, à la demande des états de Frise, allait marcher sur Groningue, quand Marguerite lui prescrivit de se conformer au plan de campagne primitivement arrêté, et de rejoindre le comte de Buren. Celui-ci s'était emparé du fort et du château de Ter Eem, où il avait laissé un gros détachement pour couper les communications d'Utrecht avec Amersfoort, et avait envahi ensuite la Weluwé. Les deux généraux opérèrent leur jonction près de Hattem, dont ils formèrent aussitôt le siège. Après trois assauts, qui coûtèrent la vie à un frère de Schenck, et où furent blessés le seigneur de Houffalize, François de Mérode, le bailli du Brabant-wallon, Philippe d'Orley[258], et autres gens de bien en grand nombre, cette ville et le château se rendirent. Les vainqueurs se portèrent alors sur Elburg, qui leur ouvrit ses portes, et, maîtres de ces importantes positions, ils investirent Harderwyk. En moins de vingt-quatre heures, leurs batteries ouvrirent quatre brèches, et l'assaut fut livré. Les assiégés résistèrent d'abord ; la garnison ne comptait pas moins de six cents lansquenets et deux cents reîtres, indépendamment des milices de la ville et des villages voisins. Néanmoins elle ne tarda pas à. battre la chamade, et se rendit à discrétion, le 30 juin[259]. La marche victorieuse des Impériaux jeta le découragement parmi les Gueldrois. Sans attendre l'ennemi, ils évacuèrent les châteaux d'Altena et de Morgesterre, que les habitants de Deventer s'empressèrent de raser. Charles d'Egmont comprit que, réduit à ses propres forces, il ne pourrait tenir longtemps devant cette furieuse attaque : il demanda une trêve[260]. Marguerite exigeait préalablement l'évacuation d'Utrecht, de Groningue, des Ommelandes, de toutes les villes, forteresses, terres et seigneuries qu'il occupait au delà de l'Yssel. A ces conditions le duc en opposa d'autres ; autrement, ajoutait-il, je me donnerai plutôt au Turc. La régente tint bon ; elle renforça l'armée du nord de troupes levées dans le Brabant, dans le comté de Namur et dans le Hainaut. A ces troupes s'était joint un corps de milices bruxelloises conduites par leur châtelain, Robert de la Marck. La prise de Harderwyk avait entraîné l'évacuation de la plupart des châteaux voisins, et tout le littoral du Zuiderzée se trouvait aux mains des impériaux. Le succès était désormais attaché à leurs armes. Pour venger la capture de bateaux naviguant sur la Meuse et de marchands brabançons revenant de la foire de Francfort, les milices d'Anvers et de Bois-le-Duc portèrent le ravage jusqu'aux portes de Zutphen. Peu de temps après les Gueldrois, à leur tour, pénétrèrent dans la mairie de Bois-le-Duc, sous la conduite d'un de leurs plus vaillants capitaines, Henri Van Wyssche. Des forces considérables avaient été réunies pour cette expédition : trois mille lansquenets, trois à quatre cents chevaux, les milices des quartiers de Ruremonde et de Venloo et une puissante artillerie. Thierri de Batenburch, lieutenant de Buren, ne se laissa pas effrayer par le nombre. A la tête de la bande d'ordonnances de son chef, de celle de Henri de Nassau, de quelques lansquenets et de paysans déterminés, il attaqua, entre Heze et Leende, les Gueldrois qui menaçaient Helmond et Eindhoven. Il leur tua quatorze à quinze cents hommes, et rejeta le reste dans la Meuse, où beaucoup de fuyards périrent. Franchissant le fleuve à son tour, il entra dans le quartier de Ruremonde, secondé par les paysans voisins du pays de Gueldre, qui firent grandement leur devoir[261]. Les habitants d'Utrecht s'étaient maintenus jusque là en état d'insurrection. Ils avaient proclamé la déchéance de Henri de Bavière, et élu pour évêque le comte de Bilq, chanoine de Cologne. Mais bloqués par les hommes d'armes de l'évêque joints aux Impériaux, en proie à la disette, ils n'avaient pas tardé à tomber dans le découragement, et les partisans de Henri de Bavière avaient repris courage. Le 1er juillet 1528, une porte de la ville fut livrée au commandant du fort d'Oostbrœck, Guillaume Turek, qui n'éprouva qu'une faible résistance. Le comte de Meurs et plusieurs chefs de l'insurrection tombèrent entre ses mains. La rentrée de l'évêque fut signalée par quelques exécutions bientôt arrêtées, le comte d'Hoogstraeten ayant déclaré que le châtiment des rebelles appartenait à l'empereur. La nouvelle de la prise d'Utrecht fut apportée, le 3 juillet, à Marguerite, qui ordonna de la célébrer par des processions et par des réjouissances publiques[262]. Malheureusement les chefs manquaient d'argent, et le mécontentement commençait à paralyser leur activité. Le comte de Buren ne s'était décidé que difficilement, et sur l'instance des états de Brabant, à continuer les hostilités. Pressé par eux, il investit Tiel à la tête de vingt mille hommes, et Marguerite lui envoya quatre cents mineurs des pays de Namur et de Liège. Mais la mutinerie éclata dans cette armée, qui, depuis le 21 juillet, ne recevait plus de solde. Buren ordonna l'assaut le 12 août, mais, livré par des troupes démoralisées, il échoua complètement et les assaillants y perdirent six cents hommes. Cependant les états de Hollande et de Brabant s'étaient réunis à Malines pour statuer sur une proposition du gouvernement demandant la continuation de l'aide allouée quelques mois auparavant. L'assemblée fut orageuse ; on accusait les généraux de ménagements intéressés envers l'ennemi. En vain répondait-on qu'il s'agissait des intérêts de l'empereur, et non de ceux de ses généraux. Cela nous importe peu, répondaient les députés. Si l'empereur est le plus intéressé dans cette guerre, qu'il en supporte la dépense. Ils se calmèrent pourtant à la nouvelle que le seigneur du Rœulx venait d'amener à Georges Schenck deux mille Espagnols à la solde du prince, et ils accordèrent la continuation de l'aide pour un terme de deux mois. En réalité on était à bout de ressources des deux parts. Charles d'Egmont alors proposa une trêve de dix jours pour traiter de la paix, et Marguerite s'empressa d'accepter la proposition. Les négociations aboutirent enfin. Par un traité conclu à Gorcum, le 3 octobre 1528, Charles d'Egmond reconnaissait la souveraineté de l'empereur sur Utrecht et l'Over-Yssel, et la suzeraineté de ce prince sur la Gueldre et le comté de Zutphen. Charles-Quint lui accordait l'investiture de ces deux provinces pour lui et ses enfants légitimes, à défaut desquels, l'empereur, en qualité de duc de Brabant, était appelé à lui succéder. Une pension annuelle de seize mille livres était assurée au duc, qui obtenait de plus le commandement d'une compagnie de cinquante hommes d'armes, dont la solde devait être réglée trimestriellement, mais à la condition de n'être employée qu'au service des Pays-Bas. Une amnistie générale était proclamée en faveur des personnes compromises dans les troubles d'Utrecht, et tous les prisonniers de guerre étaient renvoyés sans rançon[263]. Le 5 octobre, la paix fut publiée à Gorcum, où les états de Hollande se trouvaient assemblés. Marguerite en reçut avis le même jour, et elle récompensa largement le porteur de cette bonne nouvelle[264]. Une circulaire du 7 annonça aux villes des Pays-Bas la paix, ligue et confédération perpétuelle conclue avec messire Charles de Gheldres. La publication du traité eut lieu, le 13 et le 14, avec les solennités accoutumées, et partout elle donna lieu à des réjouissances publiques. Après avoir juré l'observation du pacte, Charles d'Egmont envoya ses représentants à Malines, pour y recevoir le serment de Marguerite. A leur tête figurait Martin Van Rossem. On leur fit une réception splendide. La régente prêta serment, dans l'église de Saint-Rombaut, en présence du Saint-Sacrement, et, le 28 octobre, il y eut une procession générale pour remercier Dieu de la fin de ces guerres désastreuses. Lorsque les envoyés prirent congé de Marguerite, elle remit à chacun d'eux une coupe d'argent remplie de carolus d'or, et, par lettres du 6 décembre suivant, elle prescrivit aux cours de justice d'omettre désormais les titres de duc de Gueldre et de comte de Zutphen dans les patentes délivrées au nom de l'empereur. Le traité de Gorcum mit fin aux calamités qui depuis un demi-siècle désolaient la Hollande et le Brabant. Si la Gueldre n'était pas définitivement conquise, l'implacable ennemi de la maison d'Autriche n'en était pas moins contraint de s'en reconnaître le vassal, et dès ce moment il cessait d'être redoutable. Le 21 novembre, le comte d'Hoogstraeten prit, possession des pays d'Utrecht et d'Over-Yssel au nom de l'empereur, agissant comme duc de Brabant. Un bref du pape homologua la transaction relative à la temporalité de l'église d'Utrecht, et donna ainsi au traité de Schoonhoven la sanction apostolique. Quant à Henri de Bavière, il céda son évêché au cardinal Guillaume Enckevoort[265], et alla mourir en sa coadjutorerie de Worms, le 11 juin 1552. La guerre avait été ruineuse pour les Pays-Bas, mais elle aboutit à l'accroissement de la puissance de leur souverain, dont les pays patrimoniaux s'agrandirent de deux nouvelles provinces. La paix conclue, le gouvernement s'empressa de licencier les corps d'armée du comte de Buren et de Georges Schenck. Mais une difficulté s'éleva alors. Les troupes de Schenck, que l'empereur avait promis d'entretenir à ses frais, refusèrent de recevoir leur congé avant d'être entièrement payées. On leur avait donné un à-compte de quarante mille livres, et il leur en était encore dû quatre-vingt six mille. Marguerite, fort pressée de s'en débarrasser, chargea Georges Schenck et Gérard Mulart de négocier avec leurs capitaines. Elle emprunta quarante mille livres à Anvers, sous sa garantie et celle des comtes de Buren et d'Hoogstraeten, des seigneurs de Berghes et de Beveren, du trésorier et du receveur général. Moyennant ce nouvel à-compte, jointe à la promesse d'un payement intégral à prochain terme, ces troupes se soumirent à l'ordre de licenciement. Plus tard, les états de Brabant allouèrent cent cinquante mille livres pour achever la liquidation des dettes résultant de la désastreuse guerre qui venait de finir (13 avril 1530). La régente, toujours portée à interpréter en mal les plaintes d'un peuple accablé sous le poids des sacrifices qui lui étaient imposés continuellement et à y voir des actes de rébellion, brisa rudement, vers cette époque, l'opposition de la ville de Bruxelles et prit des mesures sévères pour en prévenir le retour. Un règlement du 18 juin 1528 remit en vigueur l'ancienne organisation municipale que le désordre des finances avait contraint de modifier sous Wenceslas, et rétablit deux bourgmestres, un patricien et un plébéen. Le souverain avait la nomination du premier, et celui-ci celle de son collègue plébéen. Les neuf nations, qui formaient le troisième membre de la commune, furent surtout en butte à des mesures restrictives et humiliantes. Il leur était interdit d'examiner ensemble les objets soumis à leurs délibérations et de les discuter en commun, suivant leur coutume mauvaise et déraisonnable, sous peine de vingt années de bannissement. Leurs réunions étaient mises sous la surveillance de l'amman, et le nombre des doyens appelés à leurs assemblées extraordinaires réduit de sept cents ou huit cents à trois cents. Enfin il était statué que pour former la majorité, il suffirait des deux premiers membres et de quatre nations, ou de cinq nations avec un des deux premiers membres[266]. Charles-Quint, réconcilié avec le pape Clément VII, désirait vivement aller recevoir la couronne impériale en Italie des mains du souverain pontife. Les préparatifs de cet important voyage donnèrent lieu à de très grandes dépenses. Les seigneurs de Mouscron et de Montfort vinrent, de la part de l'empereur, demander à Marguerite des troupes et de l'argent. L'évêque de Liège et les principaux seigneurs furent invités à assister à la cérémonie du couronnement. La plupart se montrèrent disposés à acquiescer à ce désir, mais Érard de la Marck s'excusa sur son âge et ses infirmités. Marguerite désigna, pour accompagner son neveu en Italie, une partie des troupes du pays, et notamment les bandes d'ordonnances d'Aerschot, de Rœulx et de Vianden. Quant à l'argent, il était plus difficile de se le procurer. Érard de la Marck avança six cent mille florins, remboursables le 15 octobre 1533. Le mariage de Charles-Quint, la naissance d'un fils le 21 mai 1527, le prochain couronnement autorisaient des pétitions d'aides, et les états généraux furent convoqués à Bruxelles au mois de mai 1529. Marguerite présida en personne à l'ouverture de la session. On y exposa le motif de la réunion qui n'était autre que la demande d'une aide générale pour la Ceinture, la Naissance et le Couronnement. Les seigneurs de Montfort, de Mouscron, de Rosimbos, et le secrétaire Guillaume de Barres, récemment revenus d'Espagne, entretinrent ensuite l'assemblée du vouloir et du désir de l'empereur. Il y eut de la résistance de la part du Limbourg et du Luxembourg, des états de Hollande et des villes du Brabant, mais ces provinces finirent par suivre l'exemple des autres et le consentement fut complet. Le Brabant accorda deux cent quarante mille livres ; la Flandre, la même somme ; l'Artois, trente-quatre mille sept cent soixante six livres, six sous, par an, durant six ans ; le Hainaut, quarante-huit mille livres, sans compter six mille six cents livres fournies par le clergé ; la Hollande, cent vingt mille écus, non compris les quatre-vingt mille florins demandés pour le château et les garnisons du pays d'Utrecht. La Zélande donna quarante mille livres, bien qu'elle fût endettée de cinquante sept mille écus ; le comté de Namur, deux mille livres par an, durant six années ; Lille, Douai et Orchies, vingt-quatre mille livres ; Tournai, trois mille ; le Tournaisis, neuf mille ; Valenciennes, douze mille ; Malines, six mille. Les comptes n'indiquent point les sommes votées par les états de Limbourg et de Luxembourg. La paix de Cambrai, publiée solennellement le 5 août 1529, fut l'œuvre de Marguerite et de Louise de Savoie. Nous ne reviendrons pas sur les détails donnés précédemment. Nous ne pouvons nous dispenser cependant de retracer avec quelque soin le tableau des magnificences déployées à cette occasion par les deux cours, et l'appareil de luxe et de grandeur avec lequel la tante de Charles-Quint y figura. Toute sa maison, ses dames, son premier écuyer, ses neuf pages d'honneur, ses laquais, et jusqu'à Neuteken, son fou en titre[267], avaient été habillés à neuf. On avait renouvelé ses écuries, les harnachements de ses chevaux, les garnitures de sa litière et de celles de ses dames ; les archers de sa garde avaient reçu de nouveaux et brillants uniformes[268] ; le tambourin de ses filles d'honneur avait été pourvu d'un tambour neuf tout en argent[269]. Les orgues mêmes de sa chapelle et son organiste la suivirent durant tout son voyage[270] ; où elle était accompagnée d'Érard de la Marck, de l'archevêque de Palerme, des comtes de Gavre, de Buren, d'Hoogstraeten, des seigneurs de Berghes, du Rœulx, de Rosimbos, d'un grand nombre de gentilshommes, de conseillers et de députés des états des diverses provinces. Marguerite partit de Bruxelles vers la mi-juin, et arriva à Valenciennes le 23. Elle séjourna dans cette dernière ville jusqu'au 4 juillet ; les habitants et les sociétés de rhétorique donnèrent de nombreuses fêtes en son honneur[271]. Le 5, après avoir été complimentée au village d'Escaudœuves par l'évêque Robert de Croy, elle entra à Cambrai, où l'avaient devancée la plupart des seigneurs de sa suite. Il était trois heures de l'après-midi ; deux heures plus tard arrivèrent en grand cortège la duchesse d'Angoulême, mère du roi de France, et la reine de Navarre, sa sœur, qui vinrent immédiatement la visiter. Marguerite avait pris gîte à la célèbre abbaye de Saint-Aubert ; Louise de Savoie, à l'hôtel Saint-Pol ; illarguerite de Valois, à l'hôtel d'Anchin. L'hôtel Saint-Pol était situé en face de l'abbaye d'Auchin, et, au-dessus de la rue qui les séparait, on avait pratiqué une galerie, qui permettait aux deux princesses chargées des négociations, de se voir et de conférer à volonté. Il y avait, en ce moment, réunis à Cambrai, huit cardinaux, quatre princes, dix archevêques, trente-trois évêques, quinze ducs, soixante-douze comtes et quatre cents seigneurs de tout rang. Les fêtes, les concerts, les divertissements de tout genre se succédaient sans relâche. Non seulement les plus grands seigneurs[272], mais môme les gens de leur suite s'invitaient et se traitaient réciproquement. Louise et Marguerite se donnèrent des marques mutuelles d'une grande amitié, et la régente des Pays-Bas, qui savait d'expérience l'influence exercée par les présents, multiplia autour d'elle les effets de sa générosité, et les étendit des plus hauts aux plus infimes personnages[273]. Les conférences entre les deux princesses furent tout-à-fait secrètes ; personne n'y fut admis. Après avoir été trois semaines ensemble et plusieurs choses débattues, tant d'un côté que d'autre, estant quelquefois les affaires prêtes à se terminer, d'autres fois désespérées, on était arrivé au 24 juillet ; à dix heures du matin, la rédaction du traité venait d'être arrêtée, lorsque des incidents imprévus menacèrent de tout rompre. Louise de Savoie avait déjà annoncé son départ. Heureusement il n'en fut rien. Tout s'arrangea, et la paix fut conclue le 31, signée le 3 août, et publiée le surlendemain. C'était, comme on l'a remarqué, le traité de Madrid renouvelé, moins la cession de la Bourgogne, plus une somme de deux millions d'écus d'or peur la rançon royale, et révélant en outre, dans sa teneur et son exécution[274], les défiances les plus injurieuses pour le roi chevalier. Cette paix des dames fut, en effet, aussi avantageuse et honorable pour Charles-Quint qu'humiliante pour François Ier. Si la Bourgogne restait de fait au roi, sous la réserve expresse des droits de l'empereur maintenus dans toute leur intégrité, la Flandre, l'Artois, Tournai, le Tournaisis étaient définitivement séparés de la France ; l'Italie abandonnée, la suprématie d'un ancien rival hautement reconnue. La violation du traité de Madrid n'avait donc servi, selon la remarque de M. Ancillon, qu'à étendre et à consolider la puissance impériale, devenue l'unique arbitre de l'Europe. Le jour de la publication du traité, les ambassadeurs anglais signèrent avec Marguerite, les comtes de Gavre, d'Hoogstraeten et, Jean de Berghes un traité de paix, d'amitié et d'alliance, rétablissant les relations commerciales entre les sujets des deux princes. Après les formules d'usage, Charles-Quint et Henri VIII s'engageaient mutuellement à ne point donner asile aux rebelles et à les expulser de leurs états à la première réquisition. Ils se promettaient aussi d'interdire réciproquement l'impression et la publication de tous livres et brochures hérétiques, écrits en langue teutonique ou en langue anglaise[275]. Les ambassadeurs anglais, à la suite de cet arrangement, reçurent de la princesse de riches présents de vaisselle[276]. Le 5 août donc, les princesses et leurs suites assistèrent, dans l'église de Notre-Dame, à la solemnisation de la paix faite entre l'empereur et le roi de France. Il y eut une messe d'actions de grâces et un sermon de l'évêque Robert de Croy sur les bienfaits de cette paix tant désirée. Cela fait, Marguerite, Louise de Savoie et les ambassadeurs d'Angleterre, agenouillés devant le grand autel sur un banc couvert de drap d'or, et en présence du très Saint Sacrement, jurèrent d'observer fidèlement les traités[277]. Au même instant, le chœur, accompagné de cymbales et de trompettes, entonna le Te Deum, et la voix retentissante des hérauts mit fin à la cérémonie religieuse par ce cri : la paix est faite. Les princesses furent reconduites avec la plus grande pompe ; on jeta de l'argent au peuple qui ne cessait de répéter : largesse ! largesse et d'élégants buffets dressés dans les rues versèrent à tous venants eau de rose et hypocras. François Ier attendait à l'abbaye du Mont-Saint-Martin, près des sources de l'Escaut, l'issue du congrès. Dès que le traité fut signé, il vint visiter Marguerite, et sa présence à Cambrai fournit aux fêtes un nouvel aliment. Après avoir fait donner par ses musiciens plusieurs concerts à la régente des Pays-Bas[278], le roi de France quitta Cambrai le 20, et les trois princesses n'y firent plus qu'un court séjour. De retour à Bruxelles, Marguerite fit publier, le 31 août, un avis invitant les personnes ayant été pillées et adommagées depuis la paix, à se rendre à Cambrai devant la commission mixte établie pour connaître de leurs réclamations. Des lettres du 25 et du 26 septembre annoncèrent la ratification des traités, et cet heureux événement fut célébré par des fêtes religieuses et par des réjouissances publiques. Les états généraux, convoqués à cet effet, le 31 décembre, reçurent communication des traités, en jurèrent l'exécution et en firent expédier les lettres d'enregistrement munies de leur sceau. Déjà, le 24 novembre précédent, la ville et le château de Hesdin avaient été remis par Jean de Humières, commissaire de François Ier, aux commissaires impériaux, Philippe de Lannoy, gouverneur de Tournai ; Hughes de Bulleux, capitaine du château d'Aire, et Georges d'Esplechin, secrétaire de Charles-Quint. Marguerite ne perdit pas un instant pour assurer les dispositions du traité détachant la Flandre et l'Artois de la suzeraineté de la France. Au mois de janvier 1530, en même temps qu'elle envoyait à son neveu un projet d'organisation du conseil d'Artois, elle déléguait des représentants à Paris pour le recouvrement des pièces des procès pendant devant le parlement. Charles-Quint récompensa le dévouement et l'active habileté de sa tante par une gratification de quatre mille livres, et les états du Brabant lui allouèrent trente mille livres, en reconnaissance des services rendus par elle dans ces négociations, et aussi pour le bon ordre qu'elle avoit maintenu dans le pays. Enfin une médaille frappée en son honneur consacra le souvenir de ses intelligents et heureux efforts pour mettre fin aux désastres de la guerre[279]. NOTE Instructions données au
seigneur de Monfort. — De graves dissentiments existaient depuis plusieurs
années entre les chefs des monastères des Pays-Bas et le gouvernement. Sans
entrer dans des détails qui ne sont point de notre sujet, nous croyons devoir
en donner ici une notion succincte mais exacte. Nous en empruntons les
éléments, pour une grande part, à un livre rare et rédigé d'après des
documents authentiques : Summaria chronologia
insignis ecclesiæ Parchi ordinis Prœmonstratensis, sitœ prope muros oppidi
Lovaniensis, de archivo dictes ecclesiæ in ordinem redacta ;
Lovanii, 1662. — A la demande des députés du Brabant, il avait été inséré
dans la Joyeuse-Entrée de 1515 une clause interdisant aux abbés, monastères,
chapitres et autres lieux réguliers et ecclésiastiques, d'acquérir, soit par
achat, soit par testament, soit ab intestat, des biens immeubles situés dans
les duchés de Brabant et de Limbourg. Les abbés réclamèrent énergiquement
contre cette disposition, qu'ils considéraient comme contraire au droit et à
la liberté de l'Église ; ils obtinrent de Charles-Quint une suspension
provisoire de la mise à exécution de la défense ainsi faite aux
établissements religieux, jusqu'à ce que, les parties entendues, une
résolution définitive eût été adoptée. Cette résolution fut prise en 1520 et
promulguée dans un édit perpétuel reproduit par Antoine Anselme au tome Ier
de ses Édits du Brabant. Cette disposition maintenait, en l'aggravant, la
clause insérée dans la Joyeuse-Entrée de 1515. Une autre difficulté était née
plus tard. Charles-Quint s'était plaint au pape Léon X de ce qu'on conférât
souvent les grands bénéfices ecclésiastiques, beneficia
ecclesiastica majora, à des personnes étrangères et inconnues du
gouvernement, exteris et ignotis personis, sine
ulla prœvia agnitione seu notitia principis. Par une bulle datée
du 2d jour des ides de juin 1515, le Saint-Père avait fait droit à cette
plainte, et statué qu'il ne serait désormais pourvu par l'autorité
apostolique aux dignités abbatiales et autres, qu'après avoir pris
connaissance de l'intention et du consentement du prince touchant les
personnes jugées aptes à cette promotion, quoad
abbatiales dignitates... per sedem
apostolicam de nullis personis quovis modo provideri posset, nisi prius
habitis intentione et consensu principis de personis idoneis ad hujusmodi
dignitates promovendis. S'appuyant sur cette bulle, les
conseillers du prince s'en autorisèrent pour empêcher la libre élection des
chefs des monastères, et pour les conférer, non selon les vœux et les
suffrages des religieux, mais selon le bon plaisir du prince, et pour charger
ces institutions de pensions en faveur des courtisans et d'autres séculiers ;
quœ bulla, etsi tota favorabilis videbatur pro
abbatibus Belgii et in favorem abbatiarum a principe expetita, tamen
consiliarii ejus illa titi incepêre contra liberam electioriern
conventualium, hanc impedire, et non juxta vota seu suffragia religiosorum,
sed juxta placitum principis ad abbatias deputare sen nominare personas,
casque pensionibus in favorem aulicorum et aliorum sœcularium gravare.
— Le premier usage qu'en fit Charles-Quint ou plutôt qu'en firent ses
conseillers, fut de conférer en commende, in
commendam, à Érard de la Marck la célèbre abbaye de Saint-Michel à
Anvers. Cet acte fut le signal d'une longue et vive agitation. Les religieux
procédèrent à une autre nomination, et furent énergiquement soutenus par les
abbés de leur ordre dans le Brabant, et particulièrement par l'abbé de Parc,
Ambroise Van Engelen (De Angelis), qui était alors
vicaire général. Le gouvernement, de son côté, se montra très irrité, et
poussa tes choses jusqu'à faire saisir et placer sous le séquestre le
temporel des abbés. Un arrangement intervint à la longue. L'abbé élu par les
religieux, Corneille de Mera, resta en possession, et Érard de la Marck
renonça à ses prétentions moyennant une somme d'argent et une pension
annuelle, ce qui ne laissa pas d'être très onéreux pour l'abbaye. Le
gouvernement avait cependant fini par reconnaître que la Joyeuse-Entrée
s'opposait à ce régime des commendes, qui fut d'ailleurs si fatal à l'Église.
Ambrosius ille noster, dit le livre
cité, cum suis, scieras magis obediri debere Deo
quant hominibus, perstiLit in defensione ecclesice S. Michaelis, et Regi
demonstravit, secunduni jura scripts, privilegia et immemorabilern
consuetudinem, abbatiis Brabantice competere liberam electionem suorum
prcelatorum, Regem in lceto suo introitu abbatibus addixisse et promisisse
nunquarn abbatiana aliquam dandarn in cornmendam, et eousque Regem et
concilium ejus indusit, quod fessus fuerit se dictorum privilegiorum
recordaturn non fuisse, quando primam vacantern abbatiam Episcopo Leodiensi
addixerat. — Nous croyons qu'on ne lira pas sans intérêt le
passage suivant du travail de M. Altmeyer sur Marguerite d'Autriche. Le
lecteur saura faire la part de vérité et d'erreurs plus ou moins conscientes
mêlées dans ces pages : s Marguerite, qui ne voulut pas des innovations de
Luther et de Calvin, pensa à créer une église belgique, une église nationale
pour l'opposer à l'Église universelle. Voici ce qu'elle écrivit le 4 février
1522 à l'empereur : Soubz couleur que pourveu des
joyeuses-entrées des princes, ils peuvent prendre cognoissance d'entre gens
layz (laïques) en matières concernant traictiez
matrimoniaulx, testa-mens ou biens spirituelz, ils prendent aussi et
cognoissent (les
juges ecclésiastiques),
soubz umbre de ce, de toutes matières séculières, tant réelles que
personnelles, tellement que ainsi faisant et tollérant, les juges séculiers
n'auront comme rien ou bien peu de cognoissance des matières, et pour ce
fonder et donner couleur, ilz couchent en leurs citations et libels, et
narrent d'aucuns testaments, traictez de mariages ou des bien spirituels,
jaçoit (quoique) les matières n'en dépendent ou
concernent en rien... Parquoy sembleroit qu'il ne seroit pas seulement
convenable, mais aussi nécessaire, mesme le temps comme il est, que
l'impériale maté donnast quelque charge à Me François (van der Hulst) d'aller
en commission vers nostre saint père... afin
que nostre dit saint père anniehillant tous les abuz dessusditz créast et
feist ung texte, loy et décretz, par lesquels les juges et officiers
spirituels soient bridez, limitez et contraintz de le non transgresser, ne
eulx plus avant entremettre de la jurisdiction séculière ou temporelle, ainsi
que les roys d'Angleterre et de France ont obtenu le semblable des saint
pères par ci-devant (Correspondance, vol. Ier, f° 72 et 73). —
Marguerite invoquait ici une des principales maximes sur lesquelles se
fondent les libertés de l'Église proclamées par le christianisme (lisez :
gallicanisme) : la séparation complète de la puissance temporelle d'avec le
pouvoir spirituel. — Sous ce rapport, la régente trouvait un fort appui dans
les hommes de loi, les conseillers, les parlementaires, qui voulaient, en
outre, qu'aucune bulle du pape ne fût promulguée dans les états de l'empereur
sans sa permission, et qu'aucune redevance (lisez relevante) ne pût être
portée en cour de Rome sans la même autorisation. — Marguerite avait pris la
résolution de faire un remaniement complet dans le système des dimes, et
quand le clergé s'opposa aux mesures qu'elle avait prises à cet égard, elle
défendit au conseil de Brabant de rendre ou bailler aucun appointement dans
cette cause (Correspondance, vol. II, f° 154) ; et lorsqu'en 1522
Adrien voulut ériger en collège pour les étudiants en théologie la maison
qu'il avait dans la rue du Bourgmestre à Louvain, il rencontra de sérieux
obstacles à la cour de Bruxelles. Ils ont (le clergé), écrivit la régente, partout
ailleurs, en ces pays, que l'on estime à près de la juste moitié du Fons et
propriété de la terre... en y ajoutant les 4
mil livres de rente (annuelle qu'Adrien voulait lever pour l'établissement de son
collège), qui est le fruit
et levées de plus de 24 cens bonniers de terre, la plus part de la terre
dudit quartier (de
Louvain) seroit és mains de
l'église, ou auriez à succession de temps et de plus en plus de granz
intéreptz en diverses sortes, comme de confiscation, eschéanees de biens
extraières, droits seignuraulx, reliefz et autres droits que vre majesté a
droit de prendre sur gens lais. Avec ce, vos povres subjects seroient tant
plus chargez, en tant que gens d'église, possesseurs des terres, ne
paieroient aides (Lettre du 26 octobre
1522). — Le remaniement des dîmes devait être suivi d'un changement radical
dans la circonscription des évêchés. L'on a de
longtemps tenu propos d'obtenir érection de divers éveschiez en vos pays de
par deça, des parties des diocèses de Liège, de Cambray, de Thérouane, de
Tournay, et de celui d'Utrecht, si avant qu'ils s'extendent en vos dits pays.
Il semble à aucuns que si vous ne les obtenez du père saint moderne, duquel,
au dire de plusieurs, vous avez grand faveur. que d'autres vous ne
l'obtiendrez, et aincoires, dyent aucuns que, pour la commodité de vos
suhgects, et de deffense et conservation de vostre haulteur, et de la
recouvrante de ce que les évesques desdits lieux, au moyen de leur grandeur
et de la faveur qu'ils ont eu ès jours de feu voz prédécesseurs, ont usurpé,
mieulx vous vauldroit faire obtenir divers éveschiez, assavoir de la porcion
de Thérouane, qui est à Flandre, deux ; de la porcion de Cambray, deux, l'ung
à Mons et l'autre à Bruxelles, et ainsi des autres, qui tous auront
honnestement à vivre, et y pourrez dénommer gens doctz, desquels pourriez
avoir plus de service, que d'obtenir et avoir d'évesques riches et puissans,
desquels vous n'avez que desservice et contrariété (Lettre du 19 juin
1524). — Conformément à ces conseils, l'empereur ordonna que l'on regardast de ne bailler nominations à gens qui ne
fussent bien ydoines et plustôt que l'on préférast ung religieux qui fust de
bonne vie que nul autre ; l'autre point, que l'on regardast de charger les
abbayes de pensions le moins que l'on pourra ; car nous ne voudrions oster le
vivre de povres religieux (6 mars 1526). — Mais bientôt un violent
débat s'engagea entre les prélats et l'empereur à
cause, disait le prince, de nostre droit de
nomination aux dignitez en nos pays de par delà et de l'élection qu'ils
prétendent estre libre à leur dignitez (20 août 1527). Tous les rois absolus, hautains, continue M. Altmeyer, favorisèrent
ce principe d'une église nationale et pourquoi ? C'est que rien n'était plus
simple que de s'en faire proclamer les chefs, que de disposer des abbayes et
des riches revenus de l'Église au profit des courtisans et des conseillers.
Il était impossible que Charles-Quint n'adoptât pas ces idées de
suprématie.... Mais des réactions ne tardèrent pas d'éclater contre ces
prétentions de l'empereur. Les prélats insistèrent sur la restitution de
leurs libertés si illégalement confisquées ; ils s'appuyaient
particulièrement sur un indult formel de Léon X. Mais en quoi consistaient
ces libertés ? Dans l'origine, le moine qui établissait un monastère ou qui
s'en réservait le gouvernement prenait le titre d'abbé ; et, par suite, celui
que les institutions de la vie monastique ou l'élection appelaient à régir la
communauté succédait à son titre. Quelquefois, dès le temps de la fondation,
une élection conférait le titre d'abbé ; cette élection se faisait par les
moines assemblés en chapitre. Les curés étaient nommés par les évêques, et
ils ne pouvaient être destitués que par un jugement en forme. Enfin les
évêques eux-mêmes étaient élu par les chapitres cathédraux. Le métropolitain
était seulement appelé à confirmer leur choix, et le pape l'approuvait. En
France, depuis le concordat de François Ier, les papes ne donnèrent cette
confirmation que sur la nomination royale. Le même concordat y transféra aux
rois la nomination à presque toutes les abbayes françaises. Or, ce furent ces
exemples que Marguerite avait devant les yeux lorsqu'elle suggéra à son neveu
l'idée de la destruction des libertés dont jouissait le clergé belge. — Les
abbés de Parc et de Ste-Gertrude à Louvain firent entendre d'énergiques
réclamations. L'abbé de Parc déclara si l'affaire
Fust à luy seul, qu'il n'en feroit plus de poursuite par devers eux (les membres du conseil de
Brabant), mais se plaindroit
par tout le inonde de dénégation de justice ; et, à son partement de ce
conseil... cryoit
publiquement et par manière de contempnement par plusieurs fois : Justice ! à
l'oye de tout le monde, au grand esclandre du chancellier et conseil,
conséquemment de Vre Majesté... Et
ouvertement et publiquement a dit que plutôt il vouldroit mourir que demander
pardon ou grâce (Lettre de Marguerite du 23 septembre 1527). — En
décembre 1527, alors que l'abbé de Ste-Gertrude gisait mourant sur son lit de
douleur, Marguerite défendit au prieur et aux moines du couvent de procéder à
l'élection d'un nouveau chef, sous peine d'une amende de 20.000 carolus d'or
et de la confiscation de tous les biens temporels du monastère. Les bons
frères invoquèrent les lois et coutumes garanties par la Joyeuse Entrée. On
répondit que la Joyeuse-Entrée avait été diversement modifiée pendant la
minorité de Charles-Quint, et que ce prince, majeur et empereur, n'était plus
lié par cette charte. Puis on leur faisait force
menaces, comme de les mettre au sacq ou en ung bateau pour les noyer au fond
(Correspondance, II, 183). — Poursuivis dans leurs derniers
retranchements, les prélats du Brabant eurent recours à la prière et
adressèrent une humble supplique à la régente, portant que si leur langage a
pu paraître inconvenant, ils prient de les excuser, attendu
que iceulx suppliants ne savent autre vulgaire langaige que thioys et ne sont
si bien stilés que pour précisément user des termes à ce convenables.
Supplient qu'ils soient ouis en justice par devant le conseil de Brabant (Voy.
Copie de la Requeste originale présentée par les prélats du Brabant à madame
Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, en l'an 1527 (novembre). Signé : Denys, abdt van Villers,
de Angelis, abbas Par. Pater, abdt van Sincte Gertrud. (Correspondance, II, 177-197). Armée d'un bref
d'Adrien, par lequel Charles-Quint, ainsi que tous les rois d'Espagne ses
successeurs, étaient investis du pouvoir d'élire et de présenter des
candidats aux évêchés et aux abbayes du royaume et des Pays-Bas, Marguerite
ne voulut rien entendre, et soutint vigoureusement les prétentions de son
neveu. Toutes ses concessions se bornaient à donner mainlevée de la saisie
qu'elle avait fait pratiquer sur les biens des prélats récalcitrants. Elle en
écrivit le 23 avril 1528 à l'empereur : Je leur ay (aux abbés remontrants), de vre part, accordé la levée de vre
main de leurs biens soubs promesse qu'ils ont faite de en l'avenir soy
deuement conduire et acquitter envers Vrc Majesté. Ils ont davantage fait
quelque petite réparation par eseript par eulx soubsigné (Correspondance, II, 206). — Des troubles provoqués par l'immixion de la princesse dans
les affaires spirituelles éclatèrent aussi en province, à Mons et à Gand.
J'ignore où M. Altmeyer a trouvé un bref d'Adrien VI accordant aux rois
d'Espagne le pouvoir d'élire et de présenter des candidats aux évêchés et aux
abbayes des Pays-Bas, mais il résulte de cette longue note deux choses, ce me
semble : la droiture avec laquelle l'écrivain reconnaît la légitimité de
l'opposition du clergé d'abord ; ensuite l'identité des vues et des tendances
qui animaient le gouvernement dans sa lutte contre les libertés du clergé et
contre celles des communes. FIN DU DEUXIÈME VOLUME |