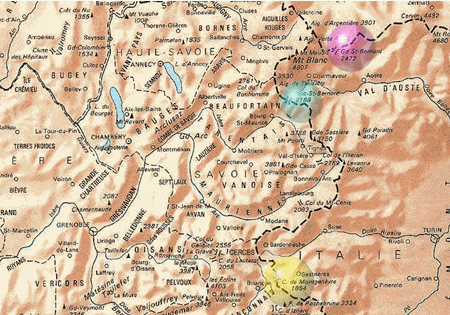L’HISTOIRE ROMAINE À ROME
Depuis la réunion de l’Italie jusqu’à la soumission de Carthage et de la Grèce
Chapitre IV — Hamilcar et Hannibal.
|
Le traité de 513 [241 av. J.-C.] avait vendu cher la
paix à Carthage. Ce n’était point assez que les tributs de presque toute Dans tout état plus faible en butte à une guerre
d’anéantissement certain ; mais dont l’heure indécise n’a point sonné encore,
c’est le devoir des hommes prudents, fermes et désintéresses, de se tenir
prêts pour l’inévitable lutte ; de l’entreprendre au moment favorable, et
de fortifier par l’offensive stratégique les calculs d’une politique de
défense. Mais combien alors, ils se sentent entravés de toutes parts par la
cohue paresseuse et lâche des serviteurs du veau d’or, des vieillards
affaiblis par l’âge, et des hommes légers, qui, voulant vivre et mourir en
paix, s’efforcent de reculer à tout prix la bataille suprême. Dans Carthage
aussi, le parti de la paix et le parti de la guerre étaient en présence, se
rattachant l’un et l’autre, comme bien on pense, aux deux doctrines hostiles,
conservatrice et réformiste : le premier s’appuyant sur le pouvoir exécutif,
sur le conseil des anciens, et le conseil des Cent, et ayant à sa tête Hannon,
dit le Grand : le second, représenté par les meneurs populaires, par Hasdrubal
notamment, avec les officiers de l’ancienne armée de Sicile, tant de fois
victorieuse sous les ordres d’Hamilcar, et dont les succès, pour être
demeurés stériles, n’enseignaient pas moins aux patriotes quelle était la
route à suivre pour triompher des immenses dangers de l’heure actuelle.
Depuis longtemps déjà les deux factions se combattaient, quand éclata la
guerre libyque. Le parti des magistrats avait fait naître l’émeute en prenant
toutes les folles mesures qui annihilèrent les précautions organisées par les
officiers de Sicile ; puis l’inhumanité du système administratif avait
changé l’émeute en révolution. Enfin l’incapacité militaire de ce parti,
surtout celle d’Hannon, son chef et le fléau de l’armée, avait amené l’État à
deux doigts de sa perte. Alors, et sous le coup des extrémités les plus
terribles, on avait dû rappeler Hamilcar Bacas, le héros d’Eirctè.
A lui de sauver les gouvernants des effets de leurs fautes et de leurs
crimes. Il prend le commandement, et dans sa magnanimité patriotique, il ne
s’en démet point, même quand on lui donne Hannon pour collègue. Les troupes
renvoient-elles celui-ci indignées, il cède aux supplications, des magistrats
et lui rend une seconde fois la moitié du généralat ; et bientôt, malgré
les ennemis de Carthage, malgré son collègue, et grâce à son autorité sur les
soldats soulevés, à ses négociations habiles avec les cheiks numides, à son
incomparable génie d’organisateur et de capitaine, il apaise en un rien de
temps la plus formidable des révoltes, et ramène l’Afrique à l’obéissance
(vers la fin de 517 [237
av. J.-C.]). Mais si le patriote s’était tu pendant la guerre,
aujourd’hui il élève la voix. Ces grandes épreuves avaient mis au jour les
vices incorrigibles et la corruption de l’oligarchie gouvernante, son
incapacité, son esprit de coterie, sa lâche condescendance envers Rome. D’un
autre côté, l’enlèvement de On ne toucha donc point à la constitution : les chefs du gouvernement demeurèrent en pleine jouissance de leurs privilèges, et maîtres, comme avant, de la chose commune ; seulement, il fut proposé et voté une motion aux termes de laquelle, des deux généraux en chef de l’armée à l’époque où avait fini la guerre Libyque, l’un, Hannon était rappelé ; l’autre, Hamilcar, était nommé au commandement suprême pour toute l’Afrique, et pour un temps indéterminé ; de plus, il était proclamé indépendant du pouvoir exécutif. — Selon ses adversaires, c’était là lui conférer le pouvoir monarchique, contrairement à la constitution : selon Caton, il exerçait une véritable dictature. Le peuple seul pouvait le rappeler et l’obliger à rendre compte de sa conduite[2]. Les magistrats métropolitains n’eurent même plus rien à voir dans la nomination de son successeur ; elle appartenait à l’armée, ou plutôt aux Carthaginois attachés à l’armée en qualité d’officiers ou de Gérousiastes, et dont les noms figuraient aussi dans les traités à côté de celui du général : naturellement la confirmation de leur choix était réservée au peuple. Usurpation ou non, une telle réforme montre clairement que le parti de la guerre avait fait de l’armée son domaine et sa chose. — En la forme, la mission donnée à Hamilcar était modeste. Les escarmouches ne cessaient pas, à la frontière avec les tribus numides. Carthage venait d’occuper à l’intérieur la ville aux cent portes, Thévesté (Tébessa). Le nouveau général en chef d’Afrique avait à pourvoir à cette guerre : elle semblait trop peu importante pour que les gouvernants, maintenus dans leurs attributions ordinaires à l’intérieur, élevassent à ce sujet la voix contre les décisions expresses du peuple ; quant aux Romains, sans nul doute, ils ne comprirent pas alors la portée de l’entreprise. L’armée, avait enfin à sa tête, l’homme qui, dans les guerres de Sicile et de Libye, avait fait voir que les destins l’appelaient seul à sauver sa patrie. Jamais héros plus grand n’avait livré un plus grand combat à la fortune. L’armée était l’instrument de salut ; mais cette armée où la trouver ? Entre les mains d’Hamilcar. Les milices carthaginoises ne s’étaient point mal comportées durant la guerre Libyque : mais il savait trop bien qu’autre chose est de pousser une fois au combat des marchands ou des industriels sous le coup d’un péril suprême ou d’en faire de solides soldats. La faction patriotique lui fournissait d’excellents officiers mais ceux-ci épuisant naturellement le contingent entier de la haute classe, la milité citoyenne lui manquait, à l’exception pourtant de quelques escadrons de cavalerie. Il lui fallait donc se faire une armée avec les recrues forcées dés cités libyques et avec les mercenaires. L’entreprise était difficile ; néanmoins, seul il la pouvait remplir, et la condition pourtant de payer ponctuellement et richement la solde de ses hommes. Il avait fait en Sicile l’expérience que les revenus de l’État avaient à défrayer, dans Carthage même, des dépenses plus urgentes que la paye des troupes combattant à l’ennemi. Il savait que la guerre devait nourrir la guerre, et qu’il convenait de tenter en grand l’expérience conduite en petit jadis sur le mont d’Eirctè (Monte Pellegrino). Ce n’était point là tout, Hamilcar était chef de parti autant que grand capitaine. Ayant affaire à des adversaires irréconciliables, infatigables, et toujours à l’affût d’une occasion de le détruire, il comprit qu’il devait prendre son point d’appui au milieu des simples citoyens. Or, si purs, si nobles que fussent les chefs, les citoyens étaient gangrenés en masse, et vivant en pleine et systématique corruption, ils ne voulaient rien donner pour rien. Sans doute l’aiguillon du besoin, les excitations du moment les avaient pu émouvoir parfois, comme il arrive même dans les sociétés les plus vénales ; mais si, pour l’exécution d’un plan qui nécessitait, à tout le moins plusieurs années de vastes préparatifs, il voulait s’assurer la complaisance durable des citoyens de Carthage, il lui fallait aussi pourvoir à de grands envois d’argent, et donner par là à ses amis le moyen d’entretenir le peuple en bonne et favorable humeur. Mendier ou acheter à l’indifférence ou cupide multitude la permission de la sauver ; à force d’humble et feinte modestie, arracher à ces orgueilleux, haïs du peuple, à ces hommes tous les jours vaincus par lui, le délai de grâce qui lui était absolument indispensable ; cacher à la fois et ses plans et son mépris à ces traîtres méprisés de tous, qui se disaient les maîtres de la cité : à quelles nécessités le grand homme n’avait-il pas à pourvoir ? Entouré de quelques amis, confidents de sa pensée, il était là, entre les ennemis du dehors et ceux du dedans, spéculant sur l’indécision des uns et des autres ; les trompant, les affrontant en réalité tous ; accumulant les munitions, l’argent, les soldats, afin d’aller engager la lutte contre un empire difficile, pour ne pas dire presque impossible à atteindre ; à supposer encore son armée formée et prête à combattre ! Hamilcar était jeune ; à peine s’il comptait plus de trente ans : il lui semblait parfois pressentir qu’au bout de tant d’efforts il ne lui serait pas donné de toucher le but, et qu’il ne verrait que de loin la terre promise de ses rêves. On raconte que, quittant Carthage, il conduisit son fils Hannibal, âgé de neuf ans, devant l’autel du plus grand des dieux de la ville, et lui fit jurer haine éternelle au nom romain. Puis il l’emmena à l’armée, lui et ses deux autres plus jeunes fils, Hasdrubal et Magon : ses lionceaux, ainsi il les appelait, devaient un jour hériter de ses desseins, de son génie et de sa haine. Le nouveau capitaine général de Libye partit de Carthage aussitôt la guerre des mercenaires terminée (printemps de 518 [236 av. J.-C.]). Il allait, croyait-on, en expédition contre les Libyens occidentaux. Son armée, très forte par le nombre de ses éléphants, longeait la côte : en vue de la côte naviguait la flotte, conduite par l’un de ses fidèles partisans, Hasdrubal. Tout à coup on apprend qu’il a franchi la mer aux colonnes d’Hercule, abordé en Espagne, et que déjà il est aux prises avec les indigènes, avec des gens qui ne lui ont fait aucun mal, et sans mission spéciale du pouvoir exécutif, disent les magistrats de Carthage, qui se plaignent. Ils ne pouvaient, en tout cas l’accuser d’avoir négligé les affaires d’Afrique. Un jour que les Numides se sont de nouveau soulevés, le général en second, Hasdrubal, les met à la raison si rudement , qu’ils laissent pour longtemps la frontière en paix, et que de nombreuses peuplades, jusque-là indépendantes, se soumettent à payer tribut. Nous ne saurions dire dans le détail les œuvres accomplies en Espagne par Hamilcar, mais Caton l’Ancien, qui trente ans après sa mort en vit encore les vestiges récents sur place, ne put pas ne pas s’écrier, en dépit de sa haine du nom carthaginois, qu’aucun roi ne méritait d’être nommé dans l’histoire à côté du nom d’Hamilcar Barca. Nous connaissons d’ailleurs en gros ses succès durant les neuf dernières années de sa vie (518-526 [-236/-228]) jusqu’au jour, où, comme Scharnhorst[3], la mort le coucha sur le champ de bataille dans la vigueur de l’âgé, à l’heure même où ses plans mûris allaient porter leurs fruits : mais nous savons les résultats obtenus après lui par Hasdrubal, son gendre, héritier de ses desseins et de sa charge, et qui, durant huit années consécutives (527-534 [-227/-220]), continua ses vastes travaux. A la place d’un simple entrepôt commercial, avec droit de protectorat sur Gadès, seule possession de Carthage, avant eux, sur la côte d’Espagne, et qu’elle avait gérée comme une dépendance de ses établissements de Libye, Hamilcar avait dû fonder, les armes à la main, un vaste empire, consolidé après lui, je le répète, par Hasdrubal, avec une habileté consommée d’homme d’État. Les plus belles régions de cette grande terre, les côtes du sud et de l’est, devenues des provinces carthaginoises ; plusieurs villes bâties, Carthage d’Espagne (Carthagène) entre autres, avec son port, le seul bon port de la côte du sud, et le splendide château royal d’Hasdrubal, son fondateur ; l’agriculture florissante, les mines d’argent les plus riches trouvées et ouvertes dans le voisinage de la nouvelle Carthage (un siècle plus tard elles rendront encore plus de 36 millions de sesterces par an[4]), voilà les traits principaux du tableau. Presque toutes les cités jusqu’à l’Èbre reconnaissent la suprématie de Carthage et lui paient tribut. Hasdrubal a su mettre tous les chefs des diverses peuplades dans ses intérêts par des mariages ou autrement. Ainsi Carthage avait conquis un nouveau, et immense débouché pour son commerce et ses fabriques, et les revenus des provinces espagnoles, après avoir défrayé ses armées, fournissaient un excédant à la métropole et pourvoyaient aux besoins de l’avenir. En même temps l’Espagne aidait à former une armée dont elle était l’école : des levées régulières se faisaient dans les contrées soumises : les prisonniers de guerre étaient incorporés dans les cadres carthaginois, et les peuplades dépendantes fournissaient des contingents ou des mercenaires, en quelque grand nombre qu’il fût demandé. A la suite de ses longues campagnes, le soldat s’était fait du camp une seconde patrie ; et s’il ne ressentait pas l’inspiration du vrai patriotisme, il avait pour en tenir lieu l’amour du drapeau, et l’attachement enthousiaste pour son illustre général. Enfin les combats acharnés et continuels avec les vaillants Ibères et les Celtes, aux côtés de l’excellente cavalerie numide, avaient donné à l’infanterie une solidité remarquable. Carthage laissa faire les Barcides. Comme ils ne demandaient plus à la cité ni prestations ni sacrifices, et Qu’au contraire ils lui envoyaient un excédant tous les jours ; comme par eux le commerce carthaginois avait retrouvé en Espagne tout ce qu’il avait jadis perdu en Sicile et en Sardaigne, la guerre et l’armée espagnoles, signalées par d’éclatantes victoires et d’importants résultats, eurent bientôt la popularité pour elles ; au point que, dans les moments critiques, à la mort d’Hamilcar notamment, on se décida sans peine à envoyer de nombreux renforts d’Africains à l’armée d’au delà du détroit. Le parti de la paix, bon gré mal gré, se tut, ou se contenta, dans ses conciliabules ou ses communications avec ses amis à Rome, de rejeter la faute sur les officiers et sur la multitude. Rome, non plus, ne fit aucun effort sérieux pour arrêter
la marche des affaires en Espagne. Son inactivité tenait à plusieurs causes.
La première, et la principale, était assurément son ignorance des faits. Il y
avait loin de la grande Péninsule à l’Italie ; en la choisissant, et non
l’Afrique, comme il eut semblé possible de le faire, pour le théâtre de ses
entreprises, Hamilcar avait calculé juste. Non que Le succès avait couronné les projets enfantés par le génie d’Hamilcar : il avait préparé les voies et moyens de la guerre, une armée nombreuse, éprouvée, habituée à vaincre, et une caisse se remplissant tous les jours. Mais soudain, le moment venu de choisir l’heure du combat et la route à suivre, le chef manqua à l’entreprise. L’homme qui, portant haut la tête et le coeur au milieu du désespoir de tous, avait su ouvrir le chemin du salut à son peuple, cet homme vient de disparaître, à peine entré dans la carrière. Par quel motif Hasdrubal renonça-t-il à attaquer Rome ? Crut-il les temps non encore propices? Homme politique plutôt que général, n’osât-il se croire au niveau de l’entreprise ? Je ne saurais le décider. — Quoiqu’il en soit, au commencement de l’an 534 [220 av. J.-C.] il tombe sous le fer d’un assassin, et les officiers de l’armée d’Espagne élisent pour son successeur Hannibal, le fils aîné d’Hamilcar. Le nouveau général était bien jeune encore : né en 505 [-249], il était à sa vingt-neuvième année. Mais il avait beaucoup vécu : ses souvenirs d’enfance lui montraient son père combattant en pays étranger, et victorieux sur le mont d’Eirctè ; il avait assisté à la paix conclue avec Catulus ; il avait partagé avec Hamilcar invaincu les amertumes du retour en Afrique, les angoisses et les périls de la guerre libyque ; il avait tout enfant suivi son père dans les camps : à peine adolescent il s’était distingué dans les combats. Leste et robuste, il courait et maniait les armes excellemment ; il était le plus téméraire des écuyers ; il m’avait pas besoin de sommeil ; en vrai soldat, il savourait un bon repas ou endurait la faim sans peine. Quoi qu’il eut vécu au milieu des camps, il avait reçu la culture habituelle chez les Phéniciens des hautes classes. Il apprit assez de grec, devenu général, et grâce aux leçons de son fidèle Sosilon de Sparte, pour pouvoir écrire ses dépêches dans cette langue. Adolescent, il avait fait, je l’ai dit, ses premières armes sous les ordres et sous les yeux de son père : il l’avait vu tomber à ses côtés durant la bataille. Puis, sous le généralat du mari de sa soeur, Hasdrubal, il avait commandé la cavalerie. Là, sa bravoure éclatante et ses talents militaires l’avaient aussitôt signalé entre tous. Et voilà qu’aujourd’hui la voix de ses égaux appelait le jeune et habile général à la tête de l’armée. C’était à lui qu’il appartenait de mettre à exécution les vastes desseins pour lesquels son père et son beau-frère avaient vécu et étaient morts. Appelé à leur succéder, il sut être leur digne héritier. Les contemporains ont voulu jeter toutes sortes de taches sur ce grand caractère. les Romains l’ont dit cruel, les Carthaginois l’ont dit cupide. De fait, il haïssait comme savent haïr les natures orientales : général, l’argent et les munitions lui manquant à toute heure, il lui fallut bien se les procurer comme il put. En vain la colère, l’envie, les sentiments vulgaires ont noirci son histoire, son image se dresse toujours pure’ et grande devant nos regards. Si vous écartez de misérables inventions qui portent leur condamnation avec elles-mêmes, et les fautes mises sous son nom et qu’il faut reporter à leurs vrais auteurs, ses généraux en second, à Hannibal Monomaque, à Magon le Samnite, vous ne trouvez rien dans les récits de sa vie qui ne se justifie ou par la condition des temps ou par le droit des gens de son siècle. Tous les chroniqueurs lui accordent d’avoir réuni, mieux que qui que ce soit, le sang-froid et l’ardeur, la prévoyance et l’action. Il eut par-dessus tout d’esprit d’invention et de ruse, l’un des caractères du génie phénicien ; il aima à marcher par des voies imprévues, propres à lui seul. Fertile en expédients masqués et en stratagèmes, il étudiait avec un soin inouï les habitudes de l’adversaire qu’on avait à combattre. Son armée d’espions (il en avait à demeure jusque dans Rome), le tenait au courant de tous les projets de l’ennemi : on le vit souvent, déguisé, portant de faux cheveux, explorant et sondant çà et là. Son génie stratégique est écrit sur toutes les pages de l’histoire de ce siècle. Il fut aussi homme d’État du premier ordre. Après la paix avec Rome, on le verra réformer la constitution de Carthage ; on le verra, banni et errant à l’étranger, exercer une immense influence sur la politique des empires orientaux. Enfin, son ascendant sur les hommes est attesté par la soumission incroyable et constante de cette armée mêlée de races et de langues, qui, dans les temps même les plus désastreux, ne se révolta pas une seule fois contre lui. Grand homme enfin, dans le vrai sens du mot, il attire à lui tous les regards. A peine fut-il promu au commandement, qu’il voulut sans
tarder commencer la guerre (printemps de 534 [220 av. J.-C.]). De sérieux motifs l’y
poussaient. Les Gaulois étaient encore en fermentation. Le Macédonien
semblait prêt à attaquer Rome. En se mettant lui-même immédiatement en
campagne, il pouvait choisir son terrain, et cela avant que les Romains
eussent eu le temps de commencer la guerre par une descente en Afrique,
entreprise plus commode, à leurs yeux. Son armée était au complet, ses
caisses avaient été remplies par quelques grandes razzias. Mais Carthage ne
se montrait rien moins qu’empressée à l’envoi de sa déclaration de guerre, et
il était plus difficile de donner dans ses murs un successeur politique à
Hasdrubal, le chef du peuple, que de le remplacer, général, en Espagne. Là,
la faction de la paix avait la haute main, et faisait alors leur procès à
tous les hommes de l’autre parti. Elle qui avait mutilé, rapetissé les
entreprises d’Hamilcar, serait-elle plus favorable à ce jeune homme inconnu,
qui commandait d’hier au delà du détroit, et dont le téméraire patriotisme
allait se déchaîner aux dépens de l’État ? Hannibal recula : il ne
voulut pas non plus déclarer la guerre de son chef, en se mettant en révolte
ouverte contre les autorités légitimes de la république africaine. Il se
résolut alors à pousser les Sagontins à des actes d’hostilité : les Sagontins
se contentèrent de porter plainte à Rome. Celle ci ayant dépêché ses
ambassadeurs sur les lieux, Hannibal tenta, à force de dédain, de les pousser
à dénoncer la rupture. Mais les commissaires voyaient bien la
situation ; ils se turent en Espagne, réservant leurs récriminations
pour Carthage même, et racontant à Rome qu’Hannibal était armé, et que la
lutte était proche. Le temps marchait. Bientôt se répandit la nouvelle de la
mort d’Antigone Doson, survenue tout à coup et presque à la même heure que la
fin d’Hasdrubal. Dans L’opiniâtre résistance de Sagonte avait coûté à Hannibal
toute une année. La campagne finie, il était revenu à Carthagène, y prenant,
comme de coutume, ses quartiers d’hiver (535-536), et y préparant à la fois
son expédition prochaine et la défense de l’Espagne et de l’Afrique. Comme
son père et son beau-frère, il avait le commandement sur les deux contrées,
et par conséquent aussi lui incombait le devoir de veiller à la protection de
la métropole. Ses forces réunies se composaient d’environ cent vingt mille
hommes, de pied, de seize mille chevaux, de cinquante-huit éléphants, de
trente-deux quinquérèmes armées en guerre, et de dix-huit quinquérèmes non
armées, sans compter les éléphants et les navires laissés à Carthage. A
l’exception de quelques Ligures placés dans les troupes légères, il n’avait
plus de mercenaires dans ses troupes. On y comptait aussi quelques escadrons
phéniciens ; mais le gros de l’armée était à peu près exclusivement
formé des contingents des sujets de Les dispositions pour l’offensive n’étaient pas moins
grandioses : Carthage devait expédier vingt quinquérèmes armées de mille
soldats, avec mission de descendre sur la côte occidentale de l’Italie et d’y
porter le ravage. Une deuxième escadre de vingt-cinq voiles avait Lilybée
pour objectif : cette ville devait être réoccupée. Mais ce n’étaient là
que les détails plus modestes et accessoires de l’entreprise : Hannibal
crut pouvoir s’en remettre à Carthage pour leur bonne exécution. Quant à lui,
il avait décidé de partir pour l’Italie avec la grande armée, prenant en main
l’exécution du plan sans nul doute conçu avant lui par son père. De même que
Carthage n’était directement attaquable qu’en Libye ; de même on ne
joignait Rome, que par l’Italie. Rome bien certainement voulait descendre en
Afrique, et Carthage ne pouvait plus, comme autrefois, se limiter à des
opérations secondaires, telles que la lutte en Sicile, ou la défensive sur
son propre territoire. Les défaites y comportaient les mêmes conséquences
désastreuses : la victoire n’y assurait point, les mêmes résultats. —
Mais comment, par où attaquer l’Italie ? Assurément les routes de terre
et de mer y conduisaient, mais si l’entreprise n’était point une sorte
d’aventure désespérée, si Hannibal rêvait une expédition sérieuse, ayant un
but vaste et stratégique à la fois, il lui fallait une base d’opérations plus
rapprochée que l’Espagne ou l’Afrique. Rome étant maîtresse de la mer, une
flotte, une forteresse maritime constituaient un mauvais appui. Il ne pouvait
pas compter davantage sur les régions occupées par la confédération
italienne. En d’autres temps, en dépit des sympathies puissantes éveillées
par le nom grec, elle avait tenu ferme devant Pyrrhus : on ne pouvait
s’attendre à la voir se dissoudre à l’apparition d’un général carthaginois.
Entre le réseau des forteresses romaines et la forte chaîne des alliés de
Rome, une armée envahissante ne serait-elle pas bientôt écrasée ? Seuls,
les Ligures et les Gaulois offraient à Hannibal tous les avantages que les
Polonais assurèrent à Napoléon dans ses campagnes contre les Russes,
analogues sous tant de rapports avec l’expédition carthaginoise. Ces peuples
frémissaient encore au lendemain de la guerre, où avait péri leur
indépendance : étrangers aux Italiques, menacés dans leur vie, voyant
s’élever chez eux les premières enceintes des citadelles romaines et ces
grandes voies qui les enveloppaient, ne croiraient-ils pas voir des sauveurs
dans l’armée carthaginoise, où combattaient en foule les Celtes de
l’Espagne ? Ne seraient-ils pas pour Hannibal un premier et solide point
d’appui ? Ne lui fourniraient-ils pas et les approvisionnements et les
recrues ? Déjà il s’était formellement abouché avec les Boïes et les
Insubres, qui avaient promis des guides à son armée, un bon accueil à leurs
frères de race, et des vivres sur la route. Ils devaient se soulever aussitôt
que les Carthaginois auraient mis le pied sur le sol de l’Italie. Les
événements de l’Est n’étaient pas moins propices à l’invasion. Donc, dès l’ouverture de la saison, Hannibal réunit sous Carthagène toutes les troupes composant la grande armée : quatre-vingt-dix mille hommes d’infanterie et douze mille chevaux ; les deux tiers Africains, un tiers Espagnols. Il emmène trente-sept éléphants, plutôt pour en imposer aux Gaulois que comme renfort efficace de combat. Son infanterie n’avait plus rien de commun avec celle de Xanthippe, se cachant par peur derrière la ligne de ces grands animaux. Il n’était point homme à ignorer que c’était là une arme à deux tranchants, apportant la défaite dans les rangs amis aussi souvent que chez l’ennemi. Aussi n’usait-il des éléphants qu’avec circonspection, et en petit nombre. Telle était l’armée avec laquelle il quitta Carthagène, et marcha vers l’Èbre, au printemps de 536 [218 av. J.-C.]. Des mesures prises à l’avance, et surtout des relations nouées avec les Celtes, des moyens, du but de son expédition, il laissa transpirer assez pour donner confiance même au simple soldat. Celui-ci, dont l’instinct militaire s’était développé sous les armes, pressentait partout les vues nettes et hardies ; la main sûre et forte de son général, et il le suivait avec une aveugle foi dans ses voies inconnues. Puis, quand par ses paroles enflammées il leur montrait la patrie humiliée, les exigences insolentes de Rome, l’asservissement imminent de cette Carthage qui leur était chère, l’extradition honteuse de leur général et de ses officiers imposée comme condition de la paix, il les entraînait avec lui, ardents à la guerre, emportés par l’élan du civisme. A Rome, la situation était ce qu’elle est souvent au sein
des aristocraties les plus solidement assises et les plus prévoyantes. Certes
le gouvernement savait ce qu’il voulait, et il agissait. Malheureusement il
n’agissait ni bien ni en temps utile. Depuis longtemps on aurait pu fermer
les portes des Alpes, et en finir avec les Cisalpins : or on avait laissé les
Alpes ouvertes, et les Cisalpins étaient encore redoutables. On aurait pu
avec Carthage vivre en paix, et en paix durable, à la condition d’observer
fidèlement le traité de 513 [241 av. J.-C.]. Que si l’on voulait la ruine de Carthage,
depuis longtemps les légions auraient pu et dû la réduire. Mais en fait, les
traités avaient été violés par la confiscation de Arrivé aux Pyrénées, Hannibal renvoya une partie de ses soldats chez eux. Mesure préméditée dès le début, et qui témoignait hautement aux yeux de l’armée de la confiance du général dans le succès de l’entreprise, en même temps qu’elle était un démenti donné à ceux qui croyaient qu’elle était de celles dont nul ne revient. Ce fut, avec cinquante mille fantassins et neuf mille cavaliers seulement qu’il franchit la chaîne sans rencontrer de difficultés. Puis, longeant la côte dans la région de Narbonne et de Nîmes, il s’ouvre rapidement passage au milieu des peuplades gauloises, rendues favorables par des négociations antérieures, ou achetées, sur place par l’or carthaginois, ou enfin domptées par les armes. A la fin de juillet, il arrive sur le Rhône en face d’Avenio (Avignon). Ici l’attend, ce semble, une résistance plus sérieuse : le consul Scipion avait débarqué à Marseille (fin juin) : en faisant route pour l’Espagne, il apprit qu’il était trop tard, et qu’Hannibal avait non seulement passé l’Èbre, mais aussi franchi les Pyrénées. A cette nouvelle, qui jetait enfin la lumière sur la direction et le but de l’expédition carthaginoise, le consul abandonne pour le moment ses projets sur l’Espagne, et prend le parti de faire sa jonction avec, les peuplades celtiques de la contrée, obéissant toutes à l’influence, des Massaliotes et par les Massaliotes à l’influence romaine. Il recevra donc Hannibal sur le Rhône, et lui fermera le passage du fleuve et l’entrée de l’Italie. Heureusement pour les Carthaginois, ils n’avaient en face d’eux, sur le lieu de leur passage projeté, que quelques milices gauloises. Le consul, avec son armée (vingt-deux mille fantassins et deux mille cavaliers) se tenait encore à Massalie, à quatre jours de marche en aval. Les envoyés des Gaulois accoururent et lui donnèrent avis de l’arrivée de l’ennemi. Celui-ci se voyait obligé de franchir le rapide torrent en toute hâte avec sa nombreuse cavalerie, ses éléphants, sous les yeux des Gaulois, et avant que le Romain se montrât. Il ne possédait pas une nacelle. Aussitôt et par son ordre toutes les barques employées dans le pays à la navigation du Rhône sont achetées à tout prix ; on en construit d’autres en abattant les arbres dans les alentours. En peu de temps les préparatifs sont faits. L’armée pourra en un seul jour accomplir son passage. Pendant ce temps un fort détachement commandé par Hannon, fils de Bomilcar, remonte le fleuve à quelques jours de marche au-dessus d’Avignon, et trouvant un endroit plus facile et non défendu, il aborde sur l’autre rive au moyen de radeaux rapidement assemblés ; puis il redescend vers le midi, pour tomber sur le dos des Gaulois, qui arrêtent le gros de l’armée. Le matin du cinquième jour après son arrivée, trois jours après le départ d’Hannon, Hannibal voit s’élever en face de lui une colonne de fumée, signal convenu qui lui annonce la présence de son détachement ; aussitôt il donne l’ordre impatiemment attendu de l’attaque. Les Gaulois, au premier mouvement de la flottille ennemie accourent sur la rive, mais tout à-coup le feu mis derrière eux à leur camp les surprend et les arrête. Divisés, ne pouvant ni résister, à ceux qui les attaquent, ni à ceux qui passent le fleuve, ils s’enfuient et disparaissent. Pendant ce temps, Scipion tient conseil dans Massalie, et s’enquiert des points qu’il conviendrait d’occuper sur le Rhône. Les Gaulois ont eu beau lui envoyer les plus pressants messages, il n’a pas jugé à propos de marcher à l’ennemi. Il ne veut pas croire aux nouvelles qu’on lui apporte, et se contente d’expédier sur la rive gauche un petit corps de cavalerie en éclaireur. Ce corps se heurte contre l’armée carthaginoise tout entière, déjà passée au delà du fleuve, et aidant au transport des éléphants laissés sur la rive droite. Il achève sa reconnaissance, en livrant un combat vif et sanglant, — le premier combat de cette guerre, — à quelques escadrons de Carthaginois qui battaient aussi la plaine (non loin d’Avignon) ; puis il tourne bride rapidement, et s’en va rendre compte de la situation au quartier général. Alors Scipion part à marches forcées ; mais quand il arrive, déjà depuis trois jours la cavalerie carthaginoise, après avoir protégé le passage des éléphants, a suivi le gros de l’armée. Il ne reste plus au consul qu’à s’en retourner sans gloire à Massalie avec ses troupes fatiguées, affectant follement le mépris de ces Carthaginois qui ont lâchement pris la fuite. — De compte fait, c’était la troisième fois que les Romains, par pure négligence, abandonnaient leurs alliés et perdaient une ligne de défense importante. Puis, comme après l’erreur commise, ils avaient passé de l’immobilité déraisonnable à une plus déraisonnable hâte ; comme ils venaient de faire, sans plan, sans résultat, ce que, quelques jours plus tôt, ils auraient pu et dû, en toute sûreté, exécuter d’une façon utile, ils se mettaient par là hors d’état de réparer leurs fautes. Une fois de l’autre côté du Rhône, il n’y avait plus à songer à empêcher Hannibal d’atteindre le pied des Alpes. Du moins Scipion pouvait-il encore, à la première nouvelle du passage du fleuve, s’en retourner avec toute son armée : en passant par Genua il ne lui fallait que sept jours four arriver sur le Pô. Là, il obérait sa jonction avec les corps plus faibles stationnés dans la contrée : il attendait l’ennemi, et le recevait vigoureusement. Mais non, après avoir perdu du temps en courant sur Avignon, il semble que Scipion, homme habile pourtant, n’ait eu alors ni courage politique, ni tact militaire ; il n’ose pas prendre conseil des circonstances, et modifier la destination de son corps d’armée ; il le fait embarquer pour l’Espagne en majeure partie, sous le commandement de Gnœus, son frère, et revient à Pise avec le reste. Hannibal, le Rhône franchi, avait convoqué une grande
revue de ses troupes, leur annonçant quels étaient ses projets, et les abouchant
à l’aide d’un interprète avec un chef gaulois, Magilus, venu de la
région du Pô ; puis il s’était de suite remis sans obstacle en marche
vers les passes des Alpes. Là, choisissant sa route, il ne prit en
considération ni la moindre longueur des vallées, ni les dispositions plus ou
moins favorables des habitants, quelque intérêt qu’il eût d’ailleurs à ne pas
perdre une minute dans des combats de détail ou dans les détours de la
montagne. Avant tout, il devait préférer le chemin le plus facilement praticable
pour ses bagages, sa nombreuse cavalerie et ses éléphants, celui où il
trouverait bon gré mal gré des subsistances en quantité suffisante. Bien
qu’il portât avec lui des approvisionnements considérables chargés à dos de
bêtes de somme, ces approvisionnements ne pouvaient alimenter que pendant
quelques jours son armée forte encore, nonobstant ses pertes, de cinquante
mille hommes valides. Quand on laissait de coté la route qui longe la mer,
et, dont il ne voulut pas, non parce que les Romains la lui barraient, mais
parce qu’elle l’eût éloigné du but[6]. Dans ces temps
anciens, deux passages seulement, méritant ce nom, conduisaient des Gaules en
Italie par les cols alpestres : l’un franchissait les Alpes Cottiennes
(mont Genèvre) et descendait chez les Taurins (à Turin par Suse
ou Fénestrelles) : l’autre, par les Alpes Gréées (le petit
Saint-Bernard), conduisait chez les Salasses (pays d’Aoste
et d’Ivrée). Le premier est plus court : mais après avoir quitté
le Rhône, il conduit dans les vallées difficiles et infertiles du Drac,
de On touchait au but, mais au prix de grands sacrifices. Des cinquante mille fantassins, des neuf mille cavaliers vétérans qui composaient encore l’armée au delà des Pyrénées, il en avait péri la moitié sur le champ de bataille, dans la marche et au trajet des rivières. Hannibal, de son propre aveu, ne pouvait plus mettre en ligne que vingt mille hommes de pied, dont les trois cinquièmes étaient Libyens, les deux autres cinquièmes Espagnols. Il lui restait en outre six mille cavaliers, démontés pour la plupart. Les pertes bien moindres de la cavalerie témoignent et de l’excellence des Numides et aussi du soin particulier et des ménagements dont ces troupes choisies avaient été l’objet de la part du général en chef. Une marche de 526 milles ou de trente-trois jours en moyenne, commencée et exécutée sans accidents graves ou imprévus, marche qui eût été impossible peut-être sans les hasards les plus heureux ou les fautes les plus inattendues de la part de l’ennemi ; cette seule marche avait coûté énormément cher ! Elle avait épuisé et démoralisé l’armée, au point qu’il lui avait fallu un plus long temps encore pour se remettre en haleine. Disons-le : en tant que stratégie, il y a là une opération militaire contestable ; et l’on est en droit de se demander si Hannibal lui-même a pu vraiment s’en targuer comme d’un succès. Pourtant ne nous hâtons pas d’infliger un blâme au grand capitaine. Nous voyons bien les lacunes du plan qu’il a exécuté, mais nous ne pouvons décider s’il aurait pu les prévoir. Sa route le menait, il est vrai, en pays barbare, inconnu ; mais oserions nous soutenir, encore une fois, qu’il aurait dû plutôt longer la côte, ou s’embarquer à Carthage ou à Carthagène ? Eût-il couru de moindres dangers de ce côté ? Quoi qu’il en soit de la route choisie, l’exécution dans les détails révèle la prudence consommée d’un maître : elle étonne à tous les instants ; et soit par la faveur de la fortune, soit par l’habileté même du général, le but final de l’entreprise, la grande pensée d’Hamilcar, la lutte avec Rome transportée en Italie, tout cela devenait aujourd’hui une réalité. Le génie du père avait enfanté le projet ; et de même que la mission de Stein et Scharnhorst a été plus difficile et plus grande peut-être que tous les exploits d’York et de Blücher, de même aussi l’histoire, avec le tact sûr et le souvenir des grandes choses, a mis en première ligne dans ses admirations le passage des Alpes, cet épisode final du grand drame héroïque des préparatifs d’Hamilcar ; elle loue même et glorifie ce haut fait plus encore que les victoires fameuses du lac Trasimène et de Cannes. |