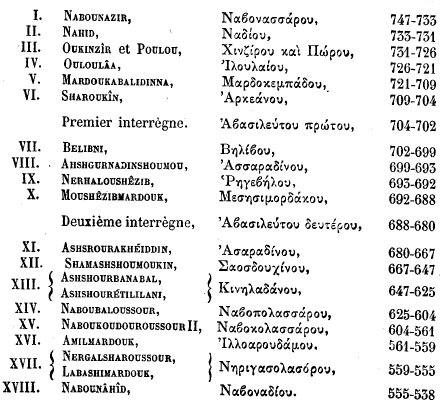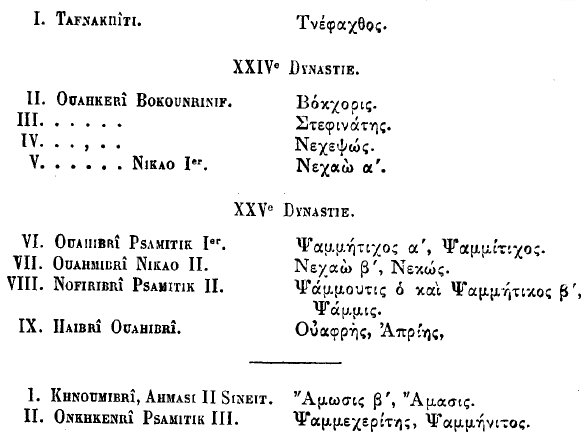|
Le monde oriental à l'avènement de Cyrus : Crésus et Nabonide ; conquête
de la Lydie
(546) ; les Perses dans l'extrême Orient (545-539) ; chute de l'empire
chaldéen (538).
Depuis le traité de 585, la paix n'avait pas été troublée
entre les deux grands États qui se partageaient l'Asie Mineure, la Médie et la Lydie. Chacun
d'eux, sûr de la neutralité de l'autre, avait concentré ses efforts contre
les régions où il comptait ne pas rencontrer de rivaux sérieux : la Médie contre les
pays de l'extrême Orient et contre Babylone, la Lydie contre les colonies
grecques et contre les nations indigènes de la péninsule. Alyatte n'avait
plus songé qu'à consolider sa situation, soit par des alliances de famille,
soit par la force des armes. Le mariage d'une de ses filles avec Mêlas
d'Ephèse lui assura dans cette ville l'appui d'une faction considérable[1]. Son fils Crésus,
qu'il avait eu d'une Carienne, reçut en apanage la Mysie Propontide[2], et son fils
Adramytios la Mysie
méridionale, où il bâtit la forteresse d'Adramytion[3] : la Bithynie elle-même fut
entamée[4]. Il employa les
dernières années de son règne à la construction d'un tombeau gigantesque, à
peine inférieur pour la masse aux édifices de l'Égypte et de Babylone[5]. Toutes les ressources
du royaume suffirent à peine à ce travail : il fallut suspendre les
guerres pour l'achever. Aussi Crésus eut-il quelque peine à faire prévaloir
ses droits à la couronne son frère Pantaléon, fils d'une Ionienne, lui
disputa longuement le pouvoir avec l'appui des mécontents[6]. Débarrassé de ce
rival incommode, il essaya de la politique pacifique et il s'ingénia à
enrichir les sanctuaires grecs, ceux de l'Europe comme ceux de l'Asie :
l'Apollon et l'Athénée de Delphes, l'Apollon de Didyme et celui de Thèbes
furent comblés de cadeaux. Une pitié aussi méritoire lui valut le droit de
cité grecque et aux Lydiens le privilège de siéger sur le premier rang dans
les Jeux Olympiques[7], mais les
habitants de la côte ionienne ne se crurent pas obligés pour cela de
sacrifier leur liberté. Alors Crésus renonça à la douceur et il déclara la
guerre aux villes qui lui fermaient l'issue des vallées du Caystre et de l'Hermos.
Ephèse succomba la première, malgré les relations personnelles du roi avec le
banquier Pamphaês[8],
malgré la présence aux affaires d'un de ses neveux, Pindaros, fils de
Mélas ; l'acropole fut démolie, et la population descendit dans la
plaine autour du temple d'Artémis. Smyrne éprouva le même sort, puis les villes
de moindre importance tombèrent l'une après l'autre. Crésus eut un moment la pensée
d'équiper une flotte et de s'emparer des Cyclades ; l'inexpérience des
Lydiens en matière de navigation le força de renoncer à ce projet[9]. Il se retourna
alors contre l'intérieur et il subjugua en quelques années les Maryandiniens,
les Thraces d'Asie, les Bithyniens, les gens de la Paphlagonie, les
tribus phrygiennes qui avaient échappé à ses prédécesseurs, la Lycaonie, la Pamphylie ; sauf la Lycie et la Cilicie, tous les pays
compris entre le Pont-Euxin, l'Halys et la Méditerranée
lui payèrent le tribut[10]. L'acquisition
de tant de provinces fertiles et industrieuses fit de lui un des souverains
les plus opulents, et la générosité avec laquelle il prodigua ses trésors
excita l'admiration des contemporains au plus haut degré[11]. Les Grecs lui
restituèrent en éloges et en reconnaissance ce qu'il leur donna en présents;
ils l'entourèrent d'un renom de richesse qui dure encore.
En apprenant la chute de l'empire mède, il se sentit assez
perplexe sur les conséquences que cet événement pouvait entraîner pour lui.
Les traités de 585 se trouvaient annulés du coup, et si, d'un côté, la Lydie perdait une alliance
qui avait aidé à sa grandeur en assurant sa sécurité, d'autre part, elle
rentrait en possession de sa liberté d'action et rien ne l'empêchait plus de
passer l'Halys. Le moment était d'ailleurs favorable à une attaque, tandis
que la puissance de Cyrus était mal établie encore et que les provinces
orientales de l'empire mède ne s'étaient pas ralliées à sa domination. Crésus
se résolut donc à la guerre et il se chercha des alliés au dehors. L'Égypte
accueillit d'autant mieux ses ambassadeurs qu'Amasis lui-même voyait dans
l'avènement des Perses un danger prochain pour son royaume. Une alliance offensive
et défensive fut conclue[12], â laquelle
Nabonide de Babylone et les Lacédémoniens adhérèrent bientôt[13]. En 545, le roi de Lydie était à la tête
d'une coalition qui aurait eu raison des Perses aisément, si son action avait
pu se produire d'ensemble ; par malheur, la trahison d'un chef de
mercenaires grecs révéla à Cyrus le danger qui le menaçait et précipita les
événements. La tradition lydienne prétendit saisir dans la chute de Crésus la
volonté expresse du destin trois
années durant Apollon fit échec à la fortune, mais le moment arriva où aucune
force divine ne put la contenir plus longtemps. Le roi s'était adressé aux
différents oracles de la
Grèce pour connaître l'avenir, et il avait reçu d'eux
plusieurs réponses ambiguës qu'il lui plut interpréter de la manière la plus
favorable à ses désirs ; on lui avait dit que, s'il attaquait les
Perses, il détruirait un grand empire, et que la suprématie de sa race
durerait jusqu'au jour où un mulet s'assiérait sur le trône de Médie[14]. Il crut que les
dieux lui promettaient la victoire et il ne songea plus qu'à porter la guerre
sur le territoire ennemi. Les rares documents qui nous sont parvenus prouvent
pourtant que, loin d'assumer l'offensive, il fut surpris par son adversaire.
A peine prévenu, Cyrus s'était mis en campagne ; il traversa sans autorisation
la partie nord de l'empire chaldéen et il déboucha en Cappadoce, mais là, il
se heurta aux avant-postes lydiens. Crésus, averti par des émissaires de Nabonide,
avait rassemblé ce qu'il avait de troupes disponibles, et, avant l'arrivée
des Perses, il avait envahi la
Cappadoce, au printemps de 546. Il s'y empara de Ptéria,
dont la citadelle commandait la route de Sinope, et il en dévasta les
environs comme pour interposer entre lui et l'ennemi une large bande de
désert. Cyrus, battu à la première rencontre, proposa une trêve de trois mois
que Crésus accepta pour donner à ses alliés le temps de le rejoindre. Cyrus
essaya de soulever une révolte sur les derrières de son adversaire et manda
des messagers aux Grecs d'Ionie pour les inviter à se joindre à lui. Ils refusèrent,
moins par amitié pour le Lydien que par crainte de la domination perse. A la
reprise des hostilités, la chance tourna et les Lydiens, pliant sous le nombre,
durent se replier derrière l'Halys après une journée de lutte acharnée :
Crésus se retira lentement, dévastant le pays sur son passage pour retarder
la poursuite. L'hiver était proche, il crut la campagne terminée, et il
licencia ses mercenaires ; il envoya à ses alliés de Grèce, de Chaldée
et d'Égypte l'intimation de se préparer pour une campagne offensive au printemps
suivant. Il avait compté que les Perses hiverneraient en Cappadoce :
mais Cyrus comprit que, s'il attendait quelques mois encore, sa cause serait
sinon perdue, au moins gravement compromise. Attaqué de front par les contingents
de la Lydie
et de Lacédémone, menacé en flanc et sur ses derrières par les Égyptiens et
par les Chaldéens, il serait contraint de reculer ou de diviser ses forces.
Il franchit donc l'Halys malgré l'hiver et il poussa droit vers Sardes.
Crésus rassembla à la hâte ce qu'il avait de troupes indigènes et offrit la
bataille. Même en ces circonstances défavorables, il aurait remporté la
victoire si sa cavalerie, la meilleure qui fût au monde, avait pu donner.
Mais Cyrus avait couvert le front de ses colonnes d'une ligne de chameaux ;
l'odeur en effraya tellement les chevaux lydiens qu'ils se débandèrent et
refusèrent de charger[15]. Une seconde défaite
sur les confins de la plaine de l'Hermos acheva de désorganiser la
résistance. Crésus se retrancha dans Sardes et dépêcha message sur message à ses
alliés, afin de hâter leur venue. La citadelle était bien défendue et passait
pour imprenable ; elle avait déjà repoussé un assaut et elle paraissait
disposée à tenir longtemps encore, lorsqu'un coup du hasard consomma sa ruine.
Un soldat de la garnison laissa tomber son casque du haut des murailles,
descendit le ramasser et remonta par le même chemin. Un aventurier marde,
nommé Hyrœadês, l'aperçut, escalada les rochers que les ingénieurs avaient négligé
de fortifier, les croyant inaccessibles, et pénétra avec quelques-uns de ses
compagnons dans le coeur de la place. Elle succomba après quatorze jours de
siège (546)[16].
La Lydie
hors de combat, la coalition se dénoua d'elle-même. Les Lacédémoniens restèrent
chez eux[17] ;
Amasis, que son éloignement protégeait encore, se garda de bouger; Nabonide
demeura sur la défensive. Si Crésus avait remporté la victoire, il n'aurait
pas changé sensiblement la face du monde. La Lydie était trop loin de l'Iran pour pouvoir
jamais établir sa domination sur la Médie de façon durable : Cyrus aurait
refait son armée plus ou moins vite, et il serait revenu à la charge jusqu'à
l'achèvement complet de ses projets. Son triomphe marqua une ère décisive
dans l'histoire. Tous les rois d'Orient, les grands comme les petits, comprirent
qu'ils étaient désormais à sa discrétion, et ils s'ingénièrent à éviter le
moindre sujet de querelle avec lui ; une campagne de quelques jours
avait détruit l'œuvre de trois années de négociations. L'affaissement soudain
de la monarchie lydienne frappa les Grecs de stupeur. C'était la première fois
qu'ils voyaient se jouer sous leurs yeux une de ces grandes tragédies dont
l'histoire du monde oriental est remplie. La dynastie de Gygès les avait
effrayés par sa vigueur, éblouis par son opulence, gagnés par ses largesses ;
ils l'avaient crue invincible et ils ne concevaient pas qu'elle eût péri par
un jeu de causes naturelles : ils imaginèrent que Crésus avait expié le
crime qui avait élevé Gygès au trône. Au moment où les Perses pénétraient
dans la citadelle, il avait fait ce que tant de monarques avaient fait avant
lui, Shamashshoumoukîn et Saracos à Babylone et à Ninive : il avait mis
le feu à son palais pour échapper au vainqueur. Le sacrifice s'accomplit-il
jusqu'au bout ? Il est probable, mais le peuple ne put se résigner à le
croire. Bacchylide affirmait dans une ode célèbre, qu'au moment où la flamme
montait, Apollon avait enlevé le prince qui avait si largement enrichi ses
autels et qu'il l'avait transporté chez les Hyperboréens[18]. La version d'Hérodote
est plus développée. Crésus, aux jours de sa grandeur, avait eu la visite de l'Athénien
Solon et il lui avait demandé qui était le plus heureux des hommes ?
Solon avait énuméré successivement Tellus d'Athènes, les Argiens Cleobis et
Biton, et, comme le roi se récriait, il lui avait déclaré qu'on ne peut juger
du bonheur d'un homme tant qu'il vit, car souvent le
dieu nous donne un éclair de prospérité et il nous plonge ensuite dans la
misère. Crésus ne comprit pas la sagesse de cet avis sur le moment ;
mais, bientôt après le départ de l'Athénien, son fils Atys fut tué à la
chasse par un de ses hôtes, et il n'était pas encore consolé de ce malheur
quand la prise de Sardes fit de lui un mendiant et un esclave. Il faillit
être tué dans la foule par un soldat perse qui ne le connaissait pas ;
un autre de ses fils, sourd et muet de naissance, vit le danger et en fut si
effrayé que la parole lui jaillit aux lèvres : Soldat,
cria-t-il, ne tue pas Crésus ! Crésus,
mené devant le vainqueur, fut condamné à mourir. Il était déjà sur le bûcher
quand les discours de Solon lui revinrent à l'esprit avec tant de force qu'il
s'écria par trois fois Solon ! Cyrus
l'interroge, apprend son histoire et lui accorde sa grâce. La flamme refusait
de s'éteindre, un orage amassé par Apollon éclate soudain et noie le bûcher
en quelques instants[19]. Bien traité par
Cyrus, le Lydien devint l'ami fidèle et le conseiller de son vainqueur, l'accompagna
désormais partout et lui fut utile en plus d'une circonstance. En passant l'Halys
il avait détruit un grand empire, mais cet empire était le sien. Le fils de
Cambyse le Perse et de la femme mède, le Mulet, comme l'avait appelé
l'oracle, retourna à Ecbatane après sa victoire et laissa à ses lieutenants
le soin de consommer l'annexion. Mazarès réprima une révolte de Sardes,
enleva l'une après l'autre les colonies grecques de la côte et mourut à la
peine. Son successeur, Harpage, acheva sa tâche et conquit la Lycie, qui avait résisté
aux Mermnades avec succès. Les gens de Phocée et de Téos s'expatrièrent, la
population entière de Xanthos se fit massacrer plutôt que de se rendre : le
reste se résigna à son sort et subit docilement la souveraineté des Perses[20].
Tandis qu'Harpage achevait la pacification de l'Asie Mineure,
Cyrus s'enfonçait dans les régions lointaines de l'extrême Orient. Nous
n'avons sur cette partie de son règne que des renseignements isolés et
presque sans valeur. S'il faut en croire Ctésias, la Bactriane fut frappée
la première. Ses habitants comptaient parmi les meilleurs soldats du monde,
et ils combattirent d'abord avec bonheur ; Ctésias affirme qu'ils
posèrent les armes en apprenant que Cyrus avait épousé une fille d'Astyage[21]. On ne voit pas
trop en quoi le mariage du conquérant avec une princesse mède pouvait exercer
quelque influence sur leur décision; Ctésias a dû reproduire une légende
reçue de son temps à la cour de Suse. L'annexion de Bactres entraînait celle
de la Margiane,
de l'Ouvarazmiya (Khorasmie[22]) et de la Sogdiane ; Cyrus y construisit plusieurs
places fortes, dont la plus célèbre, Cyropolis ou Cyreskhata, commandait un
des gués principaux du fleuve Iaxartès[23]. Les steppes de la Sibérie
arrêtèrent sa marche vers le nord, mais à l'est, dans les plaines de la Tartarie chinoise, les
Çakâ ou Saces, renommés pour leur bravoure et leur richesse, n'échappèrent
pas à son ambition. Il les assaillit, prit leur roi Amorgès et crut les avoir
réduits ; mais Sparêthra, femme d'Amorgès, rassembla ses derniers
fidèles, et repoussa les envahisseurs. Elle les aurait même contraints à lui
rendre son mari en échange des prisonniers qu'elle avait faits[24] : malgré sa
victoire, les Saces se déclarèrent tributaires[25], et ils formèrent
désormais l'avant-garde de l'empire contre les Nations de l'Est. En les
quittant, Cyrus remonta vers le sud sur le plateau de l'Iran et il parcourut
l'Haraïva (Arie), les Thatagous (Sattagydie), l'Haraouvati, le Zaranka, le
pays entre la rivière de Caboul et le fleuve Indus[26]. Eut-il le temps
de descendre au delà du lac Hamoun et parvint-il aux bords de la mer
Erythrée ? Une tradition d'époque postérieure prétendait qu'il avait
perdu son armée dans les déserts sans eau de la Gédrosie[27]. On ne saurait
avoir confiance dans ces récits : le fait seul de la conquête subsiste, les
détails en étaient oubliés depuis longtemps lorsqu'on s'avisa de les
recueillir.
Ces guerres l'occupèrent cinq ou six ans, de 545 à 539[28] ; dès le
retour, il se prépara à marcher contre la Chaldée. La
Chaldée avait l'apparence plus que la réalité d'un ennemi redoutable :
ses luttes incessantes contre l'Assyrie l'avaient usée peu à peu, l'effort
par lequel elle s'était délivrée et avait renversé sa rivale, les batailles
de Nabuchodorosor, les discordes de ses successeurs avaient achevé de
l'épuiser. La décadence était aussi prompte que l'élévation avait été
soudaine : moins de trente ans après la mort du conquérant, on pouvait
déjà prédire la chuté imminente de son oeuvre. Nabonide n'avait rien du héros
ni même du soldat : c'était un monarque indolent et paisible, occupé du
culte des dieux plutôt que de l'entretien des places et des armées. Dans les
premières années, il réprima quelques rébellions insignifiantes en Syrie[29] et il régla la
succession des rois de Tyr. Plus tard, quand la Médie se fut écroulée,
il voulut avoir sa part des dépouilles et il s'attribua la ville de Kharrân avec
le district environnant[30]. Là se bornèrent
ses exploits : il préféra employer à construire les ressources de son
royaume. Où il trouvait un édifice en ruines, il le réparait ou il le rebâtissait
entièrement : il recherchait dans les fondations les cylindres que le
roi dédicateur y avait enfouis pour perpétuer la mémoire de sa dévotion aux
dieux, et sa joie était vive lorsque les fouilles lui livraient le nom d'un
prince qui avait fleuri quelques centaines ou même quelques millier d'années
avant lui[31].
A Larsam, à Ourou, à Sippar, il restaura les monuments des vieux chefs chaldéens,
et le soin qu'il eut de ces villes et de leurs divinités excita des sentiments
de jalousie chez les prêtres de Babylone. Cependant Cyrus grandissait
toujours et les alliés de la Chaldée disparaissaient l'un après l'autre, la Médie d'abord, la Lydie ensuite : en
l'an XVII, les riverains de la Méditerranée
se soulevèrent et Nabonide ne fit rien pour les ramener à l'obéissance[32].
Les Juifs étaient trop faibles encore pour imiter
l'exemple que leurs anciens voisins leur donnaient : mais si leur
dispersion leur défendait d'agir efficacement, ils ne dissimulaient déjà plus
la joie dont l'isolement de Babel les comblait. La sentence d'exil lancée contre
eux par Nabuchodorosor n'avait pas été aussi générale qu'on le croit
d'ordinaire. La population des villes secondaires et des campagnes, ou bien
n'avait pas quitté ses foyers pendant la guerre, ou bien y était rentrée
aussitôt après, avec assez d'empressement pour que les Chaldéens ne fussent
pas obligés, comme les Assyriens lors de la chute de Samarie, à la renforcer
par des colonies d'étrangers. Jérusalem elle-même n'avait pas été transplantée
entière en Chaldée : beaucoup de ses habitants l'avaient abandonnée à
temps et s'étaient réfugiés en Égypte. Le nombre des déportés n'avait pas
dépassé peut-être vingt mille en trois fois[33], mais, à défaut
de la quantité, la qualité leur méritait d'être considérés comme la
représentation d'Israël entier. C'étaient d'abord les deux derniers rois, Joïakîn
et Zédékias, puis leur famille, l'aristocratie de Juda, le clergé du temple et
son grand prêtre, les prophètes[34]. Ils furent
répartis entre Babylone et les cités voisines. Les textes contemporains ne
nous signalent d'une manière précise qu'un seul de leurs établissements, celui
de Tel-Abîb, sur le Kébar[35], mais plusieurs
des colonies juives qui florissaient en ces régions vers l'époque romaine
prétendaient remonter jusqu'au temps de la captivité : une légende
recueillie dans le Talmud affirmait que la synagogue de Shafyâthib, prés de
Nehardaa, avait été bâtie par le roi Joïakîn avec des pierres arrachées aux
ruines du temple de Jérusalem[36]. Ces communautés
jouissaient d'une autonomie complète. Pourvu qu'elles acquittassent l'impôt
et les corvées réglementaires, elles étaient libres de pratiquer leur
religion et de s'administrer comme elles l'entendaient. Les cheikhs, les
anciens de la famille et de la tribu, qui avaient joué un rôle prépondérant
au pays d'origine, conservèrent leur rang[37] : le
Chaldéen les acceptait pour chefs de leur peuple et il ne les gênait aucunement
dans l'exercice de leur autorité. Comment les autres arrangèrent leur
existence, à quelles industries ils s'adonnèrent pour gagner le pain de
chaque jour, pour conquérir l'aisance et même la richesse, aucun de ceux qui
écrivaient alors n'a en souci de nous le dire[38]. Ouvriers ou
laboureurs, employés ou marchands, il fallait vivre, et l'on vécut, et, selon
le conseil de Jérémie[39], on travailla à
ne pas laisser perdre la semence d'Israël. Quelques siècles plus tard, on s’imaginait
volontiers que les exilés avaient été plongés tout entiers dans la pénitence
et dans l'inertie. Au bord des fleuves de Babel -
nous étions assis et nous pleurions, - en nous souvenant de Sion. Aux saules
de la campagne - nous avions suspendu nos lyres ; - car là nos ravisseurs
nous commandaient des paroles de chant, - nos oppresseurs des accents de
joie : - Chantez-nous des
cantiques de Sion ! Comment chanterions-nous le chant de Jahvé - sur
la terre étrangère ![40] Cela n'était
vrai que des prêtres et des scribes. Le vide s'était fait dans leur vie, du
jour que le conquérant les avait arrachés à cette routine de prières et de
rites minutieux dont l'accomplissement leur semblait être le privilège le
plus enviable auquel l'homme pût aspirer. Le temps qu'ils avaient consacré
jadis au service du temple ils le consumaient à se lamenter sur les malheurs
de la nation, â s'en accuser eux-mêmes et les autres, à se demander quel
crime leur avait mérité la ruine et pourquoi Jahvé, qui avait absous si
souvent leurs pères, n'avait pas étendu sa clémence jusque sur eux.
C'est dans la patience même de Dieu qu'Ézéchiel leur montrait
la cause de leur déchéance. Nourri dans le temple dès l'âge le plus tendre,
puis déporté en 597 avec Joïakîn, il avait médité sur l'histoire du passé et
elle lui était apparue comme un long conflit entre la justice divine et
l'iniquité juive. Jahvé s'était engagé envers la maison d'Israël du temps
qu'elle était encore en Égypte, et il ne lui avait réclamé qu'un peu de
fidélité en échange de sa protection : Jetez
chacun de vous les idoles de ses yeux et ne vous souillez pas avec les faux
dieux du pays d'Égypte ; moi, Jahvé, je suis votre Dieu !
Cette condition si douce, les enfants d'Israël ne l'avaient jamais observée
et c'était l'origine de leurs maux ; avant même d'échapper à Pharaon,
ils avaient trahi leur maître, et celui-ci avait songé à les accabler de sa
colère, mais j'agis par égard pour mon nom, pour
qu'il ne fût pas avili aux yeux des peuples au milieu desquels ils se
trouvaient, et en présence desquels je m'étais révélé à eux, et à l'effet de
les tirer d'Égypte. Je les tirai donc d'Égypte et les conduisis dans le désert.
Et je leur donnai mes préceptes et je leur promulguai mes commandements, que
l'homme doit pratiquer pour s'assurer la vie. Et de plus, je leur assignai
mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux. Mais ils furent rebelles à
mes ordres. Comme ils avaient fait en Égypte, ils firent au pied du Sinaï.
Cette fois encore Jahvé ne put se résoudre à les détruire ; il se borna
à décréter que nul d'entre eux n'entrerait dans la Terre Promise, et
il se retourna vers leurs fils. Mais les fils ne furent pas plus sages que
n’avaient été les pères ; à peine entrés dans la contrée qui leur était dévolue,
un pays de lait et de miel, le plus beau de tous les
pays, ils jetèrent les yeux sur toute colline élevée, sur tout arbre touffu,
ils y immolèrent leurs victimes, ils y déposèrent le parfum de leur encens, ils
y versèrent leurs libations. Et, non contents de profaner leurs autels
par des cérémonies et par des offrandes impies, ils s'inclinèrent devant des
idoles : Soyons comme les autres nations, comme
les peuples de tous les pays, adorons le bois et la pierre. – Par ma vie ! dit le Seigneur, l'Éternel ; d'une main puissante et le bras étendu, et déversant sur vous mon
courroux, je vous gouvernerai ![41] Si légitime que
fût le châtiment, Ezéchias ne croyait pas qu'il dût être perpétuel. Dieu est
trop juste pour rendre les générations futures responsables à jamais de la
faute des générations passées et présentes. Qu'avez-vous
donc, vous autres d'Israël, à répéter sans cesse : Les pères ont mangé du verjus, et les dents des fils en ont été agacées ?
- Par ma
vie ! dit le Seigneur
l'Éternel : ne répétez plus ce proverbe
en Israël ! Car voyez toutes les
personnes sont à moi, la personne du père et la personne du fils, mais c'est
la personne coupable qui mourra… Celui
qui est juste restera en vie, parole du Seigneur l'Éternel. Israël
est donc maître de ses destinées : s'il s'obstine en ses égarements, il
reculera d'autant l'heure du salut ; s'il se repent et s'il observe la
loi, la colère divine s'apaisera. Ainsi donc, maison
d'Israël, je vous jugerai chacun selon ses oeuvres. Jetez loin de vous tous
les péchés que vous avez commis ; faites-vous un coeur nouveau et un
nouvel esprit ! Pourquoi voudriez-vous mourir, maison d'Israël ?
Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt ! Revenez
donc et vivez ![42] Quelques-uns
objectaient qu'il était bien tard pour parler encore d'espoir et d'avenir :
Nos ossements sont desséchés, disaient-ils, notre confiance est minée ; nous sommes perdus.
Le prophète leur répondait que Dieu l'avait emmené en esprit au milieu d'une
plaine couverte d'ossements. Et je les adjurai, et
tandis que je les adjurais, voilà qu'avec fracas ils se rejoignirent les uns
les autres. Et quand je les regardai, je vis sur eux des nerfs, puis ils se
vêtirent de chair et la peau les enveloppa, mais il n'y avait pas encore de
souffle en eux. Alors Jahvé me dit : Évoque
le souffle, évoque, fils de l'homme, et crie au souffle : Voici ce que
dit le Seigneur, l'Éternel : Viens, souffle des quatre vents et souffle
dans ces cadavres pour qu'ils revivent. Et j'évoquai, comme j'en avais
reçu l'ordre, et le souffle entra en eux et ils revinrent à la vie et ils se
dressèrent sur leurs pieds, une grande, grande multitude ; alors il me
dit : Ces ossements-là c'est la
maison d'Israël… Voyez, je vais ouvrir vos tombeaux et vous en sortir, ô
mon peuple ! et je vous ramènerai dans la terre d'Israël… et je mettrai mon
souffle en vous, pour que vous reveniez à la vie, et je vous replacerai dans
votre patrie, afin que vous reconnaissiez que moi, Jahvé, je l'ai dit et fait[43].
Les prophètes d'autrefois n'avaient tracé de la
restauration d'Israël et de son bonheur que des descriptions poétiques où
rien n'était défini nettement, ni la loi qui le jugerait, ni le culte qu'il
pratiquerait, ni les conditions les plus propres à garantir sa prospérité. Jérémie
le premier avait désespéré de rien obtenir du peuple, sous le régime du pacte
conclu jadis en Égypte, et il avait proclamé la nécessité de négocier une
seconde convention, mais sans oser en indiquer les clauses[44]. Ézéchiel, plus
hardi, songea dès lors à fixer les termes de l'alliance nouvelle et à rédiger
la constitution qu'on devrait substituer à l'ancienne, le jour où l'exil
serait terminé. La royauté avait été essayée et elle n'avait pas produit de
résultats heureux : pour un monarque comme Ezéchias ou Josias, on en
avait eu dix comme Achaz et comme Manashshèh. Cependant les Juifs étaient
encore attachés si sincèrement à la forme de gouvernement monarchique, qu'il
jugea inopportun de la supprimer entièrement. Il se résigna à conserver un
roi, mais un roi plus pieux et moins indépendant que le prince rêvé par
l'auteur du Deutéronome, un serviteur des serviteurs de Dieu dont la fonction
principale se réduirait à subvenir aux besoins du culte. Jahvé était en
vérité le seul souverain qu'il acceptât pleinement. Mais le Jahvé qu'il
concevait n'était déjà plus celui que ses prédécesseurs avaient rêvé, le
seigneur Jahvé d'Amos, qui ne fait rien sans révéler
son secret aux prophètes, ses servants[45], ou celui d'Hoshéa
qui prend plaisir à l'amour et non aux sacrifices et
à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes[46]. Son Jahvé à lui
n'admet plus aucun commerce familier avec les interprètes de ses
volontés ; il tient le fils de l'homme à
distance, et il communique avec lui uniquement par l'intermédiaire des anges,
ses messagers. Sans doute l'affection de ses enfants lui est douce ;
mais il préfère leur respect et leur crainte, et l'odeur du sacrifice
légalement accompli est suave à ses narines. Le premier soin du prophète est
donc de lui dresser une maison neuve sur la montagne sainte. Ce temple de
Salomon où il avait passé les lointaines années de sa jeunesse, il le rebâtit
sur le même plan qu'autrefois, mais plus grand, mais plus beau ; la cour
extérieure d'abord, puis la cour intérieure et ses chambres, puis le
sanctuaire dont il calcule les dimensions au plus juste : dix coudées
d'ouverture pour la porte, cinq coudées de chaque côté pour les parois latérales
de la porte, vingt coudées de large et quarante de long pour la salle même,
et ainsi de suite avec un luxe de détails techniques souvent malaisé à
comprendre[47].
Et, comme il faut à un édifice aussi bien ordonné un clergé digne de l'habiter,
les fils de Sadok seuls auront rang de prêtres, parce que seuls ils ont gardé
une fidélité inébranlable ; les autres lévites se confineront dans les
emplois secondaires, car non seulement ils ont suivi les errements de la
nation, mais ils lui ont donné le mauvais exemple et ils ont pratiqué l'idolâtrie.
Les devoirs et les prérogatives de chacun, les revenus de l'autel, les sacrifices,
les fêtes, l'apprêt des banquets, tout est prévu et déterminé avec une
rigueur inexorable[48]. Ézéchiel était
prêtre et attaché aux manipulations les plus mesquines comme aux fonctions
les plus nobles de son métier : les moindres recettes de boucherie ou de
cuisine sa¬crée lui paraissaient aussi nécessaires que les préceptes de la morale
â la prospérité future de son peuple. La construction et le rituel une fois
mis sur pied, son imagination l'emportait de nouveau. Il se figurait voir une
source jaillir du seuil même de la maison divine, et, s'écoulant vers la mer
Morte à travers un grand bois, en assainir les eaux. Et
toutes sortes d'êtres animés qui se meuvent vivront partout où le ruisseau débouchera
dans la mer, et le poisson sera très nombreux… Et sur les bords du ruisseau, des deux côtés, croîtra toute espèce d'arbres
fruitiers, dont le feuillage ne se fanera pas et dont les fruits ne finiront
pas : ils en produiront de nouveaux tous les mois, parce que cette eau
sort du sanctuaire, et les fruits serviront de nourriture et les feuilles de médicaments[49]. Les douze
tribus d’Israël, même celles qui avaient disparu à diverses époques, se
partageront le pays d'une manière idéale, Dan au nord, Ruben et Juda au sud,
et elles fonderont à frais communs, autour de la montagne de Sion, la Jérusalem nouvelle
dont le nom sera désormais : Ici l'Éternel[50].
Ézéchiel n'exerça que peu d'influence sur ses
contemporains ; il resta seul ou presque seul de son avis, et les idées
exprimées par Jérémie l'emportèrent sur les siennes. Quelques-uns parmi les
exilés s'obstinèrent de plus en plus à adorer les divinités païennes ;
ils se fondirent probablement dans la masse de la population chaldéenne et
ils furent perdus pour Israël aussi complètement que l'avaient été les
déportés d'Ephraïm. Les autres, et c'était le grand nombre, restèrent fidèles
à leurs espérances et s'appliquèrent à démêler, parmi les événements qui se
déroulaient sous leurs yeux, les signes précurseurs de la délivrance annoncée
par le prophète. Veuille accroître ton peuple, ô Éternel,
- veuille accroître ton peuple et te glorifier, - veuille étendre la limite
de son pays ! - Éternel, dans la détresse ils ont regardé vers toi, -
ils se sont répandus en prières quand tu les châtias. - Comme une femme enceinte,
quand son terme approche, - se tord et crie dans ses douleurs, - ainsi nous
étions devant toi, Éternel ! … Va, mon
peuple, retire-toi dans ta chambre, - et ferme les portes derrière toi !
- Cache-toi un petit instant, - jusqu'à ce que le courroux soit passé. - Car
bientôt l'Éternel va sortir de son lieu, - pour demander compte de ses crimes
à l'habitant de la terre, - et la terre découvrira le sang versé - et ne cachera
plus le corps des victimes[51]. La mort de
Nabuchonorosor en 562 amena un changement dans leur condition. Evilmérodach
tira leur roi Joïakîn de la prison où il languissait depuis trente années, et
le traita avec honneur[52] ; ce n'était
pas encore la restauration désirée, mais c'était du moins la fin de la
persécution. Puis vinrent les querelles de palais qui, en moins de huit ans,
changèrent quatre fois de mains le sceptre de Nabuchodorosor, puis
l'avènement du pacifique et dévot Nabonide, puis les premières victoires de
Cyrus. Rien n'échappait à l'oeil vigilant des exilés, et leurs prophètes commencèrent
à déclarer que les temps étaient proches, à parler de l'humiliation de Babylone,
à en prédire la date. L'un, dont l'oeuvre a été classée avec les écrits de
Jérémie, aperçoit les peuples du Nord et de l'Est en marche contre la cité
condamnée. Sonnez le clairon parmi les nations,
appelez les peuples à inaugurer la guerre, convoquez contre elle les royaumes
d'Ararat, de Minni et d'Ashkouz ; rangez contre elle les bataillons, lancez
la cavalerie comme un essaim de sauterelles aux ailes droites ! Appelez
les peuples à inaugurer la guerre contre elle, les rois de Médie, les
capitaines et leurs satrapes, et tout le pays de leur domination. La terre
tremble, elle est en travail, car ils vont s'accomplir les desseins de l'Éternel
de changer Babel en un désert sans habitants[53]. Un autre voit
déjà l'oppresseur mort et descendu aux
enfers : L'enfer dans ses profondeurs
s'émeut pour toi, - à ton arrivée il excite les ombres ; - il fait lever
de leurs sièges tous les princes de la terre, - tous les rois des nations. -
Tous ils élèvent leur voix - et te disent : Toi aussi tu t'es donc évanoui comme nous, - Tu es devenu notre
égal ! - Et toi tu te disais en ton
cœur : Je monterai au ciel ;
- au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône ; - je serai l'égal
du Très-haut ! Ha ! c'est dans l'enfer que tu seras précipité, - au
fond du sépulcre ! - Ceux qui t'y verront te contempleront, - jetteront
sur toi un regard curieux : - Est-ce là l'homme qui ébranla la terre, -
qui fit trembler les empires, - qui changea le monde en un désert, dévasta
les villes - et ne relâcha pas les captifs ? - Tous les rois des
peuples reposent avec honneur - chacun dans son mausolée : - mais toi, tu es
jeté loin de ton sépulcre, - comme une branche vile, - sous un linceul de
morts égorgés par l'épée, qui descendront dans leurs tombes maçonnées, - toi,
cadavre foulé aux pieds - tu ne seras point réuni avec eux dans la tombe, -
désolateur de ton pays, - bourreau de ton peuple[54].
L'écho de ces malédictions n'arrivait pas jusqu'aux
oreilles de Nabonide, mais il comprenait la grandeur du péril qui le menaçait
et il tâchait de le conjurer. Ce n'était pas une fantaisie d'archéologue qui
le poussait à relever les temples détruits, à restaurer de vieux cultes
oubliés dés longtemps ; il voulait détourner de sa personne et de son
royaume la colère des dieux ennemis et se concilier la bonne volonté des
nationaux. Cette affectation de piété envers des divinités qui n'étaient pas
de Babylone mécontenta le sacerdoce babylonien : lorsque les Perses
parurent sur la frontière en 538, non seulement les captifs internés en
Chaldée, mais une partie de la population indigène appelait de ses voeux la
présence de l'étranger. Nabonide recourut aux grands moyens : il ordonna
des sacrifices à Bel, en expiation des péchés du peuple, et il transféra dans
la capitale les dieux les plus vénérés, Zamalmal et les maîtres de Kis,
Bêltis et les seigneurs de Kharsagkalama, les divinités d'Akkad qui sont au-dessus et au-dessous de l'atmosphère.
Cyrus ne fut pas intimidé par l'arrivée de cette garnison d'idoles : il
eut raison de ses adversaires en quelques semaines. Au commencement du mois
de Tammouz, il avait franchi le Tigre et battu les Chaldéens près de la ville
de Routoum. Aussitôt une révolte éclata en Akkad qui enleva à Nabonide ses
dernières ressources. Le 14, les Perses entrèrent paisiblement dans Sippar ;
le 16, Gobryas qui les commandait s'empara de Babylone presque sans coup
férir. Nabonide, livré par les siens, fut traité avec bienveillance et exilé
en Carmanie. Son fils aîné Belsharousour, le Balthazar des Hébreux, tenta un
effort suprême pour repousser l'invasion : il fut battu par Gobryas le
14 de Marchesvân, et il périt dans la déroute[55].
L'empire entier tomba du même coup et sans secousse aux
mains des Perses. Les peuples tributaires, Syriens, Arabes, Phéniciens,
perdirent leurs anciens maîtres et en gagnèrent de nouveaux, sans plus
s'inquiéter du changement que s'il ne se fût pas agi d'eux et de leurs
intérêts ; du moment qu'ils ne pouvaient plus être libres, peu leur
importait qui régnait. Babylone elle-même parut s'accommoder de sa servitude,
et les partis qui avaient été hostiles à Nabonide se réjouirent de sa
captivité. Cyrus fit d'ailleurs ce qui était nécessaire pour s'assurer leur
bon vouloir : comme ses prédécesseurs assyriens, Tiglatphalasar, Sargon,
Asarhaddon, Assourbanabal, il se plia aux exigences de leur orgueil, et,
saisissant les mains de Bel, il se proclama formellement roi de Babylone. Son
premier soin fut de renvoyer chacun dans sa ville les dieux que Nabonide y
avait appelés au début de la campagne, et cette satisfaction accordée aux
âmes dévotes que leur présence avait blessées acheva de les gagner au
vainqueur[56].
ils présentèrent les événements sous le jour le plus favorable à la vanité
nationale, Mardouk dirent-ils, s'était irrité de l'abandon où Nabonide
l'avait laissé ; le roi des dieux s'était
affligé profondément de cette humiliation et tous les dieux qui habitent les
temples de Babel avaient abandonné leurs sanctuaires ; on ne voyait plus
Mardouk et les divinités ses alliés aux processions de Kalanna, car ils
s'étaient réfugiés chez d'autres cités qui ne leur refusaient pas leur respect.
Cependant la race de Shoumir et d'Akkad, tout en deuil, le pria de revenir ;
il accéda à leur requête, et contenta le pays en lui choisissant un roi qui gouvernât selon son vouloir le peuple
qui lui serait confié ! Il proclama Kouroush, d'Anshân, roi du monde entier
et il annonça ce titre à toutes les nations… Il
l'incita à marcher contre Babel sa propre ville, et conduisit l'armée perse
comme un ami et comme un bienfaiteur : ses troupes, dont le nombre ne se
peut non plus compter que celui des flots de l'Euphrate, et leurs épées ne
furent qu'un vain ornement, car il les conduisit sans combat et sans résistance
jusqu'à Kalanna, puis cerna et conquit sa propre cité. Nabonide, le roi qui
l'avait méprisé, il le livra dans les mains de Kouroush. Tout le peuple de Babel,
beaucoup parmi ceux de Shoumir et d'Akkad, les nobles et les prêtres s'étaient
soulevés contre lui et s'étaient refusés de lui baiser plus longtemps les pieds :
ils se réjouirent de leur nouveau maître et changèrent leur serment de féauté,
car le dieu qui ramène les morts à la vie, et qui est secourable dans tout
malheur et dans toute angoisse, lui avait accordé toute sa faveur[57].
Les Chaldéens n'étaient pas seuls à voir dans le Perse un
envoyé de Dieu ; plus qu'eux encore, les Juifs étaient disposés à lui
prêter ce caractère. La manière dont Babylone avait succombé avait trompé
leurs espérances et démenti les prédictions de leurs prophètes : la cité
de Nabuchodorosor n’avait pas été effacée de la face du monde comme celle de Sargon
et de Sennachérib, et la vengeance de Jérusalem était moins complète que
celle de Samarie ne l'avait été. Mais, déçus en cela, ils sentaient que la
délivrance était proche, et l'un des plus grands parmi leurs poètes, l'un de ceux
dont les oeuvres ont été transcrites à la suite de celles d'Isaïe,
l'annonçait déjà en termes magnifiques : Réjouissez-vous,
cieux, car l'Éternel l'accomplit ; poussez des cris, profondeurs de la terre !
Montagnes, éclatez de joie, et toi, forêt avec tous les arbres ! - Car
l'Éternel rachète Jacob, en Israël il manifeste sa gloire. Voici ce que dit
l'Éternel, ton rédempteur, qui t'a formé lors de ta naissance : Moi je suis
l'Éternel, créateur de l'Univers ; - moi seul je déploie les cieux, -
j'affermis la terre - qui est avec moi ? … - C'est moi qui confirme la parole
de mon serviteur, - qui ratifie le conseil de mes messagers, - qui dit de
Jérusalem, qu'elle soit habitée, - et des villes de Juda, quelles soient
rebâties : - Je veux relever leurs ruines ! - C'est moi qui dis à
l'Océan : Dessèche-toi ; - je veux que tes courants tarissent !
- Je dis à Koresh : Tu es mon berger ! - et il accomplira toute ma
volonté, - en disant à Jérusalem : Sois
rebâtie ! - et au temple : Sois
fondé ![58] Dès la première
année de son séjour à Babylone, Cyrus promulgua l'édit par lequel il
permettait aux Juifs de rentrer au pays de leurs pères. Tous ne profitèrent pas
de la faculté qui leur était accordée ; s'il faut en croire la tradition,
quarante-deux mille trois cent soixante se déclarèrent prêts à quitter la
terre de l'exil, sous la conduite d'un descendant de David, un fils du roi
Joakîn, du nom de Shesbazzar. Ils s'établirent dans les petites villes de
Juda et de Benjamin, et la réalité répondit si peu à l'idéal qu'ils s'étaient
tracé de ce retour, qu'ils laissèrent écouler sept mois avant de déblayer le
site du temple pour y élever un autel des sacrifices. Leur petite colonie, noyée
dans un flot de populations hostiles, Philistins, Iduméens, Moabites, Ammonites,
Samaritains, se serra autour du gouverneur perse, qui seul pouvait la
protéger et lui témoigna une fidélité inébranlable. C'était bien sur quoi
Cyrus comptait lorsqu'il les autorisait à regagner leurs montagnes : ils
formèrent à cette extrémité de son empire une marche d'autant plus dévouée à
ses intérêts que leur existence même dépendait de leur fidélité[59].
De tous les princes qui s'étaient alliés contre la Perse, un seul, Amasis,
avait jusqu'alors esquivé le châtiment. Une guerre contre l'Égypte semblait
donc être imminente : Cyrus hésita un instant, puis il se rejeta vers
l'Est lointain, et il y disparut d'une manière mystérieuse (529). Au dire de
Xénophon, il mourut dans son lit, entouré de ses enfants, édifiant ceux qui
l'approchaient par la sagesse plus qu'humaine de ses derniers moments[60] ; ce
tableau n'est pas plus authentique que ne le sont en général les
renseignements fournis par Xénophon sur la Perse. Ctésias
contait qu'il avait été blessé dans un engagement contre les Derbikes, peuple
à moitié sauvage de la
Bactriane, et qu'il avait succombé aux suites de sa
blessure, trois jours après la bataille[61]. Selon Hérodote,
il demanda en mariage Tomyris, reine des Massagètes, et il fut dédaigné. De
dépit il franchit le fleuve Araxès[62], battit les
barbares et prit le fils de leur reine, Spargapisès, qui se tua de désespoir.
Tomyris, ayant rassemblé ses forces, attaqua les
Perses. De toutes les batailles livrées entre barbares, celle-là me paraît
avoir été la plus sanglante, à en juger du moins par ce que j'ai ouï dire.
D'abord ils se criblèrent de flèches à courte distance ; quand les
flèches leur manquèrent, ils tombèrent les uns sur les autres à coups de
piques et de sabres. Ils soutinrent la lutte pendant longtemps sans qu'aucun
parti voulût fuir : à la fin les Massagètes eurent le dessus. La plus
grande partie de l'armée perse resta sur le champ de bataille ; Cyrus
lui-même y périt après un règne de vingt-neuf ans. Tomyris, ayant rempli une
outre de sang humain, ordonna qu'on cherchât parmi les morts le cadavre de
Cyrus : dès qu'on l'eut trouvé, elle lui plongea la tête dans l'outre et
elle l'accabla d'injures. Bien que je
vive et que je sois victorieuse, tu m'as perdue en m'enlevant mon fils par
ruse : aussi moi te rassasierai-je de sang[63]. Les Perses
parvinrent à recouvrer le corps de leur roi ; ils le transportèrent à
Pasargades, où ils l'ensevelirent somptueusement dans les jardins de son
palais[64].
La poésie populaire, qui avait défiguré sa vie et
substitué des histoires fabuleuses au récit véritable de ses actions,
s'attacha à faire de lui le portrait idéal d'un prince d'Orient : il
devint grâce à elle le plus brave, le plus doux, même le plus beau des
hommes. En fait, il paraît avoir eu toutes les qualités d'un général,
l'activité, l'énergie, la bravoure, l'astuce et la duplicité si nécessaires
en Asie au succès de la conquête : large et tolérant pour les religions étrangères,
il n'eut pas les vertus d'un administrateur, et il ne se soucia pas de réunir
en un seul corps constitué solidement les peuples divers qu'il avait su
ranger sous sa loi. En Lydie et en Chaldée seulement il installa un
gouverneur perse : partout ailleurs il se contenta d'une déclaration
d'obéissance et il confia le gouvernement aux mains des indigènes. Il avait
conquis tous les pays du vieux monde, l'Égypte exceptée, et fondé l'empire
perse : il laissait le soin de l'organiser à ceux qui viendraient après
lui[65].
Cambyse, Amasis et Psammétique III ; conquête de l'Égypte
(525) ; tentatives sur la
Libye et l'Éthiopie ; le faux Smerdis.
Cyrus avait légué la couronne à l'aîné de ses enfants,
Kambouzia II, que les Grecs appelèrent Kambysès, et le commandement de
plusieurs provinces à Bardiya (Smerdis),
son second fils[66].
Réglant sa succession par avance ; il s'était flatté de prévenir les querelles
qui accompagnent d'ordinaire un changement de règne en Orient. Son voeu ne
fut pas exaucé : Cambyse, à peine assis sur le trône, égorgea son frère.
Le crime fut commis avec tant de prudence et de secret qu'il passa inaperçu
du vulgaire : le peuple et la cour crurent que Bardiya avait été enfermé
dans quelque palais éloigné de la Médie, et ils s'attendirent à le voir
reparaître bientôt[67].
Après s'être débarrassé d'un rival qui menaçait de devenir
dangereux, Cambyse ne songea plus qu'à la guerre. L'Égypte, protégée par le
désert et par les marais du Delta, bravait encore la puissance des Perses.
Depuis son alliance malheureuse avec la Lydie, Amasis s'était toujours conduit de
manière à ne fournir aucun prétexte de guerre à ses voisins. Il se borna à
rétablir en Chypre l'antique suzeraineté de l'Égypte[68] et il n'éleva
pas plus haut son ambition. Grâce à sa prudence inaltérable, il évita tout
conflit avec Cyrus, et il profita des années de tranquillité qui lui furent
accordées pour développer les ressources naturelles de son royaume. Le réseau
des canaux fut réparé et agrandi, l'agriculture encouragée, le commerce
étendu. On dit que l'Égypte ne fut jamais plus florissante
ni plus heureuse, que jamais Je fleuve ne fut aussi bienfaisant pour la
terre, ni la terre aussi féconde pour les hommes, et qu'on y comptait alors
vingt mille villes habitées[69]. Les carrières
de Troiou[70],
de Souan[71]
et de Rahanou[72]
furent rouvertes et exploitées comme aux plus beaux jours. Thèbes, à demi
indépendante, sous l'administration de la reine Onkhnas[73], fille de
Psammétique II, reprit quelque animation sur ses deux rives ; les monuments
de Karnak furent restaurés avec soin, et quelques riches particuliers se
creusèrent des tombeaux qui ne le cèdent en rien aux tombes d'autrefois pour
l'étendue et pour le fini des bas-reliefs[74]. Le reste de la
haute Égypte était déjà trop dépeuplé pour qu'il y eût intérêt à en embellir
les cités; les forces vives du pays se concentrèrent sur Memphis et sur les
villes du Delta. A Memphis, Amasis bâtit un temple d'Isis qu'Hérodote
qualifie de très grand et très digne d'être vu ;
ce temple a disparu malheureusement, ainsi que le colosse couché de
soixante-quinze pieds de long que le même prince avait consacré devant le
temple de Phtah[75].
Il décora Bouto, Sébennytos, Mendés, Tanis, la plupart des localités même secondaires.
Il construisit, à Saïs, dans le temple de Neith, des propylées « qui
surpassaient beaucoup les autres ouvrages de ce genre, tant par leur élévation
et leur grandeur que par la grosseur et la qualité des matériaux ». Ils
étaient ornés de colonnes énormes et précédés d'une longue avenue de sphinx.
On y admirait deux obélisques gigantesques, une statue couchée, en tout semblable
à celle de Memphis, et une chapelle monolithe en granit rose que le roi y
avait amenée des carrières d'Abou. Deux mille bateliers avaient été occupés
pendant trois ans à la transporter. Elle avait â l'extérieur environ onze
mètres de hauteur, sept mètres trente-huit centimètres de profondeur et
quatre mètres de largeur ; évidée à l'intérieur, elle pesait encore prés
de cinq cent mille kilogrammes. Elle n'arriva jamais au fond du sanctuaire. On conte que l'architecte, au moment même où elle
atteignit son site actuel, poussa un soupir, songeant au temps qu'avait exigé
le transport, et lassé par ce rude labeur. Amasis entendit le soupir et, le
tenant à présage, point ne voulut qu’on menât plus loin la pierre. D'autres
disent toutefois qu'un des ouvriers employés à la manoeuvre fut écrasé et tué
par la masse et que ce fut la raison véritable pour quoi on la quitta à l'endroit
où elle est maintenant[76].
La révolution qui avait porté Amasis au trône avait été
suscitée par le parti national égyptien contre les étrangers. Les mercenaires
et les marchands grecs s'étaient prononcés en faveur d'Apriès contre son
rival : on pouvait craindre que celui-ci, une fois vainqueur, ne les
chassât de son royaume. Il n'en fut rien : Amasis roi oublia les injures
d'Amasis prétendant à la couronne. Ses prédécesseurs avaient bien accueilli
les Grecs ; lui, les aima passionnément[77], et il se fit
aussi Grec qu'il était possible à un Egyptien de le devenir. Il resta en bons
rapports avec les Doriens de Cyrène : une fois même il intervint comme
arbitre dans leurs affaires domestiques. Le Battos, qui avait triomphé si facilement
des soldats d'Apriès, avait eu pour successeur Arkésilas. Des querelles de
palais, compliquées d'une guerre contre les tribus libyennes où il avait eu
le dessous, indisposèrent contre lui les Égyptiens qu'il avait à sa
solde : son frère Laarchos l'assassina et le remplaça avec l'approbation
des mercenaires, puis il fut tué à son tour par Éryxo et par Polyarchos,
femme et beau-frère de sa victime. Les partisans de Laarchos s'adressèrent au
Pharaon, et celui-ci se préparait à les appuyer de son armée quand la mort de
sa mère arrêta les préparatifs. Polyarchos accourut en Égypte pendant la durée
du deuil royal, et il plaida si bien sa cause qu'il la gagna : Battos le
Boiteux, fils d'Arkésilas et d'Éryxo, fut proclamé par son puissant voisin[78]. Plus tard même
une alliance plus intime resserra les liens qui unissaient les deux États :
moitié politique, moitié caprice, Amasis épousa une femme de Cyrène, Ladikê,
fille, selon les uns, d'Arkésilas ou de Battos, selon les autres, d'un riche
particulier nommé Critoboulos[79].
Les Grecs d'Europe et d'Asie n'eurent pas moins à se louer
de lui que leurs frères d'Afrique : il noua des relations amicales avec
les principaux sanctuaires de l'Hellade et il leur octroya à plusieurs
reprises des présents magnifiques. En 548 le temple de Delphes brûla, et les
Alcméonides s'engagèrent à le rebâtir moyennant trois cents talents, dont un
quart fourni par les Delphiens. Ceux-ci, trop pauvres pour se procurer une
somme aussi forte, quêtèrent chez toutes les nations amies : Amasis leur
donna pour sa part mille talents d'alun d'Égypte, le plus estimé de tous.
L'alun était employé en teinture et coûtait fort cher : les Delphiens en
tirèrent bon parti[80]. Il envoya à Cyrène
une statue de sa femme Ladikê et une statue de Neith, dorée
complètement ; à Lindos pour la Minerve, deux statues de pierre et une cuirasse
de lin d'une finesse merveilleuse[81] ; à Samos
et à sa Junon deux statues en bois qui existaient encore au temps d'Hérodote[82].

Le site
actuel de Naucratis[83]
Aussi les Grecs affluèrent en Égypte et s'y établirent en
si grand nombre que, pour éviter toute querelle avec les indigènes, on dut
bientôt régler leur position à nouveau. Les colonies fondées le long de la
branche Pélusiaque par les Ioniens et par les Cariens de Psammétique 1er
avaient prospéré et possédaient déjà une population qu'on peut évaluer à près
de deux cent mille âmes[84] : Amasis la
transféra à Memphis ou dans les environs pour se garder contre ses sujets
égyptiens[85].
Les colons plus récents furent dirigés vers la bouche Canopique sur la petite
ville de Pamaraïtî, qui prit le nom de Naucratis et qu'on leur abandonna
complètement[86].
Ils y constituèrent une république gouvernée par des magistrats indépendants,
prostates ou timouques[87] ; on y
voyait un Prytanée, des Dionysiaques, des fêtes d'Apollon Komæos, des
distributions de vin et d'huile, le culte et les moeurs de la Grèce[88]. Ce fut désormais
le seul port ouvert aux étrangers. Lorsqu'un navire marchand poursuivi par
des pirates, assailli par la tempête ou contraint par quelque accident de
mer, abordait sur un autre point de la côte, le capitaine était tenu de se présenter
devant le magistrat le plus proche, afin d'y jurer qu'il n'avait pas violé la
loi de son plein gré, mais forcé par des motifs impérieux. Si l'excuse
paraissait plausible, on l'autorisait à gagner la bouche Canopique ;
quand les vents ou l'état de la mer s'opposaient à ce qu'il partît, on
embarquait la cargaison sur des bateaux du pays et on la transportait en
territoire grec par les canaux du Delta[89]. Cette
disposition de la loi fit la fortune de Naucratis: le commerce entier du Nil
s'écoula par ses marchés, et elle devint en quelques années un des entrepôts
les plus considérables du monde ancien. Les Grecs de tous pays la remplirent
et ils ne tardèrent pas à déborder sur les campagnes environnantes, qu'ils
semèrent de villas et de bourgs. Les marchands qui consentaient à ne pas
vivre sous la protection hellénique furent autorisés à s'établir dans telle
ville d'Égypte qu'il leur plairait choisir et à s'y bâtir des factoreries.
Amasis leur concéda même le libre exercice de leur culte : les Éginètes
avaient le sanctuaire de Zeus, les Samiens celui de Héra, les Milésiens celui
d'Apollon, et neuf villes d'Asie Mineure s'entendirent pour édifier à frais
communs un temple et un enclos sacré qu'elles nommèrent l'Hellénion[90]. La Haute Égypte et le désert
ne furent pas à l'abri de cette invasion pacifique. Les négociants de
Naucratis sentirent de bonne heure la nécessité d'avoir des agents sur la
route des caravanes qui viennent de l'intérieur de l'Afrique : des
Milésiens ouvrirent leurs comptoirs dans l'antique cité d'Abydos[91], et les Samiens
de la tribu Æskhrionie avaient poussé jusque dans la Grande Oasis[92]. Les Grecs
rapportaient de ces régions lointaines des récits merveilleux qui piquaient
la curiosité de leurs compatriotes et des richesses qui stimulaient leur cupidité
: philosophes, marchands, soldats, s’embarquaient pour le pays des
merveilles, â la recherche de la science, de la fortune ou des aventures.
Amasis, qui craignait toujours une attaque des Perses, accueillait les
immigrants à bras ouverts : ceux qui restaient s'attachaient à sa
personne, ceux qui partaient emportaient avec eux le souvenir des bons traitements
qu'ils avaient reçus et ils préparaient en
Grèce les alliances dont l'Égypte craignait d'avoir besoin dans
quelques années au plus tard.
Tout cela était sagement conçu, mais les Égyptiens de
vieille souche ne savaient aucun gré à leur roi de sa prévoyance. Comme les
Juifs depuis Ezéchias, comme les Babyloniens sous Nabonide, comme la plupart
des peuples de race antique qui se sentent menacés par la ruine, ils attribuaient
leur faiblesse, non pas à leurs propres fautes, mais à la fatalité d'en haut.
Les faveurs qu'Amasis prodiguait aux étrangers leur parurent un sacrilège
véritable. Les Grecs n'introduisaient-ils pas leurs dieux avec eux ? Ne
trouvait-on pas dans les villes et dans les campagnes des gens qui
associaient le culte de ces divinités barbares à celui des divinités
nationales ? Le roi n'avait-il pas ordonné qu'on payât la solde et
l'entretien des mercenaires sur les biens des temples, à Sais, à On, à
Bubaste, à Memphis[93] ? La haine
qui s'était amassée contre lui ne se manifesta point par des actes ou par des
révoltes : elle le calomnia sourdement et elle dénatura son caractère.
Mille histoires malignes ou plaisantes coururent sur son compte, et se
perpétuèrent pendant les siècles suivants. On raconta qu'avant son avènement
il aimait fort à boire et à mener grande chère, qu'il avait souffert souvent
du mal qui a nom faute d'argent, mais qu'il avait réussi toujours à se
procurer ce qui lui manquait par divers moyens dont
le plus honnête était par larcin furtivement fait[94]. On affirma que,
devenu roi, il s'enivrait encore de brandevin au point de ne plus être en
état de vaquer aux affaires publiques[95]. A ces légendes
et à bien d'autres non moins mensongères, ses partisans en opposaient qui
étaient toutes en son honneur. D'un bassin d'or dans lequel lui et les siens
se lavaient les pieds chaque jour, il avait tiré une statue divine à laquelle
les gens vinrent rendre hommage, et ceux-là même qui lui reprochaient la
bassesse de son origine. Sur quoi il convoqua le peuple, lui exposa que leur
vénération s'adressait à une ancienne cuvette, puis ajouta : Il en est de moi ce qui en est d'elle : encore que je
fusse jadis petit compagnon, aujourd'hui je suis votre roi et j'entends que
vous m'honoriez tel que de raison[96]. Quoi qu'on pût
dire, ce furent les sentiments de haine qui l'emportèrent dans l'esprit des
indigènes.
Cyrus mort, Amasis se résigna à la guerre. Les motifs
sérieux ne manquaient pas contre lui : il s'était allié à la Lydie, il avait intrigué
avec la Chaldée ;
Cambyse d'ailleurs était jeune et plutôt disposé à exciter qu'à refréner
l'ardeur belliqueuse de ses compatriotes. L’imagination populaire ne se
contesta pas des raisons très naturelles qui avaient produit le choc de la
plus jeune et de la plus vieille des nations orientales : elle chercha à
tout expliquer par des motifs personnels aux principaux acteurs du drame. Au
dire des Perses, Cambyse demanda en mariage la fille du vieux roi dans
l'espoir qu'on la lui refuserait et qu'il aurait une injure à venger :
Amasis substitua Nitêtis[97], fille d'Apriès,
à sa propre fille. Quelque temps après, Cambyse, se
trouvant avec elle, l'appela par le nom de son prétendu père. Sur quoi elle
dit : Je vois, ô roi, que tu ne
soupçonnes pas combien tu as été trompé par Amasis : il m'a prise et, me
couvrant de parures, m'a envoyée à toi comme étant sa propre fille. De vrai,
je suis l'enfant d'Apriès, qui était son seigneur et maître jusqu'au jour
qu'il se révolta et, de concert avec les Égyptiens, le mit à mort. Ce
discours et le motif de querelle qu'il renfermait soulevèrent la colère de
Cambyse, fils de Cyrus, et attirèrent ses armes sur l'Égypte[98]. En Égypte, on
contait les choses autrement. Nitêtis avait été envoyée à Cyrus et elle lui
avait donné Cambyse[99] : la
conquête n'avait été qu'une revendication de la famille légitime contre
l'usurpateur Amasis, et Cambyse montait sur le trône moins en vainqueur qu'en
petit-fils d'Apriès. C'est par une fiction aussi puérile que les Égyptiens de
la décadence se consolaient de leur faiblesse et de leur boute. Toujours
orgueilleux de leur gloire passée, mais désormais incapables de vaincre, ils
n'en prétendaient pas moins n'être vaincus et commandés que par eux-mêmes. Ce
n'était plus la Perse
qui imposait son roi à l'Égypte : c'était l'Égypte qui prêtait le sien à
la Perse et
par la Perse
au reste du monde.
Depuis longtemps le désert et les marais constituaient le
véritable boulevard du Delta contre les attaques des princes asiatiques.
Entre le dernier château important de la Syrie, Jénysos[100], et le lac de
Serbon, où les avant-postes égyptiens campaient, il y a près de quatre-vingt-dix
kilomètres d'intervalle, qu'une armée ne pouvait parcourir en moins de trois
jours[101].
Dans les siècles passés, le désert avait été moins étendu : mais les ravages
des Assyriens et des Chaldéens avaient changé la face du pays et transformé
en une solitude des régions jadis assez populeuses. Un événement imprévu tira
Cambyse d'embarras. Phanès d'Halicarnasse, un des généraux grecs d'Amasis,
déserta et se réfugia en Perse. Il avait du jugement, de l'énergie, une
profonde connaissance du théâtre futur de la guerre. Il conseilla au roi de
s'entendre avec le cheikh qui dominait sur la côte et de lui demander un
sauf-conduit ; l'Arabe disposa le long de la route des relais de
chameaux chargés d'eau en quantité suffisante pour les besoins d'une armée[102].
En arrivant devant Péluse, les Perses apprirent qu'Amasis
était mort[103]
et que son fils Psammétique III l'avait remplacé. Malgré leur confiance aux dieux
et en eux-mêmes, les Égyptiens étaient en proie à de sombres pressentiments.
Ce n'étaient plus seulement les nations du Tigre et de l'Euphrate, c'était l'Asie
entière, de l'Indus à l'Hellespont, qui se ruait sur eux et qui menaçait de
les écraser. Les alliés sur lesquels Amasis avait compté, Polycrate de Samos
par exemple[104]
et ses anciens sujets tels que les Chypriotes[105] avaient abandonné
une cause qu'ils sentaient condamnée d'avance et ils s'étaient ralliés aux Perses.
Le peuple, tourmenté par la crainte de l'étranger, voyait partout des signes
et il interprétait en présage sinistre le moindre phénomène de la nature. La
pluie est rare dans la Thébaïde et les orages ne s'y produisent guère
qu'une ou deux fois par siècle. Quelques jours après l'avènement de Psammétique,
la pluie tomba à Thèbes en petites gouttes, ce qui
n'était jamais arrivé auparavant[106]. La bataille
qui s'engagea en avant de Péluse fut menée de part et d'autre avec une
bravoure désespérée[107], Phanès avait
laissé ses enfants en Égypte. Ses anciens soldats, les Cariens et les Ioniens
au service de Pharaon, les égorgèrent sous ses yeux, recueillirent leur sang
dans un grand vase à moitié plein de vin, burent le mélange et se lancèrent
comme des furieux au plus fort de la mêlée. Vers le soir, la ligne égyptienne
plia enfin et la déroute commença. Au lieu de rallier les débris de ses
troupes et de disputer le passage des canaux, Psammétique, perdant la tête,
courut s'enfermer dans Memphis. Cambyse l'envoya sommer de se rendre, mais la
foule furieuse massacra les hérauts. Après quelques jours de siège, la ville
ouvrit ses portes ; la
Haute Égypte se soumit sans résistance, les Libyens et les
Cyrénéens n'attendirent pas qu'on les attaquât pour offrir un tribut[108] (525). Cette chute rapide d'une puissance qui
défiait tous les efforts de l'Orient depuis des siècles, et le sort de ce roi
qui n'était monté sur le trône que pour tomber aussitôt, remplirent les
contemporains d'étonnement et de pitié[109]. On contait
que, dix jours après la reddition de Memphis, le vainqueur voulut éprouver la
constance de son prisonnier. Psammétique vit défiler devant lui sa fille
habillée en esclave, ses fils et les fils des principaux Égyptiens que l'on
conduisait à la mort, sans qu'il se départît de son impassibilité. Mais, un
de ses anciens compagnons de plaisir étant venu à passer couvert de haillons
comme un mendiant, il éclata en sanglots et se déchira le front de désespoir.
Cambyse, étonné de cet excès de douleur chez un homme qui avait marqué tant
de fermeté, lui en demanda la raison. A cette question, il répondit : Ô fils de Cyrus !
mes infortunes personnelles sont trop grandes pour qu'on les pleure, mais non
pas le malheur de mon ami. Quand un homme tombe du luxe et de l'abondance
dans la misère au seuil de la vieillesse, on peut bien pleurer sur lui.
Lorsque le messager rapporta ces paroles à Cambyse,
il reconnut que c'était vrai ; Crésus fondit en pleurs, lui aussi, - car
il était en Égypte avec Cambyse, - et les Perses présents se mirent à pleurer.
Cambyse, touché de compassion, traita son prisonnier en roi et il allait
peut-être le rétablir sur son trône comme vassal, quand il apprit qu'une
conspiration se tramait contre lui ; il l’envoya au supplice[110] et il confia le
gouvernement de l'Égypte au Perse Aryandès[111].
Pour la première fois de mémoire d'homme, le vieux monde
obéissait à un seul maître ; mais était-il possible de tenir longtemps réunis
les gens du Caucase et ceux de l'Égypte, les Grecs de l'Asie Mineure et les
Iraniens de Médie, les Scythes de la Bactriane et les Sémites des bords de l'Euphrate,
et l'empire n'allait-il pas s'écrouler aussi promptement qu'il s'était
élevé ? Cambyse essaya d'abord de gagner ses nouveaux sujets en se
pliant à leurs moeurs et à leurs préjugés. Il adopta le double cartouche, le
protocole et le costume royal des Pharaons; tant pour satisfaire ses rancunes
personnelles que pour se concilier les bonnes grâces du parti loyaliste, il se
rendit à Saïs, viola le tombeau d'Amasis et brûla la momie[112]. Cet acte de
vindicte posthume accompli, il traita avec déférence Ladikê, veuve de
l'usurpateur, et il la renvoya chez ses parents[113]. Il ordonna
qu'on évacuât le grand temple de Nît, où des troupes perses s'étaient logées
au mécontentement des dévots, et il répara à ses frais les dommages qu'elles
avaient causés ; il poussa le zèle jusqu'à s'instruire dans la religion,
et il reçut l'initiation aux mystères de la déesse des mains du prêtre Ouzaharrîsniti[114]. C'était agir à
l'égard de l'Égypte comme son père avait agi à l'égard de Babylone, et il
avait des raisons majeures de montrer une condescendance pareille envers les
vaincus de la veille : il songeait à prendre Memphis et le Delta pour
base de ses opérations dans l'Afrique septentrionale. Il parut n'attacher que
peu d'importance à la soumission volontaire de Cyrène : au moins, la
tradition dorienne assurait qu'il dédaigna les présents d'Arkésilas III et
qu'il jeta par poignées à ses soldats les cinq cents mines d'argent que ce
prince lui avait payées en signe de vasselage[115]. Les Grecs de
Libye n'étaient pas assez riches à son gré : la renommée de Carthage,
accrue encore par l'incertitude et par la distance, excitait seule son
avidité. Carthage était alors à l'apogée de la grandeur : elle dominait
sur les anciennes possessions phéniciennes de la Sicile, de l'Afrique et
de l'Espagne, sa marine régnait sans rivale sur le bassin occidental de la Méditerranée,
ses marchands pénétraient au loin dans les régions fabuleuses de l'Europe septentrionale
et de la
Mauritanie. Cambyse voulut d'abord l'assaillir par mer,
mais les Phéniciens qui montaient sa flotte refusèrent de servir contre leur
ancienne colonie[116]. Forcé de
l'aborder par voie de terre, il expédia de Thèbes une armée de cinquante
mille hommes chargée d'occuper l'Oasis d'Amou et de frayer la route au reste
des troupes. Le sort de cette avant-garde ne fut jamais bien éclairci. Elle
traversa la Grande
Oasis, puis elle se dirigea vers le nord-est dans la
direction du temple d'Amon. Les indigènes racontèrent plus tard qu'arrivée à
mi-chemin elle fut assaillie pendant une halte par une rafale soudaine et
ensevelie sous des monceaux de sable. Il fallut bien les croire sur
parole : quelque diligence qu'on fit, on n'apprit rien d'elle, si ce
n'est qu'elle n'atteignit pas l'Oasis et qu'elle ne revint jamais en Égypte[117].
L'entreprise paraissait plus aisée vers le sud, car il
semblait qu'en longeant toujours le Nil on n'éprouverait pas de difficulté à
pénétrer au cœur de l'Afrique. Depuis la retraite de Tandamanou, le royaume
de Napata avait rompu ses relations avec les nations de l'Asie. Attaqué par
Psammétique 1er et Psammétique II, il avait conservé son
indépendance et brisé les derniers liens qui l'attachaient à l'Égypte. Les
contrées de la Nubie
inférieure, si peuplées au temps des Pharaons égyptiens, étaient devenues
presque désertes: les villes fondées par les princes de la XVIIIe
et de la XIXe dynastie
gisaient en ruine et leurs temples disparaissaient sous les sables. A peu
prés à mi-chemin entre la première et la seconde cataracte, on rencontrait
les grands-gardes éthiopiennes. Le royaume de Napata se divisait en deux
régions comme celui d'Égypte : dans le To-Qonsit s'échelonnaient, en
remontant le fleuve, Pnoubs[118], Dongour[119], la capitale
Napata, sur la Montagne Sainte[120], Astamouras, au
confluent du Nil et de l'Astamouras[121], Beroua enfin, la Méroé des
géographes alexandrins ; au delà de Beroua commençait le pays d'Alo[122], qui s'étalait
entre le Nil Blanc et le Nil Bleu jusque dans la grande plaine de Sennaar.
Sur la frontière méridionale d'Alo résidaient les Asmakh, descendants des
soldats égyptiens émigrés au temps de Psammétique 1er. A l'est, au
sud et à l'ouest, entre le Darfour, le massif d'Abyssinie et la mer Rouge,
vivaient une foule de tribus à moitié sauvages, les unes noires, les autres
de race africaine, d'autres de race sémitique, les Rohrehsa, au sud de Beroua,
entre le Nil Bleu et le Tacazzé[123], les Madi ou
Maditi, entre le Tacazzé et la chaîne de montagnes qui bordent la mer Rouge[124]. L'humeur
belliqueuse des rois de Napata trouvait dans ces régions populeuses matière à
victoires faciles et profitables : deux d'entre eux, qui florissaient à
peu près dans le même temps que Cambyse, Horsiatef et Nastosenen, avaient
soumis la plupart de ces peuplades et désolé par des razzias incessantes
celles d'entre elles qui résistaient[125].
La royauté éthiopienne était élective. L'élection avait
lieu à Napata, dans le grand temple, sous la surveillance des prêtres d'Amon
et en présence d'un certain nombre de délégués choisis à cet effet par les
magistrats, les lettrés, les soldats et les officiers du palais. Les membres
de la famille régnante, les frères
royaux, étaient introduits dans le sanctuaire et présentés successivement
à la statue du dieu, qui indiquait l'élu de son choix[126] par quelque
signe convenu d'avance. Nommé par les prêtres, le souverain restait sous leur
domination sa vie durant. Comme le dernier des Ramessides à Thèbes, il ne
pouvait entreprendre aucune guerre ni accomplir aucun acte important, sans
implorer l'autorisation du dieu. S'il venait à désobéir ou simplement à
marquer quelques velléités d'insubordination, le clergé lui transmettait
l'ordre de se donner la mort, et il n'avait d'autre ressource que de s'incliner
devant cet arrêt. La loi si dure pour lui n'était pas plus tendre pour ses
sujets. La moindre divergence d'opinion, le moindre changement introduit dans
les pratiques du culte était considéré comme une hérésie et traité en conséquence.
Vers la fin du septième siècle, quelques membres du sacerdoce de Napata
méditèrent une sorte de réforme religieuse : ils voulaient, entre autres
choses, substituer au sacrifice ordinaire du vieux rite égyptien différentes
cérémonies, dont la principale consistait à manger crue la viande des
sacrifices. Cette coutume, sans doute d'origine nègre, parut abominable aux
yeux des orthodoxes. Le roi se rendit au temple d'Amon, en chassa les prêtres
hérétiques, et brûla vifs ceux de leurs adhérents qu'il put saisir. L'usage
sacré de la viande crue n'en persista pas moins il gagna du terrain à mesure que
l'influence égyptienne allait s'affaiblissant, et il finit par s’établir si
solidement qu'il s'imposa même au christianisme[127]. Encore au
commencement de notre siècle, les Abyssins se régalaient de viande crue,
qu'ils appelaient brindé[128]. L'isolement
des Éthiopiens avait été plus profitable que nuisible à leur renommée. A
peine entrevus dans la distance par les nations de la Méditerranée,
ils avaient été investis peu à peu de vertus merveilleuses et presque divines.
On disait d'eux qu'ils étaient les plus grands et les plus beaux des hommes[129], qu'ils
prolongeaient leur existence jusqu'à cent vingt ans et au delà, qu'ils
possédaient une fontaine merveilleuse dont l'eau entretenait dans leurs
membres une jeunesse perpétuelle[130]. Prés de leur
capitale, il y avait une prairie sans cesse couverte de boissons et de mets
préparés : qui voulait venait et mangeait à sa fantaisie[131]. L'or était si
commun qu'on l'employait aux usages les plus vils, même à enchaîner les
prisonniers : le cuivre était rare et très recherché[132]. Cambyse fit
explorer le pays par des espions, et, sur leurs rapports, il quitta Memphis à
la tête de son armée. L'expédition à moitié réussit, échoua à moitié. Il
semble que les envahisseurs suivirent le Nil jusqu'a Korosko, puis qu'ils
l'abandonnèrent et qu'ils piquèrent droit à travers le désert dans la
direction de Napata[133] : les
vivres et l'eau leur manquèrent au quart du chemin, et la famine les obligea
à battre en retraite après avoir perdu beaucoup de monde[134]. L'expédition
eut pour résultat de rattacher à l'empire les cantons de la Nubie les plus voisins de
Syène[135] ;
néanmoins la population égyptienne, toujours disposée à bien accueillir les
nouvelles défavorables à ses maîtres, se plut à ne voir que l'échec final.
Cambyse avait été, dès son enfance, sujet à des crises d'épilepsie pendant
lesquelles il devenait furieux et il n'avait plus conscience de ses actions[136]. L'insuccès de
ses tentatives en Afrique exaspéra sa maladie et redoubla la fréquence et la
longueur des accès : il y perdit le peu de sens politique qu'il avait
montré jusqu'alors et il se laissa emporter à toute la violence de son
caractère. Le bœuf Apis était mort en son absence, et les Égyptiens, après
avoir pleuré le défunt le nombre de jours réglementaires, intronisaient un
Apis nouveau quand les débris de l'armée perse rentrèrent à Memphis. Cambyse,
trouvant la ville en fête, s'imagina qu'elle se réjouissait de ses malheurs.
Il manda auprès de lui les magistrats, puis les prêtres, et il les envoya au
supplice sans écouter leurs explications. Il commanda qu'on lui amenât le
bœuf et il lui perça la cuisse d'un coup de poignard. L'animal succomba
quelques jours après[137], et ce
sacrilège excita dans le cœur des dévots plus d'indignation que la ruine de
la patrie. Leur haine redoubla quand ils virent le Perse s'ingénier autant à
heurter leurs préjugés qu'il avait pris de peine à les concilier auparavant.
Il pénétra dans le temple de Phtah à Memphis et il se moqua d'une des formes
grotesques sous lesquelles on avait accoutumé de représenter ce dieu. Il
viola les tombeaux anciens, afin d'en examiner les momies. Les Iraniens
eux-mêmes et les gens de la cour n'échappèrent pas à sa rage. Il tua sa
propre sœur, qu'il avait épousée malgré la loi qui défendait les mariages
entre enfants du même père et de la même mère. Une autre fois il abattît d'une
flèche le fils de Prexaspès, il enterra vifs douze des principaux parmi les
Perses, il ordonna l'exécution de Crésus, puis il se repentit de sa
précipitation et cependant il condamna les officiers qui n'avaient pas obéi à
l'ordre qu'il se repentait d'avoir donné. Les Égyptiens prétendirent que les
dieux l'avaient frappé de folie en punition de ses sacrilèges[138].
Bien ne le retenait plus aux bords du Nil : il reprit
la route d'Asie. Il était déjà dans le nord de la Syrie lorsqu'un héraut se
présenta devant lui, proclama à l'ouïe de toute l'armée que Cambyse, fils de
Cyrus, avait cessé de régner, et somma ceux qui lui avaient obéi jusqu'alors
de reconnaître pour roi Bardiya, fils de Cyrus. Cambyse crut d'abord que son
frère avait été épargné par l'homme chargé de l'assassiner : il apprit
bientôt que ses instructions n'avaient été que trop fidèlement accomplies et
il pleura au souvenir de ce crime inutile. L'usurpateur était un certain
Gaumatâ, dont la ressemblance avec Bardiya était si frappante que les
personnes, mêmes prévenues, s'y laissaient tromper aisément. Il avait pour
frère Patizêithès, à qui Cambyse avait confié la surveillance de sa maison
pendant son absence[139]. Tous deux connaissaient
le sort de Bardiya ; tous deux savaient aussi que la plupart des Perses
l'ignoraient et qu'ils croyaient le prince encore vivant. Gaumatâ se révolta
dans Pasargades vers les premiers jours de mars 522 ; après quelques
moments d'hésitation, la Perse,
la Médie,
le centre de l'empire se déclarèrent en sa faveur et l'intronisèrent le 9
Garmapada (juillet 522)[140]. D'abord
atterré, Cambyse allait partir à la tête des troupes qui lui étaient restées
fidèles, lorsqu'il mourut d'une manière mystérieuse. L'inscription de
Béhistoun semble dire qu’il se tua de sa propre main dans un accès de
désespoir[141].
Hérodote raconte qu'en montant à cheval, il s'enfonça la pointe de son
poignard dans la cuisse à l'endroit même où il avait frappé le bœuf
Apis : Se sentant atteint à mort, il demanda le
nom de l'endroit où il se trouvait, et on lui répondît Agbatana[142]. Or, avant
cela, il lui avait été annoncé par l'oracle de Bouto qu'il finirait ses jours
à Agbatana. Il avait compris l'Agbatana de Médie, où ses trésors étaient, et
il avait pensé qu'il y finirait ses jours dans un âge avancé : mais
l'oracle songeait à l'Agbatana de Syrie. Lors qu'il eut ouï le nom de
l'endroit, il revint à lui : C'est donc ici que
Cambyse, fils de Gyms, est condamné à mourir. Il expira vingt jours
après, sans laisser de postérité et sans avoir désigné son successeur[143].
Gaumatâ et Darius 1er ; réorganisation et division de
l’empire perse.
On a considéré souvent la révolte de Gaumatâ comme une
sorte de mouvement national, qui restaura l'ancienne suprématie des Mèdes, et
qui ravit un moment aux Perses la domination sur l'Asie[144]. Gaumatâ
n'était pas Mède : il était né en Perse, dans la petite ville de
Pisyaouvada (Pasargades), près du mont
Arakadris. D'abord acclamé pur les provinces centrales et orientales
seulement, il fut accepté dans le reste de l'empire aussitôt après la mort de
Cambyse. On le tenait généralement pour Bardiya, et cela suffisait à lui assurer
le respect et la fidélité des Iraniens. Il s'empressa d'ailleurs de supprimer
tous ceux, grands ou petits, qu'il soupçonnait d'être bien renseignés, et la
crainte ferma la bouche des survivants : Il n'y
eut personne, ni parmi les Perses, ni parmi les Mèdes, ni même parmi les gens
de la race achéménide, qui songeât à lui disputer le pouvoir[145]. Afin de gagner
à sa cause les peuples vaincus, il les dispensa pour trois ans de l'impôt et
du service militaire. Six mois durant il régna sans que personne soupçonnât
l'imposture et vît en lui autre chose que l'héritier légitime du trône, le
fils du grand Cyrus et le frère de Cambyse. A la fin pourtant la crédulité publique
s'émut. Les révélations faîtes par le dernier roi un peu avant sa mort
n'avaient trouvé d'abord que peu de créance ; on les avait attribuées à
la jalousie ou à la haine fraternelle. Certaines circonstances se produisirent qui semblaient montrer que
Cambyse avait dit vrai. Selon l'usage, Gaumatâ avait hérité, avec la couronne,
le harem de son prédécesseur ; on apprit que les femmes étaient au
séquestre et qu'elles ne communiquaient plus entre elles ou avec le monde
extérieur que par messagers secrets, au péril de leurs jours. Le bruit se
répandit que le prétendu Bardiya était essorillé, et l'on conclut de sa
mutilation qu'il n'était pas le fils de Cyrus[146]. Daryavous (Darius)[147], fils de
Vistâspa (Hystaspe), satrape d'Hyrcanie,
qui appartenait à la maison royale et qui aurait été de plein droit
l'héritier de Cambyse, s'entendit avec six des plus résolus parmi les chefs
des grandes familles seigneuriales de la Perse[148], surprit
Gaumatâ dans son palais de Sikhyaouvâtis en Médie et le tua le 10 Bagayadis (mars-avril) 521. On raconta plus tard que, le
crime accompli, les sept convinrent de choisir pour souverain celui d'entre
eux dont le cheval hennirait le premier au lever du soleil : une ruse de
son écuyer procura la couronne à Darius[149]. Le droit du
sang les dispensait d'avoir recours à ce moyen romanesque : Darius,
proclamé sans retard, purifia les temples que son prédécesseur avait souillés[150], et il institua
la fête de la magophonie en souvenir du meurtre qui l'avait fait roi.
Deux révolutions se succédant coup sur coup en moins d'une
année avaient ébranlé la puissance des Perses. Leur empire n'était, comme
celui des Égyptiens et des Assyriens, qu'un assemblage hasardeux de provinces
administrées par des gouverneurs à demi indépendants, de royaumes vassaux, de
villes et de tribus mal soumises. Tout prétexte était bon pour ces sujets
impatients du joug, et, dès les premiers bruits, la révolte éclata sur deux
points à la fois, en Susiane, où Athrîna, fils d'un des derniers rois
nationaux, Oumbadaranma[151], ceignit le
diadème, à Babylone, où Nadintavbel se présenta comme étant le second fils de
Nabonide et assuma, en montant sur le trône, le nom glorieux de
Nabuchodorosor[152]. Darius abandonna
à ses généraux la tâche facile de vaincre Athrîna et il se réserva pour
lui-même le commandement des troupes destinées à agir contre la Chaldée.
Nabuchodorosor III avait bien employé le peu de temps que son
rival lui avait laissé : quand les Perses débouchèrent dans la plaine
assyrienne, il occupait déjà de fortes positions sur la rive droite du Tigre,
et une flottille nombreuse couvrait son camp. Darius n'osa pas l'attaquer de
front : il divisa son armée en petits corps, qu'il monta, partie à
cheval, partie à chameau, et, trompant la surveillance de son adversaire par
la multiplicité de ses mouvements, il réussit à franchir la rivière. Les
Chaldéens essayèrent en vain de le rejeter à l'eau : battus, ils se
replièrent en bon ordre et, six jours après, ils livrèrent une seconde
bataille, à Zazanou, sur les bords de l'Euphrate (décembre
521). Leur déroute fut complète ; Nabuchodorosor, échappé avec
quelques cavaliers, courut s'enfermer dans Babylone. Si Darius avait compté
sur une reddition aussi prompte que celle qui avait livré la ville à Cyrus,
son espoir fut déçu : il fut contraint de commencer un siège régulier,
et cela, au moment où les provinces se mettaient en rébellion ouverte sur
tous les points. La tentative du Perse Martiya pour débaucher une seconde
fois la Susiane
fut, il est vrai, réprimée promptement par les Susiens eux-mêmes, mais la Médie se laissa
entraîner par un certain Fravartish, qui disait descendre de Cyaxare et qui
se proclama roi sous le nom de Khshatrîta. Le temps n'était pas encore assez
éloigné où Astyage dominait sur l'Iran, pour que la noblesse mède eut renoncé
à recouvrer l'hégémonie dont la victoire de Cyrus l'avait dépouillée :
l'occasion était d'autant plus favorable que Darius avait dû quitter la
province subitement, presque aussitôt après le meurtre de Gaumatâ, et la
dégarnir, afin de former l'armée qui opérait contre Babylone. Quelques-unes
des tribus nomades demeurèrent fidèles : tous ceux des Mèdes qui vivaient dans des maisons se rangèrent sous les
drapeaux du prétendant, puis l'insurrection gagna les pays les plus proches,
l'Arménie et l'Assyrie.
C'en eût été fait de Darius si le mouvement se fût propagé
aux satrapies occidentales ; par bonheur elles ne bougèrent point. Orœtès,
gouverneur de la Lydie,
affectait des allures indépendantes et menaçait de devenir dangereux :
Bagæos, envoyé à Sardes, communiqua aux soldats perses l'ordre royal de ne plus
garder leur commandant, et aussitôt ils posèrent
leurs piques. Lors Bagæos, voyant qu'ils obéissaient, prit courage et
remit aux mains du secrétaire une deuxième lettre, où il était dit : Le roi Darius somme les Perses qui sont à Sardes de tuer
Orœtès. Sur quoi ils tirèrent leurs
sabres et le tuèrent[153]. Rassuré de ce
côté, Darius n'était pas encore hors d'affaire et sa situation demeurait
critique. Lever le siège de Babylone, il n'y devait pas songer : c'eût
été fait de lui si Nabuchodorosor avait reparu librement en Assyrie et en
Élam. Il se décida donc à poursuivre plusieurs campagnes à la fois et, tandis
qu'il pressait lui-même le blocus, il leva deux autres armées et il les lança,
l'une en Arménie sous Dadarshîsh, l'autre en Médie sous Vidarna, l'un des
sept. Vidarna rencontra Khshatrîta à Maroush, le 20 Anamaka 510, mais la
bataille demeura indécise, et il dut camper dans la Cambadène pour
y attendre des renforts. Dadarshîsh de son côté remporta trois victoires consécutives
sur les Arméniens mais sans faire de progrès sérieux[154] : en
Arménie comme en Médie, Khshatrîta conserva ses positions, et sa résistance
acharnée décida l'Hyrcanie et la Parthyène à se rallier à sa cause[155]. La Sagartie s'arma à
l'appel de Tchitrañtakhma qui s'annonçait comme un descendant de
Cyaxare, et Frâda s'insurgea en
Margiane. La Perse
elle-même commença à douter du succès et elle élut un roi selon son coeur[156]. Bien des gens
ne pouvaient encore se résigner à croire que la descendance directe de Cyrus
se fût éteinte avec Cambyse. L'usurpation et la chute de Gaumatâ, l'avènement
de Darius ne les avaient point ébranlés dans leur foi en l'existence de
Bardiya : de ce que Gaumatâ était un imposteur, il ne suivait pas
nécessairement que Bardiya fût mort. Aussi, quand un certain Vahyasdâta
s'annonça à eux comme étant le plus jeune fils de Cyrus, ils l'acclamèrent
avec enthousiasme.
Un succès qu'Hystaspe remporta à Vispaousatîsh en Parthiène,
le 22 Viyakhna 519, empêcha les Hyrcaniens de se rallier aux Mèdes, et
quelques jours plus tard la chute de Babylone rendit enfin à Darius l'usage
de toutes ses forces. La longue résistance de cette place fournit une matière
abondante à l'imagination populaire : un demi-siècle plus tard, on
contait que le roi, arrivé devant Babylone, l'avait trouvée résolue à se
défendre désespérément. Les habitants avaient coupé les canaux, rempli leurs
magasins et leurs greniers, puis ils s'étaient débarrassés des bouches
inutiles : ils avaient égorgé toutes les femmes, sauf le petit nombre
qu'il en fallait pour la préparation du pain. Au bout de vingt mois les
Perses n'étaient pas plus avancés que le premier jour, et ils se
décourageaient, quand Zopyre, l'un des sept, se dévoua pour leur assurer la
victoire. Il se coupa le nez et les oreilles, il se déchira à coups de fouet,
puis il s'introduisit dans la pince comme transfuge, et, quand il eut gagné
la confiance des assiégés, il livra les deux portes dont on lui avait confié
la garde : trois mille Babyloniens expirèrent sur le pal, les murs
furent rasés au niveau du sol et la ville se repeupla de colons étrangers[157]. Ce qu'il y a
de certain dans cette histoire, c'est la longueur du siège. Nabuchodorosor
fut exécuté, et Darius, enfin maître d'agir à sa guise, dépêcha un de ses
lieutenants, le Perse Artavardiya, contre le faux Smerdis, tandis qu'il
marchait de sa personne au-devant de Khshatrîta. Il pénétra en Médie par le
défilé de Kerend et rallia Vidarna dans la Cambadène.
L'entrée en scène des vétérans de Cyrus et de Cambyse
changea soudain la face des affaires. Les milices des Mèdes cédèrent devant
eux : Khshatrîta fut battu près du bourg de Koundourous, le 20
d'Adoukanis 519. Il s'enfuit vers le nord, sans doute afin de se jeter dans
la montagne et d'y continuer la lutte, mais il fut pris non loi de là et
conduit à Ecbatane. Son châtiment fut atroce : on lui coupa le nez, les
oreilles et la langue, on lui creva les yeux, on l'enchaîna à la porte du palais,
puis, quand le peuple se fut suffisamment repu de ce spectacle, le pal ;
ses principaux partisans furent, les uns empalés comme lui, les autres
décapités[158].
Le succès n'avait été ni moins rapide, ni moins complet du côté de la Perse. Dès le
début, Vahyasdâta commit la faute de diviser ses troupes et d'en expédier une
partie en Arachosie : Artavardiya, vainqueur à Bacha, puis à Paraga (519-518)[159], l'enferma dans
le château d'Ouvadéshaya et s'empara de sa personne[160], tandis que le
satrape d'Arachosie repoussait l'invasion victorieusement (518)[161]. Mais il
semblait qu'une guerre engendrât l'autre : le succès éphémère du second
faux Smerdis évoqua un second faux Nabuchodorosor. Darius avait à peine
quitté Babylone que l'Arménien Arakha se présentait au peuple comme le fils
de Nabonide : Vindafranâ (Intaphernès)
le vainquit et le fit exécuter (510)[162]. La Médie, la Perse et la Babylonie reconquises,
la soumission des autres provinces n'était plus qu'un jeu. Déjà Tchitrañtakhma
avait expié sa rébellion sur la croix[163] :
Vistâçpa, père de Darius, eut promptement raison de l’Hyrcanie (juillet 519), et Dadarshîsh, satrape de la Bactriane, triompha
sans grand'peine de la résistance de Frâda. La guerre était terminée (518)[164].
La leçon de ces dures années ne fut pas perdue pour le
vainqueur. L'empire de Cyrus renfermait, à côté des pays gouvernés par les
officiers perses, des royaumes et des cités vassales, des peuplades
tributaires, qui relevaient directe ment du souverain et qui n'avaient aucun
ordre à recevoir des satrapes dans la province desquels leur domaine était
enclavé : c'était encore le système qu'avaient pratique Tiglatphalasar
III et ses successeurs assyriens. Darius ne s'ingénia pas à supprimer les dynasties
locales; loin de là, il encouragea les peuples à garder leur' langue, leurs
mœurs, leur religion, leurs lois, leurs institutions particulières. Les Juifs
eurent la permission d'achever la construction de leur temple[165] ; les
Grecs d'Asie retinrent leurs constitutions variées, la Phénicie conserva
ses rois et ses suffètes, l'Égypte ses nomarques héréditaires. Mais il y eut
au-dessus de ces pouvoirs locaux une autorité unique, supérieure à tous et la
même partout. Le territoire fut divisé en grands gouvernements, dont le
nombre flotta selon les temps. Au début, il y en avait vingt-trois :
1° La Parçâ ou Perse proprement dite ;
2° L'Ouvajâ, l’Élam, où se trouvait Suse, l'une des
résidences favorites de Darius ;
3° Babirous, la Chaldée ;
4° Athourâ, l'Assyrie, du Khabour au mont
Zagros ;
5° Arabayâ, la Mésopotamie
entre le Khabour et l'Euphrate, la
Syrie, la Phénicie et la Palestine ;
6° L'Égypte (Moudrâya) ;
7° Les peuples de la mer, parmi lesquels on comptait
les Ciliciens et les Chypriotes ;
8° L'Yaounâ, qui renfermait, outre la Lycie, la Carie et la Pamphylie, les colons
grecs de la côte, Ioniens, Éoliens et Doriens ;
9° La
Lydie et la
Mysie (Çpardâ) ;
10° La Médie ;
11° L'Arménie ;
12° La
Katpatouka, c'est-à-dire toute la région centrale de l'Asie
Mineure, du Taurus au Pont-Euxin ;
13° La Parthyène et l'Hyrcanie (Parthava) ;
14° La Zarânka (Zarangie) ;
15° L'Arie (Haraïva) ;
16° La
Chorasmie (Ouvârazmiya) ;
17° La
Bactriane (Bakhtrîs) ;
18° La
Sogdiane (Çoughdâ) ;
19° La
Gandarie (Gandara) ;
20° Les Çaka ou Saces, aux plaines de la Tartarie, presque sur
les confins de la Chine ;
21° Les Thatagous ou Sattagydes, dans le bassin
supérieur de l'Helmend ;
22° L'Arachosie (Haraouvatis) ;
23° Les Maka, qui habitaient les pays à cheval sur
le détroit d'Ormuzd. Ce nombre s'accrut encore par la conquête : à la
fin de son règne, Darius comptait dans l'empire trente et une satrapies[166].
Si chacune d'elles avait été régie par un seul homme,
investi de pouvoirs équivalents aux pouvoirs royaux et à qui il ne manquait
du roi que le titre et l'hérédité, l'empire aurait couru le risque de se
résoudre bientôt en un amas confus de principautés sans cesse en lutte contre
la Perse. Darius
évita de concentrer l'autorité civile et le commandement militaire entre les
mêmes mains. Il établit dans chaque gouvernement trois officiers indépendants
l'un de l'autre, et qui relevaient directement de la cour : le satrape[167], le secrétaire
royal et le général. Les satrapes étaient choisis par le roi dans n'importe
quelle classe de la nation, parmi les pauvres comme parmi les riches, parmi
les gens de race étrangère comme parmi les Perses[168] : mais
l'usage s'établit de ne confier les satrapies importantes qu'aux descendants
des six familles qui avaient aidé à renverser Gaumatâ, ou bien à des personnages
alliés à la famille royale[169] par le sang[170] ou par un
mariage. Ils n'étaient pas nommés pour un espace de temps déterminé, mais ils
restaient en charge aussi longtemps qu'il plaisait au souverain. Ils
exerçaient l'autorité civile dans toute sa plénitude, ils avaient des palais,
des parcs ou paradis, une cour, des gardes du corps, des harems bien fournis,
ils répartissaient l'impôt à leur guise, ils administraient la justice, ils
possédaient le droit de vie et de mort. Ils avaient auprès d'eux un secrétaire
royal ; ce fonctionnaire, chargé ostensiblement du service de la
chancellerie, n'était en réalité qu'un espion occupé à surveiller tous leurs
actes et toutes leurs démarches pour en référer à qui de droit[171]. Les soldats
perses, les troupes indigènes et les mercenaires cantonnés dans la province
étaient sous la main d'un général, souvent ennemi du satrape et du secrétaire[172]. Ces trois
rivaux se balançaient et se tenaient mutuellement en échec, de manière à
rendre une révolte, sinon impossible, au moins difficile. Ils étaient en rapports
perpétuels avec la cour par des services de courriers réguliers, qui
transportaient leurs dépêches en quelques semaines[173] d'un bout de
l'empire à l'autre. Pour surcroît de précaution, le roi envoyait chaque année
dans les provinces des officiers qu'on nommait ses yeux et ses oreilles,
parce qu'ils étaient chargés de voir et d'entendre pour lui ce qui se passait
sur les parties les plus reculées du territoire. Ils surgissaient au moment
où l'on s'y attendait le moins, ils examinaient l'état des choses, ils
réformaient certains détails d'administration, ils réprimandaient et ils suspendaient
au besoin le satrape ; ils étaient accompagnés d'un corps de troupes qui
appuyait leurs décisions et qui prêtait à leurs conseils une autorité qu'ils
n'auraient peut-être pas eue sans cela[174]. Un rapport
défavorable, une désobéissance minime, même le simple soupçon d'une
désobéissance, suffisaient à perdre un satrape ; quelquefois on le
déposait, souvent on le condamnait à mort sans procès, et on laissait aux
gens de sa suite le soin de son exécution. Un courrier arrivait à
l'improviste, intimait aux gardes l'ordre de tuer leur chef, et les gardes
obéissaient sur simple vue du firman royal.
Cette réforme administrative ne plut pas aux Perses ;
ils se vengèrent par des railleries de l'obéissance à laquelle Darius
prétendait les plier. Cyrus, disaient-ils, avait été un père, Cambyse un
maître : Darius n'était qu'un cabaretier affamé de gain[175]. La division de
l'empire avait eu un but financier autant et plus encore qu'un but
politique répartir, lever, verser
l'impôt, était le grand devoir des satrapes. La Perse propre fut dispensée
de charge régulière[176] : ses habitants
étaient seulement requis à faire un cadeau au roi toutes et quarante fois il
traversait le pays. Le cadeau était proportionné à la fortune de l'individu
ce pouvait n'être qu'un bœuf ou un mouton, même un peu de lait ou du fromage,
quelques dattes, une poignée de farine ou des légumes[177]. Les autres
provinces furent frappées, à raison de leur étendue et de leur richesse, d'un
tribut payable partie en argent, partie en nature. Le revenu en argent
s'élevait à 1.460 talents euboïques, ce qui fait en poids 82.799.866 francs,
et, en tenant compte de la valeur. relative de l'argent aux différentes époques,
environ 665.000.000 de francs[178]. Afin de rendre
les payements moins difficiles, Darius mit en circulation une monnaie d'or et
d'argent, à laquelle on a donné son nom. Les dariques portent au droit une
figure de roi armée de l'arc ou de la javeline. Elles sont épaisses,
irrégulières, grossières de frappe, mais d'un titre remarquablement
pur : l'alliage n'y représente que trois centièmes au plus de la masse totale[179]. L'usage ne
s'en répandit pas uniformément partout : elles servirent surtout à la solde des
armées de terre ou de mer, et elles n'eurent cours communément que dans les
contrées riveraines de la Méditerranée. A l'intérieur de l'Asie, on
continua à évaluer selon le poids les métaux nécessaires aux transactions du
commerce ou de la vie quotidienne, et les rois eux-mêmes préférèrent les
conserver à l'état brut[180] ; ils les
coulaient dans des vases en terre à mesure qu'ils les recevaient, et ils ne
les monnayaient que progressivement selon les besoins ou le caprice du moment[181]. L'impôt en
nature n’était pas moins considérable que l'impôt en argent. L'Égypte
fournissait le blé nécessaire aux 120.000 hommes qui l'occupaient militairement[182]. Les Mèdes
livraient chaque année 40.0000 moutons, 4.000 mulets, 5.000 chevaux ; les
Arméniens, 50.000 poulains[183] ; les gens
de Babylone, 500 jeunes eunuques ; la Cilicie, 365 chevaux blancs, un pour chaque
jour de l'année[184]. Les taxes
royales n'avaient rien d'exagéré, mais elles ne sauraient donner la mesure
des charges que chaque province supportait. Les satrapes ne recevaient aucun
traitement de l'État : ils vivaient sur le pays avec leur suite et ils
se faisaient rémunérer largement par les indigènes. Le seul gouvernement de
Babylone suait chaque jour à son possesseur une pleine artabe d'argent[185] ;
l'Égypte, l'Inde, la Médie,
la Syrie ne
devaient pas rapporter beaucoup moins, et les provinces les plus pauvres
n'étaient pas les moins lourdement frappées. Les satrapes coûtaient à
entretenir au moins autant que le roi.
Malgré ses défauts, ce système était de beaucoup préférable
à celui qu'on avait jusqu'alors employé en Orient. Il assurait au souverain
un budget régulier, il mettait les provinces sous sa main et il rendait les
révoltes nationales fort difficiles. La mort de chaque roi ne fut pas suivie
comme autrefois de soulèvements, dont la répression remplissait une bonne
partie du règne suivant. Darius n'eut pas seulement la gloire d'organiser
l'empire perse : il inventa une forme de gouvernement qui servit
désormais de type aux grands États orientaux. Sa renommée d'administrateur a même
nui à sa gloire militaire : on a trop souvent oublié qu'il avait élargi
son domaine dans le temps qu'il en réglait la gestion. A force de victoires,
les Perses en étaient arrivés à ne plus avoir d'issue que dans deux
directions opposées, à l'est vers l'Inde, à l'ouest vers la Grèce. Partout
ailleurs ils étaient arrêtés par des mers ou par des obstacles presque
infranchissables aux lourdes armées de l'époque ; au nord, la mer Noire,
le Caucase, la Caspienne,
les steppes de la Tartarie ;
au sud, la mer Erythrée, le plateau sablonneux de l'Arabie, le désert d'Afrique.
Un moment, vers 512, on put croire qu'ils allaient se jeter à l'est[186]. Du haut de
l'Iran ils dominaient au loin les immenses plaines de l'Heptahendou (Pendjab). Darius les envahit, y conquit des
territoires étendus, dont il forma une satrapie nouvelle, celle de l'Inde,
puis, renonçant à pousser plus loin vers le Gange, il fit explorer les
régions du sud. Une flotte construite à Peukéla et placée sous les ordres
d'un amiral grec, Skylax de Karyanda, descendit l'Indus jusqu'à son
embouchure et soumit au passage les tribus qui bordaient les deux rives.
Parvenue à la mer, elle cingla vers le couchant et elle releva en moins de
trente mois les côtes de la Gédrosie et de l'Arabie[187].
Une fois engagés dans l'Inde, les Perses voyaient s'ouvrir
devant eux une carrière lucrative et brillante. Je ne sais quelle
circonstance les empêcha de poursuivre leurs premiers succès et ramena leur
attention sur l'Occident. La conquête de la Lydie et la soumission des cités et des îles
grecques de la côte leur avaient assuré le concours de populations actives et
riches, et que leurs aptitudes aux arts de la guerre comme à ceux de la paix
rendaient d'un prix inestimable pour le souverain qui saurait se servir d'elles.
Curieux, hardis, sans cesse en mouvement, avides de gains, endurcis aux
fatigues des voyages, les Grecs étaient déjà partout, en Asie Mineure, en
Syrie, en Égypte, à Babylone, en Perse même, et c'était un Grec qui venait de
naviguer l'Indus pour le compte du grand roi. D'autre part, la fougue même de
leur tempérament, leur orgueil, leur impatience de tout contrôle régulier,
leur tendance aux luttes civiles et à la révolte faisaient d'eux des sujets
de maniement difficile et de fidélité douteuse. Ajoutez que leur entrée dans
l'empire n'avait pas rompu les liens qui les attachaient à leurs frères
d'Europe, et qu'ils continuaient à négocier et à intriguer avec ceux-ci aussi
ouvertement qu'ils le faisaient auparavant: ce n'étaient d'une rive à l'autre
de la mer Égée que complots et intrigues, bien propres à inquiéter la cour de
Suse et à soulever ses colères. Dans le moment même que Darius s'efforçait
d'armer le pouvoir central et de rendre l'obéissance aux satrapes plus
effective, il lui était difficile d'endurer que des Grecs d'Europe se
mêlassent à chaque instant des affaires de ses sujets d'Asie, sous prétexte
que ceux-ci étaient Grecs comme eux : le prestige du souverain en aurait
trop souffert ainsi que l'autorité de ses officiers. La conquête seule pouvait
mettre un terme à ces pratiques : le jour où des satrapes commanderaient
sur les côtes européennes de la mer Égée aussi bien que sur les côtes asiatiques,
il faudrait que ces turbulents personnages vécussent en paix les uns avec les
autres, dans la crainte du suzerain. Ce ne fut donc pas, comme on le répète
encore, un pur caprice de despote qui déchaîna le fléau des guerres médiques,
ce fut le besoin impérieux de sécurité qui obligea les empires organisés
fortement à subjuguer l'une après l'autre toutes les tribus ou toutes les
cités qui s'agitent sur leurs frontières. Darius, qui de Trébizonde à Barca
possédait un tiers environ du monde grec, ne vit d'autre moyen d'y assurer sa
domination et d'enrayer les révoltes que de conquérir la métropole comme il
avait conquis les colonies et d'annexer la Grèce d'Europe à celle d'Asie.
|