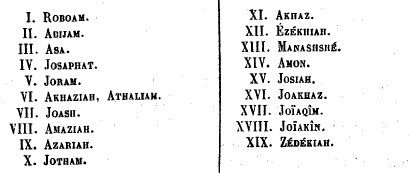|
L'empire mède et Cyaxare : la Lydie.
Deux grands royaumes sortirent à la fois de ses ruines.
Cyaxare s'attribua l'Assyrie propre et ses dépendances sur le haut Tigre.
Nabopolassar joignit à la possession de Babylone la suzeraineté sur la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine,
l'Élam : il prétendit même étendre sa domination au delà de l'isthme, et
il considéra les rois d'Égypte comme ses feudataires, pour ce qu'ils avaient,
quelques années durant, relevé de Ninive[1]. On pouvait
craindre qu'après avoir fourni un effort commun dans l'action contre
l'ennemi, ils ne fussent mécontents l'un et l'autre de leur part des
dépouilles et qu'ils ne se heurtassent bientôt, mais il n'en fut rien. Soit
tolérance, soit crainte mutuelle, ils s'évitèrent, et leur neutralité
réciproque assura la paix du monde oriental pendant plus d'un demi-siècle.
L'histoire de Cyaxare nous est presque inconnue durant les
années qui suivirent son triomphe : on devine seulement les obstacles
qu'il rencontra, et l'on constate le résultat des guerres qu'il entreprit
pour les surmonter. Les régions qui s'étendent entre la Caspienne et le
Pont-Euxin avaient été bouleversées par les Cimmériens et par les Scythes.
Rien n'y subsistait plus de l'ordre de choses qui y avait prévalu si
longtemps, et les barbares semblaient être incapables d'édifier quoi que ce
fût à la place de ce qu'ils avaient renversé. L'Ourartou était rentré dans
ses limites anciennes au pied de l'Ararat, et l'on ne sait qui le
gouvernait : la civilisation d'Argishtis et de Ménouas s'était évanouie
presque complètement avec leur dynastie, et le peuple, qui ne s'en était
jamais imprégné profondément, était retombé bientôt dans une demi barbarie.
Des masses confuses d'aventuriers européens se remuaient dans les régions de
l'Araxe, cherchant un canton où s'établir, et ils ne réussirent que beaucoup
plus tard à s'emparer de celui qui tira son nom de Sacasène[2] de la principale
de leurs tribus. Les Moushkou et les Tabal, ceux du moins qui n'avaient pas
péri sous la tourmente, s'étaient réfugiés dans les montagnes qui bordent la Mer Noire, et où les
Grecs les fréquentèrent sous les noms de Mosynèques et de Tibaréniens[3]. Les restes des
Cimmériens les avaient remplacés dans la Cappadoce, tandis que les Phrygiens gagnaient
du côté de l'Est et se répandaient sur le bassin du Haut Halys, puis sur
l'ancien Miliddou[4],
qui bientôt reçut d'eux le nom d'Arménie. Tout cela s'agitait, se choquait,
se chassait de contrée en contrée, formait bien le
chaudron bouillant que le prophète hébreu entrevoyait dans ses visions[5], et qui tantôt
débordait sur les nations voisines, tantôt se consumait en grondements inutiles.
Cyaxare employa près d'un quart de siècle à conquérir et à
régulariser ce chaos : il y réussit enfin et, toujours victorieux, il
parvint aux bords de l'Halys, mais là il se trouva soudain face à face avec
des ennemis d'autre valeur, les Lydiens. La Lydie avait changé deux fois de dynastie depuis
l'émigration des Toursha et des peuples de la mer.
Selon la tradition nationale, la lignée des Atyades avait été remplacée par
une famille d'Héraclides, dont le fondateur Agron possède une généalogie plus
mythique encore que sa personne : il descendait d'Hercule et d'une
esclave de Jardanos par Alkæos, Bêlos et Ninos. Faut-il voir dans les noms
assyriens de ces derniers un souvenir de la domination hittite[6] ? Agron eut
pour successeurs vingt et un rois, chacun fils du précédent et dont les
règnes additionnés forment un total de cinq cents ans[7]. On ignore ce
qu'ils furent pour la plupart, et ce qu'on nous dit des autres nous
transporte en pleine légende. Kamblês était tourmenté d'une faim si féroce
qu'une nuit, pendant son sommeil, il dévora la reine[8] ; la femme
de Mêlés enfanta un lion[9]. Le récit de
l'expédition, en Palestine, d'un général lydien qui aurait fondé Ascalon au
temps d'Alkimos[10],
peut être un souvenir effacé des migrations tyrrhéniennes et semble montrer
que, longtemps encore après la crise des peuples de la mer, les Lydiens
partaient en course aux côtes d'Égypte et de Syrie. Vers 687, ces Héraclides
furent renversés à leur tour[11].
La Lydie
était, comme les autres contrées de l'Asie Mineure, un véritable État féodal.
Au-dessous du roi, qui résidait à Sardes, s'échelonnait une hiérarchie de
grands vassaux et de princes, alliés pour la plupart à la famille régnante et
munis chacun de privilèges spéciaux. Thyessos, Kelænæ, Daskylion, Tyrrha,
étaient le siège d'autant de dynasties subalternes, dont les prétentions et
les rébellions perpétuelles restreignaient singulièrement le pouvoir du
suzerain. Depuis près d'un siècle déjà, les Héraclides n'exerçaient plus que
l'apparence du pouvoir : deux clans issus du sang royal, celui des
Tylonides et celui des Mermnades, se disputaient le poste de compagnon du
roi, qui mettait toutes les forces de l'État à la disposition du titulaire.
Un certain Gygès, le premier des Mermnades dont nous ayons le nom, avait été
élevé à cette dignité par le vieux Kadys, et son fils Daskylos, lui avait
succédé pendant le principat d'Ardys, vers 740. Une conspiration à la tête de
laquelle était Alyattés, l'héritier du trône, substitua pour un temps
l'influence des Tylonides à celle des Mermnades. Sadyattès, le dernier des
Héraclides, crut peut-être contenter les deux factions rivales en leur
partageant les emplois les plus élevés : tandis que le Tylonide était le
compagnon du roi et à ce titre dépositaire de la hache à deux tranchants, symbole
de l'autorité suprême, Gygès, prince de Tyrrha, remplissait les fonctions de
majordome. Mécontent de la part qui lui était dévolue, il se révolta
ouvertement, tua Sadyattès et ceignit le diadème (687)[12]. Son histoire
devint plus tard pour les Grecs un sujet de roman sur lequel leur fantaisie
travailla sans contrôle. Gygès ne fut plus pour eux un vassal qu'une
rébellion heureuse avait porté au trône : ils lui attribuèrent une
origine des plus basses. Les Cariens avaient alors le privilège de fournir
aux armées orientales un de leurs éléments les mieux disciplinés. Opprimés
par les colons grecs, ils s’expatriaient volontiers et ils allaient prendre
du service au dehors, en Égypte ou en Phénicie : en Lydie, ils
remplissaient la garde royale, et leurs chefs exerçaient une influence
prépondérante. Gygès, fils de Daskylès, était un chef d'aventuriers de race carienne,
entré aux gages de la Lydie ;
il usurpa graduellement les prérogatives de la royauté, puis il assassina,
d'accord avec la reine, Candaule, le dernier descendant des Héraclides.
Hérodote contait déjà, d'après le poète Archiloque, que Candaule, affolé par
la beauté de sa femme, la montra nue à Gygès : la reine, outrée de ce
qu'elle considérait comme un affront, força le favori à tuer son maître, puis
elle lui donna sa main et la couronne[13]. Le récit de
Platon est plus merveilleux. Après un orage terrible, un berger du roi de
Lydie aperçoit une fente dans le sol et il y descend. Il y trouve un grand
cheval de cuivre à moitié brisé, et, dans les flancs du cheval, le cadavre
d'un géant, qui porte au doigt une bague d'or. Il s'aperçoit que la bague
peut le rendre invisible à volonté, va chercher fortune à la cour, séduit la
reine, poignarde le roi et se substitue à lui[14]. D'après une
troisième légende, il ne commet son crime et ne monte sur le trône que pour
accomplir un oracle. Tandis que Toudô, fille du roi des Mysiens, n'était
encore que la fiancée de Sadyattès, deux aigles géants s'abattirent sur le
toit de sa chambre à coucher, et les devins conclurent de ce présage qu'elle
serait en une seule nuit la femme de deux rois : la nuit des noces,
Gygès tua son maître, et il épousa la reine sur place[15]. Le changement
de dynastie ne s'accomplit pas sans lutte. Les partisans des Héraclides
coururent aux armes et se préparèrent à défendre la cause des souverains
légitimes. Gygès, appuyé par les mercenaires cariens, préféra s'en rapporter
à la décision d'Apollon Delphien ; elle lui fut favorable. Dès qu'il fut assis fermement sur le trône, il envoya à Delphes
des présents considérables, comme en font foi les offrandes en argent qu'il
plaça dans le sanctuaire. Outre cet argent, il donna un grand nombre de vases
en or, parmi lesquels les plus remarquables sont les gobelets, au nombre de
six, et du poids de trente talents, qui sont déposés dans le trésor
corinthien[16].
L'avènement des Mermnades fut pour la Lydie le commencement
d'une ère nouvelle. Elle avait toujours été une terre vaillante et
belliqueuse, féconde en hommes, nourricière de chevaux vigoureux ; mais
les Héraclides n'avaient pas exploité les ressources qu'elle offrait pour la
conquête. Gygès n'eut pas de peine à réveiller les instincts guerriers de son
peuple. Sardes, appuyée sur un rocher dont les flancs à pic défient de trois
côtés l'escalade, était naturellement presque imprenable : il la changea
en un vrai camp retranché, où sa cavalerie se reposait chaque hiver, et d'où
elle partait presque chaque printemps pour quelque aventure nouvelle. De ses
campagnes à l'intérieur on ne sait rien, si ce n'est qu'il annexa plusieurs
cantons de la Phrygie
à son royaume[17].
Ce n'était toutefois là que le moindre de sa tâche : le plus pressé pour
lui était de se frayer un chemin à la mer. Les colonies grecques, éoliennes
et ioniennes, barraient l'embouchure de toutes les rivières qui arrosaient
son territoire : Smyrne et Phocée fermaient la vallée de l'Hermos et
bloquaient Sardes ; Colophon commandait l'entrée du Caystros, Milet
celle du Méandre. Gygès débuta par s'emparer de la côte carienne au sud, au
nord de la Troade[18] et de la Mysie, depuis le golfe
d'Adramyttion jusqu'au delà du Rhyndakos. Les Grecs le secondèrent d'abord
dans ses ambitions : les Milésiens se liguèrent même avec lui pour établir
la colonie d'Abydos sur l'Hellespont[19]. Mais leurs
intérêts différaient trop des siens pour que l'entente persistât longtemps.
La guerre éclata entre les Lydiens et l'Ionie, et se prolongea sans trêve
pendant un siècle et demi : la cavalerie lydienne se répandait dans la
banlieue des cités helléniques, brûlait les vergers, détruisait les villages,
pillait les temples, razziait les hommes et les bestiaux. Gygès assiégea
Milet et Smyrne sans succès, mais il prit Colophon[20] : ici
encore la légende s'est mêlée à l'histoire pour attribuer une cause
extraordinaire à ses succès. On conta qu'il avait pour favori un jeune homme
d'une beauté merveilleuse, nommé Magnés, et que les Magnésiens défigurèrent
au point de le rendre méconnaissable : il les assiégea et il ne se
retira qu'après les avoir châtiés cruellement[21]. Rien ne prouve
qu'il ait jamais possédé une cité grecque autre que Colophon, mais, malgré
divers échecs, la politique qu'il avait inaugurée eut les résultats les plus
heureux pour sa dynastie. La
Lydie était demeurée jusqu'alors un État purement oriental,
et elle n'avait eu qu'une part modeste dans le développement général de l'histoire.
Gygès l'arracha au milieu dans lequel elle avait vécu, et il l'introduisit
dans le concert des Etats helléniques. La culture de l'Ionie s'infiltra à la
cour des Mermnades, et elle y effaça peu à peu la trace des influences
hittites et assyriennes qui l'avaient précédée.
Les anciens se demandaient qui avait inventé la monnaie,
Phidon d'Argos ou les rois lydiens[22] : les
modernes se sont décidés en faveur de ces derniers[23]. Les peuples les
plus policés, les Égyptiens, les Assyriens, les Hittites, les Phéniciens,
avaient pourvu par l'échange aux opérations journalières entre gens d'une
même ville et à celles du commerce international. Les marchés étaient un
simple troc de denrées nécessaires ou de produits de luxe : un monument
d'époque memphite nous montre des ménagères allant au bazar et y achetant des
souliers, des légumes, des liqueurs avec des éventails, des colliers en
verroterie et d'autres menus objets. On avait cependant reconnu déjà que les
métaux nobles, l'or, l'argent, et, parmi les métaux vils, le cuivre, étaient
l'instrument le plus sûr et le plus commode des transactions. D'abord
employés à l'état brut, en poudre ou morceaux irréguliers, on s'habitua
bientôt à leur imposer des figures régulières et à les couler en lingots,
échelonnés selon le système de poids en usage chez chaque peuple, et ramenés
à des tailles assez faibles pour représenter les valeurs minimes dont on a besoin
au courant de la vie. Ces lingots ne recevaient aucune marque officielle
destinée à garantir l'exactitude du poids et la pureté du titre ;
c'était une marchandise dont il fallait vérifier la qualité et évaluer la
quantité à la balance, chaque fois qu'elle changeait de main. Les banquiers
lydiens et les rois de Lydie, Gygès le premier[24], imaginèrent de
les timbrer d'une empreinte déterminée qui leur assurât un cours légal. Le
métal qu'ils choisirent pour cet usage fut non pas l'argent ou l'or pur, mais
cet alliage naturel d'or et d'argent que les anciens appelaient électrum, et
qu'ils recueillaient dans les lavages du Pactole ou dans les filons quartzeux
du Tmolos ou du Sipylos[25]. Le type de ces
monnaies primitives diffère assez sensiblement de celui qui a prévalu depuis.
Ce sont des pastilles de métal, ovoïdes, légèrement aplaties sur les côtés ;
n'offrant au droit qu'une surface striée, et montrant au revers l'empreinte
profondément enfoncée en creux de trois poinçons, dans l'un desquels on
distingue encore le renard, emblème d'Apollon Bassareus. L'usage s'en
répandit rapidement, et les Grecs ne furent pas les moins prompts à imiter
l'exemple que les Lydiens leur donnaient. Phidon d'Argos appliqua à l'argent
ce qui n'avait été encore essayé qu'avec l'électrum, et il frappa des pièces
au type de la tortue dans l'île d'Egine, dont il était le maître. Moins de
deux siècles plus tard, l'usage de la monnaie s'était répandu dans tout le
monde antique.
Le règne de Gygès se termina par un désastre. Pressé des
Cimmériens, il avait reçu en rêve l'avis de prêter hommage au roi d'Assyrie,
Assourbanabal, dont les premiers succès remplissaient de bruit le monde
oriental. Du jour qu'il eut obéi à l'ordre d'en haut, la fortune se déclara
pour lui : il choisit parmi ses prisonniers deux chefs qu'il manda enchaînés
à Ninive. Mais, le péril passé, il se repentit de sa démarche et il expédia
des secours aux Égyptiens révoltés. Bientôt après, les Cimmériens, ayant
groupé autour d'eux les Trères et d'autres tribus thraces, revinrent à la
charge sous la conduite d'un certain Tougdamis. Cette fois, la chance les
favorisa. Gygès fit de son mieux pour soutenir leur choc, mais ses lanciers
se débandèrent devant l'élan désordonné des Barbares ; il fut tué dans
la déroute de ses soldats, et son corps demeura sans sépulture[26]. La Lydie entière fut dévastée
et Sardes prise, à l'exception de la citadelle (652) : Ardys, revenant à
la politique première de son père, implora le secours de l'Assyrie. Il s'en
trouva bien vers 640, Tougdamis succomba dans les gorges du Taurus sous les
coups des généraux d'Assourbanabal. Ardys recouvra dès lors la plus grande
partie du territoire perdu et s'agrandit aux dépens des cités grecques[27] ; il isola
Milet du reste de la confédération ionienne, en occupant l'acropole fortifiée
de Priène[28].
Sadyattès (645-610) écrasa deux fois l'infanterie
milésienne dans les plaines basses du Méandre. Alyatte, qui lui succéda en
610, désespérant de forcer la ville, essaya de la réduire par la famine. Chaque été, dès que les fruits et les moissons
commençaient à mûrir, il partait à la tête de son armée, qu'il faisait
marcher et camper au son des instruments. Arrivé sur le territoire des
Milésiens, il gâtait entièrement les récoltes et les fruits. Il se
conduisait avec une modération relative dont les Grecs lui surent gré. Il
évitait de détruire les habitations et les édifices consacrés au culte :
une fois, l'incendie qui ravageait la plaine ayant gagné le temple d'Athéna,
près d'Assêsos, il le rebâtit à ses frais. Son obstination échoua devant la
fermeté des Milésiens. Il traita avec eux, se rejeta sur d'autres cités moins
fortes, enleva Smyrne[29] : il avait
établi sa suzeraineté jusque sur la rive gauche de l'Halys, quand les Mèdes
parurent à la rive opposée.
La Lydie
était trop riche et trop fertile pour ne pas exciter la convoitise de
Cyaxare : la tradition courante chez les Grecs, un siècle plus tard,
avait inventé un véritable roman pour expliquer les origines du conflit. Un
corps de Scythes nomades, que le Mède avait à son service, le quitta soudain,
disait-on, et se réfugia auprès d'Alyatte : il réclama ces transfuges,
n'obtint pas leur extradition et déclara la guerre. Il s'aperçut bientôt que
l'ennemi qu'il avait devant lui était trempé d'autre façon que les barbares
de la Haute Asie.
De vrai, l'armée d'Alyatte était inférieure en nombre à la sienne, mais elle
l'emportait par la valeur des éléments qui la composaient et des chefs qui la
commandaient Cyaxare n'avait rien
qu'il pût comparer aux lanciers cariens, aux hoplites d'Ionie, à la grosse
cavalerie lydienne. La lutte se prolongea six ans à succès égal, et les deux
armées, après plusieurs batailles indécises, allaient se rencontrer une fois
encore, lorsque le soleil s'éclipsa soudain. Les peuples de l'Iran ne
voulaient combattre qu'à la pleine lumière du soleil, et les Lydiens, bien
que prévenus, dit-on, par Thalès, du phénomène qui se préparait, n'étaient
peut-être pas plus rassurés que leurs adversaires : on se sépara
sur-le-champ. La tradition recueillie par Hérodote racontait que le Syennésis
de Cilicie, allié du roi lydien, et le Babylonien Nabonide[30] (Labynètos), qui soutenait Cyaxare, proposèrent
un armistice et persuadèrent aux rivaux de s'accommoder. L'Halys resta la limite
officielle des deux royaumes ; pour consolider l'alliance, Alyatte maria
sa fille Aryènis avec Astyage, fils de Cyaxare. Selon l'usage du temps, les
deux princes, après s'être prêté le serment d'amitié l'un à l'autre,
scellèrent le contrat en se piquant le bras mutuellement et en buvant le sang
qui coulait de la blessure (585)[31].
Cyaxare ne survécut pas longtemps à la conclusion du
traité : il mourut en 584, plein de gloire et de jours. Peu de princes
eurent une destinée aussi brillante que la sienne, même dans ce siècle de
fortunes soudaines et de triomphes éclatants. Héritier d'un royaume sans
cohésion et sans organisation, proclamé roi au lendemain d'une défaite où son
père avait succombé, assailli par des hordes barbares, il surmonta tous les
obstacles par sa ténacité et par sa vaillance ; les Scythes détruits, il
écrasa les Assyriens, conquit l'Asie orientale, l'Arménie, la Cappadoce. A son
avènement, la Médie
était confinée dans une petite portion du plateau de l'Iran : à sa mort,
l'empire mède s'étendait des bords de l'Helmend à la rive orientale de
l'Halys[32].
La religion iranienne : Zoroastre, les Mages.
Il est à coup sûr le moins connu de tous ceux qui régirent
l'Orient : les historiens de l'âge classique n'ont pu que recueillir les
traditions courantes sur lui chez les Perses, et ses princes ne nous ont
légué aucun monument qui nous renseigne directement sur leur histoire. Nous
l'entrevoyons donc comme à travers un brouillard, organisé à peu près de la
même manière que l'empire achéménide, mais plus imparfait, plus fruste, plus
proche de la barbarie : c'est une Perse à l'état rudimentaire et dont
les rouages sont encore mal engrenés. La machine politique y était montée sur
les mêmes principes qui avaient prévalu en Assyrie, en Élam, en Chaldée, dans
tous les États avec lesquelles il avait eu des rapports de vassalité,
d'alliance ou de guerre : dès que nous perçons ce vernis superficiel,
nous rencontrons dans sa vie intérieure et dans sa religion des éléments dont
l'originalité nous transporte au milieu d'un monde entièrement nouveau.
La religion y était établie dans ses grandes lignes
lorsque le peuple s’éleva contre Assourbanabal, et le nom même de Fravartish,
le confesseur, que porte le
souverain d'alors, prouve qu'elle était pratiquée dans la famille royale.
Nous ne saisissons presque rien des diverses évolutions qu'elle accomplit
avant de revêtir la forme la plus ancienne que les livres sacrés nous en ont
conservée. Selon les uns, le mazdéisme naquit dans l'Aryanêm Vâedô ;
selon les autres, il ne se développa qu'en Médie[33] presque au
dernier terme des migrations iraniennes. Plus tard on attribua à l'influence
d'un seul homme ce qui avait été l'œuvre des siècles : les légendes
nationales attribuèrent au prophète Zarathoustra (Zoroastre)[34] l'honneur
d'avoir établi la vraie religion. Presque tous les écrivains de l'époque
classique s'accordent à placer ce personnage sur les plans les plus reculés
de l'antiquité fabuleuse. Hermippos et Eudoxe prétendaient qu'il florissait
six ou sept mille ans avant Alexandre, mais Pline le disait de mille ans
antérieur à Moïse[35], et Xanthos de
Lydie affirmait que six cents années seulement s'étaient écoulées entre sa
mort et la campagne de Xerxès contre Athènes. Selon la tradition la plus
ancienne, il était né à Raghà en Médie[36], ou en
Atropatène[37],
et il vivait aux premiers âges de la race iranienne, au temps où les tribus
étaient encore campées en Bactriane. Il était de race royale et il fut choisi
par Dieu, dès avant sa naissance, pour régénérer le monde. Son enfance et sa
jeunesse ne furent qu'une lutte incessante contre les démons : toujours
assailli, il était toujours vainqueur et il sortait plus parfait de chaque
épreuve. Quand il eut trente ans, un génie supérieur, Vôhoumanô, lui apparut
et le conduisit en présence d'Ahouramazdâ, invité à interroger Dieu, il
demanda quelle était la meilleure des créatures qui
sont sur la terre. On lui répondit que celui-là était excellent parmi
les hommes dont le cœur est pur. Il voulut ensuite connaître le nom et la
fonction de chacun des anges, la nature et les attributs du mauvais principe.
Il traversa une montagne de flammes, se laissa ouvrir le corps et verser dans
le sein du métal fondu, sans éprouver aucun mal ; après quoi il reçut
des mains de Dieu l'Avesta, le livre de la loi, et il fut renvoyé sur la
terre[38]. Il se rendit à
Balkh, auprès de Vistâçpa, fils d'Aourvatàçpa, qui régnait alors sur la Bactriane, et il y
défia les savants de la cour. Pendant trois jours ils essayèrent de le
combattre et de l'égarer, trente à sa droite, trente à sa gauche. Lorsqu'ils
se furent avoués vaincus, il déclara qu'il venait de Dieu et il commença de
lire l'Avesta au souverain. Persécuté par les sages, accusé par eux de magie
et d'impiété, il l'emporta sur eux à force d'éloquence et de miracles.
Vistâçpa, sa femme, son fils, crurent en lui, et la plus grande partie du
peuple suivit cet exemple. La légende ajoute qu'il vécut longtemps encore,
honoré de tous pour la sainteté de sa conduite. Selon les uns, il mourut
frappé de la foudre ; selon les autres, il fut tué à Balkh par un soldat
touranien. On s'est demandé souvent s'il était un personnage historique, ou
seulement un héros mythique égaré dans l'histoire. On ne saurait trancher
pareille question d'une manière décisive : ce dont on peut être assuré,
c'est que, s'il vécut réellement, rien ne nous est arrivé de lui que le nom[39].
Au début, le dieu suprême des Iraniens était le cercle entier du ciel[40], le plus solide des dieux, car il a pour vêtement la voûte
solide du firmament, le plus beau, le plus intelligent, celui dont les
membres ont les proportions les plus harmonieuses. Son corps est la lumière souveraine et infinie, ses yeux sont le soleil et
la lune[41].
Plus tard, sans perdre tout à fait son caractère originel, il devint de plus
en plus abstrait et il se dégagea presque entièrement de la matière. On
emprunta au début pour le représenter le symbole d'Assour, et les sculpteurs
le montrèrent sortant à mi-corps du disque ailé qui plane au front des
monuments de Ninive ; on se le figura par la suite comme un roi de
stature imposante qui se révélait de temps en temps aux souverains de l'Iran.
On l'appelait Ahouramazdâ[42] l'omniscient, Çpentomainyous,
l'esprit du bien, le sage par excellence, le
lumineux, le resplendissant, le très grand et très bon, le très parfait et
très actif, le très intelligent et très beau[43]. Il est incréé,
mais il a créé toute chose[44] et il est
assisté dans l'administration de son œuvre par des légions d'êtres qui lui
sont soumis. Les plus puissants de ses coadjuteurs sont six génies d'ordre
supérieur qu'on appelle les Ameshaçpentas (Amshaspands),
les immortels bienfaisants. Ils étaient à
l'origine des dieux de la nature, le Soleil, la Lune, la terre, les vents,
les eaux, mais on leur attribua ensuite des fonctions moins matérielles, et l'on
fit d’eux, Vôhoumanô, le Bon esprit,
Ashavahista, le très pur, Khshathravairya, le
royaume désirable, Çpenta ârmaïti, la sagesse parfaite, Haourvatât, la santé, Ameretât,
l'immortalité[45].
Lumineux comme leur maître, ils ont tous les sept
même pensée, même parole, même action, même père, même Seigneur[46]. Toutefois,
chacun d'eux avait son domaine propre dont il s'occupait sans contrôle
étranger ; Vôhoumanô veillait sur le bétail, Ashavahista sur le feu,
Khshathravairya sur les métaux, Çpenta ârmaïti sur la terre, Haourvatât et
Ameretât sur les végétaux et sur l'air. Au-dessous d'eux, les Yazatas (Yzeds)[47], répandus par
milliers dans l'univers, veillent à la conservation et au jeu de ses
organes : l'esprit de la lumière divine, Mithra aux
beaux pâturages, le vigilant Mithra, qui, le
premier des Yazatas célestes, pointe au-dessus du mont Hara[48], avant le soleil immortel aux chevaux rapides, qui le
premier, en pompe dorée, saisit les beaux sommets et abaisse son regard
bienfaisant sur la demeure des Ariens[49] ; Mâo, le
génie de la lune ; le vent, Vâto ; l'atmosphère, Vayou, le grand des grands, le fort des forts, le dieu à l'armure
d'or, qui amasse l'orage et le lance contre le démon[50] ; Atar, le feu ; Verethraghna, qui
suscite la guerre et qui accorde la victoire ; les différents génies de
l'eau, du feu, de l'air et des astres[51]. Ils touchent de
près à une classe d'êtres spéciaux, les Fravashis (Frohar ou Feroüer). La Fravashi est le type
divin de chacun des êtres doués d'intelligence, son idée dans la pensée d'Ormazd[52]. Chaque homme,
chaque créature née ou à naître, chaque Yazata et Ahouramazdâ lui-même avait
sa Fravashi qui veillait sur lui et qui se dévouait entière à son salut.
Après la mort de l'homme, les Fravashis restaient au ciel et elles y
devenaient une sorte d'esprit indépendant, d'autant plus puissant pour le
bien que les créatures auxquelles elles avaient été attachées sur la terre
avaient mieux pratiqué la pureté et la vertu[53]. Pendant les six
derniers jours de l'année, elles erraient par les villes, demandant : Qui veut nous louer ? Qui nous offrir un sacrifice ?
Qui songer à nous et nous saluer, nous accueillir par un don de viande, de
vêtements purs et de prières ? Et s'il se trouve un homme qui
réponde à leur prière, elles le bénissent : Puisse-t-il
y avoir en sa maison troupes d'animaux et d'hommes, un cheval léger et un
chariot solide, un homme qui sache la manière de prier Dieu et de présider
dans une assemblée[54].
Ahouramazdâ avait fait le monde non par l'acte de ses
mains, mais par la magie de sa parole, et il avait voulu que son œuvre fût
exempte de fautes. Mais la création ne peut subsister que par l’équilibre des
forces qu'elle met en jeu, et l'opposition de ces forces inspira aux Iraniens
l'idée qu'elles étaient mues par deux principes ennemis, l'un créateur et
utile, l'autre mauvais et meurtrier. Le dieu de l'obscurité et de la mort,
Angrômainyous, se dressa contre Ahouramazdâ, le dieu de la lumière et de la
vie. Au début, ils régnèrent chacun dans son domaine, rivaux mais non pas
adversaires irréconciliables : ils cœxistèrent pendant des âges sans
entrer en conflit direct, séparés qu'ils étaient par le vide. Tant
qu'Ahouramazdâ se renferma inactif dans sa splendeur stérile, le principe du
mal sommeilla inconscient de lui-même sous la nuit qui n'avait pas eu de
commencement ; mais le jour où l'esprit qui accroît (Çpentomainyous) résolut enfin de se mettre au
travail, les premiers essais de son activité vivifiante éveillèrent Angrômainyous[55]. Le ciel
n'existait pas encore, ni l'eau, ni la terre, ni le feu, ni le bœuf, ni
l'homme, ni les démons, quand le mauvais se rua sur la lumière pour
l'étouffer ; mais Ahouramazdâ avait déjà évoqué les ministres de sa
volonté, Ameshaçpentas, Yazatas, Fravashis, et il récita la prière de vingt
et un mots dans laquelle tous les éléments de la morale sont résumés,
l'Ahouna-vairya : La volonté du Seigneur est la
règle du bien. Que les bienfaits de Vôhoumanô soient accordés aux œuvres
accomplies pour Mazdâ en ce moment : celui-là fait régner Ahoura qui
protège le pauvre. Angrômainyous fut repoussé, mais de même
qu'Ahouramazdâ se manifestait dans tout ce qu'il y a d'utile et de beau, dans
la lumière, dans la justice, dans la vertu, il voulut percer dans tout ce qui
est nuisible et laid, dans les ténèbres, dans le crime, dans le péché[56]. Il opposa aux
six Ameshaçpentas six esprits égaux en force et en puissance : Akômanô,
la pensée mauvaise ; Andra, le feu
destructeur, qui cherche à semer dans le monde le chagrin et le péché ;
Çaourou, la flèche de la mort[57], qui pousse les
rois à la tyrannie, les hommes au vol et au meurtre ; Nâonghaithya,
l'arrogance et l'orgueil ; Taourou, la soif ; Zaïri, la faim[58]. il suscita
contre les Yazatas les Daêvas (devs) ou
démons, qui ne cessent d'assiéger la nature et de s'opposer à la régularité
de ses mouvements[59]. Au moment de la
création, tandis qu'Ahouramazdâ émettait la lumière, l'homme, tout ce qu'il y
a de bon en ce monde, Angrômainyous évoquait les ténèbres, les animaux et les
plantes nuisibles : jaloux de l'homme, il chercha à le faire déchoir.
Avant l'arrivée de Zoroastre, ses créatures mâles (Yatous) et femelles (Païrikas,
Péris) se mêlaient librement à l'humanité et contractaient des
alliances avec elle : Zoroastre brisa leurs corps et leur défendit de se
révéler autrement que sous forme de bêtes[60], mais leur
pouvoir ne sera complètement détruit qu'à la fin des temps. Alors trois
prophètes issus de Zoroastre, Oukhshyatereta, Oukhshyatnémô, Çaoshyañt ou
Açtvatereta, dicteront trois nouveaux livres de la loi qui compléteront le
salut du monde, mais à Çaoshyañt est réservé l'honneur de porter le coup décisif.
La lumière souveraine s'attachera à lui et à ses compagnons ; il
affranchira les créatures de la corruption et de la pourriture, puis il rendra l'univers éternellement vivant, éternellement
accroissant, maître de lui-même. Les ténèbres se dissiperont devant la
lumière, la mort devant la vie, le mal devant le bien. Akoumanô frappe, mais Vôhoumanô le frappera à son tour. La
parole de mensonge frappe, mais la parole de vérité la frappera à son tour.
Haourvatât et Ameretât frapperont et la faim et la soif ; Haourvatât et
Ameretât frapperont la faim terrible, la soif terrible[61]. Angrômainyous
lui-même devra confesser la supériorité d'Ahouramazdâ, et la perfection
régnera souveraine[62].
Au milieu de ce conflit des deux principes, l'homme,
assailli par les Daêvas, défendu par les Yazatas, vit selon la loi et la
justice dans la condition où le sort l'a jeté. Il doit contribuer autant
qu'il est en lui à l'accroissement de la vie et du bien, et suivant qu'il
travaille à remplir cette fin naturelle ou qu'il agit pour la contrarier, il
est l'ashavan, le pur, le fidèle
ici-bas et le bienheureux en l'autre monde, ou l'anashavan, le maudit qui se révolte contre la pureté. La plus
haute place dans la hiérarchie appartient à l'âthravan, au mage dont la voix glace les démons de terreur, puis
au soldat dont la massue terrasse les impies ; mais, à côté d'eux, le
législateur a réservé une place d'honneur à celui qui cultive la terre. C'est un saint, celui qui s'est construit ici-bas une maison,
dans laquelle il entretient le feu, du bétail, sa femme, ses enfants et de
bons troupeaux. Celui qui fait produire du blé à la terre, celui qui cultive
les fruits des champs, celui-là cultive la pureté : il avance la loi
d'Ahouramazdâ autant que s'il offrit des sacrifices[63]. L'homme a été
placé ici-bas afin de disputer à Angrômainyous les parties stériles du
sol : labourer est son premier devoir. Son second est de protéger les
créatures d'Ahouramazdâ et d'anéantir celles d'Angrômainyous. Il aidera donc
ses coreligionnaires ; il leur donnera un vêtement s'ils sont nus, et il
ne refusera jamais du pain au laboureur affamé sous peine de tourments
éternels. Même sa charité s'étendra aux bêtes mazdéennes, au taureau, au mouton,
au hérisson, au chien. Le chien est la meilleure des créatures d'Ahouramazdâ,
celle pour laquelle il faut avoir le plus de respect ; c'est pêché non
seulement que le tuer[64], mais que lui
servir des os dans lesquels il ne peut mordre ou des
aliments assez chauds pour lui brûler la gueule ou la langue[65].
Pour le reste, on avait soin de ne pas surcharger la vie
de formules ; on exigeait de l'Iranien qu'il crût en Dieu, qu'il lui
adressât des prières et des sacrifices, qu'il fût simple de cœur, sincère en
paroles, loyal dans tous ses actes. Nous adorons
Ahouramazdâ, le pur, le seigneur de pureté ; nous adorons les
Ameshaçpentas, les possesseurs du bien, les distributeurs du bien ; nous
adorons tout ce que le bon esprit a créé, tout ce qui peut servir au bien de
sa création et à l'extension de la vraie foi. - Nous louons toutes les bonnes
pensées, toutes les bonnes paroles, toutes les bonnes actions qui sont ou qui
seront, et nous conservons en pureté tout ce qui est bon. - Ahouramazdâ, être
toujours bon, toujours heureux, nous nous efforçons de penser, de parler,
d'agir comme il convient pour assister les deux vies[66], celle de l'âme
et celle du corps. L'homme de bien par excellence (ashavan) est celui qui a bonne pensée, bonne parole, bonne
action ; quiconque réunit en soi ces trois vertus est en état d'ordre et
de pureté complète (asha)[67]. Une fois sorti
de la perfection, ou n'y rentrait que par le repentir accompagné de bonnes
œuvres : détruire les animaux malfaisants la grenouille, le serpent, la
fourmi[68], transformer les
terres incultes en terres cultivées, marier une jeune fille pure et saine à
un homme juste[69],
étaient autant de modes d'expiation recommandés par la loi. Le mariage était
strictement obligatoire, et, comme il paraissait d'autant plus recommandable
que la parenté était plus étroite entre les deux époux, non seulement on
accouplait la sœur au frère, mais le père à la fille et le fils à la mère, au
moins parmi les mages[70]. Nulle loi ne
restreignait le nombre des épouses ou des concubines : loin de là, l'on
estimait qu'un homme devait s'unir à autant de femmes que sa fortune lui
permettait d'en entretenir. Après la mort, il était défendu de brûler le
corps, de l'ensevelir[71], ou de le jeter
dans la rivière : à le faire, on eût souillé le feu, la terre ou l'eau.
On avait deux manières différentes de se débarrasser du cadavre sans dommage
pour la pureté des éléments. On le recouvrait d'une couche de cire et on
l'enfouissait[72] :
l’enduit était censé empêcher l'impureté qu'un contact direct avec la terre
aurait produite. On l'exposait en plein air et on le laissait dévorer aux
oiseaux et aux bêtes de proie[73] : en ce
cas, de grandes tours rondes servaient de cimetières[74]. L'âme, après
être restée trois jours encore dans le voisinage de sa dépouille mortelle, la
quittait à l'aube du quatrième pour se rendre au jugement. Le génie Rashnou
Razishta, le véridique par excellence, pesait ses actions bonnes et mauvaises
dans la balance infaillible et l'acquittait ou la condamnait, selon le
témoignage de sa propre vie. Au sortir du tribunal, on la menait à l'entrée
du pont Chinvat, qui était jeté sur l'enfer et qui menait au paradis. Impie,
elle ne le franchissait pas, mais elle tombait dans l'abîme, où elle devenait
l'esclave d'Angrômainyous ; pure, elle le passait sans peine avec l'aide
de l'ange Çraosha. Vôhoumanô lui souhaitait la bienvenue, la présentait au
trône d'Ahouramazdâ comme il avait fait Zoroastre, puis lui assignait la
place qu'elle devait occuper désormais jusqu'au jour de la résurrection des
corps[75].
L'Avesta avec les doctrines qu'il renferme, c'est le code d'une secte religieuse très bornée ;
c'est un Talmud, un livre de casuistique et d'étroite observance. J'ai peine
à croire que ce grand empire perse ait eut une loi aussi stricte[76]. Les livres
sacrés de l'Iran, tels que nous les possédons aujourd'hui, ont été rédigés
probablement à l'époque des Sassanides : une tradition fort ancienne
raconte que le roi des Parthes, Vologèse 1er, ordonna qu'on
recueillît tous ceux de leurs fragments qui avaient échappé aux persécutions
d'Alexandre, et que l'édition définitive en fut publiée sous Sapor II Anoushirvân,
vers le milieu du vie siècle de notre ère[77]. La collection
renferme des chapitres fort anciens, écrits dans une langue plus archaïque[78], et une partie
des idées qui y sont exprimées découle de textes déjà considérés comme étant
canoniques au temps des rois achéménides ; mais le peu que les
historiens grecs nous racontent des religions mèdes et perses diffère sur
bien des points de ce que l'Avesta nous enseigne. Il n'est pas certain que le
dualisme ait été aussi nettement réglé alors qu'il l'est dans les livres de
la loi, ni que les rois achéménides aient connu l'existence d'Angrômainyous.
La coutume qu'ils avaient de se construire, en vue de leur capitale, des
tombes monumentales, dont quelques-unes existent encore, montre que le fait
d'enterrer un cadavre n'était pas considéré comme un sacrilège. Il semble
cependant que beaucoup de préceptes, qui n'étaient pas observés par le
peuple, étaient pratiqués par les prêtres, par ces Mages qui formaient une
des six tribus de la nation médique[79]. En tout cas les
observances que la loi leur imposait étaient innombrables et minutieuses.
Ahouramazdâ et ses aides n'avaient ni temples, ni tabernacles, et bien qu'on
les figurât parfois dans les bas-reliefs sous des espèces humaines et
animales, personne ne se serait risqué à ériger dans leurs sanctuaires ces statues
soi-disant animées ou prophétiques auxquelles les Égyptiens et les Assyriens
rendaient hommage. Toutefois on leur élevait, au sommet des collines, dans
les palais, au centre des cités, des pyrées, c'est-à-dire des abris où la
flamme s'allumait en leur honneur, et ne s'éteignait plus d'âge en âge. Ces
pyrées allaient d'ordinaire deux par deux, et c'est ainsi qu'on les rencontre
çà et là parmi les ruines, à Nakhsh-î-Roustem, par exemple[80]. Ils ont la
forme d'un cube et ils ressemblent à des tours flanquées aux quatre angles de
colonnes reliées par des arches demi-circulaires ; une rangée de créneaux
triangulaires les surmonte et le haut en est creusé légèrement pour réserver
la place du foyer.
Les rites du sacrifice duraient longtemps, et ils se
compliquaient de manipulations, de gestes cérémoniels et d'incantations
interminables. Où le pyrée ne devait pas abriter un feu perpétuel, on
l'allumait avec des brindilles écorcées et purifiées par avance, puis on
l'entretenait avec des bois précieux, de préférence du cyprès ou du laurier,
mais on avait soin de ne pas souffler sur la flamme pour l'activer :
l'haleine humaine la souillait, et celui qui commettait volontairement cette
grave offense était puni de mort[81]. L'offrande
ordinaire consistait en pains, en fruits, en parfums, en fleurs, mais, quand
l'occasion exigeait un sacrifice sanglant, le cheval était la victime
préférée[82],
puis le bœuf, la vache, la brebis, le chameau, l'âne, le cerf : dans
certaines circonstances même, lorsqu'on souhaitait se concilier la faveur du
dieu des morts, on offrait un homme[83]. Le roi, représentant
d'Ahouramazdâ sur la terre, officiait quand il lui plaisait, mais, lui excepté,
nul ne pouvait se dispenser de l'entremise des Mages. Les fidèles se
rendaient en procession à l'endroit où la cérémonie devait s'exécuter, et le
prêtre, coiffant la tiare, récitait une invocation d'une voix basse et
mystérieuse, afin d'appeler les bénédictions du ciel sur le roi et sur la
nation[84]. Il tuait
ensuite la victime d'un coup sur la tête, et il la coupait en portions qu'il
distribuait aux assistants, sans se rien réserver, car Ahouramazdâ ne voulait
pour lui que l'âme : dans quelques cas, la victime était brûlée en
entier, le plus souvent, on ne mettait sur le feu qu'un peu de la graisse et
des entrailles[85].
L'officiant se couvrait la bouche avec les rubans qui tombaient de sa mitre,
pour empêcher son haleine d'effleurer la flamme ; il tenait dans ses
mains le petit fagot de brindilles de tamarisque, le baresman[86],
et il préparait la liqueur mystérieuse du haoma[87]. Tous les
membres de la tribu des mages n'étaient pas nécessairement des prêtres, mais
ceux-là seuls qui avaient été voués au sacerdoce dès leur enfance, et qui,
après avoir reçu l'instruction nécessaire, étaient ordonnés régulièrement.
Ceux-là se divisaient en plusieurs classes dont trois au moins avaient des
fonctions séparées, les magiciens, les interprètes des songes, et les
prophètes, parmi lesquels on choisissait le conseil de l'ordre et son chef
suprême. Leur existence était austère : ils devaient s'abstenir de toute
nourriture ayant eu vie, et même les classes auxquelles la viande était
permise n'en pouvaient user que sous de certaines restrictions. Leurs
vêtements étaient simples ; ils ne se paraient d'aucun bijou, et ils observaient
la plus stricte fidélité dans le mariage : les, vertus qu'ils avaient ou
qu'on leur prêtait leur assuraient un ascendant incontestable sur le peuple aussi
bien que sur les nobles, et le roi lui-même n'entreprenait rien avant d'avoir
consulté Ahouramazdâ par leur entremise. Plusieurs auteurs classiques
affirment que, sous des apparences d'austérité, ils cachaient des vices
monstrueux, et ce que nous savons d'eux par les monuments originaux ne nous
permet pas de combattre ou d'approuver ce jugement ; toutefois il est
probable que, même dans les derniers temps, la dépravation fut chez eux la
particularité de quelques-uns plutôt que le tort de tous. Ils restèrent
jusqu'au bout fidèles aux règles de pureté cérémonielle et d'honnêteté que
les livres sacrés de leurs ancêtres leur imposaient.
L'empire chaldéen et le monde oriental depuis la chute de Ninive jusqu'à
la chute de l'empire mède.
La
Chaldée avait dû lutter elle aussi pour saisir la part qui
lui avait été attribuée dans l'héritage de l'Assyrie. Non seulement Néchao
lui avait ravi la Judée, la Phénicie et la Syrie, qu'elle estimait
lui revenir de droit, mais les Araméens nomades du Khabour et du Balikh lui
refusaient leur hommage, et les bandes de Cimmériens ou de Scythes qui battaient
encore la campagne depuis l'invasion de Madyés se joignaient souvent à eux
pour attaquer les cités de la Mésopotamie : récemment encore elles
avaient pillé la cité sainte de Harrân et dévasté le temple du dieu Sin[88]. Nabopolassar,
trop vieux pour partir lui-même en expédition contre elles, confia
probablement le commandement de ses troupes au fils qu'il avait choisi afin
de lui succéder, Nabuchodorosor[89], le mari de la
princesse mède. Il ne fallut pas à celui-ci moins de trois ans pour remettre
tout en ordre : Harrân demeura aux barbares sous condition d'un tribut,
mais le district des Soubarou fut annexé à l’empire, et la domination
babylonienne escalada les versants méridionaux du Masios[90]. Allait-elle en
rester là et laisser les pays d'au delà l'Euphrate, aux mains de ce Néchao
qu'on affectait de considérer comme un satrape rebelle ? Nabuchodorosor
franchit l'Euphrate en 604. On ne sait rien des débuts de la guerre, mais la
rencontre décisive eut lieu sur les bords du fleuve, non loin de Gargamish[91] ; les
Égyptiens furent complètement battus, et les Syriens surent désormais à quoi
s'en tenir sur la force des deux grands empires qui se disputaient leur
allégeance. La Judée, qui avait le
plus souffert des Égyptiens, accueillit la nouvelle de leur désastre avec
joie, et le prophète Jérémie le célébra en strophes ironiques : Que vois-je ? les voilà culbutés, reculant
d'épouvante ! Leurs guerriers sont écrasés, ils courent, ils fuient sans
tourner la tête… Ah ! le plus agile
n'échappera pas ! Là, au nord, sur les bords de l'Euphrate, ils
trébuchent, ils tombent ! … Ce jour est
pour le Seigneur, pour le Dieu des astres un jour de vengeance, où il
frappera ses ennemis ; l'épée doit se rassasier, s'abreuver de leur
sang ; car le Seigneur, le Dieu des astres veut avoir son hécatombe au
pays du Nord, sur l'Euphrate ! Et maintenant monte en Galaad et cherche
du baume, vierge fille de l'Égypte. C'est en vain que tu multiplies les
remèdes ; pour toi, il n'y a plus rien qui puisse panser ta
blessure ! Les nations ont appris ta honte, et la terre est remplie de
tes cris : c'est que tes guerriers se renversent l'un sur l'autre et
tombent à la fois tous ensemble[92]. Nabuchodorosor
rentra en possession de tout le territoire, reçut en chemin la soumission de
Joïakîm et des rois indigènes ; il était déjà à Péluse, et il se
préparait à passer en Afrique, quand la mort de son père l'arrêta dans sa
marche. Il craignit qu'un compétiteur ne s'élevât en Chaldée pendant son
absence, il conclut un traité avec Néchao et il partit en toute hâte. Son impatience
d'arriver ne s'accommodant pas aux longueurs de la route ordinaire par Gargamish
et la Mésopotamie,
il se lança à travers le désert d'Arabie avec une légère escorte, et il entra
dans Babylone au moment où on l'y attendait le moins. Les prêtres avaient
pris la direction des affaires et ils lui avaient gardé le trône : il
n'eut qu'à paraître pour se faire acclamer et obéir[93].
Son règne fut long, prospère, et somme toute pacifique.
Les changements politiques survenus en Asie lui fermaient la plupart des
champs de bataille ouverts jadis aux Assyriens. Il n'y avait plus ni
Ourartou, ni Mannai, ni Parsua, ni Ellipi, ni Élam, mais un seul royaume
Mède, où ce qui subsistait de la plupart de ces pays était incorporé :
même l'Assyrie propre depuis le Radanou et le bassin du Haut Tigre
appartenaient à Cyaxare. Du côté de l'Asie-Mineure, la Cilicie relevait
peut-être de Babylone, mais là, derrière la Cilicie c'étaient la Médie encore, puis
les tribus à demi barbares du Golfe de Pamphylie, et la Lydie par delà.
Nabuchodorosor ne rencontrait d'ennemis sérieux qu'à l'Ouest et au Sud, où il
avait une position analogue à celle des rois d'Assyrie moins d'un siècle
auparavant. L'expérience d'alors avait prouvé que le dernier but où tendait
l'ambition des conquérants asiatiques était la possession de Memphis et de
Thèbes, voire de l'Éthiopie : comme Sargon, comme Sennachérib, comme
Assourbanabal, Nabuchodorosor, maître de la Syrie, était un danger perpétuel pour
l'existence de l'Égypte. Les Pharaons des dynasties précédentes avaient
essayé de s'abriter derrière les États syriens, et la politique de Sabacon
avait consisté à maintenir la barrière de royaumes qui s'interposait entre
lui et l'Assyrie. Damas et Samarie tombées, il ne restait plus à Pharaon
d'autre ressource que d'être conquérant et de s’emparer, s'il le pouvait, de
la côte phénicienne. Psammétique 1er avait commencé cette œuvre
par la prise d'Ashdod ; Néchao II avait paru l'achever après la bataille
de Mageddo. La défaite de Gargamish avait tout renversé, mais en prouvant la
justesse de vue des hommes d'État égyptiens. Si la bataille perdue par Néchao
l'avait été entre Péluse et Gaza, c'en eut été fait de l'Égypte[94] : livrée
sur les bords de l'Euphrate, les vaincus avaient eu le temps de rassembler
des forces nouvelles et d'en garnir le front est du Delta. Néchao ne se
découragea donc pas malgré son insuccès. Il appartenait à une race
persévérante, qu'un siècle de revers n'avait pas découragée de ses
aspirations à la couronne, et qui ne l'avait gagnée qu'à force de patience et
d'obstination. Il remonta sa flotte et son armée en silence, comptant sur
l'esprit remuant des Phéniciens et des Juifs pour lui fournir une prompte occasion
de revanche.
Une fois de plus il recourut à la Grèce. Des ingénieurs
ioniens lui construisirent des chantiers maritimes et lui remplacèrent son
vieux matériel par une flotte de trières. En même temps, il essayait de
restaurer le canal des deux Mers, abandonné ou ensablé depuis la chute de la
vingtième dynastie ; il comptait le creuser assez large pour que deux
trières pussent y voguer de front ou s'y croiser, sans déborder. Le canal
s'embranchait sur le Nil un peu en amont de Bubastis, non loin de Patoumos :
il longeait le pied des collines arabiques de l'est à l'ouest, puis il
s'enfonçait dans la gorge de l'Ouady Toumilât, et il déviait au sud dans la
direction de la mer Rouge. La tradition contait qu'après avoir perdu cent
vingt mille hommes dans cette entreprise, Néchao la suspendit sur la foi d'un
oracle : on lui avait prédit qu'il travaillait pour les barbares[95]. Déçu de ce
côté, il tourna son activité vers un autre objet. Les Tyriens et les
Carthaginois avaient exploré, le long de la côte d'Afrique, des pays
abondants en or, en ivoire, en bois précieux, en épices, mais la politique
jalouse des deux peuples empêchait les autres nations d'arriver à travers la Méditerranée
jusque dans ces régions lointaines. Les Égyptiens avaient encore présent le
souvenir des campagnes maritimes d'autrefois, au siècle où l'escadre de la
reine Hatshopsouîtou naviguait les mers d'Arabie et relâchait aux Échelles de
l'Encens. Néchao lança les matelots phéniciens de sa flotte à la recherche
des terres nouvelles ; ils partirent du golfe d'Arabie sans trop savoir
où ils allaient. L'entreprise, hardie en tout temps, était des plus
périlleuses pour les petits vaisseaux de l'époque ; ils devaient
toujours cheminer en vue des côtes, et les côtes de l'Afrique sont d'une
navigation difficile. Pendant plusieurs mois les Phéniciens continuèrent vers
le sud, la droite au continent qui s'allongeait devant eux, la gauche à
l'orient. Vers l'automne, ils débarquèrent sur la plage la plus proche, semèrent
le blé dont ils s'étaient munis et attendirent que le grain fût mûr :
aussitôt après la moisson, ils reprirent la mer. Le souvenir précis de leurs
observations et de leurs découvertes se brouilla bientôt. On se rappela
pourtant qu'arrivés à un certain endroit ils virent avec stupeur que le soleil
sembla modifier son cours et ne cessa plus de se lever à leur droite :
ils avaient doublé la pointe méridionale de l'Afrique et ils commençaient à
remonter vers le nord. La troisième année ils franchirent les Colonnes
d'Hercule et ils rentrèrent au port : l'amitié étroite qui mussait Tyr à
l'Égypte les protégea sans doute contre la jalousie des Carthaginois pendant
cette dernière croisière. La faiblesse des moyens dont la marine de cet âge
disposait rendit leur voyage inutile ; il n'ouvrit aucune voie nouvelle
au commerce, et il demeura comme un fait curieux, mais sans résultat. Les
prêtres égyptiens le racontèrent à Hérodote, et Hérodote lui-même nous en a
parlé sans trop y croire[96].
Ce n'était là qu'un épisode curieux : tout en
poussant ses explorations aussi loin qu'il le pouvait vers le sud, Néchao
suivait d'un œil vigilant les événements qui s'accomplissaient en Asie.
Depuis ses luttes désastreuses contre l'Assyrie, la Phénicie avait
conservé une aversion profonde pour tous ceux de ses maîtres qui lui venaient
de l'est. Il en était de même de la plupart des États syriens qui avaient
encore un semblant d'indépendance, Ammon, Moab, les Nabatéens, les
Philistins, Juda. Néchao exploita habilement ces haines ; quatre ans
après sa défaite, il décida Joïakîm à se révolter. La mort de Josias avait
porté un coup terrible aux espérances des prophètes. « Jamais avant lui
il n'y avait eu roi qui lui fût comparable pour s'être dévoué à l'Éternel de
tout son cœur et de toute son âme, et de toute sa force, en toutes choses,
conformément à la loi de Moïse, et après lui jamais il n'en surgit de pareil[97] ». Les
événements qui suivirent la déposition de Joachaz, puis le brusque
renversement de la puissance égyptienne, l'avènement de la domination
chaldéenne ébranlèrent plus profondément encore la foi en l'efficacité de la
réforme. Le peuple sembla n'y voir qu'une vengeance de Jahvé contre les
impies qui avaient renversé ses temples et prétendu l'enfermer dans un
sanctuaire unique. Le culte du Dieu d'Israël reprit ses allures d'autrefois,
et celui des divinités étrangères fut pratiqué avec plus de ferveur que
jamais. Le désappointement des prophètes et de leurs partisans fut d'autant
plus amer qu'ils avaient cru un instant toucher presque au but de leurs
efforts[98].
Un jour de fête, le plus connu d'entre eux, Jérémie, fils d'Hilkiah, se présenta
sur le parvis et apostropha violemment la foule : Ainsi a dit Jahvé : Si vous ne m'écoutez point et ne marchez dans la loi que je vous ai
proposée, si vous n'obéissez aux paroles des prophètes mes serviteurs que je
vous mandé et que vous n'écoutez point, je mettrai ce temple en même état que
celui de Silo, et je livrerai cette ville en malédiction à toutes les nations
de la terre. On était au commencement du règne de Joïakîm, au
moment le plus fort de la réaction contre les tendances de Josias ; aussitôt que Jérémie eut achevé, les sacrificateurs, les
prophètes et le peuple entier le saisirent, disant : Tu mourras la mort. La foule
s’amassa dans le temple, les principaux de Juda montèrent de la maison du roi
à celle de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve. L'accusation
énoncée, quelques-uns des juges déclarèrent que l'inculpé ne méritait aucun
châtiment, puisqu'il avait parlé au nom de Jahvé, et les anciens alléguèrent
en sa faveur l'exemple de Michée : Le roi
Ezéchias et ceux de Juda le firent-ils mourir ? Il échappa cette
fois, mais d'autres n'eurent pas le même bonheur. Uriah de Kiriath-Jéarim,
dont le seul crime avait été de prophétiser contre Jérusalem en la même
manière, eut beau se sauver en Égypte ; Joïakîm dépêcha à ses trousses Elnathan,
fils de Hakbor, et quelques hommes avec lui, qui le ramenèrent à Jérusalem,
le décapitèrent, et jetèrent son corps à la fosse commune[99].
Cette séparation entre le peuple et l'homme qui
représentait la grande tradition prophétique s'accentua rapidement ; le
moment vint où Israël sembla s'être réduit à Jérémie et à son disciple
Baruch. Jérémie était en effet de ceux à qui le désastre de Mageddo avait
enlevé toute espérance au présent. Lorsqu'il présenta son premier recueil de
prophéties au roi, celui-ci le déchira, puis le brûla, et il fallut que plus
tard le prophète et Baruch, en restituassent le texte entier de mémoire[100]. Le plus grand
nombre ne pouvait en effet s'habituer à l'idée que Jahvé déserterait Juda
ainsi qu'il avait déserté Israël. Toute tentative contraire aux intérêts du
Chaldéen, toute alliance avec ses ennemis paraissait légitime, et les
conseils de l'Égypte trouvaient un accueil favorable auprès de la masse. Nabuchodorosor
se rendit sur les lieux, de sa personne, et sa présence enraya le mouvement ;
Joïakîm ne sortit pas du devoir[101], mais trois ans
plus tard, il se souleva de vrai, toujours à l'instigation de Néchao.
Nabuchodorosor ne jugea pas la conjoncture assez grave pour diriger lui-même
les opérations militaires. Il se contenta d'envoyer un de ses généraux avec
les contingents d'Ammon et de Moab, toujours prêts à oublier leur horreur du
Chaldéen lorsqu'il s'agissait de satisfaire leur haine contre le Juif.
Joïakîm, laissé à ses propres forces, résista avec tant de vigueur que
Nabuchodorosor fut contraint d'amener ses vétérans à la rescousse. Son armée
était encore en route quand Joïakîm mourut et fut remplacé par son fils, un
jeune homme de dix-huit ans, qui assuma le nom de Jékoniah ou Joïakîn.
Celui-ci ne régna pas longtemps. Nabuchodorosor arriva au moment même où il
montait sur le trône, et sa présence précipita le dénouement ; trois
mois après, Joïakîn se rendit à discrétion. Les trésors du temple furent
saisis, le roi exilé en Chaldée, l'armée réduite en esclavage, la population
ouvrière transportée à Babylone, où on l'employa aux grandes
constructions ; le demeurant fut remis au dernier fils de Josias,
Mattaniah, alors âgé de vingt et un ans (597).
Mattaniah, comme ses prédécesseurs, changea de nom en changeant de
condition : il s'appela désormais Zédékias[102].
Néchao n'avait rien fait pour secourir les Juifs. Il
mourut deux ans plus tard, sans avoir rencontré l'occasion qu'il cherchait
(595)[103],
et son fils Psammétique II n'eut pas le loisir d'entreprendre quoi que ce fût
contre l'Asie : une incursion en Éthiopie (594) signala son règne[104], mais il
disparut avant d'avoir rien accompli de grand (589)[105]. Pendant cet
intervalle, la Syrie,
tranquille en apparence, n'avait cessé de s'agiter sourdement ; les partis
qui ne voyaient de salut que dans une alliance étroite avec l'Égypte
s'étaient remis du coup brutal dont l'échec de Néchao et de Joïakîm les avait
frappés. A Jérusalem, le courant qui portait les esprits vers Pharaon devint
si fort que Zédékias, créature de Nabuchodorosor, y fut entraîné. Les
prophètes de l'ancienne école, pleins de foi en Jahvé, continuaient à penser
que l'humiliation de leur patrie ne pouvait durer longtemps encore. Plus les
désastres s'accumulaient sur elle, plus l'heure de la délivrance leur
paraissait voisine. Ceux d'entre eux qui avaient accompagné Joïakîn dans
l'exil, Achab, Zédékiah, fils de Maassiah, Shémaïah, se prédisaient à
eux-mêmes un retour prochain. Ceux qui étaient demeurés à Jérusalem ne cessaient
de répéter au peuple : Vous ne serez point
asservis au roi de Chaldée ; les vases sacrés du temple sortiront de
Babylone. Jérémie essayait en vain de combattre l'effet de leurs
déclamations. Il écrivait aux exilés de s'armer de patience : Bâtissez des maisons et demeurez-y, plantez des jardins et
mangez-en les fruits ! Mariez-vous, engendrez des fils et des filles,
donnez des femmes à vos fils et des époux à vos filles pour qu'elles
deviennent mères à leur tour. Multipliez-vous là et ne laissez pas diminuer
votre nombre… Gardez-vous d'écouter vos prophètes qui sont au milieu de vous
ou vos devins et ne croyez pas aux songes que vous auriez, car ils mentent en
prophétisant en mon nom : je ne leur ai pas donné mission, dit Jahvé.
Car voici ce que dit Jahvé : Quand
soixante-dix ans seront accomplis pour Babel, je vous visiterai et je
ratifierai pour vous une bonne promesse de vous ramener dans votre patrie[106]. L'un de ceux
qu'il dénonçait de la sorte, Shémaïah, s'indigna de ces conseils pacifiques
et adressa au grand prêtre Zéphaniah une lettre, dans laquelle il le sommait
de condamner aux ceps et au carcan ce brouillon d'Anatôt, qui faisait le
prophète à Jérusalem et ne savait que recommander la patience aux déportés.
Jérémie n'était jamais en reste d'invectives avec ses adversaires : il
maudit Shémaïah dans sa personne et dans sa race[107], et il n'en
continua que plus fort à prêcher contre les partisans de la politique
agressive : N'écoutez point ces gens-là, mais
rendez-vous plutôt sujets du roi de Babylone, et peut-être vous vivrez ;
pourquoi cette ville serait-elle réduite en un désert. Mais s'ils sont
prophètes, et que la parole de Jahvé soit en eux, qu'ils intercèdent
maintenant auprès de Jahvé des armées, afin que les
vases sacrés qui sont demeurés au temple et au palais des rois et à Jérusalem
n'aillent pas rejoindre les autres à Babylone[108]. Un jour il
descendit en public le joug au cou, tandis que le prophète
Hananiah-ben-Azzour de Gibéon prêchait devant les prêtres et le peuple en ces
termes : Ainsi a dit l'Éternel des armées, le
Dieu d'Israël : J'ai rompu le joug
du roi de Babylone. Dans deux ans accomplis je ramènerai ici Jékoniah, fils
de Joïakîm, roi de Juda, et tous ceux qui ont été déportés de Juda et Babylone.
Puis, levant le joug de dessus le cou de Jérémie, il le rompit, car ainsi a dit Jahvé : Entre ceci et deux ans accomplis, je romprai de même le joug de
Nabuchodorosor, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations.
Le jour d'après, Jérémie reparut chargé d'un nouveau joug, mais d'un joug de
fer, emblème de celui que Jahvé devait jeter sur le
cou de toutes les nations afin qu’elles soient asservies au roi de Babylone[109].
L'avènement d'Apriès au trône d'Egypte suggéra de nouveaux
arguments aux partisans de la révolte. On le savait entreprenant, ambitieux,
préparé de longue main aux chances d'une guerre : Tyr et la Phénicie,
Jérusalem et les pays situés au delà du Jourdain coururent aux armes d'un
commun accord. Nabuchodorosor, placé entre trois adversaires, hésita un
moment. Il s'arrête au carrefour des chemins pour
consulter l'avenir ; il mêle les flèches divinatoires, interroge les
Téraphim, inspecte le foie des victimes[110]. Son indécision
ne fut pas de longue durée. Juda était le nœud de la coalition ; son
territoire reliait les confédérés de la côte à ceux du désert, les forces de
l'Égypte à celles de la
Syrie. Tandis qu'une division ravageait la Phénicie et
commençait le blocus de Tyr, le gros de l'armée se rua sur la Judée. Zédékias
n'osa l'affronter en rase campagne et il se renferma dans Jérusalem, cette
fois le Chaldéen était à bout de patience ; il ravagea le pays sans
miséricorde, livra les habitants des campagnes à la merci des Philistins et
des Edomites, bloqua les deux forteresses de Lakhish et d'Azèkah, et ne se
présenta devant la capitale qu'après avoir tout mis à feu et à sang[111]. Il la serrait
déjà de prés quand il apprit qu'Apriès débouchait du côté de Gaza ; Zédékias
dans sa détresse avait mandé ses agents en Égypte
pour qu'on lui donnât des chevaux et une armée considérable[112]. Le Chaldéen
leva aussitôt le siège et marcha à la rencontre de ce nouvel ennemi. Le parti
populaire triomphait déjà du succès de sa politique ; Jérémie pourtant
n'avait pas foi en l'heureuse issue de l'entreprise : Ne vous faites pas d'illusion à vous-mêmes, disant : les Chaldéens se retireront de Judée,
car ils ne se retireront point. Quand même vous battriez toute l'armée qui
vous assiège, et qu'il ne restât d'eux qu'un homme blessé sous chaque tente,
ils se lèveraient tout de même et bouteraient le feu à la ville[113]. On ne sait pas exactement ce se passa en
cette occurrence : selon les uns, le roi d'Égypte se retira sans
combattre[114] ;
selon d'autres, il accepta la bataille et il fut vaincu[115].
Lui parti, la chute de la ville n'était plus qu'une
question de jours, et la résistance ne pouvait plus servir qu’à irriter le
vainqueur. Les Juifs ne s'en défendirent pas moins avec l'obstination
héroïque et, malheureusement aussi, avec l'esprit de discorde qui fut toujours
au fond de leur caractère. Pendant le court moment de répit que la diversion
d'Apriès leur avait procuré, Jérémie avait voulu sortir de Jérusalem pour
continuer sa prédication en Benjamin. Arrêté à la porte sous prétexte de
trahison, il fut fouetté, incarcéré, et il n'obtint d'adoucissement aux
rigueurs de ses geôliers que par l'intervention personnelle du roi[116]. Interné dans
la cour de la prison, il continuait de prêcher à tout venant : Celui qui demeurera dans cette ville mourra par l'épée,
par la famine, par les maladies ; mais celui qui sortira vers les
Chaldéens vivra, et son âme lui sera pour butin, et il vivra. Car ainsi a dit
Jahvé : Cette ville sera livrée
certainement à l'armée du roi de Babylone et il la prendra. Les
généraux de Zédékias et les partisans de la résistance interpellèrent le
roi : Qu'on fasse mourir cet homme, car il rend
lâches les mains des hommes de guerre et de tout le peuple par de telles
paroles. Livré à ses accusateurs, jeté au fond d'une citerne à moitié
remplie de boue, il n'échappa, grâce à la compassion d'un eunuque de la
maison royale, que pour renouveler ses ordres de soumission plus
impérieusement. Zédékias lui demandait secrètement son avis : Si tu sors volontairement pour aller vers les officiers du
roi de Babylone, ta vie sera sauve, cette ville ne sera pas consumée des
flammes, et tu vivras toi et ta maison. Mais, si tu ne sors pas vers les
officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui
l'incendieront, et tu n'échapperas pas à leur main. Zédékias inclinait
à suivre les conseils du prophète, mais il s'était trop avancé pour pouvoir
reculer sans ignominie[117]. La famine se
joignit bientôt aux ravages de la guerre et des maladies, sans abattre la
constance des assiégés : on n'avait plus de pain, et l'on ne parlait pas
encore de se rendre. Enfin, après un an et demi de souffrances, la onzième année de Zédékias, au quatrième mois, au
neuvième jour du mois, il y eut une brèche pratiquée au mur de la ville. - Et
tous les principaux capitaines du roi de Babylone y entrèrent et se portèrent
à la porte du milieu. Zédékias essaya de s'enfuir au delà du
Jourdain : pris dans la plaine de Jéricho, il fût conduit à Riblah, où
Nabuchodorosor tenait cour plénière. Celui-ci traita le vaincu comme les gens
de sa race avaient accoutumé de traiter les rebelles : il fit égorger
ses fils et tous les magistrats de Juda en sa présence, puis il commanda
qu'on lui crevât les yeux et qu'on l'expédiât à Babylone chargé de doubles
chaînes. La ville fut démolie et brûlée sous la direction de Nabousaradan, un
des grands officiers de la couronne ; les soldats, les prêtres, les
scribes, les gens de haute classe furent transportés en Chaldée et dispersés
dans différentes villes. Il ne resta plus au pays que le petit peuple des
campagnes, à qui le vainqueur abandonna les vignes et les champs des riches.
L'œuvre de destruction accomplie, les Chaldéens se retirèrent, laissant le
gouvernement de la nouvelle province à un ami de Jérémie, nommé Guédaliah[118] (586).
Guédaliah ne vécut pas longtemps : il fut massacré à
Mizpah, avec les troupes juives et chaldéennes qui l'appuyaient par Ismaël,
fils de Nataniah, de la race de David[119]. Ismaël fut
attaqué à son tour par Jokhanan, fils de Karéah, et se réfugia presque seul
chez les Ammonites[120]. Ceux qui
avaient vengé Guédaliah et expulsé Ismaël craignirent à leur tour la colère
du maître, et ils s'enfuirent en Égypte, entraînant Jérémie et une partie du
peuple[121].
Apriès leur concéda des terres près de Daphné, d'où ils se répandirent à Migdol,
à Memphis et jusque dans la Thébaïde[122]. Même après
cette catastrophe, la mesure des maux de Juda ne fut pas comble. En 581, les
débris de la population s'allièrent aux Moabites et tentèrent la fortune des
armes : une dernière défaite, suivie d'un dernier exil, acheva leur
ruine. Les bannis de la première heure ne purent que pleurer de loin l'anéantissement
de leur race. La Judée
a été emmenée captive, tant elle est affligée et tant est grande sa
servitude ; elle demeure maintenant parmi les nations et ne trouve point
de repos. Les chemins vers Sion mènent deuil, parce que personne ne vient
plus aux fêtes ; ses portes sont béantes, ses sacrificateurs sanglotent,
ses vierges sont accablées de tristesse - ses enfants vont en captivité par
devant l'ennemi. - O Jahvé, tu demeures éternellement et ton trône dure d'âge
en âge ! - Pourquoi nous oublierais-tu à jamais ? Pourquoi nous
délaisserais-tu à toujours ? Ramène-nous à toi, que nous nous
convertissions ; - renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois[123]. La défaite des
peuples situés au delà du Jourdain suivit de prés, Moab d'abord, puis Ammon[124], puis Édom et
l'Arabie elle-même[125] : les tribus de
Kédar et leurs voisins, ces hommes aux tempes rasées,
virent réprimer sévèrement leurs brigandages. Plus tard, la tradition arabe
transforma ces razzias en guerres sérieuses menées jusqu'au fond de la
péninsule. Elle affirma qu'après avoir dispersé, près du bourg de Dhât-îrk,
les Djorhom Joctanides qui lui barraient le chemin de la Kaâbab,
Nabuchodorosor atteignit aux frontières de l'Yémen occidental, mais que la
fatigue de son armée l'empêcha de pousser plus loin : il revint sur ses
pas, emmenant une foule de captifs et deux tribus entières, celles d'Hadhourâ
et d'Ouabar, qu'il établit en Chaldée[126].
Tyr et l'Égypte restaient seules debout. Tyr, à l'abri
derrière les murailles de son île, commandait la mer et brava la colère
impuissante des Chaldéens ; après treize années d'efforts infructueux,
ils se résignèrent à traiter avec le roi Ithobaal III, qui avait conduit la
défense[127]
(574), et ils furent libres désormais de se tourner contre l'Egypte. Dès le
lendemain de la défaite de Néchao, il ne s'était guère passé d'année où les
prophètes juifs n'eussent proclamé prochaine la lutte entre Pharaon et la Chaldée.
Jérémie l'avait prédite plusieurs fois sans se laisser
décourager par le néant de ses prédictions[128] : en
apprenant la reddition de Tyr, un des captifs de Babylone, Ézéchiel,
l'annonça de nouveau. Ainsi a dit le Seigneur
Jahvé : J'en finirai avec le faste
d'Égypte par la main du roi de Babel. - Lui, et son peuple avec lui, les plus
barbares d'entre les nations, seront amenés pour ruiner le pays, et ils
dégaineront contre l'Égyptien, et ils joncheront le sol de cadavres. - Or je
mettrai les canaux à sec, et je livrerai le pays aux mains des méchants ;
je le désolerai et tout ce qu'il contient par la main des étrangers. Moi,
Jahvé, j'ai parlé ainsi. Ainsi a dit le Seigneur Jahvé : Je détruirai aussi les idoles, j'anéantirai
les faux dieux de Memphis, et il n'y aura plus de prince égyptien, et je
répandrai la terreur au pays d'Égypte. - Je désolerai la Thébaïde,
j'incendierai Tanis, et je ferai bonne justice de Thèbes ; - et je
répandrai une fureur sur Péluse, qui est la force d'Égypte, et j'exterminerai
la multitude qui est à Thèbes. - Quand je mettrai le feu en Égypte, Péluse
sera grièvement tourmentée et Thèbes sera rompue par diverses brèches, et il
n'y aura à Memphis que détresse en plein jour. - La jeunesse d'On et de
Bubaste tombera par l'épée ou s'en ira en captivité ; - et le jour
faudra dans Daphné, lorsque je romprai les appuis de l'Égypte et que
l'orgueil de sa force sera abattu ; une nuée la couvrira, et ses villes
iront en captivité[129]. A en croire
Josèphe, la prédiction du prophète aurait reçu son entier
accomplissement : Nabuchodorosor aurait envahi l'Egypte, battu et tué
Apriès, puis installé un gouverneur sur sa nouvelle conquête, et serait
rentré en Asie, emmenant avec lui les Juifs établis dans le Delta[130]. Les récits égyptiens
prouvent, au contraire, que Nabuchodorosor subit un échec sérieux. La flotte
d'Apriès, équipée par des Grecs, détruisit la flotte phénicienne au service
des Chaldéens, enleva Sidon et força les autres villes à se rendre sans
combat[131].
Toute la côte syrienne tomba aux mains de Pharaon sans que Nabuchodorosor fit
rien pour la lui disputer ou la lui reprendre. Des garnisons africaines
occupèrent Gébel et y construisirent, en pierres du pays, un temple dont on a
déterré récemment les ruines[132]. Par un coup de
fortune, Apriès atteignit en quelques semaines le but que ses ancêtres
avaient vainement poursuivi pendant un demi-siècle : il put s'intituler le plus heureux des rois qui avaient vécu auparavant
et s'imaginer, dans son orgueil, que les dieux eux-mêmes
seraient incapables de lui nuire[133].
Les dieux ne lui accordèrent pas de jouir longtemps du
fruit de ses succès. Les tribus libyennes de la côte, sans cesse harcelées
par les colons grecs de la Cyrénaïque, s’étaient adressées à lui comme à
leur protecteur naturel et elles lui avaient demandé secours contre les
empiétements de leurs voisins. Il n'eût pas été prudent de mettre les mercenaires
en face de leurs compatriotes : Apriès dépêcha contre Cyrène une armée
égyptienne, qui fut vaincue près du bourg d'Irasa et qui souffrit si
cruellement dans la déroute qu'un petit nombre de fuyards seulement regagna
la frontière du Delta[134]. Leur retour
produisit des troubles. Apriès avait encouru la haine des prêtres et de la
populace pour la protection qu'il avait accordée aux étrangers. On crut ou on
affecta de croire qu'il avait envoyé les soldats indigènes en Libye pour les
y exposer à une mort certaine et pour se débarrasser de gens dont la fidélité
lui était suspecte une sédition éclata[135]. Il y avait
alors à la cour un homme de basse extraction, Amasis, que sa bonne humeur
perpétuelle et son habileté avaient élevé des derniers rangs de l'armée au
grade de général[136]. Il l'envoya au
camp des rebelles avec ordre de les ramener au devoir. Amasis haranguait les
troupes, quand un soldat lui posa un casque sur la tête et le proclama roi.
Devenu d'ambassadeur chef de la révolte, il marcha contre Saïs et anéantit,
près de Momemphis[137], les trente
mille mercenaires qui défendaient encore le roi légitime (569). Apriès, pris dans la déroute, fut
d'abord épargné et traité avec honneur : il demeura associé au trône, et
son nom figura sur les monuments au même titre que celui de son vainqueur[138]. Mais, réclamé
au bout de quelque temps par la populace de Saïs, il fut livré à ses ennemis
et assassiné[139].
A Thèbes, la reine Onknas-Nofiribi, fille de Psammétique II, qui avait
succédé à Nitokris dans l'exercice du pouvoir sacerdotal[140], reconnut son
autorité ; mais, en Asie, il dut presque aussitôt repousser l'attaque
des Chaldéens. Un document découvert récemment raconte, qu'en l'an 37 de son
règne, Nabuchodorosor partit en campagne contre Ahmassou, roi d'Égypte. Nous
ne connaissons point malheureusement l'issue de la lutte[141]. La tradition
chaldéenne assure que l'Egypte fut conquise; la tradition égyptienne est
muette à cet égard[142]. Il est
probable qu'Amasis perdit les conquêtes phéniciennes de son prédécesseur et
fut réduit à l'Égypte : rien n'indique que l'Égypte même ait été entamée
et que les Chaldéens aient renouvelé à un siècle de distance l'exploit
d'Asarhaddon et d'Assourbanabal.
Ce fut la dernière guerre de Nabuchodorosor, la dernière
du moins dont l'histoire ait gardé la trace. Au temps où elle se termina, il
était déjà vieux et il devait songer à toute autre chose qu'aux armes ;
son ambition se borna désormais à terminer les grands travaux de construction
qui rendirent sa mémoire fameuse dans l'antiquité. Pendant le siècle qui
avait précédé la chute de Ninive, Babylone avait souffert cruellement des Assyriens.
Elle avait été saccagée deux fois par Sennachérib et par Assourbanabal, sans
compter les sièges et les pillages partiels qu'elle avait subis au cours de
ses révoltes perpétuelles. Nabopolassar avait déjà commencé l'œuvre de
réparation ; il semble l'avoir menée pour le compte d'une de ses femmes
qui, par un hasard étrange, porte dans la tradition classique le nom égyptien
de Nitôkris[143].
Nabuchodorosor utilisa aux corvées les nombreux captifs syriens, juifs,
égyptiens, arabes, qu'il s'était procurés dans ses campagnes, et Babylone, qui
n'était guère avant lui qu'une ville de province, devint grâce à lui l'une
des cités les plus belles du monde entier. Au centre la ziggourat, la tour à
sept étages de Bel, se dressait gigantesque, couronnée d'une statue du dieu
en or, haute de quarante pieds, à laquelle une rampe tournante conduisait. Le
palais royal, achevé en cinquante jours, était célèbre par ses jardins
suspendus, où les femmes du harem se promenaient dévoilées, à l'abri des
regards profanes. Dans le même temps on rétablissait les canaux qui amenaient
les eaux du Tigre et qui unissaient ce fleuve à l'Euphrate ; on réparait
les réservoirs où les rois des vieilles dynasties avaient reçu et emmagasiné
les crûes annuelles ; on reconstruisait le pont par lequel les deux
rives communiquaient entre elles ; on bâtissait le temple de Nabo à
Barsip. Toutes les ressources dont les ingénieurs du temps pouvaient disposer
furent employées à protéger la capitale. Un double mur l'entoura ainsi que
Barsip : il était percé de cent portes fermées par des battants en
bronze, et l'épaisseur en était telle que deux chariots couraient de front
sur la crête. Les districts environnants eurent leur part des
embellissements : on nettoya le réservoir de Sippar, le canal royal, une
partie au moins du lac Pallacopas. Les richesses accumulées dans ce coin de
terre étaient de nature à tenter les voisins, et d'ailleurs les rapports avec
la Médie
étaient moins amicaux, depuis l'intervention de la Chaldée dans les
affaires de Lydie[144].
Nabuchodorosor, dans la prévision d’une guerre prochaine, traça, en avant des
grands canaux, le mur médique dont la ligne, appuyée sur Sippar, barrait
entièrement l'espèce d'isthme formé en cet endroit par le Tigre et par
l'Euphrate. Infatigable dans ses entreprises, il fut pour la Chaldée ce que
Ramsès II avait jadis été pour l'Égypte, le roi maçon par excellence. Il
travailla sans relâche à toutes les cités et à tous les temples : il n'y
a pas autour de Babylone un endroit où l'on ne lise son nom et où l'on ne
signale la trace de sa merveilleuse activité (562)[145].
Son successeur, Amilmardouk (Evilmérodach),
fut assassiné, après deux ans de règne (560),
par son beau-frère Nergalsharoussour (Nériglissor),
qui lui-même s'éteignit en 556, sans autre héritier qu'un enfant du nom de
Lâbashi-mardouk (Laborosoarkhod). Neuf
mois après son avènement, Lâbashi-mardouk fut tué et remplacé par Nabounâhîd (555)[146]. La lignée de
Nabopolassar finit avec lui, et l'imagination populaire, étonnée d'une chute
si rapide après tant de grandeur, vit la main de Dieu dans cet événement. La
tradition nationale racontait que, vers la fin de ses jours, Nabuchodorosor,
saisi de l'esprit prophétique, était monté sur le toit de son palais et avait
prédit aux Chaldéens la ruine prochaine de leur empire[147]. La légende
juive, implacable pour le prince qui avait renversé Jérusalem et détruit le
temple, disait qu'enivré de sa gloire il s'était cru l'égal de Dieu et qu'il
avait été changé en bête par la colère de Jahvé. Sept années durant il avait
vécu dans les champs, se nourrissant d'herbes comme les bestiaux, puis il
avait recouvré sa forme première et il avait repris possession de la royauté[148].
Si, pendant son règne, Nabuchodorosor n'était pas entré en
lutte avec la Médie,
cela tenait partie à la prudence qu'il avait apportée dans ses relations avec
son puissant voisin, partie au caractère pacifique du prince qui siégeait
alors à Ecbatane. Ishtouvègou, que les Grecs ont nommé Astyagès, fils de
Cyaxare, n'avait pas été élevé, comme son père, pour la vie des champs de
bataille. Sauf une attaque dirigée contre les Cadusiens[149], et qui se
termina par la soumission momentanée de ce peuple, il n'entreprit aucune
expédition. Cruel et superstitieux, il végéta dans le faste d'une cour
orientale, entouré de gardes et d'eunuques, sans autre passe-temps que la
chasse à travers les parcs de ses palais ou sur les confins du désert[150]. La révolte de
son vassal Kouroush (Cyrus) ne le tira
de son engourdissement que pour lui ravir sa couronne. Cent ans à peine après
l'événement, la tradition se plaisait déjà à compliquer de fables romanesques
le récit de sa chute[151]. Quelques-unes
de celles qui nous sont parvenues se ressentent de la tendance qu'ont les
conteurs populaires à prêter une origine ignoble aux fondateurs d'empire.
Comme Shargina en Chaldée, comme Gygès en Lydie, Cyrus n'aurait été issu
d'aucune famille royale : sa mère gardait les chèvres, son père
appartenait à la tribu sauvage des Mardes et vivait de rapines. Remarqué pour
sa bravoure et envoyé contre les Cadusiens à la tête d'une armée, il noue des
intrigues secrètes avec l'ennemi, conspire avec le Perse Œbaras, puis,
dénoncé par une chanteuse et rappelé à Ecbatane, il se déclare ouvertement en
rébellion, bat Astyage et le fait prisonnier. Astyage avait marié sa fille
Amytis à un seigneur mède nommé Spitamas : Cyrus tue Spitamas, épouse la
veuve et se proclame roi à la place de son beau-père[152]. Le plus grand
nombre des légendes semble inspiré par la vanité nationale et n'a d'autre
objet que de rattacher le destructeur de l'empire mède à la lignée de Cyaxare.
Astyage n'avait pas d'enfant mâle : le sceptre devait passer après lui
entre les mains de sa fille Mandanê et des fils de sa fille. Une nuit, il
rêva que l'eau jaillissait d'elle en telle abondance que non, seulement
Ecbatane, mais l'Asie entière en était inondée, et les devins lui conseillent
de ne pas la marier avec un Mède. Il la donne donc à un seigneur perse, de
sang royal, Cambyse : car les Perses étaient alors tributaires des
Mèdes. Un second rêve trouble bientôt la sécurité que ce mariage lui inspirait :
il voit sortir du sein de sa fille une vigne dont les rameaux couvraient
toute l'Asie, et les devins consultés de nouveau lui prédisent que son
petit-fils le détrônera. L'enfant né, il le confie à Harpage, qui, après bien
des hésitations, se décide à le faire exposer dans les bois par un des bergers
royaux. L'enfant, allaité par une chienne, aurait néanmoins succombé si la
femme du berger n'avait pas accouché d'un enfant mort[153]. Elle persuade
à son mari de recueillir le jeune Cyrus, et elle l'élève comme son fils. Le
chien était un animal sacré chez les Iraniens : l'intervention de la
chienne est donc en réalité une sorte d'intervention divine, mais les Grecs,
qui soupçonnaient peu cette particularité du mazdéisme, en furent choqués et
ils cherchèrent une explication rationaliste à la tradition perse. Ils supposèrent
que la femme du berger avait porté le nom de Spako : Spako signifie en
effet chienne en langue médique[154]. Cyrus grandit,
est reconnu pour le fils de Mandanê et revient auprès de son grand-père. Il
ne tarde pas à remarquer combien l'humeur pacifique d'Astyage avait affaibli
la constitution militaire des Aryens de Médie et les laissait impuissants
sous leur apparence de force et de grandeur. Il conçoit donc le dessein hardi
de substituer à leur empire l'empire du peuple dont lui-même était issu.
Abrités par leur éloignement contre la corruption des mœurs babyloniennes,
les Perses avaient conservé plus de simplicité et plus d'énergie que les Mèdes ;
Cyrus, qui le savait, décide son père à courir les risques d'une révolte. Il
s'échappe de la cour, disperse une troupe envoyée à sa poursuite et rentre en
Perse. Vaincu dans une première bataille et son père tué, il est vainqueur
dans la seconde et il fait Astyage prisonnier : le roi captif, la Médie ne résiste
plus et elle s'abandonne tout entière au vainqueur[155].
L'histoire réelle, ou du moins le peu que nous en
entrevoyons, est moins romanesque. D'après les inscriptions, Cyrus
appartenait à la famille Achéménide, et il était roi d'Anshân comme ses trois
prédécesseurs immédiats l'avaient été avant lui, Téispès, Cyrus 1er
et Cambyse 1er. Nous avons vu qu'on peut attribuer la conquête de
l'Anshân à Téispès : la tradition classique assure que les rois perses
demeurèrent les vassaux des Mèdes, et rien ne prouve qu'elle se soit trompée
en cela comme en tant d'autres choses. Deux générations plus tard, Cyrus II
monta sur le trône vers 558. Il prit les armes contre son suzerain vers 553
ou 552, et il battit Astyage ; sur quoi, l'armée mède se révolta et elle
livra son maître à l'ennemi, puis Ecbatane succomba et ses dépouilles
enrichirent le trésor du vainqueur[156]. L'empire de
Cyaxare s'écroula (549), mais ce fut un changement de dynastie plutôt qu'une
conquête étrangère : Astyage et ses prédécesseurs avaient été rois des
Mèdes et des Perses, Cyrus et ses successeurs furent rois des Perses et des Mèdes.
|