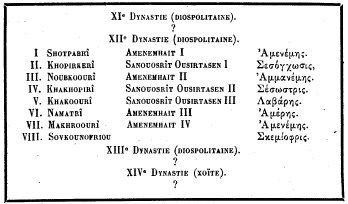|
La onzième dynastie ; débuts de la puissance thébaine.
Depuis l'avènement de Ménès, toute la civilisation
égyptienne semblait s'être concentrée dans la partie moyenne du pays, entre
Thinis et Memphis. C'est à Thinis ou à Memphis que les princes avaient trôné,
à Thinis ou à Memphis que les arts s'étaient développés et avaient produit
leurs chefs-d'œuvre : les nomes du sud avaient été relégués au second
plan. Leurs métropoles vivaient dans une obscurité profonde ; leurs
dieux même étaient ignorés à ce point que, sur les monuments des six
premières dynasties publiés jusqu'à ce jour, j'ai trouvé une seule fois, dans
un nom propre, le nom du grand dieu de Thèbes, Anion, le seigneur des deux
mondes, le patron de l'Egypte au temps des conquêtes syriennes.
Lorsque Memphis eut perdu la suzeraineté, au milieu des
révolutions qui désolèrent le règne des princes Héracléopolitains, les villes
du sud de l'Egypte, Coptos, Silsilis, Thèbes surtout, commencèrent de naître
à la vie politique. Les premiers monuments que nous connaissons d'elles
dérivent directement des derniers monuments que la sixième dynastie nous a
légués, mais ils sont empreints encore de gaucherie et de rudesse provinciale.
Ce sont des tombeaux creusés dans le roc, peints mais non sculptés. Les
scènes de la vie civile n'y sont pas représentées ; on y voit seulement
dessinés sur les murs des amas d'offrandes, accompagnés de prières
empruntées, partie au Livre des Morts, partie ail Rituel des pyramides
royales. Comme à l'âge memphite, la stèle est un résumé de la chapelle du
tombeau ; mais elle affecte une forme cintrée qui rappelle les voûtes
des hypogées de la Haute
Égypte, et elle suffit seule à procurer au mort tout ce qui est nécessaire à
son existence. Souvent le dieu à qui l'on recommande le maître de la stèle
est figuré avec ses attributs. C'est Osiris, c'est Khnoumou, c'est Minou, c'est
Amon surtout qu'on invoque. Phtah, Atoumou, Râ, tous les dieux memphites et
héliopolitains se sont abaissés au rang des dieux provinciaux, dans le même
temps que Memphis descendait de la dignité de capitale à la condition de
ville de province.
La onzième dynastie était originaire de Thèbes elle se rattachait à Pépi-Miriri par des
liens inconnus et elle fut la souche de la dix-huitième dynastie. D'abord
vassale des rois Héracléopolitains, nous avons vu qu'elle ne parvint pas
aisément à conquérir son indépendance. Le premier de ses princes dont nous
sachions le nom, Antouf 1er, n'avait pas droit au cartouche :
il était simple noble, sans plus de titres que les autres chefs des familles
féodales. Son fils, Montouhotpou 1er, tout en assumant le
cartouche et le protocole, demeure un Horou, un souverain partiel, chef des
pays du sud sous la suzeraineté des rois légitimes. Trois générations après
lui, Antouf IV rompit le dernier lien de vasselage et se fit appeler Dieu
bon, maître des deux pays[1]. Il ne faudrait
pas toutefois se laisser abuser à ce dernier titre et croire que son autorité
prévalût dès lors sur l'Egypte entière : les Pharaons d'Héracléopolis
conservaient la possession du Delta et ils firent sentir plus d'une fois leur
pouvoir aux monarques thébains. Le premier de ceux-ci qui parvint à réunir les deux régions sous un sceptre unique
fut Montouhotpou IV (Nibhapouîtrî), à qui cet exploit valut plus tard
d'occuper dans les listes royales une place d'honneur et parfois même de
représenter à lui seul la famille à laquelle il appartenait[2]. Ses successeurs
ne réussirent pas à se maintenir longtemps sur le trône, et ils cédèrent la
place au fondateur de la douzième dynastie, après avoir dominé un peu moins
d'un demi-siècle sur l'Egypte entière[3].
Quelques tablettes sculptées sur les rochers, quelques
stèles funéraires et quelques menus objets dispersés dans les différents
musées de l'Europe, quelques tombeaux à moitié ruinés, voilà tout ce qui nous
reste des seize rois[4] qui composèrent
la première dynastie thébaine dans sa longue période de vasselage et dans sa
courte grandeur. Les luttes constantes qu'ils eurent à soutenir contre les
rois Héracléopolitains ne les empêchèrent pas de diriger quelques expéditions
heureuses contre les peuples voisins de l'Égypte. Montouhotpou III
(Nibhotpourî) se fit représenter près de Philae, vainqueur des nations
barbares[5] ; Sonkhkherî
Montouhotpou prétendait inspirer la terreur à toutes les nations, et
plusieurs de ses monuments semblent prouver qu'il avait fait des guerres heureuses[6]. Leurs succès
devaient être fort peu de chose. Au nord et à l'ouest, les mines du Sinaï
avaient été abandonnées ; vers le sud, les conquêtes de Pépi et de ses
successeurs étaient perdues, et la frontière ne dépassait pas Éléphantine de
beaucoup. C'est aux rois de la douzième dynastie qu'il était réservé de
réduire la Nubie
en province égyptienne.
Comme rois constructeurs, les Antouf, les Montouhotpou ont
laissé peu de traces : les ressources dont ils disposaient, même au
temps de leur prospérité le plus notoire, n'étaient pas suffisantes pour leur
permettre d'élever des monuments considérables. La ville de leur origine,
Thèbes, fut embellie par eux dans la mesure de leurs moyens : du moins
une inscription de l'an II de Montouhotpou III (Nibhotpourî) nous apprend que
ce prince manda une expédition à la vallée de Hammamât pour chercher la
pierre nécessaire aux constructions qu'il méditait dans Thèbes[7]. Les seules
ruines de cette époque qui subsistent se trouvent à Drah-Abou'l-Neggah, au
milieu de la nécropole. C'était là que s'étaient fait ensevelir Antoufâ 1er,
Antoufâ II, Montouhotpou IV (Nibhotpoutrî) et plusieurs de leurs successeurs.
Les tombes, déjà violées par les malfaiteurs au temps de la vingtième
dynastie[8], sont aujourd'hui
détruites, excepté celles d'Antoufâ 1er et de Montouhotpou IV. Celle de
Montouhotpou était une pyramide considérable bâtie au fond du cirque de Deîr
el-Bahari. Celle d'Antoufâ était en briques crues, de travail médiocre,
presque à cheval sur la lisière du désert. La chambre sépulcrale renfermait,
outre le sarcophage disparu sans retour, une stèle de l'an L, où le roi était
figuré en pied, l'uræus au front, accompagné de quatre de ses chiens favoris[9].
Après Thèbes, c'est Coptos qui paraît avoir eu le plus à
se louer de l'activité de ces premiers Thébains. Située au débouché des
routes qui mènent au bord de la mer Rouge et aux carrières de Rohanou[10], Coptos avait
pris dès lors un grand développement. Antouf IV (Noubkhopirrî) y avait élevé
des édifices dont les fragments ont servi de nos jours à la construction d'un
pont[11]. Montouhotpou Il
et Montouhotpou III (Nibhotpourî) professait une dévotion spéciale pour le
dieu local Minou, forme d'Amonrâ générateur, et ils marquèrent leur zèle pur
la restauration de divers temples aujourd'hui détruits. L'exploration de la
vallée de Hammamât devait mener plus loin encore un des derniers princes de
la dynastie, Sonkhkherî Montouhotpou. Désireux d'établir des communications
directes avec l'Arabie et l'Egypte, il envoya un des hauts fonctionnaires de
sa cour aux abords de la mer Rouge, très probablement dans le voisinage de
Qocéyr[12]. Comme on voit,
l'esprit d'initiative ne manquait pas à ces princes obscurs, mais le
développement de leur puissance fut interrompu par des révolutions dont nous
ne savons ni la cause, ni les détails. Lorsque l'Égypte, divisée pour
quelques années, se trouva de nouveau réunie tout entière entre les mains
d'un seul homme, la onzième dynastie avait cessé de régner.
La douzième dynastie ; conquête de la Nubie ; le lac Moeris.
L'avènement de la dynastie nouvelle ne s'opéra pas sans
combat. Amenemhaît 1er d'origine thébaine comme ses prédécesseurs,
eut à batailler contre les compétiteurs dont les entreprises troublèrent ses
premières années. Ce fût après le repas du soir,
dit-il dans des Instructions au roi
Sanouasrît 1er qui lui sont attribuées, quand vint la nuit, - je pris une heure de
joie. - Je m'étendis sur les couches moelleuses de mon palais, je m'abandonnai
au repos, - et mon coeur commença de se laisser aller au sommeil ;
-quand, voici, on s'assembla en armes pour se révolter contre moi, - et
tandis que j'étais aussi faible que le serpent des champs. - Alors je
m'éveillai pour combattre moi-même, de mes propres membres, - et je trouvai
qu'il n'y avait qu'à frapper qui ne résistait pas. - Si je prenais un
assaillant les armes à la main, je faisais retourner cet infâme ; - il
n'avait plus de force même dans la nuit
on ne combattit point, - aucun accident fâcheux ne se produisit contre
moi[13].
A force de persévérance, le roi triompha de ses adversaires. Soit que les
sauterelles aient organisé le pillage, - soit qu'on ait machiné des désordres
dans le palais, - soit que l'inondation ait été insuffisante et que les
citernes se soient desséchées, - soit qu'on se soit souvenu de ta jeunesse
pour agir [contre moi], - je n'ai jamais reculé depuis ma naissance[14].
Dés lors Amenemhaît s'appliqua sans relâche à réparer les
malheurs des discordes civiles et à repousser les peuples voisins, Libyens,
Nubiens, Asiatiques, dont les excursions perpétuelles troublaient sans cesse
le repos de l'Égypte. J'ai fait que l'endeuillé ne fût plus en deuil, et il n'a plus
été entendu ; - les batailles perpétuelles[15], on ne les a plus
vues, - tandis qu'avant moi l'on s'était battu comme un taureau qui ignore le
passé - et que le bien-être de l'ignorant ou du savant n'était pas assuré[16]. - J'ai
fait labourer le pays jusqu'à Abou[17], - j'ai répandu la joie jusqu'à Adhou[18]… - Je suis le
créateur des trois espèces de grains, l'ami de Nopri[19]. - Le Nil a accordé
à mes prières l'inondation sur tous les champs - point d'affamé sous moi,
point d'altéré sous moi, - car on agissait selon mes ordres, - et tout ce que
je disais était un nouveau sujet d'amour. - J'ai renversé le lion - et pris
le crocodile ; - j'ai réduit les Ouaouaîtou[20], - j'ai emmené les Mazaiou en esclavage[21] ; - j'ai forcé les Asiatiques à marcher prés de
moi comme des lévriers[22]. En Nubie, le
roi, après avoir pacifié la vallée, pénétra dans la montagne et il y rouvrit
les mines d'or négligées depuis le temps de Pépi.
Amenemhaît 1er n'était plus un jeune homme au
jour de son avènement : après dix-neuf ans de règne, il appela au
pouvoir son fils Sanouasrît 1er, qui dès lors partagea avec lui
les titres royaux[23]. De sujet que tu
étais je t'élevai, - je te remis l'usage de tes bras, pour que tu fusses
craint à cause de cela. - Quant à moi, je me parai des fines étoffes de mon
palais, pour paraître aux yeux comme une des plantes de mon jardin, - je me
parfumai des essences comme si je répandais l'eau de mes citernes[24]. Au bout de
quelques années, le rôle du vieux roi était tellement effacé qu'on oubliait
parfois d'inscrire son nom dans les actes officiels à côté du nom de son fils[25]. Enfermé dans
son palais, il se bornait à donner des avis qui contribuèrent beaucoup,
paraît-il, à la prospérité de l'État. La réputation de sagesse qu'il s'acquit
de la sorte se répandit si fort, qu'un scribe à peu près contemporain composa
sous son nom un pamphlet où le roi, se levant comme un dieu, fut représenté adressant à son
fils quelques instructions sur l'art de gouverner. Écoute mes paroles. - Tu règnes sur les deux
mondes ; tu régis les trois régions[26]. - Agis mieux encore que n'ont fait tes
prédécesseurs. - Maintiens la bonne harmonie entre tes sujets et toi, - de
peur qu'ils ne s'abandonnent à la crainte ; - ne t'isole pas au milieu
d'eux ; - n'emplis pas ton coeur, ne fais pas ton frère uniquement du
riche et du noble, -mais n'admets pas non plus auprès de toi les premiers
venus dont l'amitié n'est pas éprouvée[27]. A l'appui de
ses conseils, le vieux prince raconte sommairement ses propres exploits. Ce
petit ouvrage, qui ne compte guère plus de trois pages, devint bientôt classique
et conserva sa vogue pendant prés de vingt siècles. Encore au temps de la
dix-neuvième dynastie, c'était un des morceaux qu'on étudiait dans les écoles
et que les jeunes gens copiaient comme exercice de style[28].
Rien ne saurait mieux montrer l'état de l'Égypte et des
pays voisins à cette époque que certains passages des Mémoires d'un aventurier contemporain nommé Sinouhît[29]. Il était l'un
des fils puînés d'Amenemhaît, et ayant surpris un secret d'État au moment de
la mort de son père, il quitta l'armée avec laquelle il guerroyait pour
s'enfuir en Asie. Arrivé à la cour d'un petit chef asiatique, on lui demanda
des détails sur la puissance des souverains égyptiens. Y aurait-il eu une mort dans le palais
d'Amenemhaît sans que nous le sachions ? Alors je lui
dis : Il n'en est rien…
Mon exil en
ce pays est comme le dessein d'un dieu. Le chef me dit : L'Égypte
est aux mains d'un maître qu'on appelle le dieu bienfaisant et dont la
terreur s'étend sur toutes les nations environnantes, comme la déesse Sokhit
s’étend sur la terre dans la saison des maladies. Je lui
répondis : Oui, par mon salut ! Son fils[30] entre au palais,
car il a pris la direction des affaires de son père ; c'est un dieu sans
second, nul autre comme lui auparavant ; c’est un conseiller sage en ses
desseins, bienfaisant en ses décrets, qui entre et sort à son gré ; il
dompte les régions étrangères, et, tandis que son père reste au palais, lui,
annonce ce qu'il a gagné. C'est un brave qui agit par l'épée, un vaillant qui
n'a point d'égal il voit les barbares,
s'élance, fond sur les pillards. C'est un lanceur de javeline, qui rend
débiles les mains de l'ennemi : ceux qu'il frappe ne lèvent plus la
lance. C'est un redoutable[31], qui brise les
fronts : on ne lui a point résisté en son temps. C’est un coureur
rapide, qui massacre le fuyard ; on ne l'atteint pas à courir après lui.
C'est un coeur debout dans son heure. C'est un lion qui frappe de la griffe[32] et
n'a jamais rendu son arme. C'est un coeur cuirassé à la vue des multitudes et
qui n'a rien laissé subsister derrière lui. C'est un brave qui se jette en
avant quand il voit la lutte. C'est un soldat joyeux de s'élancer sur les
barbares : il saisit son bouclier, il bondit, et, sans redoubler son
coup, il tue, personne ne peut éviter sa flèche ; sans qu'il ait besoin
de tendre son arc, les barbares fuient ses bras comme des lévriers, car la
grande déesse lui a donné de combattre qui ignore son nom, et quand il
atteint, il n'épargne rien, il ne laisse rien subsister. C'est un ami[33] merveilleux qui a
su s'emparer de l'affection : son pays l'aime plus que soi-même et se
réjouit en lui plus qu'en un dieu : hommes et femmes accourent lui
rendre hommage. Il est roi, il a commandé dés l'œuf ; depuis sa
naissance, il a été un multiplicateur de naissances, un être unique d'une essence
divine, par qui cette terre se réjouit d'être gouvernée. C'est un
agrandisseur de frontières qui saisira le pays du sud et ne convoite pas les
pays du nord ; il s'est rendu maître des Asiatiques et a écrasé les
Nemmâshaîtou[34]. L'association
de Sanouasrît 1er à la couronne avait habitué les Égyptiens à
considérer ce prince comme, roi de fait, du vivant même de son père. Aussi,
lorsque Amenemhaît mourut, après au moins dix années de corégence et trente
ans de règne, la transition, si délicate dans une dynastie nouvelle, du
fondateur à son successeur immédiat, s'opéra sans secousse. Sanouasrît 1er
était engagé dans une expédition contre les Libyens. Les fonctionnaires
demeurés dans la capitale auprès de son père le firent aussitôt
prévenir ; il quitta son camp en secret et revint à Memphis où il fut
proclamé roi[35].
L'exemple d'Amenemhaît 1er fut suivi dès lors par la plupart de
ses descendants. Après quarante-deux ans, Sanouasrît 1er associa
au trône son fils Amenemhaît II[36], et celui-ci,
trente-deux ans plus tard, partagea le pouvoir avec Sanouasrît II[37]. Amenemhaît III
et Amenemhaît IV régnèrent longtemps ensemble[38]. Les seuls
règnes pour lesquels nous n'ayons point la preuve de ce fait sont ceux de Sanouasrît
III et de la reine Sovkounofriou, la Skémiophris de Manéthon, avec laquelle la
douzième dynastie s'éteignit, après deux cent treize ans, un mois et
vingt-sept jours de durée totale[39].
Parmi les dynasties égyptiennes, la douzième est à coup
sûr celle dont l'histoire offre le plus de certitude et le plus d'unité. Sans
doute nous sommes loin de connaître tous les événements qu'elle vit s'accomplir :
la biographie des huit souverains qui la composent et le détail de leurs
guerres sont encore des plus incomplets. Mais du moins nous suivons sans
interruption le développement de leur politique ; on peut, après quatre
mille ans et plus, reconstituer leur Égypte telle qu'ils se l'étaient faite
et qu'ils la léguèrent à leurs successeurs. A la fois ingénieurs et soldats,
amis des arts et protecteurs de l'agriculture, ils ne cessèrent un seul
instant de travailler à la grandeur du pays qu'ils gouvernaient. Reculer les
frontières de l'empire au détriment des peuples barbares et coloniser la vallée
du Nil dans toute sa partie moyenne, de la première cataracte à la quatrième;
régula¬riser le système des canaux et obtenir, une plus juste répartition des
eaux dans ce qui est aujourd'hui le Fayoum ; orner d'édifices
Héliopolis, Thèbes, Tanis, Héracléopolis, et cent cités moins célèbres :
telle fut l'oeuvre qu'ils s'imposèrent et qu'ils continuèrent de père en fils
pendant plus de deux siècles. Au sortir de leurs mains, l'Égypte, agrandie
d'un tiers par la conquête de la
Nubie, enrichie par de longues années de paix et, de bonne
administration, jouissait d'une prospérité sans égale. Plus tard, au temps
des guerres asiatiques et des conquêtes lointaines, elle eut plus d'éclat
apparent et fit plus de bruit dans le monde : au temps des Sanouasrît,
elle était plus riche et plus heureuse.
Deux champs de bataille s'ouvraient aux Pharaons, l'un à
l'est du Delta, en Syrie, l'autre au sud d'Éléphantine, dans la Nubie proprement dite. A
l'est, l'Égypte, séparée des populations syriennes par le désert, semblait
n'avoir rien à craindre derrière sa ceinture de sables. Tout au plus lui
fallait-il subir quelques incursions des barbares nomades, plus ruineuses
pour la fortune de certains particuliers que pour la sécurité du pays. Pour
se mettre à l'abri de ces razzias, difficiles à éviter malgré la vigilance
des garde-frontières, les souverains de l'Ancien Empire avaient, de la mer
Rouge au Nil, élevé une série de forteresses et bâti une muraille qui barrait
aux pillards l'entrée de l'Ouady-Toumilât[40]. Cette muraille,
entretenue avec soin par Amenemhaît 1er et par ses successeurs, marquait
de ce côté l'extrême limite de l'empire. Au delà, le désert commençait et,
pour la masse des Égyptiens de cette époque, un monde à peu près inconnu. Sur
les peuples de la Syrie,
ils ne possédaient que des notions flottantes empruntées aux caravanes ou apportées
dans les ports de la Méditerranée par les marins qui les
fréquentaient. Parfois cependant les riverains du Delta voyaient descendre
dans leurs villes des bandes d'émigrés ou même des tribus entières qui,
chassées de leur canton natal par la misère ou par les révolutions, venaient
chercher asile en Égypte. Un des bas-reliefs du tombeau de Khnoumhotpou à
Béni-Hassan nous fait assister à la réception d'une troupe de ces malheureux.
Au nombre de trente-sept, hommes, femmes et enfants, ils sont amenés devant
le gouverneur du nome de Mihi, auquel ils présentent une sorte de fard
verdâtre nommé moszimit et deux bouquetins. Ils sont armés, comme les
Égyptiens, de l'arc, de la javeline, de la hache, de la massue, et vêtus de
longues robes ou de pagnes étroits bridant sur la hanche ; l'un d'eux,
tout en marchant, joue d'un instrument qui rappelle, par la forme, les lyres
de vieux style grec[41]. Les détails de
leur costume, l'éclat et le bon goût des étoffes bariolées et garnies de franges
dont ils sont revêtus, l'élégance de la plupart des objets qu'ils ont avec
eux, témoignent d'une civilisation avancée. C'était déjà d'Asie que l'Égypte
tirait les esclaves, les parfums dont elle faisait une consommation énorme,
le bois et les essences du cèdre, les vases émaillés, les pierreries, le
tapis et les étoffes brodées ou teintes dont la Chaldée se
réserva le monopole jusqu'au temps des Romains[42].
Sur un point seulement du territoire asiatique, les
Pharaons de la douzième dynastie songèrent à s'établir solidement : ce
fut dans la péninsule du Sinaï, auprès des mines de cuivre et de turquoise
exploitées jadis par les princes de l'Ancien Empire. Des postes échelonnés
dans les gorges de la montagne protégèrent les ouvriers contre les tentatives
des Bédouins. Grâce à cette précaution, on put reprendre l'exploitation des
anciens filons, ouvrir des filons nouveaux et imprimer aux travaux une
activité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Sanouasrît 1er[43], Amenemhaît II[44], Amenemhaît III[45], Amenemhaît IV[46] y ont laissé des
inscriptions à leur nom. Toutefois, même en cet endroit, les rois de la
douzième dynastie ne se départirent point de leur politique habituelle ;
ils ne saisirent de terrain que ce qui leur était nécessaire pour
l'exploitation des mines, et ils ne disputèrent pas le surplus aux tribus
nomades du désert.
De toutes ces tribus, celles qu'ils connaissaient le
mieux, pour avoir souvent à repousser ou à châtier leurs incursions, étaient
les Sitiou ou Shasou, pillards effrontés, ainsi que l'indique le nom qu'ils
s'appliquaient à eux-mêmes[47]. Répandus sur
les frontières de l'Égypte et de la
Syrie, à la lisière du désert et des terres cultivées, ils
vivaient comme les Bédouins d'aujourd'hui, sans demeure fixe, moitié de
pillage, moitié du profit de leurs maigres troupeaux. Quelques-uns de leurs
royaumes, celui de Kadouma par exemple, étaient fréquentés des marchands
égyptiens et servaient de refuge aux bannis. Un conte populaire, dont le
héros vivait sous Amenemhaît et Sanouasrît 1er, nous dépeint d'une
manière saisissante l'existence que ces exilés menaient à la cour des petits
sheïkhs asiatiques. Sinouhît, forcé de fuir l'Égypte pour avoir surpris un
secret d'État, franchit la muraille orientale et s'enfonce dans le désert. Je cheminai, dit-il, pendant la nuit,
et à l'aube je gagnai Pouteni et me dirigeai vers le lac de Qîmoîri. Alors la
soif, elle fondit sur moi ; je faiblis, mon gosier s'embrasa, je me
disais déjà : Voici le goût de la mort, quand soudain je relevai
mon coeur et raidis mes membres, j'entendais la voix douce des bestiaux.
J'aperçus des Bédouins ; leur chef qui avait été en Égypte me reconnut
et il me donna de l'eau, il me fit bouillir du lait, puis j'allai avec lui
dans sa tribu[48].
Les Bédouins qui avaient accueilli Sinouhît le conduisent
de station en station jusqu'au territoire de Kadouma. Un des chefs de cette
contrée l'envoie chercher et l'invite à s'installer près de lui : Demeure avec moi, tu pourras entendre
le langage de l'Égypte. Et en effet, Sinouhît rencontre près du prince
certains
hommes d'Égypte qui étaient parmi ses hôtes[49]. Cette
circonstance décide l'aventurier à se fixer dans le pays, où il fait rapidement
fortune. Le
chef me mit à la tête de ses enfants, me maria à sa fille aînée, et me donna
mon choix parmi les terres les meilleures qui lui appartenaient jusqu'aux frontières
du peuple voisin. C'est un bon lieu nommé Aïa[50] ; il a des figues et du raisin, et produit plus
de vin qu'il n'a d'eau. Le miel y est en quantité, ainsi que les oliviers et
tous les fruits des arbres. On y trouve de l'orge ; ses froments n'ont
point de nombre, non plus que ses bestiaux. Ce fut grand, certes, ce qu'on me
conféra, quand le prince vint pour m'investir et m'établit chef de tribu
parmi les meilleures du pays. J'eus des rations quotidiennes de pain et de
vin, chaque jour des viandes cuites, des oies rôties, outre le gibier du pays
que je prenais ou qu'on posait devant moi en plus de ce que me rapportaient
mes chiens de chasse ; on me faisait toute espèce de beurre et de fromage.
Je passai de nombreuses années, mes enfants devinrent des braves, chacun
d'eux dirigeait sa tribu. Le voyageur qui allait et revenait dans l'intérieur
du pays se détournait vers moi, car j'accueillais bien tout le monde je
donnais de l'eau à qui avait soif, je mettais l'égaré sur sa route, je
saisissais le brigand. Les archers qui s'en allaient au loin pour battre et
pour repousser les princes du pays, j'ordonnais et ils marchaient ; car
ce roi de Tonou me fit passer plusieurs années parmi son peuple comme général
de ses soldats. Aussi chaque pays que j'envahis, je le forçai de payer tribut
des produits de ses terres ; je pris ses bestiaux ; j'emportai ce
qui lui appartenait, j'enlevai ses boeufs, je tuai ses hommes ; il était
à la merci de mon sabre, de mon arc, de mes expéditions, de mes desseins
pleins de sagesse qui plaisaient au roi. Donc il m'aima, connaissant ma
vaillance ; il me mit à la tête de ses enfants, voyant la valeur de mon
bras.
Un brave de Tonou vint me défier dans ma tente ; c'était un
illustre, sans pareils, car il avait détruit tous ses rivaux. Il
disait : Que Sinouhît se batte avec moi, car il ne m’a pas encore
frappé ; il se flattait de prendre mes bestiaux pour sa tribu. Le
roi se consulta avec moi, et je dis : Je ne le connais point. Certes
je ne suis pas son frère, je me tiens éloigné de son logis ; est-ce que
j'ai jamais ouvert sa porte ou franchi ses clôtures ? C'est quelque
aventurier désireux de me voir et qui se croit appelé à me dépouiller de mes
chats et de mes chiens, en plus de mes vaches, de fondre sur mes taureaux,
mes chèvres, mes veaux, afin de se les approprier… Je bandai mon arc, je
préparai mes flèches, je donnai du jeu à mon poignard ; je fourbis mes
armes. Quand l'aube arriva, Tonou vint lui-même, après avoir rassemblé toutes
ses tribus et convoqué tous ses vassaux, car il désirait voir ce combat. Tous
les coeurs brûlaient pour moi ; hommes et femmes poussaient des Ah !
et chaque coeur s'attrista pour moi ;
car on disait : Est-ce que c'est un autre brave qui va lutter avec lui ?
Voici, l'adversaire a son bouclier, sa javeline, son paquet de dards. Quand je sortis
et qu'il eut paru, je détournai de moi ses traits. Comme pas un seul ne
portait, il fondit sur moi ; et alors je déchargeai mon arc contre lui.
Quand mon trait s'enfonça dans son cou, il poussa un grand cri et tomba à
terre[51].
Telle était, il y a plus de quatre mille ans, la vie des tribus du désert,
telle elle est encore aujourd'hui ; le récit de Sinouhît, à peine
modifié, s'applique fort bien aux Bédouins de nos jours.
Ce fut surtout vers l'Éthiopie que l'attention des princes
de la douzième dynastie se concentra. Là, en effet, l'Égypte était directement
menacée par des peuplades remuantes qui habitaient les deux rives du Nil et
les déserts environnants. C'étaient d'abord, au delà de la première cataracte
et jusqu'à mi-chemin de la seconde, les Ouaouaîtou, ces vieux ennemis des
Pharaons, auxquels Pépi avait eu affaire et que les princes d'Éléphantine
avaient réduits en partie. Battus par les princes de la onzième dynastie et
pourchassés par Amenemhaît 1er, ils reculaient sans cesse vers le
Midi ou vers la mer Rouge, et ils préféraient s'expatrier plutôt que se
soumettre. Plus au sud, auprès de la seconde cataracte, on trouvait le pays
de Hehou et celui de Shaad, avec des carrières de calcaire blanc[52]. Dans le désert
et au delà de la seconde cataracte erraient cent tribus aux noms étranges,
Shemîk, Khasa, Sous, Kaâs, Aqîn, Anou, Sabiri, Akîti, Makisa, toujours prêtes
aux razzias, toujours battues et jamais pacifiées[53]. Elles
appartenaient à une race blanche, la race de Koush, qui, peu après la
conquête memphite[54], avait fait son
apparition sur les bords de la mer Rouge et avait refoulé les Nègres vers les
régions du Haut Nil[55]. Ces peuples
nouveaux, issus de la souche d'où sortirent plus tard les Phéniciens, apportaient
avec eux les éléments d'une civilisation à peine inférieure à celle de
l'Égypte. Les Pharaons comprirent combien il leur était nécessaire de les
dompter, tandis qu'ils étaient encore indécis et flottants, et ils tournèrent
contre eux toutes les forces vives de la nation. A force de persévérance, ils
parvinrent à en annexer complètement la plupart, à détruire ou à pourchasser
vers le sud ceux qui s'obstinèrent à la lutte et à les remplacer par des colonies
de fellahs. Dés lors toute la vallée, depuis l'endroit où le Nil quitte les
plaines d'Abyssinie pour entrer dans le lit étroit qu il s'est creusé au
milieu du désert, jusqu'à l'endroit où il se décharge dans la Méditerranée,
ne constitua plus qu'un seul empire, habité par un seul peuple, parlant la
même langue, adorant les mêmes dieux et obéissant au même souverain.
Amenemhaît 1er avait battu les Ouaouaîtou dans la
trentième année de son règne[56] ; son fils,
Sanouasrît 1er, vainquit sept peuples nègres confédérés et courut
triomphant jusqu'à Ouadi-Halfa[57]. Sous Amenemhaît
II, le pays des Ouaouaîtou n'était déjà plus qu'une province égyptienne gouvernée
comme les autres nomes par un fonctionnaire royal[58]. Sanouasrît II
continua, avec éclat ce semble, l'oeuvre de ses prédécesseurs, que son fils,
Sanouasrît III, acheva. Ce prince, si populaire en Égypte que Manéthon ou ses
compilateurs l'identifiaient avec le Sésostris de la tradition grecque et lui
attribuaient la conquête du monde[59], marcha lui-même
à la tête de ses armées[60] et soumit toute la Nubie d’une manière
définitive. Après l'annexion du canton de Heh, il fixa la frontière de
l'empire à Semnéh, prés de la seconde cataracte. Une inscription gravée en
l'an VIII constate le fait : [C'est ici] la frontière méridionale réglée en l'an VIII, sous la
sainteté du roi des deux régions Khakerî Sanouasrît III, vivificateur à
toujours et à jamais, afin que nul Nègre ne la franchisse en descendant le
courant, si ce n'est pour le transport des bestiaux, boeufs, chèvres, moutons
appartenant aux Nègres[61]. Une autre
inscription de l'an XVI renouvelle cette défense, et nous apprend que sa Sainteté avait
permis qu'on érigeât une statue d'elle sur la frontière qu'elle-même avait
établie[62].
Nul emplacement n'était mieux choisi pour servir de
boulevard permanent contre les invasions du sud. La large chaîne de rochers
granitiques qui coupe perpendiculairement la vallée en cet endroit, et qui
détermine une série de rapides difficiles à franchir, excepté au temps des
hautes eaux, opposait une barrière assurée aux flottes qui auraient essayé de
brusquer le passage. De chaque côté, sur des rochers qui plongent à pic dans
le courant, Sanouasrît III construisit une forteresse destinée à commander
entièrement le fleuve et la vallée. Bâtis en briques crues, comme tous les
édifices militaires de l'Égypte, ces forts présentent non seulement les
hautes murailles et les tours massives des citadelles antiques, mais
l'escarpe, le fossé, la contre escarpe et le glacis des places plus récentes,
et ils pouvaient défier pendant longtemps tous les moyens d'attaque dont on
disposait à cette époque. Leur enceinte renfermait un temple dédié au fondateur,
et de nombreuses habitations aujourd'hui ruinées[63].
Désormais les expéditions dirigées par les monarques
égyptiens au delà de Semnéh n'eurent plus pour objet la conquête : on se
borna à exiger un tribut et à réclamer un droit de suzeraineté, toujours incertain.
C'est ainsi qu'on voit Sanouasrît III diriger en l'an XVI une razzia
méthodique contre le pays de Houà sur le Tacazze[64], et Amenemhaît
III se vanter de victoires remportées sur les nègres éthiopiens, mais sans
mention d'acquisition nouvelle[65]. On se contenta
de fortifier et d'aménager le territoire annexé récemment. Sanouasrît III y
fonda, un peu au sud d'Éléphantine, une ville qu'il appela de son nom
Hirou-Khakerî, les voies de
Khakerî, et jeta le long du fleuve tant de fondations utiles, qu'après
sa mort il fut divinisé à Semnéh[66] et adoré pendant
plus de dix siècles sur le même pied que Doudoun, Anoukit, Khnoumou et les
autres divinités locales. Son temple, ruiné pendant les premiers règnes de la
dix-huitième dynastie, fût restauré par Thoutmosis III et il a duré jusqu'à
nos jours. Son fils et successeur, Amenemhaît III, construisit en face de
Pselkis une forteresse importante[67]. Il eut aussi
l'idée de faire observer les hauteurs que le Nil atteignait à Semnéh pendant
l'inondation, et les cotes qu'il a enregistrées sur les rochers voisins ne
sont pas au nombre des souvenirs les moins curieux de son règne[68].
Ce n'était pas dans un simple intérêt de curiosité que les
ingénieurs postés à Semnéh se livraient à ce travail de relevé. Ils
amassaient les éléments de calcul nécessaires à ceux de leurs confrères qui
étaient chargés en Egypte de l'entretien des canaux. On sent quelle devait
être l'utilité de cette tâche dans une contrée où le succès de la culture dépend
de la répartition des eaux à la surface du sol, et dans un temps où les
princes ne cessaient de rechercher tous les moyens possibles pour remédier à
l'excès ou à l'insuffisance de l'inondation. Sanouasrît 1er traça une ligne
de digues le long de la rive occidentale, contre laquelle portait surtout le
fleuve, et ses successeurs, occupés qu'ils étaient par les guerres nubiennes,
n'en exercèrent pas moins la plus active surveillance sur le service des
eaux. A quelques lieues en amont de Memphis, la chaîne Libyque s'interrompt
soudain et démasque l'entrée d'une vallée qui, d'abord étouffée entre les
parois de là montagne, s'élargit à mesure qu'elle b 'enfonce vers le couchant
et finit par s'épanouir en amphithéâtre. Au centre s'étend un large plateau dont le
niveau général est celui des plaines de l'Egypte ; à l'ouest, au
contraire, une dépression considérable de terrain produit une vallée qu'un
lac naturel de plus de dix lieues de long (le Birket-Qèroun) emplit de ses
eaux[69].
Au début de l'histoire, le lac était beaucoup plus considérable que nous ne
le voyons aujourd'hui : il remplissait l'amphithéâtre entier, à
l'exception d'un canton marécageux qui se déployait en bordure au pied de la
montagne orientale, vers le point où s'ouvre la gorge qui communiquait avec
la vallée. Là se trouvait de toute antiquité ce qu'on appelait To-shaît, la terre du lac, et sur
cette terre la ville de Shodît, celle à qui les Grecs attribuèrent plus tard
le nom de Crocodilopolis. Les rois de la XIIe dynastie, qui allaient souvent
chasser les oiseaux dans ces marais, se prirent d'affection pour le site. Amenemhaît
1er y construisit un édifice dans lequel on a déterré sa statue[70]. Sanouasrît 1er
y éleva un temple, dont il ne subsiste plus rien, si ce n'est les fragments
de l'un des obélisques qui en décoraient l'entrée[71]. Amenemhaît III
fit plus encore. S'il ne fonda point Crocodilopolis, comme le veulent
certains auteurs classiques[72], du moins il y
érigea des monuments dont la nature, mal comprise à l'époque hellénique,
donna naissance à la légende du lac Moeris et du Labyrinthe.
Hérodote est le premier des historiens occidentaux qui en
parle, le seul qui les ait vus, et c'est à lui que les écrivains postérieurs
en empruntèrent la description, non sans l'embellir de traits plus ou moins
fabuleux. Il racontait donc qu’un Pharaon Moeris, inconnu aux documents
indigènes, avait établi en cet endroit un réservoir immense où il emmagasina
le surplus de l'inondation. Ce réservoir était ceint de fortes digues et il
mesurait un pourtour de quatre-vingt-dix milles[73]. Deux canaux
munis d'écluses procuraient la communication avec le Nil et régularisaient
l'entrée ou la décharge des eaux[74]. L'un d'entre
eux s'emmanchait sur le fleuve à quelque distance au sud et courait en
diagonale le long de la chaîne Libyque, à peu près dans la direction du
Bahr-Yousouf actuel ; l'autre branchait beaucoup plus bas, à l'est du
Fayoum, et suivait probablement le lit du canal auxiliaire qui s'amorce
aujourd'hui au voisinage de Béni-Souef. C'était probablement au point d'intersection
de ces cieux canaux qu'étaient placées les écluses, et le rameau nord était
seul ouvert pendant le moment de l'étiage[75]. La crue
était-elle suffisante ? L’eau, emmagasinée dans le lac, puis relâchée au
fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, maintenait le niveau à la
hauteur convenable dans toute la moyenne Egypte et sur la rive gauche du Nil
jusqu'à la mer. L'année d'après, la crue menaçait-elle d'envahir les villes ou d'emporter les
villages du Delta, malgré les mottes artificielles sur lesquelles on les
avait exhaussés, ou simplement de séjourner trop longtemps sur les terrains
bas et de les changer en marécages ? Le Moeris absorbait le surplus des
eaux et l'emprisonnait jusqu'au moment où le fleuve commençait à baisser. Au
milieu du lac se dressaient, dit-on, deux pyramides couronnées chacune d'un
colosse assis, dont l'un représentait Moeris et l'autre la reine sa femme[76]. Du haut de ce
piédestal, le vieux Pharaon semblait dominer son oeuvre et contempler
éternelle ment les campagnes dont il avait assuré la fortune.
Le réservoir construit, Moeris établit sa résidence dans
le voisinage et s'y érigea à la fois un palais et un tombeau[77]. Le palais,
devenu temple après la mort de son fondateur, et appelé Labyrinthe, gisait à
l'orient du lac, sur un petit plateau qui joint presque l'emplacement de
Crocodilopolis. La façade qui donnait sur le Moeris était tout entière d'un
calcaire si blanc, que les anciens la supposaient en marbre de Paros. Le
reste de l'édifice était en granit de Syène[78]. Une fois dans
l'enceinte, on se sentait bientôt comme perdu au milieu d'un dédale de
petites chambres obscures, toutes carrées, toutes coiffées d'un seul bloc de
pierre en guise de toit, et reliées les unes aux autres par des couloirs si
habilement enchevêtrés qu'un étranger sans guide s'évertuait vainement à en
sortir[79]. Il y en avait,
dit-on, trois mille, dont moitié sous terre[80]. Les murs et les
plafonds étaient décorés d'inscriptions et de figures sculptées en bas-relief
dans le creux. On enfermait là les emblèmes des divinités ou les statues des
rois défunts[81],
et sans doute aussi les objets précieux, les vêtements sacrés, les sistres,
les colliers, les parures emblématiques, en un mot tout le matériel du culte
qu'une obscurité perpétuelle pouvait seule préserver des insectes, des
mouches, de la poussière et du soleil. Au centre du massif on voyait douze
grandes salles hypostyles, affrontées deux à deux, et dont les portes
s'ouvraient, six au midi, six au nord. A l'angle nord du carré, Moeris avait
préparé son tombeau, une pyramide en briques crues revêtue de pierre
sculptée. C'était aux yeux des Grecs le monument le plus parfait de l'art
égyptien. J'ai
vu le Labyrinthe, disait Hérodote, et je l'ai estimé plus grand encore que sa
renommée. On rassemblerait tous les édifices et toutes les constructions des
Grecs, qu'on les trouverait inférieurs comme travail et comme coût à ce
Labyrinthe ; et, pourtant, le temple d'Éphèse est remarquable, aussi
celui de Samos. Les pyramides encore m'avaient paru plus grandes que leur
renommée, et une seule d'entre elles équivaut à beaucoup des plus grandes
constructions grecques ; et si, le Labyrinthe surpasse-t-il même les
Pyramides[82]. On avait
raconté à Hérodote que le Labyrinthe n'était pas l'oeuvre de Moeris, mais
celle de Psammétique et de ses onze corégents. D'autres auteurs remplacèrent
Psammétique et Moeris par un Mnévis[83], par un Imendès[84], par un
Pétésoukhis[85],
qu'on aurait tort de chercher sur les listes de Manéthon.
Ce sont là des légendes où la vérité ne tient qu'une place
très mince. Le réservoir fameux, qui réglait l'inondation et qui assurait la
fertilité à l'Egypte, n'a jamais existé : ce qu’Hérodote a vu c'est
l'inondation - mou-oîri - et ce
qu'il a pris pour les digues qui constituaient l'enceinte du réservoir, ce
sont les chaussées qui séparaient les bassins l'un de l'autre. Au temps qu'il
visita l'Egypte, le lac naturel, qui s'étalait à l'Est de la vallée, occupait
une surface beaucoup plus considérable que celle qu'il a de nos jours, et son
niveau était assez élevé pour qu'au moment de la crue le pays entier semblât
ne plus former qu'une seule nappe d'eau de la montagne au désert[86]. Le labyrinthe
lui-même n'était pas ce palais merveilleux que nous décrit Hérodote ;
c'est la ville qu'Amenemhaît III fonda comme dépendance de sa pyramide, et
dont les ruines sont visibles près du village moderne de Haouaara[87]. Les rois de la XIIe dynastie, s'ils n'ont
point exécuté les travaux gigantesques que la tradition leur attribuait au
Fayoum, n'en furent pas moins des constructeurs acharnés. A Thèbes,
Amenemhaît et Sanouasrît 1er embellirent de leurs offrandes le
grand temple d'Amon[88]. Dans la ville
sainte d'Abydos, Sanouasrît 1er restaura le temple d’Osiris[89]. A Memphis,
Amenemhaît III édifia les propylées au nord du temple de Phtah[90]. A Tanis,
Amenemhaît 1er commença, en l'honneur des divinités de Memphis, un
temple que ses successeurs agrandirent à l'envi[91]. Bubaste[92], Fakous[93], Héliopolis[94], Hakhninsou[95], Zorit[96], Edfou[97], et d'autres
localités moins importantes ne furent pas négligées. Comme leurs ancêtres de
l'Empire Memphite, les princes de la douzième dynastie mettaient tous leurs
soins à se préparer des tombeaux magnifiques. Mon maître, disait sous Sanouasrît 1er
le scribe Mirri, m'envoya en mission pour lui deviser une grande demeure
éternelle. Les couloirs et la chambre intérieure étaient en maçonnerie et renouvelaient
les merveilles de construction des dieux. Il y eut en elle des colonnes,
sculptées, belles comme le ciel, un bassin creusé qui communiquait avec le
Nil, des portes, des obélisques, une façade en pierre blanche de Rouou ;
aussi Osiris, seigneur de l'Amentit, s'est-il réjoui des monuments de mon
seigneur, et moi-même, j'ai été dans le transport et l'allégresse en voyant
le résultat de mon travail[98]. Cette pyramide
de Sanouasrît 1er a été retrouvée à Licht[99], celle de Sanouasrît
III à Dahchour[100], celles de Sanouasrît
II et d'Amenemhaît II à Illahoun et à Haouara[101]. Elles sont
assez endommagées pour la plupart, mais c'est dans l'une d'elles, celle de
Sanouasrît III, qu'ont été recueillis ces admirables bijoux qui font
aujourd'hui l'une des richesses du musée du Caire[102]. Ce sont des
bijoux de mort, à la monture un peu trop légère pour le poids des émaux qui y
sont enchâssés, mais, ce défaut indiqué, quel goût dans le dessin, quelle
richesse de couleur, quelle habileté d'exécution : l'art de l'orfèvrerie n'a
jamais rien produit qui dépasse ces chefs-d'oeuvre des vieux artisans
égyptiens[103].
Toutefois les tombes royales comme les temples sont trop ruinés pour qu'on
puisse juger, par ce qui nous reste d'eux, l'état de la sculpture et les
conditions de la vie princière. Les hypogées où reposaient les barons
féodaux, qui se partageaient le territoire sous la suzeraineté des Pharaons,
se révèlent de jour en jour, à Siout, à Berchéh, à Meîr, à Éléphantine :
mieux protégés contre la rapacité des envahisseurs de l'Égypte et contre les
ravages du temps, ils ont survécu et ils suscitent à nos yeux la vallée du
Nil telle qu'elle était il y a cinq mille ans depuis la première cataracte
jusqu'au voisinage de Memphis.
Toutefois c'est à Béni-Hassan, dans le cimetière des sires
héréditaires de Mihi[104], que l'on
comprend le mieux quelle était alors la condition du pays. Ces princes
appartenaient à ce que j'ai appelé ailleurs la féodalité égyptienne. Aux
temps agités de la dixième et de la onzième dynastie, leurs ancêtres avaient
probablement joui d'une indépendance complète et formé une de ces dynasties
locales, inconnues aux annales officielles du royaume, mais si vivaces
qu'elles reparaissaient à chaque nouvelle révolution qui affaiblissait l'autorité
du pouvoir central. Soumis par les Antouf et les Montouhotpou avant d'avoir
réussi à s’étendre sur les nomes voisins, ils se contentaient pour le moment
d'occuper auprès de la personne du Pharaon les places les plus exaltées
auxquelles la hiérarchie leur permettait d'aspirer. Aussi rien n'est-il plus
curieux que leur biographie pour se faire une idée de l'histoire des classes
nobles. Le premier d'entre eux que nous connaissions avait été institué
nomarque dans la ville de Monâït-Khoufoui par Amenemhaît 1er, au
cours des victoires qui assurèrent à celui-ci la possession incontestée de
l'Égypte. Lorsqu'il devint seigneur de Mihi, son fils Nakhîti lui succéda à
Monâït-Khoufoui, avec le titre de gouverneur ; mais, Nakhîti étant mort
sans postérité, le roi Sanouasrît 1er voulut bien accorder à la soeur du
jeune homme, Baqit, la qualité de princesse héritière. Baqit apporta le nome
de Mihi en dot à Nouhri, qui était de la famille des barons de Khmounou, et
doubla de la sorte la fortune de ce dernier. L'enfant qui naquit de leur
union, Khnoumhotpou, fut nommé tout jeune gouverneur de Monâït-Khoufoui,
titre qui paraît avoir appartenu dans la famille à l'héritier présomptif,
comme plus tard sous la dix-neuvième dynastie le titre de prince de Koush appartenait à
l'héritier présomptif de la couronne d'Égypte. Son mariage avec la dame
Khiti, princesse héritière du dix-septième nome, rangea sous son autorité
l'une des provinces les plus fertiles de l'Heptanomide. Sous son fils Nakhîti
la maison atteignit l'apogée de la grandeur. Nakhîti, confirmé dans toutes
ses dignités prince du dix-septième nome des droits de sa mère, reçut de Sanouasrît
II un grand gouvernement, qui renfermait quinze des nomes du midi,
d'Aphroditopolis jusqu'aux frontières de Thèbes[105].
On voit par cet exemple avec quelle facilité les nomes,
principautés héréditaires distribuées entre quelques familles illustres,
passaient de l'une à l'autre par mariage ou par succession, à condition pour
le nouveau titulaire de régulariser son acquisition et de se faire investir
par le souverain régnant. Les devoirs de ces petits princes envers leur suzerain
et leurs sujets étaient fort nettement définis ils devaient l'impôt et le
service militaire à l'un, bonne et exacte justice aux autres. J'ai suivi mon
maître, lorsqu'il marcha pour battre les ennemis dans les contrées étrangères.
J'ai marché en qualité de fils d'un chef, de chambellan, de général de
l'infanterie, de nomarque de Mihi. Je vins contre Koush, et en marchant je
fus conduit jusqu'aux extrémités de la terre. Je conduisis les butins de mon
maître, et ma louange atteignit le ciel. Quand Sa Majesté revint en paix,
après avoir battu ses ennemis dans Koush la vile, je vins le servir devant
lui. Pas un de mes soldats n'a déserté lorsque je convoyai les produits de
mines d'or à la
Sainteté du roi Sanouasrît 1er, vivant à
toujours et à jamais. J'allai alors avec le prince héritier, fils aîné du roi
de son flanc, Amoni v. s. f. ; j'allai avec quatre cents hommes tous
choisis d’entre mes guerriers, je vins en paix, et aucun d'eux ne déserta
quand je conduisis le produit des mines d'or. Mon entreprise me fit louer par
les rois[106]. - Moi j'étais un
maître de bonté, plein d'amabilité, un gouverneur qui aimait son pays… J'ai
travaillé et le nome entier fut en pleine activité. Jamais petit enfant ne
fut affligé par moi, jamais veuve maltraitée par moi ; jamais je n'ai
repoussé laboureur, jamais, je n'ai empêché pasteur. Jamais n'exista
commandant de cinq hommes dont j’aie réquisitionné les hommes pour mes travaux.
Jamais disette ne fut de mon temps, jamais affamé sous mon gouvernement, même
dans les années de disette[107] ; car alors je
labourai tous les terrains du nome de Mihi jusqu'à ses limites au sud et au
nord ; je fis vivre ses habitants en leur répartissant ses productions,
si bien qu'il n'y eût pas d'affamés en lui. J'ai donné également à la veuve
et à la femme mariée, et je n'ai pas préféré le grand au petit dans ce que
j'ai donné. Quand la crue du Nil était haut et que les propriétaires de
champs ainsi que les propriétaires de toutes choses avaient bon espoir, je
n'ai pas coupé les bras d'eau qui arrosent les champs[108].
Sous l'influence pacifique des barons locaux, la richesse,
déjà générale même en temps de trouble, se développa d'une manière
merveilleuse. Il faut avoir étudié, sur les murailles des tombeaux de
Béni-Hassan ou sur les planches de Champollion, de Rosellini ou de Lepsius[109], les peintures
où les artistes du temps ont représenté les différents métiers alors en
usage, pour se faire une idée de l'activité avec laquelle tous les travaux
utiles étaient poussés. C'est d'abord le labourage à farce de boeufs ou à
bras d'hommes ; le semage, le foulage des terres par les béliers ;
le hersage, la récolte et la mise en gerbes du lin et du blé, le battage, le
mesurage, le transport au grenier à dos d'ânes ou par chalands ; la
vendange, l'égrenage du raisin, la fabrication du vin dans deux pressoirs
différents, la mise en amphores et l'aménagement des caves. D'autres tableaux
montrent le sculpteur sur pierre et le sculpteur sur bois à leurs
pièces ; des verriers soufflant des bouteilles, des potiers modelant
leurs vases et les enfournant ; des cordonniers, des charpentiers, des
menuisiers, des corroyeurs, des femmes au métier, tissant la toile sous la
surveillance des eunuques, sans trêve ni relâche. Malgré les professions de
charité que les nomarques étalaient sur leurs pierres funéraires, la
condition de ces classes ouvrières était des plus dures. Sans cesse courbées
sous le bâton du contremaître, il leur fallait peiner du matin au soir contre
une maigre ration de vivres à peine suffisante pour leur nourriture et celle
de leur famille. J'ai vu le forgeron à ses travaux, - à la gueule du four, disait
un scribe du temps à son fils. Ses doigts sont rugueux comme des objets en peau de crocodile, -
il est puant plus qu'un oeuf de poisson. Tout artisan en métaux, - a-t-il
plus de repos que le laboureur ? - Ses champs à lui, c'est du
bois ; ses outils, du métal. - La nuit, quand il est censé être libre, -
il travaille encore, après tout ce que ses bras ont déjà fait pendant le
jour, - la nuit, il veille au flambeau.
Le tailleur de pierre cherche du travail, - en toute espèce de
pierres dures. - Lorsqu'il a fini les travaux de son métier, - et que ses
bras sont usés, il se repose ; - comme il reste accroupi dès le lever du
soleil, - ses genoux et son échine sont rompus. - Le barbier rase jusqu'à la
nuit : - lorsqu'il se met à manger, alors seulement il se met sur son
coud~ pour se reposer. - Il va de pâté de maisons en pâté de maisons pour chercher
les pratiques ; - il se rompt les bras pour emplir son ventre, comme les
abeilles qui mangent le produit de leurs labeurs. - Le batelier descend
jusqu'à Natho pour gagner son salaire. Quand il a accumulé travail sur
travail, qu'il a tué des oies et des flamants, qu'il a peiné sa peine, - à
peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il à sa maison, qu'il lui faut
s'en aller.
Je te dirai comme le maçon - la maladie le goûte ; - car il
est exposé aux rafales, - construisant péniblement, attaché aux chapiteaux en
forme de lotus des maisons, - pour atteindre ses fins ? - Ses deux bras
s'usent au travail, - ses vêtements sont en désordre ; - il se ronge
lui-même, - ses doigts lui sont des pains ; - il ne se lave qu'une fois
par jour. - Il se fait humble pour plaire : - c'est un pion qui passe dé
case en case - de dix coudées sur six ; - c'est un pion qui passe de
mois en mois sur les poutres d'un échafaudage, accroché aux chapiteaux en
forme de lotus des maisons, - y faisant tous les travaux nécessaires. - Quand
il a son pain, il rentre à la maison, et bat ses enfants…
Le tisserand, dans l'intérieur des maisons, - est plus malheureux
qu'une femme. - Ses genoux sont à la hauteur de son estomac ; il ne
goûte pas l'air libre. - Si un seul jour il manque à fabriquer la quantité
d'étoffe réglementaire, - il est lié comme le lotus des marais. C'est
seulement en gagnant par des dons de pains les gardiens des portes, - qu'il
parvient à voir la lumière du jour. - Le fabricant d'armes peine extrêmement
- en parlant pour les pays étrangers - c'est une grande somme qu'il donne
pour ses ânes, - c'est une grande somme qu'il donne pour les parquer, -
lorsqu'il se met en chemin. - A peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il
à sa maison, le soir, - il lui faut s’en aller. - Le courrier, en partant
pour les pays étrangers, - lègue ses biens à ses enfants, - par crainte des bêtes
sauvages et des Asiatiques. - Que lui arrive-t-il quand il est en
Egypte ? - A peine arrive-t-il à son verger. - arrive-t-il à sa maison -
il lui faut s'en aller. - S'il part, sa misère lui pèse ; - s'il ne s'en
va pas, il se réjouit. - Le teinturier, ses doigts puent - l'odeur des
poissons pourris ; - ses deux yeux sont battus de fatigue ; - sa
main n'arrête pas. - Il passe son temps à couper des haillons ; - c'est
son horreur que les vêtements. - Le cordonnier est très malheureux ; il
mendie éternellement ; - sa santé est celle d'un poisson crevé ; -
il ronge le cuir pour se nourrir[110].
Les portraits ne sont pas flattés : s'il fallait les
prendre au sérieux, on n'aurait rencontré que misère dans l'Égypte de la
douzième dynastie. Aussi bien l'auteur à qui je les emprunte est-il un vieux
scribe gourmé et tout infatué des avantages de sa profession, qui veut
dégoûter son fils des métiers et l'encourage à suivre la carrière des
lettres. J'ai
vu la violence, j'ai vu la violence ; - c'est pourquoi mets ton coeur
après les lettres ! - J'ai contemplé les travaux manuels, - et en vérité
il n'y a rien au delà des lettres. - Comme on fait dans l'eau, plonge-toi au
sein du livre Qimi[111], - tu y trouveras ce précepte en propres
termes : Si le scribe va étudier au palais, - son inactivité
corporelle ne sera point sur lui. - Lui, c'est un autre qui le
rassasie ; - il ne remue pas, il se repose. – J'ai
vu les métiers figurés, y est-il dit en propres termes, - aussi te fais-je
aimer la littérature, ta mère ; je fais entrer ses beautés en ta face. -
Elle est plus importante que tous les métiers, - elle n'est pas un vain mot
sur cette terre ; - celui qui s'est mis à en tirer profit dés son
enfance, il est honoré ; - on l'envoie remplir des missions. - Celui qui
n’y va point reste dans la misère[112]. - Celui qui connaît
les lettres - est meilleur que toi par cela seul. - Il n'en est pas de même
des métiers que j'ai mis à ta face -
le compagnon y méprise son compagnon. - On n'a jamais dit au scribe - Travaille pour un tel ; - ne transgresse
pas tes ordres. - Certes, en te conduisant au - palais, certes, j'agis par
amour pour toi ; - car, si tu as profité un seul jour dans l'école, -
c'est pour l'éternité, les travaux qu'on y fait sont durables comme les
montagnes. - Ce sont ceux-là, vite, vite, que je te fais connaître, que je te
fais aimer, - car ils éloignent l'ennemi[113]. L'étude
des lettres sacrées et le rang de scribe menaient à tout ; le scribe
pouvait devenir selon ses aptitudes et son adresse, prêtre, général, receveur
des contributions, gouverneur des nomes, ingénieur, architecte. Aussi la
science des lettres, considérée comme moyen de parvenir, était-elle fort en
honneur à cette époque, et nous est-elle vantée dans un certain nombre de morceaux
réputés classiques dans les siècles postérieurs. J'ai déjà eu plusieurs fois
occasion de citer presque toutes les oeuvres qui nous restent de la douzième
dynastie, le Conte de Sinouhit[114], les Instructions
du roi Amenemhaît 1er à son fils Sanouasrît, les Recommandations
du scribe Khatoui, fils de Douaouf, à son fils Pépi, et le bel Hymne au Nil
du Musée britannique[115]. On jugera, par
les extraits que j'en ai donnés, du mérite qu'elles pouvaient avoir aux yeux
des Égyptiens.
Nous sommes encore mieux placés pour apprécier la
perfection que les arts plastiques avaient atteinte. Sans doute nous ne
pouvons nous figurer exactement ce qu'était un temple ou un palais ; le
temps a balayé presque jusqu'aux débris des édifices immenses qui ornaient
alors les villes royales de l'Égypte. Les portiques des tombes de Béni-Hassan
nous autorisent cependant à affirmer que l'architecture avait dès lors
produit des chefs-d'oeuvre. L'un d'eux est décoré de colonnes analogues aux
colonnes doriques, et antérieures de deux mille ans pour le moins aux plus
anciennes colonnes de cet ordre, qui aient été élevées en Grèce. La
sculpture, bien qu'inférieure en certains points au grand art de l'Ancien
Empire, nous a laissé tant de morceaux admirables, qu'on se demande où
l'Égypte a pu enrôler assez d'artistes pour les exécuter. Les statues
d'Amenemhaît 1er et de Sanouasrît 1er, que Mariette a
découvertes à Tunis, sont presque aussi belles que la statue de Khephren.
Elles inspiraient tant d'admiration aux Égyptiens eux-mêmes, que les Pharaons
d'époque postérieure, Ramsès II et Mineptah, les ont usurpées[116]. Le colosse en
granit rose dressé par Sanouasrît III devant une des portes des temples
d'Osiris à Abydos, montre que les sculptures de la haute Égypte ne le
cédaient en rien à celles du Delta[117]. Une école
locale, dont le siège paraît avoir été Tanis, nous a légué des oeuvres d'un
style particulier où Mariette voulut d'abord reconnaître les souverains
Hyksôs, mais qui représentent en réalité Amenemhaît III. En général, le style
de ces monuments est remarquable par une vigueur exagérée; les jambes sont
traitées avec une liberté de ciseau surprenante. Tous les accessoires, dessin
des ornements, gravure des hiéroglyphes, sont poussés à une finesse qu'ils ne
retrouveront jamais plus. Les bas-reliefs, toujours dénués de perspective,
sont, comme pendant la période memphite, d'une délicatesse extrême; on les
habillait de couleurs vives, qui conservent encore aujourd'hui tout leur
éclat premier. L'art de la douzième dynastie, examiné dans son ensemble,
était de bien peu inférieur à celui des dynasties précédentes. Les défauts
qui plus tard arrêtèrent le progrès de la sculpture égyptienne, la convention
dans le rendu des détails, la lourdeur des jointures, la raideur hiératique,
se laissaient à peine sentir. Toutes les fois qu'au milieu de la décadence
artistique une renaissance partielle s’annonçait, les sculpteurs de la
dix-huitième et de la vingt-sixième dynastie allaient chercher leur modèle
parmi les oeuvres de la douzième ou de la quatrième, et ils s'essayaient à en
imiter le style.
De la treizième à la quinzième dynastie.
L'Égypte était donc en pleine prospérité à la mort
d'Amenemhaît III. La dynastie avait conquis la Nubie et recouvré la péninsule
du Sinaï, assaini le sol, régularisé l'inondation, orné les villes
principales de temples et de monuments, assuré la bonne administration et par
sui le doublé la richesse du pays ; en un mot, elle avait terminé
l'oeuvre de réparation que la onzième dynastie n'avait pu qu'ébaucher. C'est
à ce moment qu'elle s'éteignit, après deux règnes insignifiants, ceux
d'Amenemhaît IV et de sa soeur Sovkounofriou. Treize ans et quelques mois
s’étaient à peine écoulés depuis la mort d'Amenemhaît III, quand le Thébain
Sovkhotpou 1er Khoutoouïrî monta sur le trône et inaugura une dynastie
nouvelle.
Elle dura, dit-on, quatre cent cinquante-trois ans et
compta soixante rois, dont l'ordre de succession est encore incertain[118]. Pendant ce
long intervalle de temps, la série dynastique, plusieurs fois interrompue par
le manque de lignée mâle, se renoua sans secousse, grâce aux droits
héréditaires que possédaient les princesses, et qu'elles transmettaient à
leurs enfants. Sovkhotpou II Skhemouaztoouïrî, fils d'un simple prêtre, Montouhotpou,
et d'une princesse royale, hérita de sa mère la couronne d'Égypte[119] ;
Nofirhotpou II Khâsoshshourî, dont le père n'appartenait pas à la famille
régnante, devint roi du chef de sa mère Kama[120]. Quoi qu'il en
soit de ces interruptions dans la succession directe, l'examen des monuments
nous enseigne que la treizième dynastie assura à l'Egypte entière quelques
siècles de prospérité. Les Sovkhotpou et les Nofirhotpou qui se pressent sur
ses listes, et dont les noms rappellent involontairement à l'esprit les
dix-huit rois éthiopiens qui, au dire d'Hérodote, étaient bien antérieurs à
Sabacon[121],
surent conserver les conquêtes de leurs prédécesseurs et parfois même les
étendre. Le vingt-quatrième ou vingt-cinquième d'entre eux, Sovkhotpou
Khânofirri[122],
pouvait encore ériger des colosses dans l'île d'Argo au fond de l'Éthiopie, à
peu prés cinquante lieues au sud de Semnéh[123]. A l'intérieur,
ils continuèrent les travaux d'hydrographie entrepris par les Sanouasrît et
les Amenemhaît. L'un d'eux, Sovkhotpou Skemkhoutoouïri[124], faisait
relever et inscrire à l'observatoire de Semnéh les hauteurs de la crue du Nil
pour les quatre premières années de son règne[125]. Ils mirent
tous leurs soins à l'embellissement des grandes villes de l'Egypte, et ils
exécutèrent des travaux à Thèbes dans le grand temple d'Amon[126], à Bubaste,
dans le Delta, où fut trouvée, dit-on, la belle statue de Sovkhotpou
Khânofirri, aujourd'hui conservée au Louvre[127], à Tanis, où
ils semblent avoir eu l'une de leurs résidences favorites[128]. Le sanctuaire
d'Abydos fut de leur part l'objet d'une vénération particulière. Le roi
Nofirhotpou Khâsoshshourî lui concéda des dons considérables[129], le roi
Rânouzir Rànmàtan le restaura et le décora à neuf par l'entremise d'un de ses
officiers[130],
Sovkoumsaouf Skhemouazkourî y consacra sa statue[131], et les
particuliers, suivant l'exemple du maître, prodiguèrent les faveurs de tout
genre au temple d'Osiris. Le style des oeuvres de cette époque est déjà
inférieur à celui des oeuvres de la douzième dynastie les proportions de la figure humaine
commencent à s'altérer, le modelé des membres à perdre de sa vigueur et de
son fini. Malgré ces défauts, souvent peu apparents, la plupart des statues
royales jusqu'à présent connues sont d'une beauté que l'art des époques
postérieures a rarement égalée. Il suffit d'examiner avec soin l'un de ces
morceaux et de se rappeler qu'on en rencontre de semblables tout le long de
la vallée du Nil, depuis la troisième cataracte jusqu'à l'embouchure du
fleuve, pour rester convaincu que l'Égypte était alors une grande puissance,
réunie sous un seul sceptre et non pas, comme le voudraient certains auteurs, un État divisé en deux royaumes
indépendants l'un de l'autre[132], ou possédé
militairement par les rois pasteurs établis dans le Delta[133]. Les dernières
années de la treizième dynastie furent-elles aussi heureuses que les
premières ? On ne saurait le dire dans l'état actuel de la science. Tout
ce que l'on peut affirmer, c'est que les monuments en sont rares, et qu'ils
ne présentent pas le même mérite que ceux des souverains du début. Les listes
de Manéthon enregistrent un fait certain vers cette époque, le centre de la
puissance égyptienne se déplaça. La prépondérance que Thèbes avait maintenue
pendant sept cents ans et plus sur le reste des cités lui échappa et dévolut
aux populations du Delta. Les Pharaons de la douzième et surtout ceux de la
treizième dynastie avaient préparé ce résultat en favorisant le nord, Mendès,
Saïs, Bubaste, Tanis surtout, au détriment du midi. Quand ils disparurent, Thèbes
perdit son rang de capitale, et ce fut une ville de la Basse Égypte, ce fut Xoïs,
qui lui succéda. Le Delta avait profité des travaux exécutés naguères par les
Thébains autant, sinon plus, que la vallée proprement dite : ses marais
s'étaient colmatés, ses campagnes assainies, ses canaux régularisés et le
commerce avec l'Asie y apportait mie richesse sans cesse croissante. Xoïs,
située au centre même de la plaine, entre les branches phatmétique et
sébennytique du Nil[134], n'avait
jusqu'alors joué qu'un rôle des plus effacés : elle sembla avoir gagné
plus que les autres à la prospérité générale. La quatorzième dynastie, sortie
de ses murs, compta, dit-on, soixante-quinze rois, qui dominèrent quatre cent
quatre-vingt-quatre ans. Leurs noms mutilés se pressaient en colonnes sur les
pages du Papyrus royal de Turin, et les chiffres qui désignent la longueur de
leur règne sont souvent assez bas, deux ans, un an, trois ans : on voit
qu'ils se sont succédé sur le trône très rapidement, mais leur histoire est inconnue.
Tout au plus pourrait-on supposer que les derniers d'entre eux furent
assaillis par des révolutions et par des guerres civiles qui amenèrent leur
chute[135].
|