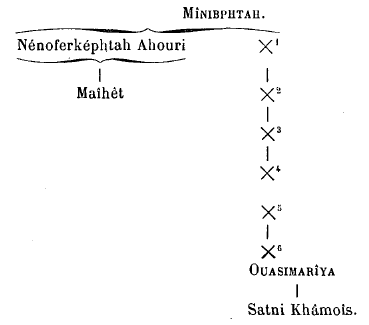LES CONTES POPULAIRES DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
Gaston MASPERO
Membre de l’Institut, professeur au Collège de France, directeur général du Service des Antiquités de l’Égypte.
INTRODUCTION
Parties : I – II – III – IV – V.Lorsque M. de Rougé découvrit en 1859 un conte d’époque pharaonique analogue aux récits des Mille et une Nuits, la surprise en fut grande, même chez les savants qui croyaient le mieux connaître l’Égypte ancienne. Les hauts personnages dont les momies reposent dans nos musées avaient un renom de gravité si bien établi, que personne au monde ne les soupçonnait de s’être divertis à de pareilles futilités, au temps où ils n’étaient encore momies qu’en espérance. Le conte existait pourtant ; le manuscrit avait appartenu à un prince, à un enfant de roi qui fut roi lui-même, à Sétoui II, fils de Ménéphtah, petit-fils de Sésostris. Une Anglaise, madame Élisabeth d’Orbiney, l’avait acheté en Italie, et comme elle traversait Paris au retour de son voyage, M. de Rougé lui en avait enseigné le contenu. Il y était question de deux frères dont le plus jeune, accusé faussement par la femme de l’autre et contraint à la fuite, se transformait en taureau, puis en arbre, avant de renaître dans le corps d’un roi. M. de Rougé avait paraphrasé son texte plus qu’il ne l’avait traduit[1]. Plusieurs parties étaient analysées simplement, d’autres étaient coupées à chaque instant par des lacunes provenant, soit de l’usure du papyrus, soit de la difficulté qu’ors éprouvait alors à déchiffrer certains groupes de signes ou à débrouiller les subtilités de la syntaxe : même le nom du héros était mal transcrit[2]. Depuis, nul morceau de littérature égyptienne n’a été plus minutieusement étudié, ni à plus de profit. L’industrie incessante des savants en a corrigé les fautes et comblé les vides : aujourd’hui le Conte des deux Frères se lit couramment, à quelques mots près[3]. Il demeura unique de son espèce pendant douze ans. Mille reliques du passé reparurent au jour, listes de provinces conquises, catalogues de noms royaux, inscriptions funéraires, chants de victoire, des épîtres familières, des livres de comptes, des formules d’incantation magique, des pièces judiciaires, jusqu’à des traités de médecine et de géométrie, rien qui ressemblât à un roman. En 1864, le hasard des fouilles illicites ramena au jour, près de Déîr-el-Médinéh et dans la tombe d’un religieux copte, un coffre en bois qui contenait, avec le cartulaire d’un couvent voisin, des manuscrits qui n’avaient rien de monastique, les recommandations morales d’un scribe à son fils[4], des prières pour les douze heures de la nuit, et un conte plus étrange encore que celui des deux Frères. Le héros s’appelle Satni-Khâmoîs et il se débat contre une bande de momies parlantes, de sorcières, de magiciens, d’êtres ambigus dont on se demande s’ils sont morts ou vivants. Ce qui justifierait la présence d’un roman païen à côté du cadavre d’un moine, on ne le voit pas bien. On conjecture que le possesseur des papyrus a dû être un des derniers Égyptiens qui aient entendu quelque chose aux écritures anciennes ; lui mort, ses dévots confrères enfouirent dans sa fosse des grimoires auxquels ils ne comprenaient rien, et sous lesquels ils flairaient je ne sais quels pièges du démon. Quoi qu’il en soit, le roman était là, incomplet du début, mais assez intact par la suite pour qu’un savant accoutumé au démotique s’y orientât sans difficulté. L’étude de l’écriture démotique[5] n’était pas alors très populaire parmi les égyptologues : la ténuité et l’indécision des caractères qui la composent, la nouveauté des formes grammaticales, l’aridité ou la niaiserie des matières, les effrayaient ou les rebutaient. Ce qu’Emmanuel de Rougé avait fait pour le papyrus d’Orbiney, Brugsch était seul capable de l’essayer pour le papyrus de Boulaq : la traduction qu’il en a imprimée, en 1867, dans la Revue archéologique, est si fidèle qu’aujourd’hui encore on y a peu changé[6]. Depuis lors, les découvertes se sont succédé sans interruption. En 1874, Goodwin, furetant au hasard dans la collection Harris que le Musée Britannique venait d’acquérir, mit la main sur les Aventures du prince prédestiné[7], et sur le dénouement d’un récit auquel il attribua une valeur historique, en dépit d’une ressemblance évidente avec certains des faits et gestes d’Ali Baba[8]. Quelques semaines après, Chabas signalait à Turin ce qu’il pensait être les membres disjoints d’une sorte de rapsodie licencieuse[9], et à Boulaq les restes d’une légende d’amour[10]. Golénicheff déchiffra ensuite, à Saint-Pétersbourg, trois nouvelles dont le texte est inédit en partie jusqu’à présent[11]. Puis Erman publia un long récit sur Chéops et les magiciens, dont le manuscrit, après avoir appartenu à Lepsius, est aujourd’hui au musée de Berlin. Krall recueillit dans l’admirable collection de l’archiduc Régnier, et il rajusta patiemment les morceaux d’une Emprise de la Cuirasse[12] ; Griffith tira des réserves du Musée Britannique un deuxième épisode du cycle de Satni-Khâmois, et Spiegelberg acquit pour l’Université de Strasbourg une version thébaine de la chronique du roi Pétoubastis. Enfin, on a signalé, dans un papyrus de Berlin, le début d’un roman fantastique trop mutilé pour qu’on en devine sûrement le sujet[13], et sur plusieurs ostraca dispersés dans les musées de l’Europe les débris d’une histoire de revenants[14]. Ajoutez que certaines œuvres considérées au début comme des documents sérieux, les Mémoires de Sinouhft[15], les Plaintes du fellah[16], les négociations entre le roi Apôpi et le roi Saqnounriya[17], la Stèle de la princesse de Bakhtan, le Voyage d’Ounamounou, sont en réalité des œuvres d’imagination pure. Même après vingt siècles de ruines et d’oubli, l’Égypte possède encore presque autant de contes que de poèmes lyriques ou d’hymnes adressés à la divinité. IL’examen en soulève diverses questions difficiles à résoudre. Et d’abord de quelle manière ont-ils été composés ? Ont-ils été inventés du tout par leur auteur ? ou celui-ci en a-t-il emprunté la substance à des œuvres préexistantes qu’il a juxtaposées ou fondues pour en fabriquer une fable nouvelle ? Plusieurs sont venus certainement d’un seul jet et ils constituent des pièces originales, les Mémoires de Sinouhît, le Naufragé, la Ruse de Thoutiyi contre Joppé, le Conte du prince prédestiné. Une action unique s’y poursuit de la première ligne à la dernière, et si des épisodes s’y rallient en chemin, ils ne sont que le développement nécessaire de la donnée maîtresse, les organes sans lesquels elle ne pourrait atteindre le dénouement saine et sauve. D’autres au contraire se divisent presque naturellement en deux morceaux, trois au plus, qui étaient indépendants à l’origine, et entre lesquels le conteur a établi un lien souvent arbitraire afin de les disposer dans un même cadre. Ainsi ceux qui traitent de Satni-Khâmoîs contiennent chacun le sujet de deux romans, celui de Nénoferképhtah et celui de Thoubouî dans le premier, celui de la descente aux enfers et celui des magiciens éthiopiens dans le second. Toutefois l’exemple le plus évident d’une composition .artificielle nous est fourni jusqu’à présent par le conte de Chéops et des magiciens. Il se résout dès l’abord en deux éléments : l’éloge de plusieurs magiciens morts ou vivants, et une version miraculeuse des faits qui amenèrent la chute de la IVe et l’avènement de la Ve dynastie. Comment l’auteur fut-il amené à les combiner, nous le saurions peut-être si nous possédions encore les premières pages du manuscrit ; en l’état, il est hasardeux de rien conjecturer. Il paraît pourtant qu’ils n’ont pas été fabriqués tout d’une fois mais que l’œuvre s’est constituée comme à deux degrés. Il y avait, dans un temps que nous ne pouvons déterminer encore, une demi-douzaine d’histoires qui couraient à Memphis ou dans les environs et qui avaient pour héros des sorciers d’époque lointaine. Un rapsode inconnu s’avisa d’en compiler un recueil par ordre chronologique, et pour mener à bien son entreprise, il eut recours à l’un des procédés les plus en honneur dans les littératures orientales. Il supposa que l’un des Pharaons populaires, Chéops, eut un jour la fantaisie de demander à ses fils des distractions contre l’ennui qui le rongeait. Ceux-ci s’étaient levés devant lui l’un après l’autre, et ils lui avaient vanté tour à tour la prouesse de l’un des sorciers d’autrefois ; seul Dadoufhorou, le dernier d’entre eux, avait entamé l’éloge d’un vivant. En considérant les choses de plus près on note que les sages étaient des hommes au livre ou au rouleau en chef de Pharaon, c’est-à-dire des gens en place, qui tenaient leur rang dans la hiérarchie, tandis que le contemporain, Didon, ne porte aucun titre. Il était un simple provincial parvenu à l’extrême vieillesse sans avoir brigué jamais la faveur de la cour ; si le prince le connaissait, c’est qu’il était lui-même un adepte, et qu’il avait parcouru l’Égypte entière à la recherche des écrits antiques ou des érudits capables de les interpréter. Il se rend donc chez son protégé et il l’amène à son père pour opérer un miracle plus étonnant que ceux de ses prédécesseurs. Didou refuse de toucher à un homme, mais il ressuscite une oie, il ressuscite un bœuf, puis il rentre au logis comblé d’honneurs. Le premier recueil s’arrêtait ici à coup sûr, et il formait une œuvre complète en soi. Mais il y avait, dans le même temps et dans la même localité, une histoire de trois jumeaux fils du Soleil et d’une prêtresse de Râ, qui seraient devenus les premiers rois de la Ve dynastie. Didou y jouait-il un rôle dès le début ? En tout cas, l’auteur à qui nous devons la rédaction actuelle le choisit pour ménager la transition entre les deux chroniques. Il supposa qu’après avoir assisté à la résurrection de l’oie et du bœuf, Chéops avait requis Didou de lui procurer les livres de Thot. Didou ne se refuse pas à confesser qu’il les connaît, mais il déclare aussi qu’un seul homme est capable d’en assurer la possession au roi, lainé des trois garçons qu’une prêtresse de Râ porte actuellement dans son sein, et qui sont prédestinés à régner au bout de quatre générations. Chéops s’émeut de cette révélation, ainsi qu’il est naturel, et il s’informe de la date à laquelle les enfants naîtront : Didou la lui indique, il regagne son village et l’auteur, l’y laissant, s’attache sans plus tarder aux destinées de la prêtresse et de sa famille. Il ne s’était pas torturé longuement l’esprit à chercher sa transition, et il avait eu raison, car ses auditeurs ou ses lecteurs n’étaient pas exigeants sur le point de la composition littéraire. Ils lui demandaient de les amuser, et pourvu qu’il y réussît, ils ne s’inquiétaient pas des procédés qu’il y employait. Les romanciers égyptiens n’éprouvaient donc aucun scrupule à s’approprier les récits qui circulaient autour d’eux, et à les arranger selon leur guise, les compliquant au besoin d’incidents étrangers à la rédaction première, ou les réduisant à n’être plus qu’un épisode secondaire dans un cycle différent de celui auquel ils appartenaient par l’origine. Beaucoup des éléments qu’ils combinaient présentent un caractère nettement égyptien, mais ils en utilisaient aussi qu’on rencontre dans les littératures des peuples voisins et qu’ils avaient peut-être empruntés au dehors. On se rappelle, dans l’Évangile selon saint Luc, cet homme opulent, vêtu de pourpre et de fin lin, qui banquetait somptueusement chaque jour, tandis qu’à sa porte Lazare, rongé d’ulcères, se consumait en vain du désir de ramasser seulement les miettes qui tombaient de la table du riche. Or, il arriva que le mendiant, étant mort, fut emporté au ciel par les anges, et que le riche mourut aussi et fut enterré pompeusement ; au milieu des tortures de l’enfer, il leva les yeux, et il aperçut très loin Lazare, en paix dans le sein d’Abraham[18]. On lit, au second roman de Satni-Khàmoîs, une version égyptienne de la parabole évangélique, mais elle y est dramatisée et amalgamée à une autre conception populaire, celle de la descente d’un vivant aux enfers[19]. Sans insister sur ce sujet pour le moment, je dirai que plusieurs des motifs développés par les écrivains égyptiens leur sont communs avec les conteurs des nations étrangères, anciennes ou modernes. Analysez le Conte des deux Frères et appliquez-vous à en définir la structure intime : vous serez étonnés de voir à quel point il ressemble pour la donnée et pour les détails à certains des récits qui ont cours chez beaucoup d’autres nations. Il se dédouble à première vue : le conteur, trop paresseux ou trop dénué d’imagination pour inventer une fable, en avait choisi deux ou plus parmi celles que ses prédécesseurs lui avaient transmises, et il les avait soudées bout à bout de façon plus ou moins maladroite, en se contentant d’y introduire quelques menus incidents qui pussent faciliter le contact entre elles. L’Histoire véridique de Satni-Châmois est de même un ajustage de deux romans, la descente aux Enfers, et l’aventure du roi Siamânou ; le rédacteur les a reliés en supposant que le Sénosiris du premier réincarnait l’Horus qui était le héros du second. Le Conte des deux Frères met d’abord en scène deux frères, l’un marié, l’autre célibataire, qui habitent ensemble et qui s’occupent aux mêmes travaux. La femme de l’aîné s’éprend du cadet sur le vu de sa force, et elle profite de l’absence du mari pour s’abandonner à un accès de passion sauvage. Baîti refuse ses avances brutalement ; elle l’accuse de viol, et elle le charge avec tant d’adresse que le mari se décide à le tuer en trahison. Les bœufs qu’il rentrait à l’étable l’ayant averti du danger, il s’enfuit, il échappe à la poursuite grâce à la protection du soleil, il se mutile, il se disculpe, mais il refuse de revenir à la maison commune et il s’exile au Val de l’Acacia : Anoupou, désespéré, rentre chez lui, il égorge la calomniatrice, puis il demeure en deuil de son petit frère. Jusqu’à présent, le merveilleux ne tient pas trop de place dans l’action : sauf quelques discours prononcés par les bœufs et l’apparition, entre les deux frères, d’une eau remplie de crocodiles, le narrateur s’est servi surtout de moyens empruntés à l’ordinaire de la vie. La suite n’est que prodiges d’un bout à l’autre. Baîti s’est retiré au Val pour vivre dans la solitude, et il a déposé son cœur sur une fleur de l’Acacia. C’est une précaution des plus naturelles. On enchante son cœur, on le place en lieu sûr, au sommet d’un arbre par exemple ; tant qu’il y restera, aucune force ne prévaudra contre le corps qu’il anime quand même[20]. Cependant, les dieux, descendus en visite sur la terre, ont pitié de l’isolement de Baîti et ils lui fabriquent une femme[21]. Comme il l’aime éperdument, il lui confie son secret, et il lui enjoint de ne pas quitter la maison ; car le Nil qui arrose là vallée est épris de sa beauté et ne manquerait pas à vouloir l’enlever. Cette confidence faite, il s’en va à la chasse ; et elle lui désobéit aussitôt : le Nil l’assaille et s’emparerait d’elle, si l’Acacia ; qui joue le rôle de protecteur on ne sait trop comment, ne la sauvait en jetant à l’eau une boucle de ses cheveux. Cette épave, charriée jusqu’en Égypte, est remise à Pharaon, et Pharaon ; conseillé par ses magiciens, envoie ses gens à la recherche de la fille des dieux : La force échoue la première fois ; à la seconde la trahison réussit, on coupe l’Acacia, et sitôt qu’il est à bas Baîti meurt. Trois années durant il reste inanimé ; la quatrième ; il ressuscite avec l’aide d’Anoupou et il songe à tirer vengeance du crime dont il est la victime. C’est désormais entré l’épouse infidèle et le mari outragé une lutte d’adresse magique et de méchanceté. Baîti se change en taureau : la fille des dieux obtient qu’on égorge le taureau. Le sang ; touchant le sol, en fait jaillir deux perséas qui trouvent une voix pour dénoncer la perfidie : la fille des dieux obtient qu’on abatte les deux perséas, qu’on en façonne des meubles, et, pour mieux goûter sa vengeance, elle assiste à l’opération. Un copeau, envolé sous l’herminette des menuisiers ; lui entre dans la bouche ; elle l’avale, elle conçoit, elle accouche d’un fils qui succède à Pharaon ; et qui est Baîti réincarné. A peine monté sur le trône, il rassemble les conseillers de la couronne et il leur expose ses griefs, puis il envoie au supplice celle qui, après avoir été sa femme, était devenue sa mère malgré elle. Somme tonte, il y a dans ce seul conte l’étoffe de deux romans distincts, dont le premier met en scène la donnée du serviteur accusé par la maîtresse qu’il a dédaignée, tandis que le second dépeint les métamorphoses du mari trahi par sa femme. La fantaisie populaire les a réunis par le moyen d’un troisième motif, celui de l’homme ou du démon qui cache son cœur et meurt lorsqu’un ennemi le découvre. Avant de s’expatrier, Baîti a déclaré qu’un malheur lui arriverait bientôt, et il a décrit les prodiges qui doivent annoncer la mauvaise nouvelle à son frère. Ils s’accomplissent au moment où l’Acacia tomba et Anoupou part d’urgence à la recherche du cœur : l’aide qu’il prête en cette circonstance compense la tentative de meurtre du début, et elle forme la liaison entre les deux contes. La tradition grecque, elle aussi, avait ses fables où le héros est tué ou menacé de mort pour avoir refusé les faveurs d’une femme adultère, Hippolyte, Pélée, Phinée. Bellérophon, fils de Glaucon, à qui donnèrent les dieux la beauté et une aimable vigueur, avait résisté aux avances de la divine Antéia, et celle-ci, furieuse, s’adressa au roi Prœtos : Meurs, Prœtos, ou tue Bellérophon, car il a voulu s’unir d’amour avec moi, qui n’ai point voulu. Prœtos expédia le héros en Lycie, où il comptait que la Chimère le débarrasserait de lui[22]. La Bible raconte en détail une aventure analogue au récit égyptien. Joseph vivait dans la maison de Putiphar comme Baîti dans celle d’Anoupou : Or il était beau de taille et de figure. Et il arriva à quelque temps de là que la femme du maître de Joseph jeta ses yeux sur lui et lui dit : « Couche avec moi ! » Mais il s’y refusa et lui répondit : « Vois-tu, mon maître ne se soucie pas, avec moi, de ce qui se passe dans sa maison, et il m’a confié tout son avoir. Lui-même n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit si ce n’est toi, puisque tu es sa femme. Comment donc commettrais-je ce grand crime, ce péché contre Dieu ? » Et quoiqu’elle parlât ainsi à Joseph tous les jours, il ne l’écouta point et il refusa de coucher avec elle et de rester avec elle. Or, il arriva un certain jour qu’étant entré dans la chambre pour y faire sa besogne, et personne des gens de la maison ne s’y trouvant, elle le saisit par ses habits en disant : « Couche avec moi ! » Mais il laissa son habit entre ses mains et il sortit en toute hâte. Alors, comme elle vit qu’il avait laissé son habit entre ses mains et qu’il s’était hâté de sortir, elle appela les gens de sa maison et elle leur parla en ces termes : « Voyez donc, on nous a amené là un homme hébreu pour nous insulter. II est entré chez moi pour coucher avec moi, mais j’ai poussé un grand cri, et quand il m’entendit élever la voix pour crier, il laissa son habit auprès de moi et il sortit en toute hâte ». Et elle déposa l’habit près d’elle, jusqu’à ce que son maître fût rentré chez lui ; puis elle lui tint le même discours, en disant : « Il est entré chez moi, cet esclave hébreu que tu nous as amené, pour m’insulter, et quand j’élevai la voix pour crier, il laissa son habit auprès de moi et il se hâta de sortir. » Quand son maître eut entendu les paroles de sa femme qu’elle lui adressait en disant : « Voilà ce que m’a fait ton esclave ! » il se mit en colère, et il le prit, et il le mit en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Et il resta là dans cette prison[23]. La comparaison avec le Conte des deux Frères est si naturelle que M. de Rougé l’avait instituée dès 1852[24]. Mais la séduction tentée, les craintes de la coupable, sa honte, la vengeance qu’elle essaie de tirer sont données assez simples pour s’être présentées à l’esprit des conteurs populaires, indépendamment et sur plusieurs points du globe à la fois[25]. Il n’est pas nécessaire de reconnaître dans l’aventure de Joseph la variante d’une histoire, dont le Papyrus d’Orbiney nous aurait conservé la version courante à Thèbes, vers la fin de la XIXe dynastie. Peut-être convient-il de traiter avec la même réserve un conte emprunté aux Mille et une Nuits, et qui n’est pas sans analogie avec le nôtre. Le thème primitif y est dédoublé et aggravé d’une manière singulière : au lieu d’une belle-sœur qui s’offre à son beau-frère, ce sont deux belles-mères qui essaient de débaucher les fils de leur mari commun. Le prince Kamaralzaman avait eu Amgiâd de la princesse Badour et Assâd de la princesse Haïat-en-néfous. Amgiâd et Assâd étaient si beaux que, dès l’enfance, ils inspirèrent aux sultanes une tendresse incroyable. Les années écoulées, ce qui semblait affection maternelle éclate en passion violente : au lieu de combattre leur ardeur criminelle, Bâddur et Haïât-en-néfous se concertent et elles déclarent leur amour par lettres de haut style. Évincées avec mépris, elles craignent une dénonciation. A l’exemple de la femme d’Anoupou, elles prétendent qu’on a voulu leur faire violence ; elles pleurent, elles crient, elles se couchent ensemble dans un même lit, comme si la résistance avait épuisé leurs forces. Le lendemain matin, Kamaralzaman, revenu de la chasse, les trouve plongées dans les larmes et leur demande la cause de leur douleur. On devine la réponse : Seigneur, la peine qui nous accable est de telle nature que nous ne pouvons plus supporter la lumière du jour, après l’outrage dont les deux princes vos enfants se sont rendus coupables à notre égard. Ils ont eu, pendant votre absence, l’audace d’attenter à notre honneur. Colère du père, sentence de mort contre les fils : le vieil émir chargé de l’exécuter ne l’exécute point, sans quoi il n’y aurait plus de conte. Kamaralzaman ne tarde pas à reconnaître l’innocence d’Amgiâd et d’Assâd : cependant, au lieu de tuer ses deux femmes comme Anoupou la sienne, il se borne à les emprisonner pour le restant de leurs jours[26]. C’est la donnée du Conte des deux Frères, mais adaptée aux besoins de la polygamie musulmane : à se modifier de la sorte, elle n’a gagné ni en intérêt, ni en moralité[27]. Les versions du deuxième conte sont plus nombreuses et plus curieuses[28]. On les rencontre partout, en France[29], en Italie[30], dans les différentes parties de l’Allemagne[31], en Transylvanie[32], en Hongrie[33], en Russie et dans les pays slaves[34], chez les Roumains[35], dans le Péloponnèse[36], en Asie-Mineure[37], en Abyssinie[38], dans l’Inde[39]. En Allemagne, Baîti est un berger, possesseur d’une épée invincible. Une princesse lui dérobe son talisman ; il est vaincu, tué, coupé en morceaux, puis rendu à la vie par des enchanteurs qui lui concèdent la faculté de revêtir toutes les formes qui lui plairont. Il se change en cheval. Vendu au roi ennemi et reconnu par la princesse qui insiste pour qu’on le décapite, il intéresse à son sort la cuisinière du château : Quand on me tranchera la tête, trois gouttes de mon sang sauteront sur ton tablier ; tu les mettras en terre pour l’amour de moi. Le lendemain, un superbe cerisier avait poussé à l’endroit même où les trois gouttes avaient été enterrées. La princesse coupe le cerisier ; la cuisinière ramasse trois copeaux et les jette dans l’étang où ils se transforment en autant de canards d’or. La princesse en tue deux à coups de flèche, s’empare du troisième et l’emprisonne dans sa chambre ; pendant la nuit, le canard reprend l’épée et disparaît[40]. En Russie, Baîti s’appelle Ivan, fils de Germain le sacristain. Il trouve une épée magique dans un buisson, il va guerroyer contre les Turcs qui avaient envahi le pays d’Arinar, il en tue quatre-vingt mille, cent mille, puis il reçoit pour prix de ses exploits la main de Cléopâtre, fille du roi. Son beau-père meurt, le voilà roi à son tour, mais sa femme le trahit et livre l’épée aux Turcs ; quand Ivan désarmé a péri dans la bataille, elle s’abandonne au sultan comme la fille des dieux à Pharaon. Cependant, Germain le sacristain, averti par un flot de sang qui jaillit au milieu de l’écurie, part et recueille le cadavre. Si tu veux le ranimer, dit son cheval, ouvre mon ventre, arrache mes entrailles, frotte le mort de mon sang, puis, quand les corbeaux viendront me dévorer, prends-en un et oblige-le à t’apporter l’eau merveilleuse de vie. Ivan ressuscite et renvoie son père : Retourne à la maison ; moi je me charge de régler mon compte avec l’ennemi. En chemin, il aperçoit un paysan : Je me changerai pour toi en un cheval merveilleux, avec une crinière d’or : tu le conduiras devant le palais du sultan. Le sultan voit le cheval, l’enferme à l’écurie et ne se lasse pas de l’aller admirer. Pourquoi, seigneur, lui dit Cléopâtre, es-tu toujours aux écuries ? — J’ai acheté un cheval qui a une crinière d’or. — Ce n’est pas un cheval, c’est Ivan, le fils du sacristain : commande qu’on le tue. Un bœuf au pelage d’or naît du sang du cheval : Cléopâtre le fait égorger. De la tête du taureau naît un pommier aux pommes d’or : Cléopâtre le fait abattre. Le premier copeau qui s’envole du tronc sous la hache se métamorphose en un canard magnifique. Le sultan ordonne qu’on lui donne la chasse et il se jette lui-même à l’eau pour l’attraper, mais le canard s’échappe vers l’autre rive. Il y reprend sa figure d’Ivan, avec des habits de sultan, il jette sur un bûcher Cléopâtre et son amant, puis il règne à leur place[41]. Voilà bien, à plus de trois mille ans d’intervalle, les grandes lignes de la version égyptienne. Si l’on voulait se donner la peine d’en examiner les détails, les analogies se révéleraient partout presque aussi fortes. La boucle de cheveux enivre Pharaon de son parfum ; dans un récit breton, la mèche de cheveux lumineuse de la princesse de Tréménéazour rend amoureux le roi de Paris[42]. Baîti place son cœur sur la fleur de l’Acacia ; dans le Pantchatantra, un singe raconte qu’il ne quitte jamais sa forêt sans laisser son cœur caché au creux d’un arbre[43]. Anoupou est averti de la mort de Baîti par un intersigne convenu à l’avance, du vin et de la bière qui se troublent ; dans divers contes européens, un frère partant en voyage annonce à son frère que, le jour où l’eau d’une certaine fiole se troublera, on saura qu’il est mort[44]. Et ce n’est pas seulement la littérature populaire qui possède l’équivalent de ces aventures — les religions de la Grèce et de l’Asie occidentale renferment des légendes qu’on peut leur comparer presque point par point. Pour ne citer que le mythe phrygien, Atys dédaigne l’amour de la déesse Cybèle, comme Baîti celui de la femme d’Anoupou, et il se mutile comme Baîti[45] ; de même aussi que Baîti en arrive de changement en changement à n’être plus qu’un perséa, Atys se transforme en pin[46]. Toutefois ni Anoupou, ni Baîti ne sont des dieux ou des héros venus à l’étranger. Le premier est allié de près au dieu chien des Égyptiens, et le second porte le nom d’une des divinités les plus vieilles de l’Égypte archaïque, ce Baîti à double buste et à double tête de taureau[47] dont le culte s’était localisé de très bonne heure dans la Moyenne Égypte, à Saka du nome Cynopolite[48], à côté de celui d’Anubis[49] : il fut plus tard considéré comme l’un des rois antérieurs à Ménès[50], et son personnage et son rôle mythique se confondirent dans ceux d’Osiris[51]. D’autres ont fait ou feront mieux que moi les rapprochements nécessaires : j’en ai dit assez pour montrer que les deux éléments principaux existaient ailleurs qu’en Égypte et en d’autres temps qu’aux époques pharaoniques. Y a-t-il dans tout cela une raison suffisante de déclarer qu’ils n’en sont pas ou qu’ils en sont originaires ? Un seul point me paraît hors de doute pour le moment : la version égyptienne est de beaucoup la plus vieille en date que nous ayons. Elle nous est parvenue en effet dans un manuscrit du XIIIe siècle avant notre ère, c’est-à-dire nombre d’années avant le moment où nous commençons à relever la trace des autres. Si le peuple égyptien en a emprunté les données ou s’il les a transmises au dehors, l’opération s’est accomplie à une époque plus ancienne encore que celle où la rédaction nous reporte ; qui peut dire aujourd’hui comment et par qui elle s’est faite ? IIQue le fond soit ou ne soit pas étranger, la forme est toujours indigène : si par aventure il y eut emprunt du sujet, au moins l’assimilation fut-elle complète. Et d’abord les noms. Quelques-uns, Baîti et Anoupou, appartiennent à la religion ou à la légende : Anoupou[52] est, je viens de le dire, en rapport avec Anubis, et son frère, Baîti, avec Baîti le double Taureau. D’autres dérivent de l’histoire et ils rappellent le souvenir des plus célèbres parmi les Pharaons. L’instinct qui porte les conteurs de tous les pays et dé tous les temps à choisir comme héros des rois ou des seigneurs de haut rang, s’associait en Égypte à un sentiment patriotique très vif. Un homme de Memphis, né au pied du temple de Phtah et grandi, pour ainsi dire, à l’ombre des Pyramides, était familier avec Khoufouf et ses successeurs : les bas-reliefs étalaient à ses yeux leurs portraits authentiques, les inscriptions énuméraient leurs titres et célébraient leur gloire. Sans remonter aussi loin que Memphis dans le passé de l’Égypte, Thèbes n’était pas moins riche en monuments : sur la rive droite comme sur la rive gauche du Nil, à Karnak et à Louxor comme à Gournah et à Médinét-Habou, les murailles parlaient à ses enfants de victoires remportées sur les nations de l’Asie ou de l’Afrique et d’expéditions lointaines au-delà des mers. Quand le conteur mettait des rois en scène, l’image qu’il évoquait n’était pas seulement celle d’un mannequin affublé d’oripeaux superbes : son auditoire et lui-même songeaient à ces princes toujours triomphants, dont la figure et la mémoire se perpétuaient vivantes au milieu d’eux. Il ne suffisait pas d’avancer que le héros était un souverain et de l’appeler Pharaon : il fallait dire de quel Pharaon glorieux on parlait, si c’était Pharaon Ramsès ou Pharaon Khoufouî, un constructeur de pyramides ou un conquérant des dynasties guerrières. La vérité en souffrait souvent. Si familiers qu’ils fussent avec les monuments ; les Égyptiens qui n’avaient pas fait de leurs annales une étude attentive inclinaient assez à défigurer les noms et à brouiller les époques. Dès la XIIe dynastie, Sinouhît raconte ses aventures à un certain Khopirkérîya Amenemhaît, qui joint au nom propre Amenemhaît le prénom du premier Sanouosrît : on le chercherait en vain sur les listes officielles[53]. Sanafrouî, de la IVe dynastie, est introduit dans le roman conservé à Saint-Pétersbourg avec Amoni de la XIe[54] ; Khoufouî, Khàfriya et les trois premiers Pharaons de la VI’ dynastie jouent les grands rôles dans les récits du papyrus Westear ; Nabkéourîya, de la IXe, se montre dans l’un des papyrus de Berlin[55] ; Ouasimarîya et Mînibphtah de la XIXe, Siamânou de la XXIe avec un prénom Manakhphré qui rappelle celui de Thoutmôsis III[56], dans les deux Contes de Satni ; Pétoubastis de la XXVIe[57] ; Râhotpou et Manhapourîya dans un fragment d’histoire de revenant ; et un roi d’Égypte anonyme dans le Conte du prince prédestiné. Les noms d’autrefois prêtaient au récit un air de vraisemblance qu’il n’aurait pas eu sans cela : une aventure merveilleuse, inscrite au compte de l’un des Ramsès, devenait plus probable qu’elle n’aurait été, si on l’avait attribuée à quelque bon bourgeois sans notoriété. Il s’établit ainsi, à côté des annales officielles, une chronique populaire parfois bouffonne, toujours amusante. Le caractère des Pharaons et leur gloire même en souffrit : de même qu’il y eut dans l’Europe au moyen âge le cycle de Charlemagne où le rôle et l’esprit de Charlemagne furent dénaturés complètement, on eut en Égypte des cycles de Sésôstris et d’Osimandouas, des cycles de Thoutmôsis III, des cycles de Chéops, où la personne de Ramsès II, de Thoutmôsis III, de Chéops, se modifia au point de devenir souvent méconnaissable. Des périodes entières se transformèrent en sortes d’épopées romanesques, et l’âge des grandes invasions assyriennes et éthiopiennes fournit une matière inépuisable aux rapsodes : selon la mode ou selon leur propre origine, ils groupèrent les éléments que cette époque belliqueuse leur prodiguait autour des Saïtes Bocchoris et Psammétique[58], autour du Tanite Pétoubastis, ou autour du bédouin Pakrour, le grand chef de l’Est[59]. Toutefois, Khoufou4 est l’exemple le plus frappant peut-être que nous ayons de cette dégénérescence. Les monuments nous suggèrent de lui l’opinion la plus avantageuse. Il fut guerrier et il sût contenir les Nomades qui menaçaient les établissements miniers du Sinaï. Il fut constructeur et il bâtit en peu de temps, sans nuire à la prospérité du pays, la plus haute et la plus massive des Pyramides. Il fut dévot, il enrichit les dieux de statues en or et en matières précieuses, il restaura les temples anciens, il en édifia de nouveaux. Bref, il se montra le type accompli du Pharaon Memphite. Voilà le témoignage des documents contemporains, mais écoutez celui des générations postérieures, tel que les historiens grecs l’ont recueilli. Chez eux, Chéops est un tyran impie qui opprime son peuple et qui prostitue sa fille pour achever sa pyramide. Il proscrit les prêtres, il pille les temples, et il les tient fermés cinquante années durant. Le passage de Khoufouî à Chéops n’a pu s’accomplir en un jour, et, si nous possédions plus de la littérature égyptienne, nous en jalonnerions les étapes à travers les âges, comme nous faisons celui du Charlemagne des annalistes au Charlemagne des trouvères. Nous saisissons, avec le conte du Papyrus Westcar, un des moments de la métamorphose. Khoufouî n’y est déjà plus le Pharaon soumis religieusement aux volontés des dieux. Lorsque Ra se déclare contre lui et suscite les trois princes qui ont détrôné sa famille, il se ligue avec un magicien pour déjouer les projets du dieu ou pour en retarder l’exécution : on voit qu’il n’hésiterait pas à traiter les temples de Sakhîbou aussi mal que le Chéops d’Hérodote avait traité tous ceux de l’Égypte. Ici, du moins, le roman n’emprunte pas le ton de l’histoire sur la Stèle de la princesse de Bakhtan, il s’est entouré d’un appareil de noms et de dates combiné si habilement qu’il a réussi à revêtir les apparences de la vérité. Le thème fonda-mental n’y a rien d’esse ntiellement égyptien : c’est celui de la princesse possédée par un revenant ou par un démon, délivrée par un magicien, par un dieu ou par un saint. La variante égyptienne, en se l’appropriant, a mis en mouvement l’inévitable Ramsès II, et elle a profité du mariage qu’il contracta en l’an XXXIV de son règne avec la fille aînée de Khattousîl II, le roi des Khâti, pour transporter en Asie le théâtre principal de l’action. Elle le marie à la princesse presque un quart de siècle avant l’époque du mariage réel, et dès l’an XV, elle lui expédie une ambassade pour lui apprendre que sa belle-sœur Bintrashît est obsédée d’un esprit, dont seuls des magiciens habiles sont capables de la délivrer. Il envoie le meilleur des siens, Thotemhabi, mais celui-ci échoue dans ses exorcismes et il revient tout penaud. Dix années s’écoulent, pendant lesquelles l’esprit reste maître du terrain, puis en l’an XXVI, nouvelle ambassade : cette fois, une des formes, un des doubles de Khonsou consent à se déranger, et, partant en pompe pour l’étranger, il chasse le malin en présence du peuple de Bakhtan[60]. Le prince, ravi, médite de garder le libérateur, mais un songe suivi de maladie a promptement raison de ce projet malencontreux, et l’an XXXIII, Khonsou rentre à Thèbes, chargé d’honneurs et de présents. Ce n’est pas sans raison que le roman affecte l’allure de l’histoire. Khonsou était demeuré très longtemps obscur et de petit crédit. Sa popularité, qui ne commença guère qu’à la fin de la XIXe dynastie, crût rapidement sous les derniers Ramessides : au temps des Tanites et des Bubastites, elle balançait presque celle d’Amon lui-même. Il n’en pouvait aller ainsi sans exciter la jalousie du vieux dieu et de ses partisans : les prêtres de Khonsou et ses dévots durent chercher naturellement dans le passé les traditions qui étaient de nature à rehausser son prestige. Je ne crois pas qu’ils aient fabriqué notre conte de toutes pièces. Il existait avant qu’ils songeassent à se servir de lui, et, les conquêtes de Ramsès en Asie, ainsi que son mariage exotique, le désignaient nécessairement pour être le héros d’une aventure dont une Syrienne était l’héroïne. Voilà pour le nom du roi : celui du dieu guérisseur était avant tout affaire de mode ou de piété individuelle. Khonsou étant la mode au temps que le conteur écrivait, c’est à sa statue qu’il confia l’honneur d’opérer la guérison miraculeuse. Les prêtres se bornèrent à recueillir ce roman si favorable à leur dieu ; ils lui donnèrent les allures d’un acte réel, et ils l’affichèrent dans le temple[61]. On conçoit que les égyptologues aient pris au sérieux les faits consignés dans une pièce qui s’offrait à eux avec toutes les apparences. de l’authenticité : ils ont été victimes d’une fraude pieuse, comme nos archivistes lorsqu’ils se trouvent en face des chartes fausses d’une abbaye. On conçoit moins qu’ils se soient laissé tromper aux romans d’Apôpi ou de Thoutîyi. Dans le premier, qui est fort mutilé, le roi Pasteur Apôpi dépêche message sur message au thébain Saqnounrîya et le somme de chasser les hippopotames du lac de Thèbes qui l’empêchent de dormir. On ne se douterait guère que cette exigence bizarre sert de prétexte à une propagande religieuse : c’est pourtant la vérité. Si le prince de Thèbes refuse d’obéir, on l’obligera à renoncer au culte de Râ pour adopter celui de Soutekhou[62]. Aussi bien la querelle d’Apôpi et de Saqnounrîya semble n’être que la variante locale d’un thème populaire dans l’Orient entier. Les rois d’alors s’envoyaient les uns aux autres des problèmes à résoudre sur toutes sortes de matières, à condition de se payer une espèce de tribut ou d’amende, selon qu’ils répondraient bien ou mal aux questions proposées. C’est ainsi qu’Hiram de Tyr débrouillait par l’entremise d’un certain Abdémon les énigmes que Salomon lui intentait[63]. Sans examiner ici les fictions diverses qu’on a établies sur cette donnée, j’en citerai une qui nous rend intelligible ce qui subsiste du récit égyptien. Le Pharaon Nectanébo expédie un ambassadeur à Lycérus, roi de Babylone, et à son ministre Ésope : « J’ay des cavales en Égypte qui conçoivent au bannissement des chevaux qui sont devers Babylone : qu’avez-vous à répondre là-dessus ? » Le Phrygien remit sa réponse au lendemain ; et, retourné qu’il fut au logis, il commanda à des enfants de prendre un chat et de le mener foüettant par les rües. Les Égyptiens, qui adorent cet animal, se trouvèrent extrêmement scandalisez du traitement que Ion luy faisoit. Ils l’arrachèrent des mains des enfans, et allèrent se plaindre au Roy. On fit venir en sa présence le Phrygien. « Ne savez-vous pas, lui dit le Roy, que cet animal est un de nos dieux ? Pourquoy donc le faites-vous traiter de la sorte ? » — « C’est pour l’offense qu’il a commise envers Lycerus, reprit Ésope ; car la nuit dernière il luy a étranglé un coq extrêmement courageux et qui chantoit à toutes les heures. » — « Vous estes un menteur, reprit le Roy ; comment seroit-il possible que ce chat eust fait, en si peu de temps, un si long voyage ? » — « Et comment est-il possible, reprit Ésope, que vos jumens entendent de si loin nos chevaux hannir et conçoivent pour les entendre ? »[64] Un défi porté par le roi du, pays des Nègres au Pharaon Ousimarès noue la crise du second roman de Satni, mais là du moins il s’agit d’une lettre cachetée dont on doit deviner le contenu, non pas d’animaux prodigieux que les deux rivaux posséderaient. Dans la Querelle, les hippopotames du lac de Thèbes, que le roi du Sud devra chasser pour que le roi du Nord dorme en paix, sont cousins des chevaux dont le hennissement porte jusqu’à Babylone, ou du chat qui accomplit en une seule nuit le voyage d’Assyrie, aller et retour. Je ne doute pas qu’après avoir reçu le second message d’Apôpi, Sagnôunriya ne trouvât, dans son conseil, un sage aussi perspicace qu’Ésope le phrygien, et dont la prudence le tirait sain et sauf de l’épreuve. Le roman allait-il plus loin, et décrivait-il la guerre éclatée entre les princes du Nord et du Sud, puis l’Égypte délivrée du joug des Pasteurs ? Le manuscrit ne nous mène pas assez avant pour que nous devinions le dénouement auquel l’auteur s’était arrêté. Bien que le roman de Thoutîyi soit incomplet du début, l’intelligence du récit ne souffre pas trop de cette mutilation. Lé sire de Joppé, s’étant révolté contre Thoutmôsis III, Thoutîyi l’attire au camp égyptien sous prétexte de lui montrer la grande canne de Pharaon et il le tue. Mais ce n’est pas tout de s’être débarrassé de l’homme, si la ville tient bon. Il empote donc cinq cents soldats dans des cruches énormes, il les transporte jusque sous les murs, et là, il contraint l’écuyer du chef à déclarer que les Égyptiens ont été battus et qu’on ramène leur général prisonnier. On le croit, on ouvre les portes, les soldats sortent de leurs cruches et enlèvent la place. Avons-nous ici le récit d’un épisode réel des guerres égyptiennes ? Joppé a été l’un des premiers points de la Syrie occupés par les Égyptiens : Thoutmôsis Ier l’avait soumise, et elle figure sur la liste des conquêtes de Thoutmôsis III. Sa condition sous ses maîtres nouveaux n’avait rien de particulièrement fâcheux : elle payait tribut, mais elle conservait ses lois propres et son chef héréditaire. Le Vaincu de Jôpou, car Vaincu est le titre des princes syriens dans le langage de la chancellerie égyptienne, dut agir souvent comme le Vaincu de Tounipou, le Vaincu de Kodshou et tant d’autres, qui se révoltaient sans cesse et qui attiraient sur leurs peuples la colère de Pharaon. Le fait d’un sire de Joppé en lutte avec son suzerain n’a rien d’invraisemblable en soi, quand même il s’agirait d’un Pharaon aussi puissant qu’était Thoutmôsis Ill et aussi dur à la répression. L’officier Thoutîyi n’est pas non plus un personnage entièrement fictif. On connaît un Thoutîyi qui vivait, lui aussi, sous Thoutmôsis et qui avait exercé de grands commandements en Syrie et en Phénicie. Il s’intitulait prince héréditaire, délégué du roi en toute région étrangère des pays situés dans la Méditerranée, scribe royal, général d’armée, gouverneur des contrées du Nord[65]. Rien n’empêche que dans une de ses campagnes il ait eu à combattre le seigneur de Joppé. Les principaux acteurs peuvent donc avoir appartenu à l’histoire. Les actions qu’on leur prête ont-elles la couleur historique, ou sont-elles du domaine de la fantaisie ? Thoutîyi s’insinue comme transfuge chez le chef ennemi et il l’assassine. Il se déguise en prisonnier de guerre pour pénétrer dans la place. Il introduit avec lui des soldats habillés en esclaves et qui portent d’autres soldats cachés dans des jarres en terre. On trouve chez la plupart des écrivains classiques des exemples qui justifient suffisamment l’emploi des deux premières ruses. J’accorde volontiers qu’elles doivent avoir été employées par les généraux de l’Égypte, aussi bien que par ceux de la Grèce et de Rome. La troisième renferme un élément non seulement vraisemblable, mais réel : l’introduction dans une forteresse de soldats habillés en esclaves ou en prisonniers de guerre. Polyen raconte comment Néarque le Crétois prit Telmissos, en feignant de confier au gouverneur Antipatridas une troupe de femmes esclaves. Des enfants enchaînés accompagnaient lés femmes avec l’appareil des musiciens, et une escorte d’hommes sans armes surveillait le tout. Introduits dans la citadelle, ils ouvrirent chacun l’étui de leur flûte, qui renfermait un poignard au lieu de l’instrument, puis ils fondirent sur la garnison et ils s’emparèrent de la ville[66]. Si Thoutîyi s’était borné à charger ses gens de vases ordinaires ou de boîtes renfermant des lames bien affilées, je n’aurais rien à objecter contre l’authenticité de son aventure. Mais il les écrasa sous le poids de vastes tonneaux en terre qui contenaient chacun un soldat armé ou des chaînes au lieu d’armes. Si l’on veut trouver l’équivalent de ce stratagème, il faut descendre jusqu’aux récits véridiques des Aille et une Nuits. Le chef des quarante voleurs, pour mener incognito sa troupe chez Ali Baba, n’imagine rien de mieux à faire que de la cacher en jarre, un homme par jarre, et de se représenter comme un marchand d’huile en tournée d’affaires qui désire mettre sa marchandise en sûreté. Encore le conteur arabe a-t-il plus souci de la vraisemblance que l’égyptien, et fait-il voyager les pots de la bande à dos de bêtes, non à dos d’hommes. Le cadre du récit est historique ; le fond du récit est de pure imagination. Si les égyptologues modernes ont pu s’y méprendre, à plus forte raison les anciens se sont-ils laissé duper à des inventions analogues. Les interprètes et les prêtres de basse classe, qui guidaient les étrangers, connaissaient assez bien ce qu’était l’édifice qu’ils montraient, qui l’avait fondé, qui restauré ou agrandi et quelle partie portait le cartouche de quel souverain ; mais, dès qu’on les poussait sur le détail, ils restaient court et ils ne savaient plus que débiter des fables. Les Grecs eurent affaire avec eux, et il n’y a qu’à lire Hérodote en son second livre pour voir comment ils furent renseignés sur le passé de l’Égypte. Quelques-uns des on-dit qu’il a recueillis renferment encore un ensemble de faits plus ou moins altérés, l’histoire de la XXVIe dynastie par exemple, ou, pour les temps anciens, celle de Sésostris. La plupart des récits antérieurs à l’avènement de Psammétique Ier sont chez lui de véritables romans où la vérité n’a point de part. Le canevas de Rhampsinite et du fin larron existe ailleurs qu’en Égypte[67]. La vie légendaire des rois constructeurs de pyramides n’a rien de commun avec leur vie réelle. Le chapitre consacré à Phéron renferme l’abrégé d’une satire humoristique à l’adresse des femmes[68]. La rencontre de Protée avec Hélène et Ménélas est l’adaptation égyptienne d’une tradition grecque[69]. On pouvait se demander jadis si les guides avaient tout tiré de leur propre fonds : la découverte des romans égyptiens a prouvé que, là comme ailleurs, l’imagination leur manqua. Ils se sont contentés de répéter en bons perroquets les fables qui avaient cours dans le peuple, et la tâche leur était d’autant plus facile que la plupart des héros y étaient affublés de noms ou de titres authentiques. Aussi les dynasties des historiens qui s’étaient informés auprès d’eux sont-elles un mélange de noms véritables, Ménès, Sabacon, Chéops, Chéphrên, Mykérinos, ou déformés par l’addition d’un élément parasite pour les différencier de leurs homonymes , Rhampsinitos à côté de Rhamsès, Psamménitos à côté de Psammis et de Psammétique ; de prénoms altérés par la prononciation, Osimandouas pour Ouasimarîya[70] ; de sobriquets populaires, Sésousrîya, Sésôstris-Sésoôsis ; de titres, Phérô, Prouiti, dont on a fait des noms propres, enfin de noms, forgés de toutes pièces comme Asychis, Ouchoreus, Anysis. La passion du roman historique ne disparut pas avec les dynasties nationales. Déjà, sous les Ptolémées, Nectanébo, le dernier roi de race indigène, était devenu le centre d’un cycle important. On l’avait métamorphosé en un magicien habile, un constructeur émérite de talismans : on l’imposa pour père à Alexandre le Macédonien. Poussons même au delà de l’époque romaine : la littérature byzantine et la littérature copte qui dérive de celle-ci avaient aussi leurs Gestes de Cambyse et d’Alexandre, cette dernière calquée sur l’écrit du Pseudo-Callisthènes[71], et il n’y a pas besoin de scruter attentivement les chroniques arabes pour extraire d’elles une histoire imaginaire de l’Égypte empruntée aux livres coptes[72]. Que l’écrivain empêtré dans ce fatras soit Latin, Grec ou Arabe, on se figure aisément ce que devient la chronologie parmi ces manifestations de la fantaisie populaire. Hérodote, et à son exemple presque tous les écrivains anciens et modernes jusqu’à nos jours, ont placé Moiris, Sésostris, Rhampsinite, avant les rois constructeurs de pyramides. Les noms de Sésostris et de Rhampsinite sont un souvenir de la XIXe et de la XXe dynastie ; celui des rois constructeurs de pyramides, Chéops, Chéphrên, Mykérinos, nous reporte à la quatrième. C’est comme si un historien de la France plaçait Charlemagne après les Bonaparte, mais la façon cavalière dont les romanciers égyptiens traitent la succession des règnes nous enseigne comment il se fait qu’Hérodote ait commis pareille erreur. L’un des contes dont les papyrus nous ont conservé l’original, celui de Satni, met en scène deux rois et un prince royal. Les rois s’appellent Ouasimârîya et Mînibphtah, le prince royal Satni Khâmoîs. Ouasimârîya est un des prénoms de Ramsès Il, celui qu’il avait dans sa jeunesse alors qu’il était encore associé à son père. Mînibphtah est une altération, peut-être volontaire, du nom de Mînéphtah, fils et successeur de Ramsès II. Khâmoîs, également fils de Ramsès II, administra l’empire pendant plus de vingt ans, pour le compte de son père vieilli. S’il y avait dans l’ancienne Égypte un souverain dont la mémoire fût restée populaire, c’était à coup sûr Ramsès Il. La tradition avait inscrit à son compte ce que la lignée entière des Pharaons avait accompli de grand pendant de longs siècles. On devait donc espérer que le romancier respecterait la vérité au moins en ce qui concernait cette idole et qu’il ne toucherait pas à la généalogie :
Il n’en a pas tenu compte. Khâmoîs demeure, comme dans l’histoire, le fils d’Ouasimârîya, mais Mînibphtah, l’autre fils, a été déplacé. II est représenté comme étant tellement antérieur à Ouasimârîya, qu’un vieillard, consulté par Satni-Khâmoîs sur certains événements arrivés du temps de Mînibphtah, en est réduit à invoquer le témoignage d’un aïeul très éloigné. Le père du père de mon père a dit au père de mon père, disant : « Le père du père de mon père a dit au père de mon père : « Les tombeaux d’Ahouri et de Maîhêt sont sous l’angle septentrional de la maison du prêtre... » Voilà six générations au moins entre le Mînibphtah et l’Ouasimâriya du roman :
Le fils, Mînibphtah, est passé ancêtre et prédécesseur lointain de son propre père Ouasimârîya, et pour achever la confusion, le frère de lait de Satni porte un nom de l’âge persan, Éiernharérôou, Inaros[73]. Ailleurs, Satni, devenu le contemporain de l’Assyrien Sennachérib[74], est représenté comme vivant et agissant six cents ans après sa mort. Dans un troisième conte[75], il est relégué avec son père Ramsès Il, quinze cents ans après un Pharaon qui paraît être un doublet de Thoutmôsis III. Supposez un voyageur aussi disposé à enregistrer les miracles de Satni qu’Hérodote l’était à croire aux richesses de Rhampsinite. Pensez-vous pas qu’il eût commis, à propos de Mînibphtah et de Ramsès II, la même erreur qu’Hérodote au sujet de Rhampsinite et de Chéops ? Il aurait interverti l’ordre des règnes et placé le quatrième roi de la XIXe dynastie longtemps avant la troisième. Le drogman qui montrait le temple de Phtah et les pyramides de Gizéh aux visiteurs avait hérité vraisemblablement d’un boniment où il exposait, sans doute après beaucoup d’autres, comme quoi, à un Ramsès dit Rhampsinite le plus opulent des rois, avait succédé Chéops le plus impie des hommes. 11 le débita devant Hérodote et le bon Hérodote l’inséra tel quel dans son livre. Comme Chéops, Chéphrén et Mykérinos forment un groupe bien circonscrit, que d’ailleurs, leurs pyramides s’élevant au même endroit, les guides n’avaient aucune raison de rompre l’ordre de succession à leur égard, Chéops une fois transposé, il devenait nécessaire de déménager avec lui Chéphrén, Mykérinos et le prince qu’on nommait Asychis, le riche[76]. Aujourd’hui que nous contrôlons le témoignage du voyageur grec par celui des monuments, peu nous importe qu’on l’ait trompé. Il n’écrivait pas une histoire d’Égypte. Même bien instruit, il n’aurait pas attribué à celui de ses discours qui traitait de ce pays plus de développement qu’il ne lui en a donné. Toutes les dynasties auraient tenu en quelques pages, et il ne nous eût rien appris que les documents originaux ne nous enseignent aujourd’hui. En revanche, nous y aurions perdu la plupart de ces récits étranges et souvent bouffons qu’il nous a contés si joliment sur la foi de ses guides. Phéron ne nous serait pas familier, ni Protée, ni Séthôn, ni Rhampsinite : je crois que ce serait grand dommage. Les hiéroglyphes nous disent, ou ils nous diront un jour, ce que firent les Chéops, les Ramsès, les Thoutmôsis du monde réel. Hérodote nous apprend ce qu’on disait d’eux dans les rues de Memphis. La partie de son second livre que leurs aventures remplissent est pour nous mieux qu’un cours d’histoire : c’est un chapitre d’histoire littéraire, et les romans qu’on y lit sont égyptiens au même titre que les romans conservés par les papyrus. Sans doute, il vaudrait mieux les posséder dans la langue d’origine, mais l’habit grec qu’ils ont endossé n’est pas assez lourd pour les déguiser : même modifiés dans le détail, ils gardent encore des traits de leur physionomie primitive ce qu’il en faut pour figurer, sans trop de disparate, à côté du Conte des Deux Frères ou des Mémoires de Sinouhît. IIIVoilà pour les noms : la mise en scène est purement égyptienne, et si exacte qu’on pourrait tirer des seuls romans un tableau complet des mœurs et de la société. Pharaon s’y révèle moins divin qu’on ne serait disposé à le croire, si on se contentait de le juger sur la mine hautaine que ses maîtres imagiers lui prêtent dans les scènes religieuses ou triomphales. Le romancier ne répugne pas à l’imaginer parfois ridicule et à le dépeindre dans des situations qui contrastent avec l’appareil plus qu’humain de sa grandeur. Il est trompé par sa femme comme un simple mortel[77], volé puis dupé à tout coup par les voleurs[78], escamoté par un magicien au milieu de son palais et rossé d’importance devant un roitelet nègre[79]. C’était la revanche du menu peuple, dépouillé et battu, sur le tyran qui l’écrasait. Le fellah qui venait de passer par les verges pour avoir refusé l’impôt, se consolait de sa poche vidée et de ses chairs sanglantes en s’entendant conter comment Manakliphrè Siamonou avait endossé trois cents coups de bâton en une seule nuit, et comment il avait exhibé piteusement ses meurtrissures aux courtisans. Ce n’était là que des accidents passagers, et le plus souvent sa toute-puissance demeurait intacte dans la fiction comme dans l’histoire ; l’étiquette se dressait toujours très haute entre ses sujets et lui. Mais le cérémonial une fois satisfait ; si l’homme lui plaît, comme c’est le cas pour Sinouhît, il daigne s’humaniser et le dieu bon se montre bon prince[80] : même il est jovial et il plaisante sur l’apparence rustique du héros, plaisanterie de roi qui provoque la gaieté de l’assistance mais dont le sel a dû s’évaporer à travers les âges, car nous n’en goûtons plus la saveur. Il. va plus loin encore avec ses intimes, et il s’enivre devant eux, malgré eux, sans vergogne[81]. Il est du reste en proie à cet ennui prodigieux que les despotes orientaux ont éprouvé de tout temps, et que les plaisirs ordinaires ne suffisent plus à chasser. Comme Haroun-ar-raschid des Mille et une Nuits, Khoufouî et Sanafrouî essaient de se distraire en écoutant des histoires merveilleuses, ou en assistant à des séances de magie, mais ils n’y réussissent que médiocrement. Quelquefois, pourtant, un ministre mieux avisé que les autres leur invente un divertissement dont la nouveauté les aide à passer un ou deux jours presque dans la joie. Sanafrouî devait être aussi blasé que Haroun sur les délices du harem : son sorcier découvre pourtant le moyen de réveiller son : intérêt en faisant ramer devant lui un équipage de jeunes filles à peine voilées d’un réseau à. larges mailles[82]. Les civilisations ont beau disparaître et tes religions changer, l’esprit de l’Orient demeure immuable sous tous les masques, et Méhémet-Ali, dans notre siècle, n’a pas trouvé mieux que Sanafrouî dans le sien. On visite encore à Choubrah les bains qu’il avait construits sur un plan particulier. C’est, dit Gérard de Nerval, un bassin de marbre blanc, entouré de colonnes d’un goût byzantin, avec une fontaine dans le milieu, dont l’eau s’échappe par des gueules de crocodiles. Toute l’enceinte est éclairée au gaz, et, dans les nuits d’été, le pacha se fait promener sur le bassin dans une cange dorée dont les femmes de son harem agitent les rames. Ces belles dames s’y baignent aussi sous les yeux de leur maître, mais avec des peignoirs en crêpe de soie, le Coran ne permettant pas les nudités. Sans doute, mais le crêpe de Méhémet-Ali n’était guère moins transparent que le réseau de Sanafrouî. Celui-là, c’est le Pharaon des grandes dynasties, dont l’autorité s’exerçait indiscutée sur l’Égypte entière, et pour qui les barons n’étaient que des sujets d’un ordre un peu plus relevé. Mais il arrivait souvent qu’après des siècles de pouvoir absolu, la royauté s’affaiblît et ne tînt plus la féodalité en respect. Celle-ci reprenait le dessus avec des caractères nouveaux selon les époques, et ses chefs les plus hardis se rendaient indépendants ou peu s’en faut, chacun dans son fief héréditaire : Pharaon n’était plus alors qu’un seigneur à peine plus riche ou plus fort que les autres, auquel on obéissait, par tradition et avec lequel on liait partie contre les rivaux, afin d’empêcher que ceux-ci ne finissent par usurper le trône, et qu’ils ne remplaçassent une souveraineté presque nominale par une domination effective. Tel est Pétoubastis dans l’Emprise de la cuirasse et du trône. Il n’a plus rien du maître impérieux de qui d’autres romans nous retracent le portrait, Chéops, Thoutmôsis, Ramsès Il. Il est encore, par droit divin, le possesseur prétendu des deux Égyptes : seul il coiffe le double diadème, seul il est le fils de Râ, seul il a le droit d’envelopper ses noms des cartouches, et c’est d’après les années de son règne que la chancellerie date les événements qui s’accomplissent de son vivant. Toutefois c’est avant tout un pacifique, un dévot, soumis à toutes les prescriptions de la religion, le prototype de ce roi sans libre arbitre et sans esprit d’initiative dont les Grecs de l’âge macédonien nous représentèrent l’image comme celle du prince idéal[83]. La puissance ne réside pas entre ses mains. Il ne lui reste plus en propre qu’une portion, la moindre, de l’ancien domaine pharaonique, le nome de Tanis, celui de Memphis, peut-être deux ou trois de ceux du voisinage ; des familles, apparentées à la sienne pour la plupart, se sont approprié le gros du territoire et le serrent étroitement, Pakrour à l’Est dans l’Ouady Toumilàt, le grand Seigneur d’Amon à Diospolis du Nord, à Mendès et à Busiris, Pétékhonsou et Pémou au sud, l’un dans Athribis, l’autre dans Héliopolis, sans parler des sires de Sébennytos, de Sais, de Méïtoum, de la lointaine Éléphantine, et d’une quinzaine d’autres plus obscurs. Ces gens-là lui doivent en principe l’hommage, le tribut, l’obéissance passive, le service de cour, la milice, mais ils ne s’astreignent pas toujours de bonne grâce à leurs obligations et la paix règne rarement autour d’eux. Ils entretiennent chacun leur armée et leur flotte, où les mercenaires libyens, syriens, éthiopiens, asianiques même, abondent à l’occasion. Ils ont leurs vassaux, leur cour, leurs finances, leurs dieux par lesquels ils jurent, leurs collèges de prêtres ou de magiciens ; ils s’allient, ils se brouillent, ils se battent, ils se pourchassent d’une rive du Nil à l’autre rive, ils se coalisent contre le Pharaon pour lui arracher les lambeaux de son domaine, puis, quand l’un d’eux sort du rang et qu’il acquiert trop d’ascendant, ils s’unissent momentanément contre lui ou ils appellent les étrangers éthiopiens pour l’obliger à rentrer dans l’ordre. C’est déjà presque notre féodalité, et les mêmes conditions ont suscité chez eux des coutumes analogues à celles qui prévalurent chez nous pendant la durée du moyen âge. Voyez en effet ce qui se passe dans cette Emprise de la cuirasse dont Krall a reconstitué la fable si ingénieusement. Le sire d’Héliopolis, un Inarôs, possédait une cuirasse que ses rivaux lui enviaient. Il meurt, et pendant les jours de deuil qui précèdent les funérailles, le Grand Seigneur de Diospolis la dérobe on ne sait comment : le fils de cet Inarôs, Pémou le petit, la réclame et, comme on la lui refuse, il déclare très haut qu’il la recouvrera par force. Ce serait la guerre allumée, clan contre clan, ville contre ville, nome contre nome, dieu contre dieu, si Pétoubastis n’intervenait pas. Seul, ses vassaux ne l’écouteraient peut-être guère, mais le grand chef de l’Est, Pakrourou, se joint à lui, et tous deux ensemble ils imposent leur volonté à la masse des seigneurs moindres[84]. Ils décident qu’au lieu de s’aborder en rase campagne sans trêve ni merci, les adversaires et leurs partisans se battront en champ clos, selon les lois assez compliquées, ce semble, qui régissaient ce genre de rencontres. Ils font disposer des estrades sur lesquelles ils siégeront comme juges du camp, ils assignent à chacun des champions un poste particulier, puis Pakrour les appareille l’un contre l’autre, et, s’il en survient un nouveau lorsque l’appareillage est terminé, il le tient en réserve pour le cas où quelque événement imprévu se produirait[85]. Tout est réglé comme dans un tournoi, et nous devons présumer que les armes seront courtoises, mais la traîtrise du seigneur de Diospolis bouleverse des mesures prises : il attaque Pémou avant l’arrivée de ses alliés, et bien que l’intervention de Pakrourou l’empêche de pousser trop loin son avantage, sa félonie lause une impression fâcheuse sur l’esprit de ses adversaires A mesure que l’engagement se prolonge, les esprits s’échauffent et les jouteurs oublient la modération que le chef du jeu leur avait commandée : ils se provoquent, ils s’insultent, ils s’attaquent sans ménagement, et le vainqueur, oubliant qu’il s’agit d’une simple passe d’armes, s’apprête à tuer le vaincu comme il ferait dans une bataille. Aussitôt le roi accourt ou Pakrourou, et c’est à peine si leurs injonctions ou leurs prières préviennent la catastrophe. Lorsqu’après plusieurs heures de mêlée ils proclament la trêve, il semble bien que les deux partis n’ont pas souffert beaucoup, mais qu’ils en sont quittes pour quelques blessures. On jurerait une de ces rencontres de notre XIe siècle entre Français et Anglo-Normands où, après toute une journée de horions échangés, les deux armées se quittaient pleines d’admiration pour leur prouesse et laissant sur le carreau trois chevaliers étouffés par leur armure. Ainsi font encore aujourd’hui les Bédouins de l’Arabie, et leurs coutumes nous aident à comprendre pourquoi Pétoubastis et Pakrourou s’évertuent si fort à éviter qu’il y ait mort de prince : un chef tué, c’était l’obligation pour son clan de le venger et la vendetta sévissant pendant des années sans nombre. Pétoubastis ne veut pas que la guerre désole l’Égypte en son temps, et si amoindri que soit son prestige, comme sa volonté est d’accord avec l’intérêt commun, il la fait prévaloir sur ce point. Les Gestes des Pharaons ne se présentaient pas toujours de la même manière, selon qu’elles étaient composées par des Memphites ou par des Thébains. Les provinces du Nord de l’Egypte et celles du Sud différaient grandement, non seulement de langage, mais de tendances politiques et de caractère. Elles se méfiaient souvent l’une de l’autre, et les méfiances dégénéraient aisément en haines puis en guerres civiles. Tels rois, qui étaient populaires chez l’une, étaient peu aimés de l’autre ou n’y étaient pas connus sous le même nom. Ramsès II avait, au temple de Phtah Memphite, des monuments où son sobriquet de Sésousi ou Sésousrîya était mentionné : la légende de Sésôstris se forma autour d’eux[86]. A Thèbes, son prénom d’Ouasimarîya prédominait : il y devint l’Ousimarês des romans de Satni, et l’Osimandouas dont les écrivains copiés par Diodore de Sicile célébrèrent les victoires et décrivirent le palais. La découverte d’un roman nouveau par Spiegelberg nous apprend que Pétoubâstis eut le même sort. Une partie des personnages qui l’entouraient dans celui de Krall y reparaissent avec lui, mais l’objet de la querelle y est différent. C’est un trône ou une chaire, et je soupçonne qu’il s’agit ici d’une forme de la divinité fréquente à l’époque gréco-romaine dans le nome thébain, un emblème de nature indéterminé, peut-être l’image d’une pierre sacrée posée sur un fauteuil d’apparat : Amon se manifesta ainsi probablement à son fils Alexandre de Macédoine, quand celui-ci vint le consulter dans son oasis[87]. L’héritier légitime était, comme dans l’Emprise de la Cuirasse, l’enfant du premier propriétaire, un prophète de l’Horus de Boutô, mais il dévolut au fils du roi Ankhhorou, et le refus de le rendre fut l’origine du conflit. On assistera ailleurs aux péripéties des combats que les champions des deux partis se livrèrent à Thèbes en présence du souverain : ce qu’il convient de signaler dès maintenant, c’est que le prophète d’Horus est aidé dans ses revendications par treize bouviers vigoureux, dont l’énergie lui assure d’abord la victoire sur l’armée de l’Égypte. Les clans moitié de pêcheurs, moitié de pasteurs, qui habitaient les plaines marécageuses du Delta septentrional, les Boucolies, ne supportaient qui contrecœur le joug des autorités constituées régulièrement, grecques ou romaines : ils saisissaient les moindres occasions de leur déclarer la guerre ouverte, et on ne les réduisait, d’ordinaire, qu’au prix d’efforts longs et coûteux. La plus sanglante de leurs révoltes fut celle de l’an 172 après J.-C.[88], mais il y en avait eu sous les Ptolémées dont le souvenir se perpétua longtemps dans la vallée du Nil : si un romancier grec du Bas-Empire, Héliodore, se plaisait encore à décrire leurs mœurs pillardes[89], on ne saurait s’étonner qu’un conteur indigène les ait choisis comme des types de bravoure brutale. Par contraste avec ces Gestes toutes remplies du mouvement et du bruit des armes, les premières pages du Conte des deux Frères présentent une peinture excellente de ce qu’étaient la vie et les occupations habituelles du fellah ordinaire. Anoupou, l’aîné, a sa maison et sa femme : Baîti, le cadet, ne possède rien, et il habite chez son frère, mais non pas comme un parent chez son parent ou comme un hôte chez son hôte. Il soigne les bestiaux, il les conduit aux champs et il les ramène à l’étable, il dirige la charrue, il fauche, il bottelle, il bat le blé, il rentre les foins. Chaque soir, avant de se coucher, il enfourne le pain de la famille et il se lève de grand matin pour le retirer cuit. Pendant la saison du labourage, c’est lui qui court à la ferme chercher les semailles et qui rapporte sur son dos la charge de plusieurs hommes. Il file le lin ou la laine en menant ses animaux aux pâturages de bonnes herbes, et quand l’inondation retient bâtés et gens au logis, il s’accroupit devant le métier et il devient tisserand. Bref, c’est un valet, un valet uni au maître par les liens du sang, mais un valet. Il ne faut pas en conclure d’une manière générale l’existence du droit d’aînesse, ni que, partout en Égypte, l’usage à défaut de la loi plaçât le plus jeune dans la main de l’aîné. Tous les enfants d’un même père héritaient également de son bien quel que fût leur ordre de géniture. La loi était formelle à cet égard, et le bénéfice s’en étendait non seulement aux légitimes mais à ceux qui naissaient hors le mariage : les fils ou les filles de la concubine héritaient au même titre et dans la même proportion que les fils ou les filles de la femme épousée régulièrement[90]. Anoupou et Baîti, issus de mères différentes, auraient été égaux devant la loi et devant la coutume : à plus forte raison l’étaient-ils, puisque le conteur les déclare issus d’un seul père et d’une seule mère. L’inégalité apparente de leur condition n’était donc pas commandée par le droit, et il faut lui chercher une cause ailleurs que dans la législation. Supposez qu’après la mort de leurs parents communs, Baîti, au lieu de rester chez Anoupou, eût pris la moitié qui lui revenait de l’héritage et fût allé courir la fortune à travers le monde, à quels ennuis et à quelles avanies ne se fût-il pas exposé ? Le fellah dont l’histoire est contée au Papyrus de Berlin n° II, et qui commerçait entre l’Égypte et le Pays du Sel[91], est volé par l’homme lige d’un grand seigneur sur les terres duquel il passait[92]. Il porte plainte, l’enquête prouve la justesse de sa réclamation, vous imaginez qu’on va lui rendre aussitôt son dû ? Point. Son voleur appartient à une personne de qualité, a des amis, des parents, un maître : le paysan, lui, n’est qu’un homme sans maître. L’auteur a soin de nous l’apprendre, et n’avoir point de maître est un tort impardonnable dans la féodale Égypte ; contre les seigneurs qui se partageaient le pays, contre les employés qui l’exploitaient pour le compte de Pharaon, l’individu isolé était sans défense. Le pauvre diable crie, supplie, présente à mainte reprise sa requête piteuse. Comme, après tout, il est dans son droit, Pharaon commande qu’on ait soin de sa femme et qu’on ne le laisse pas mourir de faim ; quant à juger l’affaire et à délivrer sentence, on verra plus tard s’il y a lieu. Nous savons maintenant qu’il finit par obtenir justice, après s’être répandu en belles harangues pour le plus grand plaisir de Pharaon ; mais les délais et les angoisses qu’il subit n’expliquent-ils pas suffisamment pourquoi Baîti est resté chez son frère ? L’aîné, devenu maître par provision, était pour le cadet un protecteur qui le gardait du mal, lui et son bien, jusqu’au jour où un riche mariage, un caprice du souverain, une élévation soudaine, un héritage imprévu, ou simplement l’admission parmi les scribes, lui assurerait un protecteur plus puissant et, par aventure, de protégé l’investirait protecteur à son tour. Donc, à discuter chaque conte détail par détail, on verrait que tout le côté matériel de la civilisation qu’ils décrivent est purement égyptien. On commenterait aisément les scènes du début au Conte dés deux frères avec les peintures des hypogées thébains : telle des expressions que l’auteur y emploie se rencontre presque mot pour mot dans les légendes explicatives des tableaux[93]. Il n’y a pas jusqu’aux actes les plus intimes de la vie privée, les accouchements par exemple, dont on ne puisse illustrer le mécanisme au moyen d’images prises dans les temples. Que ce soit à Louxor[94], à Déir-el-Baharî[95], à Erment[96], qu’il s’agisse de Noutemoua, d’Ahmasi ou de Cléopâtre, vous avez sous les yeux de quoi reconstituer exactement ce qui se passa lorsque Rouditdidît mit au monde les trois fils de Râ[97]. La pauvrette est accroupie sur sa chaise ou sur son lit de misère, tandis que l’une des sages-femmes l’étreint par derrière et qu’une autre, accroupie devant elle, reçoit l’enfant qui s’échappe de son sein. Elle le transmet aux nourrices qui le lavent, le bercent dans leurs bras, le caressent, l’allaitent. L’examen des monuments prouverait qu’il en est de même avec ceux des contes dont nous possédons l’original hiératique, et je l’ai constaté aussi pour la plupart de ceux dont nous ne connaissons plus que la version en une langue étrangère : c’est le cas de Rhampsinite. Je n’ai pas l’intention d’en reprendre la teneur mot par mot, afin de montrer combien il est égyptien dans le fond, malgré le vêtement grec qu’Hérodote lui a prêté. Je me bornerai à discuter deux des points qu’on y a relevés comme indiquant une origine étrangère. L’architecte chargé de construire un trésor pour Pharaon tailla et assit une pierre si proprement, que deux hommes, voire un seul, la pouvaient tirer de sa place[98]. La pierre mobile n’est pas, a-t-on dit, une invention égyptienne : en Égypte, on bâtissait les édifices publics en très gros appareil, et toute l’habileté du monde n’aurait pas permis à un architecte de disposer un bloc à la façon qu’Hérodote décrit. Strabon savait déjà pourtant qu’on pénétrait dans la grande pyramide par un couloir dont une pierre mobile dissimulait l’entrée[99], et, en dehors de la pyramide, nous avons constaté qu’il en était de même pour les cachettes dont les temples étaient remplis. A Dendérah, par exemple, il y a douze cryptes perdues dans les fondations ou dans l’épaisseur des parois. Elles communiquent avec le temple par des passages étroits qui débouchent dans les salles sous la forme de trous aujourd’hui ouverts et libres. Mais ils étaient autrefois fermés par une pierre ad hoc, dont la face, tournée vers l’extérieur, était sculptée comme le reste de la muraille[100]. Un passage du Conte de Khoufouî semble dire que la crypte où le dieu Thot cachait sa bibliothèque était close, à Héliopolis, par un bloc analogue à ceux de Mariette[101]. Les inscriptions enseignent d’ailleurs que la chambre secrète une fois établie, on prenait toutes les précautions pour qu’elle demeurât ignorée non seulement des visiteurs, mais du bas sacerdoce. Point ne la connaissent les profanes, la porte si on la cherche, personne ne la trouve, excepté les prophètes de la déesse[102]. Comme l’architecte de Rhampsinite et ses fils, ces prophètes de Dendérah savaient comment pénétrer dans un réduit encombré de métaux et d’objets précieux, et ils étaient seuls à le savoir. Une pierre levée, que rien ne signalait au vulgaire, ils apercevaient l’orifice d’un couloir : ils s’y engageaient en rampant et ils arrivaient après quelques instants au milieu du trésor. Le bloc remis sur son lit, l’œil le mieux exercé ne pouvait plus distinguer l’endroit précis où le passage débouchait[103]. Plus loin, celui des fils de l’architecte qui vient d’échapper à la mort enivre les gardes chargés de veiller sur le cadavre de son frère, et il leur rase la barbe de la joue droite[104]. Wilkinson observa, le premier je crois, qu’en Égypte les soldats sont figurés imberbes et que toutes les classes de la société avaient l’habitude de se raser : les seuls personnages barbus auraient été des barbares[105]. Depuis lors, on n’a jamais manqué de répéter son assertion comme une preuve de l’origine étrangère du conte. Il en est d’elle comme de bien d’autres que son ouvrage renferme : elle résulte d’une étude trop hâtive des documents. Les Égyptiens de race pure pouvaient porter la barbe, et ils la portaient quand ils en avaient le caprice ; les bas-reliefs de toutes les époques le prouvent suffisamment. De plus, la police ne renfermait pas que des indigènes : elle se recrutait principalement chez une tribu d’origine libyenne, les Mazaiou, et puisque, de l’aveu de Wilkinson, les étrangers étaient exceptés de l’usage courant, pourquoi les policiers à qui Rhampsinite avait confié le cadavre n’auraient-ils pas eu du poil au menton ou sur les joues ? Des soldats qui composaient l’armée égyptienne, telle qu’elle était au temps des Saïtes et des Perses, telle en un mot qu’Hérodote a pu la connaître, les uns étaient des Libyens, les autres étaient des mercenaires sémitiques, Cariens ou Grecs, d’autres enfin faisaient partie des garnisons persanes : ils étaient tous barbus communément[106]. Il faut donc avouer que, pour les Égyptiens contemporains, il n’y avait rien que d’ordinaire à voir des gendarmes barbus, qu’ils fussent nés dans le pays ou qu’ils vinssent du dehors ; l’épisode de la barbe rasée n’est pas une preuve contre l’origine indigène du conte. Mais laissons de côté le détail matériel. Le côté moral de la civilisation n’est pas reproduit moins exactement dans nos récits. Sans doute, il faut éviter de prendre au pied de la lettre tout ce qu’ils semblent nous apprendre sur la vie privée des Égyptiens. Comme les modernes, les auteurs de ces temps-là s’attachaient à développer des sentiments ou des caractères qui n’étaient, après tout, qu’une exception sur la masse de la nation. S’il fallait juger les Égyptiennes par les portraits qu’ils ont tracés d’elles, on serait porté à concevoir de leur chasteté une opinion assez triste. La fille de Rhampsinite ouvre sa chambre et s’abandonne à qui la paie : c’est, si l’on veut, une victime de la raison d’État, mais une victime résignée[107]. Thouboni accueille Satni et se déclare prête à le recevoir dans son lit dès la première entrevue. Si elle parait incertaine au moment décisif et si elle retarde à plusieurs reprises l’heure de sa défaite, la pudeur n’entre pour rien dans son hésitation ; il s’agit de faire acheter au plus cher ce qu’elle a l’intention de vendre et de ne se livrer qu’après paiement du prix convenu. La vue de Baîti, jeune et vigoureux, allume un désir irrésistible au cœur de la femme d’Anoupou, et la femme d’Oubaouanir est aussi sensible que celle-là à l’attrait d’un beau gars. L’épouse divine de Baîti consent à trahir son mari en échange de quelques bijoux et à devenir la favorite du roi. Princesses, filles de la caste sacerdotale, bourgeoises, paysannes, toutes se valent en matière de vertu. Je ne vois d’honnêtes qu’Ahouri[108], Mahîtouaskhît[109] et une étrangère, la fille du chef de Naharinna ; encore l’emportement avec lequel cette dernière se jette dans les bras de l’homme que le hasard a fait son mari donne-t-il fort à réfléchir[110]. Dans l’écrit d’un moraliste de profession, la satire des mœurs féminines a peu de valeur pour l’histoire : c’est un lieu commun, dont le développement varie selon les époques ou selon les pays, mais dont le thème ne prouve rien contre une époque ou contre un pays déterminé. Que Ptahhotpou définisse la femme vicieuse un faisceau de toutes les méchancetés, un sac plein de toutes sortes de malices[111], ou qu’Ani, reprenant le même thème à trois mille ans d’intervalle, la décrive comme une eau profonde et dont nul ne connaît les détours[112], leur dire est sans importance : toutes les femmes de leur temps auraient été vertueuses qu’ils leur auraient inventé des vices pour en tirer des effets d’éloquence. Mais les conteurs ne faisaient pas métier de prêcher la pudeur. Ils n’avaient aucun parti pris de satire contre les femmes, et ils les peignaient telles qu’elles étaient pour les contemporains, telles peut-être qu’eux-mêmes les avaient trouvées à l’user. Je doute qu’ils eussent jamais rencontré, au cours de leurs bonnes fortunes, une princesse du harem de Pharaon ; mais Tboubouî se promenait chaque jour dans les rues de Memphis, les hiérodules ne réservaient pas leurs faveurs aux princes du sang, la compagne de Baîti n’était pas seule à aimer la parure, et plus d’un beau-frère sans scrupule savait où logeait la femme d’Anoupou. Les mœurs étaient faciles en Égypte. Mûre d’une maturité précoce, l’Égyptienne vivait dans un monde où les lois et les coutumes semblaient conspirer à développer ses ardeurs natives. Enfant, elle jouait nue avec ses frères nus ; femme, la mode lui mettait la gorge au vent et l’habillait d’étoffes transparentes qui la laissaient nue sous les regards des hommes. A la ville, les servantes qui l’entouraient d’ordinaire et qui se pressaient autour de son mari ou de ses hôtes se contentaient pour vêtement d’une étroite ceinture serrée sur la hanche ; à la campagne, les paysans de ses domaines se débarrassaient de leur pagne pour travailler. La religion et les cérémonies du culte attiraient son attention sur des formes obscènes de la divinité, et l’écriture elle-même étalait à ses regards des images impudiques. Lorsqu’on lui parlait d’amour, elle n’avait pas, comme la jeune fille moderne, la rêverie de l’amour idéal, mais l’image nette et précise de l’amour physique. Rien d’étonnant, après cela, si la vue d’un homme robuste émeut la femme d’Anoupou au point de lui faire perdre toute retenue. Il suffisait à peu près qu’une Égyptienne conçût l’idée de l’adultère pour qu’elle cherchât à le consommer sur le champ ; mais y avait-il en Égypte plus de femmes qu’ailleurs à concevoir l’idée de l’adultère ? Les guides contèrent à Hérodote, et Hérodote nous conte à son tour avec la gravité de l’historien, qu’un certain Pharaon, devenu aveugle à cause de son impiété, avait été condamné par les dieux en belle humeur à ne recouvrer la vue... Hérodote est quelquefois scabreux à traduire. Bref, il s’agissait de se procurer une femme qui n’eût jamais eu de commerce qu’avec son mari. La reine subit l’épreuve, puis les dames de la cour, puis celles de la ville, puis les provinciales, les campagnardes, les esclaves : rien n’y fit, le bon roi continuait de n’y voir goutte. Après bien des recherches, il découvrit la porteuse du remède et il l’épousa. Les autres ? Il les enferma dans une ville et, il les brûla : les choses se passaient de la sorte en ce temps[113]. Ce fabliau, débité au coin, d’un carrefour par un conteur des rues ou lu à loisir après boire, devait avoir le succès, qu’une histoire graveleuse obtient toujours auprès des hommes ; mais chaque Égyptien pensait à part soi, tout en se gaussant du voisin, qu’en pareille aventure sa ménagère saurait le guérir et il ne pensait pas mal. Les contes grivois de Memphis ne signifient rien de plus que ceux des autres nations ; ils procèdent, de ce fonds de rancune commune que l’homme a toujours conservé et partout contre la femme. Les commères égrillardes de notre moyen âge et les Égyptiennes enflammées des récits memphites n’ont rien à s’envier ; mais ce que les conteurs nous disent d’elles ne prouve rien contre les mœurs féminines de leur temps. Ces restrictions faites, le menu des aventures est égyptien. Relisez le passage où Satni rencontre Tboubouî et lui confesse crûment son désir. Les noms changés, vous y avez la peinture exacte de ce qui se passait à Thèbes ou à Memphis en cas pareil, les préliminaires noués par le valet et la servante, le rendez-vous, le divertissement et le souper fin, le marchandage avant l’abandon final. Les amoureux des Mille et une Nuits n’agissent pas autrement ; même l’inévitable cadi qu’on appelle pour célébrer le mariage de la Zobéide avec l’Ahmed ou le Noureddin d’occasion est déjà annoncé par le maître d’école qui rédige les contrats destinés à transférer sur Tboubouî les biens de Satni-Khâmoîs. Quant aux événements qui précipitent ou qui retardent le dénouement, ils sont le plus souvent les incidents de la vie courante. IVJe dis tous les incidents sans exception, même ceux qui sont e plus invraisemblables à nos yeux, car il ne faut pas juger les conditions de la vie égyptienne par celles de la nôtre. On n’emploie pas communément chez nous, tomme ressorts de romans, les apparitions de divinités, les songes, les hommes transformés en bêtes, les animaux parlants, les bateaux ou les litières magiques : ceux qui croient aux prodiges de ce genre les considèrent comme un accident des plus rares, et ils n’en usent pas dans le roman bourgeois. Il n’en allait pas de même en Égypte et ce que nous appelons le surnaturel y était journalier. Les songes y jouaient un rôle décisif dans la vie des souverains ou des particuliers, soit qu’ils fussent suscités par la volonté d’un dieu, soit qu’on les provoquât en allant dormir dans certains temples pendant la nuit[114]. La croyance aux intersignes régnait partout incontestée, et ce n’était pas seulement dans le roman que les bouillons d’un cruchon de bière ou les dépôts de lie d’une bouteille de vin prévenaient un frère de la mort de son frère[115] : tant de gens avaient reçu de ces avertissements mystérieux que personne ne s’avisait de crier à l’invraisemblance lorsqu’on les retrouvait dans le roman. La sorcellerie enfin avait sa place dans l’ordinaire de l’existence, aussi bien que la guerre, le commerce, la littérature, les métiers, les divertissements et les plaisirs ; tout le monde n’avait pas été témoin de ses prestiges, mais tout le monde était lié avec quelqu’un qui les avait vu s’accomplir, en avait profité ou en avait souffert. On la tenait en effet une science, et d’un ordre très relevé. A bien considérer les choses, le prêtre était un magicien- : les cérémonies qu’il célébrait, les prières qu’il récitait, étaient comme autant d’arts par lesquels il obligeait ses dieux à agir pour lui de la manière qu’il lui plaisait, et à lui accorder telle ou telle faveur en ce monde ou dans l’autre. Les prêtres porteurs du rouleau ou du livre (khrihabi), qui possédaient les secrets de la divinité au ciel, sur la terre, dans l’enfer, pouvaient exécuter tous les prodiges qu’on réclamait d’eux : Pharaon en avait à côté de lui, qu’il nommait khri-habi en chef, et qui étaient ses sorciers attitrés. Il les consultait, il stimulait leurs recherches, et quand ils avaient inventé pour lui quelque miracle nouveau, il les comblait de présents et d’honneurs. L’un savait rattacher au tronc une tête coupée, l’autre fabriquait un crocodile qui dévorait ses ennemis, un troisième ouvrait les eaux, les soulevait, les amoncelait à son gré[116]. Les grands eux-mêmes, Satni-Khâmoîs et son frère de lait, étaient des adeptes convaincus et ils lisaient avidement les recueils de formules mystiques ; même Satni s’acquit un renom tel en ce genre d’études qu’un cycle complet d’histoires se groupa autour de son nom[117]. Un prince à grimoires n’inspirerait chez nous qu’une estime médiocre : en Égypte, la magie n’était pas incompatible avec la royauté, et les magiciens de Pharaon eurent souvent Pharaon pour élève[118]. Plusieurs de nos personnages sont donc des sorciers amateurs ou de profession, Tboubouî[119], Nénoferképhtah[120], Oubaou-anir et Zazamânkhou[121], Didi[122], Sénosiris[123], Horou fils de la Négresse[124]. Baîti enchante son cœur, se l’arrache de la poitrine sans cesser de vivre, se métamorphose en bœuf, puis en arbre. Khâmoîs et son frère de lait ont appris, par aventure, l’existence d’un volume que Thot avait écrit de sa propre main et qui était doué de propriétés merveilleuses : on n’y comptait que deux formules, sans plus, mais quelles formules ! a Si tu récites la première, tu charmeras le ciel, la terre, le monde de la nuit, les montagnes, les eaux ; tu comprendras ce que les oiseaux et les reptiles disent, tous tant qu’ils sont ; tu verras les poissons de l’abîme, car une force divine les fera monter à la surface de l’eau. Si tu récites la seconde formule, encore que tu sois dans la tombe, tu reprendras la forme que tu avais sur la terre ; même tu verras le soleil se levant au ciel et son cycle de dieux, la lune en la forme qu’elle a quand elle parait[125]. Satni-Khâmoîs tenait à se procurer, outre l’ineffable douceur de produire à son gré le lever de la lune, la certitude de ne jamais perdre la forme qu’il avait sur terre : son désir du livre merveilleux devient le ressort principal du roman. La science à laquelle il se livre est d’ailleurs exigeante et elle impose à ses fidèles la chasteté, l’abstinence et d’autres vertus qu’ils ne peuvent toujours pratiquer jusqu’au bout. Et pourtant elle leur est si douce qu’ils s’y absorbent et qu’ils négligent tout pour elle : ils ne voient plus, ils ne boivent plus, ils ne mangent plus, ils n’admettent plus qu’une seule occupation, lire leur grimoire sans relâche et user de l’autorité dont il les investit sur les choses et sur les êtres[126]. Cet enivrement ne va pas sans danger : les dieux ou les morts auxquels le sorcier a ravi leurs talismans essaient de les recouvrer et tous les moyens leur sont bons. Ils rôdent autour de lui et ils profitent de ses passions ou de ses faiblesses pour le réduire à leur discrétion : l’amour est le grand auxiliaire, et c’est par le moyen de la femme qu’ils réussissent le plus souvent à reconquérir leur trésor perdu[127]. Et la puissance de l’art magique ne cessait pas avec la vie. Qu’il le voulût ou non, chaque Égyptien était, après sa mort, soumis aussi fatalement que pendant sa vie aux charmes et aux incantations. On croyait, en effet, que l’existence de l’homme se rattachait par des liens nécessaires à celle de l’univers et des dieux. Les dieux n’avaient pas toujours marqué pour l’humanité cette indifférence dédaigneuse à laquelle ils semblaient se complaire depuis le temps de Ménès. Ils étaient descendus jadis dans le monde récent encore de la création, ils s’étaient mêlés familièrement aux peuples nouveau-nés, et prenant un corps de chair, ils s’étaient asservis aux passions et aux faiblesses de la chair. Les gens d’alors les avaient vu s’aimer et se combattre, régner et se succéder, triompher et succomber tour à tour. La jalousie, la colère, la haine avaient agité leurs âmes divines comme si elles eussent été de simples âmes humaines. Isis, veuve et misérable, pleura de vaines larmes de femme sur son mari assassiné[128], et s’a déité ne la sauva point des douleurs de l’enfantement. Râ faillit périr de la piqûre d’un serpent[129] et détruire ses créatures dans un accès de fureur : il avait vieilli et dans sa décrépitude il avait subi les déchéances de la seconde enfance, branlant de la tête et bavant comme un vieillard d’entre nous[130]. Horus l’enfant conquit le trône d’Égypte les armes à la main[131]. Plus tard, les dieux s’étaient retirés au ciel ; autant jadis ils avaient aimé se montrer ici-bas, autant maintenant ils mettaient de soin à se dissimuler dans le mystère de leur éternité. Qui, parmi les vivants, pouvait se vanter d’avoir entrevu leur face ? Et pourtant, les incidents heureux ou funestes de leur vie corporelle décidaient encore à distance le bonheur ou le malheur de chaque génération, et, dans chaque génération, de chaque individu. Le 17 Athyr d’une année si bien perdue dans les lointains du passé qu’on ignorait combien de siècles au juste s’étaient écoulés depuis elle, Sitou avait attiré près de lui son frère Osiris et il l’avait tué en trahison au milieu d’un banquet[132]. Chaque année, à pareil jour, la tragédie qui s’était jouée dans le palais terrestre du dieu semblait recommencer dans les profondeurs du firmament. Comme au même instant de la mort d’Osiris, la puissance du bien s’amoindrissait, la souveraineté du mal prévalait et la nature entière, abandonnée aux divinités de ténèbres, se retournait contre l’homme. Un dévot n’avait garde de rien entreprendre ce jour-là : quoi qu’il se fût avisé de faire, ç’aurait échoué. S’il sortait au bord du fleuve, un crocodile l’assaillait comme le crocodile dépêché par Sitou avait assailli Osiris. S’il partait en voyage, il pouvait dire adieu pour jamais à sa famille et à sa maison : il était certain de ne plus revenir. Mieux valait s’enfermer chez soi, attendre, dans la crainte et dans l’inaction, que les heures de danger s’en fussent allées une à une, et que le soleil du jour suivant eût mis le mauvais en déroute. Le 9 Khoïak, Thot avait rencontré Sitou et il avait remporté sur lui une victoire éclatante. Le 9 Khoïak de chaque année, il y avait fête sur la terre parmi les hommes, fête dans le ciel parmi les dieux et sécurité de tout commencer[133]. Les jours se succédaient fastes ou néfastes, selon l’événement qu’ils avaient vu s’accomplir au temps des dynasties divines. Le 4 Tybi. — Bon, bon, bon[134]. — Quoi que tu voies en ce jour, c’est pour toi d’heureux présage. Qui naît ce jour-là meurt le plus âgé de tous les gens de sa maison ; il aura longue vie succédant à son père. Le 5 Tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — C’est le jour où furent brûlés les chefs par la déesse Sokhit qui réside dans la demeure blanche, lorsqu’ils sévirent, se transformèrent, vinrent[135] : gâteaux d’offrandes pour Shou, Phtah, Thot ; encens sur le feu pour Râ et les dieux de sa suite, pour Phtah, Thot, Hou-Saou, en ce jour. Quoi que tu voies en ce jour, ce sera heureux[136]. Le 7 Tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne t’unis pas aux femmes devant l’œil d’Horus[137]. Le feu qui brûle dans ta maison, garde-toi de t’exposer à son atteinte funeste. Le 8 Tybi. — Bon, bon, bon. — Quoi que tu voies en ce jour, de ton œil, le cycle divin t’exauce. Consolidation des débris[138]. Le 9 Tybi. — Bon, bon, bon. — Les dieux acclament la déesse du midi en ce jour. Présenter des gâteaux de fête et des pains frais qui réjouissent le cœur des dieux et des mânes. Le 10 Tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais pas un feu de joncs ce jour-là. Ce jour-là, le feu sortit du dieu Sop-bo dans le Delta, en ce jour[139]. Le 14 Tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — N’approche pas de la flamme en ce jour : Râ, Y. s. f., l’a dirigée pour anéantir tous ses ennemis, et quiconque en approche en ce jour, il ne se porte plus bien tout le temps de sa vie. Tel officier de haut rang qui, le 13 de Tybi, affrontait la dent d’un lion en toute assurance et fierté de courage, ou qui entrait dans la mêlée sans redouter la morsure des flèches syriennes[140], le 12, s’effrayait à la vue d’un rat et, tremblant, détournait les yeux[141]. Chaque jour avait ses influences, et les influences accumulées formaient le destin. Le destin naissait avec l’homme, grandissait avec lui, le guidait à travers sa jeunesse et son âge mûr, coulait, pour ainsi dire, sa vie entière dans le moule immuable que les actions des dieux avaient préparé dès le commencement des temps. Pharaon et ses nobles étaient soumis au destin, soumis aussi les chefs des nations étrangères[142]. Le destin suivait son homme jusqu’après la mort ; il assistait avec la fortune au jugement de l’âme[143], soit pour rendre au jury infernal le compte exact des vertus ou des crimes, soit afin de préparer les conditions d’une vie nouvelle,. Les traits sous lesquels on se le figurait n’avaient rien de hideux. C’était une déesse, Hâthor, ou mieux sept jeunes et belles déesses[144], des Hâthors à la face rosée et aux oreilles de génisse, toujours gracieuses, toujours souriantes, qu’il s’agît d’annoncer le bonheur ou de prédire la misère. Comme les fées marraines du moyen âge, elles se pressaient, autour du lit des accouchées et elles attendaient la venue de l’enfant pour l’enrichir ou pour le ruiner de leurs dons. Les sculptures des temples à Louxor[145], à Erment[146], à Déîr el Baharî[147], nous les montrent qui jouent le rôle de sages-femmes auprès de Moutemoua, femme de Thoutmôsis IV, de la reine Ahmasi et de la fameuse Cléopâtre. Les unes soutiennent tendrement la jeune mère et elles la fortifient par leurs incantations ; les autres prodiguent les premiers soins au nouveau-né et, elles lui présagent à l’envi toutes les félicités. Khnoumou ayant fabriqué une femme à Baîti, elles la viennent voir, l’examinent, un moment et s’écrient d’une seule voix : Qu’elle périsse par le glaive ![148] Elles apparaissent au berceau du Prince prédestiné et elles annoncent qu’il sera tué par le serpent, par le crocodile ou par le chien. Dans le conte de Khoufouî et des Magiciens, quatre d’entre elles, Isis, Nephthys, Maskhonouît et Hiqaît, assistées de Khnoumou, se déguisent en almées pour délivrer la femme du prêtre de Râ des trois enfants qui s’agitent dans son sein. Le point par quoi elles diffèrent de nos fées marraines, c’est une passion désordonnée pour le calembour : les noms qu’elles imposent, à leurs filleuls sont des jeux de mots, difficiles à comprendre pour un moderne, plus difficiles à traduire. C’est un manque de goût dont elles ne sont pas seules à faire preuve : l’Orient a toujours été entraîné par un penchant irrésistible vers ce genre d’esprit, et l’Arabie ou la Judée n’ont rien à envier à l’Égypte en matière d’étymologies baroques pour les noms de leurs saints ou de leurs héros. Voir les Hâthors et les entendre au moment même où elles prononçaient leurs arrêts était privilège réservé aux grands de ce monde : les gens du commun n’étaient pas d’ordinaire dans leur, confidence. Ils savaient seulement, par l’expérience de nombreuses générations, qu’elles départaient certaines morts aux hommes qui naissaient à de certains jours. Le 4 Paophi. — Hostile, bon, bon. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour. Quiconque naît en ce jour meurt de la contagion en ce jour. Le 5 Paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour ; ne t’approche pas des femmes ; c’est le jour d’offrir offrande de choses par devant le Dieu, et Montou[149] repose en ce jour. Quiconque naît en ce jour, il mourra de l’amour. Le 6 Paophi. — Bon, bon, bon. — Jour heureux dans le ciel ; les dieux reposent par devant le Dieu, et le cycle divin accomplit les rites par devant[150]... Quiconque naît ce jour-là mourra d’ivresse. Le 7 Paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais absolument rien en ce jour. Quiconque naît ce jour-là mourra sur la pierre[151]. Le 9 Paophi. — Allégresse des dieux, les hommes sont en fête, car l’ennemi de Râ est à bas. Quiconque naît ce jour-là mourra de vieillesse. Le 23 Paophi. — Bon, bon, mauvais. — Quiconque naît ce jour-là meurt par le crocodile. Le 27 Paophi. — Hostile, hostile, hostile. — Ne sors pas ce jour-là ; ne t’adonne à aucun travail manuel : Râ repose. Quiconque naît ce jour-là meurt par le serpent. Le 29 Paophi. — Bon, bon, bon. — Quiconque naît ce jour-là mourra dans la vénération de tous ses gens. Tous les mois n’étaient pas également favorables à cette sorte de présage. A naître en Paophi, on avait huit chances sur trente de connaître, par la date de la naissance, le genre de la mort. Athyr, qui suit immédiatement Paophi, ne renfermait que trois moments fatidiques[152]. L’Égyptien né le 9 ou le 29 de Paophi n’avait donc qu’à se laisser vivre : son bonheur ne pouvait plus lui manquer. L’Égyptien né le 7 ou le 27 du même mois n’avait pas raison de s’inquiéter outre mesure. La façon de sa mort était désormais fixée, non l’instant : il était condamné, mais il avait la liberté de retarder le supplice presque à volonté. Était-il, comme le Prince prédestiné, menacé de la dent d’un crocodile ou d’un serpent, s’il n’y prenait point garde, ou si, dans son enfance, ses parents n’y avisaient point pour lui, il ne languissait pas longtemps ; le premier crocodile ou le premier serpent venu exécutait la sentence. Mais il pouvait s’armer de précautions contre son destin, se tenir éloigné des canaux et du fleuve, ne s’embarquer jamais à de certains jours où les crocodiles étaient maîtres de l’eau[153], et, le reste du temps, faire éclairer sa navigation par des serviteurs habiles à écarter le danger au moyen de sortilèges[154]. On pensait qu’au moindre contact d’une plume d’ibis, le crocodile le plus agile et le mieux endenté devenait immobile et inoffensif[155]. Je ne m’y fierais point ; mais l’Égyptien, qui croyait aux vertus secrètes des choses, rien ne l’empêchait d’avoir toujours sous la main quelques plumes d’ibis et d’imaginer qu’il était garanti. Aux précautions humaines on ne se faisait pas faute de joindre dés précautions divines, les incantations, les amulettes, les cérémonies du rituel magique. Les hymnes religieux avaient beau répéter en grandes strophes sonores qu’on ne taille point le dieu dans la pierre — ni dans les statues sur lesquelles on pose la double couronne ; on ne le voit pas ; — nul service, nulle offrande n’arrive jusqu’à lui ; — on ne peut l’attirer dans les cérémonies mystérieuses ; on ne sait pas le lieu où il est ; — on ne le trouve point par la force des livres sacrés[156]. C’était vrai des dieux considérés chacun comme un être idéal, parfait, absolu, mais en l’ordinaire de la vie Râ, Osiris, Shou, Amon, n’étaient pas inaccessibles ; ils avaient gardé de leur royauté une sorte de faiblesse et d’imperfection qui les ramenait sans cesse à la terre. On les taillait dans la pierre, on les touchait par des services et par des offrandes, on les attirait dans les sanctuaires et dans les châsses peintes. Si leur passé mortel influait sur la condition des hommes, l’homme influait à son tour sur leur présent divin. Il y avait des mots qui, prononcés avec une certaine intonation, pénétraient jusqu’au fond de l’abîme, des formules dont le son agissait irrésistible sur les intelligences surnaturelles, des amulettes où la consécration magique enfermait efficacement un peu de la toute-puissance céleste. Par leur vertu, l’homme mettait la main sur les dieux ; il enrôlait Anubis à son service, ou Thot, ou Bastit, ou Sftou lui-même, il les irritait et il les calmait, il les lançait et il les rappelait, il les forçait à travailler et à combattre pour lui. Ce pouvoir formidable qu’ils croyaient posséder, quelques-uns l’employaient à l’avancement de leur fortune et à la satisfaction de leurs rancunes ou de leurs passions mauvaises. Ce n’était pas seulement dans le roman qu’Horus, fils de la négresse, s’armait de maléfices afin de persécuter un Pharaon et d’humilier l’Égypte devant l’Éthiopie[157] : lors d’une conspiration ourdie contre Ramsès III, des conspirateurs s’étaient servis de livres d’incantations pour arriver jusqu’au harem de Pharaon[158]. La loi punissait de mort ceux qui abusaient de la sorte, mais leur crime ne lui cachait point les services de leurs confrères moins pervers ; elle protégeait ceux qui exerçaient une action inoffensive ou bienfaisante. Désormais, l’homme menacé par le sort n’était plus seul à veiller ; les dieux veillaient avec lui et ils suppléaient à ses défaillances par leur vigilance infaillible. Prenez un amulette qui représente une image d’Amon à quatre têtes de bélier, peinte sur argile, foulant un crocodile aux pieds, et huit dieux qui l’adorent placés à sa droite et à sa gauche[159]. Prononcez sur lui l’adjuration que voici : Arrière, crocodile, fils de Sitou ! — Ne vogue pas avec ta queue ; — ne saisis pas de tes deux bras ; — n’ouvre pas ta bouche ! — Devienne l’eau une nappe de feu devant toi ! — Le charme des trente-sept dieux est dans ton œil ; — tu es lié au grand croc de Râ ; — tu es lié aux quatre piliers en bronze du midi, — à l’avant de la barque de Râ. — Arrête, crocodile, fils de Sitou ! — protège-moi, Amon, mari de ta mère ! Le passage est obscur ? Il fallait qu’il le fût pour opérer avec efficacité. Les dieux comprennent à demi-mot ce qu’on leur dit : des allusions aux événements de leur vie par lesquels on les conjure suffisent à les toucher sans qu’on ait besoin de les leur rappeler par le menu. Fussiez-vous né le 22 ou le 23 de Paophi, Amon était tenu de vous garder contre le crocodile et contre les périls de l’eau. D’autres grimoires et d’autres amulettes préservaient du feu, des scorpions, de la maladie[160] ; sous quelque forme que le destin se déguisât, il rencontrait des dieux embusqués pour la défense. Sans doute, rien qu’on fit ne changeait son arrêt, et les dieux eux-mêmes étaient sans pouvoir sur l’issue de la lutte. Le jour finissait par se lever où précautions, magie, protections divines, tout manquait à la fois ; le destin était le plus fort. Au moins, l’homme avait-il réussi à durer, peut-être jusqu’à la vieillesse, peut-être jusqu’à cet âge de cent dix ans, limite extrême de la vie, que les sages espéraient atteindre parfois, et que nul mortel né de mère mortelle ne devait dépasser[161]. Après la mort, la magie accompagnait l’homme au-delà de la tombe et elle continuait à le régenter. Notre terre, telle que l’imaginaient la foi aveugle du peuple et la science superstitieuse des prêtres, était comme un théâtre en deux compartiments. Dans l’un, l’Égypte des vivants s’étale en pleine lumière, le vent du nord souffle son haleine délicieuse, le Nil roule à flots, la riche terre noire produit des moissons de fleurs, de céréales et de fruits : Pharaon, fils du Soleil, seigneur des diadèmes, maître des deux pays, trône à Memphis ou à Thèbes, tandis que ses généraux remportent au loin des victoires et que les sculpteurs se fatiguent à tailler dans le granit les monuments de sa piété. C’est là, dans son royaume ou dans les pays étrangers qui dépendent de lui, que l’action de la plupart des contes se déroule. Celle des romans de Satni se poursuit en partie dans la seconde division de notre univers, la région des tombeaux et de la nuit. Les eaux éternelles, après avoir couru, pendant le jour, le long des remparts du monde, de l’orient au sud et du sud à l’occident, arrivaient, chaque soir, à la Bouche de la Fente[162] et elles s’engouffraient dans les montagnes qui bornent la terre vers le nord, entraînant avec elles la barque du soleil et son cortège de dieux lumineux[163]. Pendant douze heures, la compagnie divine parcourait de longs corridors sombres, où des génies, les uns hostiles, les autres bienveillants, tantôt s’efforçaient de l’arrêter, tantôt l’aidaient à vaincre les dangers du voyage. D’espace en espace, une porte, défendue par un serpent gigantesque, s’ouvrait devant elle et lui livrait l’accès d’une salle immense, remplie de monstres ; puis les couloirs recommençaient, étroits et obscurs, et la course à l’aveugle au milieu des ténèbres, et les luttes contre les génies malfaisants, et l’accueil joyeux des dieux propices. Au matin, le soleil avait atteint l’extrême limite de la contrée ténébreuse et il sortait de la montagne à l’orient pour éclairer un nouveau jour[164]. II arrivait parfois aux vivants de pénétrer par la vertu de la magie dans ces régions mystérieuses et d’en ressortir sains et saufs : le Pharaon Rhampsinite en avait remporté Ies dons de la déesse Nouit[165], et Satni, guidé par son fils Sénosiris, y avait assisté au jugement des âmes[166]. C’était l’exception : pour les affronter selon là règle, il l’allait avoir subi l’épreuve de la mort. Le tombeau des rois, des princes, des riches particuliers, était souvent construit à l’image du monde infernal. Il avait, lui aussi, son puits, par où le mort se glissait au caveau funéraire, ses couloirs enfoncés bien avant dans la roche vive, ses grandes salles aux piliers bariolés, à la voûte en berceau[167], dont les parois portaient, peints à même, les démons et les dieux de l’enfer[168]. Tous les habitants de ces maisons éternelles[169] revêtaient, dans la splendeur bizarre de ses modes changeantes, la livrée de la mort égyptienne, le maillot de bandelettes fines, les cartonnages coloriés et dorés, le masque aux grands yeux d’émail toujours ouverts : gardez de croire qu’ils étaient tous morts. On peut dire, d’une manière générale, que les Égyptiens ne mouraient pas au sens où nous mourons. Le souffle de vie, dont leurs tissus s’étaient imprégnés au moment de la naissance, ne disparaissait pas soudain avec les derniers battements du cœur : il persistait jusqu’à la complète décomposition. Combien obscure et inconsciente que fût cette vie du cadavre, il fallait éviter de la laisser éteindre. Les procédés du dessèchement d’abord puis de la momification fixaient la forme et la pétrifiaient, pour ainsi dire ; ceux de la magie et de la religion y maintenaient une sorte d’humanité latente, susceptible de se développer un jour et de se manifester. Aussi, l’embaumeur était-il un magicien et un prêtre en même temps qu’un chirurgien. Tout en macérant les chairs et en roulant les bandelettes, il récitait des oraisons, il accomplissait des rites mystérieux, il consacrait des amulettes souverains. Chaque membre recevait de lui, tour à tour, l’huile qui le rend incorruptible et les prières qui y alimentent le ferment de la vie[170] : même, vers la fin de l’âge pharaonique, la magie avait envahi le cadavre et elle l’avait harnaché de ses talismans des pieds à la tête. Un disque de carton doré, chargé de légendes mystiques et placé sous la tête, y entretenait un restant de chaleur animale[171]. Le scarabée de pierre, cerclé d’or, collé sur la poitrine à la naissance du cou, remplaçait le cœur immobilisé par l’arrêt du sang ou par la fuite des souffles, et il rétablissait une respiration artificielle[172]. Des brins d’herbe, des fleurs sèches, des rouleaux de papyrus, de mignonnes figurines en terre émaillée perdues dans l’épaisseur des bandages, des bracelets, des anneaux, des plaques constellées d’hiéroglyphes, les mille petits objets qui encombrent aujourd’hui les vitrines de nos musées, couvraient le tronc, les bras, les jambes, comme les pièces d’une armure magique. L’âme, de son côté, ne s’aventurait pas sans défense dans la vie d’outre-tombe. Les chapitres du Livre des Morts et des autres écrits théologiques, dont on déposait un exemplaire dans le cercueil, étaient pour elle autant de charmes qui lui ouvraient les chemins des sphères infernales et qui en écartaient les dangers. Si, au temps qu’elle était encore enfoncée dans la chair, elle avait eu soin de les apprendre par avance, il n’en valait que mieux. Si la pauvreté, l’ignorance, la paresse, l’incrédulité, ou quelque autre raison l’avaient empêchée de recevoir l’instruction nécessaire, même après la mort un parent ou un ami charitable pouvait lui servir à instructeur. C’en était assez de réciter chaque prière auprès de la momie ou sur les amulettes pour que la connaissance s’en infusât, par je ne sais quelle subtile opération, dans l’âme désincarnée. C’était le sort commun : quelques-uns y échappaient par prestige et art magique, pour qui le retour dans notre monde était une renaissance véritable au sein d’une femme. Ainsi Baîti dans le Conte des deux frères ; ainsi le sorcier Horus, le fils de Panishi. Celui-ci, apprenant que l’Égypte est menacée par les sortilèges d’une peste d’Éthiopien, s’insinue dans les entrailles de la princesse Mahîtouaskhît, et renaît au monde sous le nom de Sénosiris, comme fils de Satni-Khâmoîs. Il parcourt de nouveau tous les stages de l’existence humaine, mais il conserve l’acquis .et la conscience de sa première vie, et il ne regagne l’Hadès qu’après avoir accompli victorieusement la tâche patriotique qu’il s’était imposée[173]. D’autres au contraire, ne désirant produire qu’un effet momentané, se dispensent d’une procédure aussi lente : ils envahissent notre monde brusquement sous la forme qui leur paraît être le plus propre à favoriser leurs projets, et ils ne séjournent ici-bas que le nombre d’heures strictement indispensables. Tels les personnages que Satni trouva réunis dans la tombe de Nénoferképhtah et qui n’ont du mort que l’apparence et la livrée. Ils sont des momies si l’on veut ; le sang ne coule plus dans leurs veines, leurs membres,ont été roidis par l’emmaillotement funéraire, leurs chairs sont saturées et durcies des parfums de l’embaumement, leur crâne est vide. Pourtant ils pensent, ils parlent, ils se meuvent, ils agissent comme s’ils vivaient, je suis presque tenté de dire qu’ils vivent : le livre de Thot est en eux et les porte. Madame de Sévigné écrivait d’un traité de M. Nicole « qu’elle voudrait bien en faire un bouillon et l’avaler. Nénoferképhtah avait copié les formules du livre magique sur du papyrus vierge, il les avait dissoutes dans de Peau., puis il avait avalé le breuvage[174]. Le voilà désormais indestructible. Là mort, en le frappant, peut changer les conditions de son existence : elle n’atteint pas son existence même. Il mande dans sa tombe les doubles de sa femme et de son fils, il leur infuse les vertus du livre et il reprend avec eux la routine de famille, un instant interrompue par les formalités de l’embaumement. Il peut entrer et sortir à son gré, reparaître au jour, revêtir toutes les formes qu’il lui convient revêtir, communiquer avec les vivants. Il laisse dormir son pouvoir, mais quand Satni l’a dépouillé, il n’hésite pas à l’éveiller et à user de lui énergiquement. Il délègue à Memphis sa femme Ahouri, et celle-ci, escortée des pions de l’échiquier qui deviennent autant de serviteurs pour la circonstance, se déguise en hiérodule pour séduire le voleur. Lorsqu’elle a réussi auprès de lui dans son couvre de perdition, et qu’il gît sans vertu à sa merci, Nénoferképhtah se manifeste à son tour, d’abord sous la figure d’un roi, puis sous celle d’un vieillard, et il l’oblige à restituer le précieux manuscrit. 11 pourrait au besoin tirer vengeance de l’imprudent qui a violé le *secret de sa tombe, mais il se contente de l’employer à l’accomplissement de celui de ses désirs qu’un vivant seul peut exaucer : il le contraint de ramener à Memphis les momies d’Ahouri et de Maïhêt qui étaient en exil à Coptos, et de réunir en un seul tombeau ceux que les rancunes de Thot avaient tenus séparés. Voilà qui est égyptien et rien qu’égyptien. Si l’on persiste à prétendre que la conception originelle est étrangère, il faudra confesser que l’Égypte se l’est appropriée au point de la rendre sienne entièrement. On a signalé ailleurs des familles de spectres ou des assemblées de morts en rupture de cercueil ; une famille de momies n’est possible qu’aux hypogées de la vallée du Nil. Après cela, l’apparition d’un revenant dans un fragment malheureusement trop court du Musée de Florence n’étonnera personne[175]. Ce revenant ou, pour l’appeler par son nom égyptien, ce khou, ce lumineux, fidèle à l’habitude de ses congénères, racontait son histoire, comme quoi il était né sous le roi Râhotpou de la XVIIe dynastie, et quelle vie il avait menée. Ses auditeurs n’avaient point l’air étonnés de le rencontrer si loquace : ils savaient que le temps viendrait bientôt pour eux où ils seraient ce qu’il était, et ils comprenaient quelle joie ce devait être pour un pauvre esprit réduit depuis des siècles à la conversation des esprits, de causer enfin avec des vivants. VC’en est assez pour montrer avec quelle fidélité les récits populaires dépeignent les mœurs et les croyances de l’Égyptien en Égypte : il est curieux de démêler dans d’autres contes les impressions de l’Égyptien en voyage. J’étonnerai bien des gens en avançant que, tout considéré, les Égyptiens étaient plutôt un peuple voyageur. On s’est en effet habitué à les représenter comme des. gens casaniers, routiniers, entichés de la supériorité de leur race au point de ne vouloir en fréquenter aucune autre, amoureux de leur pays à n’en sortir que par force. Le fait était peut-être vrai à l’époque gréco-romaine, bien que la présence des prêtres errants, des nécromants, des jongleurs, des matelots égyptiens, en différents points de l’Empire des Césars et jusqu’au fond de la Grande-Bretagne, montre qu’ils n’éprouvaient aucune répugnance à s’expatrier, quand ils y trouvaient leur profit. Mais ce qui était peut-être vrai de l’Égypte vieillie et dégénérée l’était-il également de l’Égypte pharaonique ? Les armées des Pharaons guerriers traînaient derrière elles des employés, des marchands, des brocanteurs, des gens de toute sorte : les campagnes se renouvelant presque chaque année, c’étaient presque chaque année des milliers d’Égyptiens qui quittaient la vallée à la suite des conquérants et qui y revenaient pour la plupart l’expédition terminée[176]. Grâce à ces exodes périodiques, l’idée du voyage entra si familière dans l’esprit de la nation, que les scribes n’hésitèrent pas à en classer le thème parmi leurs exercices de style. L’un d’eux a consacré vingt pages de belle écriture à tracer l’itinéraire assez exact d’une randonnée entreprise sous Ramsès II à travers les provinces syriennes de l’empire[177]. Les incidents habituels y sont indiqués brièvement : le héros y affronte des forêts peuplées d’animaux sauvages et de bandits, des routes mal entretenues, des peuplades hostiles, des régions de montagnes où son char se brise. La plupart des villes qu’il visite ne sont qu’énumérées dans leur ordre géographique, mais quelques détails pittoresques interrompent çà et là les monotonies du dénombrement : c’est la Tyr insulaire avec ses poissons plus nombreux que les grains de sable de la mer et ses bateaux qui lui apportent l’eau du, rivage ; c’est Byblos et sa grande déesse, Joppé et ses vergers fréquents en séductions amoureuses. Je te ferai connaître le chemin qui passe par Magidi, car, toi, tu es un héros habile aux œuvres de vaillance, trouve-t-on un héros qui charge comme toi à la tête des soldats, un seigneur qui, mieux que toi, lance la flèche ? Te voilà donc sur le bord d’un gouffre profond de deux mille coudées, plein de roches et de galets, tu chemines tenant l’arc et brandissant le fer de la main gauche, tu le montres aux chefs excellents et tu obliges leurs yeux à se baisser devant ta main. « Tu es destructeur comme le dieu El, cher héros ![178] Tu te fais un nom, héros, maître des chevaliers d’Égypte, devienne ton nom comme celui de Kazarati, chef du pays d’Âsarou, alors que les hyènes le rencontrèrent au milieu des halliers, dans le chemin creux, féroces comme les Bédouins qui se cachent dans les taillis, longues quelques-unes de quatre à cinq coudées, leur corps massif comme celui de l’hippopotame, d’aspect féroce, impitoyables, sourdes aux prières ». Toi, cependant, tu es seul, sans guide, sans troupe à ta suite et tu ne trouves pas de montagnard qui t’indique la direction que tu dois suivre, aussi l’angoisse s’empare de toi, tes cheveux se dressent sur ta tête, ton âme passe tout entière dans ta main, car la route est pleine de roches et de galets, sans passage frayé, obstruée de houx, de ronces, d’aloès, de Souliers de Chiens[179], le précipice d’un côté, la montagne abrupte de l’autre. Tandis que tu y chemines, ton a char cahote sans cesse et ton attelage s’effraie à chaque heurt ; s’il se jette de côté, il entraîne le timon, les rênes sont arrachées violemment et on tombe ; si, tandis que tu pousses droit devant toi, le cheval arrache le timon au plus étroit du sentier, il n’y a pas moyen de le rattacher, et, comme il n’y a pas moyen de le rajuster, le joug demeure en place et le cheval s’alourdit à le porter. Ton cœur se lasse enfin, tu te mets à galoper, mais le ciel est sans nuages, tu as soif, l’ennemi est derrière toi, tu as peur, et, dès qu’une branche d’acacia te happe au passage, tu te rejettes de côté, ton cheval se blesse sur l’heure, tu es précipité à terre et tu te meurtris à grand’douleur. Entrant à Joppé, tu y rencontres un verger fleuri en sa saison, tu fais un trou dans la haie pour y aller manger ; tu y trouves la jolie fille qui garde les vergers, elle te prend pour ami et t’abandonne la fleur de son sein. On t’aperçoit ; tu déclares qui tu es et on reconnaît que tu es un héros[180]. Le tout formerait, sans peine, le canevas d’un roman géographique pareil à certains romans byzantins, les Éthiopiques d’Héliodore ou les Amours de Clitophon et de Leucippe. Il n’y adonc point lieu de s’étonner si les héros de nos contes voyagent beaucoup à l’étranger. Ramsès Il épouse la fille du prince de Bakhtan au cours d’une expédition, et Khonsou n’hésite pas à charger son arche sur un char pour s’en aller au loin guérir Bintrashît. Dans Le Prince prédestiné, un fils de Pharaon, s’ennuyant au logis, va courir l’aventure au Naharinna, en pleine Syrie du Nord. C’est dans la Syrie du Sud, à Joppé, que Thoutîyi trouve l’occasion de déployer ses qualités de soldat rusé. L’exil mène Sinouhît au Tonou supérieur. La peinture des mœurs manque presque partout, et aucun détail ne prouve que l’auteur connut autrement que de nom les pays où il conduisait ses personnages. L’homme qui a rédigé les Mémoires de Sinouhît avait ou exploré lui-même la région qu’il décrivait, ou consulté des gens qui l’avaient parcourue. Il devait avoir affronté le désert et en avoir ressenti les terreurs, pour parler comme il fait des angoisses de son héros : Alors la soif elle fondit sur moi, je défaillis, mon gosier râla, et je me disais déjà : « C’est le goût de la mort », quand soudain je relevai mon cœur et je rassemblai mes membres ; j’entendais la voix forte d’un troupeau. Les mœurs des Bédouins ont été saisies sur le vif, et le combat singulier entre Sinouhît et le champion de Tonou est raconté avec tant de fidélité, qu’on pourrait presque le donner pour le récit d’un combat d’Antar ou de Rebiâ. Il ne nous restait plus, pour compléter la série, qu’à trouver un roman maritime : Golénicheff en a découvert deux à Saint-Pétersbourg[181]. Les auteurs grecs et latins nous ont répété à l’envi que la mer était considérée comme impure par les Égyptiens et que nul d’entre eux n’osait s’y aventurer de son plein gré. Les modernes ont réussi pendant longtemps à se persuader, sur la foi des anciens, que l’Égypte n’avait jamais possédé ni matelots ni marine nationale ; le voyage d’exploration de la reine Hâtshopsouitou, les victoires navales de Ramsès III, auraient été le fait de Phéniciens combattant ou naviguant sous bannière égyptienne. Les romans de Saint-Pétersbourg nous contraignent de renoncer à cette hypothèse. L’un d’eux, celui d’Ounamounou, est le périple d’un officier que le grand-prêtre Hrihorou envoie acheter du bois sur la côte syrienne au XIIe siècle avant notre ère. Les incidents y sont ceux qui survenaient dans la vie journalière des marchands ou des ambassadeurs, et l’ensemble du document laisse pour les croisières maritimes une impression analogue à celle que le Papyrus Anastasi n° I nous avait donnée des voyages de terre. Ce sont des mésaventures du genre de celles qu’on lit dans les relations du Levant au XVIe et au XVIIe siècles, vols à bord, mauvaise volonté des capitaines de port, menaces des petits tyrans locaux, discussions et palabres interminables pour la liberté de partir et même pour la vie. Le second roman nous reporte à plus de vingt siècles plus loin, dans un temps où il n’était pas question pour l’Égypte de conquérir la Syrie. Les monuments nous avaient déjà fait connaître sous des rois de la VIe et de la XIe dynastie des expéditions maritimes au pays de Pouanît[182] : le roman de Saint-Pétersbourg nous enseigne que les matelots auxquels les souverains de la XIIe confiaient la tâche d’aller acheter au loin les parfums et les denrées de l’Arabie étaient bien de race et d’éducation égyptiennes. , Bien n’est plus curieux que la mise en scène du début. Un personnage envoyé en mission revient après une croisière malheureuse où l’on dirait qu’il a perdu son navire. Un de ses compagnons, peut-être le capitaine du vaisseau qui l’a recueilli, l’encourage à se présenter hardiment devant le souverain pour plaider sa cause, et, afin de le rassurer sur les suites de la catastrophe, il lui raconte ce qui lui arriva en semblable occurrence. Le récit est construit sur le modèle des notices biographiques que les grands seigneurs faisaient graver sur les murs de leurs hypogées, ou des rapports qu’ils adressaient à leur maître après chaque mission remplie. Les phrases en sont celles-là mêmes que les scribes employaient lorsqu’ils avaient à rendre compte d’une affaire de service. J’allai aux mines du Souverain, et j’étais descendu en mer sur un navire de cent cinquante coudées de long sur quarante de large, qui portait cent cinquante matelots de l’élite du pays d’Égypte, qui avaient vu le ciel, qui avaient vu la terre, et qui étaient plus hardis de cœur que des lions[183]. Le nomarque Amoni-Amenemhaît, qui vivait à peu près au temps où notre ouvrage fut composé, ne parle pas autrement dans le mémoire qu’il nous a laissé de sa carrière : Je remontai le Nil afin d’aller chercher les produits des diverses sortes d’or pour la Majesté du roi, Khopirkerîya ; je le remontai avec le prince héréditaire, fils aîné légitime du roi, Amoni, v. s. f. ; je le remontai avec un nombre de quatre cents hommes de toute l’élite de ses soldats[184]. Si, par une de ces mésaventures auxquelles l’égyptologie nous tient accoutumés, le manuscrit avait été déchiré en cet endroit et la fin perdue, nous aurions presque le droit d’imaginer qu’il contenait un morceau d’histoire, comme on a fait longtemps pour le Papyrus Sallier n° I. Par bonheur, il est intact et nous y voyons nettement comment le héros passe sans transition du domaine de la réalité à celui de la fable. Une tempête coule son navire et le jette sur une île. Le fait n’a rien que d’ordinaire en soi, mais l’île à laquelle il aborde, seul d’entre ses camarades, n’est pas une île ordinaire. Un serpent gigantesque l’habite avec sa famille, serpent à voix humaine qui accueille le naufragé, l’entretient, le nourrit, lui prédit un heureux retour au pays, le comble de cadeaux au moment du départ. Golénicheff a rappelé à ce propos les voyages de Sindbad le marin[185], et le rapprochement une fois indiqué par lui s’est imposé de lui-même à l’esprit du lecteur. Seulement les serpents de Sindbad ne sont plus d’humeur aussi accommodante que ceux de son prédécesseur égyptien. Ils ne s’ingénient pas à divertir l’étranger par les charmes d’une causerie’ amicale ; ils l’avalent de bon appétit et s’ils l’approvisionnent de diamants, de rubis ou d’autres pierres précieuses c’est bien malgré eux, parce qu’avec toute leur voracité ils ne sont point parvenus à supprimer le chercheur de trésors. Je ne voudrais pas cependant conclure de cette analogie que nous avons une version égyptienne du conte de Sindbad. Les récits de voyages merveilleux naissent naturels dans la bouche des matelots, et ils présentent nécessairement un certain nombre de traits communs, l’orage, le naufragé qui survit seul à tout un équipage, l’île habitée par des monstres parlants,le retour inespéré avec une cargaison de richesses. Celui qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, a, par métier, la critique lâche et l’imagination inépuisable : à peine s’est-il échappé du cercle où la vie ordinaire de ses auditeurs se meut, qu’il se lance à pleines voiles dans le pays des miracles. Le Livre des Merveilles de l’Inde[186], les Relations des marchands arabes[187], les Prairies d’or de Maçoudi apprendront aux curieux ce que des gens de bonne foi apercevaient à Java, en Chine, dans l’Inde, sur les côtes occidentales de l’Afrique, il y a quelques siècles à peine. Plusieurs des faits rapportés dans ces ouvrages ont été insérés tels quels dans les aventures de Sindbad ou dans les voyages surprenants du prince Séîf-el-molouk : les Mille et une Nuits ne sont pas ici plus mensongères que les histoires sérieuses du moyen âge musulman. Aussi bien le bourgeois du Caire qui écrivit les sept voyages de Sindbad n’avait-il pas besoin d’en emprunter les données à un conte antérieur : il n’avait qu’à lire les auteurs les plus graves ou qu’à écouter les matelots et les marchands revenus de loin, pour y recueillir à foison la matière de ses romans. L’Égypte ancienne n’aurait eu rien à envier de ce chef à la moderne. Le scribe, à qui nous devons le conte de Saint-Pétersbourg, avait les capitaines au long cours de son temps pour garant -des balivernes étonnantes qu’il débitait. Dès la V8 dynastie, et plus tôt même, on naviguait sur la mer Rouge jusqu’aux Pays des Aromates, sur la mer Méditerranée jusqu’aux îles de la côte asiatique : les noms géographiques épars dans le récit indiquent que le héros dirige son voyage vers le sud. Il se rend aux mines de Pharaon : l’autobiographie très authentique d’Amoni-Amenemhait nous apprend qu’elles étaient situées en Éthiopie, dans la région de l’Etbaye actuelle, et qu’on les atteignait par la voie du Nil. Aussi le naufragé a-t-il soin de nous informer qu’après être parvenu à l’extrémité du pays des Ouaouaîtou, au sud de la Nubie, il a passé devant Sanmouît, c’est-à-dire devant l’île de Bîgéh, à la première cataracte. Il a remonté le Nil, il est entré dans la mer, où une longue navigation a mené son navire jusque dans le voisinage du Pouanît, puis il est revenu en Thébaïde par la même voie[188]. Un lecteur d’aujourd’hui ne comprend plus rien à cette façon de procéder : il suffit cependant de consulter quelque carte du XVIe et du XVIIe siècle pour se représenter ce que le scribe égyptien a voulu dire. Le centre de l’Afrique y est occupé par un grand lac d’où sortent, d’un côté le Congo et le Zambèze, de l’autre le Nil[189]. Les géographes alexandrins ne doutaient pas que l’Astapus et l’Astaboras, le Nil bleu et le Tacazzé, ne poussassent vers l’est des bras qui établissaient la communication avec la mer Rouge[190]. Les marchands arabes du moyen âge croyaient qu’en suivant le Nil on gagnait le pays des Zindjes, après quoi l’on débouchait dans l’océan Indien[191]. Hérodote et ses contemporains dérivaient le Nil du fleuve Océan[192]. Arabes ou Grecs, ils n’avaient pas inventé cette conception : ils répétaient la tradition égyptienne. Celle-ci à son tour a peut-être des fondements plus sérieux qu’on ne serait porté à lui en prêter de prime abord. La plaine basse et marécageuse où le Bahr el-Abiad s’unit aujourd’hui au Sobat et au Bahr-el-Ghazâl était jadis un lac plus grand que le Nyanza Kéréwé de nos jours. Les alluvions l’ont comblé peu à peu, à l’exception d’un creux plus profond que le reste, qu’on appelle le Birket-Nou et qui se colmate de jour en jour[193], mais il devait encore être assez vaste au XVIe ou XVIIe siècle avant notre ère pour donner aux soldats et aux bateliers égyptiens l’idée d’une véritable mer ouverte sur l’Océan Indien. L’île où notre héros abordé a-t-elle donc quelque droit à figurer dans une géographie sérieuse du monde égyptien ? On nous la dépeint comme un séjour fantastique dont il n’était pas donné à tous de trouver le chemin. Quiconque en sortait n’y pouvait plus rentrer : elle se résolvait en vagues et elle s’enfonçait sous les flots. C’est un prototype lointain de ces terres enchantées, l’île de Saint-Brandan par exemple, que les marins de notre moyen âge apercevaient parfois parmi les brumes de l’horizon et qui s’évanouissaient quand on voulait en approcher. Le nom qu’elle porte est des plus significatifs à cet égard ; c’est Ile de double qu’elle s’appelle[194]. J’ai déjà dit tant de fois ce qu’était le double[195], que j’hésite à en parler une fois de plus. En deux mots, le double est l’âme qui survit au corps et qu’il faut habiller, loger, nourrir dans l’autre monde : une île de double est donc une île où l’âme des morts habite, une sorte de paradis analogue aux Iles Fortunées de l’antiquité classique. Les géographes de l’époque alexandrine la connaissaient, et c’est d’après eux que Pline[196] indique, dans la mer Rouge, une île des Morts, non loin de l’île Topazôn, qui se cache dans les brouillards[197] de la même manière que l’île du Double se dissimule au creux des vagues. Elle n’était même que le reste d’une terre plus grande, une Terre des Doubles que les Égyptiens de l’empire memphite plaçaient au voisinage du Pouanît et de la région des Aromates[198]. Le serpent qui la gouverne est-il lui-même un double ou le surveillant de la demeure des doubles ? Je pencherais d’autant plus volontiers vers cette seconde explication que, dans tous les livres sacrés, au Livre des morts, au Livre de savoir ce qu’il y a dans le monde de la nuit, la garde des endroits où les âmes vivent est confiée le plus souvent à des serpents d’espèces diverses. Les doubles étaient trop ténus pour que l’œil d’un vivant ordinaire les aperçût ; aussi n’en est-il pas question dans le conte de Saint-Pétersbourg. Le gardien était pétri d’une manière plus solide, et c’est pourquoi le naufragé entre en relations avec lui. Lucien, dans son Histoire véritable, n’y met pas tant de façons : à peine débarqué dans les Champs-Élysées, il lie commerce d’amitié avec les mânes et il fréquente les héros d’Homère. C’était afin de mieux se moquer des romans maritimes de son temps ; le scribe égyptien, qui croyait à l’existence des îles où résidaient les bienheureux, conformait les aventures de son héros aux règles de sa religion. N’était-ce pas en effet comme une pointe poussée dans le domaine de la théologie que ce voyage d’un simple matelot à l’Ile de Double ? Selon l’une des doctrines les plus répandues, l’Égyptien, une fois mort, ne joignait l’autre monde qu’à la condition d’entreprendre une longue traversée. Il s’embarquait sur le Nil, au jour même de l’enterrement, et il se rendait à l’ouest d’Abydos, où le canal osiriaque le conduisait hors de notre terre[199]. Les monuments nous le montrent dirigeant lui-même son navire et voguant à pleines voiles sur la mer mystérieuse d’Occident, mais sans nous dire quel était le but de sa course. On savait bien d’une manière générale qu’il finissait par aborder au pays qui mêle les hommes[200], et qu’il y menait une existence analogue à son existence terrestre ; mais on n’avait que des notions contradictoires sur l’emplacement de ce pays. La croyance à la mer d’Occident est-elle une simple conception mythologique ? Faut-il y voir un souvenir inconscient de l’époque très reculée à laquelle les bas-fonds du désert libyen, ce qu’on appelle aujourd’hui les Bahr-belâ-mâ, les fleuves sans eau, n’étaient pas encore asséchés et formaient en avant de la vallée une barrière de lacs et de marais ? Quoi que l’on pense de ces questions, il me paraît certain qu’il y a entre le voyage du matelot à l’Ile de double et la croisière du mort sur la mer d’Occident des rapports indiscutables. Le conte de Saint-Pétersbourg n’est guère que la transformation en donnée romanesque d’une donnée théologique. Il nous fournit le premier en date de ces récits où l’imagination populaire s’est complu à représenter un vivant admis impunément chez les morts : c’est, à ce titre, un ancêtre très éloigné de la Divine Comédie. La conception première en est-elle égyptienne ? Si par hasard elle ne l’était pas, il faudrait avouer au moins que la manière dont elle a été traitée est conforme de tout point aux sentiments et aux mœurs du peuple égyptien. L’avenir nous rendra sans doute d’autres débris de cette littérature romanesque. Plusieurs sont sortis de terre depuis la première édition de ce livre, et j’en sais d’autres qui sont cachés dans des musées de l’étranger ou dans des collections particulières dont l’accès ne m’a pas été permis. Les publications et les découvertes nouvelles nous forceront-elles à revenir sur les conclusions qu’on peut tirer de l’examen des fragments connus jusqu’à ce jour ? Un égyptologue parlant en faveur de l’Égypte est toujours suspect de plaider pour sa maison : il y a cependant quelques propositions que je pense pouvoir énoncer sans encourir le reproche de partialité. Un premier point que nul ne contestera, c’est que les versions égyptiennes sont parfois beaucoup plus anciennes que celles des autres peuples. Les manuscrits qui nous ont conservé le Conte des deux Frères et la Querelle d’Apôpi et de Sagnounrî, sont du XIVe ou du XIIIe siècle avant notre ère. Le Naufragé, le Conte fantastique de Berlin, les Mémoires de Sinouhît ont été écrits plusieurs centaines d’années plus tôt. Encore ne sont-ce là que des dates a minima, car les papyrus que nous avons sont la copie de papyrus plus anciens. L’Inde n’a rien qui remonte à pareille antiquité, et la Chaldée qui, seule parmi les contrées du monde classique, possède des monuments contemporains de ceux de l’Égypte, ne nous a pas livré encore un seul roman. En second lieu, l’étude sommaire que j’achève en ce moment aura suffi, je l’espère, à convaincre le lecteur de la fidélité avec laquelle les contes dépeignent les mœurs de l’Égypte. Tout y est égyptien du commencement jusqu’à la fin, et les détails même qu’on a indiqués comme étant de provenance étrangère nous apparaissent purement indigènes, quand on les examine de près. Non seulement les vivants, mais les morts, ont la tournure particulière au peuple du Nil, et ils ne sauraient être confondus en aucune façon avec les vivants et les morts d’un autre peuple. Je conclus de ces faits qu’il faut considérer l’Égypte, sinon comme un des pays d’origine des contes populaires, au moins comme un de ceux où ils se sont naturalisés le plus anciennement et où ils ont pris le plus tôt une forme vraiment littéraire. Je m’assure que de plus autorisés souscriront à cette conclusion. |
||||