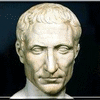JULES CÉSAR EN GAULE
TOME PREMIER
INTRODUCTION.
|
Aujourd'hui que, grâce à l’imprimerie et aux communications internationales, les documents historiques s’inscrivent, pour ainsi dire, sur toute la surface du globe et chez tous les peuples simultanément ; aujourd'hui que les géographes ont décrit avec précision presque toutes les contrées de la terre, l’on peut dire que l'histoire universelle repose désormais sur une base certaine et équitable. Ainsi, de nos jours, quel que puisse être l’intérêt d'un peuple en particulier à présenter, par exemple, un événement de guerre sous un aspect infidèle, la vérité percera l’artifice. En effet, après que les passions du moment se seront éteintes, un historien qui prendra la peine et le temps de consulter les documents des deux nations belligérantes et d'examiner les conditions du terrain, pourra toujours discerner clairement le fait vrai et en transmettre la connaissance à la postérité. Il n'en est pas de même au sujet de l’histoire ancienne. Non-seulement l’erreur a pu s'y introduire faute de documents suffisants, mais encore l’on est fondé à la considérer généralement comme viciée jusqu'il un certain point par l'intérêt national, en bien ou en mal, avec intention, et au sujet de tous les peuples. En effet, les historiens, soit latins, soit grecs, ont dû, faute de contrôle étranger, présenter les événements chacun à l'honneur de la nation pour laquelle il écrivait, et tous de même, au détriment des barbares, comme ils appelaient tous les autres peuples en général. D'où l'indispensable nécessité de faire la critique de l'histoire ancienne, pour y bien discerner la vérité : vérité qu'il nous importe beaucoup de connaître, à nous dont les aïeux sont du nombre de ces barbares, à l'égard desquels les historiens anciens n'avaient à conserver aucun ménagement. Rome a présenté dans l'histoire ce fait unique d'une petite ville qui, dans l'espace de sept siècles, est parvenue à étendre son empire sur tout l'ancien monde connu, de manière à devenir la ville de tous, Urbs. Il en est résulté que, même de nos jours, les Romains possèdent encore, pour ainsi dire, le monopole de l'histoire ancienne. En effet, les historiens romains (et nous devons considérer comme tels tous les auteurs anciens, latins ou grecs, qui ont écrit l’histoire de l’empire romain, c'est-à-dire de presque tout l'ancien monde) ont parlé des barbares pour faire connaître, non l’histoire de ces peuples, mais bien les actes des Romains chez tous ces peuples, gesta Romanorum. Or, s'il est vrai que la flatterie naisse spontanément parmi les hommes partout où brillent les richesses et la puissance, il a dû s'en montrer beaucoup autour du peuple-roi ; et en effet, les historiens romains ne la lui ont point épargnée. De sorte que, aujourd'hui, beaucoup d'autres peuples qui jouent un rôle important sur la terre, les descendants des Gaulois, des Bretons, des Germains, des Espagnols, ne peuvent retrouver l'histoire de leurs aïeux que dans les livres des historiens romains, parfois môme sous les flatteries légendaires adressées au peuple-roi. Par conséquent, ces diverses autres nations ne peuvent plus désormais se présenter devant la justice de l'histoire universelle qu'avec des titres de leurs aïeux plus ou moins viciés à leur détriment et en l'honneur du peuple romain. Et ce que l’on dit ici de toutes les races barbares est vrai surtout pour la race gauloise, qui se trouve, à ce point de vue, sous le poids de trois circonstances aggravantes : 1° L'an de Rome 364, les Gaulois qui s'étaient précédemment
établis dans 2° Vercingétorix a fait éprouver un échec à Jules César devant Gergovia ; les Commentaires l'indiquent positivement ; mais Vercingétorix paraît avoir inquiété beaucoup plus gravement César, et lui avoir fait obstacle dans tous ses projets avec bien plus d'énergie et de succès qu’on ne l'a cru jusqu'à ce jour, comme nous espérons le démontrer. Or, si en effet ce jeune barbare a été très-redoutable à ce grand Romain, mûri dans la science et la pratique militaires, le récit des événements de la guerre de Gaule devra sans doute être composé dans les Commentaires avec beaucoup d'art, et il nous faudra, pour ainsi dire, regarder sous tous les mots ; car César est un profond politique, un habile écrivain, et nul guerrier ne doit pouvoir lui être comparé. 3° César revint de la guerre de Gaule démesurément grandi aux yeux des peuples de l'Italie ; sa gloire, des lors, inspira tant d'admiration ou de terreur, qu'il put impunément violer les lois de sa patrie, aspirer à la royauté dans une prodigieuse république[2], dire publiquement à Rome, lui, consul : La république n'est qu'un vain nom, sans corps ni objet... Redemande-moi donc la république, tribun Aquila ![3] qu'il put enfin substituer au gouvernement national des Romains, lequel durant quatre siècles et demi avait augmenté leur puissance et leur territoire, son gouvernement personnel, l'empire des Césars, où la décadence allait être une suite naturelle de l'exemple donné et du succès obtenu. Les projets ambitieux de Jules César exigeaient donc que le récit de la guerre de Gaule le couvrît de gloire. Aussi, et sans doute dans cet intérêt, non pour l’honneur de nos aïeux, a-t-il jugé à propos de rédiger lui-même les Commentaires sur la guerre de Gaule, comme il a rédigé encore lui-même les Commentaires sur la guerre civile contre Pompée. Cela, néanmoins, a valu à nos aïeux la faveur unique parmi tous les peuples barbares, que Jules César, un des plus grands écrivains de Rome, se soit chargé d'écrire l’histoire des sept premières années de la guerre qu'ils ont soutenue contre lui, et de l'écrire avec beaucoup de soin. Cela nous a valu, à nous-mêmes, un moyen exceptionnel, fort beau et plein d'intérêt, de mieux connaître nos aïeux. Toutefois aussi, la partie capitale de l'œuvre de César,
ce qui concerne l’insurrection générale des cités gauloises à la voix de
Vercingétorix, la septième année de la guerre, présente des difficultés tout
à fait exceptionnelles. Le chef gaulois, môme tel que César nous le montre, y
apparaît, quand l’on l'examine bien, comme une grande figure historique, au
triple point de vue moral, politique et militaire : c'est un véritable émule
du génie de Rome. Leur lutte commence au cœur de l'hiver et ne se termine
qu'en automne, par la catastrophe d'Alésia. De ce jour, Des hommes plus autorisés que nous en pareille matière, mais sans doute moins résignés au labeur patient des textes, et peut-être aussi manquant d'une carte des Gaules suffisamment exacte, se sont contentés d'émettre quelques aperçus sommaires au sujet de ces événements, qu'il est si important de bien connaître jusque dans les moindres détails. Pour oser nous-même entreprendre ici de les expliquer, nous avons besoin d'apporter dans notre explication beaucoup de méthode, et de nous aider de tous les moyens utiles. Ainsi, nous espérons que le lecteur, à raison de l'importance et de la difficulté du sujet, en faveur de la nouveauté des opinions que nous allons émettre et du travail qu'elles nous ont coûté, voudra bien s'arrêter un peu avec nous à des considérations générales de plusieurs sortes, qui nous paraissent indispensables pour la clarté dans la discussion du récit de César. Nous osons même dire qu'en certains points elles offrent de l’intérêt pour toute l'histoire ancienne. |