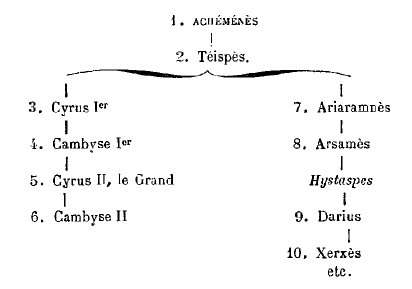LES MÈDES ET LES PERSES
CHAPITRE III — CYRUS ET LA CONQUÊTE PERSE[1].
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — LES PERSES AVANT CYRUS La patrie originaire des Perses est la province montagneuse qui porte encore de nos jours le nom de Farsistan, c’est-à-dire l’habitation des Fars, des Perses, nation qui constituait le rameau le plus pur de la migration iranienne. Ce pays, borné à l’ouest par la Susiane, au nord et à l’est par le désert de Khaver et le birman, s’étendait sur la côte du golfe Persique à peu près entre les villes modernes de Bouchir et de Bender-Abassy. Au point de vue climatérique, il se divise en trois zones bien tranchées : au nord, ce sont des montagnes formant un plateau glacé, mais toutefois non partout rebelle à la culture ; dans la région moyenne se développent en amphithéâtre sur les pentes du plateau, de fertiles vallées où l’on cultive toutes les céréales et oit paissent aujourd’hui de nombreux troupeaux ; les orangers et les oliviers y croissent en pleine terre, tandis qu’à quelques lieues au nord on rencontre des neiges éternelles ; dans le sud, enfin, c’est un soleil torride, une nature morte, sans végétation et sans eau potable, riche en reptiles et en marais pestilentiels. C’est dans la région du nord et du centre que se cantonnèrent les tribus persiques arrivant de la Bactriane. Séparés de leurs frères Iraniens, longtemps les Perses restèrent nomades, à demi barbares, et durent à leur genre de vie et à leur climat souvent rigoureux, la vigueur indomptable qui les animait. Ils étaient encore en partie nomades sous Cyrus, et ce prince savait bien tout ce que devait son peuple à un sol ingrat, à un ciel qui n’est pas toujours clément, lorsqu’il représentait à ses compagnons que la mollesse des peuples ne venait que de la douceur de leur climat et des richesses de leur terre. Aussi un certain Artembarès — autre que celui dont il a été plus haut question, — ayant voulu persuader à ses compatriotes d’échanger leur pays petit et montagneux pour une contrée plus vaste et meilleure, Cyrus combattit énergiquement sa proposition. Les contrées les plus délicieuses, dit-il, ne produisent ordinairement que des hommes mous et efféminés, et la même terre qui porte les plus beaux fruits n’engendre point des hommes belliqueux. Les Perses, ajoute Hérodote, convaincus que le sentiment de Cyrus était le meilleur, préférèrent un pays incommode avec l’empire, à un site excellent avec l’esclavage. Ils se bâtirent dans cette contrée de leur choix différentes villes dont les plus importantes furent Persépolis, Parsagade et Karmana dans les montagnes, Ormuzd, Sisidona, Agrostana et Taoké sur le bord du golfe Persique. Les Perses se divisaient en dix tribus et en trois classes sociales. Les tribus des Pasargadiens — ou plus exactement Parsagadiens, de la ville de Parçauvâdâ, la forteresse des Perses, appelée par les Grecs Parsagade — des Maraphiens et des Maspiens, formaient l’aristocratie des guerriers. Les Parsagadiens l’emportaient sur tous les autres et formèrent la tribu royale sous les Achéménides. Les Panthialéens, les Déruséens, les Germanicus étaient les cultivateurs ; les Daëns, les Mardes, les Dropiques et les Sagartiens, des pasteurs errants. Les voyageurs modernes retrouvent encore quelque chose de ces vieilles traditions dans les montagnes du Parsistan. Dans la vie simple et agreste qu’ils menaient, les Perses avaient conservé toute l’énergie de leurs mœurs primitives ; aussi le jour où, réunis sous la main d’un seul chef vaillant et habile, ils se trouvèrent en présence des Mèdes, déjà amollis et énervés par la civilisation, ils triomphèrent sans beaucoup de peine, et en un petit nombre d’années se rendirent maîtres de toute l’Asie. De cinq à vingt ans, dit Hérodote, on apprend trois choses aux jeunes Perses : à monter à cheval, à tirer de l’arc et à dire la vérité. Ces quelques mots, en révélant quelle était alors l’éducation toute guerrière et inspirée des plus nobles préceptes de la doctrine mazdéenne, que recevait la nation, infidèle plus tard à ces austères et saines traditions, expliquent ses rapides et prodigieux succès. Les Perses, avec les Bactriens, étaient, de tous les peuples de l’Iran, ceux qui avaient conservé la religion zoroastrienne dans sa plus grande pureté. La vie de morcellement et d’indépendance cantonale que nous avons montrée plus haut comme l’état normal et primitif des Iraniens, demeura eu pleine vigueur chez eux jusqu’au temps de Cyrus. Ce fut par la libre délibération de l’assemblée des grands que celui-ci fut élu roi de toute la nation. Même encore plus tard, au temps du plus brillant éclat et de la plus grande puissance de l’empire perse, il resta quelque chose de ces formes antiques, de cet esprit d’indépendance et de liberté. La nature du gouvernement et de l’autorité du grand roi était toute différente dans les provinces de son empire et dans la Perse proprement dite. Partout ailleurs il était le pur souverain asiatique, absolu, sans contrôle, presque dieu ; en Perse, il n’était que le chef d’un peuple libre. Les Perses n’étaient soumis à aucun impôt. Le roi n’avait pas le droit de prononcer contre l’un d’eux un arrêt de mort pour une faute unique et sans observer des formes préservatrices de la justice. C’étaient leurs lésions belliqueuses et endurcies dans la vie des montagnes qui formaient la vraie force militaire de l’armée. Mais le roi ne pouvait pas les faire marcher absolument suivant son caprice : il fallait que les chefs de tribus eussent accepté son projet de guerre. Dans toutes les occasions solennelles, le monarque, dont un seul signe était un ordre pour les autres nations courbées sous son sceptre, réunissait autour de lui, avant de prendre sa décision, les principaux parmi les Perses proprement dits, regardés presque comme ses égaux. C’étaient comme les leudes autour de nos rois mérovingiens. C’est ainsi qu’Hérodote, toujours si bien informé et si exact, nous fait voir la déclaration de guerre de Darius aux Grecs précédée d’une mûre délibération de cette assemblée de seigneurs, où chacun exprime son avis avec une entière liberté. Et la connaissance d’un tel fait était si bien établie dans la Grèce, qu’un célèbre vase peint du Musée de Naples retrace, avec les noms des personnages, la scène de cette délibération. Ce n’est que plus tard, postérieurement à Xerxès, que ces derniers restes de vie libre disparurent, quand la nation perse fut amollie et corrompue elle-même parles richesses et par le contact de la corruption des peuples qu’elle avait vaincus. Alors, le pouvoir du grand roi devint, dans la Perse, le même que dans le reste de l’empire, et les descendants des libres compagnons de Cyrus s’abaissèrent sous le joug d’un despotisme sans limites. Nous avons vu que les deux tronçons du rameau iranien, les Mèdes et les Perses, avaient suivi séparément le cours de leurs destinées après leur installation dans leurs pays respectifs d’adoption ; la légende elle-même les perd de vue après le règne de ce Gustasp ou Hystaspe, contemporain de Zoroastre, donné comme un des derniers princes de la dynastie des Kéaniens ou Géants. Cependant, l’histoire positive ne tarde pas à reprendre ses droits chez les Perses proprement dits. Comme les Mèdes, ils vivaient primitivement en tribus indépendantes, et deux des chefs des tribus les plus rapprochées de la Susiane, Tissapherne et Hypherne furent battus par le roi d’Assyrie Assarhaddon. Mais les Perses substituèrent bientôt une monarchie à ce morcellement fédératif. Le premier de leurs rois nationaux fut Achéménès, de la tribu des Parsagadiens, le fondateur de la dynastie des Achéménides. L’occasion de ce groupement en corps de nation sous un chef unique parait avoir été l’invasion de Phraorte, roi des Mèdes, que les Perses, malgré tout, ne réussirent pas à repousser et dont ils durent accepter le joug. Achéménès et ses successeurs, jusqu’à Cyrus le Grand, ne cessèrent pas de reconnaître la suzeraineté plus nominale qu’effective des rois Mèdes qui les méprisaient tellement que les plus nobles d’entre les Perses étaient considérés comme bien inférieurs aux Mèdes de condition médiocre. On ne sait rien sur Achéménès ni sur ses successeurs immédiats dont la généalogie a récemment donné lieu à de vives controverses. Dans une inscription cunéiforme rédigée en assyrien par les scribes de la chancellerie de Cyrus après la prise de Babylone, ce prince dresse lui-même son arbre généalogique : Je suis Cyrus, dit-il, roi de la ville d’Ansan, fils de Cambyse, roi de la ville d’Ansan, petit-fils de Cyrus, roi de la ville d’Ansan, arrière petit-fils de Téispès, roi de la ville d’Ansan. C’est exactement la généalogie attribuée par Hérodote au vainqueur d’Astyage, conquérant de Babylone. D’autre part, dans l’inscription de Béhistoun, Darius s’exprime ainsi : Il y en eut huit de ma race qui furent rois avant moi ; je suis le neuvième, et ces neuf de nous, sommes rois en deux branches. Il semble donc qu’on puisse, en rapprochant ces textes, constituer comme il suit la généalogie des princes issus d’Achéménès :
Hystaspes, père de Darius, est le seul de ces princes qui n’ait pas régné ; il perdit son trône pendant la domination de Cyrus II le Grand, et Darius lui-même ne donne pas à son père le titre de roi. Ariaramnès et Arsamès, les premiers princes de la branche cadette, issue de Téispès, eurent en partage quelque canton de la Perse proprement dite, tandis Cyrus Ier et Cambyse Ier, et les autres rois de la branche aînée ; ont régné dans une ville qui porte dans les inscriptions le nom d’Ansan. Quelle était cette ville ? où était situé le royaume dont elle était la capitale ? Les textes assyriens mentionnent, à l’orient de la Chaldée, un pays dont on n’a pu, jusqu’à présent, déterminer la position précise, et dont on lisait autrefois le nom phonétiquement An-du-an. Or, une tablette bilingue contenant une liste de noms géographiques, indique que le mot Anduan doit se lire, en réalité, Assan, et cette tablette place en même temps cette ville dans l’Elymaïde ou la Susiane. La ville d’Ansan (ou d’Assan) paraît donc avoir fait partie du pays d’Elam à l’époque assyrienne, ou en avoir été limitrophe. Une inscription assyrienne relative à des présages, parle d’un roi d’Ansan et de Subartu ; or, on a, depuis longtemps, reconnu que le pays de Subartu formait une portion de la Susiane, assez fréquemment mentionnée dans les textes assyriens ; le pays d’Ansan devait en être voisin. Il est curieux de constater qu’un historien arabe qui a recueilli les anciennes traditions de la Perse, Ibn-el-Nadin, raconte que Djemschid, l’un des fondateurs de la dynastie héroïque des Pischdadiens, régnait à Ansan, non loin de Suse. Si la position géographique de la ville d’Ansan n’est pas encore nettement déterminée, on peut donc, avec une certitude presque entière, placer cette première capitale des Achéménides à l’est de Suse, et croire qu’elle fut conquise par Téispès, roi des Perses, après que Suse, dont elle dépendait originairement, eut été détruite de fond en comble par Assurbanipal, roi d’Assyrie[2]. Ansan cessa d’être la capitale des Perses après que Cyrus eut ruiné la monarchie mède. Au lieu appelé actuellement Méched-Mourgad, sur le Polvar, M. Dieulafoy a reconnu les vestiges d’une ville achéménide bâtie par Cyrus : cette ville n’était autre que Parsagade. Là, en effet, se trouvent les soubassements d’un palais que le monarque perse se fit construire sur le lieu même où il avait vaincu Astyage ; là, on voit encore debout le bas-relief qui représente le jeune chef des Perses, la tête surmontée de l’uræus sacré et muni de quatre ailes, comme les génies des palais assyriens. A une courte distance de ces ruines s’élève un petit édifice, à demi ruiné, qui avait la forme d’une tour carrée, et qu’on suppose être le tombeau de Cambyse Ier, le père de Cyrus. Dans la même plaine, on remarque encore deux autres monuments, bâtis en grand et bel appareil, que les habitants modernes du pays appellent Takhte Madérè Soleiman, le trône de la mère de Salomon, et Gabrè Macléré Soleiman, le tombeau de la mère de Salomon. Le nom de Salomon, qui revient sans cesse dans le Coran, a été substitué partout à celui de Cyrus, inconnu des Persans modernes. § 2. — CYRUS ET LES PEUPLES ARYENS. La défaite d’Astyage et la conquête de la Médie avaient pour résultat de donner à Cyrus la souveraineté des pays dépendant de l’empire mède, et en particulier de toutes les nations aryennes situées en deçà de l’Hindou-Kousch et des déserts de la Carmanie. Le conquérant se hâta d’en rendre la soumission effective, œuvre qui ne lui donna pas beaucoup de peine, car toutes ces nations, sœurs de la sienne, se sentaient attirées de sympathie vers le jeune héros perse, et préféraient naturellement la suprématie d’un peuple de race iranienne pure, à celle des Mèdes, mélangés et pénétrés d’éléments étrangers. La Carmanie était une dépendance naturelle de la Perse ; Cyrus n’eut pas à la réduire, car toutes les vraisemblances semblent indiquer que ses tribus, ardemment mazdéennes, avaient pris part au premier soulèvement et marché contre Astyage avec les Perses. Les Bactriens, Ctésias nous l’atteste, se donnèrent spontanément, avec les habitants de la Sogdiane, de la Khorasmie, au sud de la mer d’Aral, et de la Margiane, qui dépendaient d’eux, au restaurateur de la religion de Zoroastre, dont leur pays avait été le berceau et demeurait l’un des principaux foyers. Pour maintenir ce pays en respect et le préserver des incursions touraniennes, Cyrus bâtit, vers l’un des gués de l’Iaxarte, une forteresse qu’il appela de son nom, Cyreskhata ou Cyropolis. La Parthie, enclavée entre la Médie et la Bactriane, n’osa pas résister et se soumit également sans combat. Pour assurer la tranquillité de la Bactriane, exposée aux fréquentes incursions et aux ravages des Touraniens Massagètes, Cyrus s’occupa de dompter les Saces, habitant autour des sources de l’Iaxarte. Ils furent vaincus et leur roi Amorgès fait prisonnier dans le combat. La reine Sparêthra, femme d’Amorgès, essaya de continuer la lutte, et elle parvint effectivement à délivrer sou mari en échangeant des prisonniers. Toutefois, le pays fut vite soumis ; les Saces se reconnurent tributaires, s’enrôlèrent même dans l’armée du vainqueur, et Cyrus fit de leur pays une satrapie de son empire. Il se tourna ensuite vers l’Hyrcanie, voisine de la mer Caspienne, dont les peuples, Caspiens, Panumathes et Darites, issus du sang de Touran et mêlés à quelques Aryas en minorité, faisaient mine de résister. Mais ils ne tinrent pas devant ses troupes, et voyant leur territoire envahi, ils reconnurent presque sans combattre la souveraineté du roi de Perse. Ayant assuré de cette façon sa domination dans le nord-est, Cyrus, avec la coopération de Tigrane, qui gagna dans cette guerre la possession d’un certain nombre de districts limitrophes de l’Arménie, entreprit la conquête des pays voisins du Caucase, qui étaient demeurés indépendants de la monarchie médique. Ici, la tache fut plus difficile et plus lente, à cause des obstacles qu’offraient à la fois et la configuration du pays et le caractère belliqueux des populations. Cependant le roi de Perse finit par y réussir ; après quelques années de guerres sanglantes et acharnées, l’Albanie et l’Ibérie, c’est-à-dire le Daghestan et la Géorgie actuels, dépendirent de 1a couronne du jeune conquérant. Les Colchidiens cédèrent à ses armes ; les nations des âpres montagnes qui longent le littoral du sud-est du Pont-Euxin, Mardes, Macrons, Chalybes, Tibaréniens, célèbres dans tout le monde antique pour leur industrie métallurgique remontant jusqu’aux âges les plus reculés et pour l’invention de l’acier, furent écrasées et réduites à l’obéissance. Cyrus se trouva ainsi maître de toute la partie de l’Asie qui s’étend jusqu’à la chaîne du Caucase. Il lui avait fallu quatorze ans pour accomplir ces conquêtes, dont nous ne connaissons que les traits généraux et dont aucun historien ne nous révèle les incidents. Ce fut au moment où le vainqueur d’Astyage venait de les terminer qu’éclata entre lui et Crésus, roi de Lydie, la guerre qui devait le mettre en possession de l’Asie Mineure tout entière, jusqu’aux rivages de la mer Egée. Mais avant d’entreprendre le récit de cette guerre, il est nécessaire de placer ici quelques détails sur les diverses populations de l’Asie-Mineure et sur l’histoire du royaume de Lydie. Dès cette époque, l’empire de Cyrus englobe les immenses régions comprises entre le golfe Persique, au sud, l’Iaxarte, la mer d’Aral, la mer Caspienne, le Caucase et le Pont-Euxin, au nord. Le cours de l’Halys et celui de l’Euphrate, dans sa partie supérieure, en forment la limite occidentale. Il ne va pas tarder à s’étendre sur la Chaldée et sur toute l’Asie-Mineure ; Cyrus tentera même, à l’orient, de s’approcher des bords de l’Indus. § 3. — LES POPULATIONS DE L’ASIE-MINEURE L’Asie-Mineure ou petite Asie, est cette péninsule qui s’avance comme un immense promontoire entre le Pont-Euxin et la mer de Chypre, refoulant devant elle les flots de la mer Égée. C’est un Iran en miniature qui se dresse au milieu de trois mers, formant un plateau d’un seul bloc, inaccessible, sur lequel on respire un air froid et sec, couvert, çà et là, de plaines pierreuses et arides, mais aussi de terrains fertiles capables de nourrir de fortes et puissantes races[3]. La chaîne du Taurus, avec ses crêtes taillées à pic, répand sur les côtes méridionales du plateau de nombreux contreforts, repaire de populations insaisissables et toujours prêtes à descendre sur la mer et les plaines qui s’étendent à leurs pieds, pour piller les marchands et les laboureurs. Cette région forme, de l’ouest à l’est, la Carie, la Lycie, la Pamphylie et la Cilicie, dont les pentes rapides s’inclinent au sud vers la mer ; la côte est déchirée, dans ces parages, par des torrents qui tombent des sommets montagneux et ne sont guère propres à la navigation. Seuls le Pyramus et le Sarus, en Cilicie, ont su, dans les temps géologiques, déposer à leur embouchure des terres d’alluvion à travers lesquelles ils se sont plus tard tracé un cours paisible et navigable. La Pisidie, l’Isaurie et la Lycaonie, au sommet du plateau, ne sont sillonnées que par des cours d’eau sans importance qui finissent dans des marais ou des lacs salés dont l’étendue varie suivant les saisons. A l’ouest, la côte, profondément dentelée, est, sillonnée de nombreux fleuves qui, dit-on, charriaient de l’or en abondance et qui se promènent en oisifs dans des vallées larges et fertiles. Ce sont le Caïque, l’Hermus, le Caystre, le Méandre, qui arrosent la Troade, la Mysie, l’Éolide, l’Ionie, la Doride, la Lydie et en faisaient, jadis, des contrées d’une étonnante fertilité agricole, d’une activité commerciale peu commune. En face de la côte méridionale, nous ne trouvons que deux grandes îles, Rhodes et Chypre. Au large de la côte de l’ouest, s’étend tout un labyrinthe d’îles gracieuses, Cos, Lemnos, Chios, Samos et les Sporades. Au nord, vers le Pont-Euxin qui communique avec la mer Égée par les deux détroits successifs de l’Hellespont et du Bosphore de Thrace, sont la Mysie, la Bithynie, la Paphlagonie et le Pont. Ces régions sont parcourues par trois grands fleuves, l’Iris, l’Halys et le Sangarius, qui se frayent un chemin à travers les gorges d’une chaîne de montagne qui s’allonge en ligne droite depuis le Caucase jusqu’au Bosphore. Au centre du plateau, enfin, nous rencontrons la Phrygie et la Cappadoce, le premier de ces pays, célèbre pour ses verdoyantes prairies, ses vignobles et ses riches moissons ; le second, arrosé principalement par l’Halys, le plus grand des fleuves de l’Asie-Mineure. Vers les sources de l’Halys et de l’Euphrate, la péninsule se rattache au plateau de l’Arménie et aux contreforts du Caucase, pays habités par des populations que les Assyriens englobent sous le nom générique de Naïri et dans lesquelles nous reconnaissons, d’après les sources classiques, outre les Arméniens et les Alarodiens dont nous avons retracé l’histoire, les Ibères, les Colchiens et les Chalybes qui fournissaient le fer, l’étain et les métaux précieux aux Asiatiques. Sur lès confins de l’Arménie et de la Cappadoce, sont les peuples que la Bible appelle Tubal et Meschek, dont le nom revient si souvent sous la forme de Tabal et de Muskai dans les inscriptions cunéiformes ; leurs capitales étaient Kumanu et Mazaca, villes qui, dans l’antiquité classique, sont devenues Comana et Cæsarea. Dans toute l’Asie-Mineure, on a signalé des souvenirs relatifs aux Lélèges qui finirent par s’assimiler aux populations diverses qui les subjuguèrent ; on rencontre aussi, presque partout, des monuments qui se rapportent aux Héthéens ou Hittites, qui avaient le centre de leur domination en Syrie et dont nous retracerons l’histoire dans une autre partie de cet ouvrage. Ce peuple paraît avoir appartenu à la race chananéenne et sa domination en Asie-Mineure est, comme celle des Lélèges, antérieure à l’histoire documentaire. Les Cappadociens, les Ciliciens, les Pamphyliens et les Solymes, habitants des montagnes de la Lycie, se rattachaient à la race sémitique et à la branche araméenne. Les Lydiens seraient aussi des Sémites, s’ils sont issus de Lud, le fils de Sem, mais cette origine leur est contestée ; les Cariens étaient, comme les Lélèges, de race mêlée, mais en grande partie chananéenne ; ils parlaient un jargon incompréhensible pour leurs voisins ; les autres peuples de l’Anatolie, Phrygiens, Mysiens, Paphlagoniens, Bithyniens, sont au contraire de race indo-européenne et apparentés de très près aux Thraces d’Europe. On dirait que, dans leurs migrations vers l’Occident, toutes les races du monde se sont trouvées acculées dans la péninsule où elles s’étaient engagées comme dans un filet ; le trop-plein seul déborda et risqua les chances de la mer. Les Lyciens, qui parlaient une langue apparentée au grec, étaient surtout un peuple navigateur ; ils passaient pour les premiers marins de la mer de Chypre et de la mer Égée et ne craignaient pas les pirates égyptiens. Bien qu’issus de trois races différentes, les Cariens, les Lydiens et les Mysiens, juxtaposés dans un étroit territoire, s’étaient assez mêlés, avaient noué des relations assez étroites pour oublier les rivalités qui avaient dû exister entre eux au moment de leur établissement, et pour se forger des fables généalogiques qui leur attribuaient une même origine et une très proche parenté. Ils offraient en commun, dans la ville de Mylasa, des sacrifices à Zeus Carios, qui établissaient entre eux un lien religieux et presque national. Cependant les Cauniens, bien qu’ils parlassent la même langue que les Cariens, n’y prenaient point part. Dans la partie septentrionale de l’Asie-Mineure, les Bithyniens, les Mariandyniens et les Paphlagoniens formaient un groupe particulièrement compacte et dont l’origine thrace se révélait par les signes les plus frappants, car on retrouvait chez les populations des deux rives du Bosphore, non seulement même langue, mais mêmes mœurs et l’amour de la guerre, du sang et du pillage. Les Phrygiens et les Mysiens leur étaient apparentés d’assez près. Les Phrygiens, appelés Bryges en Europe, quand ils habitaient au pied du mont Bermion, et dont le nom signifiait, dit-on, dans leur propre langue, hommes libres, les Thraces de Bithynie et les Mysiens, venus, suivant Strabon, de la contrée que les Romains appelèrent Mœsie, au bord du Danube, sont représentés par la plupart des écrit vains antiques comme des émigrants ayant passé d’Europe en Asie[4]. L’historien Xanthus de Lydie plaçait l’arrivée des Phrygiens en Asie-Mineure après la guerre de Troie. Hérodote renverse cette tradition et parle d’un corps nombreux de Teucriens et de Mysiens qui, avant cette guerre, auraient émigré d’Asie en Europe, où ils se seraient avancés jusqu’au Pénée, refoulant devant eux les Thraces, qui franchirent alors le Bosphore et s’établirent en Bithynie. Plusieurs légendes identiques se retrouvaient à la fois en Europe et en Asie : celle de Midas, par exemple, en Phrygie et en Macédoine auprès du mont Bermion. Les Bébryces ont aussi laissé des traces en Macédoine, sur les bords du Strymon, où ils habitaient avant de venir se fixer à côté des Bithyniens sur la rive asiatique du Bosphore. De ces faits résultent la parenté de ces peuples, les antiques rapports de la Thrace et de l’Asie-Mineure et par suite de la Grèce et de l’Asie, bien avant l’époque, pourtant ancienne déjà, où l’invasion des Doriens en Grèce chassa les Ioniens et les Eoliens qui vinrent couvrir de leurs cités toutes les côtes de la Lydie et de la Mysie, séparant désormais ces nations indigènes de la mer. La Troade homérique embrassait toute la partie de l’Asie-Mineure comprise entre le Caïque et l’Æsepus ; elle confinait à la Mysie et à la Phrygie. Le mont Ida, dont le sommet le plus élevé atteint 1.769 mètres d’altitude, couvre ce pays de nombreux contreforts qui séparent divers cours d’eau, parmi lesquels les plus célèbres sont le Granique, le Scamandre, le Simoïs. Les premiers habitants de Troie, les Teucriens, paraissent être venus de l’île de Crète. Leur roi Teucer adopta Dardanus, fils de Jupiter, qui donna son nom à la contrée. Homère représente la Troade comme habitée par des populations non helléniques ; et le premier document historique qui mentionne l’empire de Troie est le fameux poème égyptien de Pen-ta-our, dont nous avons parlé dans un autre chapitre. Ce texte mentionne, on s’en souvient, sous le règne de Rhamsès II (fin du XVe siècle av. J.-C.), les Dardani d’Iluna (Ilion), à côté des Léka (Lyciens), des Masa (Mvsiens) et des Akérit (Cariens), parmi les peuplades de l’Asie-Mineure qui vinrent au secours des Hittites, assiégés par l’armée égyptienne dans leur ville de Kadesh, sur l’Oronte. Ilion ou Troie fut bâtie sur un rocher à pic, dominant le cours tortueux du Scamandre, par Ilus, qui eut pour fils Laomédon, père de Priam. Les ruines de cette ville célèbre se trouvent, selon M. Schliemann, sur la colline actuelle d’Hissarlik, et au-dessous des débris de l’Ilion des âges macédonien et romain, l’intrépide explorateur a retrouvé les débris d’une civilisation originale, n’ayant rien d’hellénique et même paraissant n’avoir point subi l’influence des grandes civilisations de l’Assyrie ou de l’Égypte. Le peuple, qui a laissé ces vestiges de son existence, était fort barbare encore et peu éloigné de l’âge de la pierre. La pierre polie et assez finement travaillée formait, avec les os taillés, la majeure partie de ses armes et de ses outils ; cependant, il travaillait aussi les métaux et il employait des armes et des outils en bronze en concurrence avec ceux de pierre et de silex. On a pu constater que ces objets étaient ouvrés sur place et qu’on avait affaire à un peuple métallurgiste qui mettait en œuvre, par le moyen de la fonte, le cuivre, l’or, l’argent et l’électrum, alliage d’or et d’argent, que donnaient naturellement les lavages des sables de certaines rivières de la Lydie. Il fondait aussi le plomb ; mais il ne connaissait pas le fer. C’était en même temps un peuple agriculteur, qui employait déjà la meule de deux pierres emboîtées pour moudre son grain. L’étain, qu’il connaissait, lui venait soit du Caucase, soit de la Crète ; l’or et l’argent, qu’il employait dans une proportion étonnante pour la fabrication de la vaisselle, des bijoux, des colliers, des boucles d’oreilles, étaient des produits du pays, qui touche presque, d’ailleurs, à la vallée du Pactole. La poterie troyenne est exclusivement fabriquée à la main, sans l’emploi du tour, et elle ne porte ni peinture ni vernis ; elle ressemble aux plus anciens produits céramiques des îles de l’Archipel ; on a trouvé quelques vases avec des inscriptions écrites dans l’alphabet spécial à l’île de Chypre. Telle est la civilisation rudimentaire que nous révèlent les fouilles de AI. Schliemann à Hissarlik ; mais l’acropole d’Hissarlik représente-t-elle bien les restes de la Troie de Priam plutôt que ceux d’une autre ville primitive ? On ne pourrait, dans l’affirmative, que s’étonner de ne pas rencontrer dans ses ruines des traces de l’influence assyrienne qui, nous l’avons vu, se fit particulièrement sentir en Asie-Mineure dès le XIIe siècle avant notre ère, sous le règne de Teglath-pal-asar III. Si c’est la ville de Priam qu’a retrouvée M. Schliemann, il faut avouer, en dépit des traditions que nous avons relatées ailleurs, que Troie n’eut jamais de relations ni artistiques, ni commerciales, ni politiques avec l’Assyrie. Ctésias parle d’une mention du siège d’Ilion, qui se serait trouvée dans les annales ninivites et d’un secours que les Assyriens auraient envoyé aux Troyens. N’y aurait-il donc rien de fondé dans cette légende, non plus que dans celles qui racontent que Priam reconnaissait la suzeraineté du roi d’Assyrie, et que Memnon, roi des Éthiopiens du soleil levant, dont la capitale était Suse, vint, avec une formidable armée, au secours de la ville assiégée par les Grecs ? Cependant, la Troie homérique ne pouvait manquer, ce semble, d’avoir des rapports de commerce habituels avec des pays comme la Phrygie, où s’était, dit-on, établie une dynastie assyrienne, et comme la Cappadoce, qui se trouvait en contact journalier avec les Ninivites, était soumise complètement à leur influence et même leur payait tribut. Il y a plus : on a signalé des éléments orientaux dans les noms des principaux chefs troyens cités chez Homère[5], et, dès le XVe siècle, les Dardaniens étaient en rapport avec la Syrie du nord, bien plus anciennement conquise à l’action de la civilisation chaldéo-assyrienne. Quand ils envoyaient leurs guerriers jusque dans la vallée de l’Oronte, comme auxiliaires des Hittites, ce n’est certainement pas en faveur d’un peuple inconnu et avec lequel ils n’auraient pas entretenu des relations habituelles, qu’ils entreprenaient cette expédition ; un passage de l’Odyssée fait des Hittites des alliés venus de très loin au secours de Troie, peuple dont les Grecs ne trouvaient aucune autre mention dans leurs traditions mythiques ou héroïques et dont l’identification était, aux yeux de Strabon, un problème impossible à résoudre. Mais quelle influence ces relations prolongées avec les Lydiens, les Phrygiens, les Cappadociens, les Hittites eurent-elles sur le développement de la civilisation troyenne ? C’est ce que les fouilles de M. Schliemann n’ont pas mis en lumière. On voit que, d’après ce qui précède, il n’est pas téméraire de dire que la Troie antérieure à Homère n’a pas d’histoire. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est qu’elle partageait la domination de l’Asie-Mineure avec les Cariens, les Phrygiens et les Lydiens, sur lesquels aussi nos informations positives se réduisent à bien peu de chose, au moins en ce qui concerne les relations de ces peuples avec les grandes civilisations orientales. Les Cariens qui, plus tard, lors de leur alliance intime avec les Lélèges, les Lydiens et les Mysiens, se dirent descendants d’un frère des héros mythiques Lydus et Mysus, mais qui, dans la réalité, étaient plutôt rapprochés des Chananéens par leur origine, conservèrent encore une brande puissance, même après que les nations sémitiques et aryennes les eurent resserrés dans un étroit territoire à l’angle sud-ouest de la péninsule. Obligés alors de chercher sur la mer une nouvelle patrie, ils couvrirent la mer Égée de leurs vaisseaux et les îles de leurs colonies, et lorsque Nicias fit, en 426, la purification de Délos, on reconnut que la plupart des morts ensevelis dans l’île, et qu’on exhuma, étaient Cariens. Les Phéniciens et les Grecs les refoulèrent peu à peu. Minos, roi de Crète, faisait la chasse à leurs pirates dans la mer Égée. L’établissement des colonies grecques sur leurs côtes, où les Doriens fondèrent ou agrandirent Cnide et Halicarnasse, les refoula dans l’intérieur des terres. Les conquérants vinrent même bientôt les y chercher, Crésus d’abord, puis Cyrus, qui leur laissa toutefois leurs chefs nationaux. Du moment qu’ils ne pouvaient plus être navigateurs et écumeurs de mer, les Cariens se mirent à faire le métier d’aventuriers et de mercenaires partout où on voulait bien acheter leurs services. David, à Jérusalem, en avait déjà un corps dans sa garde, à côté de celui des archers crétois ; les rois égyptiens de la XXVIe dynastie recrutèrent chez eux une bonne partie de leurs troupes étrangères. Le peu d’étendue de leur territoire, et la difficulté d’y faire vivre une nombreuse population, les poussaient à aller mener ce métier à l’étranger, et rendaient fréquente chez eux la vente des enfants comme esclaves par leurs parents. Aussi les marchands d’hommes trouvaient si .facilement à s’approvisionner dans ce pays qu’à une certaine époque le nom de Carien devint synonyme de celui d’esclave. Ce que nous savons d’histoire précise sur les Phrygiens n’est presque rien ; mais il est certain que ce fut un grand peuple, puissamment civilisé, riche, qui joua un rôle considérable et eut une influence très notable, non seulement sur les contrées immédiatement ses voisines, mais sur la Grèce elle-même et sur les débuts de sa culture, au temps de la dynastie des Pélopides, que la tradition faisait venir de Lydie ou de Phrygie à Argos. Sous certains rapports, la civilisation de la Phrygie était très raffinée, car un des modes de la musique grecque, qui tenait le milieu entre le mode lydien, plus aigu, et le mode dorien, plus grave, était appelé mode phrygien. Les musiciens Marsyas, Olympus, Hyagnis, qu’on retrouve dans les légendes grecques, étaient Phrygiens. La religion nationale de la Phrygie, célèbre dans tout le monde antique et propagée au loin à une certaine époque, était un panthéisme grossier, qui avait, dans ses idées fondamentales, une grande analogie avec la religion chaldéo-assyrienne. Le dieu suprême Bagaios, dont le nom rappelle le perse Baga, dieu, et que les Grecs assimilaient à leur Zeus, le dieu Môn ou dieu Lune, analogue au Sin des Assyro-Chaldéens, enfin Cybèle et Atys, avec les monstrueuses légendes qu’avait engendrées leur culte, étaient les divinités nationales qui se partageaient les hommages des Phrygiens. Nous n’avons point à entrer ici dans l’analyse des rites hideux de cette religion naturaliste, qui revêtait une physionomie à part, grâce au développement qu’y avaient reçu certaines conceptions immorales, et grâce surtout au fanatisme et aux étranges pratiques de ses prêtres, appelés Galles, voués au célibat, qui gagnaient sur le peuple un ascendant d’autant plus sûr qu’ils l’effrayaient par leurs danses effrénées et leurs mutilations volontaires. La Phrygie était renommée pour ses laines, qui étaient transformées à Milet en tissus somptueux, pour sa bonne agriculture, ses fromages et ses salaisons. Dès une époque fort antique, ce pays forma un royaume florissant, qui devint surtout important après la chute de la prépondérance des Dardaniens, dont il paraît avoir dépendu au temps de leur grande prospérité. Le premier de ses rois, Gordios- n’avait à l’origine, suivant la légende, pour tout bien que deux paires de bœufs, avec lesquelles il labourait ses champs. Mais l’agriculture fut bientôt pour lui la source d’une fortune extraordinaire. Le souvenir de ses richesses est venu jusqu’à nous dans les traditions relatives à son fils Midas, qui changeait en or tout ce qu’il touchait. Il s’est conservé aussi dans la légende du héros Lityersès, fils de Midas, qui moissonnait lui-même ses blés, forçait les passants à partager son labeur, et mettait impitoyablement à mort tous ceux qui ne moissonnaient ni aussi vite, ni aussi bien que lui. Les Phrygiens précédèrent immédiatement les Lydiens dans la domination de l’Asie-Mineure, et, avant même de devenir conquérants, ils servirent de lien entre la civilisation du bassin de l’Euphrate et du Tigre et celles de la Lydie, de la Troade et de la Grèce. Malheureusement il ne reste de cette prospérité que quelques légendes entremêlées de données mythologiques, et des monuments funéraires, avec des inscriptions, taillés dans les rochers de la vallée supérieure du Sangarius. Leur caractère tout indigène, dit le voyageur français Texier, révèle le style architectural des vieux Phrygiens. Rien n’y indique l’influence d’un goût étranger ; l’art phrygien s’y produit aussi éloigné des principes de l’art grec que de l’ancien style perse ou assyrien et de la curieuse originalité du style lycien. La langue même des inscriptions y est purement phrygienne ; et celte langue, avec l’alphabet qui nous en a conservé les rares débris, reste enfermée dans les limites de l’ancien royaume où régna la dynastie de Midas. Dans toute l’étendue du pays où se trouvent ces restes vénérables du peuple indigène, on ne voit que de très rares débris de monuments appartenant à l’époque romaine ; il semble que les conquérants successifs de la contrée aient ignoré ces vallées solitaires, où plus tard des familles chrétiennes vinrent chercher un refuge contre la persécution du paganisme, peut-être aussi contre l’invasion musulmane. Les inscriptions des tombeaux de la vallée du Sangarius, découverts par le voyageur anglais Leake, et qui remontent à une époque antérieure à la domination hellénique, sont tracées dans un alphabet très analogue aux plus anciennes formes de l’alphabet grec. D’après leurs caractères paléographiques, elles doivent être rapportées au vit, ou au vin’ siècle avant l’ère chrétienne. La langue en offre certaines ressemblances avec le grec, dont elle a la déclinaison, la conjugaison et la phonétique ; mais elle présente aussi des éléments d’une nature très différente, qui la rapprochent de l’arménien[6]. Une de ces inscriptions est l’épitaphe d’un roi du nom de Midas, qui dut être un des derniers princes de la dynastie dont le fondateur, passé dans les légendes grecques à l’état de personnage purement mythique, s’appelait aussi Midas. L’inscription se lit sur un rocher haut de cent pieds, taillé en forme de monument funéraire et dont la surface est couverte d’ornements symétriques, qui ressemblent à une tapisserie : c’est le monument le plus important qui nous reste de la première dynastie phrygienne. Quelques tombeaux, quelques bas-reliefs où l’on sent l’influence et peut-être la main des artistes hittites, voilà ce qui nous reste de ces rois de Phrygie, si vantés par leur richesse, leur amour des chevaux de prix et le respect fanatique dont ils entouraient la mère des dieux et Dionysos. Le char royal de Midas et son nœud gordien demeurèrent longtemps intacts, comme un trophée de l’ancienne suprématie phrygienne : il fallut l’épée d’Alexandre pour trancher le nœud, et l’invasion grecque pour faire oublier les vieux rois nationaux[7]. Les Lydiens, qui furent, surie continent, ce qu’étaient les Phéniciens en mer, avaient primitivement pour capitale Magnésie sur le Méandre ; c’est là que résidait Tantale, le, père des Pélopides et des Niobides, et l’on montrait, sur le Sipyle, le tombeau de Tantale elle trône de Pélops. A l’époque historique, leurs rois habitent Sardes, située sur un rocher taillé à pic qui domine les flots d’or du Pactole et les vignobles de la vallée de l’Hermus. Là régnèrent successivement trois dynasties de rois : les Atyades, les Héraclides et les Mermnades. Des Atyades, nous ne savons rien, si ce n’est qu’ils durent commencer à régner vers le XVIe siècle avant l’ère chrétienne. Les légendes nationales plaçaient à leur début les deux héros mythiques, Lydus et Tyrrhénus ; ce dernier, personnifiant la colonie lydienne qui se dirigea par mer vers l’ouest, aborda aux tûtes d’Italie et devint l’origine de l’aristocratie de l’Étrurie, en se superposant dans ce pays aux premiers habitants Pélasges. Lydus et Tyrrhénus étaient fils d’Atys, qui donna son nom à cette première dynastie, et descendait lui-même de Manès, fils de Zeus et de la Terre. Voici l’anecdote que nous transmet Hérodote pour expliquer les migrations des Lydiens : Sous le règne d’Atys, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d’une grande famine, que les Lydiens supportèrent quelque temps avec patience. Mais voyant que le mal ne cessait point, ils y cherchèrent remède et chacun eu imagina à sa manière. Ce fut à cette occasion qu’ils inventèrent les dés les osselets, la balle et toutes les autres sortes de jeux, excepté celui des jetons, dont ils ne s’attribuent pas la découverte. Or, voici l’usage qu’ils firent de celte invention pour tromper la faim qui les pressait. On jouait alternativement, pendant un jour entier, afin de se distraire du besoin de manger et, le jour suivant, on mangeait au lieu de jouer. Ils menèrent cette vie pendant dix-huit ans ; mais enfin le mal, au lieu de diminuer, prenant de nouvelles forces, le roi partagea les Lydiens en deux classes et les lit tirer au sort, l’un pour rester, l’autre pour quitter le pays. Celle que le sort destinait à rester eut pour chef le roi lui-même ; son fils, Tyrrhénus, se mit à la tête des émigrants. Les Lydiens que le sort bannissait de leur patrie, allèrent d’abord à Smyrne, où ils construisirent des vaisseaux, les chargèrent de tous les meubles et instruments utiles, et s’embarquèrent pour aller chercher des vivres et d’autres terres. Après avoir côtoyé différents pays, ils abordèrent en Ombrie, où ils se bâtirent des villes qu’ils habitent encore à présent ; mais ils quittèrent le nom de Lydiens et prirent celui de Tyrrhéniens, de Tyrrhénus, fils de leur roi, qui était le chef de la colonie. Cette fable résume les migrations multiples des Pelages Tyrrhéniens d’Asie-Mineure en Europe, et nous n’avons point à nous occuper ici des relations des peuples de l’Asie-Mineure avec les civilisations occidentales. On ne sait ce qu’il advint de la dynastie des Atyades après Lydus, ni si elle occupa le trône pendant de longs siècles. Fut-elle chassée par une invasion étrangère ? C’est ce que pourraient faire croire les souvenirs du pays relatifs à l’avènement de la dynastie des Héraclides, vers l’an 1200 avant notre ère. Les traditions lydiennes, déjà fort précises en ce qui regarde cette dynastie, lui attribuent une origine assyrienne. On racontait, dit Hérodote, qu’elle avait été fondée parle prince Agron, fils de Ninus, fils de Belus, fils d’Alcée, fils d’Hercule, venu des rives du Tigre. Des savants ont admis que cette légende repose sur une base historique. Agron est un nom tout assyrien qui veut dire le fugitif ; les appellations qu’Hérodote présente comme celles des trois ancêtres d’Agron, Βήλος Άλκαΐος Ήρακλής sont précisément la traduction du nom et du titre de l’Hercule assyro-chaldéen, surnommé Sandan, le fort, le puissant, et quelquefois assimilé à Bel, Bel-Adar Sandan. D’après celte ingénieuse théorie, le fondateur de la dynastie des Héraclides de Lydie se révèlerait donc dans les traditions recueillies par le père de l’histoire, comme un prince assyrien exilé et fugitif, issu d’une famille qui regardait le dieu Adar comme son auteur ou son protecteur spécial. Elle indiquerait plutôt, selon nous, que la religion de la Lydie était marquée d’une profonde empreinte assyrienne, et les historiens les plus graves, comme M. E. Curtius, admettent que l’empire lydien resta sous la suzeraineté de Ninive pendant toute la durée de la dynastie des Héraclides[8]. Rien jusqu’ici, dans les documents cunéiformes, n’est venu appuyer ces hypothèses ; on est même autorisé à croire, d’après les inscriptions, que les monarques assyriens ne cherchèrent pas à franchir le bassin mésopotamien et à étendre leurs rapines dans la direction de l’Asie-Mineure avant le règne de Teglath-pal-asar Ier, vers 1120 seulement avant Jésus-Christ. La légende recueillie par Hérodote s’est probablement greffée autour du récit des guerres vraiment historiques que la dynastie des Mermnades eut plus tard à soutenir contre l’invasion assyrienne ; car, à moins d’admettre la réalité de l’empire de Nemrod, aucun des conquérants ninivites ne pénétra dans l’Asie-Mineure avant Sargon. Les Héraclides fournirent vingt-deux rois à la Lydie et occupèrent le trône pendant cinq siècles environ. On ne connaît que quelques-uns des noms de cette dynastie mythique. L’un d’eux, le féroce Camblès, personnifie sans doute une grande famine, car on raconte qu’un jour il fut tourmenté d’une faim si atroce qu’il dévora la reine. Mélès, la femme de l’un de ces princes, accoucha d’un lion. Candaule, le dernier d’entre eux, fut assassiné à l’instigation de sa femme, par Gygès, fils de Dascylès, le majordome du palais, le chef des mercenaires cariens, qui devint le fondateur de la dynastie des Mermnades. Tout le monde connaît les anecdotes romanesques et bien peu historiques qu’Hérodote, Platon et Nicolas de Damas racontent au sujet de cette révolution, qui paraît avoir été lé résultat d’une réaction du vieil élément pélasgique des Méoniens contre l’élément sémitique des Lydiens proprement dits, d’où la dévotion que les Mermnades témoignèrent, dès leurs premiers jours, pour les sanctuaires de la Grèce. Ce changement de dynastie se signala surtout par le réveil des sentiments belliqueux de ces peuples, et il ouvrit pour eux l’ère des conquêtes. Les Cariens, guerriers avant tout, y avaient prêté un concours actif, tandis qu’une partie de la population lydienne v résistait. L’avènement de Gygès, d’après les données chronologiques fournies par Hérodote, aurait eu lieu vers 710. Nous avons fait le récit, eu suivant les inscriptions cunéiformes, des guerres d’Assurbanipal, roi d’Assyrie, contre Guggu, roi des Ludi, dans lequel il est impossible de méconnaître Gygès, roi des Lydiens, l’ambassade et les présents qu’il en reçut., vers 666. La mort de Gygès doit être placée vers 663 ; son fils, Ardys, lui succéda. Au temps de la dynastie des Mermnades, la Lydie avait bien d’autres ennemis que les Assyriens à combattre. C’étaient : les Grecs, qui étaient venus s’établir sur ses côtes et qui lui interceptaient les approches de la mer ; les barbares, c’est-à-dire les Thraces, dont les bandes pillardes franchissaient à chaque instant le Bosphore, et les Cimmériens, dernier rameau des Scythes resté en arrière de la migration du reste de la race, qui, acculés au Caucase, en franchissaient de temps en temps les défilés et se jetaient comme un torrent sur l’Asie-Mineure pour la ravager. Issus de Gomer, fils de Japhet[9], les Cimmériens sont mentionnés dans la Bible comme des populations habitant l’extrême nord. Homère les a connus, mais il les dépeint sous des traits fabuleux : ce sont des peuples toujours enveloppés de nuées et de brouillards. Jamais le soleil ne les éclaire de ses rayons, soit qu’il monte sur le ciel étoilé, soit que du ciel il redescende sur la terre ; mais une nuit lamentable est toujours étendue sur ces infortunés mortels. C’est à Hérodote et à Strabon que nous devons ce que nous savons de positif sur l’histoire et les migrations des Cimmériens. Ils occupaient anciennement toute la Scythie d’Hérodote, où l’on signale, dans l’intérieur des terres, un canton nommé, d’après eux, Κιμμερίη et des oppida Cimmeria, le pays au nord du Pont-Euxin et celui au nord-est du Palus-Méotide, appelé quelquefois mare Cimmerium. Le centre de leur puissance était dans la Chersonèse Taurique, où ils laissèrent, quand ils eurent disparu, trace de leur domination dans le nom de Bosphore Cimmérien et peut-être même dans celui de Crimée. Après avoir longtemps dominé sur ces contrées, ils en furent chassés par l’invasion d’un rameau des Scythes. Hérodote prétend qu’ils leur abandonnèrent sans combat tous les pays qu’ils habitaient. Pourtant, il semble que, dans la Chersonèse Taurique, les Cimmériens résistèrent et se maintinrent plus longtemps qu’ailleurs et que la ligne de fortifications fermant l’isthme, dont nous parlent Hérodote et Strabon, fut alors créée par eux pour essayer d’arrêter les Taures, le peuple scythique qui finit par se substituer complètement à eux dans cette contrée. Hérodote raconte aussi que les Cimmériens, émigrant devant l’approche des Scythes, gagnèrent l’Asie-Mineure septentrionale par la voie de terre, en longeant le littoral du Pont-Euxin et en passant par le pied du Caucase, et qu’ils vinrent y former leur premier établissement, dans les cantons de la Paphlagonie, autour de Sinope. La critique moderne a cru pouvoir établir que la migration forcée des Cimmériens en Asie-11ineure s’est opérée en franchissant le Danube, en passant par la Thrace et en traversant d’Europe en Asie par le Bosphore ou par l’Hellespont. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il y eut un temps où ce peuple occupa la plus grande partie du nord de l’Asie-Mineure, depuis la Troade et la ville d’Autandros en Mysie, qui s’appela à une certaine époque Cimméris, jusqu’au pays de Sinope, en passant par la Bithynie. Certains chronographes placent vers 784 avant J.-C. la première apparition des Cimmériens en Asie-Mineure. Ainsi fixés dans la Bithynie et la Paphlagonie, les Cimmériens, pendant une période d’une centaine d’années, le VIIe siècle, ravagèrent l’Asie-Mineure occidentale par d’incessantes incursions. Après la Paphlagonie, c’est sur la Phrygie qu’ils se jetèrent d’abord, et leurs succès y amenèrent le roi Midas, fils de Gordias, à s’empoisonner de désespoir avec du sang de taureau, événement que la chronique d’Eusèbe rapporte à l’année 695. La Lydie et l’Ionie furent ensuite soumises. Sardes, sauf sa citadelle, fut pillée deux fois, la première fois quand Ardys occupait le trône de Lydie et quand vivait à Éphèse le poète élégiaque Callinos, le Tyrtée des cités grecques de l’Ionie. Ce fut alors que Callinos, comme les prophètes d’Israël, écrivit les admirables vers où, sous la gravité douce du mètre élégiaque, respire un enthousiasme contenu, qui n’a pas moins de puissance que l’accent le plus lyrique, nue ardeur calme qui rappelle cette marche régulière et terrible dont les Crétois abordaient lentement, au son de la flûte et de la lyre, les bataillons ennemis. Jusques à quand resterez-vous abattus ? Quand aurez-vous un cœur belliqueux, ô jeunes gens ? N’avez-vous pas honte de cette mollesse devant les peuples voisins ? Vous semblez assis en paix, et la guerre est partout en votre pays... Que chacun de vous, en mourant, darde encore son dernier javelot ! C’est l’honneur et la gloire de l’Homme de combattre pour son pays, ses enfants, sa jeune épouse, contre l’ennemi. La mort, viendra le jour où les Parques auront filé l’écheveau. Mais que chacun marche droit, l’épée haute et le bouclier en avant, de la poitrine, quand la mêlée commence. Il n’est pas dans la destinée que l’homme échappe à la mort, quand même il a des immortels pour aïeux. Souvent celui qui, à travers la bataille et le bruit des traits, a passé sain et sauf, la mort l’atteint à son foyer. Celui-là n’est pas cher au peuple ; il n’en est pas regretté ; mais cet autre, petits et grands le pleurent s’il succombe. L’homme de courage met en deuil le peuple par sa mort ; et, vivant, il est l’égal des demi-dieux. On le contemple des yeux comme un rempart, car seul il vaut un grand nombre. Nous ne savons si cet autre Tyrtée réussit à rendre quelque courage aux Ioniens, amollis déjà par trop de richesses. Toujours est-il que les chants enflammés du poète n’empêchèrent pas les Cimmériens, vers 633, de ruiner Magnésie du Méandre, désastre dont Archiloque fut témoin. Leur roi Lygdamis, auteur d’un des sacs de Sardes, se jeta ensuite sur Éphèse. Hésychios prétend qu’il y brûla le temple d’Artémis ; mais Callimaque, d’après la tradition sacrée, affirme, au contraire, que les traits de la déesse protégèrent sa ville favorite et que ; .de cette multitude dont les chars couvraient les bords du Caystre, égale en nombre aux sables de la mer, ni son chef, ni aucun homme ne revit sa, patrie. Ce n’est point toutefois sous les murs d’Éphèse que succomba Lygdamis, car nous savons qu’il s’avança jusqu’en Cilicie où il périt. Nous avons raconté en leur temps les rapports des Cimmériens avec l’Assyrie, et nous ne reviendrons pas sur cet épisode de leurs aventures. Assarhaddon les refoula une première fois ; mais à la fin de son règne il parait avoir été débordé par l’invasion, et une coalition des peuples du nord, à la tête de laquelle se placent les Cimmériens, semble avoir enlevé à ce prince toutes les provinces situées au nord du pays d’Assur proprement dit, y compris l’Arménie elle-même. Assurbanipal fut mêlé aux événements qui accompagnèrent la ruine de la Lydie par les barbares et leurs luttes avec Gygès et Ardys. Le dernier grand roi des Cimmériens ravageurs de l’Asie-Mineure, fut Côbos, que Strabon n’hésite pas à citer parmi les plus redoutables conquérants, à côté de Sésostris et de Madyês, le vainqueur de Cyaxare, le chef de ces Scythes qui intervinrent si fort à propos pour délivrer -Ninive une première rois. Un peu plus tard, Alyatte, roide Lydie, acheva l’anéantissement des Cimmériens, qui désormais disparaissent de l’histoire. Les Scythes, ce torrent humain qui sauva Ninive au lieu de l’engloutir, sont souvent eux-mêmes appelés les Cimmériens, avec lesquels ils se trouvèrent en lutte en Asie-Mineure et qu’ils vainquirent. Ce fait a été expliqué nettement par Fr. Lenormant[10]. Les Cimmériens ou Scythes d’Europe, vaincus par Madyès, devinrent les sujets des Scythes d’Asie, et comme tels furent associés à leurs incursions, de la même manière que tant de peuples barbares, vaincus par les Huns, qu’Attila traînait à sa suite. C’est pour cela que dans Ezéchiel, Gomer, aussi bien que la maison de Togarmah, sont représentés comme auxiliaires et sujets de Gôg, de la terre de Magôg, roi des Scythes, établis dans la vallée du Kour, en Arménie. Les Cimmériens, ainsi associés aux Scythes du sud du Caucase, et fondus dans les rangs de ces nouveaux venus, comme leur nom était depuis bien plus longtemps connu des populations sémitiques de l’Asie antérieure et environné pour elles d’une renommée de terreur, ce nom fut appliqué par une partie d’entre elles à l’ensemble des hordes envahissantes de l’une et l’autre race, et demeura dans la suite attaché aux Scythes. Il en résulta que les Assyro-Babyloniens, du temps des Achéménides, appelaient Cimmériens les Scythes de la Scythie européenne et de la Scythie asiatique ; les deux peuples ennemis, sur l’hostilité invétérée desquels Hérodote insiste tant, furent ainsi assimilés et confondus. Dans les inscriptions trilingues des Achéménides, l’assyrien Gimirri (Cimmérien), rend le perse Çaka et le médo-élamite Sakka (Saces). Avant l’arrivée des Cimmériens, Gygès, roi de Lydie, avait entrepris de soumettre à sa domination tous les Grecs de l’Asie-Mineure et de faire de la Lydie un empire maritime en s’emparant de Smyrne, de Phocée, de Colophon, de Milet, qui détenaient l’embouchure de l’Hermus, du Caystre, du Méandre, si bien que Sardes, la ville de l’or, était commercialement tributaire de ces grandes cités helléniques. Gygès avait réussi à s’emparer de Colophon, de Magnésie du Sipyle, et avait ravagé les territoires de Smyrne et de Milet. Il s’était même si bien rendu maître (le la Troade, que les Milésiens furent obligés de demander son consentement avant de blair Abydos sur l’Hellespont ; il était parvenu à dominer sur une grande partie de la Mysie, jusqu’au cours du Rhyndacus, où il éleva une forteresse qu’il nomma Dascylion, en souvenir de son père. Les dieux de la Grèce eux -mêmes furent intéressés aux succès de Gygès, qui fit présent à l’oracle de Delphes de vases d’or et d’argent eu si grand nombre que les Grecs furent éblouis à la vue d’un pareil trésor. Ni le courage des Smyrniotes, qui refoulèrent hors de leurs murs les Lydiens, qui déjà les avaient escaladés, ni les élégies du poète Mimnerme de Colophon, qui célébra ce glorieux exploit, n’avaient été capables d’arrêter le belliqueux monarque. Les Cimmériens, seuls, étaient venus contrarier les projets de domination universelle de Gygès, qui ne put léguer à son fils Ardys qu’un royaume dévasté el, des villes en cendres. Mais les Cimmériens partis, Ardys eut hâte de reprendre les projets de son père contre les cités grecques de la côte d’Asie-Mineure. Sadyatte (624-614) et Alyatte (614-558), continuèrent la guerre et dirigèrent leurs attaques principalement contre Milet. La Phrygie fut soumise et, à deux reprises, les archers milésiens furent écrasés par l’armée de Sadyatte sur les bords du Méandre ; l’acropole de Priène fut emportée d’assaut ; mais Milet, protégée par la mer, résistait toujours. Alyatte espéra la réduire par la famine. Pendant cinq années, les troupes lydiennes dévastèrent ses campagnes : Chaque été, dit Hérodote, dès que les fruits et les moissons commençaient à mûrir, le roi partait à la tête de son armée et la faisait marcher et camper au son des instruments. Arrivé sur le territoire des Milésiens, il respectait les habitations éparses dans les champs, au lieu de les livrer aux flammes, et n’en faisait pas même enlever les portes. Mais il les laissait debout, il détruisait entièrement les récoltes et les fruits et se retirait ensuite. Les Milésiens étant maîtres de la mer, il était inutile de tenter un siège régulier de la ville avec une armée de terre. Quant aux maisons de la campagne, en empêchant qu’on ne les abattît, son but était d’y rappeler les habitants, afin qu’ils pussent travailler la terre et l’ensemencer. En revenant l’année suivante, il trouvait toujours quelque chose à ravager. De toutes les villes ioniennes, les insulaires de Chios seuls envoyèrent des secours aux Milésiens. La guerre se prolongeait ainsi depuis onze ans, lorsque, dans une de ces expéditions qui ressemblent à celle des rois assyriens, un temple de Minerve, près d’Assesos, fut brûlé par les Lydiens ; presque aussitôt, Alyatte tomba gravement, malade ; il fit consulter l’oracle de Delphes, qui répondit : Le roi ne guérira qu’après avoir fait reconstruire le temple de la déesse. Alyatte envoya demander aux Milésiens une trêve qui lui permit d’exécuter l’ordre de la Pythie, et l’habileté de Thrasybule, tyran de Milet, sut transformer l’armistice en une paix qui laissa à la cité grecque son entière indépendance. Alyatte fut plus heureux contre Smyrne, qu’il prit quelque temps après ; plus tard, enfin, il réussit à donner sa fille en mariage à 11Iélas d’Éphèse, et se ménagea ainsi un parti puissant dans cette grande ville. Se tournant ensuite contre les nations indigènes de l’intérieur de l’Asie-Mineure, le roi de Lydie subjugua en peu d’années la Phrygie et la Cappadoce. Sa frontière se trouva ainsi loucher celle de l’empire des Mèdes et bientôt, comme nous l’avons raconté plus haut, une guerre s’engagea entre lui et Cyaxare. Elle dura six ans et se termina par la bataille de l’Éclipse (535) ; les Mèdes y gagnèrent, une partie de la Cappadoce et l’Halys devint la limite des deux empires, dont la paix et l’alliance fut cimentée par le mariage d’Aryénis, fille d’Alyatte, avec Astyage, fils de Cyaxare. Après un règne de cinquante-huit ans, Alyatte laissa, en 553, le trône à son fils Crésus. § 4. — PREMIÈRES ANNÉES DE CRÉSUS Les commencements du règne de Crésus furent difficiles. Il avait un frère du nom de Pantaléon, ne d’une mère Ionienne, tandis que lui-même était fils d’une Carienne : il représentait l’élément asiatique, et Pantaléon personnifiait l’élément hellénique de la nation. Une faction entreprit de faire monter Pantaléon sur le trône de Lydie : Crésus étouffa la révolte dans le sang. Il saisit son frère et fut assez cruel pour le condamner à périr déchiré lentement par les cardes d’un foulon. Prodigue de l’or que lui fournirent les dépouilles des vaincus, il se mit à faire aux dieux de la Grèce des largesses inouïes : c’était pour les corrompre et leur délier la langue en sa faveur, auprès des peuples qui s’obstinaient à repousser la domination lydienne. A Thèbes, en Béotie, il fit placer un trépied d’or dans le temple d’Apollon Isménien ; Diane d’Éphèse reçut des vaches d’or ; à Delphes, dans le temple de Minerve, il fit suspendre un grand bouclier d’or ; aux Branchides, chez les Milésiens, les présents de Crésus furent encore plus extraordinaires. Cette piété de mauvais aloi, aussi intéressée que peu sincère, valut aux Lydiens l’insigne honneur de figurer au premier rang dans les jeux olympiques. Les Grecs d’Europe pouvaient, sans crainte, paraître séduits ; mais les Grecs d’Asie, tout en acceptant l’or, ne se laissèrent point prendre aux pièges grossiers du monarque hypocrite, et Crésus, las d’attendre leur soumission bénévole, furieux de voir ses plans déjoués, résolut d’obtenir par la violence et la force ce qu’il ne pouvait avoir par les flatteries et les cadeaux. Malheureusement les villes grecques d’Asie-Mineure étaient divisées entre elles et ne pouvaient efficacement résister à un coup de force tenté par le puissant roi de Lydie. En vain Thalès de Milet conseilla aux Ioniens de nommer tin sénat commun qui siégerait à Téos, position centrale, et de là gouvernerait toute l’Ionie comme une seule ville ; ils ne voulurent pas renoncer à leur indépendance municipale et laissèrent leurs cités succomber, les mies après les autres, sous les coups de Crésus. Éphèse, gouvernée par Pindarus, fils de l’une de ses sœurs, tomba la première en son pouvoir, quoique les habitants, pour mettre leur ville sous la protection de Diane, eussent enveloppé leurs murs d’une corde qu’ils avaient attachée à l’autel de la déesse, dont le temple s’élevait à quelque distance de la cité. Crésus fil ensuite la guerre aux Ioniens et aux Éoliens, mais à chaque ville successivement, employant, dit Hérodote, des raisons légitimes lorsqu’il en pouvait donner, ou des prétextes frivoles à défaut de raisons. Smyrne succomba à son tour. Quand il eut subjugué tous les Grecs d’Asie et qu’il les eut forcés à payer un tribut, Crésus voulut équiper une flotte pour attaquer les îles voisines de la côte. Mais Bias de Priène ou, selon d’autres, Pittacus de Mitylène, car l’un et l’autre se trouvaient alors à sa cour, parvint à le détourner de ce projet, en lui montrant en perspective la certitude d’un échec. Crésus, raconte Hérodote, demanda à ce sage s’il y avait du nouveau en Grèce, et le sage lui fit cette réponse qui suspendit ses préparatifs : « Ô roi, les habitants des îles rassemblent une nombreuse cavalerie, pour venir t’attaquer à Sardes même. » Crésus, présumant qu’il disait la vérité, reprit ironiquement : « Puissent les dieux inspirer aux insulaires le projet d’attaquer les Lydiens avec de la cavalerie ! — « Ô roi, répondit Pittacus, sans doute tu désires avec ardeur te rencontrer sur le continent avec les insulaires montés sur des chevaux, et dans ce cas, il est naturel que tu espères les vaincre ; mais qu’en penses-tu ? les insulaires qui savent ton projet d’armer contre eux une flotte, souhaitent-ils autre chose que de rencontrer en mer des Lydiens, afin de venger sur toi les Grecs du continent ? » La répartie, dit-on, plut beaucoup à Crésus ; il eu fut frappé, car tout ce discours lui parut plein d’à-propos. Il abandonna donc ses constructions navales et contracta avec les Ioniens des îles, des liens d’hospitalité. Cependant Crésus n’avait pas renoncé à faire de nouvelles conquêtes. C’était le moment oit Cyrus venait de détruire la monarchie des Mèdes et poursuivait le cours de ses expéditions victorieuses dans tout le vaste pays situé entre l’Indou-Kousch et le fleuve Halys. Crésus, étroitement allié avec le roi détrôné, Astyage, brûlait de venger son beau-frère. fine pouvait, d’ailleurs, voir sans inquiétude l’accroissement si rapide et si menaçant de la puissance perse, et il devait s’attendre à ce que la force même des choses amenât nécessairement une lutte prochaine entre son empire et, celui du conquérant qui venait de surgir en Asie. En prévision de cette éventualité, il voulut se rendre maître de toute l’Asie-Mineure jusqu’à l’Halys, afin d’être en état d’opposer à Cyrus les forces d’une monarchie compacte et capable de balancer la puissance, récemment créée, des Perses. Une suite de campagnes heureuses lui permirent de réaliser ce plan, et lui livrèrent tout le territoire compris entre l’Hellespont, le Pont-Euxin, l’Halys et la chaîne du Taurus. Mysiens, Maryandiniens, Bithyniens, Thraces d’Asie, Paphlagoniens, Phrygiens subirent en très peu de temps le joug lydien. Sur le versant méridional du Taurus, la Carie, la Lycaonie, la Pisidie et la Pamphylie furent aussi rapidement conquises ; la Lycie parvint à préserver son indépendance, et Crésus n’osa pas attaquer la Cilicie, qui, possédée antérieurement par les Assyriens, paraît s’être trouvée alors aux mains des Babyloniens, depuis les campagnes de Nabuchodonosor dans la Syrie et les régions circonvoisines. Quand ces nations furent subjuguées, Crésus parut le plus puissant monarque du monde et il se mit à étaler dans Sardes, sa capitale, un faste qui éblouit tous les Grecs et produisit sur eux l’effet du mirage. On venait de loin admirer toutes ces richesses ; la légende ne reculant point devant un anachronisme grossier, prétend que Solon lui-même alla visiter l’opulent monarque. Crésus, raconte-t-elle, reçut le législateur athénien dans son palais royal. Le troisième et le quatrième, jour, par son ordre, des serviteurs promenèrent Solon parmi les trésors et lui firent admirer tout ce qu’il y avait de grand et de magnifique. Lorsqu’il eut examiné toutes choses à loisir, Crésus le questionna en ces termes : « Ô mon hôte athénien, la grande renommée est parvenue jusqu’à nous ; on parle ici de ta sagesse et de les voyages ; nous savons que tu as parcouru, en philosophe, une vaste partie de la terre, dans le dessein de t’instruire ; maintenant, le désir m’est venu de te demander quel est, de tous les hommes que tu as vus, le plus heureux. » Or, il faisait cette question parce qu’il se croyait le plus heureux de tous les hommes. Mais Solon, loin de le flatter, répondant la vérité : « Ô roi, c’est Tellus l’Athénien. » Crésus, saisi de surprise, lui demanda doucement : « A quoi juges-tu que Tellus est le plus heureux des hommes ? » Solon reprit : « D’abord, à Tellus, citoyen d’une ville prospère, sont nés des enfants beaux et vertueux, et, de tous, il a vu naître des enfants qui tous ont vécu ; secondement, il a possédé des biens autant qu’il convient chez nous et il a eu la fin la plus brillante. En effet, comme les Athéniens livraient bataille à nos voisins d’Éleusis, il combattit dans leurs rangs, décida la victoire et trouva une glorieuse mort. Les Athéniens l’ensevelirent aux frais du peuple, au lieu même où il était tombé et le comblèrent d’honneurs. » Crésus, poursuit Hérodote, demanda à Solon qui était, après Tellus, le plus heureux homme qu’il eut vu ; le sage donna la seconde place aux Argiens Cléobis et Biton, célèbres pour leur piété filiale. Alors, le roi de Lydie irrité s’écria : « Ô mon hôte athénien, mon bonheur te paraît-il donc si peu de chose que tu ne me places pas même au niveau d’hommes d’une condition privée ? » Solon reprit : « Ô Crésus, tu questionnes sur les affaires humaines un homme qui n’ignore pas combien la divinité est jalouse et combien elle se plaît à tout bouleverser... Je te vois immensément riche et roi de peuples nombreux ; mais je ne puis dire de toi ce que tu voudrais me faire déclarer, avant d’avoir appris que tu aies heureusement fini ta carrière... Nombre d’hommes regorgent de richesses et ne sont pas heureux ; d’autres le sont avec des biens médiocres... En toutes choses, il faut considérer la fin, car la divinité, après avoir fait entrevoir à beaucoup d’hommes le bonheur, les ruine sans ressource. » La réponse, poursuit la fable, ne fut pas du goût du prince habitué aux viles flatteries des courtisans : il congédia Solon sans continuer à lui rendre les honneurs qu’il lui avait d’abord prodigués. Solon pourtant avait dit vrai. Presque aussitôt après son départ, Crésus fut coup sur coup en proie à des songes affreux qui lui firent prévoir les malheurs qui allaient l’atteindre en son fils préféré. Il en avait deux : l’un était muet et ne comptait pas ; l’autre, Atys, était le plus intelligent de tous les enfants de son âge. Un songe annonça à Crésus qu’Atys périrait frappé par une pointe de fer. Aussitôt, le roi de Lydie s’empresse de marier son fils, de lui enlever le commandement de l’armée, par crainte d’accident, même de faire disparaître des appartements du jeune prince tout ce qui peut ressembler à une flèche, à une lame, à un javelot. Peu de temps après, un énorme sanglier étant venu ravager les moissons des Mysiens, ceux-ci dépêchèrent des messagers auprès de Crésus pour le prier d’envoyer son fils avec l’élite des troupes lydiennes pour tuer le terrible animal. Crésus refusait obstinément de laisser partir son fils ; mais Atys, qui brûlait du désir d’aller à la chasse, finit par triompher de la résistance de son père en ]ni représentant qu’il n’avait à craindre du sanglier ni flèche ni pointe de fer d’aucune sorte. Atys partit bien équipé en compagnie du Phrygien Adraste, un des favoris de son père, chargé spécialement de veiller sur lui. La troupe des chasseurs rencontra le sanglier sur le mont Olympe ; Adraste lui-même, ayant dirigé un trait sur l’animal, le manqua et atteignit le fils de Crésus qui succomba sur-le-champ. Adraste, inconsolable dans son malheur, se perça de son épée sur la tombe même du jeune prince. Crésus privé du fils en qui il avait placé toutes ses espérances, passa deux ans plongé dans la plus profonde tristesse. Il restait insensible à tout cet or qu’on entassait autour de lui et à cette opulence qui est encore aujourd’hui proverbiale. La Lydie, d’ailleurs, était riche en métaux précieux. Les lavages des sables du Pactole donnaient de l’or en abondance ; Crésus avait fait ouvrir auprès de Pergame des mines du même métal. Aussi fut-ce lui, plutôt que Gygès, qui fit frapper la première monnaie d’or qu’ait connue le monde antique, monnaie dont des échantillons sont parvenus jusqu’à nous. Les Lydiens étaient commerçants, industrieux ; ils passaient pour les plus anciens brocanteurs de la Méditerranée ; on vantait leurs onguents parfumés, leurs tapis pareils à ceux des Babyloniens et dont la tradition s’est conservée dans les fameux tapis de Smyrne ; on appréciait l’habileté des esclaves tirés de leur pays. Crésus se trouvait maintenant le plus malheureux des hommes et cependant il était bien loin d’avoir épuisé la coupe des maux que les dieux avait préparée pour lui. Les progrès inquiétants de Cyrus dans la partie de I’Asie-Mineure au delà de l’Halys, dans la Colchide, chez les Chalybes et leurs voisins, vinrent enfin le tirer de la douleur où il s’absorbait. § 5. — CYRUS ET CRÉSUS. - RUINE DE L’EMPIRE DE LYDIE. L’orage se rapprochait de l’empire de Lydie et déjà menaçait presque ses frontières. Crésus songea à prendre l’offensive avant que la puissance du conquérant perse ne fût devenue encore plus formidable, et à ne pas attendre que Cyrus le vînt chercher ; mais auparavant il voulut consulter les oracles de la Grèce. Il envoya des messagers à Delphes, à Dodone, près d’Amphiaraüs et près de Trophonius ; aux Branchides, chez les Milésiens ; près de Jupiter Ammon, en Libye. Voulant même ruser avec les dieux, il recommanda à ses émissaires de ne consulter ces divers oracles que le centième jour après leur départ de Sardes et de leur demander à quelle occupation se livrait le roi, ce jour-là, et au moment même où on questionnait la divinité. A cette demande, la Pythie de Delphes fit cette réponse singulière : Je sais
le nombre des grains de sable et la mesure de la mer : Je me
fais comprendre du sourd et j’entends le muet. Le
fumet de la tortue à dure écaille pénètre mes sens, Cuite
dans l’airain avec des chairs d’agneau, L’airain, sous elle, est étendu à terre, et l’airain la recouvre. Quand les messagers, rentrés à Sardes, eurent rapporté cette réponse, Crésus jugea que l’oracle de Delphes était le meilleur. Il avait deviné juste, car attentif au délai de cent jours, Crésus avait imaginé, pour faire une chose que nul ne pût soupçonner, de dépecer une tortue et un agneau et de les faire cuire ensemble dans une marmite d’airain, à couvercle d’airain. Dès lors, le dieu de Delphes fut comblé de présents. Crésus rit immoler trois mille têtes de bétail ; il amoncela sur nu immense bûcher des lits revêtus de lamelles d’or et d’argent, des coupes d’or, des vêtements de pourpre, et il les brûla pour conquérir l’amitié du dieu. Cent tuiles d’or pesant chacune un talent et demi ou deux talents, un lion en or du poids de dix talents, deux grands cratères d’or et d’argent ; quarante barils d’argent, deux aspersoirs d’or et d’argent ; une statue de femme en or, haute de trois coudées ; les colliers et les ceintures de sa lemme : tout cela fut envoyé par le roi de Lydie au sanctuaire d’Apollon. Les deux oracles de Delphes et d’Oropus lui prédirent que s’il entreprenait la guerre, il détruirait un grand empire. Crésus aveuglé par la joie. interpréta cette réponse suivant ses espérances ; il en conçut une extrême joie, fit donner deux statères d’or à chacun des habitants de la ville de Delphes et demanda encore à la Pythie si son empire, sans cesse agrandi, aurait une longue durée. On lui répondit : Lorsqu’un
mulet deviendra roi des Mèdes, Alors,
ô Lydien aux pieds délicats, tu n’auras que le temps de fuir le long de
l’Hermus, De fuir sans t’arrêter, et sans rougir de passer pour lâche. Lorsque ces vers furent répétés à Crésus, ajoute Hérodote, il s’en réjouit plus encore que des autres réponses, pensant bien que jamais, au lieu d’un homme, un mulet ne règnerait sur les Mèdes, et que ni lui, ni ses descendants ne perdraient l’empire. Au comble de la joie, le roi de Lydie ne s’inquiéta plus que de s’informer des plus puissants États de la Grèce et, de l’Asie afin de s’en faire des alliés. Il conclut un traité avec le roi d’Égypte Ahmès, avec les Lacédémoniens et avec Nabonid, roi de Babylone, et résolut de commencer les hostilités contre les Perses, malgré les conseils prudents de son ministre Sandanis qui lui représentait que les Perses étant un peuple pauvre, les Lydiens avaient tout à perdre et rien à gagner à une grande guerre comme celle qui allait s’engager. Au printemps de l’an 549, Crésus franchit l’Halys au moyen d’un canal de dérivation qui fut exécuté par les conseils de Thalès, s’empara de Ptérie, place forte qui commandait la route de Sinope, occupa la partie de la Cappadoce que la chute du royaume de Médie avait mise aux mains de Cyrus, et eu transporta les habitants dans diverses parties de l’Asie-Mineure. Cyrus, à cette nouvelle, envoya des émissaires auprès des villes ioniennes pour les soulever contre leur oppresseur, et il accourut lui-même à la tête de toutes ses troupes. Une grande bataille fut livrée entre les Perses et les Lydiens dans le district de Ptérie. La perte fut très considérable des deux côtés, et la nuit sépara les combattants sans que la victoire se fût déclarée pour l’un ou l’autre parti. Le roi de Lydie attribua cet insuccès à l’infériorité numérique de son armée et il rie douta point qu’une nouvelle bataille ne lui donnât la victoire. Crésus pourtant se retira sur sa capitale ; il croyait la campagne finie pour cette année, et renvoya ses troupes mercenaires, tout en pressant ses alliés, les Babyloniens, les Égyptiens et les Lacédémoniens de lui envoyer des secours à Sardes au printemps. Mais tandis qu’il était occupé à interroger les devins et à faire parler les oracles, Cyrus envahit la Lydie à l’improviste, et parut bientôt sous les murs de Sardes. Crésus n’avait alors à sa disposition que la cavalerie lydienne. Nulle troupe n’était plus brave ni plus habile dans les combats ; le roi sortit de Sardes avec elle pour tenter la fortune. La bataille se livra dans la vaste plaine de Thymbrée, eu avant de la ville. Cyrus, dit Hérodote, redoutant la cavalerie lydienne, suivit le conseil du Mède Harpagus. Il rassembla tous les chameaux qui portaient, à la suite de son armée, les vivres et les bagages, et les fit monter par des hommes équipés en cavaliers, avec ordre de marcher à la tête des troupes. Il commanda en même temps à l’infanterie de suivre les chameaux et posta tous ses cavaliers derrière les fantassins. Cyrus avait ainsi disposé son armée, parce que le cheval ne peut soutenir ni la vue ni l’odeur du chameau[11]. Par ce stratagème il rendait inutile la cavalerie sur laquelle Crésus fondait l’espérance d’une victoire. Les deux armées s’étant avancées pour combattre, les chevaux n’eurent pas plus tôt aperçu et senti les chameaux qu’ils reculèrent, et l’espoir de Crésus fut perdu. Les Lydiens cependant ne se laissèrent pas épouvanter : ils descendirent de cheval et combattirent à pied contre les Perses ; mais après des pertes considérables de part et d’autre, ils prirent la fuite et se renfermèrent dans leurs murailles, où les Perses les assiégèrent. Crésus, espérant que le siège traînerait en longueur, envoya chez ses alliés de nouveaux émissaires, qui devaient demander les plus prompts secours. Déjà les troupes lacédémoniennes étaient prêtes et les vaisseaux équipés, quand un autre courrier apporta la nouvelle que Sardes était pillée et Crésus prisonnier. Cyrus avait promis une récompense considérable à celui qui monterait le premier sur la muraille. Un certain Hyriadès, Marde de nation, regardant un jour un côté de la citadelle qu’on n’avait pas fortifié, parce qu’il semblait inaccessible, vit un Lydien y descendre pour aller chercher son casque qui avait roulé jusqu’en bas, et remonter par le même chemin. Il suivit ses traces ; d’autres Perses montèrent après lui, puis une grande multitude d’hommes ; la ville fut ainsi prise, le quatorzième jour du siège. L’empire des Lydiens fut renversé, et le roi devint captif du nouveau maître de l’Asie, qui le traita avec générosité. C’était vers l’an 549. Mais tant de simplicité dans le récif de la fin d’un grand empire et d’un puissant monarque ne pouvait convenir à l’imagination des Grecs. Il se forma bientôt sur ces événements une légende merveilleuse qu’Hérodote recueillit et que nous allons transcrire. C’est un de ces beaux récits où l’on voit en jeu les oracles de la Grèce, la crédulité des peuples, les dieux sauvant à propos la réputation de leurs prêtres, et la douce moralité de l’harmonieux conteur. Crésus avait un fils doué de toutes sortes de belles qualités, mais qui était muet. Au temps de sa prospérité, Crésus avait tout mis en œuvre pour le guérir, et entre autres moyens, il avait eu recours à l’oracle de Delphes. La Pythie avait répondu : « Insensé Crésus, ne souhaite pas d’entendre en ton palais la voix tant désirée de ton fils ; il commencera à aller le jour où commenceront tes malheurs. » Après la prise de la ville, un Perse allait tuer Crésus sans le connaître. Le roi, accablé du poids de ses malheurs, ne faisait rien pour l’éviter ; mais le jeune prince muet, saisi d’effroi à la vue du Perse que se jetait sur son père, fit un effort qui lui rendit la voix. « Soldat, s’écria-t-il, ne tue pas Crésus ! » Tels furent les premiers mots qui jaillirent spontanément de ses lèvres, et à partir de ce moment il conserva la faculté de parler. Crésus était entre les mains des Perses. Il avait régné quatorze ans et détruit un grand empire, suivant la réponse de l’oracle ; mais cet empire était le sien. Les Perses qui l’avaient fait prisonnier le menèrent à Cyrus. Celui-ci le fit, monter, chargé de fers et entouré de quatorze jeunes Lydiens, sur un grand bûcher dressé exprès, soit pour sacrifier à quelque dieu ces prémices de la victoire, soit pour accomplir un vœu ; soit enfin pour éprouver si Crésus, dont on vantait la piété, serait garanti des flammes par quelque divinité. Crésus, sur le bûcher, se rappela les paroles de Solon : « Que nul homme ne peut se dire heureux tant qu’il respire encore, » et il lui vint à l’esprit que ce n’était pas sans la permission des dieux que ce sage les avait proférées. On assure qu’à cette pensée, revenu à lui-même, il sortit, par un soupir, du long silence qu’il avait gardé, et il s’écria par trois fois « Solon ! » Cyrus, frappé de ce nom, lui fit demander par ses interprètes quel était celui qu’il invoquait. Ils s’approchèrent et l’interrogèrent. Crésus d’abord ne répondit pas ; forcé de parler, il dit : « C’est un homme dont je préférerais l’entretien à toute la richesse des rois. » Ce discours leur paraissant obscur, ils l’interrogèrent de nouveau. Vaincu par leurs instances et leurs importunités, Crésus reprit : « Un jour, Solon d’Athènes vint à ma cour[12]. Il contempla mes richesses, et n’en fit aucun cas. Tout ce qu’il m’a dit alors s’est confirmé par l’événement, et les avis de ce philosophe ne me regardent pas plus que tous les hommes en général, et surtout ceux qui se croient heureux. » Ainsi parla Crésus. Le feu était déjà allumé, et le bûcher s’enflammait par les extrémités. Cyrus, apprenant par ses interprètes la réponse du roi, se repentit de l’ordre qu’il avait donné ; il songea qu’il était homme et que cependant il faisait brûler un homme qui n’avait pas été moins heureux que lui. D’ailleurs, il redouta la vengeance des dieux, et, réfléchissant sur l’instabilité des choses humaines, il commanda d’éteindre promptement le bûcher, et d’en faire descendre Crésus, ainsi que ses compagnons d’infortune ; mais les plus grands efforts ne pouvaient surmonter la violence des flammes. Dans ce moment, si l’on en croit
les Lydiens, Crésus, instruit du changement de Cyrus ; à la vue de cette
foule empressée à éteindre le l’eu sans pouvoir y réussir, implore à grand
cris Apollon, le conjure, si ses offrandes lui ont été agréables, de le
secourir, de le sauver d’un péril si pressant. Ses prières étaient
accompagnées de larmes. Soudain, au milieu d’un ciel pur et serein, des
nuages se rassemblent, un orage éclate, une pluie abondante éteint le bûcher.
Ce prodige apprit à Cyrus combien Crésus était cher aux dieux par sa vertu.
Il le fait descendre du bûcher, et lui dit : « Crésus, quel homme t’a conseillé
d’entrer sur mes terres avec une armée, et de te déclarer mon ennemi au lieu d’être
mon ami ? — Roi, ton heureux destin et mon infortune m’ont jeté dans cette
malheureuse entreprise. Le dieu des Grecs en est la cause ; lui seul m’a
persuadé de t’attaquer. Eh ! quel est l’homme assez insensé pour préférer la
guerre à la paix ? Dans la paix, les enfants ferment les veux de leurs pères
; dans la guerre, les pères « enterrent leurs enfants. Mais enfin il a plu
aux dieux que les choses se passassent de la sorte. » Après ce discours, Cyrus ordonna qu’on lui ôtât ses fers, et le fit asseoir près de lui. Dans ce moment, on pillait encore la ville de Sardes. Crésus conseilla au roi vainqueur d’arrêter ses soldats, et lui indiqua un moyen de leur enlever ces richesses qui devaient les corrompre et les porter à la révolte. Cyrus trouva le conseil très sage, et, pour remercier son captif, il lui promit de lui accorder ce qu’il demanderait. « Maître, répondit Crésus, la plus grande faveur serait de me permettre d’envoyer au dieu des Grecs, celui de tous que j’ai le plus honoré, les fers que voici, en lui faisant demander s’il est permis de tromper ceux qui ont bien mérité de lui. » ... Mais la Pythie fit cette réponse aux Lydiens qu’on avait envoyés : « Crésus a tort de se plaindre : Apollon lui avait prédit qu’en faisant la guerre aux Perses, il détruirait nu grand empire ; il aurait dû envoyer demander au dieu s’il entendait l’empire des Lydiens ou celui de Cyrus. Il n’a pas non plus, en dernier lieu, compris la réponse d’Apollon relativement au mulet. Cyrus fut ce mulet, les auteurs de ses jours étant de deux nations différentes. » Crésus, apprenant cette réponse, reconnut qu’il ne devait attribuer ses malheurs qu’à lui seul. § 6. — SOUMISSION DES VILLES GRECQUES DE L’ASIE-MINEURE. Aussitôt après la soumission de la Lydie, les colonies grecques avaient offert à Cyrus de le reconnaître pour roi aux mêmes conditions que Crésus ; mais le vainqueur répondit par le célèbre apologue du pêcheur qui, n’ayant pu attirer les poissons en jouant de la flûte, les prit tous avec son filet. Il lit cependant exception pour Milet. Il n’exigea pas que cette grande ville se soumit sans conditions, mais il se contenta du tribut qu’elle payait à Crésus, et la détacha ainsi de la cause des autres cités helléniques. Les Ioniens de la côte, car les insulaires étaient à l’abri de toute attaque, fortifièrent leurs villes et se rassemblèrent, pour organiser la résistance, au Panionion, leur sanctuaire commun, dédié à Neptune Héliconien. Là, on résolut unanimement d’envoyer un citoyen de Phocée, Pythermus, demander des secours à Sparte. Les Spartiates répondirent par un refus. Mais, voulant se rendre compte des affaires de l’Ionie et pensant que leur nom aurait quelque poids auprès de Cyrus, ils envoyèrent des députés en Asie ; l’un d’eux alla jusqu’à Sardes pour déclarer au roi de Perse, au nom des Lacédémoniens, qu’il se gardât bien de faire tort à aucune ville de terre grecque, qu’autrement Sparte ne le souffrirait point. Cyrus reçut cette injonction avec mépris et répondit que c’était à Sparte de craindre d’éveiller sa colère. Il donna ensuite le gouvernement de Sardes à un Perse nommé Tabalus, et ayant chargé le Lydien Pactyès de transporter en Perse les trésors de Crésus et de la Lydie, il retourna à Ecbatane, emmenant Crésus avec lui. Peu après il se mit en campagne pour soumettre les pays situés dans l’est de ses Étals, au nord de l’Indou-Kousch, c’est-à-dire les contrées qui furent le berceau du zoroastrisme. Dès qu’il eut le dos tourné, Pactyès insurgea les Lydiens et assiégea Tabalus dans la citadelle de Sardes. Cyrus envoya aussitôt dans le pays le Mède Mazarès avec mie forte armée. Mazarès ne trouva pas de résistance, et, pour prévenir toute autre révolte, il opéra le désarmement général de la Lydie. Pactyès s’étant enfui à Cymé dans l’Éolide, Mazarès somma les habitants de le lui livrer. Les Cyméens, craignant la vengeance des Perses et ne voulant pas cependant irriter les dieux en livrant un suppliant, transportèrent Pactyès à Chios, dont les habitants le remirent au général perse, en échange du district d’Atarnée, sur la côte de Lydie, en face de Lesbos. Ainsi, dit M. E. Curtius, les plus saints devoirs furent sacrifiés aux plus vils calculs d’intérêt, non par des particuliers, mais par un acte officiel engageant l’État tout entier. Il n’y eut que les prêtres pour protester contre la violation de l’asile sacré : ils lancèrent la malédiction sur le territoire acquis au prix d’un tel sacrilège. C’est de cette façon que les Perses apprirent à connaître les populations maritimes de l’Ionie. Pouvaient-ils faire autrement que de concevoir pour elles le plus profond mépris ? Le satrape Mazarès marcha ensuite contre les villes grecques qui avaient fourni des secours aux rebelles. Priène fut prise ; il en vendit les habitants comme esclaves, ravagea la vallée du Méandre et le territoire de Magnésie ; mais peu de temps après, il tomba malade et mourut presque subitement. Harpagus fut envoyé pour le remplacer et continuer la guerre contre les Ioniens. Il prenait leurs villes en élevant contre les murs des terrasses qui en atteignaient le faîte ; il avait un corps d’archers qui s’était rendu redoutable et savait, avec des engins et des machines, conduire un siège en règle. Phocée fut ainsi assiégée ; mais ses habitants donnèrent un grand exemple de patriotisme. Voyant qu’il leur était impossible de résister, ils prièrent Harpagus de retirer ses troupes pendant qu’ils délibéreraient sur les conditions qu’on leur avait proposées. Ils lancèrent alors leurs vaisseaux à la mer, y firent monter les femmes et les enfants, placèrent au milieu d’eux les statues de leurs divinités, et se dirigèrent vers Chios. Arrivés dans celle île, ils voulurent acheter aux habitants les îles Œnusses ; mais ceux-ci, redoutant pour leur commerce le voisinage d’un peuple actif et entreprenant, repoussèrent cette demande. Les fugitifs remirent la voile et se retirèrent, partie à Alalia dans la Corse et partie à Marseille, deux colonies qu’ils avaient fondées depuis un petit nombre d’années. Avant de s’éloigner pour toujours de l’Asie Mineure, ils revinrent à Phocée, surprirent la garnison perse et l’égorgèrent. Puis, faisant les plus terribles imprécations contre ceux qui se sépareraient de la flotte, ils jetèrent dans la mer une masse de fer rougi au feu, jurant de ne pas retourner à Phocée avant que cette masse ne revint sur l’eau telle qu’ils l’y avaient,jetée. Pourtant, au moment du départ, la moitié du peuple sentit sa constance fléchir et revint dans la ville. Le reste lit voile vers l’Occident, et dit un éternel adieu à la terre natale. Les Téiens suivirent l’exemple des Phocéens, et allèrent en Thrace peupler et rebâtir la ville d’Abdère, fondée quelque temps auparavant par Timésias de Clazomène. Bias de Priène fut un des plus ardents à pousser les patriotes Ioniens à l’émigration. Vous n’avez plus, leur disait-il en leur citant l’exemple des Phocéens, que le choix entre deux partis : laisser périr la patrie ou refaire l’honneur et assurer la gloire du nom ionien. Toutes les villes tombèrent successivement au pouvoir du vainqueur et acceptèrent ses lois ; plusieurs insulaires, qui avaient des domaines sur le continent, comme ceux de Chios et de Lesbos, crurent prudent de désarmer sa colère par une soumission volontaire. Milet seule, qui avait traité avec Cyrus, ne fut pas inquiétée. La Carie et la Lycie eurent ensuite le même sort que l’Ionie. Harpagus dut livrer, près d’Halicarnasse, une grande bataille aux Pédasiens retranchés dans leur citadelle de Lida. En Lycie, la ville d’Arina, que les Grecs appelèrent plus tard Xanthos, se signala par une défense indomptable. Les habitants, ne pouvant plus résister, se brûlèrent eux-mêmes dans leurs maisons avec leurs femmes et leurs enfants. Caunus imita cet héroïque désespoir qui fait présager Léonidas aux Thermopyles. Harpagus, en récompense de ses services, reçut la satrapie lycienne dans les conditions d’une souveraineté héréditaire, vassale du roi de Perse. Les récentes explorations y ont fait découvrir des monuments très importants de son fils Kaïas, aujourd’hui conservés au Musée Britannique. § 7. — DESTRUCTION DE LA MONARCHIE BABYLONIENNE. Cyrus, marchant de conquêtes en conquêtes, aspirait à la domination de toute l’Asie. Pour réaliser ce rêve dans une proportion bien plus étendue qu’aucun monarque n’avait encore osé le concevoir, il ne lui restait plus qu’à détruire l’empire chaldéen de Babylone, fondé par Nabopolassar et Nabuchodonosor avec les débris de la vieille monarchie assyrienne, mais déjà tombé dans une complète décadence. Babylone prise et ses provinces passées, par sa chute même, aux mains du chef des Perses, il ne devait plus subsister, dans toute l’Asie alors connue, que l’Inde lointaine et les steppes où erraient les Scythes touraniens, au nord de la mer Caspienne, qui n’obéissaient pas aux ordres de Cyrus. Et sans doute il comptait bien un jour les soumettre à leur tour, une fois Babylone vaincue. La conquête de l’Ariane terminée, il se tourna donc contre les Chaldéens et marcha droit sur leur capitale (539), pensant qu’il lui suffirait de s’en rendre maître pour devenir du même coup souverain de tout l’empire. Il avait halte d’ailleurs de punir le roi Nabonid d’avoir fait un traité d’alliance avec Crésus, pour essayer de ruiner l’empire naissant des Perses. Il partit, à la tête de son armée, d’Ecbatane en Médie, où il faisait sa résidence habituelle, ayant abandonné la ville d’Ansan dans la Perse proprement dite, capitale qui ne lui parut pas en rapport avec la puissance et l’éclat de sa nouvelle royauté. Bientôt on arriva sur les bords du Gyndès, affluent du Tigre. Comme on essayait de le traverser, un de ses chevaux blancs qu’on appelait sacrés et que le commerce apportait à grands frais de Nysa dans le nord de l’Inde, entraîné par le courant, disparut. Cyrus, si l’on en croit Hérodote, irrité de l’insulte du fleuve, jura qu’il le rendrait si petit et si faible que, dans la suite, les femmes même pourraient le traverser sans se mouiller les genoux. Aussitôt il suspend l’expédition, partage son armée en deux corps, creuse de chaque côté du fleuve cent quatre vingt canaux et y détourne le Gyndès. A force de succès, la folie du pouvoir avait fini par saisir Cyrus, et sa puissante intelligence, tout comme plus tard la faible tête de Xerxès, voulait châtier la nature quand elle ne lui obéissait pas comme les hommes. Cette entreprise occupa tout l’été. Au printemps suivant, Cyrus parut devant Babylone, battit une armée sortie de la place, franchit les murailles de l’immense camp retranché de Nabuchodonosor, que leur développement insensé d’exagération rendait impossibles à défendre d’une manière efficace, et commença le siège de la ville elle-même, où Bel-sar-ussur (le Balthasar de Daniel), fils du roi, avait pris le commandement de la résistance, tandis que son père Nabonid s’enfermait dans sa résidence royale de Tema. Les Babyloniens, qui depuis longtemps se sentaient menacés, avaient fait de grands préparatifs de défense, rassemblé des vivres, creusé de nouveaux fossés et réparé leurs remparts ; aussi le siège ne les effrayait pas. Nous avons déjà dit, dans le livre consacré à Babylone, comment Cyrus réussit à le mener à bonne fin et à surprendre la vieille cité chaldéenne endormie dans l’ivresse d’une fête orgiastique (en 538) ; toutes les provinces de l’empire se soumirent sans résistance au vainqueur, et furent incorporées à la monarchie perse. Ces faits assez obscurs et dans lesquels la légende s’est quelque peu glissée, ont été vivement éclairés par la découverte de deux inscriptions cunéiformes actuellement conservées au Musée Britannique, et dont nous avons déjà parlé. Jusqu’à ces récentes découvertes, les inscriptions cunéiformes de Cyrus n’étaient qu’au nombre de trois, qui n’apportaient qu’un bien faible contingent à l’histoire de ce prince. L’une d’elles pourtant, trouvée à Senkérch par Loftus, en 1850, se compose de ces quatre lignes qui sont la reproduction presque textuelle d’une formule des anciens rois de Babylone : Cyrus
.......... reconstructeur du
E-Sagil et du E-Zida fils de
Cambyse roi puissant, moi. Écrite dans la langue des Babyloniens, c’est-à-dire des vaincus de Cyrus, rédigée dans la formule usitée antérieurement par les rois de Babylone eux-mêmes, cette inscription indiquait que Cyrus suivit les mêmes usages que ces derniers dans la rédaction des textes officiels de sa chancellerie ; que, comme Nabuchodonosor, Nabonid et d’autres monarques chaldéens qui s’en vantent sur leurs monuments, Cyrus avait restauré les principaux temples ou palais de la Babylonie ; enfin, Cyrus, dans ce texte, donne à son père le titre de roi, fait important puisque les historiens grecs, Hérodote en particulier, prétendent que le père de Cyrus n’a pas régné. A ces documents, il convient d’ajouter encore quelques contrats d’intérêt privé, datés du règne de Cyrus, dans lesquels ce prince est qualifié « roi de Babylone, » titre qu’ont d’ailleurs conservé tous les princes achéménides. Les inscriptions nouvelles auxquelles nous avons fait allusion tout à l’heure, sont en caractères cunéiformes babyloniens et en langue assyrienne. Ni le perse des inscriptions de Persépolis et de Béhistoun, c’est-à-dire la langue nationale des Achéménides, ni la langue des Mèdes, ni celle de Suse, qui toutes ont fait usage de l’écriture cunéiforme, n’ont pénétré à la suite de Cyrus, en Mésopotamie. Dans leur pays d’origine, les Achéménides se sont, servi de trois langues pour la rédaction de leurs inscriptions monumentales, mais ce système ne fut pas étendu à toutes les parties de leur empire. En Mésopotamie, Cyrus et ses successeurs se sont servis exclusivement de la langue assyrienne, et c’est par des savants babyloniens de la chancellerie des anciens rois, que leurs écrits officiels étaient rédigés. La première de ces inscriptions énumère chronologiquement les événements les plus importants des dix-sept années du règne de Nabonid et de la première année du règne de Cyrus comme roi (le Babylone. Après le récit de la campagne des Perses contre Astyage, elle poursuit en racontant une courte et peu importante expédition du roi de Chaldée Nabonid, en Syrie, du côté de l’Amanus et du Liban, la retraite de ce prince indolent dans la ville de Téma, le mécontentement des dieux qui abandonnent Babylone, la présence de Bel-sar-ussur (Balthasar) fils du roi et de la mère du roi sur la frontière du pays d’Accad : Au mois de Nisan, le cinquième jour, la mère du roi qui était dans une forteresse et dans un camp sur l’Euphrate, au delà de Sippar, mourut. Le fils du roi et ses soldats la pleurèrent pendant trois jours, dans le mois de Sivan (troisième mois, mai-juin), au pays d’Accad ; ils pleurèrent sur la mère du roi. Dans le mois de Nisan, Cyrus, roi de Perse, rassembla son armée, et au-dessous de la ville d’Arbèles, il traversa le Tigre. Dans la dixième année, le roi était à Téma ; le fils du roi, les grands et les soldats étaient dans le pays d’Accad ; le roi, jusqu’au mois de Nisan, ne vint pas à Babylone, le dieu Nabu n’y vint plus ; Bel n’y vint plus désormais ; on offrit un sacrifice expiatoire ; des victimes furent immolées dans le E-Sagil et le E-Zida pour apaiser les dieux protecteurs de Babylone et de Borsippa... Au mois de Tammuz (quatrième mois, juin-juillet), Cyrus livra, à Routou, une bataille contre ..... du fleuve de Nizallat, au milieu de l’armée du pays d’Accad.. Les hommes d’Akkad se révoltèrent ; le quatorzième jour, les guerriers de Cyrus prirent Sippar sans coup férir ; Nabonid s’enfuit. Le seizième jour, Gobryas (Gubaru) gouverneur du pays de Guti, avec l’armée de Cyrus, descendit sans combat vers Babylone. Ensuite, il prit dans Babylone, Nabonid qu’il y avait resserré. A la fin du mois de Tammuz, les hommes du pays de Guti fermèrent les portes du E-Sagil et des temples, pour qu’ils ne servissent pas de lieu de ralliement aux ennemis ; on n’y laissa pas d’armes. Au mois de Ara’h-Samna (huitième mois, octobre-novembre), le troisième jour, Cyrus entra à Babylone ; ... il établit la paix dans la ville : Cyrus promit la paix à Babylone, et il établit Gobryas gouverneur de la ville, et d’autres pour gouverner sous ses ordres. A partir du mois de Kislev jusqu’au mois de Adar, les dieux d’Accad que Nabonid avait emmenés à Babylone, furent rapportés dans leurs sanctuaires. La seconde inscription est comme la paraphrase de la précédente. Elle raconte que les dieux avaient abandonné Babylone à cause de l’impiété du roi. C’est Marduk lui-même, le prince de l’Olympe babylonien, qui suscite Cyrus pour délivrer le pays, et rétablir le culte des dieux avec l’ordre et la paix. Le roi des dieux (Marduk) s’était profondément affligé de cette humiliation, et tous les dieux qui habitent les temples de Babylone avaient abandonné leurs sanctuaires ; Marduk et les autres divinités ne vinrent plus aux processions de Kalanna ; ils se retirèrent dans d’autres villes qui ne leur refusaient pas leurs hommages. Cependant, le peuple de Sumer et d’Accad, tout en deuil, le pria de revenir. Marduk accueillit leurs sollicitations et leur donna satisfaction en choisissant un roi pour gouverner le pays selon sa volonté divine. Il proclama Cyrus (Kurus) roi de la ville d’Ansan, comme roi du monde entier et il annonça ce titre à toutes les nations. Le pays de Guti et tous les peuples qu’il avait déjà soumis à ses pieds, Cyrus les gouvernait en droiture et en justice. Marduk, le grand seigneur, le restaurateur de son peuple, vit avec joie les actions de son vicaire, la justice de ses mains et de son cœur. Il lui ordonna de marcher contre Babylone, sa propre ville, et il conduisit l’armée perse comme un ami et comme un bienfaiteur. Ses troupes dont la masse est comme les flots de l’Euphrate et les épées de ses soldats ne furent qu’un vain ornement : Marduk les conduisit sans combat et sans rencontrer de résistance jusqu’à Kalanna, puis il cerna et conquit sa propre cité. Nabonid, le roi qui l’avait méprisé, il le livra dans les mains de Cyrus. Les habitants de Babylone, en totalité, et ceux des pays de Sumer et d’Accad, les nobles et les prêtres qui s’étaient soulevés contre Nabonid et s’étaient refusés à lui baiser plus longtemps les pieds, tous se réjouirent de l’avènement de Cyrus et lui jurèrent fidélité, car le dieu qui ramène les morts à la vie et qui est secourable dans tout malheur et dans toute angoisse, lui avait accordé sa faveur. La totalité des rois qui demeurent dans des palais, de toutes les contrées, depuis la Mer Supérieure (Méditerranée) jusqu’à la Mer inférieure (golfe Persique) habitant... tous les rois de la Phénicie et du.... ont apporté leur riche tribut dans Kalanna (palais de Babylone) et ont embrassé mes pieds. Depuis... jusqu’aux villes d’Assur et d’Istar... Agadé, Isnunnah, Zamban, Me-Turnu, Duran, jusque vers le pays de Guti, au delà du Tigre dont les demeures avaient été depuis longtemps déplacées ; les dieux qui demeuraient au milieu d’eux, je les ai réinstallés à leurs places et je leur ai élevé des demeures vastes et permanentes. .J’ai aussi réuni tous leurs peuples et je les ai fait retourner dans leurs contrées. Et les dieux des pays de Sumer et d’Accad que Nabonid, en dépit du seigneur des dieux, avait fait, entrer dans Kalanna, d’après la parole de Marduk, seigneur grand, en paix je les ai rétablis dans leurs sanctuaires, leur demeure agréable. Que tous les dieux que j’ai rétablis, interviennent journellement devant Bel et Nuba afin d’obtenir pour moi une longue vie ; qu’ils augmentent ma prospérité et qu’ils disent à mon seigneur Marduk : A Cyrus, roi, ton serviteur, et à Cambyse, son fils, sois propice. D’après ces textes, ce fut dans la dix-septième année du règne de Nabonid que Cyrus pénétra en Chaldée, et livra bataille, à Routou, non loin de Babylone. Sur ces entrefaites, les habitants de Babylone se révoltèrent contre Nabonid qui s’était fait détester par son impiété, et le 14 du mois de Tammuz (juin-juillet) la ville de Sippar, la Sepharvaïm de la Bible, ouvrit ses portes au conquérant. Nabonid, fugitif, fut fait prisonnier, deux jours après, par un des lieutenants de Cyrus, Gubaru, dont le nom se retrouve dans Hérodote sous la forme Gobryas. Les armées que commandait le fils de Nabonid, Balthasar, et qui gardaient les forteresses du pays d’Accad, furent vaincues. Alors Cyrus se dirigea sur Babylone dont il s’empara, sans résistance, le 3 du mois de Ara’h-Samna (septembre-octobre) 538. Les documents cunéiformes insistent sur ce fait, que la conquête de Cyrus fut pacifique, et que Babylone et la Chaldée furent soumises sans résistance. Tous les peuples de l’Asie occidentale paraissent, en effet, avoir accepté avec indifférence, sinon avec joie comme les Juifs, la domination aryenne. Cyrus pouvait donc dire que, de la Méditerranée au golfe Persique, il reçut les tributs et les hommages des rois qui vinrent se prosterner à ses pieds, à Babylone. Le monarque perse accomplit la mission que lui assigne le prophète Isaïe : il fut un messie, l’oint de Jéhovah, celui qu’aime Jéhovah ; lui-même, dans une des inscriptions citées plus haut, se proclame l’envoyé de Dieu. Xénophon raconte qu’avant son expédition, Cyrus traita avec les Assyriens, pour que les habitants des campagnes et particulièrement les agriculteurs n’eussent rien à souffrir des maux de la guerre, et il ajoute qu’il fut accueilli partout pacifiquement. Les documents cunéiformes cités plus haut nous informent que Cyrus renvoya dans leur patrie tous les peuples que les monarques babyloniens retenaient dans les fers : J’assemblai ces peuples et je les fis retourner dans leurs contrées. Ce texte est donc en parfait accord avec la Bible qui raconte qu’après la prise de Babylone, Cyrus faisant droit aux sollicitations que lui adressaient les Hébreux répandus dans ses États, publia un édit permettant le retour des exilés dans la Palestine et. la reconstruction du Temple de Jérusalem, édit dont le texte nous a été conservé dans le livre d’Esdras : Ainsi dit Cyrus, roi de Perse. Jéhovah, le dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre, et c’est lui qui m’a ordonné de lui bâtir un temple à Jérusalem, qui est en Judée. Quiconque d’entre vous est de son peuple, que son dieu soit avec lui, qu’il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et qu’il rebâtisse le temple de Jéhovah, dieu d’Israël ; c’est le dieu qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui, faute de moyens, resteront en arrière dans les endroits où ils sont établis, les gens de l’endroit les aideront avec de l’argent, de l’or, du bétail et d’autres biens, outre le don volontaire pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Un Israélite du nom de Sasbasar fut nommé par le roi gouverneur de Jérusalem et du pays immédiatement environnant ; car, malgré la destruction du Temple et tous les ravages de Nabuchodonosor, il était resté un noyau assez considérable de population dans l’antique capitale du royaume de Juda. Par l’ordre de Cyrus, le trésorier Mithradate remit à Sasbasar les vases d’or et d’argent du Temple, enlevés par Nabuchodonosor et conservés, depuis lors, comme trophées à Babylone. Le nouveau gouverneur partit avec une troupe d’exilés et aussitôt après son arrivée à Jérusalem, commença les fondations d’un nouveau temple. Il importe de remarquer que ce rapatriement des Juifs ne fut point spécial à ce peuple qui ne fit que bénéficier d’une mesure générale, et s’il est un point sur lequel nous devons insister, c’est sur la politique religieuse de Cyrus, et son rôle comme restaurateur des temples des peuples vaincus. A l’opposé de Darius, le premier conquérant perse ne dit rien de la divinité suprême du mazdéisme, Ahura-Mazda. En revanche, il invoque Jéhovah avec les Juifs, et pour flatter les Chaldéens, il rend hommage aux dieux de Babylone. Il considère Marduk comme le chef des dieux, le dieu suprême ; il invoque aussi les autres divinités babyloniennes et il se montre polythéiste à la façon des anciens rois chaldéens. Mais sa conduite à l’égard des dieux des autres nations est surtout différente de celle des monarques de Ninive ou de Babylone. Taudis que ceux-ci pillent les temples et emportent dans leur capitale les trésors et les idoles des peuples vaincus, Cyrus, au contraire, rend à ces peuples leurs divinités, et leur permet de restaurer leurs temples. Loin donc de regarder ce prince comme un sectateur ardent du mazdéisme, qui n’aurait comblé les Juifs de ses faveurs que parce qu’il aurait remarqué certaines conformités de doctrine entre leur religion et la sienne, comme, par exemple, la croyance à un Dieu unique, il faut au contraire envisager le monarque perse comme un prince tolérant, qui a laissé les différentes nations groupées sous son sceptre, libres de retourner à leurs anciens cultes. Il faut se garder de prendre à la lettre les passages des prophètes juifs, dans lesquels se trouve prédite la chute des idoles de Babylone. Isaïe s’écrie : Bel s’incline, Nebo tombe ; on charge leurs statues sur des bêtes de somme. Ces idoles que vous portiez vous-mêmes, deviennent le fardeau d’animaux fatigués. Elles s’inclinent, elles tombent ensemble ; elles ne peuvent soulager leurs porteurs ; elles vont elles-mêmes en captivité. Le prophète n’a pas seulement en vue, ici, l’invasion de Cyrus ; il fait en même temps allusion à tous les désastres qui, plus lard, devaient fondre sur l’antique capitale de la Chaldée. Quant à Cyrus, sectateur sans doute du mazdéisme en Perse, il était adorateur de Marduk et de Nabu à Babylone ; il ne paraît avoir fait aucun effort, pour propager la religion des Perses parmi les races sémitiques, et il ne fut point ce qu’on l’a souvent représenté, un grand destructeur d’idoles et de faux dieux[13]. § 8. — LES ARYENS ET LES MASSAGÈTES. - MORT DE CYRUS. Avant la conquête de Babylone, pendant qu’Harpagus domptait l’Asie Mineure, nous dit Hérodote, Cyrus subjuguait en personne la Bactriane et toutes les nations de l’Asie Supérieure. C’est à ces quelques mots que se réduisent, les renseignements que l’histoire classique nous a légués sur une des parties les plus considérables des conquêtes dit fondateur de la monarchie perse, la soumission des nations comprises entre la chaîne de l’Indou-Kousch au nord, les déserts de la Carmanie à l’ouest, la mer Érythrée au sud, et les monts Parsyens à l’est. Ces nations lointaines n’avaient jamais subi le joug des Mèdes ; à partir de Cyrus nous les voyons dépendre de l’empire des Perses. Ce fut leur réduction qui occupa le conquérant dans l’intervalle compris entre la guerre de Lydie et la guerre de Babylone. Là, se trouvaient les riches provinces de l’Asie, de la Drangiane et de l’Arachosie, qui composent l’Afghanistan actuel. Elles étaient habitées par des tribus aryennes appartenant au même rameau que celles qui avaient fait la conquête de l’Inde. La réforme zoroastrienne n’avait pas été adoptée parmi elles ; le brahmanisme, avec son mysticisme panthéistique, et le régime des castes ne s’y étaient pas non plus constitués comme dans l’Inde. Ces nations suivaient donc encore, à peu de chose près, la religion antique des Védas. La langue que l’on parlait dans cette région était un des idiomes vulgaires dérivés du vieux sanscrit védique, le pâli, destiné à devenir plus tard la langue sacrée d’une grande partie des pays bouddhistes. On l’écrivait, dans toute cette vaste contrée, spécialement désignée sous le nom d’Ariane par les géographes classiques, avec un alphabet particulier, différent de ceux de l’Inde et d’origine sémitique. Les nations aryennes situées entre l’Hindou-Kousch et les monts Parsyens, qui séparent l’Ariane de la vallée de l’Indus, ne paraissent pas, à en juger par le peu de temps que réclama leur conquête, avoir opposé une bien sérieuse résistance à Cyrus. Les peuples qui habitaient sur les pentes du Caucase indien, Sattagydes et Aparytes (en sanscrit Parada), furent aussi compris dans la conquête perse. Enfin cette conquête, dès le temps de Cyrus, s’étendit au delà de l’Hindou-Kousch, dans le Caboul actuel, sur toute la vallée du Cophès (Koubba) et le pays des Gandariens (Gandhâra), par lequel l’empire des Achéménides vint dès lors toucher à l’Indus dans son cours supérieur. Les principales villes de ces dernières provinces étaient Kapiçâ, plus tard appelée Alexandrie d’Arie, Kabura, ou Ortospana, aujourd’hui Caboul, Nagara, aujourd’hui Djelalabad, et Puruschapura, aujourd’hui Peschaver. Au midi de l’Ariane, le long de la côte de la mer Érythrée, stérile et dépourvue de bons ports, les Aryas ne s’étaient pas étendus. Là se trouvait la Gédrosie, le Beloutchistan de nos jours, où Hérodote place ses Éthiopiens asiatiques, derniers débris des habitants primitifs de la race de Kousch, qui avaient jadis établi leur empire à Suse et dont un rameau s’était vu refoulé à l’est par l’invasion des tribus japhétiques. Ils étaient pauvres et menaient une vie toute barbare, comme encore aujourd’hui les habitants du même pays, qui semblent devoir être regardés comme leurs descendants. Malgré cette pauvreté, qui paraissait de nature à les mettre à l’abri, Cyrus les soumit à son sceptre. Le conquérant perse ne changea rien, du reste, aux divisions et aux coutumes établies avant sa conquête chez les peuples de cette région ; il se contenta d’imposer des tributs permanents, de laisser quelques garnisons dans les points stratégiques les plus importants et de lever des contingents pour ses armées. L’empire qu’il fondait était en effet un empire exclusivement militaire. C’est sur ces entrefaites que Cyrus attaqua Babylone. Après la prise de la capitale de la Chaldée en 538, le roi des Perses régna en paix pendant huit ans. En 529, soit passion insatiable de conquêtes, soit vieille haine des peuples de l’Iran contre ceux de Touran, soit désir de châtier les incursions de voisins incommodes, il entreprit une nouvelle guerre contre les Massagètes, dit Hérodote, contre les Derbices, dit Ctésias, mais c’était sans doute une tribu du même peuple. La nation des Massagètes, le Magog de la Bible, de race touranienne ou turque, habitait les steppes au nord de l’Iaxarte. Ce fut dans cette guerre que le conquérant perse trouva la mort. Hérodote nous en a conservé un récit qu’il avait recueilli au cours de son voyage en Médie. Suivant lui, Cyrus profita, pour attaquer les Massagètes, de ce que le peuple se trouvait gouverné par une femme, dont il espérait avoir plus facilement raison. Il rassembla une nombreuse armée, établit des ponts sur l’Iaxarte et passa sur l’autre rive. La reine Thomyris lui envoya un héraut pour lui proposer une sorte de rencontre, en champ clos, des deux armées sur le terrain qu’il choisirait, sur l’une ou l’autre rive du fleuve. Il choisit la rive massagète ; mais au lieu de venir à un combat loyal, il prépara une embûche, sur le conseil de Crésus, qui l’accompagnait dans cette expédition. Elle consistait à laisser presque sans défense son camp, rempli de provisions de toute nature, de manière à ce que les Massagètes pussent y entrer facilement pour le piller, puis de tomber sur eux à l’improviste avec le gros de l’armée qu’on cacherait à cet effet. Cyrus, dit Hérodote, s’étant avancé à une journée de l’Iaxarte, laissa dans son camp ses plus mauvaises troupes et retourna vers le fleuve avec les meilleures. Les Massagètes vinrent attaquer le camp avec le tiers de leurs forces et passèrent au fil de l’épée ceux qui le gardaient. Voyant ensuite toutes choses prêtes pour le repas, ils se mirent à table, et, après avoir mangé et bu avec excès, ils s’endormirent. Les Perses survinrent alors, en tuèrent un grand nombre et tirent encore plus de prisonniers, parmi lesquels Spargapithès, « celui qui aide dans le combat, » (dans la langue des Touraniens de la Médie sbarrak pikti), leur général, fils de Thomyris. Cette reine envoya aussitôt un
héraut à Cyrus : « Prince altéré de sang, lui disait-elle, que ce succès
n’enfle point ton orgueil ; tu ne le dois qu’au de la vigne, qu’à cette
liqueur qui rend insensé. Tu as remporté la victoire sur mon fils, non dans
une bataille et par tes propres forces, mais par l’appât de ce poison
destructeur. Écoute et suis un bon conseil. Rends-moi mon fils, et après
avoir défait la plus facile partie de mon armée, je veux bien encore que tu
te retires impunément de mes États. Sinon, j’en jure par le Soleil, le
souverain maître des Massagètes, oui, je t’assouvirai de sang, quelque altéré
que tu en sois. » Cyrus ne tint aucun compte de ce
discours. Quant à Spargapithès, étant revenu de son ivresse, il pria Cyrus de
lui faire ôter ses chaînes. Il ne se vit pas plus tôt en liberté qu’il se
tua. Thomyris rassembla alors toutes ses forces et livra bataille. Les deux
armées étaient à quelque distance l’une de l’autre : on se lança d’abord
une multitude de flèches ; les flèches épuisées, les soldats fondirent
les uns sur les autres à coups de lance, et se mêlèrent l’épée à la main. On
combattit longtemps de pied ferme avec un avantage égal et sans reculer.
Enfin la victoire se déclara pour les Massagètes. La plus grande partie de
l’armée des Perses périt en cet endroit. Cyrus lui-même fut tué. Il avait
régné vingt-neuf ans accomplis ; c’était en 529. Thomyris, ayant fait
chercher ce prince parmi les morts, maltraita son cadavre et lui fit plonger
la tête dans une outre pleine de sang humain, en disant : « Quoique vivante
et victorieuse, tu m’as perdue en faisant périr mon fils ; mais je
t’assouvirai de sang comme je te l’ai promis. » Cependant les Perses parvinrent à reconquérir le corps de Cyrus, qui fut somptueusement enseveli à Parsagade, à côté du palais royal. Les restes du mausolée qu’on lui attribue généralement subsistent encore sur l’emplacement de cette ville[14]. A une courte distance, on voit les ruines de son palais ; elles se composent principalement de cinq piliers monolithes, de très fortes dimensions, et d’un bas-relief sur lequel est sculptée la figure du roi presque divinisée, telle que les Perses se représentaient les âmes glorifiées dans l’autre vie, admises à siéger avec les Amschaspands et les Yazatas célestes ; elle est munie de quatre grandes ailes à l’assyrienne. Au-dessus de sa tête plane l’image d’Ahura-Mazda ou Ormuzd. Une courte inscription cunéiforme accompagne la figure royale ; elle est ainsi conçue : Moi, je suis Cyrus le roi, Achéménide. Ce prince que les légendes postérieures se complurent à dépeindre comme le type idéal du monarque juste, fort et clément, fut un grand conquérant ; il fonda l’empire perse, mais le temps lui manqua pour en organiser le gouvernement : ce sera l’œuvre de Darius. |