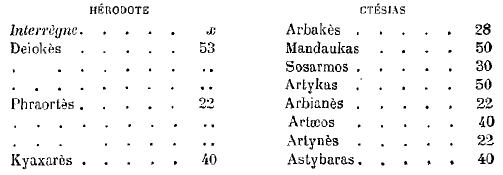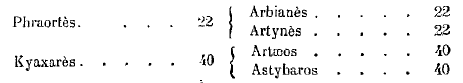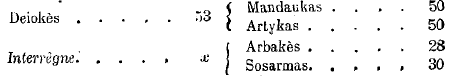LES MÈDES ET LES PERSES
CHAPITRE II — LES MÈDES ET LEUR EMPIRE[1].
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — LE ZOROASTRISME EN MÉDIE Une réforme religieuse aussi radicale et aussi importante que celle de Zoroastre ne pouvait s’établir sans de grandes résistances. Aussi, les récits orientaux sur la vie du législateur et les témoignages des historiens classiques sont-ils d’accord pour dire que sa doctrine rencontra dans une partie des Aryas une opposition décidée, qui se traduisit par des luttes à main armée, des guerres religieuses. Mais de qui vinrent ces résistances ? Les Iraniens paraissent avoir rapidement adopté tous les principes du mazdéisme, qui s’accordaient probablement avec leurs tendances naturelles ; d’ailleurs le réformateur était sorti du milieu d’eux, et c’était une puissante raison pour qu’ils se serrassent autour de lui. Ses adversaires se trouvèrent donc probablement parmi les tribus qui devaient conquérir l’Inde, tribus dans le sacerdoce desquelles les tendances panthéistiques qui donnèrent naissance au brahmanisme s’étaient déjà répandues, au moins à l’état de germe. En effet, comme nous l’avons dit, on peut établir sur des preuves tout à fait décisives que la réforme et la prédication de Zoroastre eurent lieu non en Médie, mais dans la Bactriane, et qu’elles furent antérieures au grand mouvement de migration par lequel les deux rameaux des Aryas, jusque-là coexistants sur le même territoire, se séparèrent et prirent leur route dans deux directions opposées, l’un à l’ouest et l’autre à l’est, pour y chercher de nouvelles habitations. Ceci étant, lorsque, d’un côté, les légendes persanes sur Zoroastre, qui contiennent certainement une part de vérité historique, représentent ses principaux et ses plus ardents antagonistes comme faisant partie du sacerdoce des tribus aryo-indiennes, — ces légendes les qualifient de brahmanes par un anachisme facile à comprendre et à rectifier — lorsque, de l’autre côté, nous voyons les hymnes du Rig-Vêda poursuivre de malédictions Djaradâschti, c’est-à-dire Zoroastre, et le ranger parmi les ennemis des dieux, on est amené à suivre l’opinion, soutenue déjà par d’excellents esprits, qui voit dans la scission produite par la réforme de Zoroastre, et dans les querelles religieuses qui en découlèrent, la cause déterminante de la séparation définitive des tribus aryennes en iraniens et Indiens, et de l’émigration par laquelle elles se tournèrent le dos. Les tribus fidèles à la religion védique et hostiles à la réforme de Zoroastre paraissent avoir eu le dessous dans la lutte qui s’engagea ainsi sur les questions de dogme et de culte. Elles durent, en effet évacuer complètement la Bactriane, berceau premier de la race, qui resta la possession exclusive de leurs adversaires, et elles se retirèrent en masse de l’autre côté de la chaîne de l’Hindou-Kousch, que quelques-unes d’entre elles avaient déjà franchie du côté d’Attok pour aller occuper le pays auquel elles valurent le nom d’Arie. Delà, s’avançant toujours vers l’est et le sud, elles occupèrent successivement le Paropamisus, la Drangiane, l’Arachosie et pénétrèrent dans la partie nord de la vallée de l’Indus, d’où leur domination finit, après une lutte de mille ans contre les populations autochtones de race chamitique, par s’étendre sur toute la péninsule indienne. Dès lors, séparées par les montagnes escarpée de l’Hindou-Kousch, les déserts de la Carmanie et la côte stérile de la Gédrosie, les deux fraction de la race des Aryas cessèrent pour un grand nombre de siècles d’avoir aucun contact ; et dans cet isolement réciproque, les différences de leurs génies propres, de leurs religions et de leurs langues allèrent toujours en se prononçant de plus en plus. Les Iraniens, sectateurs de Zoroastre, gardèrent la Bactriane, la Sogdiane et la Margiane, où une portion de leurs tribus y demeura fixée ; quant aux autres, obligées à l’émigration par l’accroissement de leur population, un de leurs principaux rameaux descendit droit au sud, sur la Perse proprement dite et jusque sur les bords du golfe Persique ; un autre se dirigea vers le sud-ouest, en traversant l’Hyrcanie, et envahit la Médie, où il subjugua les tribus touraniennes qui y étaient déjà cantonnées et qu’il parvint, sans doute, assez vite à s’assimiler ; les plus hardis des Iraniens se précipitèrent sur la partie fertile de la Carmanie, où la ville de Yezd devint un des principaux centres du culte mazdéen ; enfin sur la Susiane dont ils chassèrent les habitants primitifs, les Éthiopiens de Memnon, de race kouschite, décrits dans les légendes iraniennes et chez Homère, comme des hommes au teint noir, aux cheveux courts et laineux et dont les dernières fouilles de M. Dieulafoy paraissent avoir retrouvé des traces. Mais si l’on jette les yeux sur une carte géographique de l’Orient, on s’apercevra au premier coup d’œil que la vaste région connue sous le nom d’Iran ois s’établirent les Aryas zoroastriens, est naturellement divisée en deux grandes parties par le désert : la Médie et la Perse proprement dite. La difficulté des relations entre ces deux contrées, la différence du climat, du genre de vie et des habitudes, ne tardèrent pas à créer deux nationalités distinctes. Ces circonstances politiques et sociales ne pouvaient manquer d’avoir, à leur tour, leur contrecoup dans le domaine religieux. Un schisme se produisit. Bref, des divergences radicales, essentielles, dans l’interprétation de l’Avesta, divisèrent de plus en plus ces peuples frères qu’on appelle les Mèdes et les Perses ; leurs systèmes religieux, tout en ayant le même principe et le même point de départ, devinrent fort différents : la religion des Perses fut le mazdéisme proprement dit ; celle des Mèdes fut le magisme, ainsi nommé parce que la classe des mages en formait le sacerdoce. On applique assez ordinairement ce nom de magisme à la religion zoroastrienne en général, et c’est là une confusion dont les écrivains grecs ont été les premiers auteurs, à commencer par Hérodote, qui avait voyagé en Médie et non dans la Perse proprement dite ; mais elle repose sur une erreur formelle. La religion de la Médie, sans doute par suite des expéditions des monarques ninivites dans ce pays, subit l’influence astrologique de la religion assyrienne. Tous les historiens antiques s’accordent à dire que Cyrus, quand il se révolta contre les Mèdes et détruisit leur puissance au profit des Perses, rétablit la religion de Zoroastre ; donc la religion des Mèdes différait de celle des Perses et n’était pas le mazdéisme pur. Darius, fils d’Hystaspe, qui devait savoir ces choses encore mieux qu’Hérodote, raconte formellement, dans les annales de son règne gravées sur le rocher de Behistoun, que les mages, devenus un moment les maîtres de l’empire perse avec Gomatès, le faux Smerdis, avaient entrepris d’y substituer leur religion à celle de la nation iranienne, et que lui, Darius, à son avènement, renversa leurs temples et leurs autels. Jamais, dans aucun document positivement zoroastrien et d’origine perse ou bactrienne, il n’est question des mages comme ministres de la religion[2]. Le premier chapitre du Vendidad-Sadé place clans les pays de Rhagès et de Kalchra, c’est-à-dire en pleine Médie, le berceau de graves hérésies dans la religion mazdéenne, hérésies dont l’une était caractérisée par l’usage de la crémation des corps après le décès. Enfin, nous avons dit que c’est en Médie, à Rhagès, qu’une tradition des plus anciennes place le berceau de Zoroastre ; c’est là qu’était le centre d’habitation de la tribu des mages, et leur principal foyer religieux. La ville de Rhagès formait encore à l’époque des Achéménides et dans les temps postérieurs, une sorte de petit État sacerdotal véritablement indépendant, gouverné par un grand prêtre qui se donnait pour le successeur de Zoroastre. Cette situation privilégiée persista même sous les Arsacides et sous les Sassanides, et lors de la conquête musulmane, le pays de Rhaï (Rhagès) ne cessa pas d’être soumis au pouvoir cyan Masmoghân ou chef des mages, lequel résidait dans la forteresse d’Oustounavand. Khaled l’y assiégea, et ce fut là le dernier épisode de la résistance nationale de l’Iran à l’islamisme[3]. Diverses indications d’un grand prix permettent de se faire une idée de ce qu’était le système religieux du magisme. Il avait pour base le dualisme de Zoroastre ; mailles mages essayaient d’y concilier Ormuzd avec Ahriman, auquel s’était identifié tout naturellement le serpent Afrasiâb, dieu des tribus d’origine touranienne qui étaient cantonnées dans une partie des cantons de la Médie avant l’arrivée des Iraniens. Sans doute, professant les premiers la doctrine des Zarvaniens, ils considéraient Ormuzd et Ahriman comme consubstantiels et émanés tous les deux d’un seul et même principe préexistant ; dans tous les cas, ils les regardaient, pour le moins, de même que le fit plus tard la doctrine de Manès, comme, éternellement égaux en puissance, dans l’avenir aussi bien que dans le passé, et ils tenaient leur antagonisme, plus apparent dès lors que réel, pour ne devoir jamais avoir de fin. Tandis qu’en Perse Ormuzd seul était adoré, Ahriman chargé de malédictions ; en Médie, les deux principes du bien et du mal, Ormuzd et Ahriman, ou plus exactement, quand il s’agit de ce pays, Afrasiâb, recevaient également l’hommage des autels. Des savants ont même cru pouvoir affirmer que clans le culte populaire, Ahriman ou Afrasiâb primait Ormuzd, et M. Oppert a vu un reste du magisme des anciens Mèdes dans la bizarre religion des Yézidis ou adorateurs du diable, répandus encore aujourd’hui dans l’Irâk-Adjémy et dans le nord de la Mésopotamie ; celle religion, nous l’avons vu ailleurs, professe dans ses dogmes le dualisme mazdéen, mais dans son culte elle n’adore que le principe mauvais, parce que, dit-elle, le culte n’a pas d’autre objet que de fléchir la puissance divine, et que le principe du bien, excellemment bon, indulgent, clément, n’a pas besoin d’être fléchi. Mais ce n’est pas la seule dérogation radicale que le magisme médique apportât aux sévères principes de Zoroastre, dont il défigurait entièrement la doctrine. Il est certain, d’après une masse très considérable de preuves dont il serait trop long de donner ici l’énumération, que les macres, comme les Perses eux-mêmes après qu’Artaxerxés Mnémon, le fameux corrupteur de leur religion, y eut introduit de force le culte de l’Anaïtis babylonienne, avaient prétendu combiner le dualisme mazdéen avec le polythéisme chaldéo-assyrien, dont l’empire leur était limitrophe. Ils en admettaient tous les dieux, en les plaçant seulement, dans l’échelle des conceptions, à un rang inférieur à Ormuzd et au-dessus des Amschaspands ; le culte des sept corps sidéraux, sous sa forme chaldéenne, était particulièrement développé parmi eux. Mais de tous les personnages divins qu’ils avaient empruntés à l’Assyrie, celui qu’ils plaçaient le plus haut était la grande déesse-nature Mylitta ou Anaïtis, identique à la Mère des dieux de Phrygie et de Cappadoce et à l’Astarté des Phéniciens. Nous n’en voulons pour preuve que les grands et si curieux bas-reliefs religieux sculptés sur les rochers de Maltaï, à la frontière de l’Assyrie et de la Médie, et sur ceux d’Yasili-Kaïa, en Cappadoce, vers l’extrême limite de l’empire médique en Asie-Mineure, bas-reliefs qui, les uns et les autres, ont évidemment eu le même peuple pour auteur et que nous n’hésitons pas à attribuer aux Mèdes. Le célèbre passage d’Hérodote où il assimile Mithra à la Vénus asiatique, positivement inexact et erroné si on le rapporte à la Perse et au zoroastrisme pur, doit peut-être trouver son application dans la religion de la Médie ; il expliquerait alors comment les mages avaient fait cadrer l’adoption du culte de Mylitta ou Anaïtis avec la part de doctrines zoroastriennes qu’ils avaient encore conservées ; le médiateur émané d’Ormuzd était sans doute regardé comme un être féminin ou plutôt androgyne, qui aurait été à la fois, suivant le côté sous lequel on le considérait, Mithra ou Mylitta. Le sens qu’a revêtu le mot de magie semble aussi indiquer que les mages se livraient tout spécialement, comme les prêtres babyloniens, aux pratiques de la sorcellerie et d’incantations si formellement interdites par la doctrine de Zoroastre. Le premier chapitre du Vendidad-Sadé fait naître ces pratiques de sortilèges parmi les Iraniens dans le pays de Haêtumat, sur les bords de l’Hilmend, et cette partie de Carmanie est toujours signalée, de même que la Médie, comme un pays dominé par les mages. La Médie, d’ailleurs, n’a pas toujours conservé la même étendue et les mêmes frontières à travers les âges et les révolutions. Hérodote et Strabon en fixent la limite occidentale aux monts Zagros, et cette chaîne de montagnes est effectivement la barrière qui sépare l’Assyrie de la Médie pendant toute la durée de l’empire ninivite. Il faut distinguer, suivant Strabon, la Médie propre ou Grande Médie, qui correspondait à peu près à la province moderne de l’Irâk-Adjémi, d’avec la Médie Atropatène, un peu plus étendue que ne l’est actuellement l’Aderbaïjan. Aux temps antérieurs à l’époque hellénique, on englobe sous le nom de Médie le pays borné à l’ouest par les monts Zagros et Khoatras, et les rives du lac d’Ourmia qui forme la limite du pays de Naïri ou l’Arménie ; au nord par la mer Caspienne ; à l’est par le mont Demavend, ses contreforts et le grand désert de Khaver ; au sud enfin, la Médie confinait à la Perse et à la Susiane pur une limite indécise qui traversait le grand désert pour se rattacher aux monts Zagros au sud de Hamadan, l’ancienne Ecbatane. Le mont Demavend et la mer Caspienne séparaient les Mèdes des Bactriens et des Touraniens Massagètes qui dominaient dans le bassin de l’Oxus et de l’Iaxarte. Lorsque, vers le Xe siècle avant l’ère chrétienne, la Médie commence à entrer dans le mouvement de l’histoire générale par la conquête qu’en font les monarques ninivites, nous en voyons la population divisée en tribus nombreuses qui luttent isolément pour leur indépendance. Il en est six surtout qui occupent six grandes régions, et dont Hérodote nous a conservé les noms, ce sont : les Mages, les Arizantes, les Buses, les Struchates, les Budiens et les Parétacéniens[4]. Les noms de ces populations mèdes n’ont point une structure touranienne ; ils sont purement aryens : le premier est le perse magus, le sanscrit magha ; il signifie les grands, ou plutôt peut-être les saints, les sacrés[5]. Le corps sacerdotal des mages qui devint la caste la plus puissante et fournit des rois au pays, était issu originairement de cette tribu ; ses fonctions religieuses dispersaient ses membres sur toute la surface de l’empire. C’est ainsi, nous l’avons vu, que les collèges sacerdotaux des Chaldéens, répandus dans tout l’empire assyrien, étaient issus de la tribu chaldéenne qui, primitivement, peupla la Babylonie. La forme originelle du nom Arizantes se restitue facilement en Ariyazantus, ceux de la race des Aryas ; dans le troisième on reconnaît le perse bùzâ, sanscrit bhûdja, autochtone ; le quatrième enfin est le perse tchatrauvat, vivant sous la tente. Les deux dernières tribus étaient moins importantes et plus pauvres : ce sont elles, peut-être, que vise l’inscription de Behistoun, dans son texte assyrien, en parlant de Mèdes qui n’ont pas de maisons, comme de rebelles méprisables. Le nom de Budien paraît se rattacher au mot perse bûdiyâ celui qui est tenu par la terre, le serf de la glèbe ; le mot Parétacénien vient de parataitaka, nomades. Strabon, d’ailleurs, parle encore des Parétacéniens comme d’un peuple extrêmement barbare, belliqueux et faisant d’incessantes razzias sur ses voisins, tout eu s’adonnant quelque peu à l’agriculture. Au moment où l’empire mède est constitué et s’empare de la suprématie sur l’Orient, c’est-à-dire vers le temps de la chute de Ninive, on ne trouve plus guère trace de, ces différentes tribus qui s’étaient toutes fondues dans une vaste monarchie. § 2. — ARBACE ET DÉJOCÈS Nous avons rapporté, dans le livre consacré à l’histoire politique de l’Assyrie, la légende qui raconte une prétendue révolte du Mède Arbace, du Chaldéen Phul-Balazu et du Susien Sulruk-Nahunta, en 745 av. J.-C., la prise de Ninive et la mort de Sardanapale ; nous né recommencerons donc pas ici ce fabuleux récit dépourvu de tout fondement historique, ou plutôt qui ne repose que sur l’affaiblissement momentané de la puissance ninivite au milieu du VIIe siècle avant notre ère (788 à 745 environ)[6]. D’après cette légende, le Mède Arbace n’était pas proprement un roi, surtout dans le sens que les Asiatiques attachent à ce mot, mais bien plutôt le chef militaire unique d’une nation constituée fédérativement. Les tribus mèdes vivaient en effet, comme nous l’avons dit plus haut, dans un état de morcellement complet, qui fut, du reste, pendant un grand nombre de siècles, la condition normale de tous les Iraniens, chez qui le système de la tribu, si bien en rapport avec la vie belliqueuse, pastorale et agricole, mais non industrielle, existait dans toute sa pureté et formait la base de l’organisation sociale. Les familles se groupaient en tribus, celles-ci en communautés, les communautés en districts plus étendus, gouvernés par un chef unique, dont le pouvoir était limité par une assemblée populaire. Telle fut l’existence et l’organisation fédérative des Mèdes ; chacun de leurs districts vivait à peu près isolé des autres, content de sa liberté locale ; c’était seulement dans quelques rares occasions, en présence d’un danger imminent pour l’indépendance commune, qu’un sentiment d’unité nationale et de solidarité entre les diverses tribus parvenait à se réveiller ; on élisait alors un chef suprême et unique ; le chef de tribu qui avait le plus grand renom de sagesse, de force et de courage, devenait une sorte de dictateur, dont les pouvoirs n’étaient que temporaires. Tels furent Dalta, Nibi et Aspabara ou Ispabar que Sargon, roi d’Assyrie, combattit de 715 à 706 ; Aspabara figure, sous le nom bien reconnaissable d’Astybaras, mais à une place chronologique inexacte, dans la liste des rois de Médie donnée par Diodore de Sicile d’après Ctésias. Cette liste, du reste, inacceptable telle que l’historien cnidien la donnait, c’est-à-dire en tant que liste des monarques qui auraient gouverné tous les Mèdes, ne nous paraît pas non plus la fiction d’un impudent faussaire. Les noms qu’elle contient et qui sont parfaitement iraniens, Mandaucas, Sosarmos, Artykas, Arbianès, Artæos, Artynès, Astybaras, vainqueur des Saces, c’est-à-dire des tribus touraniennes, et Aspadas, doivent être des noms de chers locaux, qui commandaient à telle ou telle partie de la Médie, et dont la tradition avait conservé le souvenir. L’état de division du pays entre différents chefs est nettement indiqué dans le récit, parfaitement historique, que fait Ctésias de la querelle (changée sous la plume d’autres écrivains en légende mythique) entre Artæos et Parsondas, chef d’origine perse qui tenait une partie du pays et qui, forcé de fuir chez les Cadusiens de l’Atropatène, amena une guerre entre eux et les Mèdes proprement dits. La série des rois mèdes entre Arbacé et Déjocès, empruntée par Eusèbe à Céphalion, a le même caractère que celle de Ctésias. Mais elle comprend moins de noms et parait être la liste continue des chefs qui se succédèrent pendant cet intervalle de temps, sur une même partie du pays. Ce sont probablement ceux du canton appelé en assyrien Ellibi, où s’éleva plus tard Ecbatane ; les noms de ces prédécesseurs directs et ancêtres de Déjocès sont : Mandaucas, Sosarmos et Artykas, les trois premiers de la liste de Ctésias, qui doit contenir ensuite les chefs d’une autre province[7]. (Image dans note) Si un état de morcellement semblable donnait pleinement satisfaction à l’esprit de liberté locale et d’indépendance individuelle, s’il pouvait convenir à une nation qu’aucun danger sérieux de l’extérieur ne menaçait, comme les Perses, par exemple, il devenait funeste pour une nation placée dans les conditions où se trouvaient les Mèdes vers le temps d’Arbace. En effet, à leurs portes, l’empire assyrien s’était rapidement relevé avec Teglath-pal-asar II, il avait reconstitué sa puissance militaire, plus redoutable que jamais, et il était rentré dans la voie des conquêtes. Il élevait des prétentions sur tous les pays qui lui avaient jadis appartenu et poursuivait l’écrasement des États soustraits a sa puissance, dont la coalition avait amené l’abaissement momentané de Ninive. Les premiers grands conquérants ninivites, Teglath-pal-asar Ier par exemple, n’avaient jamais osé franchir les hauts sommets du Zagros ; ils s’étaient bornés à des razzias périodiques sur les pentes occidentales de la montagne. Salmanasar III le premier, s’avança, à travers les gorges du pays de Namri jusqu’à Ecbatane, et son fils Samsi-Raman III poussa assez loin pour se heurter aux tribus mèdes[8] ; Raman-Nirar III inscrivit aussi la Médie au nombre des pays qu’il ravagea. Teglath-pal-asar II, à son tour, fit peser un instant, sur quelques-uns des canions mèdes, le joug assyrien ; son lieutenant Assur-danin-ani imposa d’énormes contributions de guerre aux Mèdes puissants qui habitent du côté du soleil levant. Celui qui fit le mal le plus grand à la Médie fut Sargon qui saccagea le pays et en déporta les habitants, tandis qu’il les remplaçait par de familles arrachées à la Syrie et à la Palestine. Sennachérib et Assarhaddon allèrent à leur tour promener la torche incendiaire à travers la contrée occupée par les tribus aryennes. Nais faut-il ajouter une confiance absolue aux bulletins de victoire des rois d’Assyrie ? Même lorsqu’ils enregistrent leurs succès, les monarques ninivites parlent de ces puissants Mèdes dans des termes qui prouvent que ces derniers surent défendre avec courage leur indépendance nationale et qu’ils le tirent parfois avec succès. Que serait-ce si le récit de ces terribles guerres avait été fait par les Mèdes eux-mêmes ? De quelles couleurs nous dépeindraient-ils ces luttes héroïques qu’ils soutinrent pro axis et focis ? Cette période de leur histoire que les annales assyriennes nous retracent en traits si sombres pour les vaincus, fut peut-être le temps où s’affermit leur puissance et où se constitua leur empire en resserrant plus étroitement les liens de solidarité et de commune origine qui groupaient les tribus aryennes. Elles comprirent sans doute qu’elles devaient se rapprocher et s’unir pour lutter efficacement contre l’invasion des Sémites. Et il convient de remarquer que la domination assyrienne en Médie fut toujours des plus éphémères et que les cantons occidentaux furent seuls, et encore par intervalles, la proie des farouches vicaires d’Assur. Cette résistance efficace des Tièdes n’est point tout à fait une simple conjecture. Interrogeons les légendes recueillies par Hérodote. C’est du temps de Sargon, vers l’an 710, que ces traditions, qui ne doivent pas être tout à fait sans fondement historique, placent à la tête d’un groupe de tribus médiques, un roi sage, Déjocès, dont le nom se rencontre précisément dans le récit assyrien des compagnons de Sargon, sous la forme Dayaukku et dont le pays s’appelle le Bit-Dayaukku. De ce que les souvenirs nationaux des Aryens rédigés à l’époque hellénique ont revêtu une tournure grecque, et de ce que le rôle attribué à Déjocès est singulièrement embelli et grandi, il n’y a point lieu, croyons-nous, de supposer que tout, dans la légende de Déjocès, n’est que fiction et inventé de toutes pièces ; ce personnage, dans lequel s’est incarnée la résistance patriotique aux Assyriens, a existé réellement, puisque nous retrouvons son nom dans les textes cunéiformes : il faut qu’il ait joué un rôle historique important pour qu’une légende nationale se soit formée autour de sa mémoire[9]. Il y avait, dit Hérodote, chez les Mèdes, un sage nommé Déjocès ; il était fils de Phraorte. Ce Déjocès, ambitieux de la royauté, se conduisit ainsi pour y parvenir. Les Mèdes vivaient divisés en cantons. Déjocès, considéré depuis longtemps dans le sien, y rendait la justice avec d’autant plus de zèle et d’application, que dans toute la Médie les lois étaient méprisées, et qu’il savait que ceux qui sont injustement opprimés détestent l’injustice. Les habitants de son canton, témoins de ses mœurs, le choisirent pour juge. Déjocès fit paraître dans toutes ses actions de la droiture et de la justice. Cette conduite lui attira de grands éloges de la part de ses concitoyens : les habitants des autres cantons, jusqu’alors opprimés par d’injustes sentences, apprenant que Déjocès seul se conformait aux règles de l’équité, accoururent avec plaisir à son tribunal, et ne voulurent plus être jugés que par lui. La foule des clients augmentait tous les jours par la persuasion où l’on était de l’équité de ses jugements. Quand Déjocès vit qu’il portait seul le poids des affaires, il refusa de monter sur le tribunal où il avait jusqu’alors rendu la justice, et renonça formellement à ses fonctions. Il prétexta le tort qu’il se faisait à lui-même en négligeant ses propres affaires, tandis qu’il passait des jours entiers à terminer les différents d’autrui. Les brigandages et l’anarchie régnèrent plus que jamais dans les cantons de la Médie. Les Mèdes s’assemblèrent et tinrent conseil sur leur état actuel. Les amis de Déjocès y parlèrent à peu près en ces termes : « Puisque la vie que nous menons ne nous permet plus d’habiter ce pays, choisissons un roi ; la Médie étant alors gouvernée par de bonnes lois, nous pourrons cultiver en paix nos campagnes sans craindre d’en être chassés par la violence et l’injustice. » Ce discours persuada les Mèdes qui résolurent de se donner un roi. Aussitôt on délibéra sur le choix. Toutes les louanges, tous les suffrages se réunirent en faveur de Déjocès ; il fut élu roi d’un consentement unanime. Il commanda qu’on lui bâtit un palais conforme à sa dignité, et qu’on lui donnât des gardes pour la sûreté de sa personne. Les Mèdes obéirent ; on lui construisit, à l’endroit qu’il désigna, un édifice vaste et bien fortifié, el, on lui permit de choisir dans toute la nation des gardes à son gré. Ce prince ne fut pas plus tôt sur le trône, qu’il obligea ses sujets i- lui bâtir une ville, à l’orner, à la fortifier, sans s’inquiéter des autres places. Les Mèdes, dociles à cet ordre, élevèrent cette ville forte et très grande qu’on appelle Ecbatane (Hangmatâna), dont les diverses enceintes concentriques sont construites de manière que chacune ne surpasse l’enceinte inférieure que de la hauteur de ses créneaux. L’assiette du lieu, qui s’élève en colline, en facilita les moyens. Il y avait en tout sept enceintes ; dans la dernière étaient le palais et le trésor du roi. Le circuit de la plus grande égale à peu près celui d’Athènes. Les créneaux de la première sont peints en blanc ; ceux de la seconde en noir ; ceux de la troisième eu pourpre ; ceux de la quatrième en bleu ; ceux de la cinquième sont d’un rouge orangé. Quant aux deux dernières, les créneaux de l’une sont argentés, et ceux de l’autre dorés. Ce passage à lui seul suffirait à prouver le rôle important que le culte des sept corps sidéraux tenait dais la religion des Mèdes. Les couleurs qui y sont énumérées sont, en effet, précisément les couleurs sacrées des cinq planètes, de la lune et du soleil, disposées dans le même ordre que sur les étages de la zigurat du palais de Khorsabad, avec l’aspect de laquelle celui de ces sept enceintes, se dépassant les unes les autres eu gradins, devait offrir la plus grande analogie. Le palais construit, continue Hérodote, Déjocès ordonna au peuple de se loger dans les autres enceintes, et il établit pour règle que personne du peuple n’entrerait chez le roi ; que toutes les affaires s’expédieraient par l’entremise de certains officiers qui en feraient leurs rapports au monarque ; que personne ne fixerait ses regards sur le prince, et qu’on ne rirait ni ne cracherait en sa présence. Déjocès institua ce cérémonial imposant afin que les personnes qui avaient été élevées avec lui ne pussent lui montrer une familiarité inconvenante, ni conspirer contre sa personne. Il croyait qu’en se rendant invisible à ses sujets, il passerait pour être d’une espèce différente. Ces règlements faits, et son autorité affermie, il rendit sévèrement la justice. Les procès lui étaient envoyés par écrit ; il les jugeait et renvoyait le dossier avec sa décision. Quant à la police, s’il apprenait, que quelqu’un eût fait une chose injuste, il le mandait et lui infligeait une peine proportionnée au délit. Pour cet effet, il avait dans toutes ses provinces des émissaires qui veillaient sur les actions et les discours de ses sujets. Déjocès, proclamé roi en 710, au moment le plus brillant des conquêtes de Sargon, lorsque la puissance assyrienne semblait devoir tout engloutir autour d’elle, n’eut pas le temps d’en voir commencer la décadence. Il acheva de constituer la nation des Mèdes, en rassemblant toutes leurs tribus en un seul corps. Après un règne de cinquante-trois ans il mourut, en 657, tandis qu’Assurbanipal régnait encore à Ninive, et il laissa à Phraorte (Pirrouvartis), son fils, un pouvoir affermi. § 3. — PHRAORTE. Sauf la part active qu’il prit à la défense de son pays contre l’invasion assyrienne au commencement de son règne, Déjocès paraît s’être uniquement consacré à organiser intérieurement la nation médique afin de la rendre capable de hautes destinées ; Phraorte (Pirrouvartis - 657-632) fut un conquérant[10]. Nous ne savons rien de positif sur les sept premières années de son règne ; mais elles durent être occupées à chasser les Assyriens des portions de la Médie qu’ils détenaient depuis le temps de Sargon, car, au début des conquêtes extérieures de ce prince, nous le voyous maître incontesté de tous les cantons mèdes, dont certainement une grande partie était au pouvoir des étrangers du temps de Déjocès. Les campagnes de Phraorte commencèrent en 650 et furent d’abord dirigées vers l’Orient. Il débuta par soumettre à son sceptre la Perse, qui, longtemps divisée en tribus sans lien fédéral sérieux entre elles, avait essayé de former un royaume unique vers le temps où la Médie elle-même se constituait à proprement parler en corps de nation. A cause surtout de cet isolement funeste, les chefs de tribus perses Sithrapherne et Hypherne avaient été vaincus et faits prisonniers par Assarhaddon. Avertis par ce cruel exemple, les tribus perses résolurent, pour résister aux Mèdes et sauver leur indépendance nationale, de se grouper autour d’un chef unique. Elles choisirent Achéménès, de la tribu des Parsanadiens. Mais Phraorte n’en l’ut pas moins victorieux et Achéménès dut se reconnaître vassal du roi des Mèdes. C’est de ce prince que descendirent Cyrus et les rois de Perse dits Achéménides. Mais là ne se bornèrent pas, dans cette direction, les conquêtes du roi de Médie ; en quelques années il réduisit à l’obéissance toutes les nations situées en deçà de l’Hindou-Kousch et des déserts de la Carmanie, iraniennes pour la plupart. Ctésias dit formellement que les Parthes, peuple d’origine scythique ou touranienne, furent soumis par le grand-père d’Astyage, c’est-à-dire par Phraorte, dont il altère, du reste, complètement le nom. A dater du règne du même prince, nous voyons aussi la Bactriane, avec ses dépendances, l’Hyrcanie, la Margiane et la Sogdiane, obéir au roi mède. De l’autre côté de la Médie, à l’ouest, la nation aryenne des Arméniens, alliée des Mèdes depuis Arbace, auquel d’après la légende, le roi de ce pays, Barouir, avait prêté sort concours dans la guerre contre Ninive, dut aussi reconnaître la suzeraineté de Phraorte, et probablement en échange de cette soumission, vit son territoire délivré des Assyriens, qui en occupaient une partie, et sous Sargon et Sennachérib, avaient pénétré jusqu’à Van et même,jusqu’à la chaîne de l’Ararat. En faisant le récit des campagnes des monarques assyriens dans le pays de Naïri, c’est-à-dire dans les contrées septentrionales dont l’Arménie forme le centre principal, nous avons fait ressortir l’importance stratégique de ce massif montagneux, dont le nœud est le mont Ararat, et que se sont disputé tous les conquérants qui ont voulu asseoir leur domination sur l’Asie. La configuration du sol de l’Arménie est d’autant plus curieuse à étudier qu’elle a puissamment influé sur les vicissitudes que cette contrée éprouva dans le cours de son existence historique. Des montagnes plus ou moins élevées, des collines à pente douce, alternent partout avec des vallées dont plusieurs sont très resserrées et dont quelques autres, comme celle de l’Araxe, s’épanouissent en une vaste plaine. Ici, sur les hauteurs, une nature âpre et stérile ; là, dans les bas-fonds, une fertilité qui va quelquefois jusqu’aux dernières limites. Sur un sol aussi accidenté, et où quantité de montagnes séparent, comme autant de barrières, les populations, jamais ne put s’établir un pouvoir unitaire, fort et stable, rayonnant sur toute l’étendue du pays. Depuis les siècles les plus reculés, l’Arménie apparaît dans l’histoire, morcelée en une foule de petites principautés presque indépendantes de l’autorité royale et désunies entre elles. La monarchie arménienne manqua toujours de cohésion : affaiblie par les déchirements intérieurs que produisaient les vices de son organisation féodale, elle eut bien des fois à subir l’invasion et la conquête. Presque toujours elle ; fut sous la domination de maîtres étrangers, qui tantôt se contentèrent d’exercer sur elle un droit de suzeraineté, tantôt la firent gouverner par des lieutenants directs. Ce n’est qu’à de rares intervalles que quelques princes, doués de talents politiques ou militaires, parvinrent à s’affranchir du joug, mais leurs efforts n’aboutirent jamais qu’à une indépendance douteuse et viagère. L’Arménie a sur son territoire les sources de l’Euphrate et du Tigre, ainsi que les hautes vallées de ces deux fleuves. La posséder était donc pour les maîtres de la Mésopotamie une véritable nécessité, sous peine de voir par là déboucher sur leurs fertiles domaines une invasion des peuples du Nord. Aussi, s’il y a quelque foi à prêter aux listes chronologiques des antiques rois d’Arménie, rapportées par Moïse de Khorène d’après des livres fort antérieurs à son temps, les souverains du premier empire de Chaldée, au temps de leur puissance culminante, c’est-à-dire lorsqu’ils étaient maîtres de l’Assyrie, vers l’époque de Gudea et de Hammurabi, auraient déjà fait la conquête de l’Arménie. Ces listes placent en effet en 1725 avant Jésus-Christ, la défaite du roi arménien Anouschavan et l’établissement de la suprématie du grand empire mésopotamien sur ses États. Deux siècles après, le conquérant égyptien Thoutmès III, vainqueur des Rotennou et devenu maître de toute la Mésopotamie, depuis Ninive jusqu’à Babylone, alla chercher les Remenen ou Armenen dans leurs montagnes et les soumit au tribut. Lorsque l’empire assyrien se fonda pendant la décadence de la puissance égyptienne, le premier pays sur lequel il étendit sa domination fui l’Arménie, dès qu’il eut répudié la suzeraineté nominale de l’Égypte. Les plus anciennes campagnes assyriennes dont nous possédions le récit, celles de Teglath-pal-asar Ier, ont l’Arménie pour principal théâtre, et elles ont plutôt le caractère de répression de révoltes que d’une conquête entièrement nouvelle. Dans la partie de cet ouvrage consacrée à l’histoire de l’Assyrie, nous avons fait le récit des guerres épouvantables au milieu desquelles la domination assyrienne essaya de s’établir dans le pays de Naïri dont l’Arménie n’était qu’une des provinces les plus considérables. Nous avons retracé, d’après les inscriptions arméniaques récemment déchiffrées, l’histoire de la dynastie royale du pays de Manna ou de Van, et des luttes héroïques qu’elle soutint pour son indépendance. Sargon, après dit campagnes successives, finit par dompter Ursa, roi de Van et de l’Urarthu, Mitatti roi de Zikartu, Urzana roi de Musasir ; mais Sennachérib ne put venir à bout d’Argitis II, et c’est à peine si Assurbanipal osa inquiéter Ahseri, un des successeurs d’Argistis. Bref, on se battit durant quatre siècles et le colosse assyrien ne fut jamais vainqueur qu’à demi. Toutefois, clans certains cantons plus faciles à tenir en respect, l’influence assyrienne, pendant cette période de domination, fut assez profonde pour faire adopter par une partie des Arméniens la religion de Babylone et de Ninive, dont quelques personnages survécurent même à l’établissement du mazdéisme. Ce furent ceux vers lesquels se tournaient le plus volontiers les adorations populaires, avant tout Anahid, l’Anat ou Anaïtis des Chaldéo-Assyriens, puis Sbantarad, Vahal.n et Nané, les dieux armés et guerriers, correspondant à Marduk, Nergal et Adar-Samdan. Il faut joindre à ces personnages divins, connus par Moïse de Khorène, ceux qui nous sont révélés par les inscriptions cunéiformes, Bagabarta ou Bagamazda (car la lecture de son nom est douteuse), qui paraît avoir joué le rôle d’un dieu suprême, et Haldia ou Haldis, la divinité spéciale du pays de Van. Le pillage de son principal sanctuaire, situé dans la ville de Musasir, sur les bords du lac de Van, est représenté, nous l’avons vu ailleurs, clans les bas-reliefs du palais de Khorsabad. La légende fabuleuse de Sémiramis, dont nous avons montré l’origine toute religieuse au début, avant que la politique des Perses ne l’adoptât dans l’histoire officielle, était aussi répandue en. Arménie que dans le bassin de l’Euphrate et du Tigre ; on attribuait à cette héroïne, dans les fables de la poésie populaire, les prodigieux travaux du château de Van, appelé quelquefois, par suite de ces légendes, Schamiramaguerd, la cité de Sémiramis. L’Arménie n’échappa au joug assyrien que pour tomber sous celui des Mèdes qu’elle parait d’ailleurs avoir accepté sans résistance. Phraorte se présenta aux Arméniens non comme un conquérant, mais comme un libérateur ; il leur demanda seulement de se joindre à lui et de marcher sous ses ordres pour porter nue guerre de revanche jusqu’au cœur de l’Assyrie. Fort de l’appui des Arméniens et ayant fait ainsi de la monarchie médique un vaste empire militaire, Phraorte se crut en mesure d’envahir la Mésopotamie et de soumettre l’Assyrie à sou sceptre. Mais l’heure de la vengeance n’avait point encore sonné pour les Mèdes et les Arméniens ; la tentative de Phraorte était prématurée : elle échoua. Bien qu’amollis par leurs précédents succès, tombés en pleine décadence, laissant échapper une à une toutes leurs conquêtes, les Assyriens étaient encore un peuple guerrier. L’invasion des Mèdes produisit chez eux un élan de vaillance et d’énergie qui illustra leur roi d’alors, Assurbanipal ou Assur-edil-ilane. Ils résistèrent vigoureusement, et dans une grande bataille qui fut alors livrée, Phraorte succomba avec l’élite de son armée (639). § 4. — RÈGNE DE CYAXARE Son fils Cyaxare (Uvakhsatara) lui succéda sur le trône. Il fut encore plus belliqueux que son père. Averti par le sort funeste de celui-ci, ses premiers soins tendirent à donner aux Mèdes une bonne organisation militaire ; il les forma en phalanges régulières, groupa en corps distincts les différentes armes, séparant, dit Hérodote, les piquiers des archers et des cavaliers, qui jusque-là combattaient confondus ; il les soumit à une discipline sévère et se prépara de celte manière à de nouvelles conquêtes. Le premier essai qu’il fil de ses forces consista à soumettre les Parthes, révoltés à la suite de la mort de Phraorte. Plus tard, reprenant les projets de son père, il médita la ruine de Ninive et chercha une alliance dans le sud du bassin du Tigre et de l’Euphrate, afin de ne pas se trouver seul dans une semblable entreprise. Un traité fut conclu entre Cyaxare et le chaldéen Nabopolassar pour la conquête elle partage de l’Assyrie, et le gage de cette alliance fut le mariage d’Amytis, fille de Cyaxare, avec le jeune fils de Nabopolassar, Nabuchodonosor. En 625, les Mèdes envahirent l’Assyrie. Déjà Cyaxare avait vaincu les Assyriens en bataille rangée déjà il assiégeait Ninive, et Nabopolassar s’avançait avec toutes ses forces pour le rejoindre devant cette ville, lorsque le roi des Mèdes fut assailli à l’improviste par les Scythes et les Cimmériens dont les hordes nombreuses firent foui à coup irruption en Médie, puis dans le bassin du Tigre et de l’Euphrate et vinrent, comme plus tard Gengis et Tamerlan, porter l’incendie et le massacre dans toute l’Asie occidentale. Ces Scythes avaient à leur tête leur roi Madyès, fils de Protothyès. Ils ne constituaient point une armée d’auxiliaires accourus au secours du roi d’Assyrie aux abois. Loin de là, c’était une migration de peuples barbares marchant au hasard et mus par l’instinct du pillage. D’abord une grande guerre avait éclaté entre les Scythes et leurs voisins, les Cimmériens, dans les steppes au nord de la mer Caspienne et du Caucase. Ayant écrasé les Cimmériens, les Scythes s’incorporèrent ce qui restait des vaincus, et bientôt, reprenant leur marche en avant, Scythes et Cimmériens, désormais confondus, se jetèrent sur l’Assyrie. Une première fois déjà, ils avaient tenté un effort contre la puissance ninivite. C’était sous le règne d’Assarhaddon, vers 670 avant notre ère. On se rappelle l’obscurité qui, dans les annales de ce prince, enveloppe les dernières années de son règne, et l’on sait que généralement, lorsque les inscriptions assyriennes se taisent ou sont embarrassées, c’est qu’un revers de fortune est venu imposer une fin au dithyrambe composé en l’honneur du roi et de ses armées. Des tablettes malheureusement très mutilées, découvertes par G. Smith dans le voyage qui lui coûta la vie, contiennent des proclamations d’Assarhaddon au peuple ninivite et la mention de l’invasion des armées des peuples du Nord. D’aucuns ont cru qu’il s’agissait d’un Assarhaddon II, le Saracos de Bérose, qui aurait régné à Ninive après Assur-edil-ilane, et que l’invasion dont il est parlé serait celle des Mèdes et des Babyloniens confédérés, qui amena la chute de Ninive[11]. Un des chefs de l’insurrection est appelé, Kastarit, préfet de Karkassi ; on a cru que Kastarit n’était qu’une déformation du nom de Cyaxare. Ceci est loin d’être certain, car la ville de Karkassi paraît être, non point une ville mède, mais la ville arménienne de Carcathiocerta, voisine d’Amida[12]. Avant donc de, créer, à l’aide de ces conjectures, un nouveau roi d’Assyrie du nom d’Assarhaddon II, il vaut mieux croire, avec le P. Delattre, qu’il s’agit du premier roi de ce nom, bien connu par d’autres inscriptions et qui, précisément, a une tin mystérieuse qui dissimule mal des revers militaires. Quoi qu’il en soit, cette invasion des peuples du Nord, Scythes et Cimmériens, fit trembler le monarque ninivite. Dans une première proclamation, après avoir invoqué Samas, le dieu soleil, pour qu’il détourne l’effet des péchés qui ont attiré sur le pays de semblables désastres, Assarhaddon continue en disant : « Kastarit, préfet de la ville de Karkassi, a envoyé à Mamitarsu, chef de ville du peuple des Mèdes, un message ainsi conçu : L’un avec l’autre nous serons unis avec le pays de.... Mamitarsu lui obéit, il exerce son obéissance devant lui.... Cette année, il a fait la guerre à Assarhaddon, roi d’Assyrie. La seconde proclamation ordonne cent jours et cent nuits de supplications, du 3 du mois d’Aïr au 15 du mois d’Ab, parce que Kastarit, avec ses soldats, les soldats des Cimmériens (Gimirai), les soldats des Mèdes (Madai), les soldats arméniens (Mannai) et les ennemis, tous tant qu’ils sont, se sont répandus comme une inondation et ont grossi en nombre ; ... ils ont pris les armes du combat et de la bataille et se sont mis en révolte ouverte... Ils ont assiégé la ville des Kisassutai, la ville de Hautam, et d’autres places... Ainsi, dans cette invasion dont nous ne connaissons point les péripéties, les Scythes se servaient déjà comme auxiliaires des Mèdes, des Arméniens et des Cimmériens qu’ils avaient dit subjuguer d’abord. Qu’advint-il de leur tentative sur l’Assyrie ? Ils paraissent avoir été repoussés puisque Assurbanipal succéda librement à son père sur le trône de Ninive et n’eut point, tout d’abord, à s’inquiéter des incursions des hommes du Nord. Les Scythes, plus tard, se mirent de nouveau en marche et quittèrent leurs steppes sauvages pour aller s’emparer des fertiles contrées qu’ils convoitaient depuis si longtemps. Une de leurs tribus les plus importantes, celle que les Assyriens appellent les Sahi, nom dans lequel on reconnaît celui des Saces, s’établit définitivement au sud du Caucase dans la vallée supérieure du Kour. Dans sa campagne contre l’Arménie, Assurbanipal atteignit les Saces et leur infligea une première défaite. Sarati et Parithya (peut-être le Prothyès ou Protothyès d’Hérodote), fils de Gog, le chef des Sahi qui ne reconnaissaient pas le joug de ma souveraineté, je pris soixante-quinze de leurs villes fortes, et j’en enlevai le butin ; eux-mêmes, je les pris vivants dans mes mains et je les transportai à Ninive, la ville de ma domination. L’apparition d’Assurbanipal dans la Sacasène peut être placée vers l’an 660. La terreur que dut inspirer aux Touraniens la présence du conquérant ninivite eut suffi, sans doute, à retenir longtemps dans les régions du nord le flot montant de la barbarie, si sous le règne d’Assur-edil-ilane, les Mèdes n’étaient venus porter un coup terrible à la puissance niuivile. Quand ils virent détruite la digue qui les avait contenus jusque-là, les Scythes montèrent sur leurs rapides cavales et débouchèrent sur la Médie. Cyaxare, qui campait sous Ninive, accourut pour leur barrer la route. Il perdit la première bataille, et en une journée, de maître d’une grande portion de l’Asie, il se vit réduit à la condition de sujet des barbares, et dut payer un tribut annuel. On admet que les Scythes dominèrent pendant huit ans environ (624-617)[13] sur toute l’Asie antérieure. De la Médie, où ils avaient établi leur quartier général, ils se jetèrent sur l’Assyrie, l’Osrhoëne, la Syrie, la Palestine, où ils pillèrent le fameux temple de Dercéto à Ascalon ; les bordes touraniennes ne s’arrêtèrent enfin que sur les frontières de l’Égypte, où Psammétik Ier acheta leur retraite à force d’arpent et de présents. Les barbares, dignes ancêtres des Tartares de Gengis et de Tamerlan, ruinaient toutes les contrées qu’ils occupaient par leurs violences et leurs brigandages. Outre les tributs ordinaires, raconte Hérodote, ils exigeaient encore de chaque particulier un impôt arbitraire pour racheter sa vie et ses biens ; et, indépendamment de ces exactions, ils parcouraient tout le pays, pillant et enlevant à chacun ce qui lui appartenait. Nous avons reproduit ailleurs (t. IV) les imprécations que lance contre eux le prophète Jérémie. Ezéchiel s’écrie, à son tour, en parlant des peuples de Mushai et de Tabal qui succombèrent sous leurs coups : ils sont descendus au tombeau et tout leur monde avec eux, et leur, sépulcres sont autour d’eux, incirconcis tous, égorgés par l’épée, pour avoir répandu la terreur clans le séjour des vivants. Mais ils ne reposent pas avec les guerriers, tombés d’entre les incirconcis, qui sont descendus au tombeau avec leurs armes et à qui on a mis leurs épées sous la tête. Leurs crimes sont restés sur leurs ossements parce qu’ils ont répandu la terreur dans le séjour des vivants. Plus que tous les autres, les Mèdes souffrirent de ces envahisseurs, qui s’étaient établis chez eus et paraissaient ne devoir jamais en sortir. Ils ne parvinrent à s’en délivrer que par la trahison. Cyaxare et les membres de l’aristocratie médique invitèrent à une fête le roi et les principaux chefs des Scythes ; lit, ils les enivrèrent et les égorgèrent pendant leur sommeil. Toute la population de la Médie, agriculteurs, pâtres et guerriers, se leva eu masse et massacra, partout oit elle le put, les Scythes, privés de leurs chefs ; une partie d’entre eux parvinrent à s’enfuir et à regagner par le Caucase la route de leurs steppes ; d’autres eurent la vie sauve, mais lurent réduits en esclavage et cantonnés dans certains districts de la Médie. C’est ainsi que les Mèdes recouvrèrent, en même temps que leur indépendance, la domination des contrées qu’ils possédaient auparavant. Aussitôt délivré de ces envahisseurs barbares, Cyaxare renoua son alliance avec Nabopolassar et reprit ses projets favoris contre Ninive. En 606, l’orgueilleuse cité de Sennachérib et d’Assurbanipal fut prise et détruite, cette fois pour toujours. Les deux vainqueurs se partagèrent l’Assyrie, dont le nord appartint aux Mèdes et le sud aux Babyloniens. Ce fut sans doute alors que les rois de Médie devinrent maîtres de la Susiane, qui confinait à la fois à leurs provinces proprement mèdes et à leurs provinces perses. Ce pays avait été définitivement réuni à l’empire assyrien par Assurbanipal ; les rois chaldéens de la dynastie de Nabopolassar ne le possédèrent jamais, et nous voyons Cyrus en être maître aussitôt qu’il s’est assis sur le trône à la place d’Astyage. Il faut nécessairement en conclure que lors du partage des dépouilles de la puissance ninivite, les Mèdes se l’étaient adjugé. Toute l’Arménie, ruinée auparavant par les Scythes, tomba facilement au pouvoir de Cyaxare qui, poursuivant sa marche du côté de l’occident, annexa à son empire la Cappadoce, les peuples de Muskai et de Tubal et parut au cœur de l’Anatolie. Là, il eut affaire aux Lydiens qui s’étaient rapidement relevés de leurs ruines et avaient réparé les murs de leurs forteresses ; voici l’occasion que saisit Cyaxare pour se mêler des affaires de la cour de Sardes. Trois ans après la chute de Ninive, en 603, la désertion d’une des tribus scythes qui avaient été conservées en Médie comme troupe mercenaire, et l’accueil empressé qu’elle reçut d’Alyatte, roi de Lydie, amena la guerre entre Cyaxare, qui réclamait les Scythes comme transfuges, et Alyatte, devenu depuis peu d’années maître de la Phrygie et de la Cappadoce, et par conséquent limitrophe de l’empire de Médie sur la frontière arménienne. Pendant cinq années, dit Hérodote, les Mèdes et les Lydiens eurent alternativement l’avantage ; la sixième, il y eut une espèce de combat nocturne, car après nue fortune égale de part et d’autre, s’étant livré bataille, le jour se changea tout à coup en nuit, pendant que les deux armées étaient aux mains. Thalès de Milet avait prédit aux Ioniens ce changement, et il en avait fixé le temps, ainsi que l’année où il s’opéra. Les Lydiens et les Mèdes, voyant que la nuit avait pris la place du jour, suspendirent le combat et s’empressèrent de faire la paix... Ceux qui les réconcilièrent furent Syennésis de Cilicie, et Labynète le Babylonien[14]. Persuadés que les traités ne peuvent avoir de solidité sans un puissant lien, ils engagèrent Alyatte à donner sa fille Aryénis à Astyage, fils de Cyaxare. Les traités, chez ces nations, se contractent avec les mêmes cérémonies que chez les Grecs, si ce n’est que les contractants se font aux bras de légères incisions et sucent réciproquement le sang qui s’en échappe. Le cours de l’Halys, fleuve qui partage la Cappadoce par le milieu, fut choisi pour la limite des deux empires. Les astronomes fixent l’éclipse totale de soleil survenue pendant la bataille entre les Lydiens et les Mèdes au 28 mai 585 avant Jésus-Christ[15]. Cyaxare mourut deux ails après (583). A sa mort, l’empire mède comprenait depuis le cours de l’Halys jusqu’à celui de l’Helmend. § 5. — ASTYAGE. CHUTE DE L’EMPIRE MÈDE Astyage (Ajtahaga, en assyrien Istuvegu), fils de Cyaxare, lui succéda en 583. Son règne fut long, et pendant trente ans il ne paraît avoir été marqué par aucun événement saillant. Astyage ne fut pas un prince guerrier et conquérant ; sauf nue expédition contre les Cadusiens, qu’il soumit sans peine, l’histoire ne lui attribue aucune lointaine expédition hors des frontières assignées par ses prédécesseurs à la monarchie médique. Tous les traits que l’on peut recueillir sur son compte révèlent en lui un tyran soupçonneux et perfide, et sa cruauté comme sa mauvaise foi furent pour beaucoup dans la catastrophe qui termina son règne. D’ailleurs, la légende s’est emparée des événements qui ont marqué la chute de l’empire mède, et il est difficile de démêler la vérité de la fable quand on n’a, pour toutes sources d’information, que les traditions grecques et arméniennes. Astyage est pourtant mentionné clans des inscriptions assyriennes, et l’un de ces textes raconte qu’il eut une querelle avec Nabonid, roi des Chaldéens, au sujet de la possession de la haute Mésopotamie, et qu’une guerre malheureuse lui fit perdre la ville de Harran (Charræ) et le pays environnant. Mais, en attendant que ces faits obscurs soient mis en pleine lumière par de nouvelles découvertes archéologiques, force nous est de suivre la narration semi-fabuleuse que tous les historiens ont jusqu’ici acceptée, faute de mieux. Astyage avait une fille nommée Mandane, qu’il maria au perse Cambyse (Kambujya), fils de Teïspès et petit-fils d’Achéménès, investi sans doute, bien que les écrivains anciens ne le disent pas, du gouvernement de son pays natal à titre de satrape ou de prince vassal. Après ce mariage, suivant le récit d’Hérodote, il vit en songe une vigne qui sortait du sein de sa fille et qui couvrait toute l’Asie. Ayant demandé aux Mages l’interprétation de ce songe, il apprit que le fils qui naîtrait de Mandane régnerait un jour à sa place. Astyage prétendait bien ne pas perdre sa couronne, et il avait de plus deux petits-fils, Xathritas (Khsathrita) et Sithratachmès (Çithratakhma), auxquels il comptait la laisser en mourant. Il fit donc venir sa fille auprès de lui et la retint sous une garde sévère, bien décidé à faire périr le fils qu’elle mettrait au monde. Lorsque l’enfant fut né, Astyage fit appeler Harpagus, un de ses serviteurs les plus dévoués, et lui ordonna de mettre à mort le nouveau-né. Harpagus ne voulut pas se souiller lui-même d’un crime ; il chargea un des pâtres d’Astyage d’exposer l’enfant sur une montagne déserte du pays des hardes, pour qu’il y trouvât une mort certaine. Heureusement une chienne, qui répondait au nom de Spako, allaita le petit abandonné, comme la louve, suivant une fable analogue, nourrit les futurs fondateurs de Rome ; la femme du berger Mitradate, de la tribu des Mardes, intervint, recueillit le nourrisson et supplia son mari de l’élever comme son fils, puisque elle-même était accouchée quelques jours auparavant, d’un enfant mort en naissant. Le berger se laissa toucher et éleva le fils de Cambyse, qu’on appela Agradate et qui, plus tard, prit le nom de Cyrus. L’intervention de la chienne dans cette fable n’est point due à un pur hasard. Nous avons vu ailleurs que le chien était un animal sacré aux veut des Mazdéens : c’était donc la divinité elle-même qui veillait sur les jours de Cyrus et protégeait l’entrée dans la vie d’un enfant appelé à de si hautes destinées. Cependant le jeune Agradate grandit dans son village. Une aventure, dont Hérodote fait le récit plus ou moins fabuleux, amena sa reconnaissance : Un jour qu’il jouait avec d’autres enfants de son âge, ceux-ci l’élurent pour leur roi, lui qui était connu sous le nom de fils du bouvier. Il distribua aux uns les places d’intendants de ses bâtiments, aux autres celles de gardes du corps ; celui-ci était l’œil du roi (titre d’une des fonctions les plus élevées de la cour, qui, de chez les Mèdes, passa chez les Perses), celui-là devait lui présenter les requêtes des particuliers ; chacun avait son emploi, selon ses talents et le jugement qu’en portait Agradate[16]. Le fils d’Artembarès, homme de distinction chez les Mèdes, jouait avec lui. Ayant refusé d’exécuter ses ordres, Agradate le fit saisir par d’autres enfants et maltraiter à coups de verges. On ne l’eut pas plutôt relâché, qu’outré d’un châtiment si indigne de sa naissance, il alla à la ville porter ses plaintes à son père contre le fils du bouvier d’Astyage. Dans la colère on était
Artembarès, il se rendit auprès du roi avec son fils, et se plaignit du
traitement odieux qu’il avait reçu : « Maître, dit-il, en découvrant les
épaules de son fils, c’est ainsi que nous a outragés un de tes esclaves, le
fils de ton bouvier. » A ce discours, à cette vue, Astyage voulant, venger le
fils d’Artembarès, par égard pour son père, envoya chercher le pâtre Mitradate
et son fils. Lorsqu’ils furent arrivés : « Comment, dit le prince à Agradate
en le regardant, étant ce que tu es, as-tu osé traiter d’une manière si
indigne le fils d’un des premiers de ma cour ? — Je l’ai fait avec justice,
répondit Agradate. Les enfants du village, avec lesquels il était, m’avaient,
en jouant, choisi pour leur roi. Je leur paraissais le plus digne. Tous
exécutaient mes ordres. Le fils d’Artembarès n’y eut aucun égard et refusa de
m’obéir. Je l’en ai puni. Si celle action mérite quelque châtiment, me voici
prêt à le subir. » La ressemblance des traits de cet enfant avec les siens, sa réponse noble, son âge qui s’accordait avec le temps de l’exposition de son petit-fils, tout concourait à frapper vivement l’esprit d’Astyage. Il demeura quelque temps sans parler ; mais enfin, revenu à lui et voulant renvoyer Artembarès, afin de sonder Mitradate : « Artembarès, lui dit-il, vous n’aurez aucun sujet de vous plaindre de moi, ni toi, mon fils. » Ensuite il ordonna à ses officiers de conduire Agradate dans l’intérieur du palais. Resté seul avec Mitradate, il lui demanda quel était cet enfant. Le bouvier soutint d’abord qu’il en était le père ; mais à la vue des instruments de torture, il avoua tout. Aussitôt Astyage fit venir Harpagus, lui répéta ce qu’il venait d’apprendre, ajoutant que l’enfant vivait et qu’il en était content : « Car enfin, dit-il, la manière dont on l’avait traité me faisait beaucoup de peine, et j’étais très sensible aux reproches de ma fille. Mais puisque la fortune nous a été favorable, envoie-moi ton fils pour tenir compagnie au jeune prince nouvellement arrivé, et ne manque pas devenir souper avec moi ; je veux offrir, pour le recouvrement de mon petit-fils, des sacrifices aux dieux, à qui cet honneur est réservé. » Harpagus s’étant, à ces paroles, prosterné devant le roi, s’en retourna chez lui, également flatté de l’heureuse issue de sa faute et de ce qu’il était invité au festin que le roi donnait. Il ne fut pas plutôt rentré chez lui qu’il appela son fils unique, âgé d’environ treize ans, et l’envoya au palais d’Astyage. Dès que cet enfant fut arrivé, le roi le fit égorger ; on le coupa ensuite en morceaux, dont les uns furent rôtis et les autres bouillis. L’heure du repas venue, on servit à Astyage et aux autres convives du mouton, et à Harpagus le corps de son fils. Lorsqu’il parut avoir assez mangé, Astyage lui demanda s’il était content de ce repas. « Très content, » répondit Harpagus. Aussitôt ceux qui en avaient reçu l’ordre, apportant dans une corbeille couverte la tête, les mains et les pieds de son fils, la lui présentèrent en lui disant de la découvrir et d’eu prendre ce qu’il voudrait. Il le fit, et en découvrant la corbeille, il reconnut les restes de son fils. Il ne se troubla point et sut se posséder. Astyage lui demanda s’il savait de quel gibier il avait mangé ; il répondit qu’il le savait, mais que tout ce que faisait le roi lui était agréable. Les sujets d’un despote savent, comme lui, dissimuler et, n’oublier jamais une injure. Harpagus attendit longtemps, mais se vengea enfin en excitant Agradate à la révolte. Astyage, après l’avoir reconnu pour son petit-fils, avait consulté les Mages, qui prétendirent que le songe était accompli : puisque Agradate avait été roi, il n’y avait plus de danger qui menaçât la couronne d’Astyage. Celui-ci le laissa aller en Perse, auprès de son père Cambyse, et le chargea même de diriger contre les Cadusiens une expédition dans laquelle il se couvrit de gloire. C’est à la cour de Perse que les secrets messagers d’Harpagus vinrent le chercher, éveiller son ambition et lui promettre une victoire facile, en lui montrant les nombreux ennemis qu’Astyage s’était faits, par ses rigueurs, jusqu’au milieu de sa cour. L’ambition du jeune prince n’avait pas besoin d’être stimulée pour le porter à tenter la fortune : Agradate n’attendait que le moment favorable. II s’y prit habilement et n’essaya point de parvenir à la réalisation de ses espérances secrètes par nue insurrection dont le hasard seul pouvait assurer le succès. Il entreprit d’abord, sur les conseils d’Harpagus, et suivant d’autres traditions, sur ceux du Perse Œbarès, de réunir en un seul corps de nation et de soumettre à une autorité commune toutes les tribus des Perses ; une fois ce résultat obtenu, il pouvait aspirer à tout. C’est ce qui arriva. Il se donna d’abord comme ayant reçu d’Astyage la satrapie de la Perse ; à ce titre, il convoqua les chefs des tribus à une grande assemblée. Là, il jeta le masque, exposa ses vues aux chefs iraniens réunis, leur montra en perspective la fortune, la puissance, l’indépendance surtout, et par ces promesses il les décida à le proclamer roi et à attaquer le, monarque des Mèdes. Ce fut alors qu’il changea son nom d’Agradate pour celui de Cyrus (Kurus). Il fit relever dans toute la Perse les atech-gahs ou pyrées, que les Mèdes paraissent avoir renversés lors de leur conquête, et il rétablit l’exercice du culte zoroastrien dans toute sa sévère pureté ; mais en même temps, désireux de ménager les susceptibilités des Mèdes, parmi lesquels il espérait trouver des partisans fatigués de la tyrannie d’Astyage, il laissa subsister à côté les sanctuaires du magisme médique. Cyrus prescrivit une levée en masse de tous les guerriers des tribus perses, puis, quand il eut ainsi rassemblé une nombreuse armée, il marcha contre la Médie. Au bruit, de sa révolte, Tigrane, roi d’Arménie, s’insurgea également, secoua le joug des Mèdes et fournit au jeune héros perse un précieux appui. Les Arméniens, nous l’avons vu, avaient été incorporés à l’empire mède par Phraorte qui fit de leur pays une province vassale gouvernée par un roi presque indépendant. L’Arménie constituait donc en réalité plutôt un royaume tributaire qu’un pays soumis au joug, puisqu’elle conservait ses rois, ses coutumes et son gouvernement propre ; nue redevance annuelle marquait seule son état de sujétion vis-à-vis de la tiédie. C’est du moins ce qu’on peut conjecturer d’après les traditions arméniennes qui ne sauraient être entièrement dépourvues de rondement historique, bien qu’il soit difficile de dire jusqu’à quel degré elles méritent créance. Le prince qui gouvernait l’Arménie au temps d’Astyage était Tigrane Ier, l’un des rois qui tiennent la plus grande place dans les légendes du pays. Moïse de Khorène, empruntant ses récits aux poésies populaires, le décrit ainsi : Héros aux cheveux blonds, argentés par le bout, au visage coloré, au regard de miel ; ses membres étaient robustes, ses épaules larges, sa jambe alerte, son pied bien tourné ; toujours sobre dans ses repas et réglé clans ses plaisirs. Nos ancêtres célébraient au son du pampirn (espèce de luth aux cordes de métal) sa modération dans les plaisirs des sens, sa magnanimité, son éloquence, ses qualités utiles dans tout ce qui touche à l’humanité. Toujours juste dans ses jugements et ami de l’équité, il tenait la balance en main et pesait les actions de chacun. Il ne portait point envie à ceux qui étaient plus grands que lui ; il ne méprisait pas ceux qui lui étaient inférieurs, et n’avait d’autre ambition que d’étendre sur tous le manteau de sa sollicitude. Tigrane était profondément populaire parmi ses sujets ; Astyage conçut de la jalousie contre lui. Il craignit de le voir se rendre indépendant, et, n’osant pas l’attaquer ouvertement, il conçut le projet de le mettre à mort par une de ces perfidies qui lui étaient habituelles, de manière à réduire ses Mats à la condition de province directe, gouvernée par un simple satrape. Ayant demandé et obtenu la main de Dikranouhi, sœur de Tigrane, dont il fit sa seconde épouse, il essaya d’attirer ce prince auprès de lui à Ecbatane, où il comptait le faire assassiner. C’était précisément le temps où Cyrus appelait les Perses aux armes et se mettait en rébellion ouverte. Tigrane, prévenu secrètement par sa sœur, n’eut garde de tomber dans le piège. Résolu à tirer vengeance de la perfidie d’Astyage, il se révolta de son côté et rassembla les Arméniens pour entrer en Médie et y faire cause commune avec le jeune roi des Perses. Astyage était endormi dans une paix profonde, croyant la prospérité de son empire et la durée de sa domination établies pour jamais, quand la double nouvelle des révoltes de Cyrus et de Tigrane vint le surprendre comme un coup de foudre. Il avait l’habitude, nous dit une inscription cunéiforme, d’appeler dédaigneusement le Perse Cyrus, son petit serviteur, et il ne pouvait croire à la rébellion de ce jeune chef d’une misérable tribu. Ce fut pourtant du côté de la Perse que le danger fut le plus considérable et qu’il dut diriger toutes les forces dont il pouvait disposer. Mais dans son aveuglement, à ce que raconte la légende, ignorant qu’Harpagus le trahissait et oubliant qu’il ne pouvait plus compter sur la fidélité d’un homme auquel il avait infligé la plus cruelle des offenses, il lui donna le commandement de l’armée opposée à Cyrus. Tout concourait donc à faciliter la conquête du fils de Cambyse. Les Mèdes, s’étant mis en campagne, en vinrent aux mains avec les Perses. La lutte fut longue, si l’on eu croit le récit de Nicolas de Damas. En voyant les Perses se battre avec tant d’acharnement, Astyage qui dirigeait ses troupes du haut d’une éminence, demeura stupéfait. Comment se peut-il, s’écriait-il, que ces mangeurs de pistaches se battent avec un pareil courage ! Malheur à mes généraux s’ils ne triomphent pas des rebelles ! Les chefs mèdes à qui Harpagus n’avait pas fait part de ses projets luttèrent avec énergie ; le reste de l’armée passa à l’ennemi. Astyage, furieux, fit mettre en croix les Mages qui lui avaient conseillé de laisser partir Cyrus. Puis il fit prendre les armes à ce qui restait dans ses États de guerriers de la tribu des Arizantes, jeunes et vieux, les mena contre les Perses, avec qui Tigrane et ses Arméniens avaient opéré leur jonction et leur livra bataille dans la plaine de Méched-Mourgab sur le Polvar, rivière dont les eaux se déversent dans un marais salé non loin de Chiraz. C’est sur l’emplacement même du champ de bataille que Cyrus éleva plus tard la ville de Parsagade. Astyage fut complètement défait, la plupart de ses soldats restèrent sur le champ de bataille et lui-même tomba entre les mains de l’ennemi. Sa capitale Ecbatane ouvrit ses portes aux vainqueurs sans essayer la moindre résistance ; on était vers 548[17] : Astyage avait régné trente cinq ans. Une inscription cunéiforme trouvée à Babylone confirme le récit des événements militaires autour desquels la légende s’est greffée au point de les rendre méconnaissables. Dans ce document, la révolte de Cyrus est racontée en ces termes : Astyage (Istuvegu) rassembla son armée, et il marcha contre Cyrus, roi de la ville d’Ansan, pour le capturer, et... (quelques mots manquent)... L’armée d’Astyage se révolta contre son roi ; elle le fit prisonnier et le livra à Cyrus. Cyrus marcha sur le pays d’Agamtana (Ecbatane), la cité royale ; il prit l’argent, l’or, les trésors, et emporta du pays d’Ecbatane dans le pays d’Ansan les objets et les richesses qu’il avait pillés. Cette relation, écrite à la chancellerie de Cyrus, est encore corroborée par une inscription de Nabonid, l’avant-dernier roi de Babylone, publiée récemment par M. Pinches. Le monarque chaldéen y raconte d’abord un songe dans lequel lui apparurent Marduk et Sin pour lui ordonner de rebâtir un temple de Sin, détruit dans une guerre par le roi des Mèdes. Marduk me parla ainsi : Nabonid, roi de Babylone, monte sur ton char, rebâtis les murs du temple Hulhul et rétablis le trône de Sin, le grand seigneur qui séjourne en ce lieu. — Je répondis avec respect au dieu Marduk : je rebâtirai le temple dont tu parles, le roi des Mèdes l’ayant détruit, car violente était sa puissance. Mais en la treizième année, il eut des difficultés avec Cyrus, roi du pays d’Ansan, son petit serviteur. Ce dernier vint avec une faible armée, fit prisonnier Istuvegu (Astyage), roi de l’Urvanda ; il lui prit ses trésors et son royaume. La légende intervint ensuite et raconte qu’Astyage avait donné en mariage sa fille Amytis au Mède Spitamas ; pour se rattacher plus directement à la famille royale des Mèdes, Cyrus tue Spitamas, épouse Amytis et se fait couronner roi à la place de son beau-père. Tel est le romanesque récit imaginé par Ctésias pour rehausser l’antiquité de la famille des Achéménides et la rattacher à la lignée des rois mèdes. Le même narrateur ajoute que le vainqueur traita dans la suite Astyage comme nu père ; Hérodote dit simplement que le roi mède devint le captif de Cyrus ; les traditions arméniennes, au contraire, prétendent qu’il fut tué de la main de Tigrane. Le roi d’Arménie, après avoir repris avec lui sa sœur, emmena prisonniers dix mille Mèdes, avec la première des femmes d’Astyage, que Moïse de Khorène appelle Anouisch, mais qui doit être sans doute Aryénis, fille d’Alyatte, roi de Lydie. Il leur assigna pour demeure le pays qui s’étend depuis l’Ararat jusque sur les deux rives de l’Araxe, à l’est. Leur postérité s’y accrut considérablement et forma par la suite, jusqu’au IIe siècle de notre ère, un gouvernement particulier, appelé Mouratzian. A cette population mède de l’Ararat se rapportait, dans les souvenirs populaires de l’Arménie, tout un cycle de traditions et de légendes, dont s’inspirèrent plus d’une fois les poètes et dont quelques traces sont restées éparses dans le livre de Moïse de Khorène. Tigrane reconnut Cyrus pour son suzerain et se montra toujours envers lui son fidèle vassal. Ses descendants continuèrent de gouverner leur royaume sous la suzeraineté de la Perse, sans jamais se révolter, jusqu’à Vahê, fils de Van, dernier prince de la dynastie, qui mourut en défendant la cause de Darius Codoman contre Alexandre le Grand. Ils n’étaient pas traités sur le même pied que les autres rois vassaux, mais avec beaucoup plus d’honneurs, comme les plus grands parmi les Perses proprement dits. Partisan déterminé de l’influence de la Perse et de tout ce qui en venait, autant que dévoué personnellement à Cyrus, qui avait brisé la tyrannie d’Astyage, Tigrane embrassa la religion de Zoroastre et la propagea clans ses États, où elle devint bientôt prédominante, mais en se combinant avec quelques restes du polythéisme assyrien antérieurement professé par la population. Aussi tous les mots qui expriment en arménien, encore aujourd’hui, le nom même de dieu et les idées de sainteté, de feu, de bûcher, de culte, etc., sont-ils iraniens. Les armées confédérées de Cyrus et de Tigrane descendirent sur la Mésopotamie qui formait, depuis la chute de l’Assyrie, la province la plus occidentale de l’empire mède et qui, croyant peut-être que l’heure d’une nouvelle indépendance avait sonné pour elle, refusa de reconnaître l’autorité du roi des Perses. Sur les ruines fumantes de la capitale de l’Assyrie, les Mèdes avaient bâti deux villes qui avaient pris rapidement un grand développement et que visita plus tard Xénophon à la tête des Dix-Mille : ce sont les forteresses de Mespila et de Larissa. Cette dernière place fut assiégée par Cyrus et Tigrane qui n’eussent peut-être pas réussi a s’en emparer, si un prodige extraordinaire n’était intervenu en leur faveur. Cyrus, raconte Xénophon, faisait de vains efforts pour s’emparer de Larissa quand une nuée s’interposant, cacha le soleil, si bien que les habitants abandonnèrent la ville et qu’elle fut prise. Mespila, que les Perses victorieux atteignirent en remontant le Tigre après une journée de marche, ne succomba, à son tour, que grâce à l’intervention divine. On raconte, dit encore Xénophon, que Médée, femme du roi, y chercha un refuge lorsque les Mèdes furent dépouillés de l’empire par les Perses. Le roi des Perses assiégeant la ville, et ne pouvant la réduire ni par le temps ni par la force, Jupiter terrifia les habitants par le tonnerre et ainsi la ville fut prise. Le royaume des Mèdes s’étendait à l’Occident jusqu’au cours de l’Euphrate ; Cyrus dut encore faire le siège de Harran (Charræ) et des autres places fortes de la région qui avait été autrefois le pays d’Assur. Ce fut dans ces parages qu’il se trouva pour la première fois en contact avec les Chaldéens. Ainsi, la seule résistance sérieuse à Cyrus faisant la conquête de l’empire médique, eut pour théâtre l’Assyrie : les populations sémitiques de la haute Mésopotamie avaient cru, sans doute, trouver une occasion favorable pour secouer le joug iranien. La lutte dura environ quatre ans (548-544). Mais dans la Médie propre, la communauté de race et d’origine des Mèdes et des Perses fit que le vainqueur ne rencontra pas le moindre obstacle. Ce fut, comme le remarque M. Maspero, un changement de dynastie, plutôt qu’une conquête étrangère : Astyage et ses prédécesseurs avaient été rois des Mèdes et des Perses, Cyrus et ses successeurs furent rois des Perses et des Mèdes[18]. |