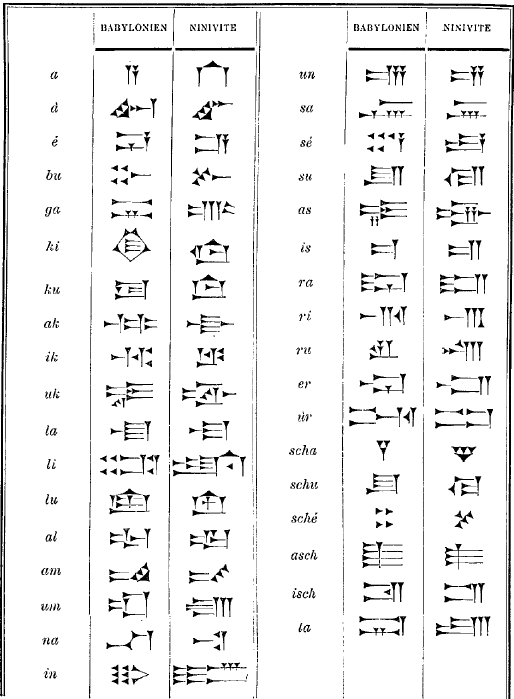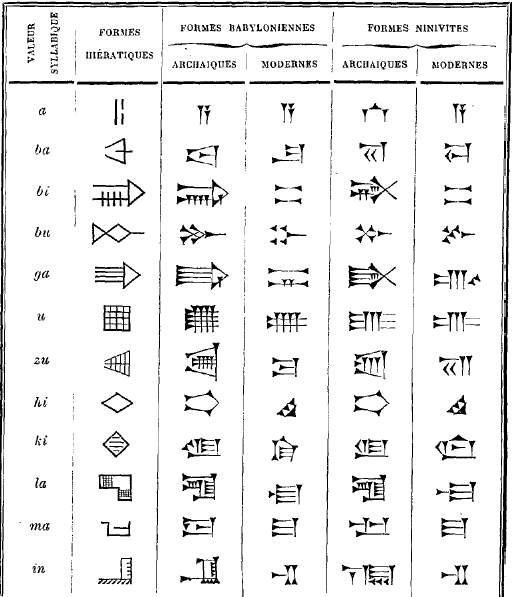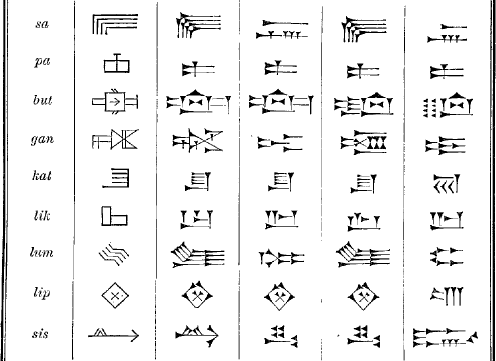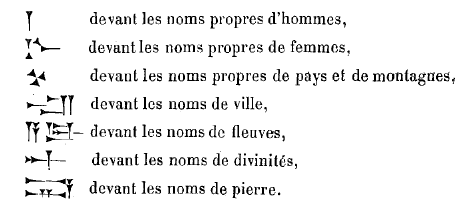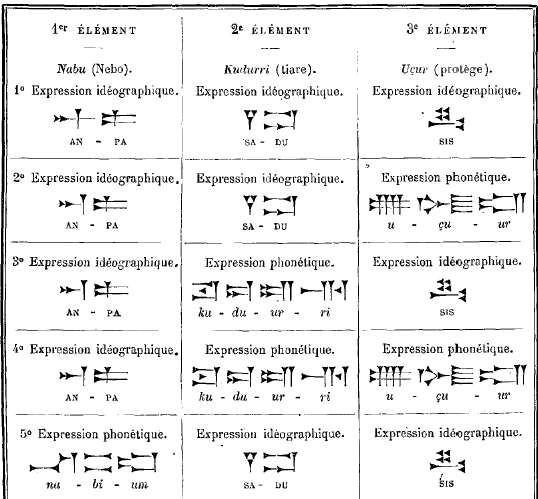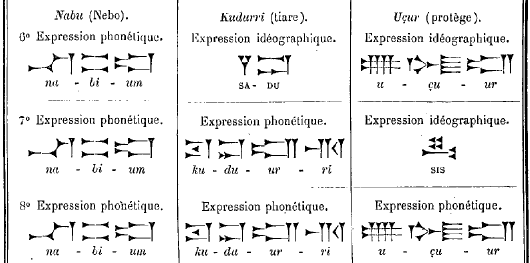CIVILISATION, RELIGION ET MONUMENTS DE L'ASSYRIE ET DE LA CHALDÉE
CHAPITRE II — LES LETTRES ET LES SCIENCES.
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — L’ÉCRITURE ET LE DÉCHIFFREMENT Les Assyriens et les Chaldéens écrivaient sur la pierre et sur l’argile molle. Se servaient-ils aussi, comme les peuples primitifs, de peaux d’animaux, de feuilles d’arbres ; de parchemin même ou de papyrus comme les Egyptiens ? Nous n’en savons rien encore. Jusqu’ici on n’a pas trouvé d’écriture cunéiforme sur une autre matière que la pierre ou la brique, et, les inscriptions ne font pas allusion au papyrus ou au parchemin. Bien qu’il soit probable que ces deux substances ne leur étaient pas inconnues, il est certain que, s’ils les employèrent pour écrire, ce fut toujours à l’état d’exception ; les documents les plus populaires, les plus usuels mêmes, comme les contrats privés, sont gravés sur la brique, et il convient d’ajouter, bien qu’on ait quelques inscriptions peintes sur les murs et non gravées, qu’il eut été beaucoup plus difficile de peindre l’écriture cunéiforme sur une substance comme le parchemin ou le papyrus que de la graver sur l’argile avant la cuisson. L’apparence de coin ou de clou donnée à chaque élément des caractères, n’était pas essentielle à l’écriture, comme nous le verrons en parlant de la transformation des signes ; elle fut produite par la l’orme de la petite spatule de métal qui servait à graver et dont l’extrémité était triangulaire. La gravure sur pierre n’a pas besoin d’être expliquée ; elle s’exécutait au moyen d’un ciseau ; ou l’employait pour les grandes inscriptions monumentales : la netteté des caractères en est généralement admirable. Toute autre est l’écriture sur briques. S’agit-il de ces briques cuites au four ou simplement séchées au soleil, qui servent à la construction des édifices, et sur chacune desquelles on reproduit invariablement la même formule, le procédé était l’estampage : sur un moule de bois ou de fer qui sert de matrice, on sculpte en relief et à rebours l’inscription qui doit figurer en creux sur le plat de chaque brique ; on procède encore à peu près de la même manière dans nos tuileries modernes, pour marquer le nom du fabricant. Mais est-il question de ces contrats d’intérêt privé, de ces textes magiques et mythologiques, ide ces observations astronomiques et de toute cette littérature dont nous avons des débris considérables, l’opération est infiniment plus délicate. Le scribe prend un gâteau d’argile détrempée légèrement, de manière à former une pute consistante et très épaisse, et à l’aide de sa pointe de fer, il y trace, en traits anguleux, fins et compacts, et en lignes serrées, tous ces caractères cursifs si enchevêtrés qu’il faut déjà être un assyriologue consommé pour en essayer le déchiffrement matériel. On sera peut-être surpris d’apprendre que, s’il existe en Europe un assez grand nombre de savants capables de traduire une inscription cunéiforme déjà transcrite sur le papier, il n’est qu’un nombre très restreint de personnes capables de bien déchiffrer, sur le monument lui-même, l’écriture des contrats d’intérêt privé, par exemple ; il faut, pour ce genre d’étude, une longue expérience servie par d’excellents yeux, avec une connaissance approfondie de la langue. Selon la nature et la longueur des inscriptions qu’on avait à graver, le gâteau d’argile avait des dimensions plus ou moins étendues et des formes variées. Pour les textes racontant les fondations de temples ou de palais, ou d’autres événements historiques, on se servait généralement de cylindres en terre cuite, ayant la forme de petits barils ; bombés à leur partie centrale, c’était, si l’on veut, comme deux cônes tronqués soudés l’un à l’autre par leur base : ces cylindres étaient déposés dans mie petite cavité ou cachette ménagée dans le mur de fondation des édifices, et c’est là que les explorateurs modernes les retrouvent presque à coup sûr. Les contrats d’intérêt privé affectent une autre forme ; nous ne saurions les mieux comparer qu’à nos savons de toilette. Ils sont rectangulaires, légèrement bombés au milieu de leurs deux faces plates, et les angles arrondis. Le calligraphe gravait l’inscription, les témoins apposaient, sur la tranche de la tablette, l’empreinte de leur sceau s’ils en avaient un, l’empreinte de leur pouce s’ils étaient trop pauvres pour avoir un cachet en pierre dure ; puis l’acte était soumis à l’action du feu. Cette première opération terminée, on retirait du four le gâteau durci comme la brique, on l’enveloppait d’une mince couche d’argile molle et l’on répétait sur cette enveloppe extérieure le contenu du contrat, avec les mêmes formalités ; après quoi, le monument subissait une seconde cuisson. Ainsi donc, les contrats étaient rédigés en double : un texte invisible et inaltérable par la fraude ou une cause accidentelle, et un texte extérieur auquel les parties pouvaient toujours avoir recours. S’il survenait contestation, altération ou soupçon de quelque nature relativement au libellé de l’acte, le juge brisait la première enveloppe, et l’on pouvait ainsi se reporter au texte intérieur qui n’avait pu être atteint par des modifications ou des surcharges de quelque nature qu’elles fussent[1]. Par ce qui précède, on peut déjà se rendre compte qu’il y avait deux sortes d’écriture, la monumentale et la cursive ; celle-ci plus penchée, plus rapide, plus enchevêtrée. Il y avait aussi une différence notable entre l’écriture de Babylone et celle de Ninive ; les exemples suivants feront, mieux que tous les raisonnements, saisir cette différence essentielle[2] :
Un autre point important de la paléographie chaldéo-assyrienne, c’est ce que nous pourrions appeler la genèse des signes. Il ne faudrait pas croire en effet, qu’à Ninive comme à Babylone, l’écriture fût demeurée stationnaire et n’eût subi aucune modification durant cette longue série de siècles que vécurent les empires chaldéo-assyriens. Le syllabaire s’est transformé lentement et graduellement, de telle sorte qu’il est souvent fort difficile, de rapprocher un signe archaïque de sa l’orme moderne quand on ne possède pas les échelons intermédiaires. Sans remonter jusqu’à l’époque où l’écriture cunéiforme était hiéroglyphique, pour ne pas traiter de nouveau un sujet déjà abordé dans cet ouvrage, nous croyons pourtant utile de montrer, dans un tableau d’ensemble, quelques-unes de ces transformations, choisies parmi les plus essentielles et les mieux établies :
Les signes de la première colonne, appelée improprement hiératique, représentent l’état de l’écriture vers le temps de Gudea et de Naram-Sin ; nous savons qu’ils dérivent d’hiéroglyphes qui se sont lentement altérés à travers les âges. Ce qui est singulier, c’est que les formes successives de l’écriture ne préjugent en rien de l’époque de la rédaction des inscriptions. Ainsi, sur des cylindres-cachets en pierre dure qui ne sont pas antérieurs à l’époque de Nabuchodonosor, on rencontre encore des inscriptions en écriture hiératique ou archaïque ; parmi les grandes inscriptions des Sargonides ou de Nabuchodonosor, les unes sont écrites avec les caractères que nous avons appelés modernes, les autres sont en caractères archaïques ; de telle sorte que les écritures anciennes se sont maintenues à côté de leurs dégénérescences et de leurs déformations ; dans les grandes inscriptions monumentales, on employait concurremment les unes et les autres, de la même façon que, pour nos inscriptions publiques, nous faisons usage de la majuscule ou de l’onciale. Jusqu’ici, nous ne nous sommes occupés que de la forme extérieure des signes et de leurs transformations graphiques ; étudions maintenant ces signes au point de vue de leur valeur et de leur lecture. Les caractères cunéiformes employés pour écrire l’assyrien
ont, en t éuéral, a la fois des valeurs idéographiques et des valeurs
syllabiques ou phonétiques. Ainsi, par exemple, le signe
Enfin, on plaçait devant ou après certaines catégories de mots, des déterminatifs préfixes ou suffises qui permettent a priori de savoir de quelle espèce de choses il est question. Les plus usités sont les suivants :
Il n’y a en général, qu’une manière d’exprimer une syllabe simple comme ba, bu, ab, ub ; mais une syllabe complexe comme ban, nak, lib, peut s’exprimer soit par le signe simple qui y correspond, soit par deux signes juxtaposés : ba + an, na-ak, li-ip. Enfin, un mot ou même simplement les différentes syllabes du corps d’un mot, peuvent être écrites phonétiquement ou idéographiquement, sans que le choix de ces deux modes soit dicté par un autre motif que le caprice du scribe ou le hasard. Un exemple fera bien saisir ces variations, rebutantes parfois pour ceux qui commencent l’étude de l’assyrien. Le mot Nabuchodonosor (Nabu-kudurri-uçur) est, comme tous les noms propres assyriens, une sorte de formule précative à l’adresse d’une divinité ; il signifie : Dieu Nabu, protège ma tiare. D’après les règles de variations et de substitutions que nous venons d’exposer, on le trouve orthographié indifféremment dans les textes, des huit manières suivantes, relevées par M. Menant :
La langue assyrienne est une langue sémitique : ce fait,
-Contesté longtemps au début des études assyriologiques, ne saurait plus être
mis en doute aujourd’hui que par l’ignorance ou le parti pris. La grammaire,
le vocabulaire et la syntaxe sont sémitiques, et les racines des mots sont en
général trilittères, comme dans les langues congénères. Cependant
l’investigation de la racine est parfois rendue singulièrement difficile à
cause de l’inaptitude de .l’écriture cunéiforme à exprimer certaines
particularités des langues sémitiques. Il n’est pas possible, dans cette
écriture, de distinguer entre les différentes lettres d’une même classe ;
toutes les gutturales s’expriment de la même manière ; de même pour les
labiales, les palatales, les linguales, les dentales. Ibru allié et ipru poussière, s’écrivent de la même
façon ; Toutes ces questions d’origine et cent autres encore, dans le domaine de la linguistique, qui n’ont point encore reçu de solution scientifique, seront sans doute éclaircies lorsque nous comprendrons les langues parlées dans les pays limitrophes de l’Assyrie et de la Babylonie, et qui, au même titre que l’assyrien, se sont servies de l’écriture cunéiforme. Connaissons-nous l’arméniaque, le susien, l’élamite ? Connaissons-nous même le médique, c’est-à-dire la langue de la seconde colonne des inscriptions trilingues de Persépolis et de Behistun ? Non, certes ; et malgré les louables efforts de divers savants, ces études sont encore dans l’enfance. Les affinités linguistiques de l’assyrien, sa place dans le groupe des langues sémitiques, ses emprunts aux langues antiques de la Perse, l’origine même de l’écriture cunéiforme, tous ces grands problèmes de philologie, comme tous ceux qui se rapportent à la chronologie historique, sont à peine abordables à l’heure présente et il faut savoir attendre patiemment de nouvelles découvertes. § 2. — LA LITTÉRATURE En donnant, au début de l’histoire politique des empires de Chaldée et d’Assyrie, un aperçu sommaire des sources de cette histoire, nous avons mentionné les débris de littérature nationale qui nous sont parvenus seulement en grec, après avoir subi des traductions, des interpolations, des abréviations et dis remaniements de toute sorte qui en ont compromis la valeur quand ils ne les ont pas absolument dénaturés. Il serait impossible de reconstituer les livres chaldéens à l’aide de ces Ασσυριακά et de ces Βαβυλωνικά que des auteurs grecs, à l’instar de Bérose, ont composés d’après des textes indigènes ; mais ces fragments, si informes qu’ils soient, suffiraient pourtant, à défaut d’autres preuves, à nous attester que Babylone fut, dès une haute antiquité, le centre d’une culture intellectuelle extraordinairement développée et féconde, et que cette littérature se composait essentiellement d’écrits religieux, exposant divers systèmes théogoniques et cosmogoniques, de traités didactiques et scientifiques, de livres de divination et de magie. Le renom qu’avaient acquis, cher les Grecs et les Romains aussi bien que chez les écrivains arméniens et syriens du commencement du moyen âge, les vieux livres chaldéens, ne fait qu’accroître des regrets qui ne sont pas compensés par les éléments d’astronomie et de médecine babyloniennes qu’on recueille dans le Talmud et chez les Gnostiques. Tels étaient d’ailleurs l’étroitesse d’idées, le manque de critique et la déplorable direction imprimée aux esprits par les doctrines néoplatoniciennes, gnostiques, cabalistes et les querelles religieuses qui ont suivi la diffusion du christianisme en Orient, que le peu que les écrivains de ce temps ont glané dans la littérature chaldéenne, est précisément ce qu’il y avait de moins intéressant et de plus futile. Faut-il rien d’aussi méprisable, au point de vue historique, que ces traductions ou ces pastiches d’ouvrages chaldéens sur la magie et l’astrologie, attribués à Adam, à Noé, à Seth, à Zoroastre, et même à Lasbas le Babylonien et à Teucer le Chaldéen ? Quelle heureuse fortune si les écrits de ces auteurs, en arabe ou en grec, eussent été perdus à la place de ce qu’ils ont négligé de traduire ou de copier, comme indigne, suivant leur jugement, de passer à la, postérité ! Il circulait, par exemple, sous le nom de Bérose, des ouvrages d’astronomie auxquels Sénèque, Plutarque, Vitruve et Stobée ont fait des emprunts, et la renommée de Bérose comme astrologue avait presque effacé, vers le commencement de l’ère chrétienne, celle qu’il eut dû avoir comme historien. Pline nous apprend que les Athéniens lui avaient élevé une statue dans le Gymnase, non certes, pour ses écrits historiques, mais à cause de ses prédictions ; saint Justin le Martyr parlant de la fameuse sibylle de Cumes, dit qu’elle était venue de Babylone et qu’elle était la fille de Bérose. Voici ce que raconte Suidas à son sujet : La sibylle chaldéenne s’appelait, de son nom propre, Sambéthé, de la famille du bienheureux Noé ; c’est elle qui prédit les exploits d’Alexandre le Macédonien et dont parle Nicanor, l’historien de la vie d’Alexandre ; elle a fait mille prophéties sur le Seigneur Christ et sa venue. Les autres sibylles sont d’accord avec elle, et on a de celle-ci vingt-quatre livres, traitant de tout peuple et de tout pays. Du temps de l’empire romain, les docteurs chaldéens, interprètes de cette sibylle, qui parcouraient le monde en se livrant à leur art divinatoire, avaient des recueils de recettes dont la plupart remontaient â l’époque la plus reculée : les uns sont des astrologues d’origine chaldéenne comme Kidénas, Naburianos et Sadinas que cite Strabon, et Zachalias de Babylone mentionné par Pline ; d’autres sont qualifiés de Parthes, comme le Inpsada ou Impsanda de Pline, le Yanbouschad de l’Agriculture nabatéenne ; d’autres enfin paraissent, d’après leurs noms, avoir une origine grecque, comme Diogène le Babylonien, Teucer de Babylone, le Tenqélouscha des écrivains astrologiques arabes et de l’Agriculture nabatéenne, et Séleucus de Séleucie, mentionné par Strabon. Malheureusement, la plupart de ces auteurs ne sont connus que de nom, et leurs écrits, remplis sans doute de puérilités et de contes charlatanesques, ne nous apprendraient que fort peu de chose sur l’ancienne civilisation babylonienne ; de même que dans les livres des Mendaïtes et dans ceux de Koutami, l’histoire parait avoir été leur moindre souci, et tout porte à croire qu’ils l’avaient systématiquement bannie. Plus utiles, sans doute, seraient ces livres au point de vue des sciences philosophiques et religieuses. Un exemple suffira pour le prouver. Nous savons que les Chaldéens avaient une doctrine philosophique et que les recherches métaphysiques formaient une des branches les plus importantes de leur enseignement ; mais nous ne pouvons guère en parler que par ouï-dire et sur la foi des auteurs classiques. Damascius et Michel Psellos sont les deus seuls auteurs qui, dans l’antiquité, se soient sérieusement préoccupés de ce côté de la science chaldéenne, et encore ce dernier mérite-t-il à peine d’être cité. Damascius au moins, parle avec détails des doctrines philos ophico-religienses des docteurs chaldéens, de leurs spéculations métaphysiques, du rôle cosmique qu’ils attribuent à la lumière et aux ténèbres, au sec et à l’humide, de leur mythologie. Une circonstance bien singulière s’est révélée naguère par la découverte des briques de la bibliothèque d’Assurbanipal : sur ces tablettes retrouvées par G. Smith se trouve le début du récit théogonique assyrien de la création : c’est le même récit que Damascius a inséré dans son traité Des premiers principes, si bien qu’on croirait à une traduction presque mot à mot faite par l’auteur grec sur le texte cunéiforme. C’est là, malheureusement, un fait isolé, et pareille constatation ne s’est pas renouvelée, même pour les fragments de l’histoire que Bérose avait composée d’après les archives des temples babyloniens. La tradition classique, comme la tradition orientale, ne nous a conservé des anciens écrits assyriens que des puérilités ou des récits farcis d’interpolations qui en ruinent la valeur historique. La littérature chaldéenne originale, dans son ensemble, ne saurait doue être jugée d’après les extravagances et les aberrations dans lesquelles sont tombés ses interprètes. Cependant, il ne faudrait pas non plus verser dans l’excès opposé en s’en exagérant l’intérêt et la haute portée ; si Babylone fut à la tête d’un mouvement littéraire dont ses collèges de prêtres étaient les organes, elle n’eut jamais rien de comparable à ces grands siècles littéraires qui ont toujours été l’apanage exclusif de la race indo-européenne. Étroit et mesquin fut toujours l’esprit de ses savants qui ne connurent ni l’essor sublime de la pensée, ni la logique rigoureuse du raisonnement, ni la critique sévère des faits. Nous pouvons bien en juger par les livres religieux de la secte des Mendaïtes, qui ont conservé le plus fidèlement l’écho (le la grande civilisation chaldéenne. En examinant avec quelques détails les écrits des Mendaïtes et des Sabiens de la Mésopotamie, nous nous dédommagerons, dans une certaine mesure, de la perte des livres originaux dont ils représentent la dernière transformation. Le livre religieux le plus important des sectaires de la basse Chaldée, celui où leurs croyances sont exposées d’une manière à la fois historique et dogmatique, est celui que Norberg a publié sous ce titre Codex Nasaræus, liber Adami appellatus. Les Mendaïtes lui donnent différents noms ; le plus commun est Sidra rabba ou le Grand livre ; on l’appelle aussi Ganza rabba, le grand Trésor, ou Sidra l’Adam, livre d’Adam. Cette dernière expression vient de ce que les Mendaïtes prétendent qu’il a été envoyé par Dieu même à Adam, le premier homme, par le ministère de l’ange Razaël. Des puérilités, même dans la disposition matérielle du texte, préviennent déjà contre la valeur scientifique d’un tel livre. Les manuscrits du Sidra rabba sont divisés en deux parties juxtaposées de telle sorte que, lorsqu’on tient le livre, l’une de ces parties se trouve à l’envers, la tête en bas. Elles commencent par conséquent chacune à l’extrémité du volume et se rejoignent au milieu. Dans tout le livre, il n’est traité que de théologie, d’astrologie, d’histoire des anges et des démons qui se comptent par milliers, de la création et de l’histoire religieuse et mystique du monde. Il y est fait mention d’Adam, de Noé, d’Abraham, de Moïse, de Salomon, de saint Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, de Mahomet, à côté des traditions chaldéennes ; on ne peut pas dire pourtant qu’il y soit question d’histoire proprement dite, à moins qu’on ne fasse exception pour une singulière chronologie royale qui commence au déluge pour aboutir aux rois de Perse de la dynastie Sassanidu. Chacun des manuscrits que nous possédons, porte là date de l’hégire où en a été rédigée la copie, ainsi que le nom du lieu, et le nom du scribe, ordinairement un prêtre de la secte. Ainsi, pour l’un des exemplaires de la Bibliothèque nationale, il ressort de plusieurs notes finales, que la copie a été exécutée à Dladgam, près de Howaiza, en 963 de l’hégire (1560 de J.-C.) par Ram Bakhtiar bar Behram Schadam. C’est le premier manuscrit mendaïte qui soit parvenu en Europe : acquis en 1674 à Bassora par J. Fr. Lacroix, il est entré ensuite dans la Bibliothèque de Colbert. Quand on parcourt le Sidra rabba, il est facile de se rendre compte de la manière dont ce livre a été composé : c’est une compilation, un assemblage de morceaux détachés, n’ayant aucun lieu entre eux. Souvent le même récit est répété dis fois avec des développements plus ou moins étendus, dans dix chapitres différents. Le scribe a pris la peine de nous donner la généalogie et les sources de plusieurs des chapitres. Il a copié telle partie sur un exemplaire appartenant à un possesseur plus ancien, lequel l’avait copié lui-même sur un autre manuscrit d’une antiquité plus reculée, et il remonte ainsi parfois jusqu’à la vingtième génération de manuscrits, ce qui nous reporte nécessairement à une ancienneté respectable, bien que nous ne puissions l’apprécier avec précision. Le second en importance des livres des Mendaïtes est le Sidra d’Yahio, le livre de Jean, qu’ils appellent encore Dravchod d’Yahio, ou les paroles sublimes de Jean. Ce Jean n’est autre que saint Jean-Baptiste, le précurseur, que les Mendaïtes regardent comme leur législateur spirituel. Le Sidra d’Yahio, est plutôt un recueil liturgique et un livre de cérémonies et de prescriptions religieuses qu’un ouvrage dogmatique. Il contient la vie de Yahio, vie moitié humaine, moitié surnaturelle, remplie de faits miraculeux et de prodiges ridicules. Il renferme en outre les règles qui doivent être observées dans les cérémonies du culte, les règlements des jours de fête, des jeûnes, de la prière, et toutes les prescriptions auxquelles doit se conformer un Mendaïte pour être un bon fidèle et faire le salut de son âme ; il y a aussi, comme dans le Sidra rabba, des morceaux entiers qui ne sont que des incitations à la piété. Un autre recueil plus spécialement liturgique encore, est le Qolasta appelé aussi Divan. Ce livre ne renferme que des hymnes et des prescriptions relatives à l’administration du baptême, aux ablutions, aux prières que doit réciter un bon Mendaïte, au mariage, à la mort et au jugement des âmes. Un quatrième ouvrage contient des prières pour le mariage, les jours de la semaine et la plupart des circonstances de la vie ; il renferme aussi des gloses astrologiques très importantes, les prières et les formules que l’on récite pour que les amulettes préservent des maladies et éloignent les malheurs. Il est fort ancien et la plupart des incantations qu’il contient remontent à l’époque chaldéenne. C’est évidemment ce même livre qu’Abraham Ecchel[3] a mentionné sous le nom de Sfar Molousché, livre des signes du zodiaque ou de la sphère. Dans ce recueil astrologique, d’après Ecchel, la sphère céleste est divisée en vingt-quatre parties égales, douze males et douze femelles, et il sert à tirer les horoscopes des enfants à leur naissance. A côté de ces livres reliés en feuillets comme nos livres modernes, les 31cndaïtes ont encore un volumen qui, d’après leur liturgie, ne doit pas être en feuillets, mais, au contraire, former un rouleau, comme le Pentateuque samaritain. La Bibliothèque nationale possède un de ces rouleaux qui a près de quatorze mètres de long, sur une largeur de seize centimètres. Divisé en quatre cent neuf paragraphes traitant de la cosmogonie, des croyances religieuses, des devoirs des évêques et des prêtres, de ceux des fidèles, il est conçu sous forme de questions et de réponses qui sont censées adressées par un archange, Hibel Zivo Yavar à Nabat rabba. Comme complément à la littérature mendaïte, nous devons mentionner les inscriptions qu’on a découvertes dans des temps très rapprochés de nous. C’est d’abord la fameuse inscription d’Abouschadr publiée avec un savant commentaire par Dietrich, et dans laquelle M. Renan croit trouver des raisons philologiques tout à fait décisives pour la rapporter au dialecte mendaïte. C’est, en second lieu, les inscriptions des bols judéo-chaldéens en terre cuite qu’on a découverts sur les ruines même de Babylone. Ces inscriptions sont écrites, en une sorte de caractère qui tient le milieu entre l’estranghelo et le palmyrénien ; les plus anciennes remontent seulement au septième siècle de notre ère ; mais on y trouve mentionnés les noms des divinités mendaïtes comme Nérig et Abatour : elles contiennent des recettes et des formules magiques pour jeter des sorts et meltre en fuite les mauvais esprits : ces recettes et ces formules remontent aux Chaldéens. Nous avons dit tout à l’heure qu’un seul passage du Sidra rabbi paraissait avoir quelque caractère historique ; mais l’histoire s’y trouve défigurée. Il y a notamment une liste des princes qui ont régné depuis le déluge jusqu’à la conquête musulmane de la Perse ; les plus anciens, par la longueur invraisemblable de leur règne, sont une réminiscence des rois énumérés par Bérose ou des patriarches postdiluviens de la Bible. Le premier, Gaïmourat, le Caïomors des traditions persanes, règne neuf cents ans ; Faridoun, le Feridoun persan, conserve le pouvoir pendant quatre cent cinquante ans ; Schlimoun bar Davit (Salomon fils de David), règne mille ans, savoir neuf cents ans sur la terre et cent ans au firmament. Bref, l’absurde et le contradictoire se disputent la prédominance dans ces listes où des noms perses du Shah Nameh sont accolés sans pudeur à des noms chaldéens ou bibliques. Aussi, un des savants qui ont le plus étudié les écrits mendaïtes, Silvestre de Sacy, les qualifie de tissu d’absurdités, et il ajoute : L’imagination y joue un grand rôle, mais c’est une imagination désordonnée dont les tableaux n’ont ni ensemble ni proportions, ni juste distribution des parties, et n’offrent presque toujours que des scènes affreuses et dégoûtantes. En un mot, la peine que coûte l’élude d’un tel recueil est bien mal récompensée par les résultats qu’elle produit[4]. Ce jugement, peut-être trop sévère, pourrait s’appliquer au même titre, aux livres religieux des Yézidis, dont on ignore encore le contenu, parce qu’aucun étranger n’a jamais pu réussir à les compulser : le Jalaou ou Jiloua, le livre ancien, et le Mashofi-Rasche, le livre noir, qui, parait-il, n’est que le commentaire du Jalaou[5]. Ce n’est pour ainsi dire encore que par ouï-dire, qu’on peut parler de la secte des Yézidis et de ses livres religieux ; l’érudition moderne est mieux informée au sujet d’une autre source, plus précieuse au point de vue des traditions chaldéennes, parce que les égarements d’imagination y sont moisis grands et que la dernière rédaction en remonte jusqu’au Xe siècle de notre ère. Il s’agit du Traité d’agriculture nabatéenne et de quelques autres écrits traduits du chaldéen en nabatéen et du nabatéen en arabe. Vers l’an 900 de notre ère, un descendant des anciennes familles babyloniennes réfugiées dans les marécages de Wasith et de Bassorah, oit elles vivent encore aujourd’hui, se prit d’admiration pour les ouvrages de ses ancêtres, dont il comprenait et probablement parlait la langue. Ibn Wahschiyyah al Kasdani ou le Chaldéen (c’était le nom de ce personnage) était musulman, mais l’islamisme dans la famille ne datait que de son bisaïeul ; il haïssait les Arabes et éprouvait contre eux ce sentiment de jalousie qui animait aussi les Persans contre leurs vainqueurs. Une bonne fortune ayant fait tomber entre ses mains une grande collection d’écrits nabatéens que l’on avait pu soustraire an fanatisme musulman, le zélé Chaldéen consacra sa vie à les traduire et créa ainsi une bibliothèque nabatéo-arabe, dont trois ouvrages complets, sans parler des fragments d’un quatrième, sont venus jusqu’à nous. Les trois ouvrages complets sont : 1° le Livre de l’Agriculture nabatéenne ; 2° le Livre des poisons ; 3° le Livre de Tenkéluscha le Babylonien ; l’ouvrage incomplet est le Livre des secrets du soleil et de la terre[6]. De ces quatre ouvrages, le Livre de l’Agriculture nabatéenne est de beaucoup le plus considérable et le plus intéressante’. Citée pour la première fois au moyen âge par saint Thomas d’Aquin, l’Agriculture nabatéenne n’a plus été oubliée depuis cette époque par les savants juifs et chrétiens qui n’ont pourtant fourni à son sujet que les renseignements les plus imparfaits, ignorant même le nom de l’auteur, l’époque où il vécut ; et ne se rendant qu’insuffisamment compte des matières renfermées dans cet ouvrage. Ce n’est qu’en 1835, dans son Mémoire sur les Nabatéens qu’un orientaliste français, Quatremère, étudia l’Agriculture dans son texte et reconnut qu’elle renfermait de précieux renseignements sur l’ancienne littérature de Babylone ; il en attribua la rédaction vers l’époque du règne de Nabuchodonosor, quand Babylone était dans toute sa splendeur. Plus récemment, M. Chwolsohn qui reprit et approfondit la question, tout en préparant u te édition de l’ouvrage, se montra beaucoup plus hardi que Quatremère, et les résultats de ses recherches se résument dans cette proposition : le Babylonien Koutami est l’auteur du Traité de l’Agriculture nabatéenne, qui fut traduit par Ibn Wahschiyyah, et il n’a pu être écrit plus tard que le commencement du XIIIe siècle avant Jésus-Christ[7]. Les arguments de M. Chwolsohn pour faire remonter la rédaction du Traité d’Agriculture nabatéenne à une date aussi reculée sont les suivants ; leur énumération fera tout au moins connaître et apprécier le contenu du livre. Dans le Traité d’Agriculture nabatéenne, remarque le savant russe, on ne voit mentionnée aucune des villes de création postérieure à la chute de Babylone, qui ont fleuri dans la basse Mésopotamie, comme Séleucie, Ctésiphon, Bassora ; nulle trace de christianisme on des dominations arsacide, séleucide, sassanide. Babylone y est toujours représentée comme en pleine prospérité. Des vingt rois de cette grande capitale qui sont cités, aucun ne coïncide avec les noms des dynasties babyloniennes qui sont connues. Ce sont : Abed-Fergila, Bedina, Çalbama, Ilarmati, Ilinafa, Kamasch, llarinala, Nemroda, Qeruçani, Qiyama, Richana, Saha, Schamaya, Schemuta, Susqiya, Thibalana, Zahmuna.. Ces princes dont les noms sont, pour la plupart, fort di fficiles à expliquer et dont la transcription n’est pas toujours sure, à cause de l’incertitude des lettres arabes non ponctuées, forment nue dynastie chananéenne implantée à Babylone par la conquête, et régnant encore au temps de l’auteur Koutami. M. Chwolsohn identifie le nom de Nemroda avec le Nemrod biblique, et il croit que cette dynastie chananéenne est la cinquième dynastie de Bérose, composée de neuf rois arabes, qu’il fait régner de 1540 à 14•88 avant l’ère vulgaire. L’année 1300 avant Jésus-Christ, serait, pour toutes ces raisons, la date la plus récente qu’on puisse proposer par la composition de l’ouvrage de Koutami. L’opinion de M. Chwolsohn a été victorieusement réfutée par M. Renan[8], au moyen d’arguments qu’il serait superflu d’analyser longuement. Koutami cite des ouvrages plus anciens et admet avant lui des siècles de culture intellectuelle et de civilisation. Il faudrait supposer à Babylone une littérature riche, variée, au moins égale à celle que les Grecs développèrent deux mille ans plus tard. Dans le livre de Koutami, sur le premier plan, apparaît le personnage capital de la littérature babylonienne, un certain Ianbuscbâd, fondateur des sciences naturelles et créateur d’une sorte de monothéisme. Quatre ou cinq cents ans le sépareraient de Koutami. Quelques siècles avant Ianbuschâd, on trouve Dhagrit, fondateur d’une autre école qui conserva des partisans même après Ianbuschâd. Ce Dhagrit vivait, selon Chwolsohn, deux mille ans avant Jésus-Christ.... Longtemps avant Dhagrit, on trouve une époque de littérature, dont les représentants sont Mâsi le Suranien, son disciple Gernânâ, et les Chananéens Anouha, Thamitri et Çardana (vers 2500). Tous ces savants apparaissent à la fois comme prêtres, fondateurs religieux, moralistes, naturalistes, astronomes, agronomes, et comme cherchant à substituer un culte épuré à la superstition des idoles. Peu de temps avant eux, vivait Ischita, créateur d’une religion que Koutami combat vivement, quoiqu’il reconnaisse qu’elle a exercé en son temps une influence salutaire. Avant Ischita apparaît Adami, fondateur de l’agriculture en Babylonie, jouant le rôle de civilisateur et nommé pour cela le père de l’humanité. Bien avant lui, on voit figurer Azada, fondateur d’un culte que les classes élevées persécutaient, mais que les basses classes aimaient ; Ankebuta, Samaï-Neheri, le poète Huhuschi qui s’occupe déjà d’agronomie ; Askolebita, bienfaiteur de l’humanité, fondateur de l’astronomie ; et enfin Dewanaï, le plus ancien législateur des Sémites, qui eut des temples, fut honoré comme un dieu et reçut le surnom de maître de l’humanité. Les temps de Dewanaï, selon M. Chwolsohn sont encore purement historiques et Babylone était déjà, à cette époque, un État complètement organisé. On sent avec Dewanaï de longs efforts vers la civilisation, et c’est dans cette période reculée que M. Chwolsohn place Kâmasch-Neheri, auteur d’un ouvrage sur l’agriculture ; les saints et favoris des dieux, Aami, Sulina, Thuluni, Resaï, Kermana, etc., et enfin le martyr Tammuz, qui fonde la religion des planètes, est mis à mort, et est depuis pleuré par ses sectateurs. M. Chwolsohn s’arrête ici ; il reconnaît qu’au delà, tout se perd dans le nuage de la fabuleuse antiquité. M. Renan ajoute encore les considérations suivantes qui ruinent de fond en comble l’échafaudage d’hypothèses dressé par M. Chwolsohn : le texte original de l’Agriculture nabatéenne a été écrit en arménien ; 2.000 ans se seraient écoulés entre sa composition et sa traduction : l’archaïsme de la langue eut été certainement un obstacle à sa traduction au Xe siècle de notre ère ; on trouve, sous la plume de Koutami, des mots grecs, des noms de villes grecques, comme Antioche et Éphèse ; des noms propres grecs comme Hermès, Esculape, Alexandre, Démétrios ; il y est parlé de la médecine scientifique des Grecs, de leur pharmacopée, de leur division des plantes en plantes chaudes et froides ; l’auteur nomme la langue pehlvi, comme un dialecte perse ; il connaît les doctrines de l’Avesta ; il donne aux prêtres zoroastriens le nom de mages, qui ne leur fut appliqué qu’à partir de l’établissement des Perses à Babylone ; il a subi, d’une manière non équivoque, l’influence des livres juifs, car il parle d’Adam comme du père de l’humanité ; il le montre donnant des noms à tous les animaux, ce qui est un emprunt à la Genèse ; il nomme les patriarches Seth, Hénoch, Noé, Abraham. Et pour conclure : L’Agriculture nabatéenne, dit M. Renan, nous apparaît comme empreinte de tous les défauts dont l’esprit humain fut frappé vers le IIIe et le IVe siècle : charlatanisme, astrologie, sorcellerie, goût de l’apocryphe. On est bien loin de cette science grecque de l’époque d’Alexandre, si dégagée de toute superstition, si ferme de méthode, si éloignée des chimères qui devaient, plus tard l’égarer et retarder de seize siècles le progrès scientifique de l’esprit humain. Le Livre des Poisons offre au même titre, au point de vue de sa rédaction dernière, des caractères incontestables de modernité ; il faut en dire autant du Livre de Tenkéluscha, le Babylonien, le Kukanien, un de ces ouvrages de généthliaque qui, répandus en Asie et en Europe à partir de l’ère des Séleucides et au moyen âge, firent du nom de chaldéen le synonyme de charlatan. Évidemment tous ces écrits, les chefs-d’œuvre de la déraison humaine, ont conservé à travers des remaniements de toute sorte, des débris de la plus haute antiquité ; la technique qu’ils renferment est une tradition des anciens collèges sacerdotaux de l’époque des empires chaldéo-assyriens et remonte aux âges les plus anciens. Le point de départ de leur astrologie est dans ces observations sidérales qui sont consignées dans un certain nombre de documents cunéiformes parvenus jusqu’à nous ; leur magie et les procédés de divination qu’ils enseignent, dérivent de celte littérature magique dont nous avons un certain nombre de pages écrites du temps d’Assurbanipal ; les procédés d’agriculture, de canalisation et de drainage qu’ils conseillent ont été mis en usage et consignés par écrit, sans doute pour la première fois, par un Hammurabi ou un Nabuchodonosor. Mais comment démêler l’ivraie du bon grain, ce qui est moderne de ce qui est véritablement antique, dans cet amoncellement indigeste de recettes empiriques ? Cette sélection ne sera possible que lorsque de nouvelles découvertes auront livré entre nos mains la littérature assyrienne presque toute entière, et lorsque nous pourrons comparer les écrits originaux avec leur grossière contrefaçon. Cependant, avec ce que nous avons déjà, en fait d’écrits en langue assyrienne ; avec ce que nous laissent entrevoir les Grecs ; avec les livres de Koutami et ceux des Mendaïtes, nous pouvons déjà chercher à nous faire quelque juste idée de la littérature chaldéo-assyrienne. Elle était caractérisée par une absence totale de critique et de jugement, et les plus étranges égarements de l’imagination ; la noblesse des sentiments, l’originalité des idées en étaient absolument bannies ; le style même étai sans couleur et sans vie, se traînant dans l’ornière de la formule. Impuissance pour la forme, impuissance pour la pensée, la littérature chaldéenne n’enfanta que rêveries, mensonges et absurdités sans nom ; qu’elle est misérable si on la compare même à la plus inférieure des pages de la Bible ! Elle est la digne mère de ces livres gnostiques et cabalistes qui naquirent de ses cendres, et qui marquent la dernière étape de la marche de l’esprit humain dans la voie de la folie et de l’aberration. Ne nous berçons donc pas d’illusion au sujet de l’importance littéraire ou scientifique des monuments que les fouilles modernes de la Mésopotamie mettront au jour : nous laissons ici de côté, bien entendu, les inscriptions historiques. Mais ce point de vue mis à part, on ne peut nier que l’influence de Babylone sur la marche progressive de l’esprit humain n’ait été singulièrement funeste en le détournant des voies scientifiques de la recherche de la vérité, pour le perdre dans les dédales d’une fausse science qui fut, eu honneur en Europe jusqu’à l’aurore des temps modernes. Quelques-uns des produits originaux de la littérature assyrienne nous ont été livrés en partie par une découverte fameuse de M. Henry Layard, à Koyoundjik : il s’agit des salles qui contenaient ce qu’on a appelé la bibliothèque du roi Assurbanipal. Étudions cette bibliothèque et jugeons-la par elle-même. Au cours de son exploration de Ninive, raconte M. Menant[9], M. Layard rencontra deux chambres assez spacieuses, dont le sol était entièrement recouvert, sur une profondeur de cinquante centimètres, de tablettes chargées d’écriture cunéiforme. Il était aisé de constater que ces briques étaient tombées des étagères et des rayons en bois sur lesquels elles avaient été disposées : de place en place elles avaient encore conservé leur ordre primitif, tandis que dans d’autres endroits, elles étaient pêle-mêle et plus ou moins fracassées. Un examen attentif permit même d’établir que ces tablettes avaient été placées dans les salles de l’étage supérieur, et qu’elles avaient été précipitées sur le sol, en effondrant la voûte des salles inférieures. L’étude des inscriptions permit de se rendre compte de l’ordre méthodique suivant lequel les tablettes étaient originairement classées dans la Bibliothèque : Lorsque la nature du sujet comporte une série de tablettes, le récit commencé sur l’une d’elles se continue sur d’autres de même forme et de même dimension ; quelquefois le nombre des tablettes de la même série est très élevé. Chaque sujet ou chaque série de tablettes porte un litre formé par les premiers mots de l’inscription, et se répète sur toutes celles de la série. Ainsi, chaque tablette d’une série de sujets astronomiques, dont le nombre dépasse soixante-dix, porte ce titre : Quand les dieux Anu et Ilu. Ces mots sont le commencement de la première tablette ; à la fin de la tablette, on indique le rang qu’elle occupe dans la série, par cette mention : Première tablette de la série : Quand les dieux Anu et Ilu ; on bien, seconde tablette, troisième tablette de la série : Quand les dieux Anu et Ilu, et ainsi de suite pendant toute la série. Il y a plus : pour s’assurer que chaque tablette conservera la position respective qu’elle occupe dans la série, la dernière ligne de chacune d’elles est répétée à la première ligne de la tablette suivante. Enfin, on a constaté qu’il existait des catalogues écrits également sur des tablettes ; d’autres tablettes, plus petites, portant simplement le titre des ouvrages, sont destinées sans doute à indiquer les différentes séries[10]. Une grande partie des tablettes de la Bibliothèque palatine se rapporte à une sorte de traité d’écriture et de grammaire destiné à débrouiller et éclaircir les arcanes de la langue assyrienne dont le déchiffrement n’était pas toujours facile, même pour les savants chaldéens. On distingue dans celle encyclopédie grammaticale 1° Un lexique de la langue suméro-accadienne avec le sens de ses mots en assyrien ; il devait servir à l’interprétation de certains traités de religion et de science que les savants ou les prêtres chaldéens avaient sans doute rédigés dans la langue liturgique pour les rendre inaccessibles au vulgaire profane ; 2° Un dictionnaire des synonymes de la langue assyrienne ; 3° Une grammaire de la même langue, avec les paradigmes des conjugaisons verbales ; 4° Un dictionnaire des signes de l’écriture cunéiforme, avec leurs significations idéographiques et l’indication de leurs valeur ; phonétiques ; 5° Un autre dictionnaire des mêmes signes, mis en regard des hiéroglyphes primitifs dont ils dérivent ; 6° Un lexique des expressions particulières, et généralement idéographiques, employées dans les inscriptions de l’empire primitif de Chaldée ; ceci révèle une préoccupation archéologique fort remarquable, et nous savons en effet, que les rois ninivites et babyloniens des derniers temps, recherchaient activement, dans les temples qu’ils réparaient, les inscriptions de leurs antiques fondateurs ; nous avons ainsi sur un prisme de Nabonid, conservé au Musée Britannique, la traduction d’une inscription de Sagaraktias, qu’il avait découverte dans les fondations du grand temple de Sippara ; 7° Des tableaux en exemples pour enseigner les constructions grammaticales et l’équivalence des modes d’expression idéographiques et phonétiques. De la grammaire on passait à la littérature proprement dite, et nous ne saurions mieux faire que de donner ici quelques spécimens de dictons, proverbes rythmés qui passaient., sans doute, pour des chefs-d’œuvre de goût, mais donc la finesse et l’esprit nous échappent en partie aujourd’hui : J’ai
fait aller mes jambes, Je n’ai
pas donné de cesse à mes pieds Sans plus de retard, Sers-moi activement. Tu L’en vas dépouiller Le champ de l’ennemi ; Et c’est lui qui vient, qui dépouille Ton champ, l’ennemi. Le blé
de bénédiction prospérera ; nous savons comment. Le blé de l’abondance prospérera ; nous savons comment. Je
mangerai le fruit de mort, Et j’en ferai le fruit de vie[11]. Ô
homme, tu es comme les vieux réchaux. Tu es difficile à changer (en mieux). Tu t’es
levé pour prendre le champ de l’ennemi. Il est venu et l’a pris ton champ, l’ennemi. La
royauté, Mais
elle s’en va, comme l’eau du ciel. Bukli
na’kpi (mots obscurs). La boisson, je ne l’absorbe pas. Réjouis
ceux qui me jalousent Parmi
les hommes Rends-moi parfait. En tout
tu es heureux Seulement tu as revêtu un vêtement étroit. Va
devant les bœufs qui marchent, Tu abîmeras le blé. Mes
genoux se sont pliés, Mes
jambes n’ont pas eu de repos. Le chemin
ne veut pas finir. Maintenant élargis-moi ma tiare. Un veau
et un onagre Sont
attelés ensemble Le char
ainsi attelé Je dois le faire transporter par un taureau. L’amour
charnel a pour suite l’allaitement. Eh bien, j’allaite. Je veux
commettre un farcin Si je le restitue, qui me payera le dommage ?[12] Les matières sacrées étaient représentées dans la bibliothèque d’Assurbanipal par de nombreux fragments mythologiques ; des généalogies de dieux ; des listes des différentes épithètes d’un même dieu, de ses fonctions et de ses attributs. A côté, nous trouvons des tables indiquant toutes les localités où se trouvaient les principaux temples de chaque divinité, et d’autres qui en sont exactement la contrepartie, car nous y lisons l’énumération des dieux qui étaient adorés dans chaque ville de l’Assyrie et de la Babylonie. Il faut y joindre des restes de collections d’hymnes dont le style rappelle quelquefois celui des Psaumes bibliques. La magie tenait une place énorme dans les livres religieux. L’étude attentive de ces documents a même permis aux savants de reconnaître qu’ils font tous partie d’un même recueil, analogue à ceux que nous avons retrouvés entre les mains des Mendaïtes et des Sabiens de la Mésopotamie. Presque toujours, les formules magiques sont suivies d’une souscription qui indique qu’Assurbanipal fit exécuter ces copies conformément aux tablettes et aux documents antiques des héros du pays d’Assur et du pays d’Accad. On a pu constater que ce grand ouvrage magique dont l’original existait, depuis une haute antiquité, dans la bibliothèque de la fameuse école sacerdotale d’Uruk, eu Chaldée, se composait de trois livres distincts. Nous connaissons le titre d’un des trois : les Mauvais Esprits, car, à la fin des tablettes qui en proviennent et ont été préservées dans leur intégrité, on lit : Tablette n°... des Mauvais Esprits. Comme ce titre l’indique, il était exclusivement rempli par des formules de conjurations et d’imprécations destinées à repousser les démons et autres mauvais esprits, à détourner leur action funeste et à se mettre à l’abri de leurs coups. lin second livre se montre à nous, comme formé du recueil des incantations auxquelles on attribuait le pouvoir de guérir les diverses maladies. Enfin, le troisième embrasse des hymnes à certains dieux. Il est curieux de noter que, les trois parties qui composaient ainsi ce grand ouvrage magique, correspondent exactement aux trois classes de docteurs chaldéens que le livre de Daniel énumère à côté des astrologues et des devins (kasdim et gazrim), c’est-à-dire les hartumim ou conjurateurs, les hakamim ou médecins, et les asaphim ou théosophes. Le recueil magique est tout entier rédigé en suméro-accadien, mais la plupart du temps, Assurbanipal, eu le faisant transcrire par ses scribes, leur ordonna de joindre au texte original une traduction en assyrien, qui est tantôt juxtalinéaire, tantôt sur une colonne parallèle. On constate ainsi, comme nous l’avons déjà dit ailleurs, qu’il y avait bien positivement en Chaldée une langue propre à la magie, qui avait conservé ce caractère pour les Assyriens, et cette langue était celle de Sumer et d’Accad. On la regardait comme ayant une puissance spéciale sur le monde des esprits, des bons comme des mauvais. Il semble même que l’idée de la vertu propre et surnaturelle inhérente aux mots de cette langue avait grandi à mesure que son emploi comme idiome parlé était tombé en désuétude, et qu’elle était devenue pour les prêtres une langue morte et exclusivement religieuse, pour la masse un grimoire inintelligible. C’était l’effet de la tendance naturelle qui pousse l’homme à attribuer une vertu mystérieuse à dés paroles mystérieuses, de la même tendance qui avait conduit les Égyptiens à employer de préférence dans leurs formules magiques des noms étrangers, dont le sens échappe au vulgaire, et même des noms et des mots bizarres, n’appartenant à aucune langue et composés à plaisir en vue des opérations théurgiques. Les sectes gnostiques et cabalistes du moyen âge avaient aussi recours aux mêmes procédés, à des mots et à des alphabets mystérieux dont les plus célèbres sont l’atbas et l’albam. Pour ce qui est de l’histoire proprement dite, nous ne trouvons malheureusement que fort de chose dans la bibliothèque palatine de Koyoundjik : un fragment d’une liste de vieux rois chaldéens, accompagnés de l’indication des périodes astronomiques entre lesquelles ils se répartissaient. Viennent ensuite les débris des canons des magistrats éponymes ou limmu ; une tablette qui raconte les relations politiques et diplomatiques des deux royautés de Ninive et de Babylone à une époque fort reculée, et qui analyse les traités conclus entre elles avant l’établissement définitif de la suzeraineté de Ninive sur Babylone : c’est ce que nous avons appelé la Table des Synchronismes. Une autre série historique se composait des annales particulières des différents règnes, reproduisant celles qu’on écrivait sur les prismes de terre cuite déposés dans les fondations des édifices par les princes qui les construisaient. A l’histoire, nous devons rattacher la statistique. Ici, c’est une liste des officiers de la cour et de l’administration, classés dans un ordre hiérarchique. Là, c’est une sorte de catalogue géographique où nous voyons successivement énumérés et disposés par sections, les pyramides et les forteresses de la Babylonie, les districts, les rivières, les villes du même pays, les montagnes voisines, enfin les contrées étrangères. Une autre tablette contient un dénombrement de pays soumis à l’empire avec l’indication de leurs produits spéciaux ; une autre enregistre les noms des villes principales en passant successivement en revue la Babylonie, la région du Taurus, la Haute-Mésopotamie, la Syrie et la Palestine. Voici maintenant un document qui catalogue les cités assyriennes, avec la mention des sommes qu’elles payaient ou des contributions qu’elles fournissaient en nature, particulièrement en grains. Le droit civil est représenté dans la même bibliothèque par le fragment de lois en double texte relatif à la constitution de la famille et que nous avons reproduit plus haut. On y trouve des listes des plantes et des minéraux connus, des bois employés pour la construction ou l’ameublement, des métaux, des pierres propres à l’architecture et à la sculpture. On y remarque surtout avec intérêt le fragment d’une liste de toutes les espèces animales que connaissaient les savants assyro-babyloniens, classées méthodiquement par familles et par genres. Il y a une famille qui comprend les grands carnassiers ; le chien, le lion, le loup ; puis, nous avons dans la famille du chien différentes espèces, telles que le chien proprement dit, le chien domestique, le chien courant, le chien petit, le chien d’Élam. Le côté scientifique de cette classi6calion se révèle par une circonstance facile à reconnaître : on lit, en effet, auprès du nom vulgaire, une appellation spéciale qui se rattache précisément à une division scientifique que les Assyriens paraissent avoir eu en vue. Parmi les oiseaux, on remarque également les mêmes essais de classification ; on distingue les oiseaux au vol rapide, des oiseaux de mer ou de marais. Les insectes forment une classe très nombreuse ; nous voyons toute une famille dont on établit les espèces, suivant qu’elles attaquent les plantes, les animaux, les vêtements ou le bois. Les végétaux semblent avoir une classification basée sur leur utilité ou sur les services que l’industrie pouvait en retirer. Une tablette énumère les usages auxquels on peut employer les bois selon leur essence pour la charpente des palais, dans la construction des navires, dans la fabrication des chars, des ustensiles aratoires ou même dans l’ameublement. Les minéraux occupent une longue série dans ces tablettes. Ils sont classés suivant leurs qualités ; l’or et l’argent forment une division à part ; les pierres précieuses en forment une autre[13]. Les divisions de ce classement appartiennent sans doute à une science bien rudimentaire, mais on est étonné de constater que les Chaldéens avaient déjà inventé une nomenclature scientifique pareille, dans son principe, à la nomenclature linéenne. En regard du nom vulgaire de l’animal dans la langue parlée, est placé un nom savant et idéographique, composé d’un signe de genre invariable et d’une épithète caractéristique qui varie pour chaque espèce. Dans d’autres tablettes, sont des listes d’oiseaux non moins scientifiquement disposées. Les sciences qui, après la grammaire, tiennent le plus de place dans ces fragments sont les mathématiques et l’astronomie. La bibliothèque fondée par Assurbanipal contenait plusieurs traités d’arithmétique dont les débris donnent à penser que Pythagore leur emprunta le système de la fameuse table de multiplication à laquelle son nom est demeuré attaché. Les tablettes de Koyoundjik renferment aussi des catalogues d’étoiles, des recueils d’observations sidérales, entre autres des tables des levers de Vénus, de Jupiter et de Mars, des phases de la lune, jour par jour, dans le mois ; des calendriers qui nous ont fait définitivement connaître la nature et le mécanisme de l’année chaldéo-assyrienne, son caractère purement lunaire et le système d’intercalations par lequel on rétablissait son harmonie avec l’année solaire et la marche des saisons ; nous avons aussi un autre fragment de calendrier où sont indiquées les fêtes de chaque jour de l’aimée. Les documents astrologiques formaient une part considérable de la même bibliothèque. Parmi les fragments de cette catégorie, il faut mettre en première ligne ceux d’un ouvrage qui parait avoir été le livre fondamental et classique par excellence sur les matières astrologiques. La bibliothèque d’Assurbanipal en renfermait deux recensions distinctes, chacune en plusieurs exemplaires, et, en combinant tous les débris qui subsistent de ces différents exemplaires, on arrive à reconstituer le livre d’une manière presque complète. Cet ouvrage comprenait un exposé des présages tirés des positions, des apparences et des mouvements des corps célestes, des nuages et de tous les phénomènes météorologiques. Il avait été, d’après ce que rapporte une clause plusieurs fois répétée, rédigé pour la première fois par ordre de Sargon l’Ancien, roi d’Agadé, vers l’an 1900 avant notre ère. A ces livres proprement dits, il faut joindre ce que nous appellerions les documents d’archives : lettres diplomatiques, rapports officiels adressés par les gouverneurs de provinces et relatifs pour la plupart aux événements politiques, les proclamations royales, les pétitions ou dénonciations au roi. les contrats d’intérêt privé, les rapports périodiques faits au prince par les astronomes attachés au palais, sur leurs observations quotidiennes ; les pièces financières, comme sont la plupart des petits documents sur les tributs fournis par les villes de telle ou telle province. Telle était la littérature assyrienne, reconstituée d’après les débris qui nous en sont parvenus ; telle était la bibliothèque du palais d’Assurbanipal : singulière bibliothèque composée exclusivement de tablettes en terre cuite portant, sur l’une et l’autre de leurs deux faces, une page d’écriture cunéiforme cursive, si fine et si serrée, que les plus habiles ont, aujourd’hui,. peine à en établir le texte, à en fixer le déchiffrement, et dont l’usage, même dans l’antiquité, était nécessairement restreint à un petit nombre de savants. Pour donner une idée de la quantité de documents écrits qui la composaient, nous dirons qu’on a calculé que les débris recueillis par MM. Layard et Smith, et aujourd’hui au Musée britannique, forment une masse de plus de cent mètres cubes ; leur contenu couvrirait, dans la forme ordinaire de nos livres, plus de cinq cents volumes de cinq cents pages in-quarto. A peine est-il besoin d’ajouter que les érudits sont loin encore d’avoir mis à profit pour l’histoire cette immense quantité de matériaux. Mais il est aisé de se convaincre que la civilisation chaldéo-assyrienne que nous connaissons si peu, gît tout entière dans ces textes et dans ceux de même nature recueillis un peu partout dans toute la Mésopotamie. La bibliothèque d’Assurbanipal n’était évidemment pas la seule qui existât : divers indices autorisent à le croire, bien qu’on n’ait pas, jusqu’ici, encore retrouvé de dépôt semblable. Le nom de Sepharvaïm, les villes des livres, donné par la Bible aux deux Sippara voisines de Babylone, ne prouve-t-il pas que c’est là surtout qu’une exploration méthodique aurait chance d’exhumer les richesses littéraires les plus vieilles du monde ? Babylone elle-même ne fut-elle pas le principal centre des études scientifiques depuis le début de la civilisation chaldéenne jusqu’à sa chute ? N’est-ce pas là que Bérose a trouvé le secret de sa science historique et astrologique ? Ce dernier des prêtres chaldéens commence son livre des Antiquités babyloniennes, en racontant que l’on conservait avec grand soin, à Babylone, les documents les plus nombreux et les plus variés embrassant, dit-il, un espace de temps qui monte à plus de cent cinquante mille ans, lesquels documents contiennent l’histoire du ciel et de la terre et de la mer, l’origine première des choses, les annales des rois et les récits de leurs actes. Le même auteur parle des livres d’Oannès dictés par Dieu même aux hommes, pour leur apprendre l’origine des choses, et c’est de sources analogues que proviennent les notions si exactes sur la religion chaldéo-assyrienne qu’a conservées le philosophe Damascius. Ce n’est donc point sous l’influence d’un enthousiasme irréfléchi qu’on peut dire, même aujourd’hui, quarante ans après Botta, que les découvertes n’en sont qu’à leur début et que le grand secret de l’histoire de l’antique Orient est encore enfoui sous les sables du désert mésopotamien. § 3. — ASTRONOMIE ET ASTROLOGIE Les Chaldéens disaient que l’astronomie leur avait été enseignée par le dieu Oannès qui sortit un jour de la mer Érythrée sous la forme d’un homme à queue de poisson. Quelques critiques, égarés par cette donnée fabuleuse, ont cherché à expliquer celle prétendue révélation divine par une importation étrangère, et ont supposé que le golfe Persique fut la route suivie par les savants qui, d’Égypte, seraient venus implanter la science des astres sur les bords du Tigre et de l’Euphrate. Mais il n’en est rien ; l’astronomie était une science essentiellement indigène à Babylone. Une tradition conservée par le pseudo-Chérémon attribue à l’astronomie chaldéenne l’antériorité sur l’égyptienne qui parait même avoir été son élève au début[14]. L’harmonie et la périodicité des révolutions dont le ciel est le théâtre frappèrent de bonne heure l’imagination des hommes qui habitaient le beau climat de la Mésopotamie, durant ces nuits sereines et merveilleusement étoilées dont l’orient a le privilège. Ils notèrent ces changements et ces variations, ils en dressèrent des tables, en prédirent le retour, leur donnèrent des noms ; cette contemplation admirative dont le sauvage comme l’homme le plus éclairé ne se lasse jamais, forma leur expérience, et leurs observations codifiées furent le premier livre d’astronomie. Diodore de Sicile a résumé en une page que nous devons citer, la science que les Grecs de son temps reconnaissaient aux Chaldéens. Ayant observé, dit-il, les astres pendant un nombre énorme d’années, ils en connaissent plus exactement que tous les autres hommes le cours et les influences et prédisent sûrement bien des choses de l’avenir. La doctrine qui est, selon eux, la plus importante, concerne les mouvements des cinq astres que nous nommons planètes et qu’eux appellent interprètes. Parmi ces astres, ils regardent comme le plus significatif celui qui fournit les augures les plus nombreux et les plus importants, la planète désignée par les Grecs sous le nom de Cronos, et qu’à cause de cela, ils appellent Hélios (Soleil). Quant aux autres, elles sont nommées chez eux, comme chez nos astrologues, Mars, Vénus, Mercure et Jupiter. Les Chaldéens les appellent interprètes, parce que les planètes, seules douées d’un mouvement particulier déterminé que n’ont pas les autres astres, lesquels sont fixes et assujettis à une marche régulière et commune, interprètent aux hommes les desseins bienveillants des dieux. Car les observateurs habiles savent, disent-ils, tirer des présages du lever, du coucher et de la couleur de ces astres ; ils annoncent aussi les vents violents, les pluies et les chaleurs excessives. L’apparition des comètes, les éclipses de soleil et de lune, les tremblements de terre, enfin tous les changements qui surviennent dans l’atmosphère sont autant de signes de bonheur ou de malheur pour les pays et les nations, aussi bien que pour les rois et les particuliers. Au-dessous du cours des cinq planètes, continuent les Chaldéens, sont placés trente (six) astres appelés dieux conseillers. De ces dieux, la moitié habite au-dessus, l’autre moitié au-dessous de la terre, pour surveiller les choses humaines et les choses célestes. Et tous les dix jours, l’un d’eux est envoyé en qualité de messager de la région supérieure à l’inférieure ; un autre passe de celle-ci dans celle-là, par un invariable échange. En outre, il y a douze seigneurs des dieux, dont chacun préside à un mois et à un signe du zodiaque. Le soleil, la lune et les cinq planètes passent par ces signes, le soleil accomplissant sa révolution dans l’espace d’une année, et la lune la sienne dans l’espace d’un mois. Chaque planète a son cours particulier, et elles diffèrent entre elles par la vitesse et le temps de leurs révolutions. Ces astres influent beaucoup sur la naissance des hommes, et décident du bon et du mauvais destin ; c’est pourquoi les observateurs y lisent l’avenir. Ils ont ainsi fait, disent-ils, des prédictions à un grand nombre de rois, entre autres au vainqueur de Darius, Alexandre, et aux rois Antigone et Séleucus Nicator, prédictions qui paraissent toutes avoir été accomplies et dont nous parlerons en temps et lieu. Ils prédisent aussi aux particuliers les choses qui doivent leur arriver, et cela avec une précision telle que ceux qui en ont fait l’essai en sont frappés d’admiration et regardent la science de ces astrologues comme quelque chose de divin. En dehors du cercle zodiacal, ils distinguent vingt-quatre étoiles, la moitié dans la partie boréale du ciel et la moitié dans la partie australe ; celles qui se voient sont préposées aux vivants, et celles qu’on ne peut pas voir sont assignées aux morts. Et ils appellent ces astres juges de l’univers. La lune se meut, ajoutent les Chaldéens, au-dessous de tous les autres astres ; elle est la plus voisine de la terre, en raison de sa pesanteur ; elle exécute sa révolution dans le plus court espace de temps, non pas par la vitesse de son mouvement, mais parce que le cercle qu’elle parcourt est très petit. Sa lumière est empruntée, et ses éclipses proviennent de l’ombre de la terre, comme l’enseignent aussi les Grecs. Quant aux éclipses de soleil, ils ne savent en donner que des explications très faibles et très vagues ; ils n’osent ni les prédire, ni en déterminer les époques. Ils professent des opinions tout à fait particulières à l’égard de la figure de la terre ; ils soutiennent qu’elle est creuse, en forme de nacelle, et ils en donnent des preuves nombreuses et très plausibles, comme tout ce qu’ils disent, de l’univers. Nous nous éloignerions trop de notre sujet si nous voulions entrer dans tous ces détails ; il suffit d’être convaincu que les Chaldéens sont, plus que tous les autres hommes, versés dans l’astrologie, et qu’ils ont cultivé cette science avec le plus grand soin. Il est cependant difficile de croire au nombre d’années pendant lesquelles le collège des Chaldéens aurait enseigné la science de l’univers ; car depuis leurs premières observations astronomiques jusqu’à la venue d’Alexandre, ils ne comptent pas moins de quatre cent soixante-treize mille ans[15]. Dans la science astronomique des docteurs chaldéens, il est nécessaire, pour en bien déterminer le caractère, d’y reconnaître trois éléments essentiels : le côté véritablement scientifique et reposant sur des observations sérieuses et méthodiques ; le côté mythologique, car les astres devinrent, dans leurs conceptions, les divins régulateurs du monde sublunaire et furent regardés comme l’incarnation de divinités spéciales ; enfin le côté astrologique rempli de superstitions puériles : on croyait lire dans l’avenir en observant les mouvements célestes, et l’on tirait des phénomènes sidéraux les plus naturels des présages pour tous les actes de la vie ordinaire. Le succès des prédictions de cette nature fut si grand que l’astrologie se développa au détriment de l’astronomie ; celle-ci même fut la servante de l’autre et ne fut point comprise sans elle. Chaque ville de Chaldée et d’Assyrie avait un ou plusieurs observatoires ; c’étaient des tours ou plutôt des pyramides à étages appelées ziqurat dans les textes. Généralement annexées à des temples ou à des palais, comme nous l’avons vu à Iihorsabad, c’est là que se tenaient en permanence les docteurs des collèges sacerdotaux. On croyait que les dieux, dans le ciel, habitaient de même une sorte d’observatoire, la montagne de l’Orient, ou montagne des Pays (sad matati), d’où ils plongeaient leurs regards sur la terre, surveillant les actions des mortels et distribuant à leur gré les biens et les maux dans l’humanité. A quelle époque commencèrent les observations sidérales des Chaldéens, c’est ce qu’il est impossible de déterminer. On ne saurait, bien entendu, ajouter foi à la tradition de leurs docteurs qui prétendaient appuyer leurs théories scientifiques sur une série ininterrompue d’observations remontant à 473.000 ans suivant Diodore, à 488.000 d’après Pline et Cicéron. De semblables prétentions ne sont pas plus dignes de créance que l’opinion de quelques savants modernes faisant remonter l’invention du zodiaque à quinte ou seize mille ans avant l’ère vulgaire. Mais nous sommes cependant en mesure d’affirmer que l’astronomie était déjà codifiée théoriquement dès l’époque des premiers rois chaldéens que les documents cunéiformes nous permettent de citer. Nous savons, par exemple, que vers le XXXVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Sargon l’Ancien, roi d’Agadé, fit compiler, dans un ouvrage méthodique qui comprenait soixante-dix tablettes, tous les résultats de la science astrologique de son temps ; quelques fragments seulement de ce grand recueil incessamment recopié dans les siècles postérieurs, nous sont parvenus, et nous les avons reproduits plus haut. L’ouvrage fut continué par Naram Sin, et toutes les vraisemblances nous autorisent à croire que c’est ce bréviaire des astrologues chaldéens, appelé Namar-Bel, que traduisit Bérose, au témoignage de Sénèque[16]. Mais la science était à cette époque encore fort peu avancée, et l’on jugerait mal l’astronomie chaldéenne si on la croyait exclusivement composée, comme le livre dont il est ici question, d’observations puériles, de présages lus dans les astres, de’ recettes pour des horoscopes. On y lisait, par exemple, que la lune est une sphère obscure d’un côté, enflammée de l’autre, de telle sorte que les phases et les éclipses lunaires seraient produites par le déplacement de l’astre qui présente à ta terre tantôt sa face terne et tantôt sa face ignée. Toute autre était, de l’aveu même des auteurs classiques, la science des Chaldéens des âges postérieurs. On reconnaît que ce furent eux qui inventèrent le gnomon et le cadran solaire, et l’on a retrouvé dans les ruines de Ninive une énorme lentille en verre qui est sans cloute un débris d’un puissant instrument d’optique et de précision. Ils apprirent aux Grecs à décomposer le mouvement diurne apparent du soleil, de la lune et des planètes, à calculer les irrégularités de la marche des cinq planètes, leurs stations et leurs rétrogradations. Pour les astronomes de l’antique Mésopotamie, le mouvement moyen journalier de ta lune fut le principe de la mesure du temps ; et par la période de deux cent vingt-trois lunaisons qu’ils connurent, ils arrivèrent à prédire les éclipses de lune. La plus anciennement calculée, celle du 10 mars 721 avant Jésus-Christ, leur est due, et leurs calculs ne diffèrent des nôtres que de quelques minutes. Moins habiles à calculer les éclipses du soleil, qui offrent de plus grandes difficultés, ils n’osaient, dit Diodore, les prédire, et se contentaient de les observer et de les enregistrer[17]. Beaucoup de choses encore en usage dans l’astronomie nous viennent de la civilisation chaldéo-assyrienne et de sa science, à laquelle toute l’antiquité rendait un juste hommage. Telles sont la division de l’écliptique en douze parties égales constituant le Zodiaque, dont les figures ou catastérismes sont également d’origine chaldéenne ; la précession des équinoxes ; la division du cercle en trois cent soixante parties égales ou degrés ; celle du degré en soixante minutes, de la minute en soixante secondes et de la seconde en soixante tierces, ainsi que l’invention du mode de notation qui sert encore à marquer ces divisions du degré. Chez les Chaldéo-Assyriens on trouve, dès l’origine, la semaine de sept jours, consacrés aux sept corps planétaires qu’ils adoraient comme des êtres divins, et depuis un temps immémorial l’ordre de leurs jours n’a pas été changé. Ils furent les premiers à diviser la journée de vingt-quatre heures ou nycthémère, en douze parties égales ou douze heures, heures doubles ou heures babyloniennes, comme les appelaient les Grecs ; l’heure était divisée en soixante minutes et la minute en soixante secondes. Leurs grandes périodes de temps étaient calquées sur ce modèle. Le cycle de quarante-trois mille deux cents ans, qui était, dans leur opinion, celui de la précession des équinoxes, était regardé comme un jour de la vie de l’univers ; il se divisait donc en douze sares ou heures cosmiques, de trois mille six cents ans, dont chacun comprenait six nères de six cents ails ; le nère, à son tour, se subdivisait en dix sosses ou minutes cosmiques, composées chacune de soixante ans, et l’année ordinaire se Trouvait être ainsi la seconde de la grande période chronologique. Les Chaldéens partageaient l’année en trois cent soixante jours de douze mois de trente jours, et le mois en quatre parties égales, composées chacune de sept. jours, du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, enfin du 22 au 28 ; comme le mois avait régulièrement trente jours, les deux derniers restaient en dehors de la série des quatre hebdomades, qui reprenait le mois suivant, du 1er au 7. Le 7, le 14, le 21 et le 28 étaient des jours néfastes et des jours de repos, où le pasteur des hommes ne doit pas manger de viande, ne doit pas changer les vêtements de son corps ; où l’on ne porte pas de robes blanches, où l’on n’offre pas de sacrifice ; où le roi ne doit pas sortir sur un char et ne doit pas rendre la justice dans l’appareil de sa puissance ; où le général ne doit point donner d’ordres pour les cantonnements de ses troupes ; enfin où l’on ne doit pas prendre de médicaments. C’est ainsi qu’on constate des jours de jeûne et d’abstinence chez les Chaldéo-Assyriens comme chez les Juifs, de même qu’il y avait des jours de fêtes et de réjouissances appelés, dans les textes jour du cœur, jour de joie ou même sabbatum sabbat. En habiles astronomes qu’ils étaient, les Chaldéens s’étaient de bonne heure aperçu que leur année de trois cent soixante jours ne correspondait pas avec l’année vraie ; aussi, ils ajoutaient tous les six ans, à la tin de l’année, un treizième mois de trente jours, analogue au veadar des Juifs ; ils appelaient ce mois complémentaire maqru sa addari incident à Adar. Comme cette intercalation ne suffisait pas encore, ou ajoutait, à des intervalles beaucoup plus éloignés, un second mois d’Ulul et même un second mois de Nisan. Il importe de dire ici que, d’après une ingénieuse théorie de François Lenormant, le grand Poème d’Isdubar dont nous avons déjà donné divers extraits, et dans lequel la lutte d’Isdubar contre le taureau divin, l’amour de la déesse Istar pour ce Nemrod de la légende chaldéenne, la descente d’Istar aux enfers et le récit du déluge forment d’importants épisodes ; ce grand poème, disons-nous, était divisé en douze tablettes ou douze chants correspondant aux douze mois de l’année et aux douze signes du zodiaque. Le résumé suivant de ce que contient chacune des tablettes, dans l’état de mutilation où elle nous est parvenue, permettra au lecteur d’apprécier cette hypothèse et en même temps de se rendre un compte exact de l’ensemble du poème dont nous avons détaché seulement quelques épisodes. Tablette I. — Manque. Tablette II. — Le commencement est détruit. Dans ce qui vient après cette lacune, Isdubar voit en songe les étoiles tomber du ciel. Il envoie chercher, pour interpréter son rêve, le voyant Êa-bani, moitié homme et moitié taureau. Tablette III. — Êa-bani, séduit par Samhat et Harimat (la grâce et la persuasion personnifiées), se décide à venir à Uruk, à la cour d’Isdubar. Fêtes pour le recevoir. Amitié qui se noue entre les deux héros. Tablette IV. — Isdubar, sur le conseil d’Êa-bani, se met en route pour aller attaquer le tyran Humbaba dans la forêt des cèdres. Exploits des deux héros dans le voyage. Tablette V. — Défaite et mort de Humbaba. Tablette VI. — Istar se propose pour épouse à Isdubar : il la rejette en lui reprochant ses débauches. Istar irritée obtient de son père Anu qu’il crée un taureau terrible, qui va ravager Uruk. Isdubar tue le monstre, aidé d’Êa-bani. Tablette VII. — Êa-bani consulte les arbres pour leur demander un oracle. Isdubar tombe malade et voit des songes effrayants. Il en cherche l’explication auprès d’Êa-bani, dont le pouvoir de devin s’affaiblit et qui ne peut les interpréter. Mort d’Êa-bani. Tablette VIII. — Lamentation d’Isdubar sur la mort d’Êa-bani. Malade et effrayé par ses visions, il se décide à aller demander la guérison et le secret de la vie à Hasisatra. Voyage du héros. Il rencontre les deux hommes-scorpions qui gardent le lever et le coucher du soleil. Visite du jardin des arbres aux fruits merveilleux, gardé par les nymphes Siduri et Sabit. Tablette IX. — Dialogue avec les cieux nymphes pour obtenir de sortir du jardin en emportant des fruits. Isdubar rencontre le batelier Ur-Bel. Il continue son voyage par eau, sous la conduite de ce batelier ; ils finissent par naviguer sur les eaux de la mort. Tablette X. — Isdubar atteint le pays de l’embouchure des fleuves, au delà des eaux de la mort, où habite Hasisatra, devenu immortel. Il lui pose ses questions. Tablette XI. — Hasisatra répond en racontant le déluge. Purification et guérison d’Isdubar. Son retour â Uruk. Tablette XII. — Lamentation d’Isdubar sur la tombe d’Êa-bani. Marduk, sur l’ordre de Êa, tire du Pays sans retour l’ombre du voyant et la fait monter dans les demeures célestes, au milieu des dieux. Ainsi, dans cette épopée, l’homme-taureau entre en scène au mois du taureau propice, auquel préside Êa, le créateur de cet être merveilleux. Isdubar ou Nemrod se révèle comme un véritable Hercule dans le mois qui est placé sous le gouvernement de Adar-Sandan, l’Hercule assyrien. C’est au mois du feu qu’Isdubar triomphe de Humbaba et nous savons qu’Isdubar n’est autre que le dieu Feu ; Istar demande Isdubar en mariage au mois du message d’Istar ; Isdubar rencontre les deux hommes-scorpions sous le signe du Scorpion ; au mois de la caverne, il pénètre dans la retraite cachée où les dieux ont transporté Hasisatra. Celui-ci lui raconte le déluge dans le onzième chant, parce que le onzième mois est celui du signe du Verseau. Enfin le douzième mois, celui des Poissons du dieu Êa, est celui de l’apothéose de l’ombre d’Êa-bani, parce que ce sont les poissons du dieu la qui veillent au lit funèbre et protègent les morts. Ces légendes et ces mythes religieux attachés à chaque signe du zodiaque, montrent bien le caractère astrologique de la religion chaldéo-assyrienne, et ils achèvent de nous convaincre que cette division des mois est déjà complètement organisée lorsque la civilisation chaldéenne commence à être accessible aux recherches historiques. Les Chaldéo-Assyriens connaissaient l’année solaire de trois cent soixante cinq jours un quart, et ils en faisaient usage dans les calculs astronomiques. Mais leur année ordinaire, religieuse et civile, était une année lunaire, composée de douze mois correspondant aux signes du zodiaque, et alternativement pleins et caves, c’est-à-dire de trente et de vingt-neuf jours. L’année commençait au mois de Nisan (mars-avril), c’est-à-dire au printemps, comme dans la plus grande partie du monde chrétien, au moyen âge ; elle se terminait parle mois d’Adar (février-mars). Les noms assyriens des douze mois furent adoptés par les Juifs, probablement dès le temps d’Abraham, et par la plus grande partie des peuples sémitiques. Dans l’écriture cunéiforme, ces noms s’exprimaient soit phonétiquement, soit le plus souvent, par des signes idéographiques suméro-accadiens qui étaient comme les symboles scientifiques et religieux de chaque mois. C’est ainsi, pour citer un exemple, que le mois de Sivan (mai-juin) avait pour idéogramme le mot suméro-accadien murga, qui signifie la fabrication des briques. C’était, en effet, durant ce mois qui suit les pluies du printemps et les grandes crues des fleuves, qu’on commençait à mouler les briques pour les laisser ensuite sécher au soleil tropical des mois d’été. On pense aussi, non sans quelques bonnes raisons, que ces idéogrammes se réfèrent à des mythes religieux et qu’ils appartiennent au cycle des traditions cosmogoniques des Assyriens, dont nous possédons maintenant des fragments originaux. L’ordre constant des phénomènes célestes avait donc frappé de bonne heure les astronomes chaldéens. Cherchant à interpréter ces mouvements, ils avaient cru y découvrir le secret des événements terrestres et de la destinée humaine. Toutes ces étoiles constellées et imitant vaguement des formes animales devinrent les signes du zodiaque : ces signes ainsi que les planètes, avec le soleil et la lune, se préoccupant de ce qui se passait sur la terre où s’exerçait leur influence, furent les interprètes de la volonté des dieux ou plutôt du destin. C’est par cette voie toute simple et naturelle que l’astrologie, ainsi que l’a remarqué Guigniaut[18], s’empara des conceptions religieuses des Chaldéo-Assyriens. Nous verrons ailleurs la place des astres dans la religion, et comment ils en vinrent à être considérés comme des dieux ou des génies, tantôt bienfaisants, tantôt malfaisants. Les douze signes du zodiaque, régis par autant de dieux, étaient, d’après les nombreux cylindres de pierre qui nous en offrent la représentation : 1° Le Bélier ou l’Ibex ; 2° le Taureau ; 3° les Gémeaux représentés par deux petites figures viriles superposées, quelquefois avec des queues de poissons ; 4° le Cancer, figuré comme une écrevisse ou un homard ; 5° le Lion, représenté le plus souvent dévorant le taureau ; 6° la Vierge ou Istar, l’archère des dieux ; 7° les pinces du scorpion ou plutôt la Balance ; 8° le Scorpion ; 9° le Sagittaire, représenté par un archer ou un centaure ailé tirant de l’arc ; 10° la Chèvre, dont la partie postérieure se termine souvent en queue de poisson ; 11° le Verseau, représenté par un vase d’où l’eau s’écoule, ou par le dieu Raman ; 12° les Poissons. Ces douze constellations prirent place à côté du Soleil, de la Lune et des cinq planètes : Êa (Saturne) ou Kirvanu, encore appelé Keiwan par les Arabes ; Bel (Jupiter) ; Nergal (Mars) ; Istar (Vénus) ; Nabu (Mercure) ; elles furent les douze maîtres ou seigneurs des dieux, comme les appelle Diodore. La science théologique aidant, les douze signes du zodiaque furent divisés en trente-six parties, présidées par autant d’étoiles qui furent appelées les dieux conseillers : parmi ceux-ci, les uns habitaient au-dessus, les autres au-dessous de la terre, et tous les dix jours, l’un d’entre eux passait de l’un dans l’autre hémisphère en qualité de messager divin. Tantôt propices, tantôt funestes aux hommes, tous ces dieux exerçaient sur la terre une action directe, dont on pouvait prévenir ou provoquer les effets par des conjurations et des prières. Les Chaldéens, dit l’auteur des Philosophumena, ayant observé le ciel plus attentivement que les autres, en sont venus à voir la raison des causes déterminantes de ce qui arrive parmi nous, et à croire que les douze parties du zodiaque des étoiles fixes y ont une grande part. Et ils divisent chaque signe en trente degrés et chaque degré en soixante minutes, car c’est ainsi qu’ils appellent les divisions les moindres, qu’ils ne divisent pas à leur tour. Ils qualifient de mâles une partie des signes, et de femelles les autres. Ils les répartissent aussi en signes à double corps et signes qui ne le sont pas, en signes tropiques et non tropiques. Les signes mâles et femelles sont ainsi nommés d’après leur rapport avec la génération d’enfants mâles. Le bélier est masculin et le taureau féminin, et ainsi de suite de tous les autres avec la même alternance. C’est, je crois, d’après cela que les Pythagoriciens appellent la monade mâle, la dyade femelle, et de nouveau la triade mâle, définissant ensuite d’après la même règle la nature de tous les nombres pairs et impairs. Quelques-uns, divisant chaque signe en dodécatémories, arrivent presque à la même explication, car ils font le Bélier mâle, le Taureau mâle et femelle, ensuite les Gémeaux signe mâle de nouveau, et alternent ainsi deux par deux les autres signes. Ils appellent à double corps (δίσωρα) les signes qui sont exactement opposés les uns aux autres aux deux extrémités d’un diamètre du cercle, comme le sagittaire (et les Gémeaux), la Vierge et les Poissons, et les signes perdent cette dénomination à l’égard de ceux avec lesquels ils ne sont pas dans le même rapport de position. Quant aux signes tropiques, ce sont ceux où le Soleil, en arrivant, opère les grands changements de sa marche. Ce sont le Bélier, signe mâle, et son opposé diamétral, la Balance, dont la nature est la même, comme aussi celle des deux autres signes tropiques, le Capricorne et le Cancer. Car, dans le Bélier est la position tropique de l’équinoxe de printemps, dans le Capricorne celle du solstice d’hiver, dans le Cancer celle du solstice d’été, et dans la Balance celle de l’équinoxe d’automne[19]. Le Soleil et la Lune et les cinq planètes furent partagées en trois classes : deux bienfaisantes, Jupiter et Vénus, appelés plus tard grande et petite fortune par les Mendaïtes ; deux malfaisantes, Saturne et Mars, qualifiées par les Mendaïtes de grande et petite infortune ; trois équivoques, tantôt bons, tantôt mauvais suivant les cas, le Soleil, la Lune et Mercure. Le soleil, placé au centre du système, prenait, avec chaque heure, chaque jour, chaque mois, un caractère différent, suivant qu’il se trouvait dans l’influence de telle ou telle de ces planètes, dont chacune aussi son heure, son jour, son mois déterminé, et son signe dans le zodiaque. A la planète, sous l’invocation de laquelle avait été placée la première heure du jour, à partir de minuit, faut aussi consacré le jour entier ; et de là vint cette attribution des jours de la semaine aux sept planètes, la semaine planétaire, fondée certainement sur l’astrologie. La première heure était assignée à Saturne, la seconde à Jupiter et ainsi de suite, d’après la distance des planètes à la terre, selon l’ordonnance qui vient d’être dite, jusqu’à ce que toutes les heures du jour eussent été épuisées : et alors on recommençait, la première heure du jour suivant, et avec elle le jour entier, étant attribués au Soleil, la première du troisième à la Lune, etc. Sur le même principe les douze signes du zodiaque, et, avec eux, les douze mois de l’année furent distribués entre les sept planètes, dont les cinq proprement ainsi nommées eurent chacune deux signes, le Soleil et la Lune un signe chacun : c’est ce qu’on appelle maisons ou domiciles[20]. S’il y avait, comme on le voit, une science réelle de l’astronomie, dans les conceptions des Chaldéens, cette science fut toujours subordonnée à la religion dont elle resta l’humble servante. Cette merveilleuse sympathie qui existe entre les phénomènes sidéraux et les lois naturelles de la terre et qui se reflète surtout dans les saisons, fil, croire aux Chaldéens que toutes choses, ici-bas, dépendent de celles d’en haut. Ce principe admis, ils en arrivèrent facilement à se convaincre que, par l’observation des astres, ils parviendraient à deviner les secrets de l’avenir, et cette obsession de leur esprit, paraissait trouver confirmation dans quelques phénomènes naturels qui servirent d’arguments pour étayer cette fausse science née d’une science vraie. L’action générale des astres leur parut s’exercer non plus seulement sur la nature et sur la marche des saisons, mais sur les destinées de l’homme et les actes les plus indifférents de notre existence. Des maladies avaient-elles été occasionnées par un soleil trop ardent : il n’en fallut pas davantage pour croire que le soleil et les astres disposaient de la santé et de la vie des individus ; les récoltes avaient-elles été, pendant une nuit éclairée par la lune, ravagées par la gelée ; les Chaldéens s’imaginèrent, comme nos paysans d’aujourd’hui, que la lune elle-même agissait sur la végétation ; les phénomènes météorologiques comme la pluie, la grêle, les vents, furent censés animés d’un esprit ; on nota les taches du soleil, les phases lunaires, les déplacements des astres, la direction des vents, et l’on crut, en raison de coïncidences fortuites ou naturelles, que tous les événements qui s’accomplissent sur la terre avaient leur cause directe et immédiate dans les mouvements et les phénomènes célestes et aériens. C’est ainsi que les astres devinrent les régulateurs des événements humains comme ils l’étaient des mouvements de, l’univers ; dès lors, rien dans leur position et leur aspect ne parut indifférent pour l’observateur qui cherchait à en tirer des présages, et cette préoccupation se fait jour dans les documents astrologiques parvenus jusqu’à nous : Si la
lune est visible le 1er du mois, la face du pays sera bien ordonnée, le cœur
du pays sera réjoui. Si la
lune apparaît entourée d’un halo, le roi atteindra la primauté. Si la
lune apparaît avec sa corne droite longue et sa corne gauche courte, le roi
d’un autre pays, sa main sera renommée. Si la
lune apparaît très grande, il y aura une éclipse. Si la lune apparaît très petite, la récolte du pays sera bonne. Si la
lune a le même aspect le 1er et le 28 du mois, mauvais augure pour le pays
d’Occident. Si la lune est visible le 30, bon augure pour le pays d’Accad, mauvais pour la Syrie. Si la lune a le même aspect le 1er et le 27 du mois, mauvais augure pour le pays d’Elam. Si le soleil, à son coucher, a l’apparence double de sa dimension normale, avec trois rayons bleuâtres, le roi du pays sera perdu. Au mois d’Ulul, si Mars est bien visible, la récolte du pays sera banne, le cœur du pays, réjoui. Jupiter se lève et son corps brille de l’éclat du jour ; son corps apparaît comme la lame d’une épée à deux tranchants. C’est un augure favorable, qui porte bonheur au maître de la maison et à toute la terre qui en dépend. En même temps, il n’y a pas de maître dans la basse Chaldée : la perversité est divisée contre elle-même ; la justice existe ; c’est un fort qui gouverne ; ... le maître de la maison et le roi sont fermement assis dans leur droit ; l’obéissance et la paix existent dans le pays. Si l’étoile Entena-maslum (Aldébaran ?), à son lever est très brillante dans le mois de Douz, la, récolte du pays sera bonne, le rendement magnifique. Si cette étoile, à son lever, est peu visible, la récolte du pays sera mauvaise. Si l’étoile du Grand Chien est obscure, le cœur du pays ne sera pas joyeux. Si l’étoile du roi est obscure, le recteur du pays mourra. Quand la lune, dans son aspect, est obscurcie de nuages épais, il y aura des inondations. Quand la lune boit dans le ciel, il pleuvra. Les docteurs chaldéens consacraient tout leur temps à ces observations sidérales, et ils s’appliquaient à régler les actes de leur vie publique et privée d’après les instructions qu’ils croyaient lire dans le ciel. Tout eu déplorant cette superstition singulière qui imposa aux progrès scientifiques un temps d’arrêt, il est juste d’ajouter, à la décharge des astrologues chaldéens, que presque tous les peuples, même les plus éclairés, ont attribué une influence directe sur l’humanité aux apparentes dérogations à l’ordre général du ciel, comme les éclipses et les comètes : on les a considérées comme des avertissements du courroux des dieu-, et ou les a interprétés en mauvaise part, à cause de leur mystérieuse et terrifiante apparition. Après la conquête de l’Asie par Alexandre, les astrologues chaldéens se répandirent dans le monde grec oit ils ouvrirent même des écoles. De la Grèce, ils passèrent à Rome où les avait précédé leur réputation de devins et d’astrologues. Mais leur science dégénérant de plus en plus, ils nous apparaissent, au temps de l’empire romain, comme des charlatans et des diseurs de bonne aventure. Néanmoins, tout le monde les consulte ; Auguste lui-même leur fait tirer son horoscope, et leur grand art consiste à déduire l’heur ou le malheur de quelqu’un, de la position de certains astres au moment de la naissance. Ils jettent les sorts ; ils enseignent que chaque individu aune étoile, et cette croyance rencontre encore de nos jours des adhérents. Leurs almanachs prédisent la pluie ou le beau temps de chaque jour de l’année, la disette ou l’abondance des récoltes ; ils se livrent à des calculs et à des combinaisons mystérieuses de chiffres, comme les Babylonii numeri, dont parle Horace. C’étaient, la plupart du temps, d’indignes supercheries ou de ridicules puérilités : le moyen âge n’a pas connu les astrologues Sous un aspect plus favorable. § 4. — SCIENCES EXACTES ET SYSTÈME MÉTRIQUE. Tous les savant ; qui se sont occupés de reconstituer le système métrique des Assyro-Chaldéens, ont été unanimes là proclamer que les docteurs de Babylone avaient poussé la science des nombres à un degré de, perfection que n’a connu ni l’antiquité classique ni le moyen âge, et auquel on ne peut véritablement comparer que la science moderne. On reste confondu quand on réfléchit que ces prêtres magiciens ont dû inventer, sans le secours d’aucun maître et sans être guidés par l’expérience de peuples voisins, toutes les opérations d’arithmétique que nous connaissons, et créer l’ensemble d’un système métrique aussi bien coordonné que le nôtre, lequel dérive du leur. Originairement et comme la plupart des peuples enfants, les Chaldéens ont commencé par compter sur leurs doigts, c’est-à-dire de cinq en cinq unités ou par quines ; les deux mains réunies ont formé deux quines ou la dizaine : telle a été l’invention originaire, simple et naturelle du système décimal. Rien, d’autre part, de plus clair et de plus précis que la
manière dont les Assyriens exprimaient les nombres, à l’aide des éléments
même de l’écriture cunéiforme : le clou simple
Le même principe servait à transcrire les nombres au-dessus de dix. Ainsi, on écrivait :
Et de même, on écrivait :
.Vil/t, s’écrivait
En outre, divers idéogrammes servaient à représenter le sosse, le ner
et le sar, qui formaient la base de
tous les calculs. Le sosse qui
signifiait le nombre 60, est exprimé par
Ces indications suffisent pour montrer qu’un nombre pouvait
s’exprimer de, plusieurs manières différentes. Le nombre 400, par exemple,
pouvait s’écrire Le signe
M. Aurès[21] a démontré que le chiffre 60 pouvait s’écrire comme le chiffre 1, simplement par le signe [Img12.gif], et que tout en connaissant la numération décimale, les savants assyriens ont surtout fait usage du système sexagésimal qui, étant donné leur écriture, se prêtait mieux à toutes les exigences de leurs calculs. La numération savante procédait essentiellement par soixantaines, c’est-à-dire par cosses ou soixantaines d’unités, par sars en soixantaines de sosses, par soixantaine de sars, etc., comme notre numération procède aujourd’hui par dizaines, centaines, milliers, etc. Il faut remarquer, d’ailleurs, que le système duodécimal de numération s’était formé à côté du système décimal de la manière la plus naturelle : la dizaine ne peut être divisée exactement ni en trois ni en quatre parties égales, tandis que la douzaine se prête non seulement à ces opérations, mais à toutes celles, du nombre dix. Cette propriété de la douzaine, remarquée dès l’origine, a fait persister jusque chez les modernes le système duodécimal, et on l’emploie encore dans le commerce et l’industrie où l’on compte par douzaines et par grosses, aussi bien que dans la supputation des heures et des degrés. Or, en divisant l’unité cil soixante parties égales, divisées à leur tour en soixante, les Chaldéens conciliaient les deux systèmes de division de l’unité qui, depuis qu’il y a lies hommes, sont en lutte et se partagent les peuples, le système décimal et le système duodécimal. 60 a, en effet, pour diviseurs tous les diviseurs de 10 et de 12, et c’est parmi les nombres que l’on pouvait choisir comme dénominateur invariable des fractions, celui qui compte le plus de diviseurs. La numération sexagésimale des Assyriens leur permettait d’exécuter, avec la même exactitude et la même facilité que nous, les quatre opérations fondamentales de l’arithmétique ; ils se servaient, dans leurs calculs, de fractions sexagésimales, comme nous nous servons nous-mêmes de fractions décimales. Un des documents qui nous renseignent le mieux sur l’état de la science des nombres chez les Chaldéens, est la fameuse tablette mathématique trouvée à Senkereh et conservée au Musée Britannique. On y voit inscrite, sur une face, la série complète des cubes des nombres depuis 1 jusqu’à 60 ; sur l’autre face, se trouve une table complète des mesures de longueur, qui d’après les recherches de M. Aurès, avait pour objet de donner un moyen facile d’exprimer promptement et sans calcul, dans le système scientifique sexagésimal, un nombre déjà exprimé en douzaines, suivant l’ancien système populaire[22]. Sur cette tablette, les cubes sont notés par le système sexagésimal ; on donne d’abord le chiffre, puis le cube, de 1 à 59 ; les chiffres 60 et 216,000 sont remplacés par le clou vertical signifiant l’unité. La numération sexagésimale réglait l’échelle des divisions et des multiples dans le système métrique de Babylone et de Ninive, le plus savant et le mieux organisé de toute l’antiquité. C’est en effet le, seul, jusqu’à notre système métrique français, dont toutes les parties fussent scientifiquement coordonnées et qui reposât sur la conception fondamentale de l’engendrement de toutes les unités des mesures de superficie, de capacité et de poids par une unité première et typique de mesure linéaire. Cette unité, c’est l’empan qui avait 0m,270 millimètres de longueur ; la règle graduée que nous avons signalée ailleurs, sur les genoux de l’une des statues de Gudea, trouvées par M. de Sarzec., a exactement cette longueur’. Les subdivisions de l’empan qui étaient nombreuses, constituaient ce que nous appelons les mesures manuelles ; mais elles n’étaient pas toujours usitées et on les appropriait à l’objet mesuré : les arpenteurs, par exemple, ne se servaient que d’un petit nombre des multiples de l’empan, savoir : la perche, de 3m, 24, le plèthre de 32m,40 et stade ou ammat-gagar de 194m,40. ` Les carrés des mesures linéaires ont été naturellement les mesures de superficie, et les carrés de la perche, du plèthre et du stade ont été particulièrement les mesures agraires. Le pied carré avait 105 millimètres carrés de superficie, la coudée carrée en avait 292 ; le stade carré mesurait 3 hectares 78 ares ; la plus grande division était la perche-gagar carrée qui contenait 136 hectares 08 ares[23]. Les mesures de capacité ou mesures cubiques des Assyriens et des Chaldéens sont encore peu connues, mais on ne saurait douter qu’elles n’eussent été fondées sur les mesures linéaires. Les inscriptions ne parlent guère que de trois d’entre elles : 1° Le SE qui devait correspondre au hin des Juifs ; 2° Le QA qui s’appelait bath pour les liquides, epha pour les grains ; 3° Le imer correspondant à l’hébreu homer ou kor. Il y avait encore probablement des divisions correspondant au gur, à l’artaba, ou cab et au log des hébreux ; mais essayer de rétablir toutes ces mesures serait se lancer dans des conjectures tout au moins inutiles ici[24]. Le système pondéral assyrien dérivait tout naturellement aussi du système des mesures linéaires. Les musées possèdent un certain nombre de poids assyriens en fer et en pierre, coulés ou sculptés sous la forme de lions, de sangliers et de canards, et portant généralement une inscription qui est leur estimation pondérale, à laquelle on a joint parfois un nom de roi qui fixe la date de leur fabrication. Ce que les poids découverts à Ninive, dit M. Mommsen[25], nous apprennent de plus intéressant, est le système de division en usage dans l’Assyrie, et qui diffère radicalement de celui que les Grecs adoptèrent. Le talent (biltu) contient 60 mines, et la mine (mana) se divise aussi par 60, de sorte que le talent de Babylone renfermait 3.600 petites unités ou drachmes (darag mana). On comptait par mines, par soixantièmes de mine et par trentièmes du soixantième de mine. Nous avons vu ailleurs que les calculs astronomiques des Chaldéens étaient dressés suivant la même méthode : le sar contenant une période de 3,600 ans divisés en six groupes ou tiers de 600 ans, ou en 60 sosses de chacun 60 ans. La drachme se trouvant, chez les Assyriens, contenue 60 lois dans la. mine, et la mine 60 fois dans le talent, il en résulte que la mine était considérée comme égale à un sosse de drachmes et le talent comme égal à un sosse de mines, ou, ce qui est la même chose, à un sar de drachmes[26]. Un des poids conservés au Musée Britannique et dont, la valeur est fort clairement indiquée, est un poids de 5 mines ; il pèse 5055 grammes ; il en résulte une mine de 505 grammes 5. Un autre poids de 30 mines pèse 15061 grammes, ce qui donne une mine de 502 grammes ; M. Aurès est donc à peu près dans la vérité en admettant théoriquement une mine de 505 grammes. Mais il faut observer que si le système pondéral est resté le même, au point de vue des divisions et de leur graduation respective, à toutes les époques et dans toutes les parties de l’empire assyrien, la valeur pondérale de chacune des mesures a légèrement varié suivant les temps et les provinces ; c’est pourquoi, sans cloute, les textes cunéiformes qui mentionnent des pesées, ont bien soin de spécifier, s’il s’agit de mines, par exemple, que l’évaluation est faite en mines du roi Duugi, ou en mines de Babylone, ou de la ville de Karkémis. C’est d’ailleurs l’indication qu’on trouve, en général, sur les monuments eux-mêmes, avec le nom du roi et du fonctionnaire qui remplissait la charge de vérificateur des poids et mesures. § 5. — LA MAGIE. La Chaldée est la patrie de la magie et des sciences occultes, aussi bien que celle de l’astrologie et des sciences exactes. C’est des bords du Tigre et de l’Euphrate, plus encore que de ceux du Nil, que la magie West répandue dans le monde occidental où elle a exercé une influence si funeste jusqu’à ces derniers siècles. N’est-il pas étrange que les temps les plus éclairés de l’antiquité grecque et romaine, de même que ceux du moyen âge et de la Renaissance, se soient comme enivrés de ces rêveries orientales, et n’aient pas réussi à secouer le joug de ces ridicules superstitions qui, ayant survécu au triomphe du christianisme, cherchent même à lutter contre la science contemporaine ? Les sorciers, les diseurs de bonne aventure et les charlatans, héritiers des vieux Chaldéens, encombrent encore nos places publiques aux jours de fêtes populaires, et l’on a vu plus d’un sceptique croire aux sciences occultes et aux procédés divinatoires en même temps qu’il affirmait rejeter tout surnaturel. Aussi, l’histoire de la magie constitue-t-elle un des chapitres les plus intéressants du développement de l’esprit humain que tourmente l’inconnu, et que le merveilleux et l’inexpliqué ont toujours porté vers la superstition et la crédulité. Les origines de la magie sont fort obscures, malgré le témoignage des écrivains juifs et grecs, malgré même les nombreux documents originaux que l’assyriologie a récemment livrés entre nos mains. Ces sources toutes nouvelles ont toutefois singulièrement agrandi le domaine de nos connaissances, sinon en nous faisant pénétrer dans l’organisation intérieure des corporations de devins et de magiciens, du moins en nous fournissant le texte de leurs pratiques occultes, de leurs incantations et de leurs procédés théurgiques. Il y avait deux espèces de magie : celle qui n’était qu’une partie du culte régulier, et qu’on voit en usage chez tous les peuples sauvages qui, adorant les phénomènes de la nature, ont peuplé d’esprits les forêts, les nuages, les rivières, la nuit, les vents ; c’est la magie blanche, essentiellement bienfaisante, et constituant un commerce légitime, établi par les rites sacrés, entre les esprits supérieurs et les prêtres qui les invoquent. Mais à côté du prêtre thaumaturge, exorcisant pour chasser le malin esprit, consacrant des amulettes, il y avait, le sorcier qui se faisait l’interprète des puissances infernales et diaboliques, entretenant commerce avec elles et se servant de leur concours pour faire le mal ; son art, réprouvé par la religion, constituait la magie noire ; le sorcier est un homme pervers qui s’est voué au malin esprit par des pactes, des serments et des enchantements. C’est généralement pour servir les passions mauvaises des hommes et dans nu but lucratif qu’il exerce sa sinistre besogne. C’est l’état de superstitieuse terreur dans laquelle vivait constamment le Chaldéen, qui entretenait la foi aux procédés de la magie blanche et de la magie noire. Tout l’Orient, il faut bien le reconnaître, a vécu, dès les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, sous l’empire de, ces aberrations singulières, et il est curieux, par exemple, de rapprocher l’état d’esprit dans lequel se trouvaient les Chaldéens, des idées qui ont cours aujourd’hui chez les populations de l’Inde : Le peuple hindou, dit le voyageur anglais M. J. Roberts[27], a affaire à tant de démons, de dieux et de demi-dieux, qu’il vit dans une crainte perpétuelle de leur pouvoir. Il n’y a pas un hameau qui n’ait un arbre ou quelque place secrète regardée comme la demeure des mauvais esprits. La nuit, la terreur de l’Hindou redouble, et ce n’est que parla plus pressante nécessité qu’il peut se résoudre, après le coucher du soleil à sortir de sa demeure. A-t-il été contraint de le faire il ne s’avance qu’avec la plus extrême circonspection et l’oreille au guet. Il répète des incantations, il touche des amulettes, il marmotte à tout instant des prières, et porte à la main un tison pour écarter ses invisibles ennemis. A-t-il entendu le moindre bruit, l’agitation d’une feuille, le grognement de quelque animal, il se croit perdu ; il s’imagine qu’un démon le poursuit, et, dans le but de surmonter son effroi, il se met à chanter, à parler à haute voix ; il se hâte et ne respire librement qu’après qu’il a gagné quelque lieu de sûreté. Cette description du caractère des Hindous pourrait s’appliquer trait pour trait aux Assyro-Chaldéens. Leur magie repose sur la croyance à d’innombrables esprits répandus en tous lieux dans la nature, dirigeant et animant tous les êtres de la création. Ce sont eux qui causent le bien et le mal, conduisent les mouvements célestes, ramènent alternativement le jour et la nuit, veillent au retour des saisons, font souffler les vents, tomber les pluies, la neige, la grêle, la foudre, en un mot produisent les phénomènes atmosphériques, bienfaisants ou destructeurs ; ce sont eux aussi qui donnent à la terre sa fécondité, font germer et fructifier les plantes, président à la naissance et à la conservation de la vie chez les êtres animés, et qui, par contre, envoient la mort et les maladies. Il y a des esprits de ce genre partout, dans le ciel des étoiles, dans les entrailles de la terre et dans les régions intermédiaires de l’atmosphère. Tous les éléments en sont remplis, l’air, le feu, la terre et l’eau ; rien n’existe sans eux. Comme le mal est partout, dans la nature, à côté du bien, une idée de dualisme, presque aussi prononcée que dans la religion de Zoroastre, préside à la manière dont les prêtres chaldéens conçoivent le monde surnaturel dont ils redoutent encore plus les actions malfaisantes qu’ils n’en attendent de bienfaits. Il y a des esprits bons par essence, et d’autres mauvais également par nature. Leurs chœurs opposés constituent un vaste dualisme qui embrasse l’univers entier, et poursuit, dans toutes les parties de la création, une lutte incessante et éternelle. De même qu’à chaque corps céleste, à chaque élément, à chaque phénomène, à chaque être et à chaque objet, est fixé un bon esprit, un mauvais esprit s’y attache également et cherche à l’y supplanter. La discorde est partout dans l’univers. Emporté, fatalement lui-même au milieu de cette bataille perpétuelle entre les bons et les mauvais esprits, l’homme en sent à chaque instant les atteintes, et son propre sort en dépend. Tout ce qui lui arrive d’heureux est le fait des uns ; tout ce qui lui survient de malheureux, celui des autres. Il lui faut donc un secours contre les attaques des mauvais esprits, contre les fléaux et les maladies qu’ils déchaînent sur lui. Ce secours, c’est dans les incantations, dans les paroles mystérieuses et toutes-puissantes dont les prêtres magiciens enfle secret, c’est dans leurs rites et leurs talismans qu’il le trouve ; par là seulement, les démons funestes sont écartés, les esprits favorables rendus propices et appelés au secours de l’homme. Dans l’armée du bien comme dans celle du mal, on distingue des catégories de démons hiérarchisés et plus ou moins puissants suivant leur grade. Dans les textes, on mentionne le ekim, le telal guerrier, le maskin ou tendeur d’embûches, le alal destructeur, le labartu, le labassu, le ahharu, sortes de spectres, de fantômes et de vampires ; on cite souvent les mas, les lamma et les utuq ; on oppose le mas favorable au mas mauvais, le lamma favorable au lamma mauvais, le bon utuq au méchant utuq. Il y a aussi les alapi ou taureaux ailés, les nirgalli ou lions ailés, et de nombreuses catégories d’archanges qu’on appelle les Anunnaks et les Ighigs, les uns terrestres et les autres célestes. Ce sont les dieux Anna et Êa, appelés Esprit du ciel (zi an na) et Esprit de la terre (zi ki a), qu’on invoque généralement dans les incantations, comme les dieux de toute science, seuls capables de préserver l’humanité des atteintes des mauvais anges. Les documents attestent ainsi, chez les Chaldéens ; une démonologie extrêmement riche, dont la savante hiérarchie ne nous est encore que fort imparfaitement connue. Entre l’humanité et le dieu Êa, il existe un dieu médiateur qu’on n’invoque que dans les textes magiques et qui n’a jamais d’autre rôle que cette médiation : c’est Marduk, dont le nom magique et suméro-accadien est Silik-mulu-hi, celui qui dispose le bien pour les hommes. — Je suis celui qui marche devant Êa, lui fait dire un hymne, je suis le guerrier, le fils aîné de Êa, son messager. Silik-mulu-hi révèle aux hommes les volontés et la science de Êa, et, en retour, il porte à Êa l’appel des hommes tourmentés par les esprits malins et par les maladies. C’est a lui que s’adresse ce beau fragment dont les expressions ont tant d’analogie avec celles du psaume CXLVII de la Bible : Devant ta grêle qui se soustrait ? — Ta volonté est un décret sublime que tu établis dans le ciel et sur la terre. Vers la mer je me suis tourné, et la mer s’est aplanie ; — vers la plante je me suis tourné, et la plante s’est flétrie ; vers la ceinture de l’Euphrate je me suis tourné, et — la volonté de Silik-mulu-hi a bouleversé son lit. — Seigneur, tu es sublime ; qui t’égale ? Un hymne développe son rôle bienfaisant en termes remarquables [Seigneur grand] du pays, roi des contrées, — ... fils aîné de Êa, — ... qui ramènes (dans leurs mouvements périodiques) le ciel et la terre, Seigneur grand du pays, roi des contrées, — dieu des dieux, — [directeur] du ciel et de la terre, qui n’a pas d’égal, — [serviteur] d’Anna et de Mul-ge, — miséricordieux parmi les dieux, — miséricordieux, qui rappelles les morts à la vie. — Silik-mulu-hi, roi du ciel et de la terre, — roi de Babylone, roi de la Maison qui dresse la tête (la pyramide de Babylone), roi de la Maison suprême de la vie (autre temple de Borsippa), — affermis le ciel et la terre ! — affermis autour le ciel et la terre ! affermis la lèvre de la vie ! — affermis la mort et la vie ! — affermis la digue sublime de la fosse de l’Océan ! L’ensemble des hommes qui ombragent leur tête (les hommes qui ont le droit de porte au-dessus de leur tête un parasol insigne de leur puissance), — ce qui développe la vie, tout ce qui proclame la gloire dans le pays, — les quatre régions dans leur totalité, — les esprits divins des légions du ciel et de la terre dans leur totalité... Tu es le colosse (favorable) ; — tu es celui qui vivifie... ; — tu es celui qui fait prospérer..., — le miséricordieux parmi les dieux, — le miséricordieux qui rappelle les morts à la vie, Silk-mulu-hi, roi du ciel et de la terre, — j’ai invoqué ton nom, j’ai invoqué ta sublimité ; — la commémoration de ton nom, que les dieux [la célèbre ;] — la soumission à toi, qu’ils [la bénissent.] — Que celui dont la maladie est douloureuse soit [délivré.] — [Guéris] la peste, la fièvre, l’ulcère. Silik-mulu-hi est très nettement identifié dans cet hymne au Marduk de la religion babylonienne, et c’est aussi par Marduk que les traducteurs assyriens des textes magiques ont toujours rendu son nom. Outre Silik-mulu-hi, l’homme appelle souvent à son secours ou essaye d’apaiser les esprits spéciaux à chaque vent, qui sont les uns bous, les autres mauvais. Daman, sous le nom mystique de Im, le dieu ou Esprit du vent, est représenté comme celui qui amène les pluies fertilisatrices ; il a sous ses ordres la troupe des dieux des vents spéciaux : Un hymne s’adresse aux eaux qui coulent sur la terre : Eaux sublimes, [eaux du Tigre,] eaux de l’Euphrate qui [coulent] en leur lieu, eaux qui se rassemblent dans l’Océan ! filles de l’Océan, qui sent sept, eaux sublimes, eaux fécondes, eaux brillantes, en présence de votre père Êa, en présence de votre mère, l’épouse du grand poisson l qu’il soit, sublime ! qu’il fructifie ! qu’il brille ! que la bouche malfaisante et nuisible n’ait pas d’effet. Amen. Un autre invoque le fleuve comme un dieu spécial et personnel : Dieu Fleuve, qui pousse en avant, comme l’éperon d’un navire repousse de devant lui le mauvais sort, pareil à un fauve redoutable... Que le soleil à son lever dissipe les ténèbres ! dans la maison jamais plus elles ne prévaudront. Que le mauvais sort s’en aille dans le désert et dans les lieux élevés... Le mauvais sort qui se répand sur la terre, Dieu Fleuve, brise-le. Nous avons encore un hymne à la vague de l’Océan, personnifiée comme une divinité protectrice dont on célèbre l’eau sublime, l’eau féconde, l’eau vivifiante. Bien autre est l’importance du feu. On l’adore dans sa réalité matérielle comme un dieu supérieur au soleil même, sous les deux noms qui signifient flamme (bil-gi) et feu (iz-bar), appellations qui, précédées du caractère idéographique de dieu, s’échangent pour le désigner. La manière dont on le conçoit et les attributions qu’on lui assigne le rapprochent étroitement de l’ Agni des Védas. Feu, dit un hymne, seigneur qui rassemble, s’élevant haut dans le pays, — héros, fils de l’Océan, qui s’élève haut dans le pays ; — Feu, éclairant avec ta flamme sublime, — dans la demeure des ténèbres tu établis la lumière ; prophète de toute renommée, tu établis le destin ; — le cuivre et l’étain c’est toi qui les mêles ; — l’or et l’argent c’est toi qui les purifies ; — l’émanation de la déesse Ninka-si (la dame à la face cornue), c’est toi ; — celui qui fait trembler les méchants dans la nuit, c’est toi. De l’homme fils de son dieu, ses œuvres qu’elles brillent de pureté ! — comme le ciel qu’il soit sublime ! — comme la terre qu’il fructifie ! — comme le milieu du ciel qu’il brille ! Le Feu qui purifie tout est le grand dissipateur des maléfices, le héros qui met les démons en fuite : (Toi) qui chasses les maskins mauvais, — qui gratifies de la vie..., — qui ramènes la crainte parmi les méchants, — qui protèges les œuvres de Mul-ge, — Feu, destructeur des ennemis, arme terrible qui chasse la peste, — fécond, brillant, — ... anéantis la méchanceté. A la protection de ce dieu est due la paix universelle : Repos du dieu Feu, le héros, — avec toi, que soient en repos les pays et les fleuves ; — avec loi, que soient en repos le Tigre et [l’Euphrate] ; — avec toi, que soient en repos les mers et [les montagnes] ; — avec toi que soit en repos le chemin de la fille des dieux (ceci semble une allusion à la voie lactée)... ; — avec toi, que soit en repos l’intérieur des productions [de la nature] ; — avec toi, que soient en repos les cœurs de mon dieu et de ma déesse, esprits [purs ?] ; avec toi, que soient en repos les cours du dieu et de la déesse de ma ville, esprits [purs ?]. — Dans ces jours..., que les cœurs de mon dieu et de ma déesse s’ouvrent — et qu’en sorte l’oracle du destin de mon corps. On adore le Feu avant tout dans la flamme du sacrifice, et c’est pour cela qu’on l’appelle le pontife suprême sur la surface de la terre. Mais on reconnaît aussi ce dieu dans la flamme qui brûle au foyer domestique et qui protège la maison contre les influences mauvaises et les démons : Je suis la flamme d’or, la grande, la flamme qui s’élève des roseaux, l’insigne élève des dieux, la flamme de cuivre, protectrice, qui élève ses langues ardentes ; — je suis le messager de Silik-mulu-hi. Ce dieu qui réside dans la flamme du sacrifice et dans celle du foyer, est aussi le feu cosmique, répandu dans la nature, nécessaire à la vie et brillant dans les astres. Envisagé sous cet aspect, il est le dieu qui s’élève haut, grand chef, qui étend la puissance suprême du Ciel (Anna), — qui exalte la terre, sa possession, sa délectation, et c’est ainsi que nous le voyons luttant vainement pour empêcher les ravages que les terribles maskin portent dans l’économie générale du monde. Voici encore un début d’hymne qui s’adresse à lui, dans son rôle le plus vaste et le plus haut : Seigneur exalté, qui diriges les voies des dieux très grands ; — [splendeur] du zénith, seigneur exalté, qui diriges les voies des dieux, — [splendeur] de Mul-ge, qui diriges les voies de dieux, — héros feu, qui t’élèves, mâle héroïque, — qui [étends] le voile (du ciel), qui revêts l’immensité, — Feu puissant... — ... qui illumines les ténèbres. Prenant dans les documents no magiques un caractère solaire, le dieu Feu devient, sous je nom d’Izdubar (Isdu-bar, masse de feu), le héros d’une des principales histoires épiques, de celle où intervient incidemment le récit du déluge et dont nous avons parlé ailleurs. Telles étaient les principales divinités invoquées dans les conjurations magiques de la Chaldée. Dans les documents égyptiens, nous n’apercevons aucune trace de ces esprits élémentaires doués d’une personnalité distincte et répandus partout dans l’univers. En revanche, les formules magiques des Assyriens, au rebours de celles de l’Égypte, sont sans raffinement philosophique sur les problèmes de la substance divine, et sans la moindre trace de mysticisme. Les incantations se récitaient sur les personnes qui en étaient l’objet, à seule fin de les délivrer de la possession diabolique ou de certaines maladies, comme celles que l’on appelle la maladie de la tête et la peste. Les possédés étaient, parait-il, nombreux eu Chaldée et eu Assyrie, ce qui ne satinait nous étonner outre mesure, car ce genre de folie nerveuse se rencontre encore aujourd’hui très fréquemment dans les pays orientaux. Quand il s’agit de chasser les démons, la formule d’exorcisme prend parfois un caractère dramatique. Après avoir décrit les ravages causés par le malin esprit, elle suppose que la plainte a été entendue par Silik-mulu-hi. Mais son pouvoir et sa science ne vont pas jusqu’à vaincre les démons trop puissants dont il faut conjurer l’action. Alors, Silik-mulu-hi s’adresse à son père Êa, l’intelligence divine qui pénètre l’univers, le maître des secrets éternels, le dieu qui préside à l’action théurgique, et celui-ci lui révèle le rite mystérieux, la formule ou le nom tout-puissant et caché qui brisera l’effort des plus formidables puissances de l’abîme. Les formules de conjuration contre les esprits malfaisants sont très monotones, comme, du reste, toute la littérature sacrée des Chaldéens. On commence par énumérer les démons que doit vaincre le charme, par qualifier leur pouvoir et en décrire les effets. Vient ensuite le vœu de les voir repoussés ou d’en être préservé, lequel est souvent présenté sous une forme affirmative. Enfin, la formule se termine par l’invocation mystérieuse qui lui donnera son efficacité : Rappelle-toi le serment du ciel ! Rappelle-toi le serment de la terre ! Voici, par exemple, une formule magique contre les utuq méchants et Namtar, sorte de génie de la mort, qui tue tout ce qui vit, aussi bien dans les cieux que sur la terre : Le
tyran redoutable qui fauche la totalité des êtres, c’est
l’Utuq méchant, le perturbateur du ciel, c’est
Namtar, fils du majestueux Bel, enfanté par Belit. En
haut, ils détruisent ; en bas, ils renversent les murs ; ils
sont l’œuvre de l’enfer ; en
haut, ils vocifèrent ; en bas, ils poussent des hurlements ; ils
sont le venin même de la bile des dieux ; ce sont
eux qui, lors du grand jour, se sont élancés du ciel ; ils
sont les hiboux qui crient dans la ville. Eux qui
bouleversent les cieux, sont les fils de la Terre ; ils
ébranlent comme des roseaux les poutres les plus larges ; ils
passent de maison en maison ; la
porte ne les arrête pas, le verrou ne les empêche pas d’avancer, ils se
glissent sous la porte comme des serpents ; ils
sifflent comme le vent contre les gonds ; ils
arrachent l’épouse du sein de son mari ; ils
enlèvent l’enfant des genoux de son père ; ils
chassent l’homme libre de sa chambre nuptiale ; ce sont eux qui attachent aux pas de l’homme une voix sinistre. Dieu de
l’humanité, Seigneur, sois l’appui et le soutien de l’homme que son dieu a
saisi par le vêtement ; Que la
cause de sa maladie soit le roi des Lamassi (démons colosses), que ce
soit le roi des Labassi (feux follets) ; que ce
soit le roi des Aharri (démons
ronfleurs) ..... que ce
soit un Utuq méchant ; que ce
soient les quatre régions du monde que ce
soit le jour obscurci par nu nuage du sud : que ce
soit le jour obscurci par un nuage du nord ; que ce
soit le jour obscurci par un nuage de l’orient ; que ce
soit le jour obscurci par un nuage de l’occident : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô Asak
(démon des maladies), je t’adjure par le serment des Anouns (génies de l’abîme
? Ô Asak
malfaisant, je t’adjure par le serment des Aucuns ! Ô Asak,
toi qui presses fortement, qui oppresses le malade, Ô Asak,
rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la terre ! Rappelle-toi
le serment du seigneur des terres ! Rappelle-toi
le serment de la dame des terres ! Rappelle-toi
le serment du seigneur des étoiles ! Rappelle-toi
le serment de la dame des étoiles !.... Rappelle-toi
le serment du seigneur de la colline sacrée ! Rappelle-toi
le serment de la clame de la colline sacrée ! Rappelle-toi
le serment du seigneur du jour de la vie ! Rappelle-toi
le serinent de la daine du jour de la vie ! Rappelle-toi
le serment de Sin (la lune) dont le fleuve est parcouru par la barque du soleil
couchant ! Rappelle-toi
le serment de, Samas (le Soleil) souverain arbitre des dieux ! Rappelle-toi
le sergent d’Istar, à la parole de qui les Anouns ne résistent jamais ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’homme,
fils de son dieu, alors, reviendra à lui ; à l’instant il revivra ; On lui
donnera du pain à manger, on lui donnera de l’eau à boire ; on lui
mettra dans la main un vase d’eau.... de Bel ; avec de
l’eau de mer, l’eau de Sin, l’eau du Tigre, l’eau de l’Euphrate, l’eau
de puits, l’eau de rivière ou le lavera. il se
tiendra debout et il n’aura aucune crainte ; il
s’asseyra par terre et il ne sera pas molesté ; l’homme
fils de son dieu s’approchera ou s’éloignera à son gré. Tel est l’exorcisme contre l’Utuq méchant[28]. Souvent, il s’agissait non seulement de délivrer un possédé de l’obsession diabolique, mais en outre, de faire pénétrer dans son corps fin, esprit bon et favorable : c’était la meilleure garantie contre le retour des mauvais démons : Que les démons mauvais sortent ! dit un texte : qu’ils se saisissent entre eux ! Le démon favorable et le colosse favorable, qu’ils pénètrent dans son corps ! Cette possession inverse était souhaitée comme le plus grand des bonheurs, et comme l’un des plus heureux effets surnaturels de la magie ; c’était, s’il nous est permis de recourir à une pareille comparaison, comme la grâce divine ou comme une odeur de sainteté remplaçant l’état de péché et de consécration au diable. Aussi, dans une prière pour le roi, demande-t-on qu’il devienne l’habitation des bons esprits, et qu’un démon de bonheur et de sainteté pénètre dans son corps, pour lui assurer par sa présence toutes sortes de prospérités et le préserver de maladie. Dans la croyance chaldéenne, toutes les maladies sont l’œuvre des mauvais démons. De là ce fait que nous avons déjà signalé, qu’il n’y eut jamais à Ninive et à Babylone de médecins proprement dits ce sont les devins et les enchanteurs qui opèrent et guérissent en chassant le démon du mal. Parmi les incantations contre les maladies, les plus multipliées sont celles qui ont pour objet la guérison de la peste, de la fièvre et de la maladie de la tête. Celle-ci, d’après les indications que l’on donne sur ses symptômes et ses effets, paraît avoir été une sorte d’érysipèle ou de maladie cutanée. Il s’agit évidemment de cette affection de la peau dont se trouvent affligés temporairement, aujourd’hui encore, les habitants de Bagdad et de la basse Chaldée, affection analogue au bouton d’Alep et à l’éléphantiasis de Damiette. On croyait s’en guérir par les conjurations, parce qu’elle était censée l’œuvre des génies infernaux. La
maladie de la tête réside dans l’homme ; la
folie, l’ulcération. douloureuse du front, réside dans l’homme ; la
maladie de la tête enserre tout autour comme une couronne, la maladie de la tête, du lever au coucher du soleil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouvre
largement tes oreilles, ô fils d’Eridu (Marduk) ; La
maladie de la tête tourne tout autour comme un taureau ; la
maladie de la tête resserre tout autour, comme le spasme du cœur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La
maladie de la tête, comme des colombes vers leur nid, comme
des corbeaux vers le haut du ciel, comme
des oiseaux vers le vaste espace, qu’elle s’enlève ! Aux mains propices de son dieu, que le malade soit confié ![29] Cette description poétique de la maladie convient bien à l’affection endémique produite, même de nos jours par les marais des bords de l’Euphrate. Voici comment un autre texte magique la conjure : La
maladie de la tête circule dans le désert ; comme un vent elle souffle
violemment ; elle a
éclaté comme l’éclair ; en haut et en bas elle s’est précipitée. Celui
qui n’honore pas son dieu est déchiré comme un roseau ; son
ulcère l’opprime comme une entrave ; celui
qui n’a pas sa déesse pour gardienne, ses chairs sont meurtries ; comme
une étoile du ciel il disparaît, comme la rosée nocturne il s’évanouit. Envers
l’homme passager sur la terre, la maladie agit hostilement ; elle le dessèche
comme la chaleur du jour ; cet
homme, elle l’a frappé mortellement ; il est
oppressé comme par le spasme du cœur ; il est
mis hors de lui comme si elle arrachait son cœur ; il
s’agite comme un objet présenté devant le feu ; comme
ceux d’un onagre du désert en rut, ses deux yeux sont remplis de nuages ; il se
dévore dans sa propre vie, il est attaché à la mort. La
folié est comme un orage violent : personne ne connaît sa venue ; son destin complet, ce à quoi il est attaché, personne ne le connaît[30]. Quelques-uns des rites pratiqués pour les incantations nous sont révélés par le document qu’on va lire ; il se divise en deux parties bien distinctes : la première où le malade est désigné à la troisième personne, que devait par conséquent réciter sur lui le prêtre magicien, la seconde où il parle à la première personne et qu’il devait, par suite, prononcer lui-même en accomplissant un certain nombre d’actes rituels, auxquels se rapportent les différentes strophes de cette seconde partie. Les deux ne sont pas rédigées dans le même idiome, circonstance fort instructive et digne de remarque ; le magicien se sert de la langue liturgique, le suméro-accadien, qui dès lors avait cessé d’être un idiome parlé, était devenu inintelligible pour le vulgaire et la connaissance était un des principaux objets de l’enseignement dans les écoles sacerdotales ; le malade emploie l’assyrien, sa langue usuelle ; à laquelle on n’attachait aucune idée sacrée et aucune vertu mystérieuse. I — FORMULE DE L’ENCHANTEUR
L’imprécation
de malice agit sur l’homme, comme un méchant démon ; la voix
qui maudit existe sur lui ; la voix
mauvaise existe sur lui ; l’imprécation
de malice est le moyen de maléfice qui produit la folie. Cet
homme, l’imprécation de malice l’égorge comme un anneau ; son
dieu sort de son corps : sa
déesse avec satisfaction se fixe ailleurs : la voix
qui maudit, l’enveloppe comme un voile et le charge de son poids. Marduk
(Silik-mulu-hi) l’a pris en grâce, et auprès
de son père Êa, dans la demeure il est entré et il a dit : Mon
père, l’imprécation de malice existe sur l’homme comme un méchant démon. Pour la
seconde fois, il lui a dit encore : Comment
il a fait, cet homme ne le sait pas, ni à quoi il est soumis. Êa a
répondu à son fils Marduk : Mon
fils, comment ne sais-tu pas ? comment faut-il que je t’instruise ? Marduk,
comment ne sais-tu pas ? comment faut-il que je t’instruise ? Ce
que je sais, loi, tu le sais aussi, Viens,
mon fils Marduk. Du
haut de ta demeure étincelante, accueille-le, dissipe
son mauvais sort, délivre-le de son mauvais sort que
le mal qui bouleverse son corps : soit
une malédiction de son père, une
malédiction de sa mère, une malédiction
de son frère aîné ou
l’imprécation de colère d’un homme inconnu. Le sort
hostile, par l’enchantement d’Êa, qu’il soit
dépouillé comme un oignon ! qu’il
soit mis en pièces comme une datte ! qu’il
soit dénoué comme un nœud ! le sort
hostile, esprit des cieux, conjuré-le ! esprit de la terre, conjure-le. II — FORMULES DU MALADE
1. — Incantation.Comme
cet oignon est dépouillé, ainsi en sera-t-il du maléfice. Le feu
brûlant le brûlera, on ne
le plantera plus en lignes le sol
ne recevra pas sa racine, sa tête
ne contiendra pas de graines et le soleil n’en prendra pas soin, on ne
le présentera pas à la tête d’un dieu ou d’un roi. L’homme
qui a. jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps ; dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit dépouillé comme cet oignon, et qu’en
ce jour le feu brûlant le brûle ! Que le
mauvais sort s’en aille, et que, moi, je reçoive la lumière ! 2. — Incantation.Comme
cette datte est mise en pièces, ainsi en sera-t-il du maléfice. Le feu
brûlant la brûlera, elle ne
retournera pas au rameau dont elle est détachée, on ne
la présentera pas sur les plats d’un dieu ou d’un roi. L’homme
qui a jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps, dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit mis en pièces comme cette datte, et qu’en ce
jour le feu brûlant lé brûle ! Que le
mauvais sort s’en aille, et que, moi, je revoie la lumière ! 3. — Incantation.Comme
ce nœud est dénoué, ainsi en sera-t-il du maléfice. Le feu
brûlant le brûlera, ses
fils ne retourneront pas au tronc qui les a produits, on ne
l’emploiera pas à l’ornement d’un vœu. L’homme
qui a jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps, dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit dénoué comme ce nœud, et qu’en
ce jour le feu brûlant le brûle ; Que le
mauvais sort s’en aille et que, moi, je revoie la lumière ! 4. — Incantation.Comme
cette laine est déchirée, ainsi en sera-t-il du maléfice. Le feu
brûlant la brûlera, elle ne
retournera pas sur le dos de son mouton, elle ne
sera pas présentée pour le vêtement d’un dieu ou d’un roi. L’homme
qui a jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps, dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit déchiré comme cette laine, et qu’en
ce jour le feu brûlant le brûle ! Que le
mauvais sort s’en aille, et que moi, je revoie la lumière. 5. — Incantation.Comme
ce poil de chèvre est déchiré, ainsi eu sera-t-il du maléfice Le feu
brûlant le brûlera, il ne
retournera pas sur le dos de sa chèvre, on ne
l’emploiera pas à l’ornement d’ou vœu. L’homme
qui a jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps, dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit déchiré comme ce poil de chèvre, et qu’en ce
jour le feu brûlant le brûle ! Que le
mauvais sort s’en aille, et que moi, je revoie la lumière ! 6. — Incantation.Comme
cette étoffe est foulée et déchirée, ainsi en sera-t-il du maléfice. Le feu
brûlant la brûlera, le fils
du foulon ne la teindra pas pour en faire une couverture, elle ne
sera pas présentée pour le vêtement d’un dieu ou d’un roi. L’homme
qui a jeté le mauvais sort, son fils aîné, sa femme, le
maléfice, les lamentations, les transgressions, les sortilèges par écrit, les
blasphèmes, les péchés, le mal
qui est dans mon corps, dans mes chairs, dans mes ulcères, que
tout cela soit déchiré comme cette étoffe foulée, et qu’en ce
jour le feu brûlant la brûle ! Que le mauvais sort s’en aille, et que moi, je revoie la lumière ![31] On voit ainsi que des actes de purification et des rites mystérieux accompagnaient les incantations dont ils augmentaient la puissance et l’efficacité. Au nombre de ces rites il faut compter l’emploi, pour guérir les maladies, de certaines boissons enchantées et sans doute contenant des drogues réellement médicinales, puis celui des nœuds magiques, à l’efficacité desquels on croyait encore si fermement au moyen âge. Voici, en effet, le remède qu’une formule suppose prescrit par La contre la maladie de la tête : Noue à droite et arrange à plat en bandeau régulier, sur la gauche, un diadème de femme ; divise-le deux fois en sept bandelettes ;... ceins-en la tête du malade ; ceins-en le front du malade ; ceins-en le siège de sa vie ; ceins ses pieds et ses mains ; assieds-le sur son lit ; répands sur lui des eaux enchantées. Que la maladie de sa tête soit emportée dans les cieux comme un veut violent ; qu’elle soit engloutie dans la terre comme des eaux... passagères. Plus puissantes encore que les incantations sont les conjurations par la vertu des nombres. C’est à tel point que le secret suprême que Êa enseigne à son fils Silik-mulu-hi ou Marduk, quand il recourt à lui dans sou embarras, est toujours appelé le nombre, en accadien ana, en assyrien minu. Le nombre sept joue dans ces conjurations un rôle exceptionnel : on répète sept fois sept formules et les esprits qu’on invoque sont souvent au nombre de sept. Les livres sacrés des Chaldéens parlent fréquemment des sorciers et de leurs pratiques de magie noire. Tantôt les sortilèges sont mentionnés avec les démons et les maladies dans les énumérations de fléaux conjurés, tantôt des incantations spéciales les combattent. Telle est celle qui maudit le sorcier en l’appelant le méchant malfaisant, cet homme malfaisant, cet homme entre les hommes malfaisants, cet homme mauvais, et qui parle de la terreur qu’il répand, du lieu de ses agressions violentes et de sa méchanceté, de ses sortilèges qui sont repoussés loin des hommes. Le sorcier déchaîne les démons contre celui à qui il veut nuire ; il jette des mauvais sorts coutre les individus ou les pays, provoque la possession, envoie la maladie. Il peut même donner la mort par ses sortilèges et ses imprécations, ou bien par les poisons qu’il a appris à connaître et qu’il mêle à ses breuvages. Une incantation énumère les diverses opérations employés par les sorciers de la Chaldée : Le charmeur m’a charmé par le charme, m’a charmé par son charme ; la charmeuse m’a charmé par le, charme, m’a charmé par son charme ; le sorcier m’a ensorcelé par le sortilège ; m’a ensorcelé par son sortilège ; la sorcière m’a ensorcelé par le sortilège, m’a ensorcelé par son sortilège ; le jeteur de sorts a tiré et a imposé son fardeau de peine ; le faiseur de philtres a percé, s’est avancé et s’est mis en embuscade en cueillant son herbe ; que le dieu Feu ; le héros, dissipe leurs enchantements. Une autre formule détourne l’effet de l’image qui dresse sa tête et que l’on combat par des eaux purifiées et enchantées, de celui qui par la puissance de ses desseins fait venir la maladie, du philtre qui se répand dans le corps, de l’enchantement incorporé dans le philtre, enfin de la lèvre qui prononce l’enchantement. Nous avons donc ici l’enchantement par des paroles que récite le sorcier, carmen (d’où est venu notre mot charme), l’emploi d’œuvres, de pratiques mystérieuses et d’objets ensorcelés qui produisent un effet irrésistible, pratiques dont nue des principales est l’envoûtement ou l’ensorcellement. Si nous manquons de renseignements directs et originaux sur les pratiques d’envoûtement chez les anciens Chaldéens, un auteur arabe du XIVe siècle, Ibn. Khaldoun, nous permet de suppléer à cette lacune par la description qu’il fait d’une scène d’envoûtement pratiquée sous ses yeux par les sorciers nabatéens du bas Euphrate : Nous avons vu, dit-il, de nos propres yeux, un de ces individus fabriquer l’image d’une personne qu’il voulait ensorceler. Ces images se composent de choses dont les qualités ont un certain rapport avec les intentions et les projets de l’opérateur et qui représentent symboliquement, et dans le but d’unir et de désunir, les noms et les qualités de celui qui doit être sa victime. Le magicien prononce ensuite quelques paroles sur l’image qu’il vient de poser devant lui et qui offre la représentation réelle ou symbolique de la personne qu’il veut ensorceler ; puis il souffle et lance hors de sa bouche une portion de salive qui s’y était ramassée et fait vibrer en même temps les organes qui servent à énoncer les lettres de cette formule malfaisante, alors il tend au-dessus de cette image symbolique une corde qu’il a apprêtée pour cet objet, et y met un nœud, pour signifier qu’il agit avec résolution et persistance, qu’il fait un pacte avec le démon qui était son associé dans l’opération, au moment où il crachait, et pour montrer qu’il agit avec l’intention bien arrêtée de consolider le charme. A ces procédés et à ces paroles malfaisantes est attaché un mauvais esprit qui, enveloppé de salive, sort du la bouche de l’opérateur. Plusieurs mauvais esprits en descendent alors, et le résultat en est que le magicien fait tomber sur sa victime le mal qu’il lui souhaite[32]. Pour détourner l’effet des incantations des sorciers et échapper à l’action des mauvais esprits, on avait souvent recours aux talismans et aux amulettes sacrées. Il y en avait de diverses espèces. C’étaient des bandes d’étoffe portant des formules écrites, que l’on fixait sur les vêtements ou même sur les meublés, comme les phylactères des Juifs ; des statuettes de divinités qu’on portait suspendues au cou ; des cylindres de pierre dure. La plupart des cylindres-cachets qui servaient à sceller les actes étaient en même temps des amulettes. Quelquefois aussi, c’étaient des pierres consacrées ou des gâteaux de terre cuite avec des formules conjuratoires, qu’on déposait dans les fondations des maisons, qu’on cachait dans les champs, ou qu’on mettait de quelque manière en contact avec les objets qu’on voulait protéger. Une formule raconte le cérémonial usité pour déposer un talisman préservateur dans la maison d’un malade, afin d’en expulser le démon de la fièvre : Pour la
cérémonie de l’élévation de vos mains je me suis couvert d’un voile bleu
sombre, J’ai
remis dans vos mains un vêtement d’étoffe bariolée, j’ai disposé un barreau
de bois pris dans le cœur du tronc de l’arbre, J’ai
complété la barrière, je l’ai lavée, je vous ai remis à vous... (Lacune de quatre versets). Deux
images du héros des décisions, à la figure complètement formée, qui empale
les gallu mauvais : placez-les
à droite et à gauche, à la tête du malade. L’image
du roi de puissance (Nergal), qui n’a pas de rival, placez-la fixée à la clôture de la
maison. L’image
du dieu se manifestant dans la vaillance, qui n’a pas de rival, Et
l’image du dieu Narudi, seigneur des grands dieux, Placez-les
en bas du lit, Afin
que rien de mauvais n’approche, placez les dieux Mulu-lal et Latarak à la
porte ; Afin de
repousser tout mal, placez-les en épouvantail, en face de la porte ; Le
héros combattant, placez-le... à l’intérieur de la porte ; Le
héros combattant, qui oppose sa main aux mauvaises influences, placez-le au
seuil de la porte, Placez-le
à droite et à gauche. L’image
gardienne du seigneur de la terre (Êa) et de Silik-mulu-hi (Marduk) placez-la
à droite et à gauche.... Ô vous,
issus de l’Océan, brillants enfants du seigneur de la terre (Êa), Mangez
le bon aliment, buvez le breuvage miellé ! Que grâce à votre garde, rien de mauvais ne puisse entrer ![33] L’effet
miraculeux du talisman est encore consigné dans le document qui suit : Talisman,
talisman, borne qu’on n’enlève pas, borne
posée par les dieux, que l’on ne franchit pas, borne
immuable du ciel et de la terre, qu’on ne déplace pas, seul
dieu qui n’est jamais abaissé ; ni dieu
ni homme ne peuvent dissiper la puissance ; piège
qu’on n’enlève pas, disposé contre le maléfice, cimeterre
qui ne s’en va pas, opposé au maléfice ! — Que
ce soit un utuk mauvais, un alu mauvais, un ekim mauvais, un rabiç mauvais, Un
fantôme, un spectre, un vampire, Un
incube, un succube, un servant femelle nocturne, Ou bien
la peste malfaisante, la consomption douloureuse ou une maladie mauvaise — qui
résiste aux eaux d’Êa, répandues par aspersion, Que le piège d’Êa le prenne ! — Qui
s’attaque aux greniers de Nirba, Que le
cimeterre de Nirba le taille en pièces ! — Qui
franchisse la borne de la maison, Que la
borne des dieux, borne du ciel et de la terre, ne le laisse plus échapper ! .... —
qui revienne sur la maison, Qu’ils
le fassent tomber dans les rets, dans la maison ! — qui
circule ailleurs, qu’ils
le rejettent ailleurs, dans les lieux stériles 1 — qui
soit arrêté dehors, par la porte de la maison, qu’ils
l’enferment dans la maison, dans un lieu d’où l’on ne sort pas ! — qui
s’applique à la porte et au verrou, que la
porte et le verrou l’enferment dans un lieu qui ne s’ouvre plus ! — qui
souffle dans les chéneaux et sur le toit, qui
pousse avec effort sur le sceau de la porte et les gonds, qu’ils
le fassent écouler comme des eaux ! qu’ils
le brisent comme une cruche de terre ! qu’ils
le broient comme du fard d’antimoine — qui
franchisse la charpente, qu’ils
lui coupent les ailes ! — qui
présente son cou par la fenêtre, qu’ils lui coupent la gorge ![34] Sous le pavé du seuil des porto, du halais de Sargon, à Khorsabad, on a découvert une quantité d’objets talismaniques : ce sont des images assez grossières de divinités : Bel, à la tiare garnie de plusieurs rangées de cornes de taureau ; Nergal, à la tête de lion, Nabu, portant le sceptre. Le roi chaldéen Nergal-sar-ussur (Neriglissor) raconte qu’il fit placer dans les fondations de la grande pyramide, huit figures talismaniques de bronze, pour éloigner les méchants et les ennemis par la terreur de la mort. Quelques-unes de ces ligures talismaniques, sont inspirées par une idée singulièrement originale. Les Chaldéens se représentaient les démons sous des traits tellement hideux qu’ils croyaient qu’il suffisait de leur montrer leur propre image pour les faire fuir épouvantés. C’est, l’application de ce principe que nous trouvons dans une incantation contre la peste. Le Namtar (la peste) douloureux brûle le pays comme le feu ; comme la fièvre il se rue sur l’homme ; comme une inondation, il s’étend sur la plaine ; comme un ennemi il tend à l’homme ses pièges ; comme une flamme il embrase l’homme. Il n’a pas de main ; il n’a pas de pied : il vient comme la rosée de la nuit ; comme une planche il dessèche l’homme ;... Le docteur dit : Assieds-toi, et pétris une pâte d’aromates, et fais-en l’image de sa ressemblance (du Namtar). Applique-la sur la chair de son ventre (du malade) ; tourne la face (de cette image) vers le coucher du soleil, Alors, la force du mal s’échappera en même temps. Le musée du Louvre possède l’image d’un horrible démon debout, au corps de chien, aux pieds d’aigle, aux bras armés de griffes de lion, avec une queue de scorpion, la tête d’un squelette à demi décharné, gardant encore ses yeux et munie de cornes de chèvre, enfin quatre grandes ailes ouvertes. Un anneau placé derrière la tête servait à suspendre cette figure. Dans le dos est tracée une inscription en langue suméro-accadienne qui apprend que ce personnage est le démon du vent du sud-ouest, et que l’image devait être placée à la porte ou a la fenêtre pour éloigner son action funeste. Eu effet, en Chaldée, le vent du sud-ouest est celui qui vient des déserts de l’Arabie et dont l’haleine brûlante, desséchant tout, produit les mêmes ravages que le hamsin en Syrie et le simoun en Afrique. Les collections ries musées renferment beaucoup d’autres de ces figures de démons. L’un a une tête de bélier portée sur un cou d’une longueur démesurée ; un autre présente une tête de hyène, à la gueule énorme et ouverte, portée sur un corps d’ours avec des pattes de lion. Les taureaux ailés à tête humaine, qui flanquent les portes d’entrée des palais, sont, au contraire, des génies bienfaisants qui exercent une garde réelle et qu’on enchaîne pour toujours à ce poste d’honneur. Auprès d’une des entrées du palais de Nimroud était un bas-relief colossal, aujourd’hui à Londres ; on y voit Raman, le dieu de l’atmosphère et des tempêtes, la tête surmontée de la tiare royale armée de cornes de taureau, les épaules munies de quatre grandes ailes, chassant devant lui et poursuivant de sa foudre un esprit malin qui a le corps, la tête et les pattes de devant d’un lion, les ailes, la queue et les pattes de derrière d’un aigle, avec l’encolure garnie de plumes au lieu de crinière. Sculpter ce groupe sur la muraille était assurer, aussi bien que par une conjuration, que le dieu chasserait toujours de même le démon s’il essayait de pénétrer dans le palais. A Koyoundjik, au palais d’Assurbanipal, on voit en plusieurs endroits, des séries de figures monstrueuses, au corps d’homme surmonté d’une fête de lion, avec des pieds d’aigle. Il sont groupés deux à deux, se combattant à coups de poignard et de masse d’armes. Ce sont encore des démons, et la représentation sculpturale n’est qu’une traduction plastique de la formule que nous avons rencontrée dans plusieurs incantations : Que les démons mauvais sortent ! Qu’ils se saisissent réciproquement. § 6. — LA SCIENCE DES PRÉSAGES On n’aurait qu’une idée incomplète et insuffisante du rôle et de l’esprit des prêtres chaldéens si l’on se bornait à les envisager comme mathématiciens, astrologues et magiciens. Leur activité scientifique s’exerçait peut-être de préférence dans les sciences divinatoires. Par l’astrologie, ils essayaient, on l’a vu, de deviner l’avenir en interrogeant les étoiles ; là ne se bornèrent pas leurs investigations et leurs procédés de recherches vaines et fatalement infructueuses sur l’éternel problème qui, de minute en minute, se pose, toujours nouveau, devant l’esprit de l’homme. Ils imaginèrent, pour faire parler le sphinx muet de notre destinée, d’interpréter les sonnes, de traduire la grande voix de la foudre et des vents, de chercher dans le murmure ou l’agitation de l’eau, dans le feu, dans les vapeurs de l’air, dans tous les éléments, un secret qui n’y était point renfermé ; ils entreprirent même de le saisir jusque dans les entrailles d’animaux égorgés. Quel dommage que l’esprit supérieurement élevé des docteurs de Babylone se soit déshonoré en s’égarant dans ces aberrations ridicules, et que des siècles fiaient été consumés en recherches puériles, au lieu de profiter à la science vraie dont les bases étaient pourtant et par eux, déjà solidement assises ! Diodore de Sicile signale chez les Chaldéens les quatre procédés principaux de la divination : la science des augures et des auspices cherchés dans l’observation des oiseaux, l’aruspicine d’après les entrailles des victimes, l’explication des prodiges extraordinaires et de toute nature qui se manifestent dans le monde et dans la vie de l’homme ou des animaux, enfin, l’interprétation des songes. D’ailleurs, cette science des présages et des augures avait donné lieu à une foule d’écrits qui formaient une partie de la littérature chaldéo-assyrienne et dont quelques épaves sont arrivées jusqu’à nous. Nous possédons notamment la table des matières de l’un de ces livres[35] qui comprenait vingt-cinq tablettes formant autant de chapitres, quatorze sur les présages terrestres, favorables ou défavorables, et onze sur les augures célestes. Les uns sont des pronostics tirés de la pluie, -des orages et des vents ; dans d’autres, il est question des oiseaux du ciel, clos augures que fournissent leur vol et leurs cris, du murmure de l’eau dans les fleuves, du bruissement des vents dans les arbres. L’état de mutilation de la tablette et la concision des indications qui y sont mentionnées ne nous permettent pas de dire plus longuement ce que contenait ce code de sorcellerie qui formait sans doute le pendant du livre de magie dont nous avons parlé dans le précédent paragraphe. Il est permis de croire que d’importants fragments de la littérature mantique retrouvés dans les fouilles archéologiques dont Ninive a été l’objet, sont clos copies de divers chapitres de ce grand ouvrage qui, sans cesse transcrit, puis traduit en grec, a pénétré, avec les procédés et les recettes qu’il indiquait, jusque dans le monde romain et celui du moyen âge. L’interprétation des songes occupait une grande place dans les éludes des docteurs chaldéens. Dans les tablettes magiques de la bibliothèque d’Assurbanipal, il en est plusieurs qui contiennent de longues énumérations de rêves nocturnes avec les présages qu’on en prétendait tirer. En voici quelques extraits choisis parmi les moins ridicules ou les moins sales ; la tablette étant mutilée, nous ne connaissons pas les conséquences et la signification des songes ainsi énumérés : Si
quelqu’un voit dans son rêve, de la chair de chien à son pied droit... Si
quelqu’un voit une grille de bête à son pied droit... Si
quelqu’un voit de la chair de chien à ses deux pians... Si
quelqu’un croit tomber d’une poutre... Si
quelqu’un voit un chien mort.... Si
quelqu’un, dans son rêve, voit des bêtes sauvages mortes... Si quelqu’un, dans son rêve, croit qu’un chien pisse sur lui... etc.[36] Il est superflu d’insister davantage sur de semblables puérilités qui n’étaient pas, d’ailleurs, l’apanage exclusif des Chaldéens, puisqu’on en trouve d’analogues sous la plume même d’Hérodote. Jamblique[37] nous apprend qu’à Babylone les femmes allaient dormir dans le temple de la déesse Zarpanit (Vénus-Astarté) afin d’avoir des rêves dont les devins tiraient des prédictions pour leur avenir : il y avait aussi des voyants (sabru) qui provoquaient les songes pendant leur sommeil en absorbant des breuvages narcotiques. Dans l’épopée d’Isdubar, nous lisons que les dieux envoient au héros un songe sur l’avis duquel il va consulter Hasisatra. Le caractère fatidique du rêve était si bien admis par les Assyriens qu’on accordait une grande influence aux songes sur les événements politiques eux-mêmes. Nous avons raconté, en leur temps, les visions qui obsédèrent Assurbanipal lors de sa campagne contre Teumman, roi du pays d’Élam, et les avertissements que la déesse Istar lui envoya, pendant la ; nuit ; pour l’éclairer sur la conduite de cette terrible guerre. Lies annales du même prince signalent encore le songe qui détermina Gygès, roi de Lydie, à se placer dans la vassalité du roi d’Assyrie. La superstition des songes, enfin, tient une grande place dans le livre de Daniel qui dut son élévation politique à son habileté merveilleuse à expliquer les rêves de Nabuchodonosor ; le rôle des devins consistait, suivant cet écrit, non pas seulement à donner l’interprétation, mais à reconstituer complètement la vision, et à rappeler les détails d’un songe dont le voyant n’avait plus conservé le souvenir à son réveil. Les Chaldéens, comme la plupart des peuples anciens, connaissaient l’emploi des sorts. Leurs procédés de bélomancie nous sont révélés par un curieux passage d’Ézéchiel que nous avons cité, et dans lequel il est raconté que Nabuchodonosor, incertain s’il irait d’abord contre Tyr ou contre Jérusalem, s’arrête au carrefour de deux routes ; il place des flèches dans un carquois en les mêlant, après les avoir marquées des noms de ses différents ennemis, afin de voir laquelle sortira, et, par suite, quelle ville il doit d’abord attaquer. Un usage analogue existait encore à La Mecque jusqu’à l’arrivée de Mahomet. Les flèches, sans pointes ni pennes, racontent les écrivains musulmans, portant chacune écrit un mot significatif, étaient au nombre de sept, conservées dans la Kâabah, sous la garde d’un ministre spécial. On les mêlait dans un sac au pied de la statue de Hobal, le dieu principal du sanctuaire, et on en faisait le tirage après avoir adressé au dieu cette prière : Ô divinité, le désir de savoir telle ou telle chose nous amène devant toi. Fais-nous connaître la vérité. Si les inscriptions cunéiformes ne nous ont pas encore offert de passage se rapportant à la divination par les flèches, les cylindres en pierre dure et les bas-reliefs nous montrent fréquemment les flèches du sort tenues à la main par Marduk et Istar[38], les planètes Jupiter et Vénus, que les astrologues observaient plus particulièrement et que les Arabes et les Mendaïtes appellent encore, nous l’avons vu, la grande et la petite fortune. La croyance à la baguette magique ou divinatoire qui n’est pas encore complètement déracinée de nos mœurs, est peut-être mi présent des Chaldéens au monde occidental. Cette espèce de bâton ou sceptre court qu’on voit entre les mains du roi, sur les bas-reliefs, n’est autre que la baguette magique, et les textes font fréquemment allusion à sa puissance. On l’appelle qan mamiti, le roseau du sort, et qan pasari, le roseau de révélation ; on trouve aussi dans le texte suméro-accadien gis-zida, le Bâton propice. Allat, la grande déesse des enfers, et par excellence la déesse de la magie et de la nécromancie, est appelée Nin-qis-zida, la dame de la baguette magique. C’est elle que l’on faisait intervenir pour évoquer les morts et se mettre en rapport avec les mânes de parents ou d’amis défunts. Un autre procédé de bélomancie en usage chez les Chaldéens, consistait à lancer arec l’arc, des flèches dans une direction, et à augurer bonne ou mauvaise fortune de la distance plus ou moins grande où elles avaient porté et de la manière dont elles étaient tombées. Des flèches, dit un texte, sont lancées dans la ville et sur ses canaux, loin de la terre[39]. Encore au moyen âge, les Sabiens de Harrân avaient recours au même procédé. Un de leurs prêtres lançait au hasard douze flèches garnies d’étoupes enflammées et prédisait l’avenir d’après leur chute[40]. D’ailleurs les autres peuples orientaux connaissaient ces pratiques de bélomancie, et il nous suffira de rapporter notamment le récit biblique de la visite de Joas, roi d’Israël, à Élisée mourant : Élisée était malade de la maladie dont il mourut ; Joas, roi d’Israël, descendit vers lui, et pleurant devant lui, il lui dit : Mon père, mon père, char d’Israël et son conducteur ! Et Élisée lui dit : Prends un arc et des flèches. Et après lui avoir apporté un arc et des flèches, Il dit au roi d’Israël : Pose ta main sur l’arc. Et quand il y eut posé sa main, Élisée plaça ses mains sur celles du roi. Et il dit : Ouvre la fenêtre de l’Orient. Et il l’ouvrit. Elisée dit : Tire. Et il tira. Et il dit : Flèche de salut de Jéhovah et flèche de salut contre Aram, tu frapperas Aram à Apheq jusqu’à la consommation. Et il dit : Prends les flèches. Et il les prit. Il dit au roi d’Israël : Frappe la terre. Et il frappa trois fois et s’arrêta. L’homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui dit : Si tu avais frappé cinq ou six fois, alors tu aurais frappé Aram jusqu’à la consommation ; mais maintenant, tu ne le frapperas que trois fois[41]. Il nous reste, de la littérature cunéiforme assyrienne, quelques indications qui prouvent que les Assyro-Chaldéens attachaient la plus grande importance au vol et aux ébats des oiseaux dans les airs ; cette superstition avait, comme tant d’autres, son point de départ dans des observations vraies des phénomènes naturels. On avait remarqué que des oiseaux fuient et disparaissent à l’approche de certaines saisons, que d’autres annoncent des changements atmosphériques parleurs cris et leur vol troublé et inquiet : il n’en avait pas fallu davantage pour qu’on appliquât ces augures à des choses qu’ils ne pouvaient annoncer. Nous savons aussi qu’on attribuait une valeur prophétique à l’agitation et au frétillement des feuilles d’arbres ou des buissons, de même qu’en Grèce on avait les chênes parlants de Dodone, et chez les Hébreux, le chêne des devins, près de Sichem. La manifestation de Jéhovah à Moïse dans un buisson ardent, au désert du Sinaï, se rattache au même ordre d’idées. Quant à l’aruspicine, Ézéchiel nous montre Nabuchodonosor consultant le foie des victimes en même temps qu’il a recours à la bélomancie. Quatre fragments du grand traité compilé par Sargon l’Ancien prouvent, d’autre part, que les Chaldéens cherchaient des présages dans les entrailles d’animaux de toute espèce. On y parle de signes observés dans le cœur d’un jeune chien, d’un renard, d’un mouflon, d’un bélier, d’un cheval, d’un âne, d’un bœuf, d’un lion, d’un ours, d’une brebis, d’un poisson, d’un serpent. On tire des indices de l’aspect et de la couleur des intestins des animaux sacrifiés aux dieux Si les
intestins de l’âne — à droite, sont noirs, — à gauche sont noirs, — à droite
sont bleuâtres, et bleuâtres leurs replis, — à gauche sont bleuâtres et bleuâtres
leurs replis, — à droite sont de couleur sombre, — à gauche sont de couleur
sombre, — à droite sent cuivrés. — à gauche sont cuivrés... Si dans
les intestins d’un âne, à droite, il y a comme des empreintes, — inondation. Si dans
un âne les intestins à droite. sont tordus et noirs, le dieu produira de l’accroissement
dans le pays du seigneur ; Si dans
un âne, les intestins, à gauche, sont tordus et noirs, le dieu ne produira
pas d’accroissement dans le pays du seigneur ; Si dans
un âne, les intestins, à droite, sont tordus et..., Raman arrosera le pays du
seigneur. Si dans
un âne, les intestins, à gauche, sont tordus, et..., Raman n’arrosera pas le
pays ; Si dans un âne, les intestins, à droite, sont tordus et bleuâtres, les
pleurs entreront dans le pays du seigneur. Si dans
un âne, les intestins, à gauche, sont tordus et bleuâtres, les pleurs
n’entreront pas dans le pays. Si
l’intérieur de l’intestin, à gauche, offre des fissures, — discordes ; Si
l’intérieur de l’intestin, à droite et à gauche, offre des fissures, — désordres. Si
l’intérieur de l’intestin, à droite et à gauche est noir, — éclipse. On inspectait aussi le foie et les poumons pour examiner le plus ou moins grand développement des lobes, leur atrophie leur couleur ; les collèges chaldéens des aruspices étaient consultés journellement par les rois, comme cela se pratiquait également en Grèce, en Étrurie et longtemps à Rome même. Les pronostics que tiraient les Chaldéens des naissances monstrueuses chez l’homme et chez les animaux nous sont connus par une longue tablette traduite par M. Oppert[42], sur laquelle se trouvent énumérés soixante-douze cas différents de monstruosités chez les enfants en venant au monde. La naissance d’un enfant qui a les oreilles d’un lion assure au pays un roi puissant ; celle d’un enfant qui a les cheveux blancs promet une longue vieillesse au roi ; celle d’un enfant auquel les deux oreilles manquent, est une marque de calamité pour le pays. Tantôt ce sont des prédictions favorables, tantôt des prédictions défavorables qu’annoncent les monstruosités et les difformités bizarres énumérées dans ce singulier document ou observait avec un soin égal les naissances exceptionnelles des animaux : une tablette contient dix-sept cas de naissances monstrueuses de chevaux, avec les présages qu’on en prétendait tirer ; une autre inscription fournit une énumération de naissances de chiens. De tous ces cas de tératologie, les plus significatifs pour les devins de Babylone étaient ceux où la femelle mettait au monde un animal d’une autre espèce : Si une
brebis enfante un lion, les armes seront actives et le roi sans égal. Si une
jument donne naissance à un lion, le roi sera puissant. Si une jument
met au monde un chien, il y aura famine dans le pays. Les chiens jouent un grand rôle dans la mantique chaldéenne. Un texte énumère les conséquences de l’entrée des chiens dans le temple ou le palais : Si un
chien jaune entre dans le palais, le palais sera anéanti. Si un
chien rouge entre dans le palais, le palais sera livré à la dévastation par
l’ennemi. Si un
chien entre dans le palais et blesse quelqu’un, le palais sera livré à la
dévastation. Si un
chien entre dans le palais et se couche dans le lit, le palais, personne
ne... Si un
chien entre dans le palais et se couche sur le trône, le palais sera brûlé. Si un
chien entre dans le palais et se couche sur le palanquin royal, le palais
sera dévasté par l’ennemi. Si un
chien entre dans le temple, les dieux ne seront pas miséricordieux pour le
pays. Si un
chien blanc entre dans le temple, la durée du temple sera stable. Si un
chien noir entre dans le temple, la durée du temple ne sera pas stable. Si un
chien gris entre dans le temple, le temple souffrira dans ses possessions. Si un
chien jaune entre dans le temple, le temple souffrira dans ses possessions. Si un
chien rouge entre dans le temple, les dieux du temple le déserteront. Si les
chiens se rassemblent en troupe et entrent dans temple, personne ne… On sait que les Grecs élevaient dans les temples d’Esculape, des serpents et des chiens guérisseurs pour sucer et lécher les plaies des malades qui avaient recours à l’intervention miraculeuse du dieu. C’est de Babylone que cet usage passe, chez les Grecs : pour les Chaldéo-Assyriens, le serpent est un des emblèmes principaux du dieu Êa ; C’est l’animal prophétique par excellence. Dans la lettre de Jérémie placée à la suite des prophéties de Baruch, il est dit des images des dieux : Des serpents nés de la terre leur lèchent le cœur. L’histoire du dragon de Bel que la Vulgate place à la suite des prophéties de Daniel, a probablement pour fondement réel, des serpents élevés dans un temple babylonien et servant à rendre des oracles, comme cela se pratiquait chez les Grecs et chez les Romains : les charmeurs de serpents ne se rencontrent-ils pas encore de nos jours ? Les nuages avaient, croyait-on, une action directe sur ce qui se passait sur la terre et on interprétait dans un sens mantique leurs formes, leur couleur, leur marche dans le ciel. Si un nuage d’un noir bleuâtre s’élève dans le ciel, — dans le jour le vent soufflera[43]. Tantôt ces présages tirés des nuées étaient relatifs au temps qu’il devait faire, ce qui parait encore aujourd’hui lotit simple et lotit naturel ; tantôt on les faisait agir sur la destinée humaine d’une manière déraisonnable. Les tremblements de terre, les vents et surtout la foudre occupaient une grande place dans les pratiques divinatoires des Chaldéens. Un texte malheureusement mutilé renferme ces lambeaux de phrases suffisamment significatifs : La
foudre des étoiles... La
foudre du dieu Raman... La
foudre de la terre... La
foudre de l’eau... La
foudre de nuit qui brille... La
foudre de l’astre Nanma... La
foudre de l’astre Balum... Les docteurs chaldéens distinguaient deux espèces de foudre : celles qui tombaient sur la terre et traversaient seulement les nuages, venant des trois planètes supérieures, Saturne, Jupiter, et Mars[44] ; c’étaient la foudre des Toiles ; elle annonçait l’avenir ; il y avait ensuite les foudres fortuites qui étaient la voix des grandes puissances de l’atmosphère la foudre du dieu Raman ; et ce dieu est souvent représenté tenant la foudre. Il y avait aussi une divination consistant à jeter certaines substances sur le feu et à tirer des présages de la manière dont elles brûlaient, de l’odeur qu’elles répandaient, de la direction et de l’élévation de la flamme et de la fumée : du cinabre est brûlé sur la flamme, dit un texte magique. Les Chaldéens connaissaient aussi l’hydromancie ou divination par l’eau, la pégomancie ou divination par les sources, la cyathomancie ou lécanomancie, divination par un gobelet ou un bassin rempli d’eau ou de tout autre liquide à la surface duquel on voyait apparaître des images, comme dans le fameux miroir d’encre des devins arabes de nos jours. La Genèse nous montre la divination pratiquée habituellement par Joseph, à l’aide du gobelet qui lui sert à se faire reconnaître de ses frères. Il est quelquefois, dans les documents magiques et mythologiques de la Babylonie et de la Chaldée, parlé de coupes magiques dont la possession est prisée très haut et donne de grands pouvoirs à ceux qui en sont les maîtres, Auchel Psellos en décrit ainsi les procédés : Elle se pratiquait au moyen d’un bassin que l’on avait sous les yeux ; il était rempli d’une eau prophétique. L’eau que l’on verse dans le vase ne diffère point, par essence, des autres eaux analogues ; mais les cérémonies et les incantations que l’on accomplit au dessus du vase qui la renferme la rendent susceptible de recevoir le souffle prophétique. Cette force divine sort du sein de la terre et n’a qu’une action partielle ; lorsqu’elle pénètre l’eau, elle produit d’abord, au moment où elle s’y introduit, un bruit auquel les assistants ne peuvent trouver de sens, puis, répandue dans le liquide, elle y fait entendre certains sons confus, d’où l’on tire des indices pour la connaissance de l’avenir. Ce souffle, appartenant au monde matériel, garde toujours un caractère incertain et obscur, et c’est à dessein que les devins exploitent ces sons légers et confus, afin que, grâce au vague même de ces bruits, ils puissent éviter d’être jamais convaincus de mensonge. On a retrouvé dans des fouilles pratiquées à Hillah, sur le sol même de Babylone, ainsi que dans d’autres localités de la basse Chaldée, un certain nombre de bols magiques pareils à ceux que devaient employer les vieux Chaldéens. Ces vases en terre cuite grossière, ont la forme de calotte hémisphérique, et la paroi intérieure est recouverte d’une inscription magique qu’on devait réciter pour opérer le charme. Les populations du moyen âge qui en faisaient usage étaient les Mendaïtes et les débris des colonies juives qui se sont transplantées sur Ies ruines de Babylone après la destruction de Jérusalem. C’est là encore une des formes les plus sensibles de la persistance des pratiques chaldéennes jusque dans des temps rapprochés de nous. Ce qui contribua par-dessus tout à rendre les docteurs chaldéens populaires après la chute de l’empire de Babylone, c’est leur habileté à construire les thèmes généthliaques. Tout le monde oriental, du temps des Séleucides était attentif à leurs oracles surtout après qu’on eût vu se réaliser leurs prédictions sur Alexandre, sur Antigone roi d’Asie, et sur Seleucus Nicator. Ces succès contribuèrent à populariser avec leur science vraie, leurs méthodes divinatoires : telle fut la cause de la vogue des écrits de Bérose, dont les prédictions excitèrent un tel enthousiasme à Athènes ; qu’on lui éleva une statue sur une place publique et qu’il ouvrit à Cos une école d’astronomie et de science divinatoire. Simon le Magicien, Astrapsycbos, Gobryas et Pazatas deviennent célèbres par leur science des présages ; on les voit qui s’élèvent dans les airs, charment les serpents, évoquent les mânes des morts. Plus leurs miracles sont ridicules et plus ils trouvent de dupes ; tout le monde les consulte, et Aulu-Gelle nous apprend que le père d’Euripide les interrogea pour connaître la destinée de son fils[45]. |