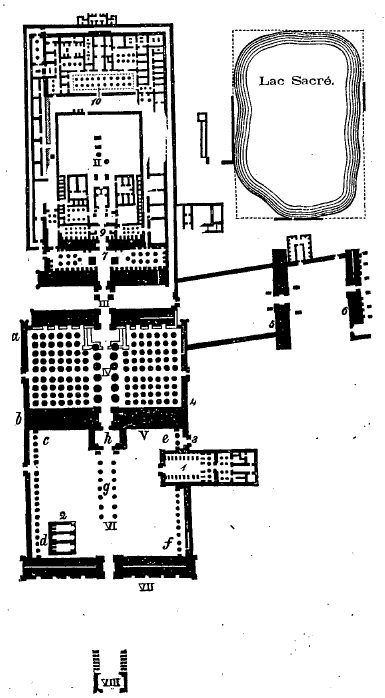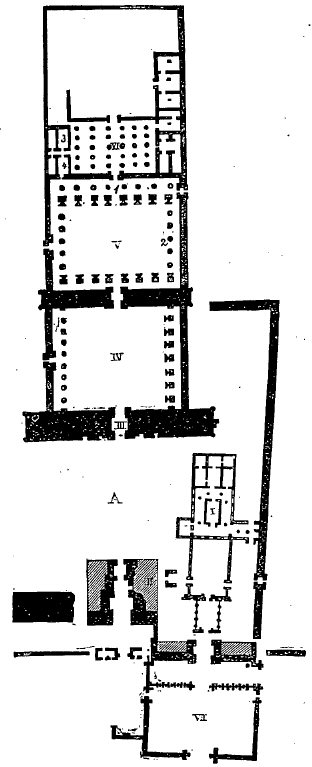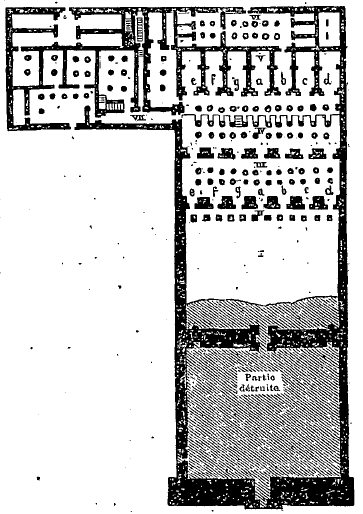CIVILISATION, MŒURS, RELIGION ET ART DE L’ÉGYPTE
CHAPITRE IV — ARTS ET MONUMENTS.
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L’ART ÉGYPTIEN[1]. — ARCHITECTURE. Les Égyptiens ont été, avant les Grecs, celui de tous les peuples de l’antiquité qui a porté les arts plastiques au plus haut degré dé perfection et de grandeur. Les Hellènes seuls sont parvenus à les surpasser. Le génie du peuple égyptien se peint tout entier dans le caractère général de son architecture. Les fils de Miçraïm, comme nous venons de le faire voir, croyaient fermement à l’immortalité de l’âme et désiraient l’immortalité de la matière, dans la pensée que l’âme rentrerait un jour dans son corps. Ils regardaient la vie d’ici-bas comme le prélude d’une existence meilleure. Aussi n’avaient-ils guère soin de l’habitation des vivants, tandis qu’ils déployaient une extrême magnificence dans la demeure des morts. Un peuple ainsi préoccupé de la vie future, un peuple qui a conservé des cadavres plus de quatre mille ans, devait développer dans son architecture là dimension qui assure la solidité de l’édifice et lui présage la durée sans fin. L’immense largeur des bases devait être le trait caractéristique de ses monuments : murs, piliers, colonnes, tout en effet dans la construction égyptienne est épais et court. Et, comme pour ajouter à l’évidence de cette inébranlable solidité, la largeur dés bases est augmentée encore par une inclinaison en talus, qui donne à toute l’architecture une tendance pyramidale. Les pyramides elles-mêmes, celles de Memphis, dont la plus grande est le bâtiment le plus élevé de la terre, sont assises sur une base énorme : elles sont beaucoup moins hautes que larges. Ainsi tous les monuments égyptiens, même ceux dont l’élévation est célèbre, sont cependant plus étonnants encore par l’étendue de leur dimension en largeur, dimension qui les rend et les fait paraître impérissables et éternels. Il faut aussi, pour l’architecture égyptienne comme pour toute architecture, dans la formation de ses caractères essentiels, de sa physionomie prédominante, faire la part de la nature des matériaux qu’elle mettait en œuvre le plus habituellement, que la nature avait placés à sa portée dans la constitution du sol. Toute construction élevée par la main de l’homme a pour supports verticaux des murs, des piliers ou des colonnes ; mais il y a différentes manières de fermer la partie supérieure de l’édifice, c’est-à-dire de couvrir l’espace qui sépare les colonnes ou les murs. Le mode le plus simple, celui qui s’est offert le premier à l’esprit des hommes, consiste à poser sur les supports verticaux des pierres horizontales assez grandes pour réunir deux points d’appui. Quand les supports se touchent et forment des murs, un seul rang de pierre suffit à couvrir l’édifice. Telle est la construction des monuments mégalithiques, dont nous avons parlé en traitant des plus lointaines origines de l’humanité (tome Ier). Quand les supports sont des piliers ou des colonnes, il faut superposer l’un à l’autre deux rangs de pierre. Les pierres du premier rang portent immédiatement sur les points d’appui et par conséquent laissent entre elles des vides (à moins d’être colossales et de toucher à la fois, par une dimension tout à fait exceptionnelle, à quatre piliers) ; les pierres du second rang portent sur les premières et sont juxtaposées de façon à couvrir ces vides, qui sont l’intervalle existant entre deux rangées de colonnes, ou bien entre une rangée de colonnes et un mur. Le bâtiment étant alors couvert en terrasse, le second rang de pierres fait saillie sur le premier, afin d’écarter la chute des eaux pluviales et d’en préserver le pied des colonnes ou le pied du mur. Mais ce système de construction en plates-bandes exigeait des pierres d’une grande portée et d’une épaisseur correspondante ; et tous les pays n’en produisent pas de pareilles. C’est ainsi que l’on fut amené à chercher d’autres combinaisons, pour suppléer à l’insuffisance des matériaux. Ici, comme toujours, la nécessité devint un aiguillon pour le progrès, et les peuples qui étaient obligé des renoncer au système des architraves de pierre et des couvertures en grandes dalles, introduisirent dans l’architecture de nouvelles ressources, d’une incomparable fécondité, en la dotant du moyen de couvrir de grands vides avec de petits matériaux, et d’espacer les supports, non plus selon la grandeur des pierres, mais selon les convenances de l’architecte et la destination du monument. Ce pas immense fut franchi lorsqu’on eut trouvé l’art de construire une voûte. La plate-bande put être alors remplacée par un arc. Au lieu de réunir deux points d’appui avec une pierre d’un seul morceau, on franchit l’intervalle qui les séparait en appareillant des pierres plus petites suivant une courbe. La nature avait mis à la disposition des Égyptiens, dans les montagnes qui bordent les deux côtés de la vallée du Nil, d’admirables pierres à bâtir. Ils n’ont donc jamais éprouvé le besoin de renoncer au système de la construction en plates bandes. Toute leur architecture se compose d’éléments verticaux et horizontaux. Les éléments verticaux, disent MM. Perrot et Chipiez, à qui je ne peux mieux faire que d’emprunter ici leurs excellentes définitions — et je le ferai largement dans ce chapitre — les éléments verticaux sont les supports de dimensions variables. Ils portent les architraves ; celles-ci les relient les uns aux autres. Ceux de petite et de moyenne dimension sont monolithes. Ceux de grandes dimensions sont composés d’assises superposées qui, dans ce cas, prennent le nom de tambours. Sur la surface extérieure des édifices, les supports se développent suivant des dispositions très diverses qui se rapportent toutes au type du portique. A l’intérieur des édifices, dans les salles, les supports résultent en principe d’une nécessité matérielle. Lorsque les pierres de la couverture ne sont pas d’une dimension suffisante pour franchir l’espace compris entre deux murs, on les fait reposer sur des supports ; c’est ce qui arrive pour tout édifice de dimensions un peu considérables. Cette combinaison tout élémentaire suffit aux besoins de la circulation. Plus les rangées de dalles qui composent la couverture sont nombreuses, plus nombreux aussi sont les supports. Ils se multiplient parfois dans une telle mesure, qu’ils affectent cette disposition qui est particulière à certaines plantations faites dans nos jardins suivant un plan régulier, à ce que l’on appelle les quinconces. On ne peut cependant pas dire que la longueur des architraves et des dalles commande rigoureusement le nombre des supports. Des monolithes d’une très grande longueur sont parfois soutenus par plusieurs supports qui soulagent ainsi la très longue portée de ces poutres de pierre, et qui empêchent qu’elles ne cèdent à la flexion, qu’elles ne se rompent sous leur propre poids. Les murs sont assez épais, les supports assez puissants, les architraves assez fortes pour que la couverture, de quelque nature qu’on la suppose, ne soit pour tous ces soutiens qu’une charge légère. Ces dispositions si simples constituent un système de construction complet, qui appartient en propre à l’Égypte, et dont l’emploi a eu des résultats sur lesquels nous ne saurions trop insister. Les architraves et la couverture, étant horizontales, n’exercent sur les murs que des pressions verticales. Il n’y a donc point de force qui tende à pousser les murs vers l’extérieur, ni à déranger l’immobilité des supports. Par conséquent, dès que les proportions des éléments horizontaux et verticaux, leurs sections, comme disent les ingénieurs, ont été convenablement déterminées, l’édifice ne contient en lui-même aucune cause de désordre ; il est dans des conditions d’équilibre parfait. Cet équilibre ne peut être détruit que par des causes physiques tout extérieures, parles intempéries des saisons, par les tremblements de terre, par la main des hommes. L’esprit n’est donc pas trompé par l’impression que produisent sur lui, dès le premier coup d’œil, les lignes extérieures, la silhouette des monuments égyptiens. Cette impression, d’abord tout irréfléchie et spontanée, l’examen et l’étude la confirment en l’expliquant. L’édifice est bâti, comme le disaient les Pharaons eux-mêmes, en pierres éternelles. La stabilité, dans son expression la plus haute et la plus simple, tel est, entre tous, le caractère qui distingue l’architecture égyptienne et qui en fait l’originalité. Le support et l’architrave composent pour ainsi dire à eux seuls tout l’édifice égyptien ; le reste n’est que secondaire. Il en résulte que l’édifice ne comprend aucun de ces appuis qui, dans les édifices construits par d’autres peuples, sont destinés à annuler les effets produits par la combinaison d’éléments moins stables par eux-mêmes. Ces moyens auxiliaires, tels que contreforts et arcs-boutants, s’imposent, au contraire, là où la pression des matériaux ne s’exerce pas tout entière, comme ici, dans le sens vertical, de haut en bas. C’est dans les édifices en pierre que le principe de cet art s’accuse le plus franchement ; mais il se laisse pourtant aussi sentir dans ceux dont le corps est formé de matériaux créés par l’industrie humaine. Ces bâtiments en briques ou en petit appareil font comme la transition entre la construction en grand appareil et la construction compacte, moulée d’un seul bloc en pisé ou terre pilonnée dans des formes de bois. Une couverture lapidaire y serait déplacée ; ils se terminent en général par une terrasse dont le bois fournit les éléments. Dans certains cas, les parties secondaires d’édifices ainsi composés, et même quelques édifices entiers, sont couverts par des voûtes également faites de briques et maintenues par des murs d’une épaisseur convenablement fixée. En effet, quoique l’emploi des monolithes pour couvrir les vides soit général en Égypte, il ne faudrait pas croire que les architectes de cette contrée aient ignoré l’art d’obtenir des couvertures au moyen de matériaux de petite dimension, c’est-à-dire de former des voûtes. Nous avons de nombreux exemples de voûtes égyptiennes, même de voûtes à claveaux, dont quelques-unes remontent à une très haute antiquité, et pourtant, dans la pratique des constructeurs égyptiens, l’emploi de la voûte a toujours gardé un caractère exceptionnel ; malgré les facilités qu’il offrait, il n’a joué, dams-4e développement de l’art, qu’un rôle très secondaire. On n’y a point eu recours pour les édifices auxquels on attachait le plus d’importance ; on s’en est servi surtout dans des parties moins en vue, dans les dépendances intérieures ou souterraines des grands ensembles monumentaux. Ce mode de construction, maintenu dans d’étroites limites, n’a jamais constitué en Égypte un système d’architecture ; il n’a donné naissance à aucune de ces formes accessoires qui en résultent et qui s’y rattachent là où, comme dans notre moyen âge, il est d’un usage constant et frappe tous les regards. L’influence des matériaux sur les formes et le style que les Égyptiens adoptèrent pour leurs monuments a été si considérable qu’à côté de leur architecture de pierre, dont les caractères viennent d’être définis, nous voyons que, dès les temps les plus reculés de l’Ancien Empire, ils avaient une architecture légère de bois dont l’esprit et les principes étaient tout différents, parce qu’elle employait d’autres matériaux. C’était celle des constructions privées, des habitations, et ce qu’elle cherchait avant tout était la sveltesse et l’élancement des formes. Elle procédait par des assemblages savamment compliqués de charpente, dont l’imitation a fourni le système habituel d’ornementation des chambres funéraires et des sarcophages du temps des vieilles dynasties memphites (voyez tome II) ; ou bien elle supportait des architraves de bois sur des colonnettes minces, hautes et d’une extrême légèreté, que couronnaient des chapiteaux sculptés dans le bois ou estampés en métal, conçus de manière à donner à la colonne l’apparence d’une tige végétale surmontée de sa fleur ou de son bouton. Ce sont les formes de ces colonnettes de l’architecture légère de bois, qui, imitées dans l’architecture en pierre et y perdant en grande partie leur sveltesse primitive, ont produit la colonne telle qu’elle commence à se montrer vers la XIIe dynastie et qu’elle devient surtout d’un emploi général avec l’avènement du Nouvel Empire. Le plus élémentaire des supports, le pilier quadrangulaire, avec ou sans base, a été naturellement le premier usité eh Égypte. Nous n’en trouvons pas d’autre dans les monuments de l’Ancien Empire. L’architecture égyptienne, même aux époques de son plus grand luxe, en a toujours conservé la donnée et Tamise fréquemment en usage, en couvrant seulement le pilier de figures et d’hiéroglyphes. C’est ainsi qu’elle a produit ce qu’on appelle le pilier osiriaque, que les monarques de la XIXe dynastie ont si fréquemment employé dans les cours des temples construits par eux à Thèbes. Ce qui caractérise ce pilier, c’est qu’au devant se dresse, adossée à sa masse, une figure colossale debout, qui représente le roi constructeur du monument avec les attributs et la coiffure du dieu Osiri. Cependant, avec le cours du temps et un certain progrès du goût, le désir d’avoir le plus de lumière possible dans l’espace situé en arrière des piliers dans une salle éclairée seulement par l’entrée, et aussi la recherche d’un allégement des formes trop massives, avaient conduit à abattre les angles du support carré. Il fut ainsi transformé en un prisme octogonal, qui se relie au sol par un large socle très bas, en forme de disque. En abattant encore les huit angles, on obtint la colonne à seize pans, dite protodorique, qui est par excellence celle des architectes de la XIIe dynastie, et où, pour faire mieux ressortir l’élégance de la division longitudinale du fût par des jeux d’ombre et de lumière, on prit bientôt l’habitude de creuser légèrement en cannelure chacune des faces. Quel que soit, du reste,, le nombre de ces faces, huit ou seize, elles s’interrompent au-dessous de la ligne de jonction avec l’architrave, de telle sorte qu’au sommet le pilier reste quadrangulaire. On conservait ainsi le souvenir du type original, et l’on obtenait, entre le fût et l’architrave, un élément de liaison qui, par la place qu’il occupe, correspond à ce que les Grecs appelèrent l’abaque. Cette partie supérieure satisfait à la double condition d’offrir une profondeur toujours égale à celle de l’architrave, et de conserver une forme invariable. C’est la persistance de ce plateau carré qui avertit l’œil du changement graduel qu’a subi le support primitif. Faiblement inclinées dans le sens de la hauteur, les faces produisent un ensemble conique : en s’arrêtant au-dessous de l’abaque et de ses angles droits, elles appellent l’attention sur le fût presque circulaire qui naît ainsi du pilier et qui porte en lui-même la preuve irrécusable de la filiation[2]. Dès la XIIe dynastie, à côté de cette colonne prismatique, si simple et si ferme d’aspect, les architectes cherchèrent à essayer dans les supports des formes plus ornées. C’est alors qu’ils commencèrent à introduire dans l’architecture de pierre des données qui jusqu’alors étaient restées propres à l’architecture de bois et avaient été conçues pour elle. La colonnette légère, dit A. Mariette, devient alors pierre, de bois qu’elle était. C’est cette colonnette qui, reniant son origine et cessant d’être elle-même pour devenir comme masse, comme solidité, comme lourdeur, la rivale du pilier, donnera naissance à la grosse colonne fasciculée, au chapiteau en bouton de lotus fermé ou en fleur ouverte, qui commence à se faire voir dans tout son épanouissement à Karnak, à Louqsor et dans les temples des premières années du Nouvel-Empire.
Chez les Grecs, de siècle en siècle la colonne a allongé ses proportions, est devenue plus svelte ; c’est par un chiffre de plus en plus élevé que s’est exprimé le rapport qui représente la hauteur du fût comparée à son diamètre. Chez les Égyptiens la marche a été inverse. A mesure qu’on avance dans le cours du temps, à mesure qu’on s’éloigne de l’époque où la colonne à chapiteau végétal sortit de l’imitation en pierre des sveltes colonnettes de l’architecture de bois, l’origine de la colonne s’oublie ; elle se raccourcit, devient plus lourde, plus trapue, se rapproche davantage de l’esprit du pilier massif. Le progrès dans cette voie sera facilement apprécié en voyant les deux colonnes à chapiteau campaniforme que nous mettons en parallèle, l’une du règne de Râ-mes-sou II, l’autre du règne de Râ-mes-sou III. Mais où la marche de l’architecture égyptienne est la même que la marche de l’architecture classique, c’est quand le goût de la décadence ne se contente plus des types de colonnes et de chapiteaux qui ont régné à la grande époque. Pour obtenir dés effets nouveaux et variés, on a recours alors à des combinaisons où s’ajoutent les uns aux autres, non sans surcharge, des motifs dont chacun avait eu jusqu’alors son existence séparée et son rôle distinct. Dans la série des types égyptiens, comme le remarquent justement MM. Perrot et Chipiez, les chapiteaux du temps de Nakht-neb-f (XXXe dynastie), à Philæ, occupent ainsi une place analogue à celle que l’on assigne, dans la série des ordres gréco-romains, au chapiteau composite des derniers siècles de l’antiquité. Si les formes des supports, piliers et colonnes, offrent des types assez divers, en revanche, rien n’est moins varié que la modérature égyptienne. Ce n’est point, comme en Assyrie, par la nature des matériaux que s’explique cette uniformité ; à la différence de la brique, le granit, le grès et le calcaire se seraient prêtés à fournir les saillies elles creux, d’où résultent ces beaux jeux d’ombre et de lumière que présentent les moulures grecques. La vraie raison de cette indigence il faut la chercher dans l’habitude prise de couvrir d’une décoration sculptée et peinte presque toutes les surfaces de l’édifice. Les moulures auraient risqué de couper, d’une manière désagréable, ces tableaux qui se succèdent, par registres superposés, depuis le haut jusqu’en bas du mur. En présence de cette riche ornementation multicolore, l’œil était satisfait ; le décor lui semblait achevé et complet[3]. La seule moulure employée, celle qui surmonte tous les édifices, est celle que l’on appelle la gorge égyptienne. Dès l’Ancien Empire l’architecte avait trouvé cette belle corniche, dont la franche saillie termine si bien ces constructions massives. Cette corniche se compose de trois éléments, toujours associés dans le même ordre. C’est d’abord un tore, autour duquel semblent s’enrouler des rubans qu’a tracés le pinceau. Ce tore sert à encadrer, sur leurs quatre côtés, les grandes surfaces murales ; il donne aux arêtes des murs plus de fermeté et d’accent. Dans le sens vertical, il indique à la fois la fin du mur et le commencement de la corniche. Au-dessus de lui commence à se dessiner, en s’évasant à son sommet, une courbe sillonnée de canaux ; c’est la gorge proprement dite. Cette courbe est surmontée d’une étroite bande plate, au-dessus de laquelle l’œil n’aperçoit plus que le bleu du ciel. Il y a là des contrastes habilement ménagés. Tandis que la concavité de la gorge se remplit d’ombre, la lumière frappe le bandeau terminal, et fait ainsi ressortir les longues lignes du couronnement. Nous étudierons brièvement un peu plus loin les dispositions ordinairement données aux tombeaux et aux temples, les deux principales classes de monuments de l’architecture égyptienne, les seules du moins dont il soit parvenu jusqu’à nous assez de spécimens pour nous les faire connaître d’une manière complète. Mais ce dont il faut dès à présent parler, dans cette esquisse sommaire et générale de l’art de bâtir dans l’antique civilisation de la vallée du Nil, c’est de la conception toute particulière qu’il avait adoptée pour la façade extérieure de ses édifices. La donnée en est toujours la même. La porte s’y ouvre au centre entre deux puissantes tours, beaucoup plus hautes qu’elle, tours aux murs en talus et infiniment plus développées en largeur qu’en hauteur, offrant en façade une vaste surface à la décoration sculpturale. C’est cette disposition à laquelle les Grecs ont donné le nom de pylône, que les modernes ont adoptée à leur exemple. Quand une porte s’ouvre dans un mur d’enceinte, isolément de tout édifice, elle a toujours un caractère monumental et dépasse notablement en élévation la crête de la muraille. Quelquefois même elle prend encore plus d’importance et est enveloppée d’un massif pareil aux tours latérales des pylônes, mais unique ; c’est ce que les Grecs ont appelé un propylon. Pylônes et propylons étaient, au moins dans les occasions de fêtes, garnis par devant de grands mâts dressés et munis de banderoles. Les obélisques placés debout en avant, aux côtés de la porte principale du pylône extérieur des temples, étaient comme deux de ces mâts, rendus permanents et exécutés en pierre. L’obélisque, cette longue poutre quadrangulaire et monolithe, taillée dans le granit, dressée debout et surmontée d’un pyramidion que revêtait primitivement une enveloppe de métal doré, constitue un type monumental exclusivement propre à l’architecture égyptienne. La forme en a été dictée par une intention symbolique et est en rapport direct avec le culte du dieu Soleil, ainsi qu’avec celui de l’Ammon générateur. Sous l’Ancien Empire, il est question d’obélisques dressés isolément et surmontés d’un disque ou d’une sphère de métal, comme monuments religieux existant d’une manière indépendante et complete en eux-mêmes. Quelquefois l’obélisque ainsi isolé était placé sur un massif en forme de pyramide tronquée, couronnée d’une vaste plate-forme. Sous le Nouvel Empire, et déjà du temps de la XIIe dynastie, il n’est plus question de rien de semblable. Les obélisques deviennent exclusivement des accessoires des grands édifices du culte. Ils ne vont plus que par couples, en avant du premier pylône des temples, un de chaque côté de l’entrée. Les grands obélisques subsistants ont de 20 à 33 mètres de hauteur ; mais les inscriptions parlent de certains de ces monuments qui auraient atteint 40 et 50 mètres. Dans les carrières de granit rosé de Syène on voit encore un obélisque qui est resté inachevé. Les Romains enlevèrent d’Égypte un grand nombre d’obélisques pour les dresser dans leurs cirques et sur leurs places. Les empereurs byzantins firent de même pour la décoration de Constantinople et de Thessalonique. Enfin, de nos jours, Paris et Londres ont voulu avoir chacune son obélisque, apporté à grands frais des rives du Nil. Celui de Paris, qui occupe le centre de la place de la Concorde, est un de ceux que Râ-mes-sou II avait élevés devant la façade du grand temple de Louqsor ; sa hauteur est de 23 mètres 57. Quelque haut que l’on remonte en Égypte, observent MM. Perrot et Chipiez, on n’y trouve pas l’appareil que les Grecs ont appelé cyclopéen ; on n’y trouve pas de murs qui soient bâtis, comme ceux de Tirynthe, en quartiers de rocs, en blocs énormes et bruts, aux interstices remplis, tant bien que mal, par de petites pierres. On n’y trouve même pas l’appareil polygonal ; nous entendons par là des murs formés de blocs travaillés au ciseau, mais dont la section verticale, sur les faces visibles, présente partout des joints irréguliers, de telle façon qu’il n’y ait pas, l’une auprès de l’autre, deux pierres de même hauteur et de même forme. En Grèce et en Italie, les acropoles les plus anciennes présentent toutes les variétés de ce système ; mais, en Égypte, les pierres sont toujours disposées par lits horizontaux ; seulement il arrive souvent que les joints montants ne sont pas tous perpendiculaires à la direction générale de l’assise ; beaucoup sont obliques et plus ou moins inclinés. On rencontre aussi, de place en place, des pierres qui dépassent la rangée dont elles dépendent et qui s’engagent, en faisant une sorte de crochet, dans celle du dessus ou dans celle du dessous ; mais ces accidents, tout en frappant l’œil, n’empêchent pas la direction générale des assises de rester sensiblement parallèle au sol. C’est par exception seulement que l’on a l’occasion d’admirer, dans les monuments égyptiens, soit le soin et la perfection du travail, soit la grandeur des matériaux. A ce point de vue, les œuvres de l’Ancien Empire sont généralement supérieures à celles des époques plus récentes. Rien n’égale, comme habileté professionnelle, le jointoiement des dalles de granit ou de calcaire qui revêtent plusieurs des chambres et des couloirs des pyramides de Gizeh. C’est ainsi qu’à plus d’un égard l’Égypte des premières dynasties a donné des exemples qui n’ont été suivis que de très loin par les générations suivantes. Ce qui, plus tard, a donné aux Égyptiens l’habitude de se satisfaire à meilleur marché, c’est, d’une part, la quantité prodigieuse d’édifices que les grands rois thébains ont fait élever à la fois, depuis le fond de la Nubie jusqu’aux plages de la Méditerranée ; c’est, d’autre part, l’usage d’étendre sur toutes les surfaces, en dehors comme en dedans des édifices, le voile d’une riche décoration polychrome. On était toujours pressé ; c’était à peine si les bras suffisaient aux tâches que l’on avait entreprises ; pourquoi aurait-on allongé le travail en s’appliquant, avec une patiente minutie, à dresser des joints qui devaient être cachés ? Le stuc et la peinture ne se chargeraient-ils pas de dissimuler toutes les imperfections ? On ne rencontre donc pas, dans les édifices égyptiens, certaines combinaisons d’appareil qui ont leur élégance et où se sont complu d’autres peuples constructeurs, ceux qui laissent apparent le nu de la pierre. Vous ne trouverez point ici le contraste d’un bossage plus ou moins saillant avec la ciselure d’une bande lisse qui borde le joint ; vous n’y trouverez pas l’alternance de blocs placés les uns en carreaux et les autres en boutisses ; surtout vous y chercheriez en vain cette régularité des assises, cet aplomb rigoureux des joints, cette perfection de la taille et de la pose qui font qu’un pan de mur des fortifications de Messène, même séparé de l’ensemble auquel il appartient, a sa noblesse et sa beauté propres. A Thèbes, l’ouvrier, comptant sur la complicité de l’enduit, se contente d’un à peu près. C’est encore pour le même motif que les Égyptiens ne se sont pas attachés, d’ordinaire, à l’emploi de très grands matériaux. Comme le prouvent leurs obélisques et leurs colosses, ils ont su tirer dé la carrière, amener à pied d’œuvre et mettre en place des blocs énormes ; mais ils ne se sont imposé cet effort que lorsqu’ils y avaient quelque intérêt. Fallait-il s’astreindre à hisser péniblement des pierres d’un très gros volume et d’un maniement difficile, pour qu’ensuite le stuc vînt empêcher l’œil du spectateur d’apprécier la difficulté vaincue ? Dans les édifices thébains les plus soignés, les dimensions des pierres de taille ne dépassent guère celles qui sont usuelles dans notre pratique. On n’a guère été au delà de ces proportions que pour les linteaux et les architraves. Dans le grand pylône de Karnak, les linteaux étaient formés par des poutres de pierre qui dépassent 8 mètres de long. Dans la salle hypostyle, les architraves de la nef centrale avaient au moins 9 m. 20. L’architecte égyptien n’éprouvait donc aucun embarras à l’idée d’avoir à couvrir les vides au moyen de monolithes dont la longueur et le poids auraient un caractère tout exceptionnel ; mais il ne recherchait pas ces occasions, comme on l’a fait chez d’autres peuples ; il n’y mettait aucune affectation, aucune coquetterie. Les voyageurs qui débarquent en Égypte se figurent souvent qu’ils vont voir partout se dresser devant eux d’énormes fûts monolithes ; vous les surprendriez fort en leur disant que les colonnes gigantesques des salles hypostyles ne sont pas d’un seul morceau. Dès qu’ils seront arrivés à Thèbes, ils reconnaîtront leur erreur. A Karnak et à Louqsor, à Médinet-Abou et au Ramesséum, partout enfin, les colonnes sont faites de tambours superposés ; souvent même, quand elles sont de grand diamètre, chacun de ces tambours est composé de plusieurs pièces. C’est sous la domination romaine que l’on a volontiers façonné des colonnes monolithes ; presque toutes celles qui présentent d’assez grandes dimensions appartiennent à cette époque. Même remarque pour ce qui concerne les procédés et la qualité de la construction. On peut citer quelques exemples de belle et savante facture ; il n’en est pas moins vrai que l’appareil a pour caractère à peu près constant un laisser-aller qui va parfois jusqu’à la négligence la plus choquante. Les fondations sont insuffisantes ; il faut descendre jusqu’aux temples ptolémaïques, tels que ceux d’Edfou et de Dendérah, pour en trouver qui s’enfoncent jusqu’à 5 ou 6 mètres de profondeur. Les édifices pharaoniques sont plutôt posés sur la surface que solidement enracinés dans le sol. Mariette expliquait l’écroulement des édifices de Karnak, moins par les ravages des hommes et par la violence des tremblements de terre que parles défauts de la construction, et par l’imprudence que les architectes avaient commise en ne plaçant pas le pied de leurs murs à une assez grande hauteur au-dessus du niveau des crues. Depuis bien des siècles, Karnak est atteint, chaque année, par les infiltrations du Nil, dont les eaux saturées de nitre corrodent le grès. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut prévoir le temps où, d’éboulements en éboulements, la magnifique salle hypostyle, par exemple, verra céder sous un dernier effort la base de ses colonnes déjà rongées plus qu’aux trois quarts et s’abattre sur elles-mêmes, comme se sont abattues les colonnes de la cour de l’ouest. Au temps où fut bâti Karnak, il existait en Égypte des monuments vieux de 10 à 15 siècles, qui pouvaient servir de points de repère ; on aurait dû, ce semble, tenir compte d’un phénomène aussi facile à observer que l’était l’exhaussement graduel du fond de la vallée. Cependant le manque de prévision n’a rien de surprenant ; ce qui étonne davantage, c’est le peu de soin avec lequel les architectes paraissent avoir dressé leurs plans, ou le peu de peine qu’ils ont pris pour contraindre les ouvriers à s’y conformer scrupuleusement. Sauf dans les cas exceptionnels, dit A. Mariette, les constructeurs égyptiens sont loin d’avoir montré cette précision dont on leur fait si souvent honneur. Il faut avoir mesuré, le mètre en main, les temples et les tombeaux de l’Égypte pour savoir combien de fois les deux murs opposés d’une même chambre ne sont pas d’égale longueur. C’est encore aux savants auteurs de l’Histoire de l’art dans l’antiquité que j’emprunterai leurs judicieuses remarques sur les caractères essentiels de la décoration sculptée et peinte qui revêt toutes les surfaces des édifices de l’Égypte, et joue un rôle si capital dans le système de son architecture. Il y a dans la décoration égyptienne union, intime et constante de deux éléments qui, chez d’autres peuples, restent souvent séparés. Le premier, c’est l’emploi de la peinture pour diversifier l’aspect des surfaces et pour distinguer, par les oppositions et les nuances des tons, les différents membres de l’architecture ; c’est ce que l’on a pris l’habitude d’appeler la polychromie. Le second, c’est la peinture s’appliquant à introduire partout la représentation de la vie et s’emparant, à cette fin, du moindre champ que lui offre le parement du mur, soit le fût de la colonne. Le décorateur ne se contente pas d’user des jeux de la couleur pour faire valoir les formes de l’édifice et pour en relever l’effet ; il entend s’en servir aussi pour tracer, pour multiplier, pour conserver les images des objets qui occupent sa pensée. Pris dans son ensemble, l’édifice présente aux regards une suite de tableaux qui font corps avec la pierre. Du sol jusqu’à la corniche, sur le pilier comme sur la muraille, ils la couvrent d’une fresque sans fin. C’est comme une tenture continue, une brillante tapisserie à personnages, qui garnit toutes les parois et qui enveloppe tous les supports ; sans voiler, sans effacer aucun des grands traits de l’architecture, elle habille de son simple et brillant tissu la construction tout entière. En Égypte comme en Chaldée et en Assyrie, comme en Grèce et en Italie, comme dans tous les pays méridionaux, la décoration polychrome s’explique par la qualité même du jour et par la manière dont il affecte nos organes visuels. Plus la lumière est intense, plus l’œil trouve de plaisir à l’intensité et à la variété des couleurs... Sous un soleil ardent et toujours resplendissant, les objets placés au premier plan, s’ils sont d’un ton neutre, ne s’enlèvent pas sur le fond, et les ombres, comme dévorées par la diffusion et la réverbération d’une incomparable lumière, perdent une partie de leur valeur. En Égypte, une colonne, une tour ronde, une coupole paraissent presque plates. Les tons chauds et variés que la polychromie permet de donner aux édifices aident à les distinguer des terrains et à faire saisir la différence des plans ; ils compensent aussi, dans une certaine mesure,la perte subie par les contours que ne dessinent plus des ombres bien accusées ; par les contrastes de couleur, ils attirent l’attention sur les lignes dominantes et ils avivent les arêtes ; ils font saillie sur le mur, le bas-relief et les ornements qui le décorent. Dans les édifices exposés à cette lumière aveuglante des pays où le soleil est sans nuages, la polychromie est un secours pour le regard ; elle lui donne une perception plus nette de ce que l’on peut appeler les articulations de ces grands corps de pierre. Elle n’est d’ailleurs pas particulière à l’Égypte ; mais l’Égypte a été la première à l’employer dans de riches et vastes constructions ; elle en a fait un usage plus constant et plus général qu’aucun autre peuple ; elle a plus hardiment poussé le principe jusqu’à ses conséquences dernières. Ce qui est propre à l’Égypte, c’est l’habitude qu’elle a tout d’abord prise de semer des figures sur toutes les surfaces de la construction, quelle que soit la forme de ces surfaces, quelle que soit la fonction remplie par le massif auquel elles appartiennent. Sur le fût tournant de la colonne, sur le nu du mur, ces figures se multiplient et se développent à l’infini, tant que monte le pilier, tant que s’allonge la paroi ; dès que le compose la dimension du champ, elles s’y étagent en plusieurs registres, qui d’ordinaire sont de même hauteur. Ces registres ne sont d’ailleurs séparés les uns des autres que par de légers filets qui indiquent, pour chaque groupe, la ligne de terre sur laquelle posent les pieds des personnages. Il n’y a aucun lien, aucun rapport sensible entre la construction et le décor ; en haut et en large, registres et figures chevauchent, d’une assise sur l’autre, comme au hasard, sans se préoccuper des joints qui les coupent. Ces joints, dira-t-on, n’étaient pas visibles avant que les siècles eussent émietté et fait tomber le stuc qui, surtout dans les édifices en calcaire ou en grès, cachait partout autrefois le nu de la pierre. Sans doute ; mais, même sous le climat de l’Égypte, l’architecte pouvait-il, devait-il compter qu’une mince couche d’enduit résisterait à l’action des années aussi longtemps que la pierre qu’il recouvrait ? N’y a-t-il pas une sorte de contradiction entre le principe de l’architecture égyptienne et celui de cette décoration ? L’architecte semble n’avoir qu’un but et qu’une pensée, assurer, à ses constructions une stabilité absolue, une durée indéfinie, et tout l’effet du riche décor dont il les revêt peut être compromis par la chute d’une légère pellicule de stuc, par l’écartement des pierres, que ne manqueront pas de déranger les tassements de l’appareil et les tremblements de terre. Quand les édifices étaient dans
toute la fraîcheur de leur nouveauté première, cette décoration devait avoir
beaucoup d’éclat et de charme : Que le pinceau seul eût tracé ces images sur
la paroi lisse ou qu’il fût venu recouvrir et compléter l’œuvre du ciseau,
toutes ces figures, répandues par milliers dans toutes les parties de
l’édifice, mêlées à des inscriptions qui étaient elles-mêmes des tableaux en
raccourci, parées des tons les plus vifs et les plus gais, amusaient l’œil
par la variété de leurs couleurs et par la diversité des scènes qu’elles
représentaient. Malgré son ampleur et son brillant, ce système a deux graves
défauts. Le premier, c’est la fragilité de l’enduit. A vrai dire, c’est sur
cet enduit, et non sur la pierre, qu’était appliqué le décor, semblable à une
somptueuse tenture étendue sur tout l’édifice. Or, pour reprendre et
continuer la comparaison, une fois que l’enduit s’est détaché, vous n’avez
plus la tenture elle-même, mais seulement ce qu’on peut appeler le dessous et
l’envers de l’étoffe. Sans doute, avec un peu d’attention, vous y devinez le
dessin, vous y distinguez les couleurs ; mais quelle différence entre cette
sorte de reflet incertain et l’aspect harmonieux et franc que présentait
l’endroit de la tapisserie, avant que les fils en eussent été tachés, ternis
et comme, arrachés brin à brin, avant que la trame eût presque partout
disparu ! L’autre inconvénient du système, c’est l’uniformité, c’est une certaine monotonie et une certaine confusion dans la richesse ; c’est surtout l’absence de ces contrastes que la Grèce saura ménager entre les parties nues ou décorées de simples moulures et les espaces choisis où le statuaire disposera, dans les cadres que lui aura préparés l’architecte, une sculpture qui pourra, grâce à la beauté de la matière, se passer du secours de la couleur. Dans le temple grec, les figures prendront d’autant plus de valeur que l’attention sera plus appelée sur elles par la limitation même de la place qui leur aura été réservée. Elles seront taillées dans des blocs séparés, et ceux-ci, soigneusement rattachés à l’appareil, n’en feront pourtant pas partie intégrante ; ces figures ne risqueront donc pas d’être coupées en deux par l’écartement des joints, que le stuc, en s’écaillant, aura mis à découvert. Quoique merveilleusement adaptées à la place qui leur aura été destinée, quoique liées étroitement à l’édifice, aussi bien par le sujet qu’elles représenteront que par la manière dont elles seront encadrées dans la construction, elles garderont cependant, si l’on peut ainsi parler, leur fortune à part, leur indépendance personnelle. A prendre la décoration dans son ensemble, l’art grec n’y fera pas entrer autant de figures ; mais il saura mieux en ménager l’effet, en assurer la conservation et en garantir la beauté contre les injures du temps. L’Égypte a donc le mérite d’avoir deviné la première l’obligation qu’une vive lumière impose à l’architecte de donner, au moyen de la couleur, plus de tenue et d’accent aux lignes de l’édifice ; elle a fort bien compris le parti qu’elle pouvait tirer de la différence et de la clarté des tons, pour distinguer les uns des autres les membres de la construction et pour en défendre le contour contre l’éblouissement du plein soleil. En ce sens, on peut dire qu’elle a fait de la polychromie l’emploi le plus judicieux et le plus brillant. Par contre, elle a dépassé le but en couvrant toutes les surfaces, sans distinction ni choix, d’une figuration continue. Ce décor, elle n’a pu l’obtenir si fourni et si varié que par l’emploi d’un procédé qui en compromettait la durée. Ce n’est pas tout : elle a méconnu l’utilité des repos et la nécessité des contrastes ; elle ne s’est pas aperçue que les figures, en se multipliant, finissent par perdre leur valeur, par lasser le regard et fatiguer l’esprit. § 2. —CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L’ART ÉGYPTIEN. —SCULPTURE En racontant, dans le livre précédent, les annales de l’Égypte, nous avons indiqué les principales époques de sa sculpture et les traits essentiels qui les caractérisent : la première phase de développement entièrement libre et tourné surtout vers une exacte imitation de la nature, sous les dynasties primitives ; la première apparition d’un canon fixe des proportions et d’une tendance à un style conventionnel, vers la XIIe dynastie ; l’apogée de la grandeur solennelle et religieuse, avec une part de convention de plus en plus grande, sous la XVIIIe et le commencement de la XIXe dynastie ; la décadence absolue qui commence à la fin du règne de Râ-mes-sou II ; enfin la dernière renaissance sous les rois Saïtes. A dater de ce moment, la sculpture égyptienne est comme figée dans cette immobilité absolue qui frappa tant Platon et les autres Grecs. L’art n’est plus qu’un ensemble de procédés qui se transmettent dans les ateliers, par l’enseignement et par la pratique ; c’est une routine, où l’habileté de l’exécution peut être poussée très loin, mais sans qu’il y ait jamais dans l’œuvre rien de personnel. On ne songe même plus à regarder et à consulter la nature ; on sait que la figure humaine doit être divisée en tant de parties ; on sait que, pour représenter tel ou tel dieu, il convient de lui prêter telle ou telle attitude et tels ou tels attributs ; on sculpte donc la statue commandée, d’après une recette confiée à la mémoire. L’art égyptien a pris, pour ne plus jamais le perdre, un caractère tout conventionnel. À plus forte raison en est-il de même au temps de Diodore de Sicile ; les sculpteurs que cet historien vit travailler à Memphis et à Thèbes, sous le règne d’Auguste, taillent une statue comme on fabrique aujourd’hui, chez un constructeur, les différentes pièces d’une machine, avec une précision rapide et une sûreté de main qui sont de l’ouvrier plutôt que de l’artiste. Ils ne cherchent plus ; on a trouvé pour eux, il y a des siècles, l’exacte mesure et la proportion la plus heureuse[4]. Une circonstance toute particulière à l’Égypte et à l’histoire du développement de ses croyances a largement contribué à pousser la sculpture des dynasties primitives dans la voie d’un réalisme vivant, que n’a connu au même degré l’art archaïque d’aucun autre peuple. C’est qu’elle travailla d’abord presque exclusivement à faire des portraits pour les tombeaux. J’ai exposé plus haut ce qu’était la conception du ka, dans les idées de l’Égypte primitive sur l’autre vie, de ce double subtil de l’homme, qui persistait après la mort du corps matériel et qui avait besoin d’un point d’attache, d’un appui corporel pour ne pas s’évanouir dans les ténèbres de sa demeure souterraine. J’ai dit comment on s’étudiait alors à assurer sa permanence en lui fournissant dans la tombe, en outre de la momie, des sortes de corps de rechange sous forme de statues iconiques du défunt. On comprend dès lors, dit M. Maspero, pourquoi les statues égyptiennes qui ne représentent pas des dieux sont toujours et uniquement des portraits de tel ou tel individu, aussi exacts que l’artiste a pu les exécuter. Chacune de ces statues était un corps de pierre, non pas un corps idéal où l’on ne chercherait que la beauté des formes ou de l’expression, mais un corps réel à qui l’on devait se garder d’ajouter ou de retrancher quoi que ce fût. Si le corps de chair avait été laid, il fallait que le corps de pierre fût laid de la même manière, sans quoi le double ne trouverait pas le support qui lui convenait. La première statue égyptienne, disent MM. Perrot et Chipiez, fut donc moins une œuvre d’art qu’un décalque de la réalité, qu’une sorte de moulage pris sur nature... On copia, dans le bois ou dans la pierre, la figure de celui que la persistance de cette effigie devait aider à lutter contre l’anéantissement. Son attitude ordinaire, son costume et ses traits, on devait tout imiter avec une sincérité scrupuleuse, de telle manière que ce fût un autre lui-même qui prît sa place dans la tombe. Pour arriver à cette équivalence du modèle et de l’épreuve que l’on en tirait, l’artiste ne pouvait s’en rapporter à sa mémoire ; il fallait que l’original posât devant le sculpteur qui se chargeait d’immortaliser sa personne. La plupart de ces images, les plus soignées tout au moins, ont dû être exécutées du vivant de celui qu’elles représentent ; autrement le statuaire n’aurait jamais produit ces effigies en présence desquelles vous sentez et vous affirmez que ce sont des portraits, sur chacun desquels tout contemporain, sans hésiter, aurait mis tout d’abord un nom, tant les traits et l’expression du visage sont empreints d’un caractère particulier et vraiment unique, vraiment individuel. Plus tard, nous l’avons dit, cette conception du ka perdit son importance primitive, et sans s’effacer entièrement, passa au second plan, par suite de la naissance de conceptions plus hautes et plus raffinées de l’âme humaine. Il en résulta une modification dans les rites funéraires, qui eut bientôt une influence décisive sur la marche de l’art et le laissa sortir de la voie où il s’était jusqu’alors tenu. On ne s’inquiéta plus de multiplier, comme on l’avait fait aux périodes florissantes de l’Ancien Empire, les statues iconiques des particuliers dans leurs tombeaux. La sculpture, désormais, travailla principalement pour la glorification des dieux et des rois. Ce sont leurs images qu’elle tailla surtout dans la pierre et le bois. Elle n’eut donc plus pour première préoccupation le désir de faire un portrait bien réel ; elle se mit à chercher l’idéal et dans cette recherche elle tendit à s’éloigner de la nature. C’est ainsi que chaque jour davantage elle glissa dans la convention. Comment l’art égyptien y fut invinciblement conduit, les auteurs de l’Histoire de l’art dans l’antiquité l’expliquent de la manière la plus exacte et la plus heureuse. Toute œuvre d’art est une interprétation de la nature. Prenons par exemple la figure humaine. Dans un même temps, chez un même peuple, elle est partout sensiblement la même : il n’y a pourtant pas deux artistes originaux qui la voient des mêmes yeux ; celui-ci en saisira certains aspects et certaines qualités, et il laissera dans l’ombre ce que celui-là, pourtant son contemporain, mettra le plus en lumière. L’un s’attachera surtout à la beauté de la forme ; l’autre fera surtout ressortir les accidents de la couleur ou la puissance expressive de la passion et de la pensée. L’original ne changera pas ; les traductions seront plus diverses. Déjà très marquées d’un maître à l’autre, ces différences seront encore plus accusées si l’on compare l’art des différents peuples, l’art égyptien à l’art assyrien ou à l’art grec, l’art ancien à l’art moderne. Si les œuvres nées dans un même pays et dans un même siècle présentent de grandes ressemblances, c’est que leurs auteurs, compatriotes et contemporains, regardent les objets, si l’on peut ainsi parler, à travers les mêmes verres, teints des couleurs de leur génie national ; ils portent dans l’étude de l’éternel modèle, qui change si peu, les mêmes penchants, les mêmes préoccupations, les mêmes préjugés. Pourtant, chez les peuples bien doués, dans les sociétés où l’art tient une grande place, il se forme des groupes, simultanés ou successifs, que l’on appelle les écoles ; chacun de ces groupes, en consultant à nouveau la nature, prétend l’interpréter plus fidèlement que ne l’ont fait s’es prédécesseurs, en tirer des types qui répondent encore mieux aux désirs et aux goûts du public pour lequel elle travaille. Entre les ouvrages de ces différentes écoles, il y a bien des rapports de similitude, qui s’expliquent par l’identité de race et de croyances ; mais il y a aussi des diversités qui tiennent, soit aux variations du milieu, soit à l’influence personnelle de tel ou tel homme supérieur. Tant qu’il naît des écoles, l’art vit ; il est en mouvement et en progrès ; mais tôt ou tard il vient un moment où cette ardeur s’épuise et tombe. La société s’est lassée ; elle vieillit, et, comme une eau qui baisse insensiblement, sa puissance créatrice diminue. Or, avant que se soit trahie cette fatigue, dans les derniers jours de force et de maturité féconde, il arrive souvent qu’une riche et brillante école traduise avec clarté, par un ensemble de formes bien choisies et bien liées, les sentiments qui tiennent le plus au cœur de ses contemporains et les idées qui leur sont le plus familières et le plus chères. Si cette traduction est de tous points satisfaisante, à quoi bon en chercher une autre et risquer de trouver moins bien ? se dit une paresse qui n’est au fond qu’un aveu déguisé d’impuissance. Cette expression plastique des plus hautes pensées de la race, on l’accepte donc comme définitive. Dès lors, la convention régnera en souveraine maîtresse. La convention, en ce sens, c’est donc un système de partis pris qui dispense l’artiste de recourir au témoignage de la nature. Une pareille révolution ne s’accomplit pas en un jour ; ce n’est pas en un jour qu’un art arrive à se figer et à s’immobiliser ainsi dans une sorte d’habileté toute mécanique. A mesure qu’un peuple vieillit, la part de la convention va toujours augmentant dans son art comme dans sa littérature. Chaque grand siècle, chaque grande école lègue aux générations suivantes des types qui ont fait sur le goût une vive impression et qui s’imposent à l’imagination. Plus on va, plus ces types sont nombreux et brillants, et plus il est difficile, de se soustraire au prestige de leur beauté, d’échapper à leur influence, on pourrait presque dire à leur tyrannie. Une société ne réussit à s’en affranchir, dans une certaine mesure, que lorsqu’elle est profondément renouvelée par l’infusion d’un sang étranger ou par de grands mouvements philosophiques et religieux, c’est ce ; qui est arrivé pour la société occidentale, dans les premiers siècles dé notre ère, par l’établissement du christianisme, par les invasions des barbares et par la chute de l’empire romain. La société égyptienne, grâce surtout aux conditions très spéciales du milieu qu’elle habitait, a su maintenir, avec une ténacité tout exceptionnelle, l’originalité de son génie et de ses institutions principales. Après chaque invasion et chaque bouleversement, elle s’est mise aussitôt à reformer ses cadres et à renouer la chaîne de ses vieilles traditions. Malgré bien des mélanges, le fond de la race est resté le même jusqu’aux derniers jours de l’antiquité ; les éléments hétérogènes ont été absorbés et se sont fondus dans la masse sans laisser de traces apparentes. Les idées que ce peuple se faisait de la destinée humaine ont pu se développer et se teindre, suivant les âges, de couleurs un peu différentes, sans que jamais il soit sorti de ces variations une religion véritablement nouvelle, comme le bouddhisme est sorti du brahmanisme, comme le christianisme a succédé au paganisme. Chaque fois qu’une dynastie active et puissante a chassé l’étranger, mis fin au morcellement et rétabli l’unité, son œuvre a eu tous les caractères d’une restauration ; ce que l’on se proposait, c’était de refaire, dans toutes ses parties, un régime resté cher à l’orgueil national. Arrivée si tôt à une civilisation qui fut longtemps unique au monde, c’était dans son passé, dans ce passé si plein et si glorieux, que cette société cherchait l’idéal qu’elle s’obstinait à poursuivre au milieu de tous les obstacles et de tous les malheurs ; elle regardait toujours eu arrière vers ses premiers souverains, qui lui apparaissaient transfigurés par l’éloignement et que rendait toujours présents à sa mémoire la perpétuité du culte qu’elle leur avait voué. Toute restauration s’inspire d’un respect plus ou moins superstitieux et plus ou moins aveugle pour ce passé que l’on a l’ambition de recommencer... Chacune de ces dynasties qui remettait l’Égypte sur pied réparait les temples à demi détruits et relevait sur leurs piédestaux les statues des dieux ou celles des ancêtres qu’avait renversées la rage du barbare ; quand elle voulait ériger de nouveaux temples et de nouvelles statues, la première pensée de ses artistes ne devait-elle pas être d’étudier les monuments anciens et de tâcher de les égaler ? Sans doute, tant que l’Égypte conserva du ressort et de la vitalité, les besoins de l’heure présente et les influences du dehors introduisirent certains changements, soit dans la disposition des édifices, soit dans le modelé, dans le mouvement et dans l’expression des figures. On ne copia pas seulement les types antérieurs ; mais on ne put résister à la tentation de s’en rapprocher, d’y chercher tout au moins un point de départ pour les tentatives où l’on s’engageait, pour les progrès que l’on avait en vue. Bâtiments et statues, il fallait tout assortir, tout raccorder avec ce qui subsistait encore de l’œuvre des générations d’autrefois ; il en résultait nécessairement qu’à chacune de ces reprises, c’était par l’imitation que l’on débutait. L’école qui se fondait acceptait de confiance, dans une certaine mesure, les dispositions architecturales auxquelles sa devancière s’était arrêtée, ainsi que sa manière de comprendre la nature. N’est-ce pas dire que dès le premier moment, il devait y avoir dans tous ses ouvrages, une part de convention ? A chaque nouvelle renaissance, cette part ne pouvait que s’augmenter. Aux formes et aux procédés d’interprétation que l’on avait reçus de ses devanciers, on en ajoutait d’autres que l’on transmettait à sou tour. Après chaque recul ou du moins après chaque pause de l’art, quand on voulait se remettre en marche, le poids du passé se faisait sentir de plus en plus lourdement. D’une part, ceux des éléments les plus anciens qui s’étaient ainsi perpétués avaient conquis, par le fait même de cette transmission et de cette adoption plusieurs fois répétée, un prestige et une autorité qui les plaçaient au-dessus de la discussion ; d’autre part, de siècle en siècle, ce legs de principes admis et de traditions imposées allait toujours en grossissant ; de plus en plus, il gênait, il supprimait la liberté de l’artiste. Lorsque, par la décadence du peuple, eut baissé la force qui permettait de ressaisir, au moins dans le détail, quelque indépendance et quelque initiative, il vint une heure où la convention s’étendit à tout, comme un de ces rituels qui règlent toutes les paroles et jusqu’aux gestes de l’officiant. Quand Platon visita l’Égypte, les écoles de sculpteurs n’étaient plus, comme nous dirions, que des conservatoires ; ses élèves très dociles et d’une grande adresse de main y recevaient de leurs maîtres et y transmettaient à leurs successeurs tout un ensemble de préceptes et de recettes qui s’appliquaient à tous les cas et qui ne laissaient aucune place à l’imprévu. Il ne faut pas l’oublier, d’ailleurs, la sculpture égyptienne, même aux époques primitives où elle cherchait avec un accent de naturalisme incontestable la réalité individuelle du portrait, a toujours été empreinte d’un esprit de symbolisme et d’hiéroglyphisme, pour ainsi dire, qui devait la conduire forcément à la convention hiératique en même temps qu’il lui a donné un accent de grandeur solennelle et monumentale. Elle semble toujours se rappeler sa première destination, alors qu’elle tentait ses premières ébauches dans le ténébreux passé des générations antérieures à Mena, destination qui fut d’exprimer des idées religieuses et d’en être l’écriture imagée. Jetez les yeux sur une statue égyptienne, même sur une de celles de l’Ancien Empire : les formes y sont accusées d’une manière concise, abrégée, non pas sans finesse, mais sans détails. Les lignes en sont droites et grandes. L’attitude est raide, imposante et fixe. Les jambes sont le plus souvent parallèles et jointes. Les pieds se touchent, ou bien, s’ils sont l’un devant l’autre, ils suivent la même direction, ils restent aussi exactement parallèles. Les bras sont pendants le long du corps ou croisés sur la poitrine, à moins qu’ils ne se détachent pour montrer un attribut, un sceptre, la croix ansée, une fleur de lotus. Mais dans cette pantomime solennelle et cabalistique, la figure fait des signes plutôt que des gestes ; elle est en situation plutôt qu’en action, car son mouvement prévu, et en quelque sorte immobile, ne changera plus ; il ne sera suivi d’aucun autre. Cependant cet art égyptien, qui semble retenu par certains côtés dans une éternelle enfance, est un art essentiellement grand, majestueux, hautement formulé. Il est majestueux et grand par l’absence du détail, dont la suppression a été voulue et préméditée. Gravée en bas-relief ou sculptée en ronde bosse, la figure égyptienne est modelée, non pas grossièrement, mais sommairement ; elle n’est point dégrossie comme une ébauche ; elle est au contraire finement dessinée, d’une simplicité choisie dans ses lignes et dans ses plans, d’une délicatesse élégante dans ses formes, ou pour mieux dire, dans ses formules algébriques. Deux choses y sont évidentes et évidemment volontaires : de tout temps, le sacrifice des petites parties aux grandes ; surtout à partir de l’avènement du Nouvel Empire, la non imitation de la vie réelle. Nue, la figure est vue comme à travers un voile ; vêtue, elle est serrée dans une draperie collante, semblable à un second épiderme, de sorte que le nu se découvre quand il est voilé, et se voile quand il est découvert. Les muscles, les veines, les plis et les contractions de la peau n’y sont pas rendus, ni même la charpente osseuse. La variété qui distingue les êtres vivants, et qui est l’essence de la nature, est désormais remplacée par une symétrie religieuse et sacerdotale, pleine d’artifice et de majesté. Tous les mouvements exécutés par plusieurs figures sont soumis au parallélisme des membres doubles et paraissent obéir à un certain rythme mystérieux, qui a été réglé dans le sanctuaire. Le plus sûr moyen d’expression dans l’art égyptien, est, en effet, la répétition. Quels que soient le naturel et la souplesse d’un mouvement, il devient cérémonieux quand il est répété intentionnellement et plusieurs fois d’une manière identique, ainsi que nous le voyons si souvent dans les sculptures de l’antique Égypte. Elle appartient à l’ordre des choses sublimes, cette répétition persistante qui fait de toute marche une procession, de tout mouvement un emblème religieux, de toute pantomime une cadence sacrée. Le style égyptien est donc monumental parle laconisme du modelé, par l’austérité des lignes et par leur ressemblance avec les verticales et les horizontales de l’architecture. Il est imposant parce qu’il est une pure émanation de l’esprit ; il est colossal, même dans les plus petites figures, parce qu’il représente la foi qui ne doit point varier ; enfin le style égyptien procède en partie d’un principe autre que l’imitation, et c’est volontairement qu’il s’écarte de la vérité imitative ; car la faculté de rendre fidèlement la nature n’était pas plus étrangère aux Égyptiens qu’aux Grecs, et la preuve en est dans la vérité que présentent quelquefois les figures d’animaux, comparées à la manière convenue et artificielle dont la figure humaine est exprimée, aussi bien que dans les œuvres des écoles primitives mises en regard avec celles qui ont été produites depuis la XIIe dynastie et surtout depuis la XVIIIe, c’est-à-dire depuis l’établissement définitif du canon fixe des proportions du corps de l’homme. Quand il modèle la tête humaine, le sculpteur égyptien l’imite avec plus de fidélité que le corps, et il montre bien ce qu’aurait pu être sou imitation dans un art qui fût resté libre. Avec quelle force est exprimée la conformation de chacune des races que les artistes ont voulu représenter ! Jamais aucun autre peuple, dans les œuvres de son art, n’a aussi bien rendu la vérité ethnographique. Est-il besoin d’insister sur la tendance au symbolisme, dominante dans la sculpture égyptienne, alors que tant de figures nous y offrent la combinaison monstrueuse de corps humains avec des têtes d’animaux ? En montrant aux yeux, a fort bien dit Raoul Rochette, un corps d’homme surmonté d’une tête de lion, de chacal ou de crocodile, l’Égypte n’eut certainement pas l’intention de faire croire à la réalité d’un être pareil ; c’était une pensée qu’elle voulait rendre sensible plutôt qu’une image vraie qu’elle prétendait offrir. Le mélange des deux natures était là pour avertir que ce corps humain servant de support à une tête d’animal était une pensée écrite, la personnification d’une idée et non pas l’image d’un être réel. Autant devons-nous dire de la combinaison inverse, de celle qui, réunissant à un corps de lion une tête d’homme, de bélier ou d’épervier, donne, naissance à l’androsphinx, au criosphinx et à l’hiéracosphinx, et crée une infinité d’autres monstres symboliques, à quelques-uns desquels la crédulité populaire en vint à attribuer une existence effective dans les pays lointains dont les voyageurs racontaient tant de merveilles et de fables. Ce dernier genre de combinaisons, du reste, nous le rencontrerons chez d’autres peuples, dans l’art des Chaldéens et des Assyriens, d’où il a passé même chez les Grecs, tandis que l’idée de placer, dans une intention de symbole, une tête d’animal sur les épaules d’un corps humain, est restée toujours exclusivement propre à l’Égypte. Ainsi, on peut le dire, la sculpture égyptienne demeura une forme de l’écriture, un art essentiellement symbolique, et ce fut une raison de plus pour qu’elle s’immobilisât de bonne heure. Le symbole fut pour ce grand art ce qu’étaient pour les morts embaumés les aromates qui les conservaient ; il le momifia, mais, en le momifiant, il le rendit incorruptible. Ajoutons que la statuaire égyptienne a toujours, pendant la longue durée de son existence, été renfermée dans certaines conditions assez étroites, qui ont nécessairement influé sur son style, par la nature des matières qu’elle travaillait et par celle des outils qu’elle avait à sa disposition. C’est un sculpteur habile, M. Emile Soldi, qui, éclairé par son expérience d’artiste praticien et l’ayant appliquée à l’étude des sculptures égyptiennes, a le premier appelé l’attention des savants sur ce côté capital de la question[5]. Dès les temps les plus reculés de l’Ancien Empire, les sculpteurs, cherchant l’indestructibilité pour leurs œuvres, se sont attachés à les exécuter dans les pierres les plus dures, le granit, la diorite, le basalte, dont sont déjà faites les statues de Kha-f-Itâ. Ces matières, de nos jours encore, c’est à grand peine si on parvient à les entamer et à les tailler à l’aide de ciseaux d’acier de la meilleure trempe ; encore le travail est-il très lent et très pénible ; on est obligé de s’arrêter à chaque instant pour aiguiser à nouveau le ciseau, qui s’émousse sur la roche, et pour retremper l’instrument. Mais l’Égypte de l’Ancien Empire, tout le monde est d’accord sur ce point, ne connaissait pas le ciseau d’acier. Le fer lui même, bien que les Égyptiens l’aient possédé, à partir d’une certaine époque, n’a été chez eux que d’un emploi singulièrement restreint ; des superstitions religieuses en repoussaient l’usage. C’est le bronze qui était le métal dont on faisait les outils. Et jamais on n’a pu prouver que les Égyptiens, non plus qu’aucun autre peuple de l’antiquité, aient su donner au bronze une trempe qui lui assurât une dureté analogue à celle de l’acier. Ce prétendu secret perdu de la métallurgie, dont on a beaucoup parlé, mais sans fondement solide, la science moderne l’a vainement cherché ; elle n’est point parvenue à la découvrir. Du reste, ce n’est que par exception, et sur des monuments du Nouvel Empire, que l’on a signalé dans la pierre dure ces crêtes vives et droites que donne le travail du ciseau, en quelque métal qu’il fût fabriqué. Les statues de ces matières résistantes, et en général toutes celles des époques les plus anciennes, portent la trace manifeste de l’emploi de tous autres procédés, et le mérite de les avoir reconnus appartient à M. Soldi. En principe, dit-il, c’est surtout par le martelage ou le frappage à plat que l’on taille le plus facilement le granit. On se sert d’abord d’un gros outil nommé pointe, que l’on fait entrer dans la matière, pour qu’ensuite celle-ci, sous les coups répétés du marteau qui frappe sur la pointe, se fende et se détache par éclats. Cette pointe, outil des plus simples, est l’instrument qui nous semble avoir le plus longtemps et le plus souvent servi aux Égyptiens, non seulement à tailler et à dégrossir les blocs, mais aussi à détailler la coiffure et à creuser des hiéroglyphes. Naturellement cet outil né peut tracer des sillons nets et fermes, comme le ferait le ciseau, et nous retrouvons bien le caractère propre du travail qu’il produit dans ces lignes éclatées et irrégulières que nous constatons sur beaucoup de monuments du Louvre. L’outil qui vient ensuite, dans la série de ceux qu’on emploie aujourd’hui, est la boucharde, sorte de marteau dont la tête est formée d’un assemblage de pointes disposées symétriquement. La boucharde, pour nous servir d’un terme technique, dresse assez bien le travail, et nous ne pouvons donner de meilleur exemple de ses effets que la bordure de nos trottoirs. Mais, outre que la boucharde est d’une fabrication compliquée, nous ne la voyons figurée sur aucun monument égyptien. Aussi doutons-nous fort qu’elle ait été connue jadis en Égypte. Il n’en devait pas être de même de la marteline, sorte de hachette à deux tranchants. On s’en sert toujours comme d’un marteau en frappant à plat ; la matière éclate en morceaux plus ou moins petits, suivant la grandeur et le poids de l’outil et la volonté du travailleur ; on peut arriver ainsi à préciser la forme assez vite et assez loin pour ne pas avoir besoin de ciseau. L’usage en a dû être fréquent en Égypte, quoique la forme ait pu varier ; la plus grande partie des monuments sont finis à l’aide de ce seul instrument... Avec des outils tels que ceux que nous avons indiqués, le polissage était nécessaire, et on le comprend, pour regagner tous les éclatements de la pierre ; il était la terminaison forcée du travail ; aussi les Égyptiens polirent-ils toutes les surfaces des statues. En même temps le polissage, par cela même qu’il augmentait l’intensité de la couleur de la pierre et qu’il offrait aux yeux des nuances de tons variés, quoique sévères, était en harmonie avec le goût des Égyptiens pour la polychromie. Ce goût était tellement prononcé chez eux que, toutes les fois qu’ils se servirent de pierre calcaire ou de terre cuite, ils prirent soin de les peindre et de les émailler, et qu’ils firent de même pour les monuments de pierre dure ayant de très grandes dimensions. Les Égyptiens ne paraissent pas avoir connu la lime, ni la râpe, variété de la lime aujourd’hui très employée ; nulle part on ne remarque les incisions sèches que donnent ces outils. Pour les grandes surfaces unies, il est probable que les sculpteurs se servirent de planches à main et frottèrent du grès écrasé sur la pierre, en versant de l’eau par un trou percé au milieu de la planche. » Des pierres aplaties pouvaient remplacer ces disques de bois. Afin de donner à certaines parties un poli plus brillant, ils durent aussi employer l’émeri. Celte substance se trouve en abondance dans plusieurs des îles de l’Archipel ; s’ils ne l’en avaient pas reçue par l’intermédiaire des navigateurs phéniciens, les artistes de l’Égypte n’auraient pas pu, comme ils l’ont fait au moins dès la XIIe dynastie, graver sur pierres fines. Quelques ouvrages de basalte de la XXVIe dynastie présentent la trace incontestable de remploi du ciseau d’acier trempé dans le découpage du contour de leurs hiéroglyphes. L’Égypte pouvait alors l’avoir reçu des Asiatiques ou peut-être des Grecs. Mais à cette époque même l’usage en fut très restreint. Et en tout cas, c’est toujours à l’aide de la pointe et de la marteline que l’on a commencé et conduit très loin le travail. Dans les figures de grande proportion, qui ont été largement ébauchées par ces moyens, le poli n’a pas toujours réussi à faire disparaître complètement les creux que des outils sans finesse avaient laissés dans la pierre, là où le praticien avait frappé trop fort. Les bas-reliefs des hypogées, qui montrent des sculpteurs à l’ouvrage, font assister aux deux opérations principales qui viennent d’être mentionnées, le taillage de la pierre par la pointe et le polissage des surfaces. M. Soldi inclinerait à croire que ce fut, au moins dans le commencement, avec des outils de pierre plutôt qu’avec des outils de métal que les Égyptiens attaquèrent les matières dures. Il a lui-même, dit-il, taillé plusieurs granits de dureté différente avec un silex commun des environs de Paris ; il a de même entamé la diorite, soit en détachant de petites parcelles, soit en pulvérisant finement la surface à l’aide du jaspe. Ce mode de travail, dit-il, est excessivement long, et le jaspe, quoique plus dur que la diorite, est fortement gâté par la pierre ; mais en somme, l’exécution d’une statue par ce procédé n’est pas impossible, si extraordinairement pénible et lente qu’elle soit. J’ajouterai que mes observations personnelles en Égypte m’ont permis de reconnaître que l’emploi des outils de pierre par les sculpteurs et les carriers égyptiens avait été général et beaucoup plus prolongé qu’on ne serait porté à l’imaginer. A l’entrée de toutes les tombes creusées dans les flancs des montagnes, on trouve à pied d’œuvre de véritables amoncellements d’éclats de silex, travaillés parla main de l’homme, qui sont manifestement les débris des pointes et des ciseaux de pierre avec lesquels a été entamée la roche calcaire, et qui, brisés pendant le travail, ont été jetés au rebut. Lés mêmes fragments s’observent avec la même abondance dans les galeries des mines de cuivre et de turquoises du Sinaï, où les marteaux employés paraissent aussi avoir été de pierre pour la plupart. Enfin, dans les carrières de granit de Syène, j’ai pu constater que le travail habituel avait consisté à délimiter les blocs que l’on voulait détacher de la masse au moyen d’une rainure profonde, taillée en attaquant la matière avec des outils de pierre, rainure dans laquelle on forçait ensuite des coins de bois, que l’on arrosait pour les faire gonfler et faire éclater longitudinalement la roche sous l’effort de leur dilatation. Il ne subsiste donc de doute que sur un seul point, celui de savoir si les sculpteurs, pour tailler le granit, employaient plutôt la pierre que le métal ; quant à la forme et au maniement de leurs outils, le témoignage des représentations plastiques s’accorde avec les inductions que l’on peut tirer de l’examen intrinsèque du travail des monuments. Malgré toute la dextérité d’ouvriers très appliqués à leur tâche, et qui ne comptaient pas les heures, il y avait toujours quelque chose d’inégal et de violent dans l’effet d’instruments plus contondants que perçants et tranchants. Les défauts des matières et l’imperfection des procédés ont eu une double conséquence : pour ne pas risquer de briser sa figure au moment même où il cherchait à la dégager du bloc, l’artiste a dû l’alourdir outre mesure ; il a dû multiplier les appuis et se garder, avec un soin constant, de tout évidement et de tout amincissement ; en même temps, pour corriger les irrégularités et les défauts d’une ébauche faite à tour de bras, par un outil capricieux et brutal, il s’est trouvé contraint d’effacer ou tout au moins de trop atténuer, sous les rondeurs et les luisants du poli, les détails et les accents de la forme vivante. On n’a pas de peine à comprendre avec quelle rigueur s’imposait à la statuaire égyptienne cette nécessité de réserver partout des supports et de grandes épaisseurs de pierre. Tout d’abord, dit M. Soldi, la tête offrait, par son emmanchement avec le corps, un des principaux dangers : le cou, plus faible que les autres parties, risquait de ne pas résister aux chocs répétés du marteau, frappant à grands coups sur la pointe qui façonnait la tête. Aussi les sculpteurs eurent-ils soin, toutes les fois qu’ils le purent, de coiffer leurs figures du klaft, dont les barbes tombent sûr la poitrine, formant ainsi, des deux côtés du visage, comme deux larges étais. Dans les cas où la tête est nue, les cheveux sont réunis en une forte masse, qui consolide le cou, en lui donnant un soutien jusqu’aux épaules. Exagérée d’une façon toute particulière, si la barbiche descend toute droite jusqu’au thorax, c’est pour servir de tenon. En même temps, on l’a modifiée dans sa forme, pour supprimer la difficulté qu’aurait causée l’extrémité, qui, comme on le voit dans les peintures, se redresse en finesse et est dégagée du cou.... La coiffure, quelquefois très haute et très mince, est toujours soutenue par derrière dans presque toute sa largeur. Toute la figure elle-même est appuyée par le dos ou par le côté à un pilier plus ou moins épais. Cet appui lui donne de la solidité ; il diminue la quantité de matière à enlever. Entre les deux jambes, dont l’une se projette en avant, disent à leur tour MM. Perrot et Chipiez, entre les bras tombant le long du corps et le creux des hanches, l’ouvrier n’a point évidé la pierre, comme l’eût conseillé la libre imitation de la vie. Rien ne lui eût été plus facile, avec un instrument aussi simple que le violon, qui permet d’opérer sans secousse les percements nécessaires ; mais il en ignorait certainement l’usage. Pour détacher les membres il lui aurait fallu frapper à la volée tout autour, et l’ébranlement qu’il aurait ainsi imprimé à la masse aurait risqué de rompre jambes ou bras : en un certain sens, les matériaux les plus durs sont aussi les plus cassants et les plus fragiles. Si le sculpteur, tout en maintenant les membres rapprochés du corps, n’a pas réussi à les faire sortir tout entiers de cette matière où ils restent comme emprisonnés, combien il lui eût été plus difficile ou, pour mieux dire, plus impossible encore de les présenter dans des mouvements très vifs, dans des mouvements tels que ceux de la course par exemple ou du combat ! L’intérêt et la beauté de ces mouvements n’échappaient pas à l’œil de l’artiste ; c’est par impuissance que la statuaire a donc laissé au bas-relief et à la peinture le plaisir et le soin de les rendre. Voici d’ailleurs qui confirme, d’une manière indirecte, la justesse de ces observations : le ciseau, lorsqu’il avait affaire à des matières moins rebelles, changeait d’allures ; il s’affranchissait de plusieurs des conventions auxquelles paraissent asservis les sculpteurs qui façonnent les images colossales des Pharaons. Dans les statues de bois, pas de pilier qui serve d’appui ; les jambes sont séparées, les bras ne touchent point au corps, mais sont souvent très librement fléchis. Nous en dirons autant du bronze ; il donne des figures aussi libres et aussi dégagées que le fait le bois. Dans les statues en calcaire, il n’en est pas tout à fait de même ; on n’avait pas d’instrument commode pour évider la pierre ; de plus, on pouvait être tenté d’imiter l’aspect de ces statues en pierre dure qui devaient passer pour les chefs-d’œuvre de l’art national. La figure est souvent adossée à un pilier auquel les jambes adhèrent par derrière ; mais parfois aussi le pilier est supprimé, et la variété des attitudes devient plus grande. Ce qui achève la démonstration, ce sont tous ces ouvrages de tabletterie et d’orfèvrerie qui appartiennent à ce que l’on appelle communément les arts industriels. La figure de l’homme et celle de l’animal y sont employées, comme éléments décoratifs, avec un goût exquis et une liberté charmante ; elles s’y groupent de la manière la plus imprévue ; pas de mouvement, si vif qu’il soit, qui ne fournisse un motif à l’imagination de l’artiste. Si les qualités qui nous frappent ici ne se rencontrent pas au même degré dans l’art officiel et monumental de l’Égypte, c’est donc que là les outils et la matière ont exercé sur la marche et sur le style de la statuaire une influence décisive, une influence qui a empêché les heureux dons du génie égyptien de porter tous leurs fruits. Cette influence s’est fait sentir non seulement dans la raideur et la monotonie des poses, mais aussi dans le caractère du modelé... Chaque chose y’est à sa place, mais en gros, comme si la figure était vue de loin, à la distance où les détails s’effacent et ne frappent plus le regard... C’est que le sculpteur s’était épris du granit ; dès lors, même quand il travaillait la pierre tendre, son faire s’est de plus en plus rapproché de celui qu’exige et qu’impose la pierre dure. Seul le ciseau donne ces accents justes et fins sans lesquels il n’y a pas de sculpture parfaite ; or il ne pouvait guère servir que pour la figure de bois ou de calcaire. La statue de granit ou de basalte, très imparfaitement ébauchée avec des outils qui obéissaient mal à la main, ne se terminait qu’à force de grès ou d’émeri, roulant, tout humide, sous le galet ou sous la planchette du polisseur ; or allez donc demander des finesses à un instrument aussi grossier ! Il émoussera toutes les arêtes, il aplatira, il arrondira toutes les surfaces ; ce n’est qu’au prix de bien des sacrifices qu’il vous permettra d’obtenir l’apparence trompeuse d’une exécution satisfaisante. L’art sculptural de l’Égypte antique se trouve donc incontestablement emprisonné dans certaines conditions matérielles et techniques qui lui fermèrent plusieurs des voies du progrès où les Hellènes ont su s’avancer avec tant de succès. Mais les statuaires égyptiens eurent le rare mérite de savoir accepter franchement ces conditions, d’en combiner les nécessités avec les exigences de l’esprit de symbolisme dont ils étaient pénétrés, et de tirer de cette combinaison un système raisonné et voulu dont nous avons cherché tout à l’heure à expliquer, en la définissant, la grandeur et l’accent solennel. § 3. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L’ART ÉGYPTIEN. — PEINTURE La peinture n’a guère été employée par les Égyptiens que d’une manière décorative, pour accompagner et rehausser l’architecture et la sculpture, qui sont toujours coloriées. Cependant on rencontre quelques petites stèles en bois où les sujets sont seulement peints, souvent avec une extrême finesse et une grande recherche de style, ou bien des tombeaux dont la roche ne se prêtait pas à l’exécution de délicates sculptures et dont les parois intérieures ont été revêtues d’un enduit peint. Ce n’est guère que sous la XIIe dynastie que l’on commence avoir cette substitution d’une décoration peinte aplat au bas-relief colorié ; elle présente alors ses chefs-d’œuvre les plus parfaits dans les hypogées de Béni-Hassan. Le système se continue dans une grande partie des tombes thébaines du Nouvel Empire et produit encore à cette époque des ouvrages fort remarquables, mais dont aucun n’égale certains morceaux du Moyen Empire. Cette peinture égyptienne est toujours, du reste, sculpturale et conçue absolument d’après les principes du bas-relief. C’est en modelant la statue et en ciselant le bas-relief, disent excellemment MM. Perrot et Chipiez, que l’artiste a pris les partis et adopté les conventions qui donnent au style égyptien son caractère à part et son originalité. Quand, au lieu de faire saillir l’image sur le nu du mur, il se contente de la dessiner à plat et d’en remplir le contour à l’aide de la couleur, cette légère différence de procédé ne change rien au mode dé représentation dont il a fait choix, à sa manière de comprendre et de traduire la forme vivante. Ce sont les mêmes qualités et les mêmes défauts ; c’est la même pureté de lignes et la même noblesse d’allure, c’est le même dessin à la fois juste et sommaire, avec la même ignorance de la perspective et le même retour constant d’attitudes et de mouvements consacrés par la tradition. La peinture, à vrai dire, n’est jamais devenue en Égypte un art indépendant et autonome. Employée d’ordinaire à compléter l’effet du modelé, dans la statue et dans le bas-relief, elle ne s’est jamais affranchie de cette subordination ; elle n’a jamais cherché les moyens de rendre, à l’aide de ressources qui lui fussent propres, ce que la sculpture ne saurait exprimer, la profondeur de l’espace, le recul et la diversité des plans, la variété des teintes que la passion répand sur le visage de l’homme et, par suite, les différents étals par lesquels passe son âme suivant la nature et l’intensité des sentiments qui la pénètrent et qui la remuent. Ce n’est même que par une sorte d’abus des termes que nous parlons de peinture égyptienne. Il n’y a pas de peuple qui ait étendu, sur la pierre ou le bois, plus de couleurs que ne l’a fait le peuple égyptien ; il n’y en a pas qui ail eu un plus juste sentiment de l’harmonie des couleurs ; mais jamais il n’a su, par des dégradations de ton, par des louches juxtaposées ou superposées, rendre l’aspect que nous offrent, dans la réalité, les surfaces sur lesquelles se porte poire regard, aspect que modifient sans cesse le plus ou moins d’épaisseur de l’ombre, l’état de l’atmosphère et la distance. Ce que nous appelons clair-obscur et perspective aérienne, ils n’en ont pas le moindre soupçon.
Poser les tons les uns auprès des autres, sans transitions qui les relient, des tons entiers et plats, c’est faire de l’enluminure, ce n’est pas peindre, dans le vrai sens du mot ; aussi le peintre n’était-il, à proprement parler, qu’un artisan. L’artiste, c’était le dessinateur, c’était celui qui, pour les peintures comme pour les bas-reliefs, traçait au crayon rouge, ou au pinceau chargé de noir, sur la paroi, les contours des personnages et des ornements ; on ne saurait trop admirer, pour la hardiesse et la liberté du trait, certaines de ces esquisses, où, par suite de l’inachèvement des travaux, la couleur n’est jamais venue recouvrir. et cacher les lignes de l’ébauche[6]. On en a des exemples particulièrement remarquables, dans plusieurs des salins des tombeaux d’Amon-hotpou III et de Séti Ier, à Thèbes. C’est à ce dernier hypogée que nous empruntons un groupe qui offre, avec une vérité ethnographique merveilleuse, les types des trois grandes races que les Égyptiens, comme nous l’avons déjà dit, admettaient dans l’humanité, en dehors d’eux-mêmes. Ces esquisses, qui pour la sûreté du trait, sans hésitations ni repentirs, la pureté du dessin, la fière et libre allure, peuvent rivaliser avec les décorations des vases peints des Grecs, ont été exécutées à main levée, sans emploi de patron découpé ni de décalque. Un artiste français, M. Paul Durand, s’en est assuré en calquant tous les portraits de Séti Ier dessinés au pinceau de cette manière dans les parties inachevées de sa tombe, et en superposant les calques ainsi obtenus. Il n’en est pas deux dont les traits coïncident exactement, malgré la fidélité avec laquelle l’artiste a toujours reproduit la même effigie. On trouve quelque chose des qualités distinctives de ces esquisses dans les vignettes au trait qui accompagnent le texte dans quelques-uns des plus soignés parmi les manuscrits sur papyrus du Livre des Morts. Le dessin des contours une fois exécuté par le dessinateur, ainsi que nous venons de le dire, lorsque aucun accident n’empêchait de compléter le décor, le peintre ou l’enlumineur arrivait, avec sa palette et ses pinceaux, pour remplir ce contour. Sa tâche était des plus aisées ; il n’avait qu’une précaution à prendre, celle de bien étendre sa couleur et de ne pas dépasser le trait qui circonscrivait la figure. Les tons des carnations et des draperies, étaient fixés d’avance, ainsi que ceux des différents objets, qui revenaient plus ou moins souvent dans ces tableaux. §4. — PRINCIPAUX MONUMENTS[7]. — LES PYRAMIDES
[Cliquez ici pour avoir un plan agrandi du site de Gizeh] La disposition des deux autres pyramides est analogue à celle de la pyramide de Khoufou ; seulement leur maçonnerie n’offre aucun vide et les chambres qu’elles renferment sont taillées dans le roc. La seconde diffère par sa hauteur de la première, et cette différence est rendue plus sensible par l’élévation du rocher sur lequel la première est assise ; sa construction intérieure est aussi loin d’égaler en beauté celle de la grande pyramide. Elle avait été élevée pour recevoir le corps de Kha-f-Râ, et est la seule à posséder encore en partie son revêtement extérieur. La troisième pyramide n’atteint pas en hauteur le tiers de la première, mais elle était plus ornée ; on y a trouvé le cercueil en bois du roi Men-ké-Râ, par qui elle fut construite. La salle où il a été découvert avec son sarcophage était entièrement revêtue de granit ; or, pour trouver cette roche, il faut remonter le Nil jusque vers la première cataracte : c’est donc de là qu’on avait dû l’apporter sur des bateaux. Cette pyramide avait aussi un revêtement extérieur tout en granit de Syène, mais un peu moins ancien, paraît-il que le monument lui-même et ajouté par la reine Nil-aqrît, de la VIe dynastie (voyez tome II).
Outre Gizeh, nombre d’autres localités plus ou moins voisines de Memphis possèdent des pyramides, moins considérables, il est vrai. On en compte une centaine, dont soixante-sept ont été l’objet d’études attentives. Elles se répartissent sur une ligne d’environ soixante-neuf kilomètres, depuis Abou-Roasch, au nord, jusqu’à Meïdoum et à l’entrée du Fayoum, au sud. Elles y forment plusieurs groupes dont les principaux, en allant du nord au sud, sont ceux de Abou-Roasch, de Gizeh, de Zaou-yet-el-Arriân et d’Abousir, de Saqqarah et de Dahschour. On a retrouvé dans ces pyramides les tombes d’une partie des rois de la IVe dynastie à Gizeh, de ceux de la Ve à Abousir, de ceux de la VIe à Saqqarah et de ceux de la XIIe au Fayoum. Il semble donc que leur position sur la ligne du nord au sud est en raison de leur ancienneté, quoique cette règle souffre quelques exceptions ; car la grande pyramide à étages de Saqqarah est positivement la plus ancienne de toutes, et de puissants indices donnent à penser que celle de Meïdoum a reçu la sépulture de Snéfrou, l’avant-dernier roi de la IIIe dynastie (voyez tome II). Les trois pyramides de Gizeh sont de toutes les plus
régulières de forme ; elles reproduisent exactement le solide géométrique
dont elles portent le nom. Mais il est bien peu de ces monuments qui suivent
avec précision la même donnée. La pyramide méridionale de Dahschour fournit
une des variantes les plus curieuses du thème traditionnel ; chacune de ses
arêtes offre à l’œil non pas une ligne droite, mais une ligne brisée ;
vers le milieu de la hauteur totale de chacune de ses faces, l’inclinaison
change d’une manière très sensible. La pyramide de Meïdoum se compose de
trois pyramides tronquées, de hauteurs diverses, superposées les unes aux
autres et fortement en retraite à mesure qu’elles se superposant.
Même variété dans les matériaux employés. Les pyramides de Gizeh sont bâties en belle pierre calcaire du Maqattam et de Tourah ; la grande pyramide de Saqqarah est faite d’un mauvais calcaire argileux tiré des roches voisines. A Dahschour et à Abou-Roasch on trouve des pyramides bâties en briques crues. Il y en a enfin dont le corps est en pierre, mais où cette pierre est maintenue par une sorte d’ossature en briques d’un travail très soigné ; tel est le cas de la pyramide d’Ellahoun, à l’entrée du Fayoum, qui date de la XIIe dynastie. Quelques modernes, ignorants des choses de l’archéologie égyptienne et aimant à parler de ce qu’ils ne savaient pas, se sont livrés aux rêves les plus bizarres sur l’origine et la destination des pyramides. Mais aucune de ces fantaisies ne mérite même l’examen. Les pyramides, quelles qu’elles soient, sont toutes des tombeaux massifs, pleins, bouchés partout, même dans leurs couloirs les plus soignés, sans fenêtres, sans portes, sans ouverture extérieure. Elles sont l’enveloppe gigantesque et à jamais impénétrable d’une momie, et une seule d’entre elles aurait montré à l’intérieur un chemin accessible d’où, par exemple, des observations astronomiques auraient pu être faites comme du fonds d’un puits, que la pyramide aurait été aussi contre sa propre destination. En vain dira-t-on que les quatre faces orientées dénotent une intention astronomique ; les quatre faces sont orientées parce qu’elles sont dédiées par des raisons mythologiques aux quatre points cardinaux, et que dans un monument soigné, comme l’est une pyramide, une face dédiée au nord, par exemple, ne peut pas être tournée vers un autre point que le nord. Les pyramides ne sont donc que des tombeaux, et leur masse immense ne saurait être un argument contre cette destination puisqu’on en trouve qui n’ont pas six mètres de hauteur. Notons, d’ailleurs, qu’il n’est pas en Égypte une pyramide qui ne soit le centre d’une nécropole, et que le caractère funéraire de ces monuments est par là amplement certifié. La preuve que les pyramides étaient des monuments hermétiquement clos, c’est que, quand le khalife El Mamoun, au IXe siècle de notre ère, voulut pénétrer dans la grande, il ne put le faire qu’en perforant violemment la face nord à peu près sur la ligue de son centre, ce qui le fit tomber par hasard à l’intérieur sur le couloir montant. Comme à cette époque le revêtement était entier et que, par conséquent, il n’y avait point de décombres accumulés à la base, il s’ensuit que la place même de l’entrée ne se voyait pas du dehors[8]. Les pyramides étant ainsi des tombeaux hermétiquement clos, chacune d’elles avait un petit temple extérieur, une chapelle funéraire détachée du monument principal qui s’élevait à quelques mètres en avant de sa face orientale. C’est là qu’on célébrait les cérémonies du culte en l’honneur du roi divinisé qui reposait sous le massif. Les débris de cet édifice, appendice nécessaire de la pyramide, se voient encore très clairement à Gi/eh près de celles de Kha-f-Râ et de Men-ké-Râ. Le temple funéraire dépendant de la pyramide de Khoufou a péri sans laisser de traces. Pendant toute la période où ce genre de sépultures fut en usage, chaque souverain, aussitôt qu’il montait sur le trône, commençait la construction de sa pyramide. Mais, comme il pouvait se faire qu’il ne lui fût accordé que peu d’années de vie et de règne, il commençait par s’assurer une sépulture convenable en pressant le travail jusqu’à l’achèvement d’une pyramide de moyenne dimension, pourvue de son caveau. Ce point gagné, il avait l’esprit en repos ; mais ce n’était pas une raison pour interrompre le travail commencé ; plus la pyramide serait haute et large, mieux elle protégerait le dépôt qui lui serait confié ; plus aussi elle donnerait à la postérité une grande idée de la puissance du roi qui l’aurait bâtie. D’année en année, il employait donc plus d’ouvriers à dresser, tout autour de la pyramide, d’abord une, puis plusieurs couches extérieures de brique ou de pierre, épaisses chacune de cinq ou six mètres ; chaque couche augmentait ainsi graduellement la grosseur et l’élévation du monument, auquel la petite pyramide élevée à la hâte dès le début du règne servait comme de noyau. La construction commençait ainsi par le centre et se développait vers le dehors à la manière de l’aubier dans les arbres. A mesure que la pyramide s’épaississait et montait, chaque nouvelle enveloppe devait exiger plus de bras et plus de temps. Nous n’avons aucune raison de croire que l’on s’astreignît à terminer chacune d’elles dans un délai déterminé ; il serait donc chimérique de vouloir calculer la durée d’un règne, comme on le fait l’âge d’un arbre, par le nombre de ses couches concentriques ; mais on peut dire, d’une manière générale, que les plus hautes pyramides correspondent aux règnes les plus longs. Nous savons, par les témoignages anciens, que les trois rois qui ont construit les trois grandes pyramides de Gizeh ont régné l’un et l’autre plus ou près de soixante ans. L’histoire confirme ainsi l’induction à laquelle on était conduit par l’analogie et par l’étude comparative des procédés de construction qu’ont employés les architectes des pyramides[9]. De tout temps, la pyramide a continué d’être employée en Égypte comme amortissement, comme motif terminal. Abydos et Thèbes nous offrent de nombreux exemples de cet emploi, soit dans des édifices funéraires encore debout, soit surtout dans les représentations de ces édifices, que contiennent les bas-reliefs. Quant à la pyramide proprement dite, dépourvue de base et composant à elle seule tout le tombeau, on n’en a plus élevé après la XIIe dynastie. Quand l’art égyptien a été en possession de toutes ses ressources, cette forme, toute géométrique, aura semblé trop simple et trop nue ; elle ne comportait pas la variété d’effets et la richesse de décoration dont l’habitude et le goût s’étaient peu à peu répandus. Cependant, remarquent MM. Perrot et Chipiez, les pyramides n’ont jamais manqué de frapper les yeux et l’imagination des étrangers qui ont visité l’Égypte ; tout y contribuait, la vénérable antiquité de ces monuments et les souvenirs mêlés de fables qu’y rattachait la tradition populaire, la masse imposante qu’ils présentaient au regard, le vaste espace sur lequel ils étaient répandus, aux portes de la plus grande des villes égyptiennes, sur la limite des terres cultivées et du désert. Les peuples qui subirent l’influence de l’Égypte et qui se mirent à son école ne pouvaient donc guère échapper au désir d’imiter les pyramides, chacun à sa manière. Nous retrouvons la pyramide employée comme couronnement de l’édifice funéraire en Phénicie, en Judée et ailleurs encore ; mais c’est le royaume éthiopien, cette annexe méridionale de l’Égypte, dont il a copié la civilisation, qui s’est le plus appliqué à reproduire le type de la vieille pyramide des Pharaons ; comme l’Ancien Empire, il l’a consacré à la sépulture de ses princes. Napata, Méroé et d’autres sites encore ont leurs pyramides, qui se comptent par douzaines. L’Éthiopie n’a jamais su donner à ses pyramides royales ce caractère de grandeur auquel les pyramides voisines de Memphis doivent surtout leur effet et l’impression qu’elles produisent ; elle leur a, de plus, attribué des proportions effilées qui en changent sensiblement le caractère. En Égypte, dans les monuments de ce genre, la ligne de la base est toujours plus longue que celle de la hauteur verticale ; sur le Haut-Nil, ce rapport est renversé ; ces édifices perdent ainsi quelque chose de cette apparence d’indestructible solidité qui en est comme l’expression naturelle ; ils semblent tenir tout à la fois de l’obélisque et de la pyramide. Ajoutez à cela qu’un goût inintelligent les a surchargées d’ornements qui leur conviennent mal. Ainsi leur partie supérieure porte le plus souvent, dans la face de l’est, car elles sont orientées, une fausse fenêtre surmontée d’une corniche. Or, peut-on imaginer un motif qui soit moins à sa place, qui s’explique moins pour l’œil et pour l’esprit ? La chapelle funéraire s’applique toujours au pied des pyramides de l’Ethiopie, du côté de l’orient. § 5. — LE LABYRINTHE Le Labyrinthe, comme disaient les Grecs, c’est-à-dire le lope-ro-hount, le Temple ou le Palais à la bouche du lac, construit vers le débouché du lac Mœris, dans le Fayoum actuel, était, ainsi que nous le dit Manéthon, l’œuvre d’un roi de la XIIe dynastie, Amon-em-ha-t III (voyez tome II). Mais il avait été peut-être achevé ou réparé après le départ des Éthiopiens, au temps de la Dodécarchie, s’il faut ajouter foi au témoignage d’Hérodote. Cet édifice avait, presque autant que les pyramides elles-mêmes, attiré l’attention et la surprise des anciens voyageurs grecs. Hérodote le place même au-dessus, et le dépeint comme formé de douze cours couvertes, opposées l’une à l’autre par leurs entrées, six au nord et six au midi, toutes enveloppées d’une enceinte commune et entourées de trois cents chambres, moitié sur terre, moitié dessous. Il ajoute qu’il n’a vu que les premières ; on ne voulut pas le conduire dans les lieux souterrains, qui renfermaient, lui dit-on, les tombeaux des princes auteurs du Labyrinthe et ceux des crocodiles sacrés. Les issues des appartements et les détours si variés pour traverser les cours me causaient, dit-il encore, un étonnement inépuisable, quand je passais des cours dans les chambres, des chambres dans les salles, des salles dans d’autres chambres, et de celles-ci dans de nouvelles cours. Le toit est partout de pierre comme les murs ; ceux-ci sont en grande partie ornés de sculptures. Chaque cour a un péristyle de pierre blanche admirablement appareillée. A l’extrémité du labyrinthe, on voit une pyramide de quarante orgyies (400 pieds) de haut, décorée de grandes figures sculptées en relief ; on y entre par un chemin souterrain. Strabon, qui visita aussi personnellement le Labyrinthe, en donne une description qui s’accorde avec celle d’Hérodote sur le caractère général du monument et de sa construction, mais qui en même temps s’en écarte singulièrement, en ce qui est du plan. D’après lui, c’était un palais renfermant autant de palais qu’il y avait primitivement de nomes en Égypte, c’est-à-dire vingt-sept, car c’est ce nombre qu’admet le géographe comme ayant été celui des plus anciennes divisions politiques et administratives de la contrée. Il y avait donc, nous dit-il, vingt-sept cours entourées de colonnes, les unes à côté des autres, disposées en avant du mur continu et peu élevé qui formait la façade de l’édifice. En avant de ces cours, pour y donner accès, sont de longues cryptes formant couloirs, communiquant les unes avec les autres et offrant des passages tortueux, de telle façon qu’aucun étranger ne pourrait sans un guide y trouver le chemin de l’entrée et de la sortie. La merveille est que le plafond de chacune des chambres est formé d’une seule pierre, et que les couloirs des cryptes sont aussi couverts de dalles monolithes d’une énorme dimension. Si l’on monte sur le toit, qui est en terrasse et à une élévation assez médiocre, on croit être sur une plaine pavée de pierres gigantesques. En redescendant dans les cours on voit que les colonnes y sont monolithes et les murs revêtus de dalles de pierre dont la dimension n’est pas moindre. A l’extrémité de l’ensemble des constructions, qui a un stade de côté, est le tombeau du roi qui a bâti l’édifice, une pyramide à quatre faces. Vingt-trois siècles après Hérodote, le 25, juin 1843, M. Lepsius écrivait des ruines du même monument : C’est du Labyrinthe que vous iront chercher ces lignes ; non d’un labyrinthe douteux ou du moins toujours contesté, dont je n’avais pu me faire une idée d’après les descriptions toujours défectueuses des voyageurs, qui le plaçaient tantôt ici, tantôt là. Il en reste encore une masse considérable de ruines, au milieu d’elles, un grand espace où étaient les cours, avec les restes de grandes colonnes de granit, formées d’une seule pierre et d’autres d’un calcaire blanc, dur, luisant presque comme du marbre... La première vue du terrain découvre à l’œil un nombre vraiment labyrinthique de chambres embrouillées (verwirrter) tant au dessus qu’au dessous du sol... Nous y trouvons à la lettre des centaines de chambres, l’une auprès de l’autre, souvent de très petites auprès de grandes, de grandes pièces soutenues par de petites colonnes, liées par des corridors, sans régularité pour l’entrée et la sortie, en sorte que sur ce point la description d’Hérodote et de Strabon est pleinement justifiée... Quant à la disposition de l’ensemble, il consiste en trois masses de constructions, épaisses de 300 pieds et dessinant un espace de 600 pieds de long sur 500 de large. Le quatrième côté, l’un des petits, est occupé parla pyramide, qui a 300 pieds en carré à sa base... Du côté oriental, surtout à l’extrémité sud, les murs des chambres s’élèvent à dix pieds au-dessus du sol ; et du haut de la pyramide on découvre un plan régulier de tout l’édifice. La construction est partout en briques crues ; la pierre n’avait évidemment été employée que pour les revêtements, les colonnes et la couverture. Sur un certain nombre de fragments de là décoration architectonique en granit et en calcaire, le docte voyageur a trouvé plusieurs fois inscrit le nom d’Amon-en-ha-t III, fondateur du monument. Bien que considérables, les ruines subsistantes du Labyrinthe sont tellement informes que l’on ne saurait prétendre en tirer une restitution plausible de l’édifice, tâche rendue d’ailleurs singulièrement difficile par les divergences des descriptions d’Hérodote et de Strabon. La destination réelle du Labyrinthe, sur lequel tout ce que nous possédons aujourd’hui de textes hiéroglyphiques reste muet, n’est pas moins obscure. Strabon prétend qu’originairement les chefs des vingt-sept nomes s’y réunissaient à époques fixes pour y pratiquer des rites religieux, chacun dans le palais correspondant à son nome et avec un personnel spécial de prêtres, et pour y tenir des assemblées à la fois politiques et judiciaires. Ceci sent beaucoup les romans des exégètes, d’autant plus que la prétendue division de l’Égypte en vingt-sept nomes n’a aucun fondement historique réel. Une seule chose paraît évidente, c’est que le Labyrinthe était avant tout un édifice religieux, qui avait en même temps, dans une certaine mesure, un caractère funéraire, résultant de sa liaison à la pyramide d’Amon-em-ha-t. Peut-être était-ce un temple renfermant dans son ensemble douze ou vingt-sept temples distincts, suivant qu’est exact le chiffre d’Hérodote ou celui de Strabon, chacun dédié à une divinité différente. Il est à remarquer, en effet, qu’on relève plusieurs exemples d’un groupement de douze grands dieux, et que, d’autre part, le nombre vingt-sept nous offrirait le triplement d’un de ces cycles de neuf dieux, donnés par le triplement de la triade, dont nous avons eu l’occasion de parler plus haut. § 6. — TOMBEAUX Les Égyptiens, dit Diodore de Sicile, appellent les demeures des vivants des hôtelleries, parce qu’on y demeure peu de temps ; les tombeaux, au contraire, ils les appellent maisons éternelles, parce qu’on y est toujours. Voilà pourquoi ils ont peu de soin d’orner leurs maisons, tandis qu’ils ne négligent rien pour la splendeur de leurs tombeaux. Je me suis appesanti, dans le chapitre précédent, sur les idées religieuses propres aux Égyptiens et sur leur si remarquable préoccupation de la vie future, qui ont fait que, plus qu’aucun autre peuple au monde, ils ont donné de développement aux rites funéraires, d’importance et de luxe à la tombe. Aussi les sépultures privées, souterraines ou construites au-dessus du sol, constituent-elles une des parties les plus originales de l’architecture égyptienne ; elle lésa multipliées en nombre infini sur les pentes du flanc occidental dé la vallée du Nil, la demeure des mort : devant être naturellement du côté où le soleil se couche, avec la porte ouverte vers l’orient, vers le point où il se lève au matin, promettant à l’homme la résurrection par son exemple divin. Même, en dépit des raisons mystiques qui imposaient ce site et cette orientation, quelques groupes importants de tombeaux se rencontrent en différents endroits par suite de circonstances locales particulières, sur la rive orientale, leur face tournée vers l’Occident. Encore aujourd’hui, après tant de siècles d’abandon qui les ont vu violer, piller, bouleverser, ces nécropoles, par leur développement, par la magnificence et la recherche de quelques-unes de tombes qui les composent, tiennent une place de premier ordre parmi les vestiges monumentaux que nous a légués, l’antique civilisation égyptienne. On peut dire que l’Égypte est comme un pays de tombeaux, une immense cité des morts. Pour toutes les périodes les plus reculées de son histoire, pour l’Ancien et le Moyen Empire, nous ne connaissons guère ses annales, ses mœurs, ses croyances, son art, que par les monuments funéraires. Les édifices religieux de ces âges reculés ont péri sans retour. Ceux qui subsistent ne commencent guère qu’avec le début du Nouvel-Empire. C’est parles grandes nécropoles des environs de Memphis que nous connaissons surtout les tombes des dynasties primitives. Elles y sont multipliées plus que partout ailleurs, car dans cette région, qui était alors comme le centre et le foyer principal de vie de la monarchie pharaonique, la population était plus dense qu’ailleurs ; on comptait plus de riches et de grands personnages en état de déployer un luxe considérable dans leur sépulture. C’est là, d’ailleurs, à Gizeh et à Saqqarah, qu’ont porté les grandes fouilles d’Auguste Mariette qui ont révélé ce monde sépulcral de l’Égypte des premiers âges. J’emprunte à M. Maspero l’excellent résumé qu’il donne des résultats essentiels des études du grand explorateur des ruines des bords du Nil sur les tombes de l’Ancien Empire[10]. Les gens du vulgaire étaient enterrés dans le sable à un mètre de profondeur, le plus souvent nus et sans cercueils. D’autres étaient ensevelis dans de petites chambres rectangulaires, grossièrement bâties en briques jaunes ; le tout surmonté d’un plafond en voûte, ordinairement aiguë. Aucun ornement, aucun objet précieux n’accompagnait le mort au tombeau : des vases en poterie commune étaient placés à côté du cadavre et renfermaient les provisions qu’on lui donnait pour le voyage de l’autre vie. Les tombes monumentales et soignées de l’Ancien Empire, dans la région de Memphis, sont construites en maçonnerie au-dessus de la surface du sol. « Lorsqu’elles sont complètes, elles se divisent en trois parties : une chapelle extérieure, un puits et des caveaux souterrains. La chapelle est une construction quadrangulaire que l’on a pris l’habitude de désigner par le nom arabe de mastabah, et que l’on prendrait de loin pour une pyramide tronquée. Les faces, bâties en pierre ou en briques, sont symétriquement inclinées et le plus souvent unies ; parfois cependant les assises sont en retraite l’une sur l’autre et forment presque gradins. La porte, qui s’ouvre d’ordinaire dans le paroi de l’est, est tantôt surmontée simplement d’un tambour cylindrique, tantôt ornée sur les côtés de bas-reliefs représentant l’image en pied du défunt et couronnée par une large dalle couverte d’une inscription en lignes horizontales. C’est une prière et l’indication des jours consacrés au culte des ancêtres. Proscynème fait à Anôpou, résidant dans le palais divin, pour que soit donnée une sépulture dans l’Ament, la contrée de l’ouest, la très grande et très bonne, au parfait selon le dieu grand ; pour qu’il marche sur les voies où il est bon de marcher, le parfait selon le dieu grand, pour qu’il ait des offrandes en pains, farines et liquides à la fête du commencement de l’année, à la fête de Tahout, au premier jour de l’an, à la fête de Ouâgâ, à la grande fête de la chaleur, à la procession du dieu Khem, à la fête des offrandes, aux fêtes du mois et du demi-mois, et chaque jour. D’habitude l’intérieur de la chapelle ne renferme qu’une seule chambre. Au fond, à la place d’honneur et toujours orientée vers l’est, se dresse une stèle quadrangulaire de proportions colossales au pied de laquelle on trouve assez ordinairement une table d’offrandes en albâtre, granit ou pierre calcaire, posée à plat sur le sol, et quelquefois deux petits obélisques ou deux petits autels, évidés au sommet pour recevoir les dons en pains sacrés, en liquides et en victuailles dont il est parlé dans l’inscription du linteau. Après une prière au dieu chacal Anôpou et aux autres dieux de l’Ament, l’inscription de la stèle énumère les titres du défunt, raconte sa vie, cite les rois qu’il a servis et qui l’ont estimé plus que nul autre serviteur. Dans certains cas la stèle seule est gravée ; mais en règle générale on peut dire que les parois de la chambre sont couvertes de tableaux où la vie entière du défunt est représentée avec une richesse de détails et une exactitude merveilleuse. Dans un coin ce sont des scènes de la vie domestique : des cuisiniers qui activent le feu et préparent le repas, des femmes du harem qui dansent et chantent au son des violes, des flûtes et de la harpe ; ailleurs des épisodes de chasse et de pêche, des joutes sur l’eau, des incidents de l’inondation, le labourage, le semage, la moisson, l’emmagasinement des récoltes. Sur une autre paroi, des ouvriers de toute sorte exécutent chacun des travaux de son métier : des cordonniers, des verriers, des fondeurs, des menuisiers sont rangés et groupés à la file ; des charpentiers abattent des arbres et construisent une barque, des femmes tissent au métier sous la surveillance d’un eunuque renfrogné qui paraît peu disposé à souffrir leur babil. Le maître de la maison, debout à l’arrière d’un grand navire, commande la manœuvre aux matelots ; la mer sur laquelle il navigue est le bassin de l’occident, et le port vers lequel il se dirige n’est autre que la tombe. Non loin de là, il est figuré assis et recevant les dons que leur apportent des files de personnages disposés en hauteur sur plusieurs registres : ce sont ses domaines, ceux dont il hérita de ses ancêtres et ceux qu’il tient de la munificence royale, qui lui présentent leurs produits et tiennent à honneur de contribuer aux offrandes funéraires qu’on lui fait. Tous ces tableaux sont accompagnés de légendes explicatives destinées à reproduire les paroles des personnages mis en scène. Tiens bon : saisis fortement, dit à son aide un sacrificateur prêt à tuer un bœuf. — C’est prêt ; fais vite, lui répond celui-ci. Un batelier de bonne humeur crie de loin à un vieillard attardé sur la rive : Viens sur l’eau. Et le vieillard : Allons ! pas tant de paroles, lui dit-il. C’est dans cette chambre que les descendants du défunt et les prêtres attachés à son culte funéraire se réunissaient aux jours indiqués pour rendre hommage à leur ancêtre... Ils le retrouvaient là tel qu’il avait été durant son existence, escorté de ses serviteurs et entouré de ce qui avait fait la joie de sa vie terrestre, partout présent et pour ainsi dire vivant au milieu d’eux. Aussi bien on savait que derrière l’une des parois, dans un étroit réduit ménagé au milieu de la maçonnerie, les statues du défunt étaient entassées pêle-mêle, servant de support à son ka ou double. D’ordinaire ce réduit, cette demeure du ka, ne communiquait pas avec la chambre et restait perdu dans la muraille ; quelquefois il était relié avec elle par une sorte de conduit si resserré qu’on a peine à y glisser la main. A certains jours les parents venaient murmurer quelques prières et brûler des parfums à l’orifice de ce conduit ; prières et parfums étaient censés arriver par là jusqu’à l’oreille du mort. Le puits qui descend au caveau se trouve quelquefois dans un coin de la chambre ; mais le plus souvent, pour en découvrir l’ouverture il faut monter sur la plate-forme de la chapelle extérieure ou mastabah. Il est carré ou rectangulaire, bâti en grandes et belles pierres jusqu’à l’endroit où il s’enfonce dans le roc. Sa profondeur moyenne est de douze à quinze mètres, mais il peut aller jusqu’à trente et au delà. Au fond et dans la paroi du sud, s’ouvre un couloir où l’on ne pénètre que courbé et qui mène à la chambre funéraire proprement dite. Elle est taillée dans la roche vive et dépourvue d’ornements, au milieu se dresse un grand sarcophage en calcaire fin, en granit rosé ou en basalte noir, gravé aux noms- et titres du défunt. Après avoir scellé le corps, les ouvriers déposaient sur le sol les quartiers d’un bœuf qu’on venait de sacrifier dans la chambre du haut, et de grands vases en poterie rouge pleins de cendres, muraient avec soin i’entrée du couloir et remplissaient le puits jusqu’à la bouche d’éclats de pierre mêlés de sable et déterre. Le tout, largement arrosé d’eau, finissait par former un ciment presque impénétrable dont la dureté mettait le mort à l’abri de toute profanation. Ces tombes monumentales, vraies maisons des défunts, formaient par leur groupement des villes funéraires, plus étendues que les villes des vivants, nécropoles qui généralement, comme nous l’avons dit plus haut, avaient pour centre les pyramides royales, isolées ou réunies à plusieurs. A Gizeh, les mastabah sont disposés sur un plan symétrique et rangés le long de véritables rues, qui se coupent à angle droit ; on peut l’observer sur le plan que nous donnions tout à l’heure du plateau où s’élèvent les grandes pyramides, plan qui n’embrasse, du reste, qu’une petite partie du vaste ensemble de la nécropole de Gizeh. A Saqqarah, les tombes sont semées en désordre sur la surface du plateau, espacées en certains endroits, entassées pêle-mêle dans certains autres. Les tombes de l’Ancien Empire que l’on a reconnu dans le champ de sépultures d’Aboud ou Abydos sont des mastabah construits en maçonnerie, tout à fait du même type que ceux de la région de Memphis. Mais sur d’autres points de l’Égypte, on constate qu’il y avait déjà sous les premières dynasties, seulement en moins grand nombre que les autres, des sépultures souterraines, en forme de grottes artificielles creusées dans le flanc des rochers. C’est seulement avec le Moyen-Empire que ce type des hypogées commence à prédominer, sous la XIIe dynastie, qui nous en offre les spécimens les plus parfaits dans les tombeaux des princes de Meh, à Béni-Hassan. Les parties essentielles qui devaient constituer toute tombe égyptienne se retrouvent dans les hypogées du Moyen-Empire comme dans les mastabah, mais disposées et exécutées d’une manière différente. Il y a toujours la chambre accessible à tous, la chapelle où se célébraient les cérémonies du culte funèbre, qui reste au point de vue monumental la portion la plus importante du sépulcre, mais qui, au lieu d’être prise dans un massif de maçonnerie, est creusée dans le roc vif. Vient ensuite le puits caché et bouché conduisant au caveau funèbre ; il s’ouvre ici au milieu ou dans un des coins de la chambre. Au fond du puits, comme du temps de l’Ancien Empire, se trouve le caveau qui renfermait le sarcophage et la momie. Mais on ne trouve déjà plus dans les tombes de cette époque le réduit étroit ou serdab, ménagé derrière une des parois de la chapelle funéraire pour recevoir les statues du défunt. Les idées sur la vie d’après la mort se sont déjà modifiées ; la conception du ka ou du double, à laquelle se rattachait cette disposition, n’a plus la même importance que primitivement, et surtout n’est plus seule. Le principe de la décoration de la salle accessible au public pour les rites périodiques reste encore le même que sous l’Ancien Empire. Elle consiste encore exclusivement en scènes de la vie civile, et les représentations des dieux continuent à en être complètement absentes. Un vestibule largement ouvert précédait cette chambre principale. Suivant la disposition des lieux, tantôt il était creusé dans le roc, tantôt construit en maçonnerie en avant de la paroi de la falaise dans laquelle on avait ouvert la tombe. Un petit jardin planté de quelques arbres entourait généralement l’entrée du vestibule. C’est une pratique qui s’est maintenue sous le Nouvel Empire. Dans la nécropole d’Abydos, les tombes du Moyen Empire ne sont plus des hypogées, mais des constructions élevées au-dessus du sol. Ce sont presque toujours de petites pyramides en briques, d’une forme plus effilée que les grandes pyramides royales, dans la masse desquelles on a ménagé la salle formant chapelle, où s’ouvre, au centre ou dans un angle, le puits bouché soigneusement qui donnait accès au caveau dans lequel le corps momifié était déposé. C’est surtout à Thèbes que l’on a l’occasion et les moyens d’étudier à fond les sépultures du Nouvel Empire. Entre les diverses nécropoles de cette grande ville, groupées sur les pentes de la montagne de l’ouest, celle de Drah-Abou-l-Neggah a été le cimetière de la XIe et de la XIIe dynastie, inauguré sous les En-t-ef, puis celui de la XVIe dynastie, dont les princes reposaient en cet endroit. A El-Assassif se trouve la nécropole de l’époque de la XVIIIe dynastie. Les sépultures de Scheikh-’Abd-el-Qour-nah et de Qournet-Mourraï appartiennent surtout à la période qui s’étend de la XIXe dynastie à la XXVIe inclusivement. Le cimetière principalement usité plus tard, jusque sous les Ptolémées et les Romains, entoure Deïr-el-Médinch. Il faut également citer, comme d’un intérêt exceptionnel, en dehors de Thèbes, les tombeaux de Tell-el-Amarna, datant tous du règne d’Arnon-holpou IV, Rhou-n-Aten, qui avait fondé cette ville pour en faire sa capitale, en abandonnant Thèbes (voyez tome II). Enfin, dans les environs de Memphis, à Gizeh et à Saqqarah, dans les nécropoles presque entièrement abandonnées depuis la fin de l’Ancien Empire, on recommence, sous la XXVIe dynastie, à exécuter des sépultures nombreuses et d’un grand luxe, remarquables surtout par la profusion de sculptures de leurs sarcophages de basaltes et d’autres pierres dures. Les tombes du Nouvel-Empire offrent universellement le type des hypogées. Pour celles de grands personnages, il n’est pas rare de leur voir un plus grand développement qu’à celles du Moyen Empire. Il en est qui offrent plusieurs chambres successives, dans la plus reculée desquelles s’ouvre le puits conduisant au caveau funéraire. La décoration de ces chambres est en bien des cas très riche, mais d’un art moins parfait et moins fin que sous la XIIe dynastie. Le plus souvent elle n’est que peinte sur enduit. On y rencontre encore des scènes de chasse, dépêche, d’agriculture et de métiers, quelquefois aussi des sujets historiques, des processions d’envoyés des peuples étrangers apportant leurs tributs au pharaon ; mais ces représentations de la vie terrestre y alternent avec des tableaux religieux, des figures des divinités ; de plus, on y retrace souvent les cérémonies des funérailles avec une multitude de détails intéressants, dont nous avons largement tiré parti plus haut, en essayant de décrire ces cérémonies. Creusées dans le roc calcaire, ces sépultures étaient précédées d’une construction extérieure en maçonnerie qui y donnait accès. D’ordinaire c’était un propylon surmonté d’une petite pyramide, dont l’intérieur formait vestibule. En avant de cette construction, qui ne manquait guères, les tombes les plus luxueuses avaient une ou plusieurs cours entourées de murailles, avec des entrées en façon de pylônes. Pour les gens du commun, qui n’avaient pas de quoi faire les frais, toujours très considérables, d’une sépulture séparée de ce genre, il y avait des tombes communes, dont quelque individu de la classe sacerdotale prenait l’entreprise, assurant par contrat à ceux qui s’y faisaient enterrer la perpétuité des cérémonies faites aux jours prescrits par le rituel pour tous les morts de l’hypogée. Les tombes de cette classe offrent une salle où l’on empilait les momies les unes sur les autres jusqu’à ce qu’elle en fût entièrement remplie. Certaines des salles du temple de Dëir-el-Bakari, qui cessa de bonne heure d’appartenir au culte, ont été dès la XXIIe dynastie transformées en sépultures collectives. On les a trouvées pleines de momies régulièrement amoncelées. Les plus magnifiques monuments de l’architecture funéraire souterraine du Nouvel Empire, à Thèbes, sont les sépultures royales de Biban-el-Molouk, que les Grecs appelaient les Syringes et qu’ils rangeaient au nombre des merveilles de l’Égypte. Biban-el-Molouk est une gorge profonde et bifurquée qui s’enfonce au cœur de la montagne de l’ouest, de la montagne funéraire, à six kilomètres de distance du Nil. Rien de plus sauvage et de plus désolé que l’aspect de cette vallée ; c’est littéralement le pays de la mort. Pas un brin d’herbe n’y égaie la vue. Toute vie en est absente ; le sol lui-même y semble dévoré parles ardeurs d’un soleil implacable, qui a fendu et comme grillé des rochers. Dans la branche la plus reculée vers l’ouest, les derniers rois de la XVIIIe dynastie ont fait creuser leurs tombes ; on y voit celles d’Amon-hotpou III et de Aï. Les monarques de la XIXe et de la XXe dynastie ont les leurs dans un ravin un peu moins retiré, que les voyageurs visitent davantage. La disposition typique de ces tombes consiste en un corridor, plus ou moins incliné, qui s’enfonce profondément dans la montagne en offrant de distance en distance des étranglements marqués par autant de portes. Au fond est une salle soutenue par des piliers, qui renferme le sarcophage où était la momie royale. Quelquefois la nécessité de suivre le banc de calcaire compacte, qui seul permettait d’y tailler de semblables excavations, a conduit l’architecte à des changements de niveau considérables ou bien à donner à sa galerie une forme contournée en plan. Quand le règne du prince qui se faisait préparer la sépulture de son vivant s’est prolongé, on a multiplié les salles, soit disposées en enfilade, soit s’ouvrant sur les côtés du couloir principal. A la mort du roi, si la tombe n’était pas achevée, le creusement s’arrêtait ; on exécutait en hâte un réduit tel quel pour le sarcophage, et la décoration était brusquement interrompue.
Plan de l’hypogée funéraire de Séti Ier, à Biban-el-Molouk[11]. Toutes les parois de la galerie principale et des salles sont couvertes de tableaux peints et sculptés où se succèdent des milliers de ligures. Dès les premiers pas que le visiteur fait dans ces tombeaux, dit M. A. Mariette, il se sent littéralement dans un monde nouveau... Le défunt n’est plus dans sa famille, entouré des siens. On ne façonne plus ses meubles ; on ne met plus les barques sur le chantier ; des fermes aux nombreuses cours ne nous montrent plus les bestiaux, bœufs, antilopes, bouquetins, oies, canards, demoiselles de Numidie défilant en présence des intendants. Tout devient fantastique et chimérique. Les dieux y ont des formes étranges. De longs serpents se glissent çà et là au bas des chambres, ou se dressent contre les portes. Il y a des condamnés qu’on décapite, d’autres qu’on précipite dans les flammes.... On a dit qu’avant de leur donner la sépulture les Égyptiens jugeaient leurs rois. C’est dans le sens allégorique qu’il faut entendre cette légende. Le jugement de l’âme après sa séparation du corps, les épreuves qu’à l’aide des vertus dont elle a fait preuve sur la terre, elle doit surmonter, voilà le sujet des représentations presque sans fin qui recouvrent la tombe, de la porte d’entrée au fond de la dernière chambre. Les serpents qui se dressent à chaque porte, en lançant leur venin, sont les gardiens de l’une des stations du trajet des enfers : l’âme ne passera pas si elle ne justifie de sa piété et de sa bienfaisance. Ces longs textes qui, autre part, s’étalent sur les murs, sont des hymnes magnifiques que l’âme entonne en l’honneur de la divinité, et où elle célèbre sa grandeur. Le mort une fois jugé digne de la vie éternelle, les épreuves sont accomplies ; il devient dieu lui-même ; désormais pur esprit, il circule dans le monde infini des astres. La tombe n’est ainsi que le passage figuré de l’âme jusqu’au séjour éternel. Elle la prend à sa sortie du corps, et, de chambre en chambre, elle nous fait assister à sa comparution devant les dieux, à son épuration graduée ; finalement, dans la grande salle du fond, elle nous montre sa définitive admission dans la vie qu’une seconde mort n’atteindra pas. Tableaux et inscriptions, dans cette décoration des sépultures royales de Biban-el-Molouk, sont généralement empruntés au Livre de ce qui est dans l’hémisphère inférieur, livre dont nous avons parlé plus haut et dont la donnée fondamentale est l’assimilation des vicissitudes des destinées de l’âme après la mort aux phases successives du voyage souterrain du Soleil pendant la nuit. Une fois les funérailles royales terminées, la momie déposée dans le sarcophage, la porte d’entrée de la syringe était murée, et le terrain environnant nivelé de telle sorte qu’aucune marque extérieure ne révélât l’entrée de la tombe. On voit par là que l’esprit dans lequel ces monuments funéraires ont été exécutés est bien loin de l’esprit qui a présidé à la construction de toutes les autres tombes égyptiennes. La chambre accessible, la chapelle où les survivants se réunissaient pour honorer la mémoire du mort, fait ici complètement défaut. Ce qui en tenait la place, les sanctuaires funéraires des rois inhumés à Biban-el-Molouk, étaient ces vastes temples commémoratifs élevés en avant de la montagne où s’enfonçait la vallée sépulcrale, tout le long de son pied du côté de l’est. Une bonne part de ces temples a péri. Les principaux et les plus solidement bâties sont seuls parvenus jusqu’à, nous. Mais originairement il devait y en avoir autant que de rois reposant dans les catacombes de la montagne. Après la chute de la XXe dynastie, au temps des luttes des grands-prêtres d’Ammon, usurpateurs de la couronne, contre les rois de Tsân, il se forma à Thèbes une association de malfaiteurs, qui comptait pour complices des personnages de l’ordre le plus élevé, dans le but de pénétrer violemment dans les tombes royales et de les dévaliser des richesses qui y avaient été déposées. Beaucoup furent forcées et dépouillées, et ces faits donnèrent lieu à une enquête judiciaire dont les pièces ont été préservées en partie. C’est alors que le roi Pi-notem II, pour les mettre à l’abri de semblables entreprises et des chances de la guerre civile, ordonna la translation générale des corps des rois enterrés à Biban-el-Molouk et les fit déposer dans un caveau voisin de Deïr-el-Bahari, où leurs momies ont été récemment retrouvées. Les tombes royales, ainsi dépouillées de leurs morts, perdirent tout caractère sacré, restèrent ouvertes et devinrent un simple objet de curiosité pour les étrangers ; On y trouve partout sur les murailles les signatures des voyageurs égyptiens, grecs et romains qui les visitèrent jusqu’à l’époque de l’invasion musulmane. Du temps de Strabon, quarante étaient accessibles ; il n’y en a plus aujourd’hui que vingt-cinq d’ouvertes, quinze ont été cachées par des éboulements de la montagne, sous lesquels des fouilles en feraient retrouver les entrées. Parmi les plus achevées et les plus remarquables sont celles de Séti Ier et de Râ-mes-sou III. Celle de Séti a été découverte il y a une soixantaine d’années seulement par Belzoni. A ce moment pas un bas-relief ne manquait à ses murailles, et ses peintures étaient aussi fraîches qu’au premier jour. Le vandalisme des voyageurs de toutes les nations les a maintenant dégradées d’une manière irréparable, mutilations d’autant plus malheureuses que le travail en était d’un art exquis et d’une incomparable finesse. Dans la tombe de Râ-mes-sou III, des chambres, placées sur les côtés du couloir d’entrée, sont garnies de représentations de meubles magnifiques, d’ustensiles de toute nature, de vases en métaux précieux, de cottes d’armes, d’arcs, de flèches, de piques, Ce sont évidemment ces peintures qui, piquant la curiosité des visiteurs et prêtant riche matière aux contes des exégètes, ont donné naissance aux légendes recueillies par Hérodote sur les prodigieux trésors du roi Rampsinitos. Car c’est à Râ-mes-sou III qu’on appliquait ce surnom populaire. Par l’infinie variété et le caractère étrange de leurs scènes du monde infernal, les sépultures de Râ-mes-sou IV et de Râ-mes-sou IX sont particulièrement remarquables. La salle du sarcophage de la première, décrite par Champollion dans ses Lettres, retrace au complet les stations du Soleil pendant les douze heures de la nuit, et les parois en sont couvertes de milliers d’hiéroglyphes. Dans l’hypogée de Râ-mes-sou IX on note la multiplicité des tableaux où l’idée de la génération s’exprime de la façon la plus brutale et la moins déguisée, expression bizarre et étrangement grossière de la notion de résurrection après la mort, d’immortalité promise au défunt, qui régnait partout dans la décoration de ces tombeaux. § 7. — TEMPLES L’Égypte, ce pays éminemment religieux, dès les époques les plus antiques a déployé plus de soin et plus de luxe encore dans la demeure de ses dieux que dans celle de ses morts. Sa piété s’est traduite de tout temps par le nombre et la somptuosité de ses temples. Mais nous ne savons presque rien de l’architecture religieuse de l’Ancien Empire. La plupart des sanctuaires renommés du pays de Kêmi-t prétendaient faire remonter leur origine jusqu’à cette période, et même jusqu’aux temps semi-fabuleux des Schesou-Hor. Mais, ruinés par l’effet du temps ou par la main des hommes dans le cours des révolutions et des invasions étrangères dont l’Égypte fut le théâtre durant son existence tant de fois séculaire, ils avaient été plusieurs fois réédifiés dans le cours des âges, et rien n’y reste plus de la construction primitive. Pourtant Strabon vit encore, à Héliopolis et à Memphis, des édifices sacrés de style barbare, dit-il, soutenus par des piliers sans sculptures ni ornements, qui dataient d’une antiquité prodigieusement reculée et qui étaient environnés d’une vénération exceptionnelle, en vertu de cette antiquité même. Un temple de cette nature a été découvert sous les sables à Gizeh dans les fouilles de A. Mariette, et est maintenant accessible aux visiteurs. C’est celui qui se trouve dans le voisinage du grand Sphinx et qui offre comme une sorte de transition entre les monuments mégalithiques et l’architecture proprement dite. On pénètre, par un couloir long d’environ 20 mètres et large de 2, qui se dirige vers l’est, dans un épais massif de maçonnerie, de forme à peu près carrée. Vers le milieu de ce corridor s’ouvrent deux étroits passages ; celui de droite conduit à une petite chambre, et celui de gauche à un escalier, par lequel on montait sur la terrasse. Au bout du couloir on arrive à l’une des extrémités d’une grande salle, orientée du nord au sud, qui a 25 mètres de long et 7 de large. Le plafond de cette salle était soutenu par six piliers quadrangulaires qui sont encore debout. Ces monolithes ont 5 mètres de haut, et de 1 mètre à 1 mètre 40 de côté ; plusieurs d’entre eux portent encore les architraves longues d’environ 3 mètres, qui les reliaient l’un à l’autre. Dans cette salle s’en ouvre une autre, orientée de l’est à l’ouest, qui est longue d’un peu plus de 17 mètres et large de 9 ; le toit en était supporté par dix autres piliers semblables. A l’angle sud-ouest de la salle où l’on est entré tout d’abord, un couloir aboutit à six niches profondes, superposées deux par deux. Du milieu de la face orientale de cette même pièce, un large passage conduit à une dernière salle, parallèle à celle d’où l’on sort. Ici point de piliers ; mais dans le sol est creusé un puits profond, qui a été vidé par Mariette du sable qui le remplissait. Autrefois il contenait de l’eau, car il descend au-dessous du niveau qu’atteint la crue du Nil. Aux deux extrémités de cette pièce, sur les petits côtés nord et sud, d’étroits couloirs mènent à de petites chambres, pratiquées dans l’épaisseur du massif, dont l’une, celle du nord, paraît avoir débouché au dehors par une sorte de fente pratiquée dans la maçonnerie. Les matériaux employés dans l’intérieur de l’édifice sont le granit rosé et l’albâtre. Les piliers sont en granit ; des dalles d’albâtre revêtent les parois des salles et en formaient le plafond. Albâtre et granit ont été dressés avec soin et assemblés avec art ; mais nulle part on ne voit la moindre trace d’une moulure ou d’un ornement. Pas de chapiteaux ni de cannelures aux piliers ; pas de bas-reliefs ou de peintures sur les murailles ; pas une inscription, pas un tableau d’adoration. Quant à l’enveloppe extérieure, elle est construite avec les plus gros blocs de calcaire qu’on trouve en Égypte. Nulle part aujourd’hui le dehors n’en est visible ; mais d’après Mariette, qui a pratiqué des sondages sur quelques points de la périphérie, elle n’offrirait à la vue que des surfaces lisses, décorées de longues rainures verticales et horizontales habilement entrecroisées[12].
Plan du temple voisin du grand Sphinx[13]. Les mêmes données d’architecture et de construction se reproduisent dans le temple funéraire dépendant de la troisième pyramide, de celle de Men-ké-Râ, édifice aujourd’hui presque entièrement caché sous les sables, mais qui a été vu et décrit par Jomard lors de la grande expédition d’Égypte. C’est, dit-il, un ouvrage extrêmement remarquable par son plan, son étendue et l’énormité des pierres dont il est construit. Le plan en est carré, presque de 53 mètres 80 dans un sens sur 56 mètres 20 dans l’autre, avec un prolongement ou long vestibule vers l’est, ayant 31 mètres sur 14 mètres 20... En sortant du vestibule on entrait dans une vaste cour qui avait deux issues latérales ou fausses portes. Au delà étaient plusieurs salles spacieuses, dont cinq encore subsistantes ; celle du fond a la même largeur que le vestibule, et répond juste au milieu de la pyramide, dont elle est éloignée seulement de 13 mètres... Après avoir étudié dans la Thébaïde la construction elles matériaux des édifices, on est encore étonné ici de la grandeur des matériaux et du soin apporté à l’appareil. Les murs ont 2 mètres 40 d’épaisseur ; c’est la largeur des pierres ; leur longueur varie de 10 à 20 pieds. Ces blocs sont tels que je les ai pris d’abord pour le rocher lui-même, travaillé et taillé, et l’on resterait dans l’erreur si l’on ne voyait le ciment qui joint les assises. Le prolongement de l’est est formé par deux énormes murailles, qui n’ont pas moins de 4 mètres 20 d’épaisseur. On se demande quelle nécessité il y avait de construire des murs aussi extraordinaires, puisque, réduits à la moitié de cette dimension, ils n’auraient pas eu moins de solidité. Jomard ne semble pas avoir trouvé trace de piliers dans aucune des parties de l’édifice ; mais Belzoni, dont la description est à la fois brève et confuse, paraît en avoir reconnu dans le temple de la seconde pyramide, car il parle d’un portique, et il ajoute que quelques blocs de ce portique avaient 24 pieds de haut : c’est à peu près la dimension des piliers monolithes du temple du Sphinx. Les traits communs de ces édifices sont le plan carré, la multiplicité des salles intérieures dont quelques-unes ont des dimensions singulièrement exiguës, la recherche des très grands matériaux, l’habileté dans la taille et dans l’assemblage de ces pierres énormes, l’absence de toute moulure et de toute décoration sculptée. Mais on concevra facilement qu’avec un si petit nombre de spécimens de l’architecture religieuse de l’Ancien Empire et dans l’absence de tout renseignement des inscriptions à cet égard, il est impossible de chercher même à donner un nom aux diverses parties du temple d’une période aussi reculée et d’en déterminer la destination. Il faut d’autant plus y renoncer que c’est sur une donnée toute différente que se construisent les temples quand la civilisation égyptienne renaît sous la XIe et la XIIe dynastie, après l’éclipsé étrange qui marque la fin de l’Ancien Empire. Aucun temple de la XIIe dynastie, ni en général du Moyen Empire, n’est parvenu jusqu’à nous dans son intégrité. Mais d’après les quelques débris qui en subsistent, englobés dans des constructions postérieures, et surtout d’après les indications des textes écrits, il est positif que ces édifices étaient déjà conçus d’après le type que reprit le Nouvel Empire, et qui se perpétua tant que l’on éleva sur les bords du Nil des sanctuaires aux vieilles divinités nationales. Désormais le temple égyptien que l’on peut appeler classique se compose de trois parties essentielles, qui ne manquent jamais, et qui peuvent se répéter plusieurs fois, à mesure que se développe l’étendue de l’édifice. Strabon les a déjà fort bien indiquées aux Grecs de son temps. C’est d’abord le sanctuaire, ou sêcos, comme disaient les Hellènes, petite pièce de forme rectangulaire, où nul que lé roi et le grand-prêtre n’avaient le droit de pénétrer et où le dieu du temple était censé résider en personne, représenté par un symbole qu’on tenait enfermé loin de tout regard profane dans un tabernacle de bois, ayant souvent la forme de la cabine d’une barque richement ornée, ou bien dans un naos monolithe de granit et de basalte. Le sanctuaire est fréquemment construit au milieu d’une grande salle carrée et toujours entouré d’une série de chambres assez petites qui servaient à renfermer les objets employés dans le culte. En avant du sanctuaire est la salle hypostyle, vaste salle au plafond plat soutenu par des colonnes, qui formaient vestibule ou pronaos, pour parler comme les Grecs. Le pronaos et la porte flanquée de tours pyloniques, qui y donne accès, est précédée d’une vaste cour garnie d’un péristyle intérieur sur trois de ses faces, cour où l’on entre du dehors par un premier pylône. Enfin, par devant celui-ci s’étend’ souvent au loin un dromos ou avenue de sphinx, formant la voie sacrée qui conduit au temple. Enfin l’ensemble des constructions de l’édifice regardé comme la demeure du dieu est environné d’une vaste enceinte, munie de plusieurs propylons comme entrées, qui renferme souvent d’autres petits temples secondaires, et en général un vaste bassin artificiel, où l’on puisait l’eau pour les lustrations et pour les sacrifices.
Il faut se garder, dit Auguste Mariette, de confondre le temple égyptien avec le temple grec, avec l’église chrétienne ou i la mosquée musulmane. Le temple n’est pas un lieu où les fidèles se l’assemblent pour dire la prière en commun ; on n’y célèbre aucun culte public, personne même n’y est admis que les prêtres et le roi. Le temple est un proscynème royal, c’est-à-dire un monument de la piété du roi qui l’a fait élever pour mériter la faveur des dieux... L’immense décoration dont sont couverts les murs des temples ne s’explique que si l’on admet ce point de départ. Le principe de la décoration est le tableau, que plusieurs tableaux soient rangés symétriquement côte à côte et que plusieurs séries de tableaux superposés par étages revêtent les parois des chambres de haut en bas. Tel est l’inévitable arrangement. Quant au sens des tableaux, il est partout le même. Le roi d’un côté, une ou plusieurs divinités de l’autre, c’est là le seul sujet de la composition. Le roi adresse une offrande (table chargée de victuailles, fleurs, fruits, emblèmes) à la divinité et demande que celle-ci lui accorde une faveur ; dans sa réponse, la divinité concède le don demandé. Il n’y a donc dans la décoration du temple qu’un acte d’adoration du roi, répété sous toutes les formes. Un temple n’est ainsi que le monument exclusivement personnel du roi qui l’a fondé et décoré. Par là s’explique encore la présence des tableaux de batailles dont sont ornés les murs extérieurs de certains temples. C’est à la divinité et à sa protection que le roi fait remonter la première cause de ses victoires. En combattant les ennemis de l’Égypte, en les amenant enchaînés par milliers dans sa capitale, en les employant à la construction du temple qu’il érige, il a fait un acte agréable aux dieux, comme en leur offrant de l’encens, des fleurs et des membres d’animaux sacrifiés. Il témoigne parla de sa piété ; il mérite la continuation de ces faveurs qu’il a voulu reconnaître par l’érection de l’édifice. Cette reconnaissance et cette piété du roi se manifestaient encore par la pompe et l’éclat des grandes fêtes, répétées plusieurs fois par an, dont le temple était le centre. Ces fêtes consistaient surtout en processions qui sortaient du sanctuaire, se formaient dans la salle hypostyle, traversaient les cours et se répandaient au dehors, à la pleine clarté du soleil, jusqu’aux limites de la grande enceinte en briques crues ; elles montaient sur les terrasses, elles faisaient voguer sur le lac les barques sacrées, toutes pavoisées de banderoles multicolores. En de rares occasions, elles franchissaient la muraille qui d’ordinaire en protégeait les évolutions contre l’indiscrète curiosité des regards profanes ; on voyait alors les prêtres, avec les saintes images, prendre la tête d’une brillante flottille, quitter la ville et se diriger soit par le Nil, soit par un canal qu’on appelle le canal sacré, vers quelque autre cité plus ou moins éloignée. Dans les processions que le roi était censé conduire, on portait les enseignes des dieux, on portait les coffres dans lesquels était enfermés leurs effigies ou le symbole qui les représentait, on portait les châsses et les barques sacrées. En temps ordinaire, celles-ci étaient déposées dans le sanctuaire. Les jours de fêtes, on les y venait chercher ; on allait prendre dans le tabernacle l’emblème mystérieux que personne rie devait voir, sauf le roi ou le prêtre qu’il avait délégué à cet effet, et on le portait sous un dais, sur lequel était jeté le voile d’une riche draperie. Un culte aussi brillant et aussi pompeux suppose un ample matériel ; il fallait donc des locaux appropriés à la garde de tout cet appareil. C’était la destination des chambres qui entouraient le sanctuaire et s’ouvraient sur les salles accessoires. On ne trouve dans le temple, dit encore A. Mariette, ni logements pour les prêtres, ni lieux d’initiation, ni trace de divination ou d’oracles, et rien ne peut laisser supposer que, en dehors du roi et des prêtres, une partie quelconque du public y ait jamais été admise, si ce n’est dans les cours et dans la salle hypostyle. Mais le temple était un lieu de dépôt, de préparation, de consécration. On y célébrait quelques rites à l’intérieur, on s’y assemblait pour les processions, on y emmagasinait les objets du culte ; et si tout y est sombre, si, dans ces lieux où rien n’indique qu’on ait jamais fait usage de flambeaux ou d’aucun mode d’illumination, des ténèbres à peu près complètes règnent, ce n’est pas pour augmenter par l’obscurité le mystère des cérémonies ; c’est pour mettre en usage le seul moyen possible alors de préserver les objets précieux, les vêtements divins, des insectes, des mouches, de la poussière du dehors, du soleil et de la chaleur elle-même. Ce n’est que rarement, du reste, qu’un temple égyptien présente un plan aussi simple et d’une clarté aussi limpide que celui de Dendérah. Le temple est la maison du dieu ; le sanctuaire, la chambre d’habitation où il réside. Mais autour de cette chambre, qui constitue le noyau essentiel et primitif de son palais sacré, les somptueuses dépendances, les parties accessoires peuvent se développer et s’étendre sans que rien y assigne de limites, au gré de la volonté souveraine du Pharaon constructeur, de la richesse d’imagination de l’architecte ou du nombre des générations qui apportent, les unes après les autres, leur tribut d’embellissement au temple. On ajoute ainsi/et quelquefois par suite de diverses circonstances, d’une façon singulièrement irrégulière, les salles hypostyles aux salles hypostyles, les cours entourées de colonnes aux cours entourées de colonnes, les pylônes aux pylônes ; on multiplie les chambres autour du sanctuaire ; on établit même plusieurs sanctuaires pour .des divinités différentes ; on donne aux appartements placés comme appendices derrière cette résidence spéciale du dieu, et constituant l’ensemble de l’opisthodome, un développement égala celui des parties antérieures. C’est ainsi que l’on arrive à produire ces édifices immenses, au plan si compliqué, dont le grand temple d’AmmOn à Karnak est le plus frappant exemple, édifices dont il ne semble pas qu’il y ait eu, en dehors des catastrophes politiques, de raisons décisives d’arrêter le développement indéfini à tel point plutôt qu’à tel autre, et qui auraient pu, si les événements y avaient prêté,.devenir pendant bien des siècles encore plus vastes et plus enchevêtrés dans leurs dispositions, par des adjonctions successives de constructions nouvelles. C’est ici qu’éclate, le plus, comme l’ont très bien montré MM. Perrot et Chipiez, la différence profonde des manières de concevoir le temple chez les Égyptiens et chez les Grecs. Le temple grec n’est pas susceptible, comme le temple égyptien, d’un accroissement indéfini. La Grèce n’a jamais rien produit de semblable à Karnak ou même à Louqsor. Dans les siècles où le goût du colossal remplace celui du grand, elle n’aurait encore rien conçu, rien rêvé de pareil. Le temple grec a l’unité d’un être vivant ; étant données les dimensions principales, les éléments qui composent cet ensemble ne peuvent varier que dans des limites très étroites. Suivant que l’on aura voulu déployer plus ou moins de luxe, la cella ne sera close que par un simple mur ou bien elle sera entourée de portiques ; mais ces portiques ne seront jamais qu’une sorte de parure, qu’un vêtement qui, suivant les circonstances, aura plus ou moins d’ampleur et de richesse. Derrière les colonnes qui se développent en longue file sur les grands côtés, derrière celles qui se pressent en double ou en triple rang sur les deux façades, partout on aperçoit ce que l’on peut appeler le corps même du temple, la cella, de même que, dans une statue drapée, pour peu qu’elle soit de main d’ouvrier, on sent sous l’étoffe les formes et les articulations du corps humain. Cette cella est faite à la taille du dieu qui y réside, représenté par sa statue. L’effigie divine donne la mesure de la chambre où elle est logée et détermine à la fois l’échelle et le sujet des groupes qui rempliront le champ des frontons et des bas-reliefs qui orneront les frises ; elle permet de prévoir la hauteur des colonnes et la saillie de l’entablement. Entre toutes ces parties, il y a un rapport intime et nettement défini.... Une fois les murs de la cella sortis de terre, le temple grandit et s’achève ; mais, du jour où le sol avait reçu les fondations, le temple existait virtuellement tout entier ; la place qu’il devait occuper sur le terrain et dans l’espace était arrêtée et circonscrite d’une manière définitive. Comme tous les corps organiques, le temple grec a en lui-même son principe et sa loi intérieure, qui en gouvernent tout le développement et qui l’enferment à l’avance dans des bornes qu’il ne saurait franchir. Il n’en est pas de même du temple égyptien. Dans les édifices de petite et de moyenne dimension, vous retrouvez bien quelque chose de cette belle unité et de cette simplicité du plan... Mais placez-vous au milieu des ruines d’Abydos ou de Qournah, et surtout parcourez celles de Louqsor ou de Karnak, et vous éprouverez une impression toute différente. Là vous verrez plusieurs sanctuaires accolés les uns aux autres, pareillement décorés et de même dimension. Ici c’est une succession de cours, de salles et de chambres, ce sont des files de colonnes disposées en portiques ou en quinconces, c’est un redoublement et un recommencement perpétuel ; il faut chercher longtemps pour découvrir le sanctuaire, et celui-ci n’est pas même la partie la plus élevée du temple ; il est dominé parles pylônes et par la salle hypostyle. Quand l’Égypte, arrivée au faite de sa puissance, a voulu honorer ses grands dieux par l’érection de monuments qui fussent dignes d’eux et digues d’elle-même, elle s’est donc trouvée bien vite entraînée soit à sacrifier l’unité du temple par un morcellement qui le subdivise en plusieurs nefs, soit à la dissimuler en cachant le principal sous l’accessoire, de telle sorte que le sanctuaire semble se perdre et disparaître parmi toutes ces annexes qui l’enveloppent par devant et par derrière. Le vestibule et les dépendances de toute sorte masquent la maison, la vraie maison du dieu. Si nous avons souvent peine à reconnaître la véritable destination de telle ou telle pièce de cet ensemble si vaste et si complexe, nos incertitudes s’expliquent par les lacunes que présente encore notre science des choses de l’Égypte ; mais n’est-il pas curieux et significatif que parfois, au milieu de ruines considérables et vraiment imposantes, on ne soit pas d’accord sur le point où il convient de placer ce que l’on peut appeler le cœur et comme le centre organique de l’édifice ? Ce centre existe ; il a précédé tous ces bâtiments somptueux, et c’est en quelque sorte lui qui leur a donné naissance ; mais on dirait que son action s’affaiblit et ne se fait plus sentir au delà d’une certaine distance. Aux deux extrémités, c’est par juxtaposition, à la manière des corps inorganiques, que se développe le temple ; on ne saurait donc assigner de limites à son allongement, à son accroissement successif. La division de l’armée française que commandait le général Desaix, lancée dans la Haute-Égypte à la poursuite de Mourad-Bey et de ses mamelouks, manquant de tout, dénuée de vivres, accablée par la chaleur, lorsqu’elle aperçut pour la première fois les ruines de Thèbes, oublia tout d’un coup sa fatigue, ses souffrances, le voisinage de l’ennemi, et saisie d’enthousiasme, se mit à battre des mains d’un mouvement unanime. C’est qu’en effet Thèbes, malgré tous les désastres qui ont fondu successivement pendant tant de siècles sur cette ville sainte d’Ammon, malgré l’action des eaux qui minent graduellement ses édifices par leur base, présente encore le plus grandiose et le plus prodigieux ensemble de constructions élevées par la main des hommes qui existe dans le monde. Ce sont les temples bâtis par les souverains de la XVIIIe, de la XIXe et de la XXe dynasties, à la période culminante de la puissance guerrière de l’Égypte, temples dont les parois, par les vastes tableaux sculptés et les longues inscriptions qui les couvrent, chantent avec une incomparable éloquence la grandeur de ces princes. Les siècles postérieurs n’ont que peu ajouté à leurs œuvres, et des édifices que les âges plus anciens, ceux du Moyen-Empire, par exemple, avaient pu élever à Thèbes, il ne reste à peine que de bien faibles lambeaux. C’est sur la rive orientale du Nil qu’était située la ville proprement dite de Ape-t ou T-Ape, nom dont les Grecs ont fait Thèbes, en même temps qu’ils traduisaient en Diospolis son appellation sacrée de Nî-Amoun. Le centre historique et géographique en était l’énorme groupe de temples que Ton désigne aujourd’hui sous le nom collectif de Karnak. Ce groupe d’édifices sacrés compte trois temples principaux, dédiés aux trois personnes de la grande triade thébaine, Ammon, Moût et Khousou. Le temple d’Ammon ou grand temple est le plus important de tous ceux qui subsistent en Égypte et le plus vaste édifice du monde. C’est en même temps comme un résumé de l’histoire égyptienne, car toutes les maisons royales qui se sont succédées sur le trône depuis le premier avènement de princes thébains à la souveraineté de l’Égypte, depuis la XIIe dynastie, ont tenu à honneur de contribuer à la grandeur et à l’éclat d’un temple qui était devenu le sanctuaire national par excellence. Nous donnons ici un plan du temple d’Ammon à Karnak. Sans vouloir entrer dans sa description minutieuse, qui à elle seule demanderait un volume entier, j’essaierai de résumer brièvement les principales phases de sa construction. Rien ne peut mieux montrer comment un temple égyptien fameux et vénéré se développait en magnificence et en étendue de générations en générations. Dès les temps les plus anciens un sanctuaire d’Ammon, le dieu spécial du nome de Ouas, s’éleva au point marqué II dans notre plan. Après l’affermissement de la XIIe dynastie, Ousor-tesen Ier le reconstruisit et l’on a trouvé en cet endroit les débris de l’édifice qu’il avait bâti, des colonnes prismatiques à seize pans, analogues à celles des tombeaux de Béni-Hassan. Le temple de la XIIe dynastie resta toujours le centre véritable du grand temple de Karnak, son lieu le plus vénéré, et toutes les dynasties qui suivirent le respectèrent pieusement, en l’environnant de nouvelles constructions. On ne saurait dire exactement aujourd’hui ce que cet édifice d’Ousor-tesen Ier eût à souffrir de l’invasion des Pasteurs et de l’abandon où il dut forcément demeurer pendant que les princes de Thèbes luttaient péniblement contre les étrangers. Mais après l’expulsion de ceux-ci les premiers souverains de la XVIIIe dynastie, Amon-hotpou Ier et Tahout-mès Ier en restaurèrent le sanctuaire de grès et construisirent à l’entour un temple déjà d’un certain développement, avec une salle hypostyle à 18 colonnes (9 du plan), précédée de deux pylônes successifs dont l’intervalle (7) forme comme une sorte de salle dont les ailes sont couvertes d’un plafond supporté par des colonnes, tandis que la partie centrale reste à ciel ouvert. Dans cette partie découverte la reine Hat-schepou fit dresser les deux plus grands obélisques que l’on connaisse en Égypte. Son frère Tahout-mès III, démolissant tout ce que les règnes précédents avaient pu élever au delà de la salle 9 de notre plan, construisit l’ensemble fort compliqué des chambres et des salles qui environnent 1’emplaceinent du temple de la XIIe dynastie, devenu le sêcos ou sanctuaire, et qui, dans la partie de l’opisthodome, présentent encore une fort vaste salle à colonnes (10). Le même Tahout-mès III fît aussi dresser, en avant du premier pylône de Tahout-mès Ier, deux obélisques de granit, dont un fut remplacé sous le règne de Râ-mes-sou IV.
Plan du grand temple d’Ammon à Karnak. Amon-hotpou III bâtit, à quelque distance par devant le premier - pylône de Tahout-mès Ier, un autre pylône, de plus vastes proportions. Mais ce sont les grands monarques conquérants de la XIXe dynastie qui ont doté le temple de Karnak de la partie qui le rend sans rival. Râ-mes-sou Ier y construisit un énorme pylône (plan V), précédant tous ceux qui existaient déjà, et dans l’intervalle entre ce pylône et celui d’Amon-hotpou III, Séti Ier fit édifier la grande salle hypostyle (IV), qu’acheva son fils Râ-mes-sou II, la plus prodigieuse salle de l’Égypte et de l’univers, la merveille incomparable de Thèbes, dont nous avons déjà signalé (tome II) la précieuse décoration de grands bas-reliefs historiques, couvrant les murailles tout autour. L’imagination, dit Champollion, qui en Europe s’élève bien au-dessus de nos portiques, s’arrête et tombe impuissante au pied des cent trente-quatre colonnes de la salle de Karnak... Je me garderai bien de rien décrire, car ou mes expressions ne vaudraient pas la millième partie de ce qu’on doit dire en parlant de tels objets, ou bien, si j’en traçais une faible esquisse, même très décolorée, je passerais pour un enthousiaste, et peut-être même pour un fou. — Imaginez, dit à son tour J.-J. Ampère, une forêt de tours ; représentez-vous cent trente-quatre colonnes égales en grosseur à la colonne de la place Vendôme, dont les plus hautes (les douze de la nef centrale) ont soixante-dix pieds de haut (c’est presque la hauteur de notre obélisque) et onze pieds de diamètre, couvertes de bas-reliefs et d’hiéroglyphes ; les chapiteaux ont soixante-cinq pieds de circonférence ; la salle a trois cent dix-neuf pieds de largeur et plus décent cinquante de longueur. Cette salle était entièrement couverte, et l’on voit encore une des fenêtres qui l’éclairaient. — Il est impossible, écrivait à son tour M. Lepsius, de rendre l’impression qu’on éprouve quand on entre pour la première fois dans cette forêt de colonnes et qu’on s’y promène de rang en rang, entre ces ligures de dieux et de rois, tantôt en entier, tantôt en partie. Tous les murs sont couverts de sculptures peintes, les unes en relief, les autres en creux ; elles n’ont été achevées que sous les héritiers de Séti et surtout sous Râ-mes-sou II, son fils. Râ-mes-sou II construisit aussi un temple complet, avec toutes ses parties, mais de dimensions qui paraissent minimes à côté de celles du grand temple, qu’il adossa au fond de celui-ci, dans le même axe, mais orienté de la manière exactement inverse, avec son entrée à l’est, tandis que celle du grand temple est à l’ouest. Pendant longtemps ce grand temple n’eut pas d’autre façade que le pylône de Râ-mes-sou Ier (V). Mais, une fois devenus maîtres de Thèbes, les rois Bubastites de la XXIIe dynastie établirent en avant la vaste cour VI, avec ses deux colonnades latérales (c-d et f-g), sur le mur extérieur d’une desquelles Scheschonq Ier a fait sculpter, avec leurs noms, les personnifications des 133 villes conquises dans son expédition de Palestine (voyez tome II). Ils englobèrent ainsi dans leurs constructions et réunirent au temple principal un temple distinct et complet en lui-même, avec salle hypostyle et sanctuaire, long en tout de 200 pieds, que Râ-mes-sou III, de la XXe dynastie, avait édifié perpendiculairement à l’axe du grand temple, avec son entrée au nord (1), et un petit édifice du règne de Séti II (2), composé de trois salles, qui se trouve vers l’angle nord-ouest de la cour. L’Éthiopien Taharqa, dans les années de ses victoires sur les Assyriens, éleva les colonnes monumentales, primitivement surmontées de symboles divins, qui se dressent sur deux lignes parallèles au milieu de la cour des Bubastites. Les édifices de, Karnak souffrirent de grandes dévastations lors du sac de Thèbes par les Assyriens d’Asschour-bani-abal et du passage de l’armée dirigée contre l’Ethiopie par le Perse Kambouziya. Quand les Macédoniens devinrent les maîtres de l’Égypte, une partie des constructions de Tahout-mès III et le temple d’Ousor-tesen Ier étaient en ruines. Ptolémée, fils de Lagos, au temps où il gouvernait l’Égypte en se donnant encore pour le lieutenant d’Alexandre, fils, de Rhoxane, et de Philippe Arrhidée, les deux successeurs nominaux d’Alexandre le Grand, entreprit des travaux considérables en cet endroit. On ne releva pas le petit temple de la XIIe dynastie et l’on en conserva les débris tels qu’ils étaient, comme une sorte de relique, mais en avant, entre ce temple (II) et la salle à dix-huit colonnes de Tahout-mès Ier (9), on construisit ce qu’on appelle aujourd’hui les appartements de granit, avec au milieu un nouveau sanctuaire (I), destiné à remplacer l’ancien, tombé en ruines. Enfin ce furent les Lagides qui élevèrent le gigantesque pylône fermant du côté de l’ouest la cour des Bubastites et y donnant accès (VII), ainsi que le propylon (VIII), placé en tête de l’avenue de sphinx qui y conduit. La construction du grand temple de Karnak se répartit donc sur une durée de tout près de 3.000 ans, pendant laquelle toutes les époques ont apporté leur pierre à l’embellissement de la demeure sacro-sainte de l’Ammon de Thèbes. C’est grâce au travail de tant de siècles que ce temple est parvenu aux dimensions prodigieuses de 366 mètres de long sur 106 de large pour l’étendue enfermée dans un mur de pierre continu, depuis le premier pylône jusqu’au fond des dernières chambres placées derrière le sanctuaire. Si on y ajoute l’avenue de sphinx et son propylon, à une extrémité, à l’autre le temple adossé par Râ-mes-sou II au principal, on trouve que l’ensemble des constructions occupe une longueur de 808 mètres sur son grand axe. Le grand temple d’Ammon n’était pas le seul de Karnak. Il y en avait aussi deux autres, de dimensions moins extraordinaires, bien que déjà fort vastes, dédiés à la mère et au fils de la triade divine de Thèbes, Moût et Khonsou, chacun ayant son enceinte distincte. Le temple de Moût est au sud du temple d’Ammon, au delà du lac sacré dépendant de ce dernier. Il a été construit par Amon-hotpou III, et sa façade, pour des raisons mystiques, était tournée vers le nord. Un lac sacré l’entourait de trois côtés. Les ruines en sont aujourd’hui dans le plus déplorable état de bouleversement. Tout autour des deux cours de ce temple étaient disposées, serrées les unes contre les autres, 500 statues assises en granit noir de la déesse léontocéphale Sekhet. Beaucoup, comme de juste, ont été détruites dans la suite des âges, on en a transporté dans tous les musées de l’Europe ; mais il en reste encore en place une multitude, les unes enfouies sous les décombres, les autres surgissant du sol et présentant au visiteur le plus étrange aspect. Une avenue de sphinx reliait le temple de Moût au temple d’Ammon. Pour y conduire de celui-ci, quatre cours successives, précédées d’autant de pylônes, ont été appliquées à son flanc sud, communiquant avec l’intervalle entre le pylône de Tahout-mès Ier et celui d’Amon-hotpou III. Le premier des quatre pylônes de ces cours latérales du sud, en venant du grand temple (5 de notre plan), est du règne de Tahout-mès III, le second (6) de celui de la reine Hat-Schepou ; les deux autres, qui se trouvent en dehors des limites de notre plan, datent du roi Hor-em-heb ; ils ont été construits en partie avec les débris de la pyramide à la mode asiatique, couverte de somptueuses sculptures, qu’Amon-hotpou IV, Khou-n-Aten, avait commencé à élever en cet endroit même en l’honneur de son dieu Aten, dont il voulait substituer le culte à celui d’Ammon (voyez tome II). Sur le flanc de la cour le plus au sud est un reposoir monumental pour les processions, construit sous Amon-hotpou II. Le temple de Khonsou se trouve au sud de la cour des Bubastites, à l’ouest des cours dirigées du temple d’Ammon vers celui de Moût. Sa façade est tournée vers le sud, regardant le côté de» Louqsor. C’est un édifice d’une seule venue, avec pylône, cour à portiques, salle hypostyle et sanctuaire entouré de chambres accessoires, très remarquable par l’unité et la simplicité classique de son plan. Il a été commencé par Râ-mes-sou III, terminé par Her-Hor et ses successeurs, les usurpateurs de la famille des grands-prêtres d’Ammon. Au flanc nord de l’enceinte extérieure ou péribole du grand temple s’appuie une autre enceinte sacrée, qui enferme les ruines d’un second temple d’Ammon, bâti par Amon-hotpou III et restauré sous les Ptolémées, ainsi que d’un certain nombre de chapelles isolées de différentes époques. Un dromos pavé, de 2 kilomètres de longueur, bordé de 1.200 criosphinx colossaux, à corps de lion surmonté d’une tête de bélier, part de la façade du temple de Khonsou pour aboutir à celle du grand temple de Louqsor. Cette avenue reliait entre eux les deux centres religieux de Ape-t (Karnak) et Ape-t-rès (Louqsor), unis par une étroite communauté de culte et servait au parcours des processions solennelles qui, dans les jours de fête, allaient de l’un à l’autre. Aussi le temple de Louqsor a-t-il sa face tournée vers Karnak. Le plan de ce temple est d’une grande irrégularité, motivée en partie sur ce que les architectes ont dû suivre la direction du quai du fleuve, sur lequel il était construit. Ici, du reste, nous avons encore affaire à un assemblage de monuments de différents règnes. La partie la plus ancienne, le temple principal avec le sanctuaire, est l’œuvre d’Amon-hofpou III ; au nord de ce premier temple, une galerie de colonnes conduit à un second, élevé par Râ-mes-sou II, dont le pylône extérieur porte le grand tableau de la bataille de Qadesch ; il est accompagné d’une copie épigraphique du poème de Pen-ta-our sur cette bataille. Les temples de Louqsor occupent une superficie de 2.500 mètres carrés. Le quartier ou faubourg de Thèbes, situé sur la rive occidentale du Nil, entre le fleuve et la montagne, avait reçu des Grecs le nom de Memnonia, de l’égyptien mennou, monument et spécialement monument funéraire. C’était un quartier fort habité et dans lequel se concentraient les nombreuses professions qui avaient trait aux funérailles ; car il conduisait aux diverses nécropoles, creusées, comme nous l’avons déjà dit, dans les flancs de la montagne de l’ouest. En avant du pied de cette montagne était comme une chaîne presque ininterrompue de temples, dont quelques-uns d’un développement considérable et d’une grande magnificence. Ce sont ceux qui avaient été destinés au culte funèbre et aux cérémonies commémoratives en l’honneur des rois de la XVIIIe à la XXe dynastie, enterrés dans les hypogées de la vallée de Biban-el-Molouk. Il n’y a que quelques-uns de ces temples dont les ruines aient été préservées. Le premier, en en commençant la visite par le nord, est le temple de Qournah, la maison de Séti, comme l’appellent les inscriptions ; il a été bâti par Séti Ier à la mémoire de Râ-mes-sou Ier, son père, et continué par Râ-mes-sou II en l’honneur de son père Séti. Le plan s’en écarte sur plusieurs points importants de celui des temples ordinaires, et la sculpture des bas-reliefs y est d’une exquise finesse. Vient ensuite, au fond d’une vallée qui pénètre dans le flanc de la montagne, le temple de Deïr-el-Bahari, œuvre de la reine Ha-t-Schepou. Précédé d’une longue avenue de sphinx, il s’élève par une série de terrasses successives, dans lesquelles l’influence de l’architecture des bords de l’Euphrate est manifeste. Ses sanctuaires sont au nombre de trois, parallèles entre eux et creusés dans le rocher auquel le temple est adossé, en manière de grottes sacrées ou spéos, comme disaient les Grecs. C’est dans une des salles du temple de Deïr-el-Bahari que se trouvent les si curieux bas-reliefs historiques représentant les scènes de l’expédition de la flotte de Ha-t-Schepou au pays de Pount. Plus au sud-est est le temple, consacré tout entier à la gloire de Râ-mes-sou II, que Champollion a nommé le Ramesséum. Les Grecs, à qui les exégètes égyptiens en avaient appris la destination funèbre, l’appelaient le Tombeau d’Osymandias, et c’est sous ce nom qu’il a été décrit par Diodore de Sicile. C’était un vaste et somptueux édifice, avec deux cours entourées de portiques, une. salle hypostyle soutenue par 48 colonnes et d’autres salles à colonnes précédant le sanctuaire. La largeur en est de 68 mètres, la longueur de 180. Dans les dépendances autour du sanctuaire étaient une bibliothèque et une salle d’archives ; Râ-mes-sou II avait fait comme les souverains du monde musulman qui, à côté du turbeh où ils reposent et de leur mosquée funéraire, établissent un médreçh, ou école religieuse. Dans la première cour s’élevait un colosse de granit de 17 mètres de haut, représentant le roi assis sur son trône. Les débris en encombrent une partie de la cour. C’est la plus grande ruine de statue qu’il soit possible de voir ; le pied seul a plus de quatre mètres de long. Le temple funéraire d’Amon-Hotpou III, situé tout auprès, était construit en calcaire. Il a été démolit jusqu’aux fondations et les fours à chaux en ont dévoré tous les matériaux. Seuls, les deux colosses dits de Memnon, qui étaient originairement devant le pylône extérieur, des deux côtés de l’entrée, sont restés debout et dressent leur silhouette solitaire au milieu de la plaine.
Plan des édifices sacrés de Médinet-Abou. I. Temple de Tahout-mès III. — II. Pavillon royal de Râ-mes-sou III. — III. Pylône extérieur du grand temple de Râ-mes-sou III. — IV. Première cour. — V. Seconde cour. — V. Salle hypostyle. Plus au sud encore, à Médinet-Abou, nous trouvons un petit temple, œuvre de Tahout-mès III, et un autre plus grand, créé d’un seul jet par Râ-mes-sou III pour servir à son culte commémoratif. C’est là qu’il a fait sculpter les grands tableaux représentant ses guerres victorieuses, que nous avons fait passer sous les yeux de nos lecteurs dans le volume précédent. Ce temple a deux grandes cours à péristyles, une salle hypostyle assez restreinte, qui ne compte que 24 colonnes, et, comme au Ramesséum, deux autres salles à colonnes précédant le sanctuaire. La longueur totale est de 145 mètres environ. Là paraît encore avoir été une bibliothèque, car plusieurs fois, en fouillant dans les chambres encore encombrées de terre qui environnent le sanctuaire, les fellahs ont découvert des cassettes remplies de papyrus littéraires, dont une partie seulement a pu être préservée et transportée dans les musées. Entre Médinet-Abou et le Ramesséum, mais plus à l’ouest, sur les pentes de la montagne, à Deïr-el-Médineh, est un petit temple, reconstruit en partie sous les Lagides. Il était consacré à la déesse Ma, la déesse de la justice, et parmi les sculptures on remarque la scène du jugement de l’âme au tribunal d’Osiri. Les processions des funérailles faisaient une station à ce sanctuaire, avant de conduire le mort à sa dernière demeure dans les nécropoles voisines. Les ruines de Thèbes sont les plus considérables et les plus majestueuses de toute l’Égypte. Aussi devrions-nous en parler avec un certain développement. Mais il ne faudrait pas croire qu’elles fussent les seules qui subsistent sur les bords du Nil. En général les temples des cités de la Basse-Égypte, principalement bâties en briques crues et où la pierre ne servait qu’à faire des colonnes et des revêtements, ne sont pas restés debout. Mais on en reconnaît les emplacements, avec leurs grandes enceintes et les vastes buttes de décombres qui marquent le site de l’édifice, écroulé sur lui-même. Les fouilles, quand on les y entreprendra, seront certainement fructueuses. Un des points où l’on peut compter qu’elles donneront le plus est Saïs, où se dessine avec une extrême netteté, par un amas énorme et confus de masses de maçonnerie en briques et de débris de toute nature, l’emplacement du fameux temple de Nit, avec sa façade tournée vers l’est, que les rois de la XXVIe dynastie s’étudièrent à l’envi à reconstruire et à embellir magnifiquement. Les seules ruines de la Basse-Égypte qui aient été fouillées par Auguste Mariette sont celles de Tsân ou Tanis. Les trois temples que renfermait l’enceinte sacrée de cette ville, dont un énorme, ont été bouleversés jusqu’aux fondations depuis l’antiquité par des mains dévastatrices. Mais les excavations de notre savant compatriote n’en ont pas moins donné des résultats capitaux pour la connaissance de l’histoire et de la religion. Onze obélisques, de nombreuses colonnes monolithiques de granit, des statues et des stèles colossales retirées des décombres, attestent que le grand temple de Tanis, quand il était entier, pouvait marcher de pair avec ceux de Thèbes. La XIIe et la XIIIe dynasties, sous lesquelles le temple était dédié à Phtah, l’âge des Pasteurs, qui le consacrèrent à leur dieu Soutekh, les règnes de Râ-mes-sou II, qui le dédia ensuite à Râ-Harmakhouti, de Mi-n-Phtah et de Séti II, les XXIIe et XXIVe dynasties, originaires de Pa-Bast et de Tsân même, sont les époques qui ont surtout laissé leurs vestiges parmi ces débris. Au temps de Strabon, les fameux sanctuaires de On ou Héliopolis, dévastés par le Perse Kambouziya, au temps de sa démence furieuse, étaient déjà dans le plus déplorable état de délabrement. Dans le moyen âge ils ont servi de carrière pour la construction du Caire. Aussi ne voit-on plus aujourd’hui sur leur emplacement, à Matarieh, que les restes de la grande enceinte en briques qui les enveloppait, quelques pans de murs informes et un obélisque d’Ousor-tesen Ier, resté debout comme par miracle au milieu de la destruction générale. Man-nofri ou Memphis, la plus antique capitale de l’Égypte, était encore une plus grande ville que Thèbes, et surtout dans les derniers siècles d’existence de la civilisation égyptienne, de même qu’à ses époques primitives, elle la primait de beaucoup en importance. Son grand temple de Phtah était aussi vaste et aussi magnifique, sinon plus, que celui d’Ammon à Karnak. Depuis Mena jusqu’aux derniers Ptolémées, toutes les dynasties qui régnèrent sur l’Égypte y avaient travaillé. Les guides d’Hérodote lui montrèrent dans ce temple des parties importantes, des cours, des portiques, des salles portant les cartouches de tous les grands souverains des longues annales de l’empire des Pharaons. Strabon y signale un sanctuaire d’architecture barbare, du genre de celui que l’on a découvert auprès du grand Sphinx de Gizeh. Malheureusement, sur les seules indications des écrivains grecs, il est impossible de se faire une idée exacte de ce que pouvaient être les dispositions du grand temple de Phtah, qui paraissent avoir été, par suite des additions successives de cinquante siècles, plus compliquées encore que celles du grand temple de Karnak. L’emplacement s’en reconnaît encore, au village de Mit-Kahineh, sous une épaisse forêt de dattiers ; mais il ne présente plus que des buttes confuses et informes de décombres, où il est impossible de retrouver la trace d’un plan. Au XIIe siècle de notre ère, avant les grands développements dû Caire sous les Ayoubites, les ruines de Memphis étaient encore la merveille de l’Égypte. Nous le savons par la description qu’en donne un des plus judicieux écrivains arabes, ‘Abd-el-Latyf, qui a écrit son livre en 1190. Malgré l’immense étendue de cette ville et la haute antiquité à laquelle elle remonte, dit-il, nonobstant toutes les vicissitudes des divers gouvernements dont elle a successivement subi le joug, quelques efforts que différents peuples aient fait pour l’anéantir, en faisant disparaître jusqu’aux moindres vestiges, effaçant jusqu’à ses plus légères traces, transportant ailleurs les pierres et les matériaux dont elle était construite, dévastant ses édifices, mutilant les figures qui en faisaient l’ornement ; enfin, en dépit de ce que quatre mille ans et plus ont dû ajouter à tant de causes de destruction, ses ruines offrent encore aux yeux des spectateurs une réunion de merveilles qui confond l’intelligence et que l’homme le plus éloquent entreprendrait inutilement de décrire. Plus on la considère, plus on sent augmenter l’admiration qu’elle inspire, et chaque nouveau coup d’œil que l’on donne à ses ruines est une cause d’admiration. Ce qui a le plus frappé ‘Abd-el-Latyf est ce qu’on appelait la Chambre verte, naos monolithe de neuf coudées (4 m. 86) de hauteur, huit (4 m. 32) de profondeur et sept (3 m. 78) de largeur, en brèche verte. Il ajoute ensuite : On voit au même endroit des piédestaux établis sur des bases énormes. Les pierres provenant de la démolition des édifices remplissent toute la surface de ces ruines ; on trouve en quelques endroits des pans de murailles encore debout... ; ailleurs il ne reste que les fondements ou bien des monceaux de décombres. J’y ai vu l’arc d’une porte très haute, dont les deux murs latéraux ne sont formés chacun que d’une pierre ; et la voûte supérieure, qui était d’une seule pierre, était tombée au-devant de la porte... Quant aux figures d’idoles que l’on trouve parmi ces ruines, soit que l’on considère leur nombre, soit qu’on ait égard à leur prodigieuse grandeur, c’est une chose au-dessus de toute description et dont on ne saurait donner une idée ; mais ce qui est encore plus cligne d’exciter l’admiration, c’est l’exactitude de leurs formes, la justesse de leurs proportions, et leur ressemblance avec la nature. Nous en avons trouvé une qui, sans son piédestal, avait plus de trente coudées (16 m. 20). Cette statue était d’une seule pierre de granit rouge ; elle était recouverte d’un vernis rouge, auquel son antiquité semblait ne faire qu’ajouter une nouvelle fraîcheur. Plus loin encore : J’ai vu deux lions placés en face l’un de l’autre à peu de distance ; leur aspect inspirait la terreur. On avait su, malgré leur grandeur colossale et infiniment au-dessus de la nature, leur conserver toute la vérité des formes et des proportions. Ils ont été brisés et couverts de terre. Tel était l’état des ruines de Memphis à la fin du XIIe siècle, au temps des Croisades, avant que les pierres de ses temples eussent été s’engloutir une à une dans les constructions du Caire. On ne peut lire cette description près des buttes de décombres de Myt-Rahyneh sans éprouver un vrai serrement de cœur en pensant à tant de trésors, d’art et d’archéologie détruits par la barbarie des hommes à une date si rapprochée de nous. On ne voit plus aujourd’hui, sur l’emplacement de la ville même de Memphis et de son pompeux sanctuaire, que deux colosses renversés de Râ-mes-sou II, l’un en granit rose (peut-être celui dont parlé ‘Abd-el-Latyf), l’autre en calcaire siliceux ; ce dernier est d’un art admirable. Ces deux statues se trouvent, avec une grande stèle de Ouah-ab-Râ (XXVIe dynastie), relatant ses donations, eh fonds de terre et ses travaux d’embellissement au temple de Phtah, près du lac sacré de ce temple, dont là dépression occupe le centre des ruines. Les fouilles que l’on a plusieurs fois tenté dans les buttés avoisinantes n’ont donné aucun résultat de quelque valeur. Le seul, temple de Memphis qui ait échappé à la destruction, a été conservé par son enfouissement sous, les sables venus dû désert. Il n’était pas, du reste, situé dans la ville, mais dans une de ses nécropoles, à Ka-kam, aujourd’hui Saqqarah. C’est le Sérapêion, si heureusement rendu à la lumière par les excavations de A. Mariette, qui servait à la sépulture des taureaux Hapi. J’en ai dit assez plus haut pour n’avoir pas besoin d’y revenir. C’est la Haute-Égypte qui offre au voyageur, .en dehors même de Thèbes ; toute une série de temples somptueux encore debout et quelques-uns presque intacts. On rencontre ainsi l’un après l’autre, en remontant le fleuve, ceux de Dendérah ou Tentyra (Tantarer ou Tsa-noutri), d’Hermonthis (On-Monthou), d’Esneh ou Latopolis (Snî), d’Edfou ou Apollonopolis (Deb), d’Ombos (Noubit), et enfin de Philæ (Aalak ou Pi-lak). Tous ceux que je viens d’énumérer datent de l’époque des Lagides et de celle des Empereurs romains, où ils ont été reconstruits conformément aux traditions de l’art pharaonique et sur des emplacements consacrés par une succession de temples antérieurs depuis les âges les plus reculés. Ces temples ptolémaïques, d’un art plus que médiocre et portant l’empreinte d’une pleine décadence, offrent un grand intérêt par les renseignements que leurs inscriptions fournissent sur la destination des différentes pièces de l’édifice, et par les textes mythologiques qui y tiennent bien plus de place que sur les murailles des temples pharaoniques. Mais nous ne nous y arrêterons pas, leur date les plaçant en dehors du cadre historique de notre livre. En revanche, nous devons dire quelques mots du temple de l’antique Aboud ou Abydos, l’un des plus Vastes et des plus beaux comme art de toute l’Égypte, dont le déblaiement est entièrement dû à Auguste Mariette et a été l’une des œuvres, capitales de sa carrière de fouilleur. C’est un monument du règne de Séti Ier. Le plan en est tout particulier, fort différent de celui des autres temples égyptiens.
Plan du grand temple d’Abydos. Les cours extérieures et les pylônes, qui conduisaient à la porte d’entrée principale, sont détruits, dit M. Ebers, mais les chambres intérieures du temple sont merveilleusement conservées et font aujourd’hui encore une grande impression sur le spectateur. Sept chapelles accotées l’une à l’autre (V. c-d du plan), et qui étaient considérées chacune comme un saint des saints, forment le noyau de l’édifice. De même qu’on fermait les grands sarcophages en pierre de couvercles arrondis à l’intérieur, représentant le firmament étoile qui s’étend par-dessus le monde et par-dessus le défunt, les sanctuaires d’Abydos sont recouverts de voûtes d’une belle courbure ménagées dans la pierre de taille. Au fond de chacun d’eux, on voit encore la niche où se dressait le tabernacle de la divinité, et on trouve, sur le montant, les cavités où les gonds de bronze des portes s’enchâssaient. On adorait une grande divinité dans chacun de ces sanctuaires : au milieu (a), Ammon de Thèbes ; à sa gauche (e, f, g), Har-m-akhouti l’Héliopolitain, Phtah de Memphis et le roi Séti, considéré comme incarnation de Râ sur cette terre ; à sa droite (b, c, d), Osiri, Isi et Hor... Sept portes (III, a-g), aujourd’hui toutes murées, à l’exception d’une seule, conduisaient de la seconde cour dans le temple et aux deux larges salles hypostyles, qu’on devait traverser pour arriver aux sanctuaires. Le toit de la première salle (III) est supporté par vingt-quatre colonnes, celui de la seconde (IV), qui est plus belle et plus grande, par trente-six. Dans l’une, elles sont réparties entre six groupes de quatre, dans l’autre entre six groupes de six, et les intervalles qui séparent ces groupes de colonnes, comme ceux qui passent entre les rangées de colonnes et les parois extérieures, sont autant de chemins qui mènent directement aux portes des sanctuaires. Lorsqu’on désirait parvenir à la chapelle d’Ammon parle passage du milieu (a), on n’apercevait plus, de droite et de gauche, partout où portait l’œil, que tableaux et inscriptions qui se rapportent à Ammon. Quand on se rendait au saint des saints d’Osiri par la nef qui y correspond, de quelque côté qu’on regardât, on ne voyait rien qui n’eût trait au maître du monde inférieur. De même pour l’ornementation de chacune des voies qui menaient, au fond delà grande salle, jusqu’à chacune des chambres voûtées. Aucun profane, ce sont les inscriptions qui nous l’apprennent, ne pouvait s’approcher de ces chambres sacrées ; il fallait, pour en obtenir l’accès, se soumettre à beaucoup de cérémonies préliminaires. Seuls, les prêtres du rang le plus élevé et le roi pouvaient pénétrer dans les sanctuaires, tandis que les processions s’arrêtaient dans la seconde salle. Chants, flûtes, harpes, aucune musique ne devait résonner dans ce temple ; c’était un cénotaphe, le tombeau honorifique d’un mort enterré ailleurs, que Séti Ier s’était construit, peut-être sur l’emplacement d’un ancien temple, dont dès inscriptions remontant à la XIIe dynastie nous racontent la restauration ; Le corps du roi reposait à Thèbes, il fallait que son nom fût placé près de la tombe d’Osiri d’Aboud, et sur la même ligne que celui de son prédécesseur divin, pour y recevoir de la postérité des offrandes et un culte, en même temps que le dieu auquel était réunie son âme. Les inscriptions nous enseignent que les prêtres devaient faire le tour de chaque chapelle, y accomplir trente-six cérémonies ; réciter des litanies pieuses, soulever les voiles qui recouvraient les statues ou les emblèmes des dieux, parer les images de bandelettes, de couronnes, d’étoffes, et leur témoigner leur vénération par des attitudes strictement prescrites. Dans les chambras qui occupent l’aile du temple en retour survie côté des sept sanctuaires, on faisait à l’avance certains préparatifs. Ils paraissent avoir été surtout nécessaires au culte qu’on célébrait dans la chapelle d’Osiri ; car c’est dans celle-ci seule que s’ouvre une porte conduisant à la salle à colonnes (VI) et à plusieurs chambres qui s’y relient. Sur les colonnes et sur les murs de ce magnifique cénotaphe, le Pharaon s’incline pour, verser des libations aux dieux, leur brûle des parfums, s’agenouille et reçoit leurs dons, les attributs de la domination ouïes symboles des biens-les plus précieux de la vie... Chacune des sculptures qui datent du règne de Séti lui-même porte le cachet de la perfection ; mais bientôt après sa mort, il semble que les grands maîtres qui maniaient le ciseau pour lui aient cessé de travailler ; les nombreuses représentations du temps de Râ-mes-sou II, et les rangées d’hiéroglyphes de la première salle hypostyle et du vestibule (II), dont le plafond était porté par douze piliers carrés, sont bien inférieures comme valeur d’art à celles qui datent des années de Séti Ier. Séti avait vécu assez pour voir terminer le gros œuvre de son cénotaphe ; c’est ce que prouvent les tenons de bois en queue d’aronde encastrés entre les blocs pour en augmenter l’adhérence, et qui tous portent son cartouche. Mais il dut laisser à son successeur le soin de terminer l’ornementation extérieure ; une longue inscription, gravée sur la face postérieure du mur du vestibule, nous apprend de quelle manière Râ-mes-sou II s’acquitta de ce devoir filial. À quelque distance au nord du temple de son père Séti, Râ-mes-sou s’en était construit un pareil pour lui-même. Mais il a été presque complètement détruit. Quant au temple d’Osiri, où l’on prétendait montrer le tombeau du dieu, il n’en reste plus pierre sur pierre. On voit seulement, au nord des deux temples dont nous venons de parler, la grande enceinte en briques qui le renfermait, et où était également l’escalier symbolique s’enfonçant dans la terre, pour représenter le lieu de la descente du Soleil dans les ténèbres de l’hémisphère inférieur. Les oasis du désert Libyque, où les Pharaons avaient étendu leur domination de bonne heure et fait pénétrer la religion de l’Égypte avec la civilisation, présentent aussi des temples dans un état de conservation .très remarquable. On n’a que des renseignements très incomplets sur celui de l’oasis d’Ammon, appelé par les Égyptiens Sokhet-Am, le Champ des dattiers, temple qui était le siège du fameux oracle qu’alla consulter Alexandre le Grand. Mais les temples de la ville de Heb, Hibis des Grecs, chef-lieu de la Grande Oasis, nommée des Égyptiens Kenem ou Ouit-rès, ont été étudiés par M. Brugsch. Le plus ancien et le moins considérable date du règne de Tahout-mès II ; le plus important a été élevé sous le Perse Darayavous, fils de Vistâçpa (Darius, fils d’Hystaspe). Il était consacré aux dieux de la triade thébaine, Ammon-Râ, Mout et Konsou, auxquels étaient associés Schou et Tef-nout de Théni ; en outre, on y célébrait clans les chambres de l’étage supérieur, accessibles aux seuls prêtres, les mystères de l’Osiris d’Aboud. La domination des souverains de la XVIIe et de la XIXe dynastie a aussi garni de nombreux sanctuaires échelonnés sur les rives du Nil en Nubie, depuis la première cataracte ou Qor-ti, comme disaient les Égyptiens, jusqu’à la troisième. Leurs constructions religieuses y avaient été précédées par celles des rois de la XIIe dynastie, au moins sur plusieurs points comme Sammina, aujourd’hui Semneh, et Bohon, aujourd’hui Ouady-Halfah. Le type qui prédomine dans les temples de cet ancien pays de Qens est celui du spéos ou du sanctuaire taillé dans le rocher en manière de grotte. Il est, au contraire, singulièrement rare dans l’Égypte propre. Ceci semble indiquer que si les architectes égyptiens l’adoptèrent en Nubie de préférence à tout autre, ce fut pour se conformer à un antique usage religieux des populations de la contrée. Les plus extraordinaires de ces spéos nubiens sont ceux d’Imbsamboul, l’antique Pa-mes-sou, dans le canton d’Aboschek. Ils sont au nombre de deux, et le plus grand, celui qu’on appelait Hat-dou-ab, la Demeure de la montagne sainte, consacrée à Ammon, Râ, Phtah et le roi Râ-mes-sou II, est un véritable prodige. On a su lui donner, dans les entrailles de la montagne, les proportions d’un véritable temple, de 55 mètres de profondeur, avec deux salles hypostyles successives, la première soutenue par huit piliers auxquels s’adossent des colosses de trente pieds de haut, la seconde par quatre piliers seulement, des chambres latérales et un sanctuaire au fond. Les parois des deux grandes salles sont couvertes de grands bas-reliefs historiques, qui ont conservé toute la fraîcheur de leur coloration primitive. La façade extérieure est garnie de quatre colosses, hauts de soixante-cinq pieds chacun, sculptés à même la montagne et représentant le roi Râ-mes-sou II, auteur du monument, assis et la tête coiffée du skhent complet. Ces masses extragigantesques, dit Charles Lenormant, sont traitées d’une manière plutôt large que précieuse, sauf les têtes auxquelles je n’ai rien vu d’égal pour la vérité, la vie et le modelé. Winckelmann n’a pu tracer d’autres règles pour cette beauté calme qu’il regarde comme le comble de l’art. La Junon Ludovisi, quatre fois au moins plus petite, ne l’emporte pas par le sentiment de l’ensemble, par l’harmonie de tant de parties simultanément étendues, Donnez le mouvement à ces rochers, et l’art grec sera vaincu. § 8. — PALAIS Les premiers voyageurs qui ont visité les ruines des bords du Nil, les savants dé la Commission d’Égypte, par exemple, destitués du secours de la lecture des textes hiéroglyphiques et encore peu au fait des usages de la civilisation pharaonique, ont pris la plupart des temples pour des palais. Personne aujourd’hui n’en méconnaît plus la destination religieuse, mais, bien que cette vérité soit définitivement établie, beaucoup d’archéologues n’ont pas encore réussi à s’affranchir de l’idée qui a si longtemps été dominante. Ils en gardent quelque chose et soutiennent une opinion moyenne, d’après laquelle l’habitation royale aurait été une dépendance du temple ; ils la cherchent, à Karnak comme à Louqsor, dans les pièces qui se trouvent en arrière du sanctuaire. C’est là que le roi aurait eu sa demeure, et sa vie se serait passée dans les cours et dans les salles hypostyles. Parmi tous les documents qui ont été recueillis dans ces parties de l’édifice, disent avec raison MM. Perrot et Chipiez, il n’en est pas un qui confirme cette hypothèse ; ni dans le reste de la littérature égyptienne, ni même chez les historiens grecs, on ne saurait trouver un texte qui prouve ou qui même tende à faire croire que les rois aient jamais vécu dans le temple ou dans ses dépendances, qu’ils aient habité l’intérieur de l’enceinte sacrée. Voici d’ailleurs qui est peut-être plus concluant encore que le silence même des textes. Rappelez-vous ce qu’était le temple égyptien avant que le temps en eût émietté les enceintes, troué les murs et défoncé les plafonds. Arrivez, par un effort d’esprit, à vous le représenter dans son état ancien, et vous comprendrez que les rois n’ont jamais dû songera choisir comme leur résidence favorite ces lieux fermés et sombres. Aussi bien que leurs sujets, les princes égyptiens devaient être, pour la plupart, d’humeur sereine et gaie ; qu’il s’agisse des grands du royaume ou des humbles et des petits, pas d’expression qui se répète plus souvent dans les textes égyptiens que celle-ci : Faire un jour de bonheur. Le palais devait être une maison d’agrément, un lieu de repos ; or était-il rien qui pût être mieux approprié à ces fins que des édifices légers et spacieux, situés hors de la ville, au milieu des jardins amples et touffus, sur le bord du Nil ou de l’un des mille canaux qui en portaient l’onde jusqu’aux limites du désert ? Des balcons, des galeries hautes, des terrasses couvertes, l’œil se promenait sans obstacle sur les plantations voisines, sur le cours du fleuve et sur les campagnes qu’il arrosait, sur les montagnes qui bornaient l’horizon. Les chambres avaient de larges fenêtres ; des volets mobiles,-que l’on distingue dans certaines peintures, permettaient d’ouvrir l’appartement à l’air et à la lumière, ou d’y faire-la nuit pendant les heures chaudes de l’après-midi. Cette ombre qui, dans les pays d’ardent soleil, est le plus délicieux de tous les biens, on la trouvait encore,-à l’extérieur, sous les sycomores et les platanes, autour des bassins où s’épanouissaient les brillantes corolles du lotus ; on la trouvait, embaumée d’odeurs printanières, sous les berceaux de feuillage et les treilles chargées de fruits ou dans les kiosques ajourés qui se dressaient, de place en place, sur la rive des étangs. Là, derrière l’abri de haies discrètes et de murs épais, le roi pouvait appeler à lui son harem, jouir des ébats de ses jeunes enfants et de la beauté de ses femmes. Là, ses campagnes finies, un Tahout-mès ou un Râ-mes-sou s’abandonnait paresseusement à la douceur de vivre, sans vouloir se souvenir des fatigues de la veille, ni penser aux soucis du lendemain ; comme on dirait aujourd’hui en Égypte, il faisait son kief. Pour cette architecture dans laquelle tout, ensemble et détails, était combiné en vue des jouissances de l’heure présente, on n’avait pas besoin de la pierre ; c’était pour la tombe, c’était pour les temples des dieux, pour ce qui devait durer éternellement, qu’il fallait compter sur la solidité du calcaire, du grès et du granit. Le palais n’était qu’une tente dressée pour le plaisir ; il ne réclamait pas d’autres matériaux que le bois et la brique. C’était affaire au peintre et au sculpteur d’en couvrir toutes les parois de couleurs vives et de riantes images ; c’était à eux de faire resplendir partout, sur les enduits des murs, sur les planches d’acacia, sur les minces colonnettes de cèdre ou de palmier, l’éclat des tons joyeux qui garnissaient leur palette et les reflets brillants de l’or. Le luxe de la décoration était ici le même que dans la tombe et le temple ; la différence était dans le caractère de l’architecture et dans ses chances de durée. Dans leur genre, ces édifices étaient tout à fait dignes de la richesse et de la puissance des souverains qui les ont bâtis pour les habiter ; mais on comprend qu’avec un pareil mode de construction ils aient disparu de bonne heure, sans laisser de traces sur le sol de l’Égypte. Depuis les siècles les plus lointains dont nous ayons gardé mémoire, l’Orient a bien peu changé, malgré l’apparente diversité des races, des empires et des religions qui s’y sont succédé sur la scène ; or on sait quel nombreux domestique y suppose la vie royale et seigneuriale, telle qu’elle y a été entendue et pratiquée de tout temps. Le konak du moindre pacha, du moindre bey renferme toute une armée de serviteurs, dont chacun rend bien peu de services. C’est par milliers que se comptent les domestiques qui peuplent le sérail du Sultan à Constantinople ou celui du Schah à Téhéran. Ce qu’il y a là d’eunuques et de palefreniers, de balayeurs et de cuisiniers, d’aleschdjis, de kafedjis et de tchiboukdjis, personne n’en sait le chiffre exact. Une telle extension de la domesticité suppose d’amples communs, où cette multitude puisse se loger, tant bien que mal, avec femmes et enfants. Afin de pourvoir à l’entretien de ce personnel, il faut aussi des provisions considérables et des réserves toujours prêtes ; il faut des magasins où viennent s’entasser les dons plus ou moins volontaires des sujets, les tributs perçus en nature et les récoltes que produisent les immenses propriétés du souverain... Si, dans le cours d’un long règne, la famille du roi s’augmente, s’il faut agrandir le palais pour monter la maison de chacun des princes royaux, rien de plus facile que d’empiéter sur les campagnes voisines et de développer ainsi bâtiments et jardins de plaisance. Quelque spacieuse que soit la grande enceinte de Karnak, la royauté égyptienne ne s’y fût pas trouvée à l’aise ; toujours elle se serait sentie à l’étroit derrière ces hautes barrières, dans cet espace clos par une ligne inflexible, au milieu de ces montagnes de pierre. Le palais oriental veut un cadre plus souple et plus large. Étudiez-le des rives du Gange à celles du Bosphore, tel que l’ont fait les nécessités du climat, la vie du harem et l’extrême division du travail ; que vous évoquiez les souvenirs de Suse et de Persépolis, de Babylone et de Ninive, ou que vous visitiez soit les résidences royales d’Agra et de Delhi, dans l’Inde soit même, sans aller si loin, le Vieux Sérail,’à Constantinople, partout, sous la diversité des ornements qui varient suivant les siècles et les lieux, vous serez frappé d’un même aspect, d’un même caractère général : le palais est multiple, complexe et, si l’on peut ainsi parler, diffus. Il ne se compose point, comme les palais modernes de l’Occident, d’un édifice unique qui forme un ensemble homogène et se laisse embrasser tout entier par un seul regard ; il ne ressemble point aux Tuileries ou à Versailles. C’est une collection de bâtiments d’importance très inégale et qui ont été construits par des princes différents ; c’est une suite de pavillons que séparent de beaux jardins ou des cours plantées de grands arbres ; pour mieux dire, c’est tout un quartier, c’est toute une ville à part, une cité royale, qu’une muraille élevée enveloppe de tous côtés. A l’intérieur, dans la partie la plus voisine de l’entrée, s’ouvrent les riches salles où le maître daigne s’asseoir parfois pendant quelques heures, sur son trône ou sur son divan, pour donner audience et pour recevoir les hommages de ses sujets ou ceux des ambassadeurs étrangers ; autour de ces pièces, ouvertes à un certain nombre de privilégiés, fourmille tout un peuple d’officiers, de soldats et de serviteurs. C’est ce qui, dans de bien autres proportions que chez le simple particulier, correspond au sélamlik de la maison orientale. Plus loin, derrière des portes jalousement gardées, s’étend et se prolonge le harem ; c’est là que le roi passe tout le temps que ne lui prennent pas la guerre ou les conseils. Tous ces bâtiments laissent entre eux assez d’air et d’espace pour que le roi puisse, s’il en a la fantaisie, rester des mois et des années sans sortir ; il fait manœuvrer ses troupes dans les vastes cours ; il se promène à pied, à cheval ou en voiture dans les allées de ses parcs ; ses thermes et ses étangs lui offrent les plaisirs du bain chaud et froid ; parfois il possède, dans l’enceinte même, des terrains de chasse. Précisément les curieuses peintures des hypogées de Tell-el-Amarna nous offrent le plan cavalier de plusieurs édifices qui rentrent exactement dans les données de ce programme habituel des palais orientaux. On les a souvent regardés comme des villas. Mais MM. Perrot et Chipiez y ont reconnu à bon droit des palais, sans doute ceux mêmes qui décoraient la ville nouvelle que le roi Amon-hotpou IV Rhou-n-Aten venait de bâtir pour en faire sa résidence et la capitale de son royaume à la place de Thèbes décapitalisée. Nous reproduisons ici la représentation conventionnelle de la principale de ces constructions, de celle qui paraît bien avoir été le palais même du souverain. La partie de cette habitation royale à la gauche de celui qui entrait par la porte principale de l’enceinte, figurée au bas du tableau, correspond évidemment à ce qu’on appelle en Orient le sélamlik, à ce que nous appellerions dans nos pays les appartements de réception. Devant l’entrée est un réservoir rectangulaire, destiné à abreuver les hôtes du palais et des jardins. En arrière de ce réservoir, une porte s’ouvre entre deux tours à murs inclinés : c’est une sorte de pylône ; sur les côtés, deux portes plus étroites. Ces trois portes conduisent dans une grande cour rectangulaire. Sur les deux longs côtés une suite de chambres ; le petit côté postérieur est la répétition de l’antérieur. Cette cour en renferme une autre, où l’on arrive en traversant un portique ; la seconde cour n’est que l’enveloppe d’une salle à ciel découvert, exhaussée sur plusieurs degrés. Les escaliers par lesquels on y accède sont très visibles sur le plan. Il est possible, probable même que dans la réalité cette vaste salle était couverte et que l’artiste en a enlevé la toiture afin de montrer l’intérieur, comme il a fait pour les chambres servant de magasins sur les deux grands côtés de la cour extérieure. Peut-être aussi était-elle sans toit et étendait-on par dessus un simple vélum interceptant les rayons du soleil. En tous cas, au centre de la salle, on voit la sorte de dais ou de tabernacle, exhaussé par un soubassement, sous lequel on plaçait le trône royal. Cette pièce était donc ce qu’on appelle aujourd’hui, dans les palais orientaux, le divan, la grande salle des audiences solennelles du monarque. Pour y parvenir il fallait franchir trois enceintes successives ; la sécurité du prince était bien protégée par cette triple clôture. A droite du bâtiment que nous venons de décrire, on en voit un autre plus vaste, mais d’un arrangement plus simple ; une aire plantée les sépare, et il n’y a point entre eux de communication apparente. En avant, même pylône précédé du même réservoir rectangulaire ; puis une ample cour, dont trois faces présentent une double série de chambres qui prennent jour soit sur la cour même, soit sur un portique. C’est sans doute là le harem ; là logeaient le prince, ses femmes et ses enfants. Sur les côtés et en arrière, disposés autour d’autres cours, des magasins, des écuries et des étables, puis des jardins. Le plus beau de ces jardins, au milieu duquel se creuse une pièce d’eau carrée, se trouve en arrière du bâtiment du sélamlik. De place en place se dressent des kiosques, des belvédères, des constructions légères où l’on devine, au mode d’assemblage indiqué par le dessinateur, l’emploi du bois. Partout des portiques sous lesquels devaient se grouper et reposer la nuit les gens de service[14]. On le voit, le palais des rois d’Égypte n’était autre chose que la maison d’habitation, agrandie, amplifiée et comme multipliée à plusieurs exemplaires, groupés dans une même enceinte. Sa construction devait certainement être la même, en briques crues et en bois. Le seul édifice de pierre qui, dans toute l’Égypte, présente un caractère d’architecture civile, je n’ose pas dire d’habitation, est celui qu’on appelle le Pavillon de Médinet-Abou. Il s’élève en avant de l’entrée du grand temple de Râ-mes-sou III et a été également construit par ce prince. En venant de la plaine, on rencontre d’abord deux logettes de gardes flanquant la porte d’une enceinte extérieure ; La porte franchie, on se trouvait en présence de deux hautes ailes en forme de pyramides tronquées, et d’un corps de bâtiment qui s’élevait entre les deux, percé d’un passage, au fond d’une cour qui va se rétrécissant par ressauts successifs. En hauteur, l’édifice se compose d’un rez-de-chaussée et de deux étages, qui étaient réunis par des escaliers. Les sculptures qui couvrent les murailles de ce pavillon, extérieurement et intérieurement, attestent qu’il n’avait pas une destination religieuse et en font une sorte de demeure royale. A l’extérieur ce sont des scènes de victoire et des figures de captifs de toutes les nations étrangères vaincues par Râ-mes-sou III ; à l’intérieur des tableaux de harem, où le roi est comme chez lui, se divertissant avec ses femmes. Mais ce n’a pas pu être un palais proprement dit, une habitation permanente du monarque. Les dimensions mêmes du monument s’opposent à ce que l’on admette une telle idée. La plus grande largeur du pavillon ne dépasse point 25 mètres, et il n’a que 22 mètres de long. L’édifice se compose de deux corps de logis, et la cour qui les sépare prend un bon tiers de la superficie totale. A eux tous, les trois étages n’ont guère dû jamais fournir plus d’une dizaine de pièces, dont quelques-unes sont plutôt des cabinets, comme nous dirions, que de vraies chambres. Avec toute la simplicité de nos habitudes une famille bourgeoise d’aujourd’hui, pourvu qu’elle fût un peu nombreuse, y serait gênée ; comment un Pharaon, avec tout son cortège d’inutiles, aurait-il pu songera s’y installer ? Comment s’y serait-il jamais senti à l’aise ?[15] Le pavillon de Médinet-Abou n’a jamais pu être qu’un kiosque de repos, où le roi venait se délasser quelques heures et revêtir ses ornements d’apparat quand une cérémonie solennelle l’appelait au temple en personne, où tout au plus il lui était possible, en pareil cas de passer une nuit. Du reste, si sa décoration intérieure et le développement de ses fenêtres se rapprochent des données des édifices civils, de ceux qui servaient ordinairement à l’habitation, sa forme générale est bien plutôt empruntée à l’architecture militaire. C’est ce qu’Auguste Mariette a discerné avec l’incomparable sûreté de son coup d’œil. L’idée, dit-il, que, vu de loin et dans le paysage, cet édifice évoque par les lignes générales de son architecture, est celle de ces tours triomphales (ma-gadil, de l’hébréo-phénicien migdol) dont les bas-reliefs de Karnak, de Louqsor, du Ramesséum et de Médinet-Abou même nous ont conservé les dessins, et que les rois faisaient élever sur leurs frontières, à la fois comme un moyen de défense et comme un monument de leurs victoires. Un type d’architecture militaire convenait bien au kiosque commémoratif d’un roi guerrier par excellence. |
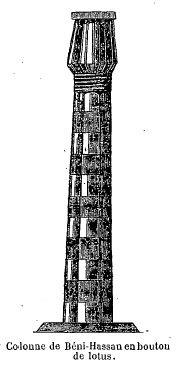 Nous
reproduisons ici la plus ancienne connue des colonnes égyptiennes en pierre
imitant les formes végétales, celle qui s’observe dans un des tombeaux de
Béni-Hassan et qui appartient au temps de la XIIe dynastie. Elle reproduit un
faisceau que formeraient quatre tiges de lotus, terminées chacune par un
bouton de fleur non encore épanoui, et serrées par un lien à plusieurs tours
au-dessous de la naissance de ces boutons. Plus tard, à partir de la XIIe
dynastie, le fût est aussi souvent cylindrique que fascicule. Il l’est
surtout quand le chapiteau devient campaniforme ou, pour parler autrement,
reproduit le galbe d’une fleur épanouie.
Nous
reproduisons ici la plus ancienne connue des colonnes égyptiennes en pierre
imitant les formes végétales, celle qui s’observe dans un des tombeaux de
Béni-Hassan et qui appartient au temps de la XIIe dynastie. Elle reproduit un
faisceau que formeraient quatre tiges de lotus, terminées chacune par un
bouton de fleur non encore épanoui, et serrées par un lien à plusieurs tours
au-dessous de la naissance de ces boutons. Plus tard, à partir de la XIIe
dynastie, le fût est aussi souvent cylindrique que fascicule. Il l’est
surtout quand le chapiteau devient campaniforme ou, pour parler autrement,
reproduit le galbe d’une fleur épanouie. Leur peinture repose tout entière
sur une convention, aussi hardie et aussi franche que les conventions d’où
parlent la statuaire et le bas-relief. Dans la nature, il n’y a que des
nuances ; ici, tout au contraire, le peintre attribue à toute surface une
valeur uniforme et tranchée ; à tout le nu d’un corps il donnera la même
couleur, qui sera plus ou moins claire suivant qu’il s’agira d’une femme ou
d’un homme. Toute une draperie sera d’un même ton, sans que l’artiste
s’inquiète de savoir si, dans telle ou telle position, la teinte de l’étoffe
ne sera pas, tantôt assombrie par l’ombre portée, tantôt, au contraire,
avivée et comme égayée par le rayon qui la frappe
Leur peinture repose tout entière
sur une convention, aussi hardie et aussi franche que les conventions d’où
parlent la statuaire et le bas-relief. Dans la nature, il n’y a que des
nuances ; ici, tout au contraire, le peintre attribue à toute surface une
valeur uniforme et tranchée ; à tout le nu d’un corps il donnera la même
couleur, qui sera plus ou moins claire suivant qu’il s’agira d’une femme ou
d’un homme. Toute une draperie sera d’un même ton, sans que l’artiste
s’inquiète de savoir si, dans telle ou telle position, la teinte de l’étoffe
ne sera pas, tantôt assombrie par l’ombre portée, tantôt, au contraire,
avivée et comme égayée par le rayon qui la frappe Ceci est sensible dans la figure d’un chasseur
rapportant son gibier, que nous empruntons, d’après Prisse d’Avesnes, à une
tombe de Thèbes du temps de la XVIIIe dynastie. Il y a contraste marqué entre
le rendu de l’homme et celui de la gazelle qu’il porte sur ses épaules, ainsi
que du chien qui l’accompagne. La figure de danseuse jouant du théorbe, que
nous reproduisons également et qui provient aussi d’une tombe thébaine,
donnera une idée du degré d’élégance auquel atteignent quelquefois les
peintures égyptiennes, dans la sobriété conventionnelle et l’imperfection de
leurs procédés. Elles vont dans ce sens plus loin que les plus gracieux et
les plus fins bas-reliefs, et l’artiste s’y permet quelquefois certaines
hardiesses que jamais n’a risquées la sculpture. Ainsi l’on y voit des
figures de face, ce qui ne se présente pour ainsi dire jamais dans les
bas-reliefs. C’est surtout à Béni-Hassan que l’on observe certaines
tentatives isolées pour donner à la peinture un aspect qui lui soit propre,
qui s’écarte un peu de celui de la sculpture. Mais les essais de ce genre ne
s’offrent plus à une époque postérieure ; les peintres du Nouvel Empire ont
été plus timides et plus esclaves de la convention traditionnelle.
Ceci est sensible dans la figure d’un chasseur
rapportant son gibier, que nous empruntons, d’après Prisse d’Avesnes, à une
tombe de Thèbes du temps de la XVIIIe dynastie. Il y a contraste marqué entre
le rendu de l’homme et celui de la gazelle qu’il porte sur ses épaules, ainsi
que du chien qui l’accompagne. La figure de danseuse jouant du théorbe, que
nous reproduisons également et qui provient aussi d’une tombe thébaine,
donnera une idée du degré d’élégance auquel atteignent quelquefois les
peintures égyptiennes, dans la sobriété conventionnelle et l’imperfection de
leurs procédés. Elles vont dans ce sens plus loin que les plus gracieux et
les plus fins bas-reliefs, et l’artiste s’y permet quelquefois certaines
hardiesses que jamais n’a risquées la sculpture. Ainsi l’on y voit des
figures de face, ce qui ne se présente pour ainsi dire jamais dans les
bas-reliefs. C’est surtout à Béni-Hassan que l’on observe certaines
tentatives isolées pour donner à la peinture un aspect qui lui soit propre,
qui s’écarte un peu de celui de la sculpture. Mais les essais de ce genre ne
s’offrent plus à une époque postérieure ; les peintres du Nouvel Empire ont
été plus timides et plus esclaves de la convention traditionnelle. Les monuments de l’Égypte les plus imposants par leur
masse et les plus curieux par leur antiquité sont sans contredit les grandes
pyramides de Gizeh. Nous avons raconté plus haut (tome II) quels travaux
immenses leur construction avait réclamé ; mais on s’en fera peut-être une
idée plus précise quand on saura que la plus grande, la pyramide de Khoufou,
se compose de plus de deux cents assises ou couches de blocs énormes ;
qu’intacte elle avait 152 mètres de hauteur, à peu près le double de
l’élévation des tours de Notre-Dame de Paris, plus que celle de la flèche de
la cathédrale de Strasbourg ; que sa base mesure 235 mètres de longueur sur
chaque côté ; enfin que les pierres dont elle se compose forment une masse
véritablement effrayante de 25 millions de mètres cubes, qui pourrait fournir
les matériaux d’un mur haut de six pieds et long de mille lieues. Pour
soulager du poids immense que devait porter la chambre destinée au sarcophage
royal, on a ménagé au-dessus, dans la masse du monument, des vides formant
cinq petites chambres bisses, sans issue extérieure. Une seconde chambre
sépulcrale est placée presque exactement au-dessous de la première, mais
taillée dans le roc et non ménagée dans la construction même. L’orientation
de ce gigantesque monument est parfaite, ses quatre faces regardent
exactement les quatre points cardinaux. Par sa masse un semblable édifice
défiait les injures du temps et les efforts de d’homme pour le détruire. Les
khalifes arabes, au moyen âge, sont cependant parvenus à dégrader
considérablement la pyramide de Khoufou et ses deux compagnes. Ils ont
arraché pierre à pierre le revêtement incliné et lisse qui la couvrait sur
toutes ses faces et se terminait en pointe au sommet. Aujourd’hui les assises
du noyau du monument, qui portaient ce revêtement, paraissent à nu, en
retraite les unes sur les autres comme les marches d’un escalier démesuré.
Les monuments de l’Égypte les plus imposants par leur
masse et les plus curieux par leur antiquité sont sans contredit les grandes
pyramides de Gizeh. Nous avons raconté plus haut (tome II) quels travaux
immenses leur construction avait réclamé ; mais on s’en fera peut-être une
idée plus précise quand on saura que la plus grande, la pyramide de Khoufou,
se compose de plus de deux cents assises ou couches de blocs énormes ;
qu’intacte elle avait 152 mètres de hauteur, à peu près le double de
l’élévation des tours de Notre-Dame de Paris, plus que celle de la flèche de
la cathédrale de Strasbourg ; que sa base mesure 235 mètres de longueur sur
chaque côté ; enfin que les pierres dont elle se compose forment une masse
véritablement effrayante de 25 millions de mètres cubes, qui pourrait fournir
les matériaux d’un mur haut de six pieds et long de mille lieues. Pour
soulager du poids immense que devait porter la chambre destinée au sarcophage
royal, on a ménagé au-dessus, dans la masse du monument, des vides formant
cinq petites chambres bisses, sans issue extérieure. Une seconde chambre
sépulcrale est placée presque exactement au-dessous de la première, mais
taillée dans le roc et non ménagée dans la construction même. L’orientation
de ce gigantesque monument est parfaite, ses quatre faces regardent
exactement les quatre points cardinaux. Par sa masse un semblable édifice
défiait les injures du temps et les efforts de d’homme pour le détruire. Les
khalifes arabes, au moyen âge, sont cependant parvenus à dégrader
considérablement la pyramide de Khoufou et ses deux compagnes. Ils ont
arraché pierre à pierre le revêtement incliné et lisse qui la couvrait sur
toutes ses faces et se terminait en pointe au sommet. Aujourd’hui les assises
du noyau du monument, qui portaient ce revêtement, paraissent à nu, en
retraite les unes sur les autres comme les marches d’un escalier démesuré.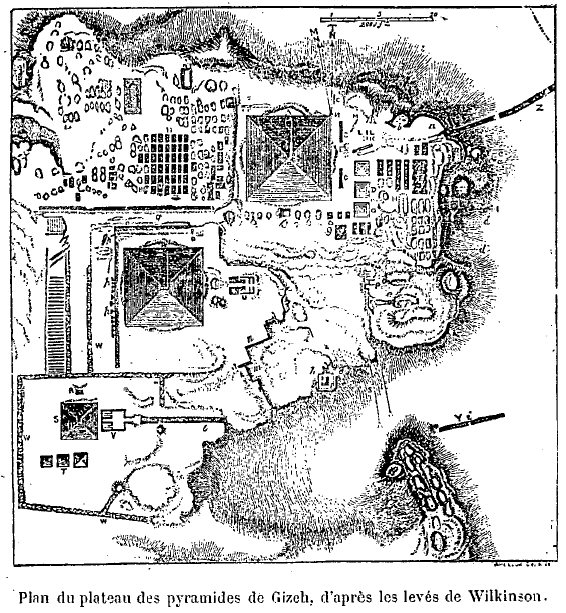
 Le Sphinx colossal qu’on voit au pied des grandes
pyramides, et qui en forme comme l’appendice, est un monument qui paraît
remonter aux époques semi-fabuleuses des Schesou-Hor, antérieurement à
l’établissement d’une royauté unique sur tout le pays, et qui subit à
diverses époques des restaurations plus ou moins étendues, entre autre sous
Khofou et Kha-f-Râ, de la IVe dynastie, et sous Tahout-mès IV, de la XVIIIe.
Il a près de 90 pieds de long et environ 60 pieds de haut. La tête seule a
été sculptée avec quelque soin. Le corps est un rocher naturel à peine
dégrossi et complété aux endroits défectueux par une mauvaise maçonnerie en
calcaire. Les assises du rocher partagent sa face en zones horizontales. On a
profité, pour la bouche, d’une des lignes de séparation des couches. Le grand
Sphinx était une image du dieu Lar-m-akhouti, le soleil à son coucher,
envisagé dans ce cas comme un dieu essentiellement funèbre. Entre ses deux
pattes de devant- se trouvait un petit sanctuaire consacré à cette divinité,
qui fut reconstruit par Tahout-mès IV, à la suite d’une vision que ce roi
avait eue pendant son sommeil.
Le Sphinx colossal qu’on voit au pied des grandes
pyramides, et qui en forme comme l’appendice, est un monument qui paraît
remonter aux époques semi-fabuleuses des Schesou-Hor, antérieurement à
l’établissement d’une royauté unique sur tout le pays, et qui subit à
diverses époques des restaurations plus ou moins étendues, entre autre sous
Khofou et Kha-f-Râ, de la IVe dynastie, et sous Tahout-mès IV, de la XVIIIe.
Il a près de 90 pieds de long et environ 60 pieds de haut. La tête seule a
été sculptée avec quelque soin. Le corps est un rocher naturel à peine
dégrossi et complété aux endroits défectueux par une mauvaise maçonnerie en
calcaire. Les assises du rocher partagent sa face en zones horizontales. On a
profité, pour la bouche, d’une des lignes de séparation des couches. Le grand
Sphinx était une image du dieu Lar-m-akhouti, le soleil à son coucher,
envisagé dans ce cas comme un dieu essentiellement funèbre. Entre ses deux
pattes de devant- se trouvait un petit sanctuaire consacré à cette divinité,
qui fut reconstruit par Tahout-mès IV, à la suite d’une vision que ce roi
avait eue pendant son sommeil.  La grande
pyramide de Saqqarah, élevée de 57 mètres environ, se divise dans sa hauteur
en six larges gradins à pans inclinés ; de la base au sommet, la hauteur
de ces degrés va toujours en diminuant ; elle varie ainsi entre 11
mètres 48 et 8 mètres 89. D’un étage à l’autre, le retrait est à peu près de
2 mètres. Par l’inclinaison des pans et par l’effet du retrait, cet édifice
tend vers la forme pyramidale plutôt qu’il ne l’atteint : c’est comme
une pyramide à l’état d’ébauche. Il est vrai que c’est la plus ancienne de
celles que l’on peut dater et que sa destination n’a pas été, comme les
autres, d’être une sépulture royale. Nous avons déjà dit (tome II) qu’elle
paraissait dater de la IIe dynastie et avoir servi de sépulture aux taureaux Hapi de l’Ancien Empire, inhumés dans les trente caveaux qu’elle recouvre.
La grande
pyramide de Saqqarah, élevée de 57 mètres environ, se divise dans sa hauteur
en six larges gradins à pans inclinés ; de la base au sommet, la hauteur
de ces degrés va toujours en diminuant ; elle varie ainsi entre 11
mètres 48 et 8 mètres 89. D’un étage à l’autre, le retrait est à peu près de
2 mètres. Par l’inclinaison des pans et par l’effet du retrait, cet édifice
tend vers la forme pyramidale plutôt qu’il ne l’atteint : c’est comme
une pyramide à l’état d’ébauche. Il est vrai que c’est la plus ancienne de
celles que l’on peut dater et que sa destination n’a pas été, comme les
autres, d’être une sépulture royale. Nous avons déjà dit (tome II) qu’elle
paraissait dater de la IIe dynastie et avoir servi de sépulture aux taureaux Hapi de l’Ancien Empire, inhumés dans les trente caveaux qu’elle recouvre.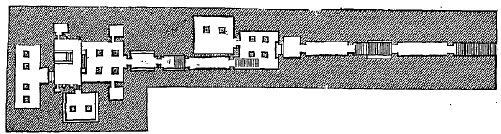
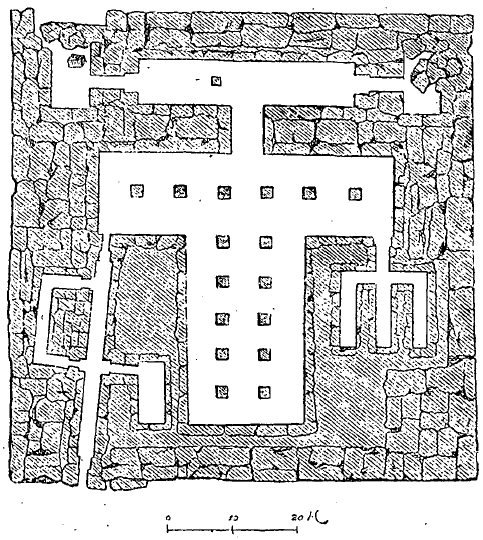
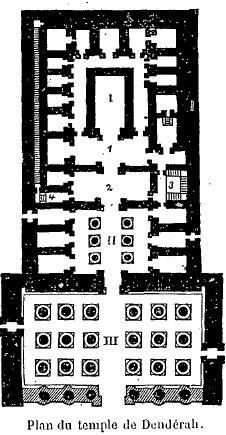 Les diverses parties essentielles
et constitutives du temple lui-même, moins la cour et le pylône extérieur, se
dessinent avec une extrême netteté dans le plan très simple et très clair, du
temple de Dendérah (Tantarer, Tentyris), que nous insérons à la page suivante
comme spécimen typique. On y voit d’abord la salle hypostyle (III) formant
pronaos ouvert dans toute la largeur de l’édifice ; vient ensuite une seconde
salle hypostyle plus petite, à une seule nef de colonnes (II), sur laquelle
s’ouvrent six chambres latérales, trois à droite et trois à gauche. Elle est
suivie de deux salles sans colonnes (1 et 2), qui précèdent le sanctuaire (I)
et où débouchent aussi des chambres latérales. Enfin un couloir circule tout
autour du sanctuaire et est enveloppé à son tour de chambres étroites. Dans
les temples ptolémaïques, comme celui de Dendérah, les inscriptions gravées
sur les murs de ces chambres accessoires expliquent la nature des objets
qu’on y conservait et les actions qu’on y accomplissait rituellement. En
outre, dans l’épaisseur des murs sont dissimulées des cryptes, où l’on
déposait certains objets employés dans le culte, que l’on voulait soustraire
plus soigneusement aux regards et à l’action de la lumière du soleil.
Les diverses parties essentielles
et constitutives du temple lui-même, moins la cour et le pylône extérieur, se
dessinent avec une extrême netteté dans le plan très simple et très clair, du
temple de Dendérah (Tantarer, Tentyris), que nous insérons à la page suivante
comme spécimen typique. On y voit d’abord la salle hypostyle (III) formant
pronaos ouvert dans toute la largeur de l’édifice ; vient ensuite une seconde
salle hypostyle plus petite, à une seule nef de colonnes (II), sur laquelle
s’ouvrent six chambres latérales, trois à droite et trois à gauche. Elle est
suivie de deux salles sans colonnes (1 et 2), qui précèdent le sanctuaire (I)
et où débouchent aussi des chambres latérales. Enfin un couloir circule tout
autour du sanctuaire et est enveloppé à son tour de chambres étroites. Dans
les temples ptolémaïques, comme celui de Dendérah, les inscriptions gravées
sur les murs de ces chambres accessoires expliquent la nature des objets
qu’on y conservait et les actions qu’on y accomplissait rituellement. En
outre, dans l’épaisseur des murs sont dissimulées des cryptes, où l’on
déposait certains objets employés dans le culte, que l’on voulait soustraire
plus soigneusement aux regards et à l’action de la lumière du soleil.