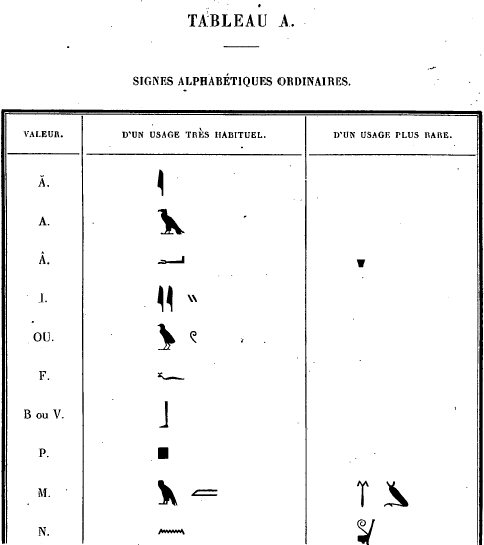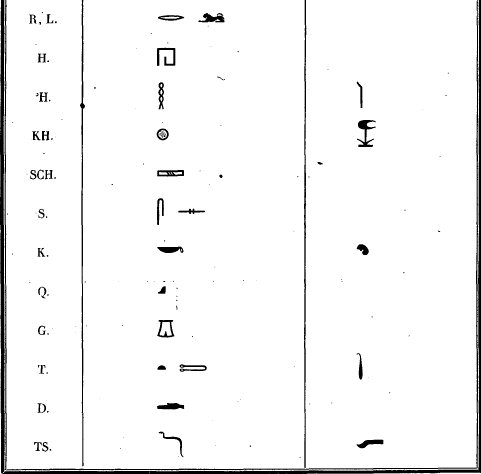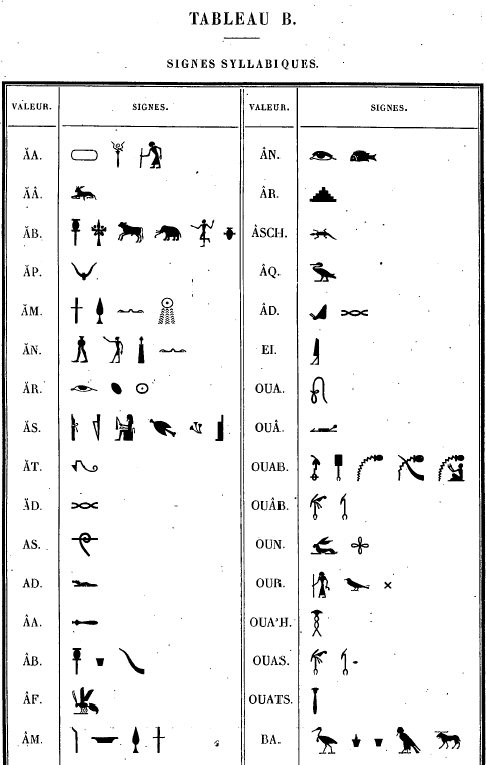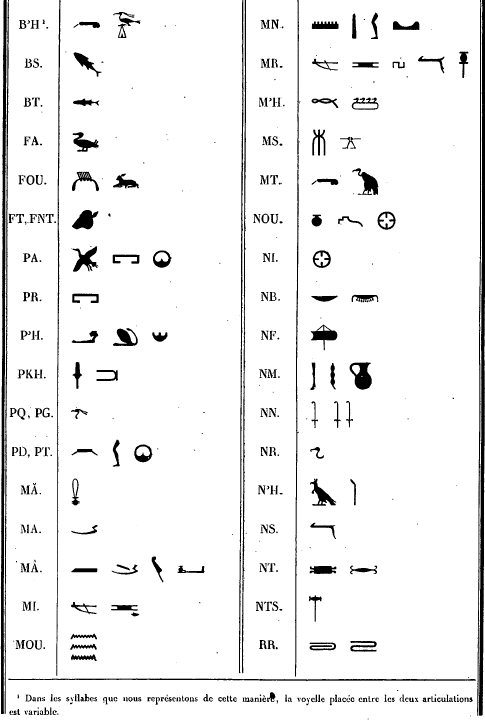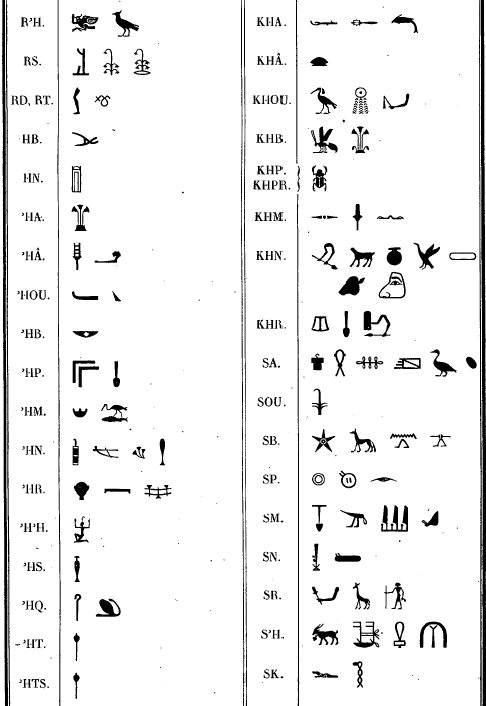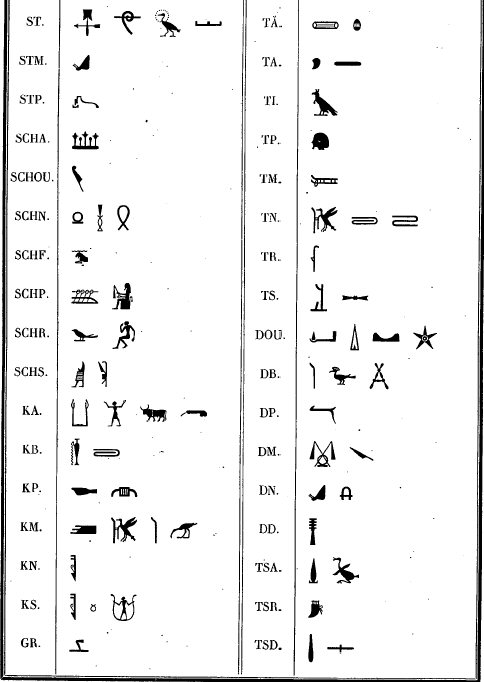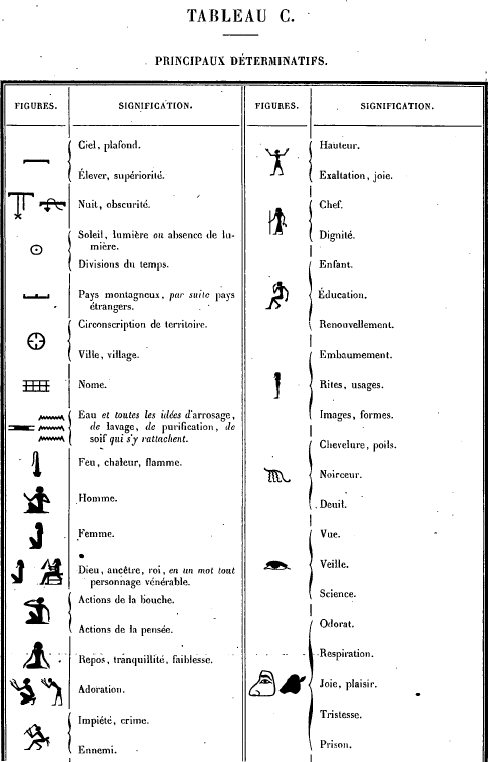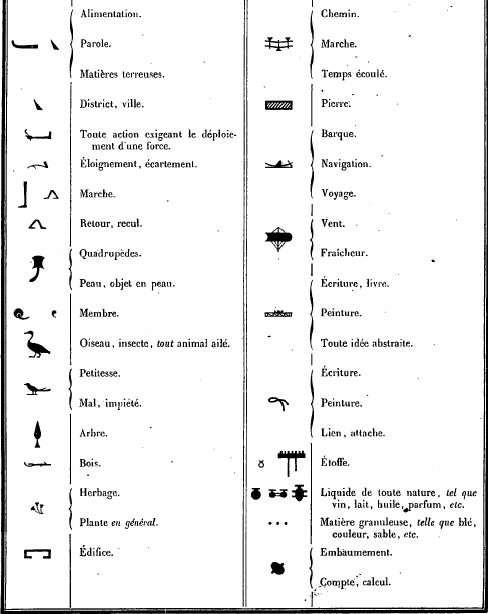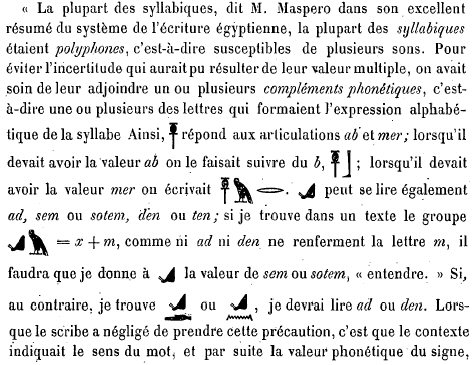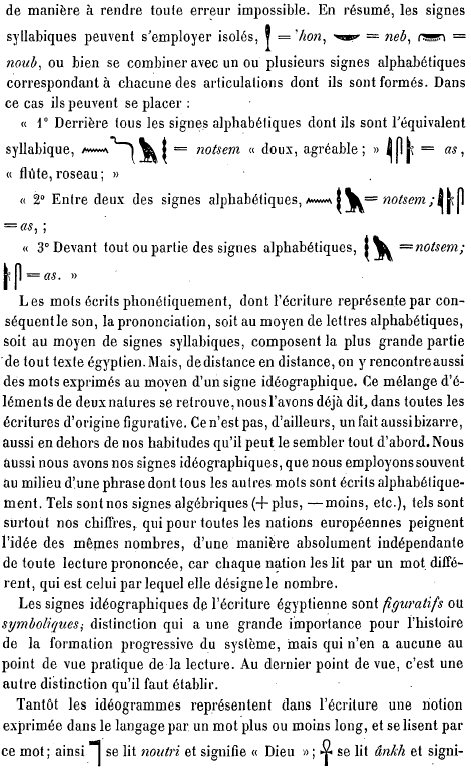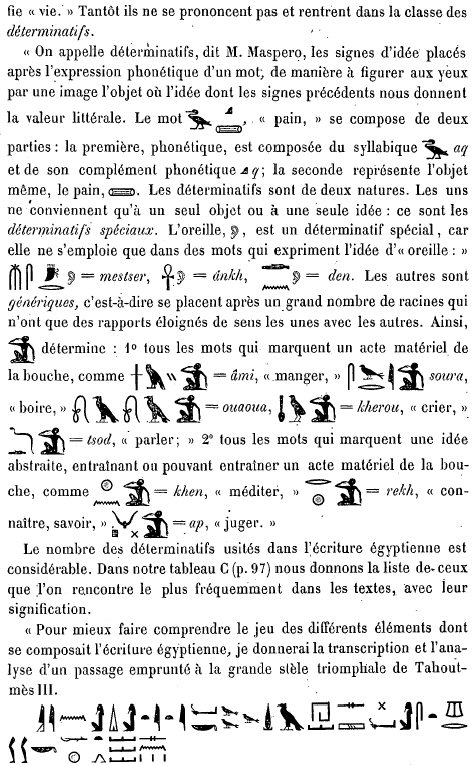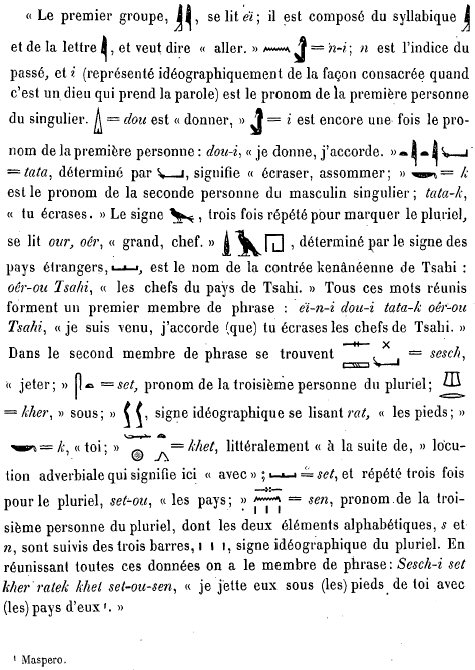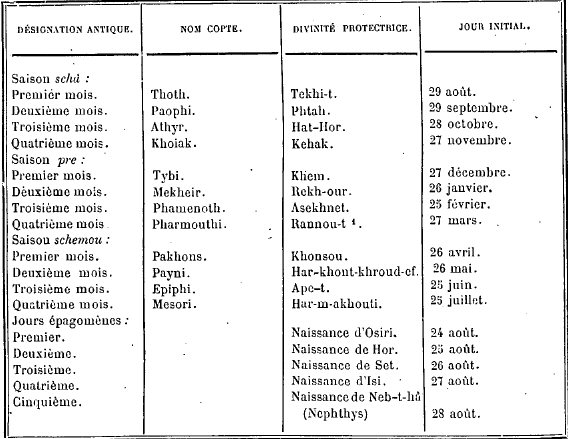CIVILISATION, MŒURS, RELIGION ET ART DE L’ÉGYPTE
CHAPITRE II — LITTÉRATURE ET SCIENCES.
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — L’ÉCRITURE. Les Grecs ont donné le nom d’hiéroglyphes, c’est-à-dire sculptures sacrées, à l’écriture nationale des Égyptiens, composée toute entière d’images d’objets matériels. Bien que très- impropre, ce nom a été adopté par les modernes et est ; si complètement passé dans l’usage que l’on ne saurait plus aujourd’hui le remplacer par une appellation plus exacte. Ni les Grecs, ni les Romains, quand ils ont été les maîtres de l’Égypte, n’ont cherché à s’instruire de la façon dé lire cette écriture, qui leur paraissait un arcane et dont cependant les indigènes continuaient à se servir sous leur autorité ;’ Pendant des siècles et des siècles le déchiffrement des hiéroglyphes, pour lequel les écrivains classiques ne fournissaient ainsi aucun secours, est demeuré enveloppé de nuages mystérieux, et l’on désespérait de jamais parvenir à les dissiper. On s’imaginait que dans les textes de cette écriture chaque signe était un symbole et représentait une idée, mais on ne croyait pas que l’on eût à y chercher la représentation des sons d’une langue. A la fin du siècle dernier, pendant l’occupation française de l’Égypte, le génie, en exécutant des travaux de fortification, découvrit à Rosette un monument qui vint enfin fournir une base solide aux essais de déchiffrement des écritures égyptiennes. C’était une inscription en triple texte, hiéroglyphique, démotique et grec, contenant un décret solennel du corps sacerdotal de l’Égypte, en l’honneur de Ptolémée Epiphane. Sylvestre de Sacy et le Suédois Akerblad abordèrent l’étude du texte démotique, qu’en raison de son aspect cursif on supposait devoir être de nature alphabétique. Akerblad détermina de la manière la plus heureuse les valeurs d’une partie des signes principaux de cette écriture, et en dressa un premier alphabet, auquel des travaux ultérieurs n’ont presque rien changé, mais ont seulement ajouté. S’il avait persévéré dans la voie où il s’était ainsi engagé, nul doute qu’il ne fût parvenu au déchiffrement complet de cette sorte d’écriture. Le problème des hiéroglyphes paraissait bien plus insoluble. Pour tant, après des tentatives de l’Anglais Th. Young, qui entrevit la voie à suivre, mais commit quelques erreurs fondamentales qui l’empêchèrent d’y avancer d’un pas sûr, le génie pénétrant d’un Français parvint enfin, il y a soixante ans maintenant, à soulever le voile. Réalisant, par un prodigieux effort d’induction et de divination, la plus grande découverte du XIXe siècle dans le domaine des sciences historiques et philosophiques, Jean-François Champollion, né à Figeac (Lot), le 23 décembre 1790, mort à Paris le 4 mars 1832, parvint à fixer sur des bases solides la lecture des hiéroglyphes. Comme tous les créateurs scientifiques, Champollion fut violemment attaqué de son vivant et abreuvé de déboires. On contesta sa découverte avec acharnement, et l’on a peine à comprendre aujourd’hui l’incrédulité qu’elle rencontra d’abord auprès des savants. Sans se laisser décourager par ces attaques si injustes, Champollion démontra le mouvement en marchant ; il continua ses travaux avec une ardeur qui épuisa bientôt ses forces et il obtint des résultats qui finirent par convaincre les plus incrédules et par s’imposer à la science. Quand il mourut, non seulement les principes fondamentaux du déchiffrement étaient acquis, mais la grammaire de la langue égyptienne antique était reconstituée dans ses traits les plus essentiels, et les principales époques de l’histoire du grand peuple civilisé de la vallée du Nil commençaient à sortir des ténèbres. Les premiers successeurs de Champollion furent, en France, Ch. Lenormant et Nestor L’Hôte ; en Italie, Salvolini, Rosellini et Ungarelli. Bientôt après MM. Leemans, en Hollande, Osburn, Birch et Hincks en Angleterre, Lepsius, en Allemagne, se mirent à leur tour courageusement à l’œuvre pour continuer et développer l’étude si admirablement inaugurée par son fondateur. C’est surtout depuis une trentaine d’années que l’égyptologie a consommé les progrès qui ont achevé de la constituer et qui en ont mis l’état à la hauteur de celui des branches les plus avancées de la science. Un de nos compatriotes (car ce sont toujours des noms français que l’on rencontre au premier rang dans l’histoire des études égyptiennes), un de nos compatriotes, le vicomte Emmanuel de Rougé, par les principes d’inflexible rigueur philologique dont il a donné l’exemple dans ses travaux et dans son enseignement, et qu’il a imposés comme règle aux recherches, a mérité le titre de second créateur de la science hiéroglyphique. Un autre Français, Auguste Mariette, dont la mort est encore un deuil récent pour la science, a illustré son nom par une exploration des ruines de l’Égypte, continuée pendant plus d’un quart de siècle, qui a produit les plus fécondes découvertes et révélé des époques entières, jusqu’alors inconnues, de l’histoire d’Égypte, en particulier l’histoire et la civilisation des dynasties primitives. Des écoles égyptologiques se sont fondées dans tous les pays de l’Europe ; et aujourd’hui ces études peuvent y citer avec orgueil les noms de leurs principaux travailleurs : MM. Chabas, Devéria, Grébaut, de Horrack, Lefébure, Maspero, Pierret, J. de Rougé, en France ; Brugsch, Ebers, Eisenlohr, Lauth, Stern, en Allemagne ; Goodwin et Lepage-Renouf, en Angleterre ; Edouard Naville, en Suisse ; Pleyte, en Hollande ; Lieblein, en Norvège ; Golenischeff en Russie ; Schiaparelli et Rossi, en Italie. La plupart de ces savants sont jeunes et en pleine activité de travail ; quelques survivants de la génération précédente rivalisent encore avec eux de zèle et de labeur. Grâce à leurs efforts concordant au même but, la science ne cesse de s’affermir chaque jour. Ses recherches s’étendent, ses travaux gagnent en solidité ; dès à présent les textes historiques et littéraires se traduisent avec presque autant de certitude que les livres de l’antiquité classique. Il n’est plus possible, dans l’état actuel de la science, de soutenir, comme on l’a fait si longtemps, que les hiéroglyphes étaient une écriture mystérieuse, réservée seulement aux prêtres et les maintenant seuls en possession du dépôt des connaissances. L’écriture hiéroglyphique se retrouve partout, sur les monuments publics et sur les objets de la vie domestique, dans les récits historiques et dans les éloges des rois destinés à la plus grande publicité, s’adressant à la postérité la plus reculée, comme dans l’exposé des plus subtiles doctrines de la religion égyptienne. Ce serait aussi une opinion très éloignée de la vérité que de regarder les hiéroglyphes comme étant toujours, ou même généralement des symboles. Sans doute il y a parmi eux des caractères symboliques, le plus souvent d’une intelligence facile, comme il y a, et en grand nombre, des caractères figuratifs, qui représentent l’objet lui-même ; mais la majorité des signes qui se trouvent dans tout texte hiéroglyphique sont dés caractères phonétiques, c’est-à-dire peignant des sons et représentant soit des syllabes (ceux-là sont assez variés pour offrir quelquefois des difficultés sérieuses), soit des lettres appartenant à un alphabet médiocrement compliqué. Ces lettres sont aussi des dessins d’objets, mais d’objets dont le nom égyptien commençait par la lettre en question, comme les caractères syllabiques (véritables rébus) représentaient un objet désigné par .cette syllabe. C’est même ainsi que Champollion est parvenu à reconstruire tout le système de l’écriture et de la langue égyptienne, dès que la comparaison des noms propres royaux (désignés, comme nous l’avons dit, par un encadrement ou cartouche) dans des textes joints à une traduction grecque — comme la fameuse inscription de Rosette — lui eut permis défaire les premiers pas dans le déchiffrement de l’alphabet, s’aidant pour le reste delà connaissance du copte, langue dérivée et très voisine de l’ancien égyptien, qui est demeurée jusqu’à nos jours la langue liturgique des chrétiens de l’Égypte. Nous avons déjà parlé, dans le chapitre III de notre IIe livre, du mécanisme de l’écriture hiéroglyphique égyptienne, et nous en avons indiqué les traits généraux, le mélange d’éléments idéographiques et phonétiques qu’elle présente, et qui y. conserve des vestiges des états successifs par lesquels a passé ce système graphique dans les évolutions de son développement. Ici nous ne reviendrons pas sur ces données d’un caractère général, mais nous préciserons un peu plus les faits principaux et essentiels pour donner au lecteur une idée suffisante de l’écriture figurative de l’ancienne Égypte et de la façon dont elle procède. Les vingt-deux articulations de l’égyptien classique, tel qu’il était constitué à sa plus belle époque littéraire, de la XIIe à la XXe dynastie, sont représentées dans l’écriture par des lettres purement alphabétiques dont la série est donnée dans le tableau A, joint à ce chapitre (ci-dessous). Pour plusieurs articulations, on y verra qu’elles peuvent être figurées par deux, trois ou quatre caractères entièrement différents de forme, mais égaux en valeur. C’est ce qu’on appelle des homophones.
Une autre part du phonétisme de l’écriture hiéroglyphique égyptienne consiste en caractères syllabiques, représentant à eux seuls une ou plusieurs articulations formant syllabes. Ces caractères, qui se mêlent aux lignes purement alphabétiques, sont en assez grand nombre. Nous les réunissons dans notre tableau B (ci-dessous), en les accompagnant de l’indication de leurs valeurs.
Les hiéroglyphes, parleur essence même de dessin figuratif d’objets naturels, constituaient une écriture presque exclusivement monumentale. Aussi ne les rencontre-t-on guère que dans un emploi épigraphique, sur les monuments publics ou privés, bien qu’il y en ait une forme, dite linéaire, où le tracé des figures est simplifié, mais toujours entier et reconnaissable, qui s’emploie quelquefois dans les manuscrits sur papyrus, par exemple dans certains exemplaires du grand Livre des Morts. D’ordinaire, pour les usages de la vie courante, pour la transcription et la propagation des œuvres littéraires, on se servait d’une écriture cursive dérivée des hiéroglyphes, à laquelle les modernes ont donné le nom d’hiératique. Nous avons déjà parlé plus haut de cette tachygraphie, dont l’usage remonte aux plus anciens temps auxquels on puisse jusqu’ici remonter dans la civilisation égyptienne ; nous avons donné (tome Ier), des exemples de la manière dont le dessin des hiéroglyphes se transforme en s’abrégeant dans l’hiératique, et placé aussi sous les yeux du lecteur (tome Ier) un texte de cette dernière écriture en regard de sa transcription en hiéroglyphes linéaires. Tandis que l’écriture hiéroglyphique se traçait indifféremment de droite à gauche et de gauche à droite, l’hiératique s’écrivait toujours de droite à gauche. Naturellement, pendant la longue suite des siècles de l’histoire égyptienne, l’écriture cursive ou hiératique subit des modifications considérables. Les fac-similés que nous avons extraits, dans notre volume précédent, de certains manuscrits auxquels nous faisions des emprunts considérables, représentent précisément les trois types principaux de cette écriture, sous les dynasties primitives (t. II), sous le Moyen Empire, vers le temps de la XIIe dynastie (tome II), enfin à la plus belle époque de la XIXe dynastie, sous le règne de Râ-mes-sou II (tome II). Ainsi que le lecteur le constatera facilement en comparant entre eux ces divers fac-similés, l’écriture égyptienne des livres avait été, pendant le cours des siècles, en perdant toujours de sa largeur et de sa longueur, en se restreignant, en s’abrégeant et en devenant plus cursive. Entre la XXIe et la XXVe dynastie, le système hiératique se simplifia pour la commodité des transactions commerciales. Les caractères s’abrégèrent encore, diminuèrent de nombre et de volume, et en vinrent à former une troisième sorte d’écriture, la populaire ou démotique, comme l’ont appelée les Grecs, employée à partir des règnes de Schabaka et de Taharqa dans les contrats, dans les registres de comptes, dans les correspondances privées et même dans quelques livres de littérature populaire ou romanesque. Nous avons donné plus haut (tome Ier) le fac-similé d’un texte démotique, dans lequel on peut voir à quelles pattes de mouche s’était réduite alors l’écriture des anciens Égyptiens. Il faut remarquer, du reste, qu’à partir de l’apparition de l’écriture démotique, sous les rois Éthiopiens de la XXVe dynastie, jusqu’à la conversion de l’Égypte au christianisme, la différence de l’emploi des types graphiques chez les habitants de la vallée du Nil correspondit désormais à des différences de langage. L’ancien égyptien des siècles classiques de la XIIe dynastie et des premières maisons royales du Nouvel Empire n’était plus désormais qu’une langue savante et littéraire, que l’on écrivait encore, que les lettrés parlaient peut-être quelquefois entre eux par affectation érudite, comme le latin dans nos pays au moyen ; âge et à la Renaissance, mais qui était complètement sortie de l’usage ordinaire de la vie[1]. Cette langue antique, on l’écrivait toujours alors en hiéroglyphes et en hiératique, et on continua de le faire jusque sous les empereurs romains, tant que persista la civilisation égyptienne et l’organisation de son sacerdoce. Ce qu’on écrivait en même temps avec les caractères démotiques, c’était un autre idiome, le parler universel et quotidien, le dialecte populaire, issu de la vieille langue classique, dégénérée et appauvrie sous certains rapports, enrichie sous d’autres de formes grammaticales nouvelles. Le langage des textes démotiques forme le chaînon intermédiaire entre l’ancien égyptien et le copte des âges chrétiens, dont il se rapproche beaucoup. Il est, du reste, à noter que, bien que l’écriture démotique serve à tracer un dialecte particulier et qu’on n’y reconnaisse plus le tracé d’aucune des images primitives, elle renferme encore le même mélange d’idéographisme et de phonétisme que les hiéroglyphes. Après avoir fait l’objet des travaux d’Akerblad et d’Young, qui avaient réalisé des progrès considérables dans leur déchiffrement, les textes démotiques, depuis que la clef des hiéroglyphes avait été trouvée, ont longtemps rebuté les égyptologues à cause de la difficulté de leur lecture et de l’aridité de la plupart de ces textes, qui consistent principalement en actes d’intérêt privé. L’étude n’en a été fondée d’une manière complètement scientifique que par M. Brugsch, qui a fait ce domaine complètement sien et y a déployé la plus merveilleuse sagacité. Sur le sujet du démotique, il a réellement tout créé, traduisant les textes avec une admirable sûreté, débrouillant les difficultés de la paléographie et donnant la grammaire de l’idiome, avec la définition de ses formes propres. Mais la matière était si ardue que pendant plus de vingt ans il n’y a eu ni disciples, ni émules. C’est seulement depuis un petit nombre d’années qu’un jeune savant français, M. Eugène Révillout, s’est mis à son tour à cette étude avec infiniment de zèle, de science et de bonheur, à la suite de M. Brugsch, et a été payé de ses peines parles plus heureuses découvertes, par l’éclaircissement d’une infinité de points essentiels du droit et de la constitution sociale de l’ancienne Égypte, sur lesquels on ne pouvait attendre de renseignements que des contrats privés[2]. § 2. — LES LIVRES La littérature égyptienne était nombreuse et célèbre ; les auteurs classiques parlent fréquemment des livres de l’Égypte. Diodore de Sicile, en décrivant le monument de Thèbes, qu’il appelle le Tombeau d’Osymandyas, y mentionne une bibliothèque, sur la porte de laquelle était, dit-il, gravée l’inscription : Médecine de l’âme. Le Ramesséum de Qournah paraît correspondre assez exactement à l’édifice décrit sous un nom inexact par l’écrivain grec. Champollion y a retrouvé d’une manière positive la salle de la bibliothèque, placée sous la protection de Tahout, dieu des sciences et des arts, et de la déesse Safekh, dame des lettres, Dans un des tombeaux de Gizeh, un grand fonctionnaire des premiers temps de la VIe dynastie prend déjà le titre de gouverneur de la maison des livres. C’est sur papier de papyrus qu’étaient généralement exécutés les manuscrits égyptiens. Le papyrus, qui a laissé son nom au papier, est une plante de la famille des cypéracées, qui croît dans les terrains noyés et élève jusqu’à dix ou douze pieds de hauteur ses tiges couronnées d’élégantes panicules en ombelles. Il repousse plus spontanément en Égypte, où il était singulièrement abondant aux temps antiques, surtout dans les marais du Delta. Ne se contentant, pas de sa production naturelle, on y avait organisé sa culture sur une grande échelle, afin de satisfaire aux besoins de la consommation, qui étaient considérables. Au temps de la domination romaine, l’administration fiscale de l’Empire fit de cette culture un monopole gouvernemental et la concentra dans certains nomes, comme celui de Sébennytus ; pour assurer ce monopole, les agents du fisc interdirent sévèrement de cultiver la précieuse plante ailleurs que dans les cantons qui y avaient été affectés, mais ils veillèrent avec un soin jaloux à faire arracher les pieds qui poussaient spontanément dans le reste du pays. C’est ainsi qu’ils parvinrent à supprimer le papyrus de la flore naturelle de l’Égypte, et que la plante disparut absolument delà contrée quand on cessa de la cultiver, vers le IXe siècle de notre ère, l’invention du papier de coton par les Arabes supplantant dans l’usage par cette nouvelle matière le papier de papyrus, plus coûteux et moins commode. Les écrivains classiques, Pline en particulier, décrivent en détail la fabrication du papier de papyrus, telle qu’elle se pratiquait de leur temps. Les tiges de la plante, dépouillées de leur écorce, étaient découpées en minces lamelles dans la direction de leur longueur. On étendait ces lamelles juxtaposées sur une table de pierre bien unie ; ceci fait, on les recouvrait d’un second lit d’autres lamelles semblables, posées sur celles-ci à angles droits, qu’on y faisait adhérer au moyen d’une colle. L’opération était répétée jusqu’à ce qu’on fût parvenu, au moyen delà superposition de couches de ce genre, à donner au papier une épaisseur et une résistance suffisantes. On le mettait alors en presse, pour rendre l’adhésion des lamelles, placées les unes sur les autres et enchevêtrées, plus intime et plus parfaite, et ensuite on le faisait sécher au soleil. Il ne restait plus dès lors qu’à en polir la surface pour la rendre propre à recevoir l’écriture. C’est là le procédé que l’on a de nos jours reconstitué, sur la description de Pline, en Sicile, où l’on fabrique, pour le vendre aux voyageurs à titre de curiosité, une petite quantité de papier avec les papyrus qui croissent dans le voisinage de Syracuse. Mais l’examen des manuscrits antiques sur papyrus parvenus jusqu’à nous montre que dans les temps pharaoniques on préférait donner aux lamelles tirées du papyrus une largeur plus grande que celle de la tige dans son travers, en procédant à un découpage circulaire continu, de la même nature que celui que les Chinois encore aujourd’hui pratiquent dans la moelle de l’Aralis papyrifera, en en faisant ce qu’on appelle improprement le papier de riz. Une longue pratique avait fini par permettre aux Égyptiens d’arriver à une extrême perfection dans le collage des lamelles tirées du papyrus, qui constituait l’opération essentielle de sa transformation en papier. Grâce à ce collage, on parvenait à donner au papier ainsi fait une longueur indéfinie, qui n’avait de limite que l’étendue du texte qu’on voulait écrire sous forme d’un rouleau continu, où les pages succédaient aux pages sur le même côté du papier. Quant à sa hauteur, elle a varié suivant les qualités du papier et suivant les époques. Le papyrus du temps de l’Ancien Empire n’excède pas six pouces de haut ; il en est de même de celui de la XIIe dynastie ; sous la XVIIIe la hauteur moyenne est de treize pouces, sous la XIXe de neuf et de onze ; avec la XXe dynastie, la dimension augmente et les papyrus sont hauts de plus de quatorze pouces ; on revient à une hauteur de onze à douze sous les rois Saïtes et aux temps gréco-romains. A toutes les époques, du reste, il y a eu plusieurs qualités de papyrus, qui variaient en hauteur, en souplesse et en blancheur. On constate de plus qu’avec le cours du temps la fabrication de ce papier s’était perfectionnée. Celui des dynasties primitives et du Moyen Empire est fort inférieur à celui du temps de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, et d’un ton notablement plus foncé. Le plus parfait, le plus souple et le plus consistant à la fois, et aussi le plus blanc, est celui qui date de l’époque de la XXVIe dynastie. Le papier de papyrus a toujours été une matière coûteuse. On l’économisait donc autant qu’on pouvait, et on s’étudiait à le faire resservit plusieurs fois. Aussi les palimpsestes ont-ils été nombreux dans l’ancienne Égypte. Il arrivait souvent qu’on reprenait un ancien manuscrit et qu’on en effaçait l’écriture en le polissant à la pierre ponce pour lui faire recevoir un nouveau texte. On a retrouvé des papyrus qui avaient subi partiellement cette opération d’effaçage, tout en conservant encore une portion de ce qui y avait été écrit jadis[3]. D’autres fois, on prenait une feuille de papyrus sur un des côtés de laquelle on avait autrefois écrit, et sans prendre la peine d’effacer l’ancien texte, dont on ne tenait plus de compte, on se servait du côté resté blanc pour tracer un document d’une toute autre nature. C’est ce qu’on appelle un manuscrit opisthographe. On chercha aussi des succédanés moins dispendieux au papyrus. Dans les âges primitifs de leur civilisation, avant d’avoir amené à un certain degré de perfection les procédés de confection de ce papier, dont l’usage se propagea ensuite dans tout le monde antique, les Égyptiens avaient employé fréquemment des rouleaux de peaux préparées à recevoir le dessin ou l’écriture. Ils continuèrent à faire de même aux plus belles époques de la monarchie des Pharaons. On a de ces temps quelques fragments écrits d’un très bon parchemin, mais ils sont fort rares. L’usage de cette matière par les écrivains semble être alors resté exceptionnel. En beaucoup de cas, au contraire, dans les administrations publiques, pour ce qui était notes à prendre, comptes à enregistrer provisoirement pour les copier ensuite sur les rouleaux de papyrus, on faisait usage de planchettes de bois bien planées et revêtues d’un vernis résistant à l’eau, sur lequel on pouvait tracer l’écriture et l’effacer ensuite par un lavage. Enfin l’on rencontre en grande quantité des tessons de poterie ou des éclats de pierre calcaire blanche écrits à l’encre, sur lesquels on lit un reçu de contributions, un congé de soldat, une courte lettre missive, un mémorandum d’une nature quelconque, quelquefois même le fragment d’un texte littéraire copié par un écolier, par un scribe à court de papier. Cette manière économique, mais incommode et encombrante, de suppléer au papier de papyrus ou au parchemin se continua pendant la période gréco-romaine. On a bon nombre de ces tessons inscrits, que l’on appelle ostraca d’après les Hellènes, qui portent des textes en grec ou en copte. Le grammairien alexandrin Apollônios, surnommé Dyscolos, qui vivait au temps des Antonins, écrivit, raconte-t-on, les manuscrits de ses ouvrages sur des tessons de poterie, à cause du prix trop élevé du papyrus. L’encre des Égyptiens, comme celle des Grecs, consistait en une solution dégomme dans l’eau, colorée par un mélange de noir de fumée ou de minium, suivant qu’on la voulait noire ou rouge. Elle manquait donc tout à fait de fixité et ne pénétrait pas dans le papyrus. Quand elle était encore récente, il suffisait d’un lavage à l’eau pour l’enlever complètement. Quand elle était plus ancienne, on la faisait disparaître sans laisser de traces en la grattant et en polissant à nouveau le papyrus. Tels étaient, au point de vue matériel, les livres de l’Égypte. Maintenant que nous les connaissons, il est bon de donner une certaine idée de leur contenu. L’ancienne littérature égyptienne, autant que nous en possédons les débris originaux et que nous en parlent les écrivains classiques qui ont été à même d’avoir quelques renseignements à son égard, peut se diviser en trois grandes classes, d’après les matières dont elle traitait : Les livres religieux, Les traités scientifiques, Les écrits historiques et purement littéraires. Nous parlerons des premiers au chapitre de la religion, et nous donnerons alors quelques indications sur ceux que l’on possède encore. Les traités scientifiques portaient principalement sur la géométrie, l’astronomie et la médecine, auxquelles se liaient bien des superstitions astrologiques et magiques. Pour les livres d’histoire et de littérature, ils consistaient surtout en chroniques où étaient enregistrés les dits et les faits des anciens rois, avec le nombre des années de leur vie, la durée de leur règne et leur classement par dynastie ; en poèmes du genre de celui de Pen-ta-our sur la bataille de Qadesch elles exploits de Râ-mes-sou II, et en narrations officielles des princes sur les hauts faits de leurs guerres et leurs fondations pieuses, telle que celle que Râ-mes-sou III donne dans le grand Papyrus Harris ; en correspondances littéraires des maîtres fameux avec leurs disciples, de la nature de celles auxquelles nous avons eu déjà l’occasion de faire de si nombreux emprunts ; en manuels de philosophie et de morale pratique sous forme de collections de sentences, enfin en romans, contes et récits de pure imagination. Les principaux livres religieux et ceux qui contenaient les éléments fondamentaux des sciences les plus essentielles à la civilisation avaient un caractère sacré, qui en faisait de véritables livres saints. On leur attribuait une origine révélée et on disait qu’ils avaient été composés par Tahout, le dieu à tête d’ibis, inventeur des lettres, maître de toute connaissance, auteur de toutes les inventions utiles, qui préside à la régularité du cours des choses et des mouvements célestes. Les Grecs, ayant assimilé Tahout à leur Hermès, appelèrent Livres Hermétiques, les écrits sacrés dont on le disait l’auteur. Nous essaierons, en puisant nos données aux meilleures sources, d’indiquer l’état auquel en étaient parvenues celles des sciences que cultivaient spécialement les Égyptiens et ce que pouvaient contenir les livres qui en traitaient. Après quoi nous nous attacherons à donner une certaine idée de leurs écrits proprement littéraires, surtout de ceux dont nous n’avons pas encore eu l’occasion de parler, en particulier de leurs œuvres d’imagination. § 3. — ASTRONOMIE, MATHÉMATIQUES, ASTROLOGIE. Dès les premiers jours, dit M. Maspero, les astronomes égyptiens reconnurent qu’un certain nombre des astres qui brillaient au-dessus de leur tête paraissaient animés d’un mouvement de translation à travers les espaces, tandis que les autres demeuraient immobiles. Cette observation, répétée maintes et maintes fois, les conduisit à établir la distinction des étoiles voyageuses qui ne reposent jamais (âkhimou-ourdou) et des étoiles fixes qui jamais ne bougent (âkhimou-sekou). Ils comptèrent parmi les premières Hor, guide des espaces mystérieux (Har-tap-schetâou), notre Jupiter, que son éclat fit mettre à la tête des planètes ; Hor, régénérateur d’en haut (Har-kâ-her), Saturne, la plus éloignée des planètes que l’œil humain puisse apercevoir sans le secours des instruments ; Har-m-akhôuti, Mars, que sa couleur rougeâtre fit appeler aussi Har-descher, le Hor rouge, et dont le mouvement rétrograde en apparence à certains moments de l’année ; ne leur échappa point ; Sevek ou Mercure ; Vénus enfin, qui dans son rôle d’étoile du matin s’appelle Douâou, et Bennou peut-être dans son rôle d’étoile du soir. Il semble même résulter de textes fort anciens qu’ils assimilaient la terre aux planètes et lui attribuaient un mouvement de translation analogue à celui de Mars ou de Jupiter. Pour les astronomes égyptiens, comme pour l’écrivain du premier chapitre de la Genèse, le ciel est une masse liquide qui enserre la terre de toutes parts, et repose sur l’atmosphère comme sur un fondement solide. Aux jours de la création, quand le chaos se résolut en ses éléments, le dieu Schou souleva les eaux d’en haut et les répandit dans l’espace. C’est sur cet océan céleste, le Nou, que flottent les planètes et généralement tous les astres. Les monuments nous les montrent figurés par des génies à formes humaines ou animales et naviguant chacun dans sa barque à la suite d’Osiris. Une autre conception, aussi répandue que la première, présentait les étoiles fixes comme des lampes (khâbesou) suspendues à la voûte céleste et qu’une puissance divine allumait chaque soir pour éclairer les nuits de la terre. Au premier rang de ces astres-lampes on mettait les décans, simples étoiles en rapport avec les trente-six ou trente-sept décades dont se composait l’année égyptienne ; Sopt ou Sothis, notre Sirius, saint à Isi ; Sahou, notre Orion, consacré à Osiri et considéré par quelques-uns comme le séjour des âmes heureuses ; les Pléiades, les Hyades, et beaucoup d’autres dont les noms anciens n’ont pu encore être identifiés d’une manière certaine avec les noms modernes. Bref, toutes les étoiles qu’on peut apercevoir à l’œil nu avaient été relevées, enregistrées, cataloguées avec soin. Les observations de la Haute et de la Basse-Égypte, à Tentyris (Tanterer), Tbinis (Teni), Memphis (Man-nofri), Héliopolis (On), signalaient leurs phases et dressaient chaque année des tables de leurs levers et de leurs couchers dont quelques débris sont arrivés jusqu’à nous. De tous ces astres, le mieux connu et le plus important était l’astre d’Isi, Sirius, que les Égyptiens nommaient Sopt, d’où les Grecs ont fait Sothis. Son lever héliaque, qui marquait le commencement de l’inondation, marquait aussi le commencement de l’année civile, si bien que tout le système chronologique du pays reposait sur lui. L’année primitive des Égyptiens, ou du moins la première année que nous leur connaissions historiquement, se composait de douze mois de trente jours chaque, soit en tout 360 jours. Ces douze mois étaient partagés en trois saisons de quatre mois : la saison du commencement (schâ), qui répond au temps de l’inondation ; la saison des semailles (pre), qui répond à l’hiver ; la saison des moissons (schemou), qui répond à l’été. Chaque mois se composait de trois décades ; chaque jour et chaque nuit se divisait en douze heures, vingt-quatre heures en tout pour le nycthémère : si bien que midi répondait à la sixième heure du jour, et minuit à la sixième heure de la nuit. Ce système, pour simple qu’il parût, avait ses inconvénients qu’on ne tarda pas à reconnaître. Entre l’année des Égyptiens, telle qu’elle était alors, et l’année tropique, il y avait une différence de 4 jours ¼ ; à chaque douze mois qui s’écoulèrent, l’écart entre l’année égyptienne et l’année fixe augmenta de 5 jours ¼, et par suite les saisons cessèrent de s’accorder avec les phases de la lune. Des observations nouvelles faites sur le cours du soleil décidèrent les astronomes à intercaler chaque année, entre le douzième mois et le premier jour de l’année suivante, cinq jours complémentaires qu’on nomma les cinq jours en sus de l’année ou jours épagomènes. L’époque de ce changement était si ancienne que nous ne saurions lui assigner aucune date et que les Égyptiens eux-mêmes l’avaient reportée jusque dans les temps mythiques antérieurs à l’avènement de Mena. Rhéa (Nou-t) ayant eu un commerce secret avec Saturne (Seb), le Soleil (Râ), qui s’en aperçut, prononça contre elle un charme qui l’empêcha d’accoucher dans aucun mois et dans aucune année ; mais Hermès (Tahout), qui avait de l’amour pour la déesse, joua aux dés avec la Lune et lui gagna la soixantième partie de chaque jour, dont il forma cinq jours qu’il ajouta aux 360 autres de l’année[4]. Dans ce système, l’année vague de 365 jours ne répond pas encore exactement à l’année astronomique de 365 jours ¼. Il y eut donc tous les quatre ans un retard d’un jour sur cette année, si bien que pour 365 x 4 ou 1460 années astronomiques, on compta 1461 années civiles écoulées. Au bout de quatorze siècles et demi, l’accord, si longtemps rompu, était parfait de nouveau : le commencement de l’année coïncidait alors, et pour une fois seulement, avec celui de l’année astronomique ; le commencement de ces deux années coïncidait avec le lever héliaque au matin de Sirius-Sothis, et par suite avec le début de l’inondation. Aussi les prêtres célébrèrent-ils le lever de l’astre par des fêtes solennelles, dont l’origine devait remonter plus haut que les rois delà première dynastie, au temps des Schesou-Hor, et donnèrent à la période de 1460-1461 ans qui ramenait cette coïncidence merveilleuse le nom de période sothiaque. Le tableau suivant présente la série des mois et des jours épagomènes de l’année égyptienne vague de 365 jours, avec les appellations antiques des mois, les noms que les Coptes leur ont donnés, l’indication de la divinité protectrice de chacun, source du nom copte par une altération dont il est presque toujours facile de se rendre compte, enfin la coïncidence de son jour initial avec les dates de l’année julienne de 365 ¼ jours, à l’époque climatérique du renouvellement de la période sothiaque[5].
On n’a pas d’astronomie sans mathématiques, et nous savons, du reste, d’une manière positive que les Égyptiens avaient poussé assez loin certaines branches de cet ordre de sciences. Malheureusement nous ne possédons absolument rien de la littérature mathématique de l’Ancien Empire. Mais les monuments prouvent que dès le temps de la construction des pyramides la géométrie devait être avancée, sinon la géométrie théorique, au moins la géométrie pratique, celle qui sert à mesurer les surfaces et à calculer le volume des solides. Dès la création de l’agriculture égyptienne, la nécessité de répéter fréquemment les arpentages après l’inondation périodique, de mesurer les accroissements ou les diminutions de terrain résultant des déplacements du sol avait conduit, nous dit l’antiquité d’un témoignage unanime, les Égyptiens à tourner leur attention vers les problèmes de la géométrie des surfaces. Et ils attribuaient la création de cette science, comme celle du calcul arithmétique, au dieu Tahout. Les architectes qui ont bâti les pyramides et les grands tombeaux de Saqqarah étaient nécessairement déjà des géomètres fort estimables. Nous n’avons plus rien des livres dans lesquels ils exposaient leurs doctrines. Le seul traité de géométrie égyptien qui soit, parvenu jusqu’à nous est postérieur de 2,000 ans au moins à l’âge des pyramides, et nous fournit des données sur l’état de la science pour les temps relativement modernes de la XIXe dynastie. C’est un papyrus du Musée Britannique, que M. Eisenlohr a récemment publié[6]. Il contient un certain nombre de théorèmes de trigonométrie plane et de mesure des solides, puis une sorte de manuel du calculateur, où l’on a cru à tort retrouver la trace de procédés algébriques, tandis qu’ils sont tous purement arithmétiques[7]. Certaines des méthodes de calcul qui y sont employées semblent donner l’origine et partant l’explication de méthodes, de manières de voir qui nous semblent étranges aujourd’hui et qui avaient cours soit chez les Grecs, soit chez les Arabes et chez les premiers mathématiciens de l’Europe au moyen âge, disciples plus ou moins directs de ces derniers. La numération égyptienne était décimale. Sa notation comprenait des chiffres pour représenter 1, 10, 100, 1000, 10000 et 100000, et on répétait autant de fois le chiffre de l’unité, de la dizaine, de la centaine, etc. que le nombre à exprimer en contenait. L’expression de 245578, par exemple, pourrait se traduire en 10000 + 100000 + 10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 +10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1. Il y a donc là une notation analogue à celle des chiffres romains, qui (en ne tenant pas compte des chiffres particuliers pour 5 et 50, inusités des Égyptiens) exprimeraient le même nombre par CCC | ƆƆƆ CCC | ƆƆƆCC | ƆƆCC | ƆƆCC | ƆƆ CC | DD MMMMMCCCCCXXXXXXXIIIIIIII. Mais cette notation compliquée et qui demandait trop de place pour s’étaler reste exclusivement propre aux textes hiéroglyphiques. Dans l’usage des documents hiératiques et démotiques, elle se simplifie et s’abrège. On crée des signes spéciaux pour tous les nombres de la série des unités de 1 à 9, de la série des dizaines de 10 à 90, de celle des centaines de 100 à 900, etc. De cette façon la notation hiératique ou démotique du nombre 245578 serait à traduire par 200000 + 40000 + 5000 + 500 + 70 + 8. Pour noter les nombres fractionnaires, les Égyptiens n’admettaient que des fractions au numérateur 1. Ils étaient donc obligés, dès qu’ils avaient à exprimer autre chose qu’une fraction de ce genre, d’en établir toute une série successivement descendante. Ainsi pour eux 248/1000 se représentaient par 1/5 + 1/25 + 1/200 + 1/500 + /1000. C’est à l’imitation des Égyptiens que les Grecs, Diophante excepté, n’avaient de notation que pour les fractions dont le numérateur est l’unité, et que Héron d’Alexandrie transformait ses nombres fractionnaires en sommes de fractions simples au numérateur[8]. Mais si les Égyptiens avaient des mathématiques assez avancées et une certaine somme d’astronomie scientifique, ils unissaient à ces notions réelles une confiance aveugle dans l’astrologie. Cette trompeuse superstition était comptée par eux au nombre des sciences. Les Grecs et les Romains ont qualifié de jours égyptiens la distinction des jours fastes et néfastes, d’après laquelle on devait faire ou ne pas faire telle ou telle chose à une certaine date de l’année. En effet, dans un papyrus du Musée Britannique on a reconnu les fragments d’un calendrier astrologique rédigé sous la XIXe dynastie, et contenant pour chaque jour l’indication des actes qu’on devait y accomplir ou dont on devait s’abstenir. En général le caractère favorable ou funeste d’un jour déterminé dépendait d’une raison empruntée aux traditions mythologiques. Le 17 athyr d’une année si bien perdue dans les lointains du passé qu’on ne savait plus au juste combien de siècles s’étaient écoulés depuis, Set avait attiré près de lui son frère Osiri et l’avait tué en trahison au milieu d’un banquet, dit M. Maspero[9]. Chaque année, à pareil jour, la tragédie qui s’était accomplie autrefois dans le palais terrestre du dieu semblait se jouer de nouveau dans les profondeurs du ciel égyptien. Comme au même instant de la mort d’Osiri, la puissance du bien s’amoindrissait, la souveraineté du mal prévalait partout ; la nature entière, abandonnée aux divinités de ténèbres, se retournait contre l’homme. Un dévot n’avait garde de rien faire ce jour-là : quoi qu’il se fût avisé d’entreprendre, c’aurait échoué. Qui sortait au bord du fleuve, un crocodile l’assaillait comme le crocodile envoyé par Set avait assailli Osiri. Qui partait pour un voyage pouvait dire adieu pour jamais à sa famille et à sa maison ; il était certain de ne plus revenir. Mieux valait s’enfermer chez soi, attendre, dans la crainte et dans l’inaction, que les heures de danger s’en fussent allées une à une, et que le soleil du jour suivant, à son lever, eût mis le mauvais en déroute. Le 9 khoiak, Tahout avait rencontré Set et remporté sur lui une grande victoire. Le 9 khoiak il y avait fête sur la terre parmi les hommes, fête dans le ciel parmi les dieux et sécurité de tout entreprendre. Les jours se succédaient, fastes ou néfastes, selon l’événement qu’ils avaient vu s’accomplir au temps des dynasties divines. Le 4 tybi. — Bon, bon, bon[10]. — Quoi que tu voies en ce jour, c’est pour toi d’heureux présage. Qui naît ce jour-là meurt le plus âgé de tous les gens de sa maison ; il aura longue vie succédant à son père. Le 5 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — C’est le jour où furent brûlés les chefs par la déesse Sekhet, qui réside dans la demeure blanche, lorsqu’ils sévirent, se transformèrent, vinrent. Gâteaux d’offrandes pour Schou, Phtah, Tahout ; encens sur le feu pour Râ et les dieux de sa suite, pour Phtah, Tahout, Hou-Saou, en ce jour. Quoi que tu voies en ce jour, ce sera mauvais. Le 6 tybi. — Bon, bon, bon. — Quoi que tu voies en ce jour, ce sera heureux. Le 7 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne t’unis pas aux femmes devant l’œil de Hor[11]. Le feu qui est dans ta maison, garde-toi de son atteinte. Le 8 tybi. — Bon, bon, bon. — Quoi que tu voies de ton œil en ce jour, le cycle divin le rendra favorable. Consolidation des débris (du corps d’Osiri taillé en pièces par Set). Le 9 tybi. — Bon, bon, bon. — Les dieux acclament la déesse du midi en ce jour. Présenter des gâteaux de fête et des pains frais qui réjouissent le cœur des dieux et des mânes. Le 10 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais pas un feu de joncs ce jour-là. Ce jour-là le feu sortit du dieu Sop-ho, dans le Delta[12]. Le 11 tybi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — N’approche pas de la flamme en ce jour. Râ l’a dirigée pour anéantir tous ses ennemis, et quiconque en approche en ce jour ne se prêtera plus bien tout le temps de sa vie. Tel officier de haut rang qui, le 13 de tybi, affrontait la dent d’un lion en toute assurance et fierté de courage, ou entrait dans la mêlée sans redouter la morsure des flèches syriennes, le 12 s’effrayait à la vue d’un rat, et, tremblant, détournait les yeux. Chaque jour avait ses influences, et les influences accumulées formaient à chaque homme un destin. Le destin naissait avec l’homme, grandissait avec lui, le guidait à travers sa jeunesse et son vieil âge, jetait, pour ainsi dire, la vie entière dans le moule immuable que les actions des dieux avaient préparé dès le commencement des temps. Le Pharaon était soumis au destin, soumis aussi les chefs des nations étrangères. Le destin suivait son homme jusqu’après la mort ; il assistait avec la Fortune au jugement de l’âme, soit pour rendre au jury infernal compte exact des vertus ou des crimes, soit afin de préparer les conditions d’une nouvelle vie. Les traits sous lesquels on se figurait la destinée n’avaient rien de hideux. C’était une déesse, Hat-Hor, ou mieux sept jeunes et belles déesses, des Hat-Hor à la face rosée et aux oreilles de génisse, toujours gracieuses, toujours souriantes, qu’il s’agît d’annoncer le bonheur ou de prédire la misère. Comme les fées marraines du moyen âge, elles se pressaient autour du lit des accouchées et attendaient la venue de l’enfant pour l’enrichir ou le ruiner de leurs dons. Les bas-reliefs du temple de Louqsor et ceux d’un temple d’Esneh nous les montrent qui jouent le rôle de sages-femmes auprès de la reine Mout-em-ouat, femme de Tahout-mès IV et auprès de la fameuse Cléopâtre. Les unes soutiennent la jeune mère et la raniment par leurs incantations ; lés autres reçoivent le nouveau-né, se le passent de main en main, lui prodiguent les premiers soins et lui présagent à l’envi toutes les félicités. Les romans les mettent plusieurs fois en scène... Les voir et les entendre au moment même où elles rendaient leurs arrêts était faveur réservée aux grands de ce monde. Les gens du commun n’étaient pas d’ordinaire dans leur confidence, Ils savaient seulement, par l’expérience de nombreuses générations, qu’elles départaient certaines morts aux hommes qui naissaient à de certains jours. Le 4 paophi — Hostile, bon, bon. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour. — Quiconque naît en ce jour meurt de contagion en ce même jour. Le 5 paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne sors aucunement de ta maison en ce jour ; ne t’approche pas des femmes. C’est un jour d’offrandes devant les dieux, et Monthou repose en ce jour. Quiconque naît en ce jour, mourra de l’amour. Le 6 paophi. — Bon, bon, bon. — Jour heureux dans le ciel. — Quiconque naît ce jour-là mourra d’ivresse. Le 7 paophi. — Mauvais, mauvais, mauvais. — Ne fais absolument rien en ce jour. — Quiconque naît ce jour-là mourra sur une terre étrangère. Le 9 paophi. — Bon, bon, bon. — Allégresse des dieux ; les hommes sont en fête, car l’ennemi de Râ est à bas. — Quiconque naît ce jour-là mourra de vieillesse. Le 23 paophi. — Bon, bon, mauvais. — Quiconque naît ce jour-là meurt par le crocodile. Le 27 paophi. — Hostile, hostile, hostile. — Ne sors pas ce jour ; ne t’adonne à aucun travail manuel. Râ repose. Quiconque naît ce jour-là meurt par le serpent. Le 29 paophi. — Bon, bon, bon. — Quiconque naît ce jour-là mourra dans la vénération de tous ses gens. Tous les mois n’étaient pas également favorables à cette sorte de présages. A naître en paophi, on avait huit chances sur trente de connaître, par le jour de la naissance, le genre de la mort Athyr, qui suivait immédiatement paophi, ne renfermait que trois jours fatidiques. Il est certain que l’idée des influences astrales avait autant de part que les dates attribuées par la légende à tel ou tel incident des histoires mythologiques, dans l’assignation d’un caractère favorable ou funeste aux différents jours de l’année et dans les présages qu’on en tirait pour la destinée de ceux qui naissaient à certains jours. Aussi les Égyptiens cultivaient-ils, comme nous verrons que le faisaient aussi les Chaldéens, l’art de dresser les horoscopes des naissances et d’en tirer des augures pour l’existence et la mort des gens qui étaient nés alors que les planètes et les étoiles fixes se trouvaient dans le ciel à telle ou telle position respective. § 4. — MÉDECINE Ici encore, c’est chez M. Maspero que nous puisons nos renseignements. Pour nous figurer ce que pouvait être la médecine égyptienne, dit-il[13], nous n’en sommes pas réduits à de simples inductions. Outre un traité dont l’invention était attribuée au règne de Khoufou et dont le manuscrit, parvenu jusqu’à nous, est connu sous le nom de Papyrus Ebers, nous possédons un livre qui est dit avoir été trouvé sous le roi Hesep-ti et complété sous le roi Send, de la IIe dynastie. Le manuscrit qui nous l’a conservé[14] remonte seulement à la IXIe dynastie ; il est assez probable que l’ouvrage lui-même avait dû se modifier depuis les jours du roi Send au far et à mesure que la science faisait des progrès. Tel qu’il nous est parvenu, il renferme un grand nombre de recettes qui remontaient à un temps immémorial. L’ancienneté de son origine le maintenait en grand honneur dans les écoles ; il faisait sans doute partie de cette bibliothèque médicale du temple d’I-m-hotpou, à Memphis, qui existait encore au temps des empereurs romains et fournissait des remèdes aux médecins grecs. L’Égypte est naturellement un pays fort sain. Les Égyptiens, disait Hérodote, sont les mieux portants de tous les mortels. Ils n’en étaient que plus attentifs à soigner leur santé. Chaque mois, trois jours de suite, ils provoquent des évacuations au moyen de vomitifs et de clystères, car ils pensent que toutes les maladies de l’homme viennent des aliments... La médecine chez eux est partagée : chaque médecin ne s’occupe que d’une seule espèce de maladie, et non de plusieurs. Les médecins en tous lieux abondent, les uns pour les yeux, les autres pour la tête, d’autres pour les dents, d’autres pour le ventre, d’autres pour les maux internes. Il ne semble pas que celle division dont parle Hérodote ait été aussi absolue que l’historien a bien voulu le dire. Le même individu pouvait traiter toutes les maladies en général ; seulement, pour les maux d’yeux ou pour quelques autres affections, il y avait comme chez nous des spécialistes que l’on consultait de préférence aux praticiens ordinaires. Si leur nombre paraissait considérable à l’historien grec, cela tient à la constitution médicale d’un pays où les ophtalmies et les maladies intestinales, par exemple, sont encore aujourd’hui plus fréquentes que partout en Europe. La médecine théorique ne paraît pas avoir fait de grands progrès en Égypte, bien que les pratiques de la momification eussent dû fournir aux médecins l’occasion d’étudier à loisir l’intérieur du corps humain. Une sorte de crainte religieuse ne leur permettait pas plus qu’aux médecins chrétiens du moyen âge de mettre en pièces, dans un but de pure science, le cadavre qui devait reprendre vie un jour. Leur horreur pour quiconque rompait l’intégrité du corps humain était si grande, que l’embaumeur chargé de pratiquer les incisions réglementaires était l’objet de l’exécration universelle. Toutes les fois qu’il venait d’exercer son métier, les assistants le poursuivaient à coups de pierres et l’auraient assommé sur place s’il ne s’était enfui à toutes jambes. De plus, les règlements médicaux n’étaient pas de nature à encourager les recherches scientifiques. Les médecins devaient traiter le malade d’après les règles posées dans certains livres d’origine réputée divine. S’ils s’écartaient des prescriptions sacrées, c’était à leurs risques et périls ; en cas de mort du patient, ils étaient convaincus d’homicide volontaire et punis comme assassins. Le seul point que nous connaissions de leurs doctrines est la théorie des esprits vitaux. Le corps renfermait un certain nombre de vaisseaux qui charriaient des esprits vivifiants. La tête a trente-deux vaisseaux qui amènent des souffles à son intérieur ; ils transmettent les souffles à toutes les parties du corps. Il y a deux vaisseaux aux seins qui conduisent la chaleur au fondement... Il y a deux vaisseaux de l’occiput, deux du sinciput, deux à la nuque, deux aux paupières, deux aux narines, deux à l’oreille droite par lesquels entrent les souffles de la vie ; il y en a deux de l’oreille gauche par lesquels entrent les souffles[15]. Les souffles dont il est question dans ce passage sont appelés ailleurs les bons souffles, les souffles délicieux du Nord. Ils pénétraient dans les veines et les artères, se mêlaient au sang qui les entraînait par tout le corps, faisaient mouvoir l’animal et le portaient pour ainsi dire. Au moment de la mort, ils se retirent avec l’âme, le sang se coagule, les veines et les artères se vident et l’animal périt. Les maladies dont il est question dans les papyrus médicaux ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Ce sont, autant qu’on en peut juger, des varices ou des ulcères aux jambes, une sorte d’érisypèle, le ver, et enfin la maladie divine mortelle, le divinus morbus des Latins, l’épilepsie. Un traité développe quelques questions relatives à la conception et à l’accouchement. La diagnose est donnée dans plusieurs cas et permettrait peut-être à un médecin de reconnaître la nature de l’affection. Voici celle d’une sorte d’inflammation : Lourdeur du ventre ; le col du cœur malade ; au cœur, inflammation, battements accélérés. Les vêtements pèsent sur le malade ; beaucoup de vêtements ne le réchauffent pas. Soifs nocturnes. Le goût pervers, comme un homme qui a mangé des fruits de sycomore. Chairs amorties comme celles d’un homme qui se trouve mal. S’il va à la selle, son ventre est enflammé et refuse de s’exonérer. Les médicaments indiqués sont de quatre sortes : pommades, potions, cataplasmes et clystères. Ils son t composés chacun d’un assez grand nombre de substances empruntées à tous les règnes de la nature. On y trouve citées plus de cinquante espèces de végétaux, depuis des herbes et des broussailles jusqu’à des arbres, tels que le cèdre dont la sciure et les copeaux passaient pour avoir des propriétés lénitives, le sycomore et maints autres dont nous ne comprenons pas les noms antiques. Viennent ensuite des substances minérales, le sulfate de cuivre, le sel, le nitre, la pierre memphite (aner sopd), qui, appliquée sur des parties malades ou lacérées, avait, dit-on, des vertus anesthésiques. La chair vive, le cœur, le foie, le fiel, le sang frais et desséché de divers animaux, le poil et la corne de cerf, jouaient un grand rôle dans la confection de certains onguents souverains contre les inflammations. Les ingrédients constitutifs de chaque remède étaient piles ensemble ; puis, bouillis et passés au linge, ils avaient d’ordinaire pour véhicule l’eau pure ; mais souvent on les mélangeait avec des liquides d’espèces variées, la bière (haq), la bière douce (haq notsem) ou tisane d’orge, le lait de vache et de chèvre, l’huile d’olive verte et l’huile d’olive épurée (baq notsem), ou même, comme dans la médecine de Molière, l’urine humaine ou animale. Le tout, sucré de miel, se prenait chaud matin et soir. Mais les maladies n’avaient pas toujours une origine naturelle. Elles étaient souvent produites par des esprits malfaisants qui entraient dans le corps de l’homme, et trahissaient leur présence par des désordres plus ou moins graves. En traitant les effets extérieurs, on parvenait tout au plus à soulager le patient. Pour arriver à la guérison complète, il fallait supprimer la cause première de la maladie en éloignant par des prières l’esprit possesseur. Aussi une ordonnance de médecin se composait-elle de deux parties : d’une formule magique et d’une formule médicale. Voici une conjuration destinée à corroborer l’action d’un vomitif : Ô démon qui loges dans le ventre d’un tel fils d’une telle, ô toi dont le père est nommé Celui qui abat les têtes, dont le nom est Mort, dont le nom est Mâle de la mort, dont le nom est Maudit pour l’éternité ! Pour guérir le mal de tête, on n’avait qu’à dire : Le devant de la tête est aux chacals divins, le derrière de la tête est un pourceau de Râ. Place-les sur un brasier ; quand l’humeur qui en sortira aura atteint le ciel, il en tombera une goutte de sang sur la terre. Ces paroles devaient être répétées quatre fois. Si ce galimatias ne guérissait pas le malade, au moins le débarrassait-il des terreurs superstitieuses dont il était assailli. Le médecin, après avoir calmé de la sorte l’esprit du patient, pouvait essayer sur le corps l’efficacité des remèdes traditionnels. L’invocation magique passait pour anéantir la cause mystérieuse ; le traitement combattait les manifestations visibles du mal[16]. § 5. — MAGIE. En parlant des connaissances réelles des Égyptiens en fait d’astronomie j’ai été amené tout à l’heure à dire quelques mots de leurs superstitions astrologiques, ainsi que de la croyance qu’ils nourrissaient à l’existence de jours heureux et néfastes répartis dans le cours de l’année et exerçant une influence décisive sur la destinée des hommes. De même, l’emploi des opérations magiques, des incantations et des talismans dans la médecine des temps pharaoniques nous impose la nécessité de parler aussi avec quelque détail d’une autre superstition, qui tenait également une place capitale dans les préoccupations des Égyptiens et qu’ils croyaient une science réelle, la magie. Les livres magiques tenaient une certaine place dans toutes les bibliothèques de l’ancienne Égypte, et parmi les papyrus que nous possédons il en est plusieurs qui traitent de cette matière. Mais ce sont surtout les contes et les romans qui nous font voir quelle importance on attachait à la magie. On n’emploie pas communément chez nous, comme ressorts de romans, dit M. Maspero, les apparitions de divinités, les transformations de l’homme en bête, les animaux parlants, les opérations magiques. Ceux même qui croient le plus fermement aux miracles de ce genre, les considèrent comme un accident rare dans la vie moderne. Il n’en était pas de même en Égypte ; là sorcellerie y faisait partie de la vie courante, aussi bien que la guerre, le commerce, la littérature, les métiers qu’on exerçait, les divertissements qu’on prenait. Tout le monde n’avait pas vu les prodiges qu’elle opérait, mais tout le monde connaissait quelqu’un qui les avait vus s’accomplir, en avait profité ou en avait souffert. La magie était une science, et le magicien un savant des plus estimés. Les grands eux-mêmes, le prince Satni Khâ-m-Ouas et son frère, sont adeptes des sciences surnaturelles et déchiffreurs convaincus des grimoires mystiques. Un prince sorcier n’inspirerait chez nous qu’une estime médiocre ; en Égypte, la magie n’était pas incompatible avec la royauté, et les sorciers du Pharaon eurent souvent le Pharaon pour élève. Parmi les personnages des contes égyptiens, la plupart sont des sorciers amateurs ou de profession. Bitiou enchante son cœur et se l’arrache de la poitrine sans cesser de vivre, se transforme en bœuf et en arbre. Khâ-m-Ouas et son frère ont appris, par aventure, l’existence d’un livre que le dieu Tahout avait écrit de sa propre main, et qui était pourvu de propriétés merveilleuses. Ce livre se composait de deux formules, sans plus, mais quelles formules ! Si tu récites la première, tu charmeras le ciel, la terre, l’enfer, les monts, les eaux ; tu connaîtras les oiseaux et les reptiles, tous tant qu’ils sont ; tu verras les poissons, car la force divine de l’eau les fera monter à la surface. Si tu récites la seconde formule, quand même tu serais dans la tombe, tu auras la même forme que tu avais sur la terre ; tu verras aussi le soleil se levant au ciel et son cycle de dieux, et la lune en la forme qu’elle a quand elle paraît. Satni Khâ-m-Ouas tenait à se procurer, outre ; l’ineffable douceur de voir à son gré le lever de la lune, la certitude de ne jamais perdre la forme qu’il avait sur terre. Le désir qu’il a de se procurer le livre merveilleux devient le principal ressort du roman. L’idée de toutes les formules magiques égyptiennes contre les fléaux de la vie, les maladies, les animaux malfaisants, est l’assimilation de celui qui les prononce aux dieux, assimilation que produit la vertu des paroles de l’enchantement et qui met l’homme à l’abri du danger. Aussi généralement la formule ne consiste pas dans une invocation à la puissance divine, mais dans le fait de proclamer qu’on est tel ou tel dieu, qu’on le devient par l’opération théurgique ; et quand l’homme qui répète l’incantation appelle à son secours quelques personnages du panthéon, c’est comme l’un d’eux, qui a droit à l’aide de ses compagnons de divinité. Ceci est très nettement établi dans les formules du célèbre papyrus magique Harris, objet des études de M. Chabas, manuscrit de l’époque de la XIXe dynastie, qui est peut-être un fragment du recueil de magie dont on attribuait la composition au dieu Tahout, le comptant ainsi dans la collection des livres hermétiques[17]. Voici une des incantations de ce papyrus, destinée à se mettre à l’abri des crocodiles : Ne sois
point contre moi ! Je suis Ammor. Je suis
An-hour, le bon gardien. Je suis
le grand maître du glaive. Ne te
dresse pas ! Je suis Monthou. N’essaie
pas de surprendre ! Je suis Set. Ne
porté pas tes deux bras contre moi ! Je suis Sotp. Ne
m’alteins pas ! Je suis Séthou. Alors
ceux qui sont dans l’eau ne sortent pas ; ceux
qui sont, sortis ne rentrent pas à l’eau ; et ceux
qui restent à flotter sur les eaux sont
comme des cadavres sur Fonde ; et
leurs bouches se ferment, comme
sont fermés les sept grandes arcanes, d’une clôture éternelle. Dans cette autre, dirigée contre les différents animaux nuisibles, l’homme qui veut se mettre à l’abri de leurs atteintes invoque l’aide d’un dieu, mais à titre de dieu lui-même : Viens à
moi, ô seigneur des dieux ! Repousse
loin de moi les lions venant de la terre, les
crocodiles sortant du fleuve, la
bouche de tous les reptiles mordants sortis de leurs trous Arrête,
crocodile Mako, fils de Set ! Ne
vogue pas avec ta queue ; ne
saisis pas de tes deux bras ; n’ouvre
pas la gueule. Que
l’eau devienne un feu ardent devant toi ! La
pique des trente sept dieux est sur tes yeux ; l’arme
des trente-sept dieux est sur ton œil ; tu es
lié au grand croc de Râ ; tu es
lié aux quatre piliers de bronze du midi, à
l’avant de la barque de Râ. Arrête,
crocodile Mako, fils de Set ! Car je suis Ammon, le mari de sa mère. Il en est de même de cette troisième formule, où c’est à Hor que s’identifie l’incantateur, en réclamant l’appui d’Isi et de Neb-t-ha Nephthys) contre tous les périls qui pourraient menacer un Égyptien dans une maison de campagne isolée : Ô toi
que ramène la voix du gardien, Hor a
prononcé à voix basse l’invocation : Campagne ! Cela
dit, les animaux qui le menaçaient ont rétrogradé. Qu’Isi,
ma bonne mère, prononce pour moi l’invocation, ainsi
que Neb-t-ha, ma sœur ! Qu’elles
demeurent dans l’arche de salut à mon sud, à mon
nord, à mon
occident, à mon
orient, Pour
que soit scellée la gueule des lions et des hyènes, la tète
de tous les animaux à longue queue qui se
repaissent de chair et boivent le sang ; pour
les fasciner ; pour
leur enlever l’ouïe ; pour me
tenir dans l’obscurité ; pour ne
pas me mettre en lumière ; pour me
rendre invisible à tout
instant de la nuit ! Fréquemment c’est à Osiri que le personnage qui veut être défendu des mauvaises influences s’assimile. Il se représente, comme le dieu bienfaisant dont nous raconterons un peu plus loin l’histoire, en butte aux entreprises de Set, le dieu ennemi, et de son funeste cortège de maux ; et pour en conjurer l’action il rappelle les événements de la lutte épique dans laquelle, après avoir succombé, le principe de l’ordre et de la conservation de la vie, symbolisé par Osiri, avait définitivement triomphé. C’est ce que nous voyons, par exemple, dans cette incantation contre la morsure des serpents venimeux, inscrite sur un petit papyrus du Louvre, qui, roulé dans un étui, se portait comme talisman : Il est
comme Set, l’aspic, le
serpent malfaisant, dont le venin est brûlant. Celui
qui vient pour jouir de la lumière, qu’il soit caché ! Celui
qui demeure dans Thèbes s’approche de toi, cède,
reste en ta demeure ! Je suis
Isi, la veuve brisée de douleur. Tu veux
t’élever contre Osiri ; il est
couché au milieu des eaux, où
mangent les poissons, où boivent les oiseaux, où les
filets enlèvent leur prise, tandis
qu’Osiri est couché dans la souffrance. Ô Toum,
seigneur d’On, ton
cœur est satisfait et triomphant. Ceux
qui sont dans le tombeau sont en acclamations, ceux
qui sont dans le cercueil se livrent à l’allégresse, lorsqu’ils
voient le fils d’Osiri renversant
les ennemis de son père, recevant
la couronne blanche de son père Osiri et
atteignant les méchants. Viens !
relève-toi, Osiri-Sap, car tes
ennemis sont abattus. Ce n’est pas seulement à l’homme que les paroles magiques peuvent communiquer la vertu divine ; elles peuvent y faire même participer des animaux pour la protection de l’homme, comme elles font résider un pouvoir invincible dans un objet inanimé, enchanté comme talisman. Le papyrus magique Harris nous donne ainsi la formule qu’on prononçait sur un chien de garde, afin d’augmenter sa force par la puissance de l’enchantement : Debout
! chien méchant ! Viens !
que je te prescrive ce que tu as à faire aujourd’hui. Tu
étais attaché, te voilà délié. C’est
par Hor qu’il t’est prescrit de faire ceci : Que ta
face soit le ciel ouvert ! Que ta
mâchoire soit impitoyable ! Que ta
force immole comme le dieu Har-schafi ! Massacre
comme la déesse Anata ! Que ta
crinière présente des verges de fer ! Sois pour cela Hor et pour cela Set[18] ! Va au
sud, au nord, à l’ouest, à l’est ; la
campagne t’est livrée toute entière ; rien ne
t’y arrêtera. Ne dirige
pas ta face contre moi ; dirige-la
contre les animaux sauvages. Ne
présente pas ta face sur mon chemin ; présente-la
sur celui de l’étranger. Je
t’investis d’une vertu fascinatrice ; enlève, l’ouïe ! Car tu
es le gardien courageux, redoutable. Salut !
Parole de salut ! Dans ces citations on voit se dessiner clairement deux faits signalés par les écrivains grecs, et qui donnaient à la magie égyptienne un caractère tout à fait à part. C’est d’abord l’absence de développement démonologique. Les Égyptiens n’admettaient que dans le monde des âmes un certain nombre de génies en antagonisme, les uns parèdres et serviteurs d’Osiri, les autres formant le cortège de Set. Sur la terre, ce sont uniquement les fléaux naturels, les animaux nuisibles qui, avec des âmes de damnés revenant comme vampires, servent d’instruments à la puissance du dieu du mal. Les exorcismes magiques ne combattent pas des démons à proprement parler ! De même, ce n’est pas sur des esprits favorables et inférieurs aux dieux que s’exerce le pouvoir des incantations propitiatoires. Il met au service dé l’homme pour le protéger l’action des dieux eux-mêmes. Quant au rapport que ces formules établissent entre l’homme et les dieux, il est aussi conçu d’une manière exclusivement propre aux doctrines égyptiennes. Chez les autres peuples, la puissance magique ne commande qu’aux esprits secondaires et n’a d’action coercitive que sur les démons mauvais. A ceux-ci l’exorciste impose une volonté impérative quand il leur dit de se retirer ; mais envers les dieux, même dans les opérations de la magie, on ne s’adresse que par voie de prières et de supplications. En Égypte il en est autrement. Admettant que l’emploi de certaines formules sacramentelles élevait l’homme jusqu’aux dieux et parvenait à l’identifier à chacun d’eux, on avait dû, par une pente inévitable, être conduit à regarder ces formules comme renfermant un pouvoir qui s’imposait aux dieux, même les plus puissants, et leur commandait. Aussi les écrivains alexandrins nous disent-ils que les Égyptiens prétendaient contraindre les dieux, par leurs évocations et leurs formules magiques, d’obéir à leurs désirs et de se manifester à leurs yeux. Appelé par son nom véritable, le dieu ne pouvait résister à l’effet de l’évocation. Le papyrus Harris fournit le texte d’une évocation de ce genre, qui ne s’adresse à rien moins qu’Ammon, le dieu suprême de Thèbes : Descends
! descends ! gauche du ciel, gauche
de la terre ! Ammon
s’élève en roi, vie, santé, force ; il a
pris la couronne du monde entier. Ne
ferme pas l’oreille. Les
serpents à la marche oblique, qu’ils
ferment leurs bouches. Et que
tout reptile reste confondu dans la poussière par ta
vaillance, ô Ammon. Ceci devait se prononcer sur une amulette représentant l’image d’Ammon à quatre têtes de bélier, peinte sur l’argile, foulant un crocodile aux pieds, et huit dieux qui l’adorent placés à sa droite et à sa gauche. » Dès lors la vertu du dieu lui-même était enfermée dans le talisman, et quel que fût l’arrêt du destin résultant du jour fatidique où avait eu lieu la naissance d’un homme, Ammon en personne était obligé de le défendre contre les périls des crocodiles et des reptiles tant qu’il restait en possession de ce moyen de protection surnaturelle. Un des phylactères les plus employés et tenus pour les plus puissants consistait dans la représentation du dieu Hor enfant, nu, debout, la tête surmontée du masque hideux du dieu Bès, les pieds sur deux crocodiles, tenant dans ses mains des serpents, des scorpions, des lions, des gazelles, et quelquefois entouré des figures d’un certain nombre d’autres dieux. Une formule talismanique accompagnait cette représentation, qu’on exécutait en toute sorte de matière, et elle avait pour effet certain d’enchaîner Hor, ainsi que tous les dieux figurés avec lui, à l’obligation de couvrir la personne de celui qui s’armait du talisman contre les attaques des animaux féroces ou venimeux, ses propriétés contre les ravages des troupeaux de gazelles venant du désert sur les terres cultivées[19]. Dans chaque talisman, la formule magique qui consacrait enfermait ainsi quelque chose de la toute-puissance divine. Par leur vertu, l’homme mettait la main sur les dieux ; il les enrôlait à son service, les lançait ou les rappelait, les forçait à travailler et à combattre pour lui. Ce pouvoir formidable que le magicien croyait posséder, quelques-uns l’employaient à l’avancement de leur fortune ou à la satisfaction de leurs passions. La loi punissait de mort ceux qui abusaient de la sorte ; elle laissait en paix tous ceux qui exerçaient par leurs charmes une action inoffensive ou bienfaisante. L’opinion tout égyptienne que j’indique persista jusqu’aux derniers temps de la religion pharaonique. Elle se trouve consignée dans les écrits de l’hiérogrammate Chérémon, qui avait composé sous les Ptolémées un traité sur la science sacrée des Égyptiens. Non seulement, remarque M. Maury, on appelait le dieu par son nom, mais s’il refusait d’apparaître, on le menaçait. Ces formules de contrainte à l’égard des dieux ont été appelées par les Grecs Θεών άνάγκαι. Porphyre, dans sa Lettre à Anébon, s’indigne d’une pareille prétention chez les magiciens égyptiens, d’une foi si aveugle dans la vertu des mots. Je suis profondément troublé de l’idée de penser, écrit-il, que ceux que nous invoquons comme les plus puissants reçoivent des injonctions comme les plus faibles, et qu’exigeant de leurs serviteurs qu’ils pratiquent la justice, ils se montrent cependant disposés à faire eux-mêmes des choses injustes, lorsqu’ils en reçoivent le commandement, et tandis qu’ils n’exaucent pas les prières de ceux qui ne se seraient pas abstenus des plaisirs de Vénus, ils ne refusent pas de servir de guides à des hommes sans moralité, au premier venu, dans des voluptés illicites. Au reste, ce pouvoir des incantations magiques, qui forçait les dieux à obéir, devenait formidable pour celui même qui l’exerçait, s’il ne s’en rendait pas digne par sa pureté morale et sa science des choses religieuses. Le roman de Satni Khâ-m-Ouas, que nous analysons un peu plus loin, roule en grande partie sur les catastrophes surnaturelles qui assaillent celui qui, sans y être préparé par une initiation suffisante, se trouve en possession du livre de magie composé par le dieu Tahout. On comprend qu’avec l’idée dont nous parlons, l’emploi des noms eût pris dans la magie et même dans la religion de l’Égypte une importance toute particulière. Les dieux égyptiens étaient essentiellement myrionymes, comme les Grecs ont qualifié Isi. Deux chapitres spéciaux du Livre des Morts, les 141e et 142e, ont pour objet d’instruire le défunt des nombreux noms d’Osiri comme secours tout-puissant dans son voyage infernal. Non seulement, dit M. Birch, il est indiqué sur quelques monuments de la XIIe dynastie qu’ils sont dédiés à certains dieux sous tous leurs noms, mais on trouve aussi des tables de noms du dieu Phtah, le démiurge, et du dieu Râ, le principe solaire, sur des monuments du règne de Râ-mes-sou II... La gnose ou la connaissance des noms divins, dans leur sens extérieur et dans leur sens ésotérique, était en fait le grand mystère religieux ou l’initiation chez les Égyptiens. Les formules du papyrus Harris sont remplies d’allusions à cette importance magique du nom des dieux : Moi, je
suis l’élu des millions d’années, sorti
du ciel inférieur, celui dont
le nom n’est pas connu. Si l’on
prononçait son nom sur la rive du fleuve, oui !
il le consumerait. Si l’on
prononçait son nom sur la terre, oui !
il en ferait jaillir des étincelles. Je suis
Schou, sous la figure de Râ, assis au milieu de l’œil de son père[20]. Si ce qui est dans l’eau[21] ouvre la bouche où
saisit de ses bras, je
ferai tomber la terre dans le bassin de l’eau, mettant
le sud à la place du nord dans le
monde entier. Et cette autre, qui contient une évocation formelle : Viens à
moi, viens à moi ! ô toi
qui est permanent pour les millions de millions d’années, ô
Khnoum, fils unique, conçu
hier, enfanté aujourd’hui ! Celui
qui connaît ton nom est
celui qui a soixante-dix-sept yeux et soixante-dix-sept oreilles. Viens à
moi ! Que ma voix soit entendue comme fut entendue la voix de la grande oie Nakak[22], dans la nuit. Je suis Bah[23], le grand. Nous trouverons également dans la magie chaldéenne la doctrine de l’efficacité du nom suprême et mystérieux des dieux. Mais elle paraît avoir un caractère fort différent sur les bords du Nil et sur ceux de l’Euphrate. En Chaldée, comme dans toutes les religions de l’Asie antérieure, le nom mystérieux est regardé comme une véritable hypostase divine, qui a une existence personnelle et par suite une puissance propre sur les autres dieux, d’un rang moins élevé, comme sur la nature et le monde des esprits. La conception égyptienne est que c’est sur le dieu même auquel il appartient que le nom mystique exerce un pouvoir ; appelé par ce nom, le dieu se voit obligé d’obéir. C’est pour cela qu’il demeure secret, de peur qu’on n’en abuse, et que les initiés seuls parviennent à le connaître. Dans la magie égyptienne des bas temps, telle que l’exposent les Néoplatoniciens, on regarda comme indispensable, dit M. Maury, lors même que le magicien ne comprenait pas la langue à laquelle le nom du dieu était emprunté, de conserver ce nom sous sa forme primitive, car un autre mot n’eût pas eu la même vertu. L’auteur du traité des Mystères des Égyptiens, attribué à Iamblique, prétend que les noms barbares, les noms tirés des idiomes des Égyptiens et des Assyriens, ont une vertu mystique et ineffable qui tient à la haute antiquité de ces langues, à l’origine divine et révélée de la théologie de ces peuples. L’emploi de noms bizarres, inintelligibles au vulgaire, étrangers à la langue égyptienne et empruntés à d’autres idiomes ou composés de fantaisie, l’emploi de tels vocables à titre de noms mystérieux des dieux remonte, du reste, en Égypte à une date plus haute qu’on ne serait d’abord porté à le croire. Nous rencontrons des noms de ce genre, dont aucun n’est égyptien, désignant Set et Osiri, dans l’imprécation magique de nature funéraire qui se lit sur un papyrus du Louvre, daté du règne de Râ-mes-sou II. Ô
Oualbpaga ! ô Kemmara ! ô Kamalo ! ô
Karkhenmou ! ô Aamâgaâ ! Les
Ouana ! les Remou ! Les
Outhoun, ennemis du Soleil ! Ceci
est pour commander à ceux qui sont parmi vous tous, les
adversaires. Il est mort par violence, l’assassin de son frère[24] ; il
averse son âme au crocodile. Pas un
pour le plaindre. Mais il
amène son âme au tribunal de la double justice, par-devant Mamouremoukahabou[25] et les seigneurs absolus qui sont avec lui[26]. Celui-ci
répond à son ennemie : Ô lion,
face noire, yeux
sanglants, venin en bouche, destructeur
de son propre nom, . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la
faculté de mordre n’est pas encore enlevée à ceux-ci. Ailleurs il est question de noms magiques de même nature empruntés à l’idiome des Anou de Nubie et des nègres du Pount africain. La magie égyptienne prétendait exercer son action par delà la mort, et ses formules avaient même pris place officiellement dans la liturgie funéraire. On peut dire d’une manière générale, remarque M. Maspero, que les Égyptiens ne mouraient pas au sens où nous mourons. Dans leurs idées, le souffle de vie, dont les tissus s’étaient imprégnés au moment de la naissance, ne disparaissait pas soudain avec les derniers battements du cœur : il persistait jusqu’à la complète décomposition. Combien obscure et inconsciente que fût cette vie du cadavre, il fallait éviter de la laisser éteindre. Les procédés de la momification, fixaient la forme et la pétrifiaient, pour ainsi dire ; ceux de la magie et de la religion devaient y maintenir une sorte d’humanité latente, toujours susceptible de se développer un jour et de se manifester. Aussi l’embaumeur était-il un magicien et un prêtre en même temps qu’un chirurgien. Tout en macérant les chairs et en roulant les bandelettes, il récitait des oraisons, accomplissait des rites mystérieux, consacrait des amulettes souveraines. Chaque membre recevait de lui, tour à tour, l’huile qui rend incorruptible et les prières qui alimentent le ferment de vie. Un disque de carton doré, chargé de légendes mystiques et placé sous la tête, y entretenait un restant de chaleur animale[27]. Le scarabée de pierre dure, cerclé d’or, remplaçait le cœur dans la poitrine et en gardait la place intacte jusqu’au jour où il reviendrait la chercher. Des brins d’herbe, des feuilles sèches, des rouleaux de papyrus, de mignonnes figurines en terre émaillée, perdues dans l’épaisseur des bandages, des bracelets, des anneaux, des plaques constellées d’hiéroglyphes, les mille petits objets qui encombrent aujourd’hui les vitrines de nos musées, couvraient et protégeaient le tronc, les bras et les jambes comme les pièces d’une armure magique. L’âme, de son côté, n’arrivait pas sans défense à la vie d’outre-tombe. Les chapitres du Livre des morts et des autres écrits théologiques, dont on déposait un exemplaire dans chaque cercueil, étaient pour elle autant de charmes qui lui ouvraient les chemins des sphères infernales et en écartaient les dangers. Si, au temps qu’elle était encore dans la chair, elle avait eu soin de les apprendre par avance, cela n’en valait que mieux. Si la pauvreté, l’ignorance, la paresse, l’impuissance à croire ou quelque autre raison l’avait empêchée de recevoir l’instruction nécessaire à sa sûreté, même après la mort, un parent ou un ami charitable pouvait lui servir d’instructeur. C’en était assez de réciter chaque prière auprès de la momie ou sur les amulettes pour que la connaissance en passât par je ne sais quelle subtile opération, à l’âme désincarnée. C’était le sort commun ; quelques-uns y échappaient par prestige et art magique. Les personnages que Satni trouva réunis dans la tombe de Nofri-ké-Phtah n’ont du mort que le costume et l’apparence. Ce sont des momies si l’on veut ; le sang ne coule plus dans leurs veines, leurs membres ont été roidis par l’emmaillotement funéraire, leurs chairs sont saturées et durcies des parfums de l’embaumement, leur crâne est vide. Pourtant ils pensent, ils parlent, ils se meuvent, ils agissent comme s’ils vivaient, je suis presque tenté de dire qu’ils vivent ; le livre de Tahout est en eux et les porte. Mme de Sévigné écrivait d’un traité de Nicole qu’elle voudrait bien en faire un bouillon et l’avaler. Aujourd’hui encore, un moyen employé en Égypte pour se débarrasser d’une maladie consiste à écrire certains versets du Qoran à l’intérieur d’un bol de terre cuite ou sur des morceaux de papier, à verser de l’eau et à l’agiter jusqu’à ce que l’écriture ait été complètement diluée ; le patient boit avec l’eau les propriétés bienfaisantes des mots dissous. Nofri-ké-Phtah avait copié les formules du livre magique de Tahout sur du papyrus vierge, les avait dissoutes dans de l’eau, puis avalé sans sourciller le breuvage. Le voilà désormais indestructible. La mort, en le frappant, peut changer les conditions de son existence ; elle n’atteint pas son existence même. Il mande dans sa tombe les momies ranimées de sa femme et de son fils, leur infuse les vertus du livre et reprend avec elles la vie de famille un instant interrompue par les formalités de l’embaumement. Vienne l’occasion, il peut entrer et sortir à son gré, reparaître au jour et revêtir toutes les formes qu’il lui convient revêtir. Un certain nombre des chapitres du Livre des Morts ont formellement le caractère d’exorcismes et de formules magiques ; quelques-uns sont accompagnés de clauses exécutoires prescrivant la confection de certains talismans destinés à préserver le mort dans les hasards de son existence d’outre-tombe, et précisant qu’ils devaient être récités sur ces talismans pour les enchanter et leur donner leur vertu. Il n’y a réellement aucune différence essentielle entre ces chapitres du grand livre hermétique sur le sort des hommes dans l’autre vie, et certaines formules magiques tracées sur des feuillets de papyrus que l’on trouve quelquefois attachés aux momies dans l’intention d’en faire des phylactères. Ce sont des textes tout à fait de même nature, dont seulement les uns ont été admis dans le recueil des écritures divines et de la liturgie officielle des morts, tandis que les autres, composés peut-être plus tardivement, n’y ont pas trouvé place[28]. Il faut, du reste, remarquer que les incantations et les exorcismes adoptés dans le Livre des Morts ont trait à la protection du défunt dans son pèlerinage souterrain, tandis que les formules magiques indépendantes et auxquelles on n’avait pas fait le même honneur, sont destinées surtout à mettre à l’abri des bêtes malfaisantes et des chances possibles de destruction la momie même, déposée dans l’hypogée et dont la préservation importait tant au destin de l’âme. Elles tendent aussi à empêcher que le corps, pendant que l’âme en est séparée, ne devienne la proie de l’esprit de quelque méchant qui y pénètre, l’anime et le fasse relever à l’état de vampire. Car, dans la croyance des Égyptiens, les esprits possesseurs et les spectres qui effrayaient les vivants étaient des âmes de damnés revenant sur la terre avant d’être soumis à l’anéantissement de la seconde mort. Voici une formule de ce genre traduite par M. Chabas : Ô
brebis, fils de brebis ! agneau, fils de brebis, qui
tettes le lait de ta mère la brebis, ne permets
pas que le défunt soit mordu par
aucun serpent mâle ou femelle, par
aucun scorpion, par aucun reptile ; ne
permets pas que le venin maîtrise ses membres ! Qu’il
ne soit pénétré par aucun mort ni
aucune morte ! Que
l’ombre d’aucun esprit ne le hante ! Que la
bouche du serpent Am-kahou-f n’ait
pas de pouvoir sur lui ! Lui, il
est la brebis. Ô toi
qui entres, n’entre dans aucun des membres du défunt ! Ô toi
qui étends, ne l’étends pas avec toi ! Ô toi
qui enlaces, ne t’enlace pas à lui ! Ne
permets pas que le hantent les influences d’aucun
serpent mâle ou femelle, d’aucun
scorpion, d’aucun reptile, d’aucun
mort, d’aucune morte. Ô toi
qui entres, n’entre pas en lui ! Ô toi
qui respires, ne lui souffle pas ce
qu’il y a dans les ténèbres ! Que ton
ombre ne le hante pas
lorsque le soleil se couche et n’est pas encore levé. J’ai
prononcé les paroles sur les herbes sacrées placées à tous les coins de la
maison ; puis j’ai aspergé la maison tout entière avec les herbes sacrées et
la bière, au soir et au lever du soleil. Celui
qui est étendu restera étendu à sa place. § 6. — RECUEILS DE PRÉCEPTES ET DE MAXIMES MORALES D’une partie des ouvrages proprement littéraires des bibliothèques de l’ancienne Égypte, listes royales, chroniques, épopées héroïques à la gloire des rois, correspondances entre les scribes fameux et leurs disciples, nous avons donné dans le cours du livre précédent et dans celui-ci assez d’échantillons pour n’être pas obligé d’y revenir de nouveau. Il n’en est pas de même des recueils de sagesse gnomique analogues aux proverbes que la Bible place sous le nom du roi Schélomo’h (Salomon). C’était, dans l’Égypte pharaonique, la forme consacrée pour l’enseignement de la morale pratique, et les traités de ce genre tenaient une place considérable dans sa littérature. J’ai déjà parlé plus haut (tome II) des deux qui remontent jusqu’à l’âge des pyramides, le livre de morale du prince Phtah-hotppu, composé sous l’avant-dernier roi de la Ve dynastie, Assa Dad-ké-Râ, et les maximes de Kaqimma, attribuées au temps de Snéfrou, de la IIIe dynastie. J’en ai même fait un certain nombre d’extraits, de manière à présenter au lecteur quelque idée de ces deux livres, les plus anciens que l’Égypte nous ait légués, les plus anciens qui subsistent au monde. Plusieurs milliers d’années plus tard, car c’est ainsi que l’on compte souvent avec l’immense durée de la civilisation égyptienne, nous avons dans le même genre les maximes du scribe Ani, adressées à son fils Khons-hotpou pour son instruction. C’est un papyrus du musée de Boulaq qui les a conservées, et nous en devons la traduction la plus avancée à M. Chabas[29]. Elles sont d’une morale très haute et très pure, et il est impossible de ne pas constater sous ce rapport en elles un grand progrès sur l’esprit terre-à-terre qui inspirait les préceptes de Phtah-hotpou. L’homme, suivant Ani, doit avoir toujours présente la pensée de la mort et de l’instabilité des choses terrestres : Il n’est pas d’homme immuable en aucune chose ; telle est la réponse de la mort. Aie l’œil sur ta vie. C’est, en effet, cette pensée constante qui doit le plus sûrement lui inspirer le bien : Rappelle-toi ce qui a été. Place devant toi, comme voie à suivre, une conduite toujours juste. Tu seras considéré comme t’étant préparé une sépulture convenable dans la vallée funéraire qui demain cachera ton corps. Que cela soit devant toi dans toutes les choses que tu as à décider. De même que les vieillards très âgés, tu te coucheras au milieu d’eux. Il n’y a pas de rémission, même pour celui qui se conduit bien ; il est aussi disposé de lui. De même à toi viendra ton messager de mort pour t’enlever : oui ! il se trouve déjà prêt. Les discours ne te serviront de rien, car il vient, il se tient prêt. Ne dis pas : Je suis encore un enfant, moi, que tu enlèves. Tu ne sais pas comment tu mourras. La mort vient, elle va au-devant du nourrisson, de celui qui est au sein de sa mère, comme de celui qui a accompli sa vieillesse. Vois ! je te dis des choses salutaires, que tu méditeras dans ton cœur avant d’agir ; tu y trouveras le bonheur, et tout mal sera écarté de toi. Donne-toi à la divinité, garde-toi constamment pour la divinité, et que demain soit comme aujourd’hui ! Que ton œil considère les actes de la divinité ; c’est elle qui frappe celui qui est frappé. La piété envers les dieux est la première des vertus ; le scribe Ani revient à plusieurs reprises à la charge pour la recommandera son fils. Il n’insiste guère moins sur le respect de la vieillesse et de l’autorité hiérarchique : Ne reste, pas assis tandis qu’un autre se tient debout, s’il est plus âgé que toi, ou s’il est ton supérieur par la fonction qu’il exerce[30]. — Que la réponse du vieillard qui s’appuie sur un bâton réprime ta hardiesse, de crainte que tu ne t’exposes à l’indignation partes discours. Où il devient d’une véritable éloquence, c’est quand il parle du respect et de l’amour filial que l’on doit à sa mère : C’est moi qui t’ai donné ta mère, mais c’est elle qui t’a porté, et en te portant elle a eu bien des peines à souffrir, et elle ne s’en est pas déchargée sur moi. Tu es né après les mois de la grossesse, et elle t’a porté comme un véritable joug, sa mamelle dans ta bouche pendant trois années. Tu as pris delà force, et la répugnance de tes malpropretés ne l’a pas dégoûtée jusqu’à lui faire dire : Oh ! que fais-je ? Tu fus mis à l’école ; tandis que l’on t’instruisait dans les écritures, elle était chaque jour assidue auprès de ton maître, t’apportant le pain et la boisson de sa maison. Tu es arrivé à l’âge adulte ; tu t’es marié, tu as pris un ménage. Ne perds jamais de vue l’enfantement douloureux que tu as coûté à ta mère, ni tous les soins salutaires qu’elle a pris de toi. Ne fais pas qu’elle ait à se plaindre de toi, de crainte qu’elle n’élève les mains vers la divinité et que celle-ci n’écoute sa plainte. Ani est un scribe ; comme tous ceux de ses confrères dont nous avons déjà cité les paroles, il vante en termes magnifiques à son fils l’excellence et la dignité de sa profession, qu’il place au-dessus de toutes les autres. Il le met en garde contre l’oisiveté, qui ruine inévitablement la plus belle situation. Il lui recommande chaudement l’étude de la science et la fréquentation des livres des sages. Si l’on vient te demander tes avis, consulte les livres. Ani condamne sévèrement les vices grossiers qui dégradent comme la gourmandise : Ne sois pas glouton pour remplir ton ventre à ne plus pouvoir tenir ferme. C’est pour un autre bonheur que je t’ai donné l’existence. Voici maintenant pour l’ivrognerie : Ne t’échauffe pas dans la maison où l’on boit la liqueur enivrante ; évite toute parole révélatrice du fait du prochain qui sortirait de ta bouche et que tu ne saurais pas avoir dite. Tu tombes d’ivresse, les membres brisés ; personne ne te tend la main. Tes compagnons boivent ; ils se lèvent et disent : Ôte-toi de là, homme qui as bu. On vient te chercher pour parler affaires ; on te trouve gisant à terre, semblable à un petit enfant. C’est surtout la femme dont il faut éviter les pièges : Ne suis point les femmes ; ne leur laisse pas prendre ton cœur. La fréquentation des femmes galantes est une perdition, et l’on ne sait pas jusqu’où elle peut conduire : Garde-toi de la femme du dehors, inconnue dans sa ville. Ne la fréquente pas ; elle est semblable à toutes ses pareilles ; n’aies pas de commerce avec elle. C’est une eau profonde, et les détours en sont inconnus. Une femme dont le mari est éloigné te remet un billet, t’appelle chaque jour ; s’il n’y a pas de témoins, elle se tient debout, jetant son filet, et cela peut devenir un crime digne de mort quand le bruit s’en répand, même lorsqu’elle n’a pas accompli son dessein en réalité. L’homme commet toute sorte de crimes pour cela seul. Pour se prémunir contre ces dangers, Ani recommande le mariage : Marie-toi avec une femme jeune ; ton fils fera de même à ton exemple. Autant il a flétri la femme de mœurs légères, autant il vante la femme sage et prudente, et il recommande au mari de la traiter avec égards et douceur. Ne sois pas rude pour ta femme dans la maison, quand tu sais qu’elle est en bon ordre. Ne lui dis pas : Où est cela ? apporte-le nous ! car elle l’a mis à sa place convenable. Car ton œil l’a vu et tu as gardé le silence en reconnaissant son mérite. Plein de joie, mets ta main dans la sienne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment l’homme se plaît à mettre le malheur dans sa maison, et en réalité ne trouve pas la manière de la conduire. Toute direction de la tenue d’une maison gît dans la douceur patiente de l’homme. Ani méprise, du reste, celui qui a le cœur sans énergie et qui ne sait pas commander. La discipline dans la maison, c’est la vie ; use de la réprimande et tu t’en trouveras bien. Cependant, s’il importe de savoir réprimander ses serviteurs, il faut les traiter avec douceur, avoir soin d’eux, n’être avec eux ni dur ni injuste. Mêlant les préceptes d’économie pratique à ceux de morale, il prêche une sage administration de fortune. Que ta main ne soit pas prodigue pour l’inconnu ; il vient à toi pour ta ruine. Si tu mets tes biens à la portée de tes enfants, le captateur viendra de nouveau vers toi. Thésaurise pour toi-même, et tous tes parents s’empresseront au-devant de toi. Il recommande cependant la générosité, mais bien entendue ; et il élève à la hauteur d’un précepte essentiel la charité envers les pauvres. Ne mange pas le pain en présence d’un assistant resté debout sans que ta main s’étende pour lui offrir du pain. A-t-on jamais vu qu’il n’y ait pas riche et pauvre ? Mais le pain demeure à celui qui agit fraternellement. L’homme doit être avant tout pacifique. Parle avec douceur à qui a parlé brutalement ; c’est le remède qui calmera son cœur. On doit éviter avec soin les querelles et les procès, ménager ses voisins, surveiller ses relations et ne pas se lier à la légère, pratiquer envers tous les devoirs de la politesse. Il faut traiter avec égards l’hôte que l’on reçoit, avec déférence celui qui vous admet dans sa maison. Surtout il importe d’être toujours discret et de ne pas chercher à pénétrer ce qui se passe chez autrui. N’observe pas de ta maison l’acte d’autrui. Si ton œil a vu et que tu aies gardé le silence, ne le fais pas raconter au dehors par un autre. Veiller soigneusement sur ses paroles est une règle de conduite fondamentale : Ne fais pas connaître ta pensée à l’homme de mauvaise langue pour lui donner l’occasion d’abuser de sa bouche. Elle circule vite, la révélation sortie de ta bouche. En la répétant, tu crées des animosités. La chute de l’homme est sur sa langue ; prends garde de te procurer la ruine. — Garde-toi de toute occasion de blesser par tes paroles ; ne te fais pas redouter. Chez l’homme le bavardage est condamnable ; ce ne sera pas une ressource au jour à venir. Tiens-toi éloigné de l’homme de contestation ; ne t’en fais pas une compagnie ! — Il ne recueille pas le bien, celui qui parle mal. — Cherche à garder le silence. En ne se pressant pas pour arriver, le bon marcheur arrive. Il faut donc toujours rester calme et de sang-froid, prévoir qu’on aura à prendre le chemin du retour et par suite, en toute chose, partir dans la voie licite. Mais la meilleure condition d’une vie heureuse est de savoir se contenter de son sort et ne point porter envie à autrui. Tu t’es fait un enclos bien arrosé ; tu as entouré de haies tes terres de labour ; tu as planté des sycomores en cercle, bien ordonnés, dans toute l’étendue de ta résidence ; tu remplis tes mains de toutes les fleurs que ton œil aperçoit. On se fatigue pourtant de tout cela. Heureux qui ne le délaisse pas ! Ne place pas ta satisfaction dans les choses d’autrui ; ne compte pas sur le bien d’autrui ; il ne montera pas dans ta demeure. Un papyrus démotique du Louvre a encore fourni à M. Pierret un petit recueil d’apophtegmes moraux, dont quelques-uns sont fort remarquables. L’auteur inconnu de ces maximes est aussi préoccupé qu’Ani du danger des mauvaises relations. Ne fais pas ton compagnon d’un méchant homme. — N’agis pas d’après les conseils d’un sot. — Ne te promène pas avec un insensé, ne t’arrête pas à écouter ses paroles. Mais s’il recommande d’éviter les fréquentations fâcheuses, il défend avec non moins d’énergie d’exercer sur les autres une mauvaise influence. Ne pervertis pas le cœur de ton camarade, s’il est pur. Il dit au père : Ne laisse pas ton fils se lier avec une femme mariée. A la mère : Qu’il n’y ait pas dans le cœur d’une mère d’entrée pour l’amertume. Surtout ses préceptes se recommandent par un très beau sentiment de respect et de ménagement pour les faibles. Ne maltraite pas un inférieur ; respecte les supérieurs. — Ne maltraite pas ta femme, dont la force est moindre que la tienne ; qu’elle trouve en toi son protecteur.— Ne fais pas souffrir un enfant, à cause de sa faiblesse ; prête-lui aide. — Ne te fais pas un divertissement de te jouer de ceux qui dépendent de toi. » Dans une dernière il arrive à une bien grande hauteur : Ne sauve jamais ta vie aux dépens de celle d’autrui. Ces débris d’une branché de littérature dont nous ne connaissons que peu de chose, mais dont nous entrevoyons du moins l’importance et le développement, sont de nature à nous inspirer une idée très belle et très favorable de ce qu’était la morale des Égyptiens, et justifie les éloges que toute l’antiquité et que la Bible elle-même ont faits de la sagesse de ce peuple. Pour achever d’en connaître l’esprit et la délicatesse, il faut recourir au 125e chapitre du Livre des Morts. On y représente l’âme du défunt, à la fin de ses épreuves dans le monde inférieur, comparaissant dans la salle de la double Justice ou de la Vérité et de la Justice, par devant le tribunal où siège Osiri, le dieu des morts, entouré des quarante-deux assesseurs divins qui l’assistent, comme un jury suprême, dans sa mission déjuge des âmes. C’est là que doit être prononcée la sentence solennelle qui réglera définitivement son sort dans l’autre vie qui la fera entrer dans la béatitude ou dans la damnation. Il lui faut y établir qu’elle est pure, qu’elle n’a pas commis d’actions mauvaises, qu’aucun péché grave ne la souille. Elle y prononce donc son apologie, et, s’adressant successivement à chacun des quarante-deux jurés, elle se déclare innocente de la faute, du vice, du crime à la répression duquel il est préposé. Nous avons ainsi, dans cette justification que Champollion a appelée la confession négative, tout le code de la conscience égyptienne, tel qu’il était sanctionné par la religion. Et par bien des côtés il surpasse ce que nous rencontrons chez tout autre peuple de l’antiquité profane. Je n’ai pas blasphémé, dit le mort. — Je n’ai pas trompé. — Je n’ai pas volé. — Je n’ai pas menti en justice. — Je n’ai pas commis de fraudes contre les hommes. — Je n’ai pas tourmenté de veuve. — Je n’ai pas fait exécuter à un chef de travailleurs plus de travaux qu’il n’en pouvait faire. — Je n’ai excité aucun trouble. — Je n’ai fait pleurer personne. — Je n’ai affamé personne. — Je n’ai pas été paresseux. — Je n’ai pas été négligent. — Je ne me suis pas enivré. — Je n’ai pas fait de commandements injustes. — Je n’ai pas eu une curiosité indiscrète. — Je n’ai pas laissé aller ma bouche au bavardage. — Je n’ai frappé personne. — Je n’ai pas tué. — Je n’ai pas ordonné de meurtre par trahison. — Je n’ai causé de crainte à personne. — Je n’ai pas médit d’autrui. — Je n’ai pas rongé mon cœur d’envie. — Je n’ai pas intenté de fausses accusations. — Je n’ai pas retiré le lait de la bouche des nourrissons. — Je n’ai pas pratiqué d’avortement. — Je n’ai pas desservi l’esclave auprès de son maître. — Je n’ai pas fait de mal à mon esclave en abusant de ma supériorité avec lui. A côté de ces préceptes généraux, l’apologie du mort au tribunal d’Osiri nous montre des prescriptions de police et d’ordre public, que l’intérêt commun avait fait élever en Égypte au rang des devoirs qui engagent la conscience. Ainsi le mort se disculpe d’avoir intercepté les canaux d’irrigation et d’avoir jamais entravé la distribution des eaux du fleuve dans la campagne ; il déclare qu’il n’a pas endommagé les pierres qui servent à amarrer les barques au rivage. La vente à fausse mesure et à faux poids constitué deux péchés spéciaux, ainsi que le déplacement des bornes des fonds de terre. Viennent aussi les fautes contre la religion, dont quelques-unes nous paraissent bizarres, surtout quand on les trouve au même rang que les véritables atteintes à la morale. Le mort n’a pas altéré les prières, il n’y a introduit aucune interpolation ; il n’a pas porté atteinte aux propriétés sacrées, en s’emparant des troupeaux ou en péchant les poissons divins dans leurs lacs ; il n’a pas volé les offrandes sur l’autel ; il n’a pas troublé les processions ; enfin il n’a pas souillé de ses excréments les flots sacrés du Nil. Le mort ne se borne pas, du reste, devant le tribunal d’Osiri à la dénégation du mal ; il parle de ce qu’il a fait de bien dans sa vie. Il énumère les œuvres de miséricorde qu’il a accomplies et qui étaient d’obligation. Ici nous trouvons un accent d’amour et de charité universelle qu’on s’étonne de rencontrer dans une aussi ancienne civilisation, fondé sur une base aussi fragile que celle de la religion égyptienne, et qui est déjà presque chrétien. J’ai fait aux dieux les offrandes qui leur étaient dues. Je me suis concilié la divinité par mon amour. J’ai donné à manger à celui qui avait faim ; j’ai donné à boire à celui qui avait soif ; j’ai vêtu celui qui était nu ; j’ai donné une barque à celui qui était arrêté dans sa route. § 7. — CONTES ET ROMANS. La découverte, en 1852, d’une sorte de nouvelle égyptienne, analogue aux récits des Mille et une Nuits, fut une surprise réelle pour la plupart des savants de l’Europe. On s’attendait bien à trouver dans les papyrus des hymnes à la divinité, des poèmes historiques, des écrits de magie ou de science, des lettres d’affaires, une littérature sérieuse et solennelle, mais des contes ? Les hauts personnages dont les momies reposent dans nos musées avaient un renom de gravité si bien établi, que personne au monde n’avait jusqu’alors osé les soupçonner d’avoir lu ou composé des romans, au temps où ils n’étaient encore momies qu’en espérance. Le conte existait pourtant ; il avait appartenu à un prince, à un enfant de roi qui fut roi lui-même, à Séti II, fils de Mi-n-Phtah, petit-fils de Râ-mes-sou II. Une dame anglaise de passage à Paris, Mme Elisabeth d’Orbiney, avait remis au vicomte Emmanuel de Rougé un papyrus qu’elle avait acheté en Italie et dont elle désirait connaître le contenu. Ce papyrus, qui fait aujourd’hui partie des collections du Musée Britannique, renfermait le récit de pure imagination connu dans la science sous le nom de Conte des deux frères. Pendant douze ans, le manuscrit étudié par E. de Rougé demeura comme un monument unique. Mille reliques du passé reparurent successivement au jour, mais rien qui ressemblât à un roman. En 1864, le hasard des fouilles fit découvrir, en pleines ruines de Thèbes, à Deïr-el-Medineh, et dans la tombe d’un moine copte, un coffre de bois qui contenait, avec le cartulaire d’un couvent voisin, des manuscrits de nature moins édifiante, les recommandations morales du scribe Ani à son fils Khons-hotpou, des prières pour les douze heures de la nuit, et un conte fantastique plus étrange encore que le Conte des deux frères. Le héros s’appelle Satni Khâ-m-Ouas, fils d’un roi de Memphis ; il s’agite au milieu d’une bande de momies parlantes, de sorcières, de magiciens, d’êtres ambigus, dont on se demande s’ils sont morts ou vivants. Ce qu’un roman de mœurs païennes venait faire dans la tombe d’un moine, j’imagine qu’il sera toujours malaisé de le savoir exactement. On conjecture que le possesseur des papyrus a dû être un des derniers Égyptiens qui aient entendu quelque chose aux anciennes écritures ; lui mort, on aurait enterré près de lui des manuscrits que personne ne comprenait plus, et sous lesquels de dévots confrères flairaient sans doute un piège du démon. Quoi qu’il en soit, le roman était là, incomplet au début, mais assez bien conservé partout ailleurs pour qu’un savant accoutumé au démotique le déchiffrât sans trop de difficulté[31]. C’est à M. Brugsch qu’en a été due la première traduction, à laquelle les études postérieures de M. Maspero et de M. Révillout ont ajouté quelque chose, mais n’ont rien modifié d’essentiel. Depuis lors cette littérature romanesque de l’ancienne Égypte s’est enrichie de la découverte de quelques contes nouveaux, plus ou moins mutilés, qui ont été signalés et traduits par différents égyptologues. Tout récemment, M. Maspero a réuni dans un intéressant petit volume[32] tous les débris que l’on en possède. L’examen des contes égyptiens, dit ce savant, soulève diverses questions plus ou moins difficiles à résoudre. Sont-ils originaires du pays même, ou l’Égypte les a-t-elle empruntés à des peuples voisins qui les connaissaient avant elle ? Je ne prétends pas indiquer tout ce que le Conte des deux frères, par exemple, a de commun avec des récits recueillis ailleurs, un peu partout ; mais prenez-en quelques traits au hasard et vous serez étonnés de voir à quel point la donnée et le détail en ressemblent à certaines données et à certains détails qu’on retrouve dans la littérature populaire d’autres nations. Il se résout à première vue en deux contes différents. Au début c’est l’histoire de deux frères, l’un marié, l’autre célibataire, qui vivent dans la même maison et s’occupent aux mêmes travaux. Le premier s’appelle Anopou, comme un des dieux du panthéon égyptien, l’autre Bitiou, nom qui, sous la forme Bytis, apparaît comme celui d’un roi antérieur à Mena dans certains récits légendaires recueillis par les Grecs. La femme d’Anopou s’éprend de Bitiou et veut profiter de l’absence de son mari pour satisfaire brutalement un accès de passion subite. Il refuse avec indignation ; elle l’accuse de viol et manœuvre si adroitement que son mari, saisi de fureur, se décide à tuer son frère en trahison. Celui-ci, prévenu par les bœufs qu’il conduisait, se sauve ; échappe à la poursuite, grâce à la protection du Soleil, se mutile et se disculpe, mais refuse de revenir à la maison commune et s’exile au Val de l’Acacia. Le frère aîné, désespéré, rentre chez lui, met à mort la calomniatrice, puis demeure en deuil de son petit frère. Jusqu’à présent le merveilleux ne tient pas trop de place dans l’action ; sauf quelques discours prononcés parles bœufs, et l’apparition miraculeuse d’une eau remplie de crocodiles entre les deux frères, au plus chaud de la poursuite, le narrateur ne s’est guère servi que de faits empruntés à la vie courante. L’autre conte n’est que prodiges d’un bout à l’autre. Bitiou s’est retiré au Val de l’Acacia pour vivre seul, et a déposé son cœur dans une fleur de l’arbre. C’est une mesure de précaution des plus naturelles : on enchante son cœur, on le place en lieu sûr, au sommet d’un arbre ; tant qu’il y restera intact, aucune force ne prévaudra contre le personnage auquel il appartient. Cependant les dieux, descendus en visite sur la terre, ont pitié de la solitude de Bitiou et lui fabriquent une belle femme. Il en tombe amoureux fou, lui confie, le secret de sa vie, et lui recommande de ne pas quitter la maison, car le fleuve qui passe à travers la vallée s’éprendrait d’elle et ne manquerait pas de vouloir l’enlever. Cette confidence faite, il part pour la chasse, et naturellement la fille des dieux s’empresse d’agir au rebours des prescriptions de son mari ; le fleuve la poursuit et s’emparerait d’elle si le cèdre, qui joue, on ne sait trop comment, le rôle de protecteur, ne la sauvait en livrant une boucle de sa chevelure. La boucle, charriée jusqu’en Égypte, est remise au Pharaon, et le Pharaon, conseillé par ses magiciens, envoie des troupes à la recherche. La force échoue une première fois ; à la seconde tentative, la trahison réussit. Le Pharaon coupe l’acacia, et la chute de l’arbre produit la mort immédiate de Bitiou. Trois années durant il reste inanimé ; mais la quatrième il ressuscite avec l’aide de son frère, et songe à tirer vengeance du mal qu’on lui a fait. C’est désormais entre l’épouse infidèle et le mari outragé une lutte implacable. Bitiou se change en taureau et dévoile l’indignité de la fille des dieux ; la fille des dieux obtient qu’on égorge le taureau. Du sang naissent deux perséas magnifiques qui trouvent une voix pour reprocher à la fille des dieux sa double perfidie ; la fille des dieux obtient qu’on abatte les deux perséas, qu’on en façonne des planches, et, pour être certaine de sa vengeance, veut assister à l’opération. Un copeau, envolé sous l’herminette des menuisiers, lui entre dans la bouche ; elle l’avale, conçoit, met au monde un fils qui devient roi d’Égypte après là mort du Pharaon. Ce fils n’est que l’incarnation de Bitiou ; à peine monté sur le trône, il rassemble les conseillers de la couronne, leur expose ses griefs, et condamne celle qui, après avoir été sa femme, est devenue sa mère. Ces deux histoires sont complètement indépendantes l’une de l’autre, et auraient pu fournir la matière de deux récits différents. La fantaisie populaire les a réunies bout à. bout ; c’est une liberté qu’elle s’accorde souvent, et cela d’après cet axiome que la plus longue histoire est toujours la meilleure. La soudure entre les deux récits est assez grossière : les Égyptiens n’ont pas déployé un grand effort d’imagination pour l’opérer. Avant de s’exiler, Bitiou a déclaré à son frère qu’un malheur lui arriverait bientôt, et a décrit les prodiges qui doivent annoncer un événement fâcheux. Au moment où l’acacia tombe, les prodiges prédits s’accomplissent ; Anopou se met en marche et part à la recherche du cœur de son frère. Le service rendu en cette circonstance compense la tentative de meurtre dont il s’était rendu coupable dans le premier conte. La tradition grecque, elle aussi, avait ses romans où le héros est tué ou menacé de mort pour avoir dédaigné Tamour coupable d’une femme, Hippolyte, Pelée, Phinée. Bellérophon, fils de Glaucos, à qui les dieux donnèrent la beauté et une aimable vigueur, avait résisté aux avances de la divine Anteia, et celle-ci, furieuse, s’adressa au roi Proitos : Meurs, Proitos, ou tue Bellérophon, car il a voulu s’unir d’amour avec moi, qui n’ai point voulu. Proitos, n’osant point tuer le héros, l’envoya en Lycie, où il dut combattre la Chimère. La tradition hébraïque nous donne un récit analogue au récit égyptien, dans l’histoire de Yôseph et de la femme de Potiphar. La comparaison avec le Conte des deux frères en est si naturelle que Rougé l’avait faite dès 1852. Ebers a remarqué avec justesse qu’après tout, l’idée de la séduction tentée par la femme adultère, de ses craintes en se voyant repoussée, de la vengeance qu’elle essaie de tirer en accusant celui qu’elle n’a pu corrompre, est assez naturelle pour qu’elle se soit présentée indépendamment, et sur plusieurs points du globe, à l’esprit des conteurs populaires. Il n’est pas nécessaire de reconnaître dans le début de l’histoire de Yôseph en Égypte une forme du récit dont le papyrus d’Orbiney nous a conservé la version courante à Thèbes, vers la fin de la XIXe dynastie. Peut-être faut-il traiter avec la môme réserve un conte emprunté aux Mille et une Nuits, et qui paraît d’abord n’être qu’une variante du nôtre. La donnée primitive y est aggravée et dédoublée d’une manière singulière ; au lieu d’une belle-sœur qui s’offre à son beau-frère, ce sont deux belles-mères qui essaient de débaucher les fils de leur mari commun. Le prince Qamar-el-zéman avait eu Amdjâd de la princesse Badour et Açâd de la princesse ‘Haïât-en-néfoûs. Amdjâd et Açâd étaient si beaux, si bien faits, que, dès l’enfance, ils inspirèrent aux deux sultanes une tendresse incroyable. Les années s’écoulent ; ce qui paraissait n’être qu’affection maternelle se change en passion violente. Au lieu de combattre leur ardeur criminelle, Badour et ‘Haïât-en-néfoûs se concertent et déclarent, leur amour par lettres en beau style. Bepous-sées avec mépris, elles craignent une dénonciation. A l’exemple de la femme d’Anopou, elles prétendent qu’on a voulu leur faire violence, pleurent, crient et se couchent ensemble dans un même lit, comme si la résistance avait épuisé leurs forces. Le lendemain matin, Qamar-el-zéman revenu de là chasse, les trouve abîmées dans la douleur et leur demande la cause de leur chagrin. On devine la réponse : Seigneur, le chagrin qui nous accable est de telle nature que nous ne pouvons plus supporter la lumière du jour, après l’outrage dont les deux princes vos enfants se sont rendus coupables à notre égard. Ils ont eu, pendant votre absence, l’audace d’attaquer notre honneur. Colère du père, sentence de mort portée contre les fils ; le vieil émir chargé de l’exécuter ne l’exécute point, sans quoi il n’y aurait plus de conte. Qamar-el-zéman ne tarde pas à reconnaître l’innocence d’Amdjâd et d’Açâd ; cependant, au lieu de tuer ses deux femmes, comme Anopou avait fait de la sienne, il se contente de les emprisonner pour le restant de leurs jours. C’est la donnée du Conte des deux frères, mais adaptée aux habitudes du harem et aux besoins de la polygamie musulmane. A se modifier de la sorte, elle n’a gagné ni en intérêt, ni en moralité. Les versions du second conte sont à la fois et plus nombreuses et plus curieuses[33]. On les retrouve partout : en France, en Italie, dans les différentes parties de l’Allemagne, en Hongrie, en Russie et dans les pays slaves, chez les Roumains, dans le Péloponnèse, en Asie Mineure, en Abyssinie, dans l’Inde. En Allemagne, le correspondant de Bitiou est un berger, possesseur d’une épée invincible. Une princesse lui dérobe son talisman ; il est vaincu, tué, mis en morceaux, puis rendu à la vie par des enchanteurs qui lui donnent la faculté de revêtir toutes les formes qui lui plairont. Il se change en cheval, est vendu au roi ennemi, et reconnu par la princesse, qui recommande qu’on lui coupe la tête. Il intéresse à son sort la cuisinière du château : Quand on me tranchera la tête, trois gouttes de mon sang sauteront sur ton tablier ; tu les enterreras pour l’amour de moi. Le lendemain, un superbe cerisier avait poussé à l’endroit même où avaient été enterrées les trois gouttes de sang. La princesse fait abattre le cerisier ; mais la cuisinière a ramassé trois copeaux et les a jetés dans l’étang de la princesse, où ils se transforment en autant de canards d’or. La princesse en tue deux à coups de flèches et s’empare du troisième. A la nuit, elle l’enferme dans sa chambre ; le canard reprend l’épée magique et disparaît. En Russie, Bitiou s’appelle Ivan, fils de Germain le sacristain. Il, trouve dans un buisson une épée magique dont il s’empare, puis va guerroyer contre les Turcs qui avaient envahi le pays d’Arinar, en tue 80.000, 100.000, et reçoit pour ses exploits la main de Cléopâtre, fille du roi. Son beau-père meurt, le voilà roi à son tour ; mais sa femme le trahit, livre son épée aux Turcs, et, quand Ivan désarmé a péri dans la bataille, s’abandonne au Sultan comme la fille des dieux au Pharaon. Cependant, Germain le sacristain, averti par un flot de sang qui jaillit au milieu de l’écurie, part et retrouve le cadavre. Si tu veux le ranimer, dit son cheval, ouvre mon ventre, arrache mes entrailles, frotte le mort de mon sang, puis, quand les corbeaux viendront me dévorer, prends-en un et oblige-le à t’apporter l’eau merveilleuse de vie. Ivan ressuscite et renvoie son père : Retourne à la maison ; moi, je me charge de régler mon compte avec l’ennemi. En chemin, il rencontre un paysan : Je vais me changer pour toi en un cheval merveilleux, avec une crinière d’or ; tu le conduiras devant le palais du Sultan. Quand le Sultan vit le cheval, il l’acheta, le mit dans son écurie et ne cessa plus d’aller le visiter. Pourquoi, seigneur, lui dit Cléopâtre, es-tu toujours aux écuries ? — J’ai acheté un cheval qui a une crinière d’or. — Ce n’est pas un cheval, c’est Ivan, le fils du sacristain ; commande qu’on le tue. Du sang du cheval naît un bœuf au pelage d’or : Cléopâtre le fait tuer. De la tête du taureau naît un pommier aux pommes d’or : Cléopâtre le fait abattre. Le premier copeau se métamorphose en un canard magnifique. Le sultan ordonne qu’on lui donne la chasse et se jette lui-même à l’eau pour l’attraper. Le canard s’échappe vers l’autre rive, reprend sa figure d’Ivan, mais avec des habits de sultan, jette sur un bûcher Cléopâtre et son amant, puis règne à leur place. Voilà bien, à plus de trois mille ans d’intervalle, les grandes lignes de la version égyptienne. Si l’on voulait se donner la peine d’examiner un à un les détails, on en retrouverait certainement d’analogues. La boucle de cheveux enivre le Pharaon de son parfum ; dans un récit breton, la mèche de cheveux lumineuse de la princesse de Tréménéazour rend amoureux le roi de Paris. Bitiou place son cœur sur la fleur de l’acacia ; dans le Pantchatantra, un singe raconte qu’il ne quitte jamais la forêt où il habite sans y laisser son cœur caché dans le creux d’un arbre. Anopou est averti de la mort de Bitiou par du vin et de la bière qui se troublent ; dans divers contes européens, un frère partant en voyage annonce à son frère que le jour où l’eau d’une certaine fiole se troublera, c’est que lui sera mort. Et ce n’est pas seulement la littérature populaire qui possède l’équivalent des aventures de Bitiou ; les religions de la Grèce et de l’Asie occidentale renferment des mythes qu’on peut leur comparer presque point par point. Pour ne citer que le mythe phrygien, Alys dédaigne l’amour delà déesse Cybèle, comme Bitiou l’amour de la femme d’Anopou ! il se mutile comme Bitiou ; de môme que Bitiou en vient de changement en changement à n’être plus qu’un perséa, Atys est transformé en pin. D’autres ont fait ou feront mieux que moi les rapprochements et les comparaisons nécessaires ; j’en ai dit assez pour montrer que les deux récits, dont est sorti le conte égyptien, se retrouvent ailleurs qu’en Égypte, et en d’autres temps qu’aux époques pharaoniques. Est-ce une raison suffisante à déclarer qu’ils ne sont pas ou sont originaires de l’Égypte ? Un seul point me paraît hors de doute pour le moment : la version égyptienne est de beaucoup la plus vieille que nous ayons. Elle nous est parvenue, en effet, dans un manuscrit du XIVe siècle avant notre ère, c’est-à-dire nombre d’années avant le moment où nous commençons à reconnaître la trace des autres. Si le peuple égyptien a emprunté ou transmis au dehors les données qu’elle contient, l’opération a dû s’accomplir à une époque plus ancienne encore. Qui peut dire aujourd’hui comment et par qui elle s’est faite ? Bien plus exclusivement égyptien est le roman de Satni Khâ-m-Ouas, dont la copie parvenue jusqu’à nous ne remonte pas au delà du temps des Ptolémées, et dont la rédaction même ne saurait être antérieure aux dernières dynasties, puisqu’il est écrit en démotique. Ici la littérature populaire des autres nations ne nous offre rien d’analogue. La conception fondamentale du récit n’a pu naître qu’en Égypte, au milieu des mœurs et des croyances propres à cette contrée. Tout le merveilleux en est absolument indigène des bords du Nil, et les combinaisons bizarres qui s’y déploient ne devaient germer que dans des imaginations égyptiennes. Satni Khâ-m-Ouas est un prince royal, fils du roi Ousor-mâ-Bâ, qui a sa résidence à Man-nofri. C’est un fervent adepte des sciences occultes, qui se vante d’avoir approfondi tous les secrets de la magie. Un jour il apprend que la puissance surnaturelle qu’il a acquise ainsi par de longues et pénibles études n’est rien à côté de celle que conférerait la possession d’un livre qui contient deux formules seulement, mais les deux formules suprêmes composées et écrites de la main du dieu Tahout lui-même. Ce livre est caché dans la tombe de Nofri-ké-Phtah, fils d’un roi antique du nom de Mer-khoper-Phtah[34], au sein de la nécropole memphite. Après trois jours de recherches consacrées à lire les épitaphes de la nécropole, Satni découvre le tombeau de Nofri-ké-Phtah, en fait ouvrir la porte et y descend pour s’emparer du livre merveilleux. L’intérieur de l’hypogée de Nofri-ké-Phtah est un lieu de prestiges. Il est éclairé comme en plein soleil par la lumière qui émane du livre de Tahout. Le mort qu’on y a déposé n’est pas seul ; de même que, bien que momifié, il a su, par vertu magique, reprendre le mouvement, la parole et toutes les actions de la vie dans l’intérieur de sa demeure funéraire, il a appelé à lui et fait résider à ses côtés les ombres de sa femme et de son fils, dont les corps reposent bien loin delà, dans la nécropole de Qoubti, et il mène avec eux là vie de famille. Satni ne s’effraie pas du spectacle de toutes ces choses extraordinaires ; il s’avance résolument pour prendre le livre. Mais l’ombre d’Ahouri, la femme de Nofri-ké-Phtah, lui barre le passage, et pour le détourner de s’emparer de l’écrit mystérieux de Tahoutj lui raconte tous les malheurs que la possession de ce livre malgré la volonté des dieux a attirés sur eux dans la vie terrestre. Elle aussi est fille du roi Mer-khoper-Phtah. Éprise de son frère, elle lui a été mariée, comme le permettaient les lois de l’Égypte, et de leur union est né un fils, Mer-ho-nofri. Nofri-ké-Phtah, son mari, avait la passion de la magie et en recherchait partout les écrits. Un jour il apprend, par un vieux prêtre du temple de Phtah, à Man-nofri, l’existence du manuscrit contenant les deux formules du dieu Tahout, lequel est caché dans un coffre au fond du Nil devant la ville de Qoubti. Nofri-ké-Phtah se rend aussitôt dans cette ville et y fabrique une barque, avec ses rameurs sculptés en bois, qu’il anime par une opération magique, sûr ainsi d’avoir des collaborateurs discrets, qui n’iront pas raconter partout ce qu’il a fait, révéler le trésor dont il s’est rendu maître. Un nouveau sortilège ouvre les eaux du fleuve et montre à découvert l’endroit où repose le coffre contenant le livre. Lorsque Nofri-ké-Phtah eut reconnu un fourmillement de scorpions et de toute sorte de reptiles autour du lieu où se trouvait le livre, et lorsqu’il eut reconnu un serpent éternel enroulé autour du coffre lui-même, elle récita un écrit sur le fourmillement de serpents, de scorpions et de reptiles qui était autour du coffre, et les fit disparaître. Il récita un écrit sur le serpent éternel, le combattit et le tue ; mais le serpent revint à la vie et reprit sa forme de nouveau. Il combattit le serpent une seconde fois et le tua, mais le serpent revint encore à la vie. Il combattit le serpent une troisième fois, le coupa en deux morceaux et mit du sable entre les morceaux ; le serpent ne reprit pas sa forma d’auparavant. Nofri-ké-Phath alla au lieu où était le coffre, et reconnut qu’il était de fer. Il l’ouvrit et vit un coffre de bronze. Il l’ouvrit et vit un coffre en bois de palmier. Il l’ouvrit et vit un coffre d’ivoire et d’ébène. Il l’ouvrit et vit un coffre d’argent. Il l’ouvrit et vit un coffre d’or. Il l’ouvrit et connut que le livre était dedans. Il porta l’écrit en question à bord de sa barque avec le coffret d’or, et lut une formule de l’écrit qui y était ; il enchanta le ciel, la terre, l’enfer, les montagnes, les eaux ; il reconnut les oiseaux du ciel, les poissons de l’eau, les animaux de la montagne, tous tant qu’ils sont. Il récita l’autre formule de l’écrit, et il vit le soleil qui montait au ciel avec son cycle de dieux, la lune se levant, les étoiles en leur forme ; il vit les poissons de l’eau, car il y avait une force divine sur eux. Maître du merveilleux talisman, Nofri-ké-Phtah rejoint sa femme et son fils à Qoubti et reprend avec eux la route de Man-nofri. Mais le dieu Tahout est irrité contre lui parce qu’il a dérobé son écrit, qui devait rester caché à tous les mortels. Il porte plainte auprès du dieu Râ, et celui-ci lui livre les personnes du ravisseur et de sa famille. Presque au départ, Ahouri et son fils tombent de la barque qui les emmène et se noient dans le fleuve. Nofri-ké-Phtah est impuissant à lès ressusciter ; il les ensevelit à Qoubti et son art magique ne peut que communiquer à leurs ombres une vie factice dans la demeure souterraine qu’ils doivent désormais habiter. Il reprend seul la route de Man-nofri, et bientôt, saisi de désespoir, il se décide à se suicider, après s’être infusé par une boisson magique la vertu de la formule qui lui assure le privilège d’aller et de venir, d’agir et de vivre dans la tombe, même après avoir été momifié. Il se jette dans le Nil et s’y noie ; on repêche son corps, on le transporte à Man-nofri et on l’y ensevelit avec les plus grands honneurs, le livre de Tahout attaché sur sa poitrine. Tel est le récit d’Ahouri, qui ne parvient pas à effrayer par là Satni Khà-m-Ouas et à le détourner de son projet. Nofri-ké-Phtah lui-même prend la parole et propose au prince de jouer aux échecs la possession du livre dont il veut s’emparer. Ils jouent six parties, Satni les perd toutes, et comme gagnant, la momie de Nofri-ké-Phtah l’emprisonne dans l’échiquier, de telle manière qu’il ne peut plus bouger. Satni appelle alors son frère An-hat-hor-raou à grands cris et. lui demande d’aller chercher les talismans du dieu Phtah pour rompre l’enchantement dont il est victime et le délivrer. Les talismans apportés, Salni, rendu à la liberté, se jette sur le livre de Tahout, s’en saisit par violence et l’emporte. Les ténèbres succèdent à la lumière dans la tombe désormais privée de ce trésor miraculeux. Ahouri se met à pleurer, mais Nofri-ké-Phtah lui dit : Ne te désole pas. Je lui ferai rapporter le livre, une fourche et un bâton à la main et un brasier allumé sur la tête. Cependant le roi Ousor-mâ-Râ a vainement cherché à décider son fils Satni Khâ-m-Ouas à rapporter le livre magique dans le tombeau où il l’a pris, pour éviter les malheurs que sa possession ne tardera pas à attirer sur lui. Satni n’était nullement disposé à se séparer du livre, et il le lisait par devant tout le monde. A quelque temps de là ce prince fit la rencontre d’une femme dont l’admirable beauté éveilla en lui des désirs irrésistibles. Il lia conversation avec sa suivante et apprit que cette femme se nommait Tabouboui, fille du prophète de la déesse Bast. Satni Khâ-m-Ouas chargea la servante d’offrir à sa maîtresse dix outens d’or pour se livrer à lui. Tabouboui écouta les propositions du prince et lui donna un rendez-vous dans sa maison, située parmi les dépendances du temple de la ville de Pa-Bast. Là, dévoilant successivement ses beautés par une gradation savante, sur laquelle le roman insiste avec complaisance, pour exaspérer les désirs de Satni, elle l’amena à lui faire d’abord donation de ses biens, puis à donner l’ordre d’égorger ses propres enfants, dont les chairs furent données en repas aux chats sacrés de la déesse Bast. C’est seulement après qu’elle consentit à s’abandonner à la passion de Satni. En s’éveillant, Satni se trouva nu, couché dans un four. Devant lui se tenait Nofri-ké-Phtah, qui avait pris l’apparence d’un roi dans l’appareil du triomphe, foulant ses ennemis sous ses sandales, et qui riait de la confusion du prince, dupé par sa puissance magique. Car tout ce qui s’était passé, la séduction de Satni par Tabouboui, le meurtre de ses enfants ordonné par lui-même, n’avait été qu’un prestige, une hallucination trompeuse, destinée à faire tomber le prince dans un piège. Devenu impur et criminel en pensée, sinon en fait, il avait perdu par là tout le pouvoir surnaturel qu’il devait à la possession du livre de Tahout. Mais ses enfants vivaient et l’attendaient à Man-nofri. Satni s’y rend et se présente devant le roi son père, qui lui reproche sa désobéissance et lui ordonne de rapporter le livre volé dans la tombe de Nofri-ké-Phtah, en tenant, en signe d’amende honorable, un bâton et une fourche dans sa main et un brasier allumé sur sa tète. La lumière surnaturelle rentre dans l’hypogée avec l’écrit de Tahout. Mais Nofri-ké-Phtah ne se contente pas de cette expiation. Il impose encore à Satni d’aller chercher à Qoubti les tombes d’Ahouri et de Mer-ho-nofri et d’en rapporter les momies dans sa sépulture, pour qu’il ait avec lui leurs corps et non plus seulement leurs ombres. C’est ce qui est exécuté et le roi fait alors sceller soigneusement l’entrée du tombeau de Nofri-ké-Phtah, pour que nul ne soit plus tenté d’aller y chercher le livre magique dont l’enlèvement imprudent a causé de si fâcheux résultats. Ce qui donne un intérêt particulier à ce roman si étrange, c’est que les noms qui y figurent sont positivement historiques. Ousor-mâ-Rà est le prénom de Rà-mes-sou II, Sêsostris, et parmi les fils de ce prince nous avons vu qu’il y eu avait eu un qui portait le nom de Khâ-m-Ouas et qui, pendant un temps régent à Man-nofri, avait laissé la réputation d’un adepte de la magie. Le fait que nous constatons pour le roman de Satni Khâ-m-Ouas est loin d’être isolé. L’instinct qui porte les conteurs à choisir partout comme héros des rois ou des seigneurs de haut rang, dit M. Maspero, s’associait en Égypte à un sentiment patriotique très vif. Un homme de Memphis, né au pied du temple de Phtah et grandi, pour ainsi dire, à l’ombre des Pyramides, était familier avec Mena et Khoufou. Les bas-reliefs et les peintures étalaient leurs portraits à ses yeux ; les inscriptions énuméraient leurs titres et célébraient les gloires de leurs règnes. Sans remonter aussi loin que Memphis dans le passé de l’Égypte, Thèbes n’était pas moins riche en monuments. Sur la rive droite comme sur la rive gauche du Nil, à Karnak et à Louqsor comme à Qournab et à Môdinet-Abou, les murailles parlaient de grandes victoires remportées sur de grandes nations, de guerres toujours heureuses, d’expéditions lointaines au delà des mers. Quand le conteur mettait des rois en scène, l’image qu’il évoquait n’était pas seulement celle d’un mannequin superbe, affublé d’oripeaux souverains ; son auditoire et lui-même songeaient aussitôt à ces princes toujours vainqueurs, dont la figure et la mémoire vivaient encore au milieu d’eux. Il ne suffisait pas d’avancer que le héros était un monarque et de l’appeler Pharaon ; il fallait dire de quel Pharaon glorieux on parlait, si c’était Pharaon Râ-mes-sou ou Pharaon Khoufou, un constructeur de pyramides ou un conquérant des dynasties guerrières. La vérité en souffrait souvent. Si familiers qu’ils fussent avec les rois monumentaux, les Égyptiens, qui n’avaient pas fait de leurs annales une étude spéciale, étaient assez portés à corrompre le nom des rois ou à brouiller les époques... Tous ces noms d’autrefois prêtaient au récit un air de vraisemblance qu’il n’aurait pas eu sans cela ; une aventure merveilleuse mise au compte de Sésostris devenait plus probable qu’elle n’aurait été si on l’avait rapportée simplement de quelque personnage inconnu. Il s’établit ainsi, à côté de l’histoire réelle, une histoire populaire parfois bouffonne, toujours amusante. De même qu’on eut dans l’Europe du moyen âge le cycle de Charlemagne où le caractère de Charlemagne ne fut guère respecté, on eut en Égypte des cycles de Râ-mes-sou H, des cycles de Tahout-mès III, des cycles de Khoufou, où la personne de Râ-mes-sou, de Tahout-mès, de-Khoufou se modifia au point de devenir méconnaissable. La plupart sont perdus, et les rares fragments qui en subsistent n’ont pas toujours été appréciés à leur juste valeur. Tels sont deux que nous avons eu déjà l’occasion de citer à propos des règnes auxquels on les rapportait, le récit de la querelle du roi Soqnoun-Râ Ta-aâ et du Pasteur Apapi (tome II), et celui du stratagème employé par le général Tahouti pour prendre Iapou (t. II). Si les égyptologues modernes ont pu se tromper à ces récits, à plus forte raison les anciens ont dû être pris à des histoires, analogues. Les interprètes, les prêtres de basse classe, qui guidaient, les étrangers, connaissaient assez bien ce qu’était l’édifice qu’ils montraient, qui l’avait fondé, qui agrandi, et quelle partie portait le cartouche de chaque souverain ; mais, dès qu’on les poussait sur le détail, ils restaient à court et ne savaient plus que débiter des contes populaires. Les Grecs eurent affaire avec ces gens-là, et il n’y a qu’à lire le second livre d’Hérodote pour voir comment ils furent renseignés sur le passé de l’Égypte. Quelques-uns des on-dit qu’il a recueillis renferment un ensemble de faits plus ou moins altérés, l’histoire de la XXVIe dynastie, par exemple, ou, pour les temps anciens, celle de Râ-mes-sou II ou Sésostris. La plupart des récits antérieurs à l’avènement de Psaméthik Ier sont de véritables romans, où la réalité n’a aucune part. Le conte de Rhampsinitos et des voleurs de ses trésors se trouve ailleurs qu’en Égypte. La vie légendaire des rois constructeurs de pyramides n’a rien de commun avec la vie réelle de ces rois. L’aventure de Phéron, qui ne peut recouvrer la vue qu’en se lavant les yeux avec l’urine d’une femme fidèle à son mari, et qui ne parvient à en trouver qu’une seule par toute l’Égypte (encore ce n’est pas la sienne), est une sorte de pièce satirique à l’adresse des femmes. Là rencontre de Protée avec Hélène et Ménélas passera sans peine pour l’adaptation égyptienne d’un récit grec. On pouvait se demander jadis si les guides avaient tiré ces fables de leur propre fonds ou s’ils les avaient empruntées aux indigènes ; la découverte des romans égyptiens a prouvé que, là comme ailleurs, les exégètes ont manqué d’imagination. Ils se sont bornés à répéter les fables qui avaient cours dans le peuple, et la tâche leur était d’autant plus facile que la plupart des héros de romans portaient des noms ou des titres authentiques. Aussi les dynasties d’Hérodote et de Diodore sont-elles un mélange de noms réels : Menés, Sabacon, Chéops, Chéphrên, Mycé-rinosj.de prénoms royaux : Moiris, Mi-Râ, l’aimé de Râ ; de sobriquets populaires : Sesous-Râ, Sésostris ; de titres : Phéro, Prouti, dont on a fait des noms propres ; et de mots formés d’éléments contradictoires, comme Rhampsinitos, où paraît, à côté du nom thébain de Râ-mes-sou, le titre saïte Si-Nit, fils de Nit. La passion du roman historique n’a pas disparu en Égypte avec les dynasties indigènes. Déjà, sous les Ptolémées, Nakht-neb-f (Necta-nébo), le dernier roi de race égyptienne, était devenu le centre d’un cycle important. On en avait fait un magicien habile, un grand constructeur de talismans ; on le donna pour père à Alexandre le Macédonien. Poussons même au delà de l’époque romaine ; il n’y a pas besoin de feuilleter bien longtemps les écrivains arabes pour y retrouver, attribuées à, des sultans d’Égypte, les aventures des Pharaons. Que l’historien pris à ces fables soit latin, grec ou arabe, on se figure aisément ce que devient la chronologie au milieu de toutes ces manifestations de la fantaisie populaire. Hérodote, et, à son exemple, presque tous les écrivains anciens et modernes jusqu’à nos jours, ont placé Moins, Sésostris, Rhampsinitos avant les rois constructeurs de pyramides. Le nom de Sésostris et de Rhampsinitos est un souvenir de la XIXe et de la XXe dynastie ; celui des rois constructeurs de pyramides, Chéops, Chéphrên, Mycérinos, Asychis, nous reporte à la IVe dynastie. La façon cavalière dont les rédacteurs de contes égyptiens ont traité la succession des règnes, nous montre comment il se fait qu’Hérodote ait commis pareille erreur. Le guide qui montrait le temple de Phtah et les pyramides de Gizeh connaissait sans doute une histoire où l’on exposait comme quoi, à un Râ-mes-sou Si-Nit, le plus riche des rois, avait succédé Khoufou, le plus impie des hommes. Il la conta à Hérodote, comme il dut la conter à beaucoup d’autres, et le bon Hérodote l’inséra dans son livre. Comme Chéops, Chéphrên et Mycérinos forment un groupe bien circonscrit, que d’ailleurs, leurs pyramides s’élevant au même endroit, les guides n’avaient aucune raison de rompre à leurs dépens l’ordre de succession, la transposition une fois faite pour Chéops, il devenait nécessaire de déplacer avec lui Chéphrên, Mycérinos et le prince qu’on nommait Asychis. Aujourd’hui que nous pouvons contrôler le témoignage du voyageur grec par le témoignage des monuments, peu nous importe qu’il se soit laissé tromper. 11 n’écrivait pas une histoire d’Égypte. Même bien instruit, il n’aurait pas donné au livre de son histoire universelle qui traitait de l’Égypte plus de développements qu’il ne lui en a donnés. Toutes les dynasties auraient dû tenir en quelques pages, et il ne nous eût rien appris que ne nous apprennent aujourd’hui les textes originaux. En revanche, nous y aurions perdu la plupart de ces récits étranges, et souvent bouffons, qu’il nous a si joliment racontés, sur la foi de ses guides. Phéron ne nous serait pas connu, ni Protée, ni Rhampsinitos. Je crois que c’aurait été grand dommage. Les monuments nous disent, ou nous diront un jour, ce que firent les Khoufou, les Râ-mes-sou, les Tahout-mès du monde réel. Hérodote nous apprend ce qu’on disait d’eux dans les rues de Memphis. Toute la partie de son second livre, que remplissent leurs aventures, est pour nous mieux qu’un chapitre d’histoire, c’est un chapitre d’histoire littéraire. Les romans qu’on y trouve sont égyptiens au même titre que les romans conservés par les papyrus. Sans doute, il vaudrait mieux les avoir dans la langue d’origine, mais le vêtement grec qu’ils ont reçu n’est pas assez lourd pour les déguiser. Même modifiés dans le détail, ils ont encore tous les traits essentiels de leur physionomie primitive. Signalons encore, parmi les œuvres de la littérature romanesque égyptienne dont les débris sont parvenus jusqu’à nous, comme un des plus intéressants et des mieux conservés, le Conte du prince prédestiné, dont la découverte est due à M. Gobdwin. Un roi d’Égypte se désolait de n’avoir pas d’enfant mâle. Enfin les dieux accordèrent un fils à ses prières. Mais quand vint le jour de sa naissance, les sept Hat-Hor étant venues fixer son destin, elles annoncèrent qu’il devait mourir de la dent d’un serpent, d’un crocodile ou d’un chien. Epouvanté de cette prédestination, le roi fit élever son fils dans l’intérieur du palais, sans permettre qu’il en sortît et surtout en prenant les plus grandes précautions pour qu’il n’eût jamais l’occasion de voir aucun des trois animaux dont la morsure devait lui être fatale. Un jour cependant il aperçut un chien et tomba dans un tel désespoir de n’avoir pas de compagnon semblable, qu’on finit par céder à ses larmes et par lui donner un tout petit chien, qui venait à peine de naître, espérant que l’animal, qui aurait grandi à ses côtés, s’attacherait à lui au point de lui devenir une sûre défense et de ne pouvoir lui faire courir aucun des dangers annoncés d’avance par les organes de la destinée. Cependant le prince grandit, arrive à l’âge d’homme et ne peut pas supporter plus longtemps la réclusion à laquelle le condamne la prudence de son père. Pourquoi être comme les fainéants ? dit-il. Puisque je suis fatalement prédestiné à l’un de trois sorts funestes, pourquoi ne pas me laisser agir à ma volonté ? Que la divinité fasse ensuite comme elle voudra ! Il fait tant que le roi son père se décide à lui rendre la liberté et à le laisser aller chercher aventure du côté de la Syrie. Il s’en va donc devant lui, chassant à son caprice et se divertissant, jusqu’à ce qu’il arrive au pays de Naharina. Le roi de cette contrée avait une fille unique, qu’il avait enfermée dans une tour dont les fenêtres étaient à soixante-dix coudées au-dessus du sol. Il avait promis de la donner à celui qui, par art magique, parviendrait à s’élever jusqu’à elle. Le prince égyptien, en arrivant à la cour de ce monarque, dissimule son illustre origine et se donne pour un simple aventurier, fils d’un officier de chars de guerre. Il se présente à l’épreuve, pour laquelle rivalisaient tous les princes de Syrie. Grâce à la puissance d’une conjuration magique irrésistible, il distance ses rivaux et parvient à s’envoler jusqu’à la fenêtre de la princesse, avec laquelle il passe la nuit. Celle-ci somme alors son père de tenir la promesse qu’il a faite et de la marier au séduisant aventurier d’Égypte. Après quelques hésitations, le roi de Naharina y consent, et le mariage a lieu. Le fils du roi d’Égypte révèle alors à sa femme sa véritable naissance et les trois formes de trépas dont le menace le destin. Elle le supplie en vain de laisser tuer son chien, qui lui deviendra sûrement fatal, il s’y refuse et ne veut pas se séparer de ce fidèle compagnon. A quelque temps de là, un serpent se glisse dans la chambre du prince ; la princesse l’aperçoit et le tue, délivrant son époux de ce danger. Un crocodile sort du fleuve voisin de la capitale du Naharina et entre dans la ville. On charge un géant de veiller sur tous ses mouvements, et un jour que le monstre allait se jeter sur le prince, il le préserve de ses atteintes. Ici s’arrête ce qui est parvenu jusqu’à nous du conte. La fin manque, mais on peut la restituer facilement. Comme nul n’évite sa destinée, après avoir échappé au serpent et au crocodile, c’est de son chien favori que le prince devait recevoir la mort. Dans un papyrus du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, écrit sous la XIIe dynastie, un habile égyptologue russe, M. Golenischeff, a découvert encore un curieux récit qui rappelle ceux des aventures de Sindbad le marin dans les Mille et une Nuits. C’est la narration du prétendu voyage d’un marinier envoyé par le roi d’Égypte aux mines du haut Nil, avec une grande barque montée par cent cinquante hommes. Il a franchi les cataractes, dépassé le pays des Ouaoua et remonté tant et tant le cours du fleuve qu’il a fini par déboucher dans la mer. Là une tempête a englouti le navire, fait périr tous les matelots, et lui-même il a été jeté seul et nu par les îlots sur le rivage d’une des îles bienheureuses où résident les ombres des morts. Cette île était gardée par un serpent gigantesque et merveilleux, muni d’une grande barbe à la façon de celle qu’on donnait aux dieux et marchant sur deux jambes à la manière des hommes, tel, en un mot, que l’imagination des Égyptiens se représentait ceux qu’elle plaçait à la garde des portes de la région infernale. Quand il s’est trouvé en présence de cet être surnaturel, le naufragé a été d’abord épouvanté ; il a cru sa dernière heure venue. Mais le serpent s’est montré bon prince. Il a accepté gracieusement les hommages de l’Égyptien prosterné devant lui ; puis il l’a interrogé sur sa naissance et le but de son voyage, en lui disant de ne pas mentir surtout, car il savait tout de science divine. Le naufragé lui a répondu avec modestie et sincérité, et le serpent s’en est montré satisfait. Il lui a annoncé qu’il resterait quatre mois dans l’île, où aucune bonne chose ne lui manquerait, puis qu’au bout de ce temps un navire passerait à portée, qu’il pourrait y monter et retourner en Égypte ; l’île alors devait s’abîmer dans les flots. Au bout des quatre mois, en effet, un vaisseau a passé à peu de distance de l’île et son équipage a aperçu les signaux que le naufragé lui faisait de la rive. On est venu à terre pour le chercher. Au moment de partir, il a été prendre congé du serpent divin, et celui-ci, en lui augurant un heureux retour, lui a fait présent d’une riche cargaison des plus précieux aromates. Puis, aussitôt que le navire a eu mis à la voile, l’île merveilleuse a disparu aux regards. M. Maspero a pensé que ce récit tranchait d’une manière définitivement affirmative la question, que nous avons laissée plus haut en suspens, de savoir si les Égyptiens de la haute antiquité pharaonique ont été par eux-mêmes habituellement des marins, si c’était par eux ou par des étrangers, tels que les Phéniciens, qu’étaient montées les flottes qui, sur la mer Rouge, partaient de la côte d’Égypte pour aller naviguer jusqu’au pays de Pount. D’après lui, l’auteur, contemporain du Moyen-Empire, du conte qui se lit dans le papyrus de Saint-Pétersbourg, croyait à une communication entre le haut Nil et l’Océan Indien, et c’est dans cette mer qu’il plaçait l’île merveilleuse où le naufragé s’était trouvé transporté. Tout ceci rie me semble point résulter du contexte du récit. Le navigateur égyptien n’est point à proprement parler un marin d’eau salée ; c’est un marinier du Nil, qui est parti pour remonter le fleuve aussi haut qu’il pourrait. S’il a, au terme de sa navigation fluviale, débouché dans la mer, rien n’indique qu’il s’y attendît d’avance. Ce qui me paraît, au contraire, la conclusion impliquée par ce conte, c’est que, dès le temps de la XIIe dynastie, qui les avait vu porter leurs armes jusque fort avant dans l’Éthiopie, les Égyptiens avaient eu, par les rapports des indigènes de cette contrée, des notions d’une certaine précision sur l’existence des grands lacs de l’Afrique équatoriale, d’où descend le Nil. L’étendue de ces lacs devait les faire regarder comme de véritables mers. C’est à l’ouest de la vallée du Nil qu’ils se prolongeaient ; et c’est sûrement dans l’Occident, et non pas vers l’Orient comme le pays de Pount, qu’on devait se représenter la situation d’une des îles bienheureuses habitées par les ombres des défunts. |