Les origines, les races et les langues
LIVRE
II — LES RACES ET LES LANGUES
CHAPITRE III— L’ÉCRITURE
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — LES MARQUES MNÉMONIQUES. L’homme n’eut pas plus tôt acquis les premiers éléments des connaissances indispensables à son développement intellectuel et moral, qu’il dut sentir la nécessité d’aider sa mémoire à conserver les notions qu’il s’était appropriées, et d’acquérir les moyens de communiquer sa pensée à ses semblables dans des conditions où la parole ne pouvait être employée. C’est là ce qui constitue l’écriture. Pour réaliser cet objet, deux méthodes pouvaient être employées, séparément ou ensemble : L’idéographisme ou la peinture des idées ; Le phonétisme ou la peinture des sons. A son tour l’idéographisme pouvait user de deux méthodes : La représentation même des objets que l’on voulait désigner, ou figuration directe ; La représentation d’un objet matériel ou d’une figure convenue pour exprimer une idée qui ne pouvait pas se peindre par une image directe ; c’est ce qu’on désigne par le nom de symbolisme. Le phonétisme présente également deux degrés : Le syllabisme, qui considère dans la parole comme un tout indivisiblement et représente par un seul signe la syllabe, composée d’une articulation ou consonne, muette par elle-même, et d’un son vocal qui y sert de motion ; L’alphabétisme, qui décompose la syllabe et en représente par des signes distincts la consonne et la voyelle. Par une marche logique et conforme à la nature des choses, ainsi qu’à l’organisation même de l’esprit humain, tous les systèmes d’écriture ont commencé par l’idéographisme et ne sont arrivés que par un progrès graduel au phonétisme. Dans l’emploi du premier système, ils ont tous débuté par la méthode purement figurative, qui les a conduits à la méthode symbolique. Dans la peinture des sons, ils ont traversé l’état du syllabisme avant d’en venir à celui de l’alphabétisme pur, dernier terme du progrès en ces matières. L’homme recourut d’abord à des procédés très imparfaits, propres seulement à éveiller la pensée du fait dont il voulait perpétuer le souvenir ; il en associa l’idée à des objets physiques observés ou fabriqués par lui. Quand il eut quelque peu grandi en intelligence, l’un des moyens mnémoniques les plus naturels qui s’offrirent à lui fut d’exécuter une image plus ou moins exacte de ce qu’il avait vu ou pensé, et cette représentation figurée, taillée dans une substance suffisamment résistante ou tracée sur une surface qui se prêtait au dessin, servit non seulement à se rappeler ce qu’on craignait d’oublier, mais encore à en transmettre la connaissance à autrui. Toutefois, dans l’enfance de l’humanité, la main était encore maladroite et inexpérimentée. Souvent elle ne pouvait même pas s’essayer à des ébauches grossières ; certaines races semblent avoir été totalement incapables d’un pareil travail. Bien des populations sauvages se bornèrent à entailler une matière dure, à y faire des marques de diverses formes, auxquelles elles attachaient les notions qu’il s’agissait de transmettre. On incisait l’écorce des arbres, la pierre, l’os, on gravait sur des planchettes, on dessinait sur des peaux où de larges feuilles sèches les signes conventionnels qu’on avait adoptés ; ces signes étaient généralement peu compliqués. Tels étaient les khê-mou, bâtonnets entaillés d’une manière convenue, que, d’après les écrivains chinois, les chefs tartares, avant l’introduction de l’alphabet d’origine syriaque adopté d’abord par les Ouigours, faisaient circuler dans leurs hordes, lorsqu’ils voulaient entreprendre une expédition, pour indiquer le nombre d’hommes et de chevaux que devait fournir chaque campement. Avant de se servir de la forme d’écriture alphabétique à laquelle on a donné le nom de runes, les peuples germaniques et Scandinaves employaient un système analogue, dont l’usage a laissé des Vestiges très manifestes dans le langage de ces peuples. C’est ainsi que pour désigner les lettres, lés signes de l’écriture, on se sert encore aujourd’hui en allemand du mot buchstaben, dont le sens primitif est celui de bâtons, parce que des bâtonnets entaillés servirent d’abord aux Germains de moyens pour se communiquer leurs idées. Chez les Scandinaves, l’expression parallèle bok-stafir désigne encore la baguette sur laquelle on grave des signes mystérieux. Ceci rappelle ce que dit Tacite des Germains, lesquels faisaient des marques aux fragments d’une branche d’arbre fruitier qu’ils avaient coupée, et se servaient des morceaux ainsi marqués pour la divination. C’est à cet usage primitif des peuples germano-scandinaves qu’Eustathe fait bien évidemment allusion, quand il dit, d’après quelque auteur aujourd’hui perdu : Les anciens, à la manière des Égyptiens, dessinaient comme des hiéroglyphes des animaux et d’autres figures, pour indiquer ce qu’ils voulaient dire, de même que plus tard quelques-uns des Scythes marquaient ce qu’ils voulaient dire en traçant ou en gravant sur des planchettes de bois certaines images ou des entailles linéaires de différentes sortes. Il faut remonter bien haut dans la vie de l’humanité pour trouver les premiers vestiges de semblables usages. Parmi les objets découverts par Lartet dans la célèbre grotte sépulcrale d’Aurignac, appartenant à la période quaternaire et à la fin de l’âge du mammouth, on remarque une lame de bois de renne, présentant, sur l’une de ses faces planes, de nombreuses raies transversales, également distancées, avec une lacune d’interruption qui les divise en deux séries ; sur chacun des bords latéraux de ce morceau ont été entaillées de champ d’autres séries d’encoches plus profondes et régulièrement espacées. On serait tenté, dit Lartet, de voir là des signes de numération exprimant des valeurs diverses ou s’appliquant à des objets distincts. Il y a, comme on le voit par la description, identité complète entre cet objet sorti des mains des hommes qui habitaient notre pays en même temps que l’elephas primigenius, le rhinoceros tichorhinus et l’ursus spelæus, et les khé-mou des Tartares, tels que les décrivent les auteurs chinois, ou les planchettes qu’Eustathe signale chez les Scythes. On a trouvé également des pièces toutes semblables dans l’ossuaire de Cro-Magnon et dans la station renommée de Laugerie-Basse. Un autre système, offrant avec celui-ci une grande analogie et destiné au même objet, fut celui des quippos ou cordelettes nouées des Péruviens, au temps de la monarchie des Incas. C’était un moyen mnémonique venant en aide aux poésies transmises par une tradition purement orale dans la mémoire des amautas ou lettrés, pour conserver le souvenir des principaux événements historiques. Les quippos péruviens, par les ressources qu’offraient la variété des couleurs des cordelettes, leur ordre, le changement du nombre et de la disposition des nœuds, permettaient d’exprimer ou plutôt de rappeler à la mémoire un beaucoup plus grand nombre d’idées que les bâtonnets entaillés des Tartares, et surtout, Garci Lasso de la Vega et Calancha nous l’attestent, fournissaient les éléments d’une notation numérale fort avancée. Cependant on n’aurait pu écrire, nous ne disons pas un livre, mais une phrase entière, au moyen des quippos. Ce n’était par le fait, qu’un perfectionnement du procédé si naturel qu’emploient beaucoup d’hommes, en faisant des nœuds de diverses façons au coin de leur mouchoir, pour venir en aide à leur mémoire et se rappeler à temps certaines choses qu’ils craindraient d’oublier autrement. Suivant la tradition chinoise, les premiers habitants des bords du Hoang-Ho, avant l’invention de l’écriture proprement dite, se servaient, eux aussi, de cordelettes nouées à des bâtons comme instruments de mnémonique et de communication de certaines idées. Ce procédé est encore usité chez les Miao-tseu, barbares des montagnes du sud-ouest de la Chine. Les bâtons noueux attachés à des cordes paraissent, dans les origines de la civilisation chinoise, avoir été le point dé départ de ces mystérieux diagrammes dont on faisait remonter l’invention au légendaire empereur Fouh-Hi, et dont il est traité dans le Yih-King, un des livres sacrés du Céleste Empire. Rapprochons encore la pratique des colliers mnémoniques des tribus de Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, appelés gaionné, garthoua ou garsuenda, lesquels empruntent un sens à la différence des grains qui les composent. Dans certains endroits on a remarqué, parmi les alluvions quaternaires, à côté d’armes de pierre de travail humain et de cailloux perforés pour former des grains de colliers ou de bracelets et servir de parures, des groupes d’autres cailloux remarquables par leurs formes bizarres, leurs couleurs variées, certains hasards de cassure. Ces groupes ont été formés intentionnellement par la main de l’homme, on n’en saurait douter quand on les trouve en place, et d’un autre côté les cailloux qui les composent n’ont été utilisés ni comme instruments ni comme parures. Tout semble donc indiquer qu’on a là les vestiges d’un procédé mnémonique analogue aux colliers des Peaux-Rouges, qu’auraient pratiqué les hommes de l’âge quaternaire. Ce qui le confirme, c’est qu’avant l’invention des quippos, les Péruviens de l’époque anté-incasique employaient de même des cailloux ou des grains de maïs de diverses couleurs. Mais ces différents procédés rudimentaires, monuments des premiers efforts de l’homme pour fixer matériellement ses pensées et les communiquer à travers la distance, là où ne peut plus atteindre sa voix, ne peuvent être considérés comme constituant de véritables systèmes d’écriture. Nulle part ils n’ont été susceptibles d’un certain progrès, même chez les Péruviens, où la civilisation était pourtant fort avancée et où l’esprit ingénieux de la nation avait porté un procédé de ce genre jusqu’au dernier degré de perfectionnement auquel sa nature même pouvait permettre de le conduire. Nulle part ils ne se sont élevés d’une méthode purement mnémonique, convenue entre un petit nombre d’individus, et dont la clef se conservait par tradition, jusqu’à une véritable peinture d’idées ou de sons. Il n’y a, à proprement parler, d’écriture que là où il y a dessin de caractères gravés ou peints, qui représentent à tous les mêmes idées ou les mêmes sons. Or, tous les systèmes connus qui rentrent dans ces conditions ont à leur point de départ l’hiéroglyphisme, c’est-à-dire la représentation d’images empruntées au monde matériel. § 2. — LA PICTOGRAPHIE. La représentation figurée des objets se prêtait bien mieux que les grossiers procédés que nous venons de passer en revue, à traduire la pensée ; elle en assurait mieux la transmission. Aussi la plupart des tribus sauvages douées de quelque aptitude à dessiner y ont-elles eu recours. On a rencontré chez une foule de tribus sauvages ou quasi sauvages de ces images qui décèlent plus ou moins le sentiment des formes. Elles n’ont point été simplement le produit de l’instinct d’imitation qui caractérise notre espèce ; l’objet en était surtout de relater certains événements et certaines idées. Il n’y a pas un siècle que la plupart des Indiens de l’Amérique du Nord avaient l’habitude d’exécuter des peintures représentant d’une façon plus ou moins abrégée leurs expéditions guerrières, leurs chasses, leurs pêches, leurs migrations, et à l’aide desquelles ils se rappelaient les phénomènes qui les avaient frappés, les aventures où ils avaient été engagés. Ces peintures ressemblent généralement, à s’y méprendre, aux dessins que nous barbouillons dans notre enfance. Les progrès de ce mode d’expression de la pensée se sont confondus avec ceux de l’art ; mais les races qui n’ont pas connu d’autre écriture ne poussèrent pas bien loin l’imitation des formes de la nature. Quelques populations atteignirent pourtant à un degré assez remarquable d’habileté dans la pratique de cette méthode, que l’on a pris l’habitude plus ou moins heureuse de désigner par le mot hybride de pictographie. Lorsqu’en 1519, le jour de Pâques, Fernand Cortez eut pour la première fois une entrevue avec un envoyé du roi de Mexico, il trouva celui-ci accompagné d’indigènes qui, réunis en sa présence, se mirent immédiatement à peindre sur des bandes d’étoffe de coton ou d’agave tout ce qui frappait pour la première fois leurs regards, les navires, les soldats armés d’arquebuses, les chevaux, etc. Des images qu’ils en firent, les artistes mexicains composèrent des tableaux qui étonnaient et charmaient l’aventurier espagnol. Et comme celui-ci leur demandait dans quelle intention ils exécutaient ces peintures, ils expliquèrent que c’était pour les porter à Montézuma et lui faire connaître les étrangers qui avaient abordé dans ses États. Alors, en vue de donner au monarque mexicain une plus haute idée des forces des conquistadores, Cortez fit manœuvrer ses fantassins et ses cavaliers, décharger sa mousqueterie et tirer ses canons ; et les peintres de reprendre leurs pinceaux et de tracer sur leurs bandes d’étoffe les exercices si nouveaux pour eux dont ils étaient témoins. Ils s’acquittèrent de leur tâche avec une telle fidélité de reproduction que les Espagnols s’en émerveillèrent. Dans cet exemple la pictographie rentre plutôt dans les données de l’art proprement dit que dans celles de l’écriture. Elle se compose de représentations directement figuratives offrant une suite de scènes où se déroulent sous les yeux les épisodes successifs d’une histoire. C’est ainsi que procèdent les Esquimaux, remarquables par leur singulière habileté de main pour ce genre de travail, dans les dessins figurés et significatifs qu’ils gravent sur leurs armes et leurs instruments, et qui représentent en général les exploits, les aventures du possesseur ou de sa famille. Les représentations grossièrement sculptées dans les âges préhistoriques sur quelques rochers de la Scandinavie et sur ceux des alentours du lac des Meraviglie, dans les Alpes niçoises, ont tout à fait le même caractère. On pourra en juger parle spécimen que nous reproduisons ici. Ces figures, gravées sur un rocher à Skebbervall dans le Bohuslän, en Suède, étaient manifestement destinées à commémorer un débarquement d’aventuriers venus par mer, qui avait triomphé de la résistance des indigènes et enlevé leurs troupeaux. Nous avons parlé plus haut des dessins exécutés sur différents objets d’os et de corne de renne par les troglodytes du Périgord à la fin des temps quaternaires. Il en est quelques-uns dans le nombre qui ont manifestement le caractère d’une véritable pictographie significative. Tel est le cas de celui que nous reproduisons pour la seconde fois en regard de cette page et qui provient de la grotte de la Madeleine [Image ci-dessous]. Ce n’est évidemment pas sans une intention voulue et calculée qu’ont été groupées les figures si diverses qui sont réunies sur ce morceau de bois de renne. Par leur succession et leur réunion, elles exprimaient un sens, elles rappelaient une histoire, non plus par sa représentation directe, mais sous une forme abrégée et sommaire, où nous pouvons saisir, la transformation qui conduisit la pictographie à devenir de plus en plus une écriture à proprement parler.
En effet, dans ces images avant tout mnémoniques, l’observation d’une grande exactitude dans les détails, d’une précision rigoureuse dans la reproduction de la réalité, aurait nui le plus souvent à la rapidité de l’exécution, et, dans le plus grand nombre des cas aurait été tout à fait impossible. Comme c’était uniquement en vue de parler à l’esprit et d’aider la mémoire que l’on recourait à de semblables dessins, on prit l’habitude d’abréger le tracé, de réduire les figures à ce qui était strictement nécessaire pour en comprendre le sens. On adopta des indications conventionnelles qui dispensèrent de beaucoup de détails. Dans cette peinture idéographique, on recourut aux mêmes tropes, aux mêmes figures de pensée dont nous nous servons dans le discours, la synecdoche, la métonymie, la métaphore. On représenta la partie pour le tout, la cause pour l’effet, l’effet pour la cause, l’instrument pour l’ouvrage produit, l’attribut pour la chose même. Ce qu’une image matérielle n’aurait pu peindre directement, on l’exprima au moyen de figures qui en suggéraient la notion par voie de comparaison ou d’analogie. Quelques exemples, empruntés aux Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, feront comprendre ce stage delà pictographie. Voici, ci-dessous, le fac-similé d’une pétition présentée par des Indiens au Président des États-Unis pour réclamer la possession de certains lacs, 8, situés dans le voisinage du lac Supérieur, 10. La figure n° 1 représente le principal chef pétitionnaire par l’image d’une grue, totem ou animal symbolique de son clan ; les animaux qui suivent sont les totems de ses copétitionnaires. Leurs yeux sont tous reliés aux siens pour exprimer l’unité de vues ; leur cœur au sien pour indiquer l’unité de sentiments. L’œil de la grue, symbole du chef principal, est en outre le point de départ d’une ligne qui se dirige vers le Président et d’une autre qui va rejoindre les lacs, 8.
Que l’on mette maintenant en regard de ces planches tumulaires des Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, les signes grossièrement gravés à l’âge de la pierre polie sur une des dalles formant la paroi de la chambre intérieure du grand tumulus du Mané-Lud à Locmariaker, dans le département du Morbihan, et il ne sera pas possible de douter que nous n’ayons dans ce dernier cas une épitaphe pictographique analogue, dont la clef est aujourd’hui perdue, mais dont la nature est certaine. Cet exemple nous justifiera pleinement d’avoir été chercher, dans les usages des sauvages modernes, l’explication des faits qui se produisirent dans les premiers âges chez les races mêmes qui surent parvenir le plus tôt à un haut degré de civilisation. II y a là des faits, tenant au génie propre et à la nature essentielle de l’homme, qui ont dû se développer partout parallèlement, en dépit des différences de races. Et le point où s’est marquée celte différence d’aptitude des races n’a pas été tant la manifestation des premiers essais rudimentaires de pictographie mnémonique que le progrès nouveau qui, chez un petit nombre de peuples seulement, devait en faire sortir l’invention féconde de l’écriture. Pour achever de montrer que la pictographie a été foncièrement la même chez toutes les races et dans toutes les parties du monde, et cela spontanément, sans qu’il soit possible d’admettre transmission de l’un à l’autre entre les peuples dont nous comparons les monuments, il suffira, après avoir produit des spécimens de la pictographie des Indiens de l’Amérique du Nord et de celle des habitants de notre pays aux deux époques archéolithique et néolithique, d’en joindre ici un de celle des habitants primitifs delà Sibérie. Ce sont les signes péniblement gravés sur un rocher voisin de l’embouchure du ruisseau Smolank dans l’Irtysch. L’analogie avec le tableau biographique d’un chef des Delawares, donné tout à l’heure, est frappante. Nous avons de même ici, à côté de signes dont la signification nous échappe, des indications de nombres de guerriers, de campements ou de villages attaqués, de marches et de contremarches militaires, notées par des flèches placées dans des directions diverses, d’ennemis tués et faits prisonniers. C’est encore toute une histoire de guerre retracée sous une forme grossièrement symbolique. L’écriture pictographique et figurative, dit M. Maury, ne fut pas seulement tracée sur les rochers et sur le tronc des arbres ; elle ne fut point uniquement employée à la composition de quelques courtes inscriptions. Elle servit, comme l’attestent les monuments de l’Égypte et de l’Amérique centrale, à décorer les édifices qu’elle, faisait ainsi parler à la postérité. Mais il fallait pouvoir transporter partout où il était nécessaire ces images écrites. L’homme avait besoin d’emporter avec lui sa mnémonique. Il prépara des peaux, des étoffes, des substances légères et faciles à se procurer, sur lesquelles il grava, il peignit des successions de figures, et. il eut de la sorte de véritables livres. La pensée put dès lors circuler ou se garder comme un trésor. Certaines tribus sauvages, pour la rendre plus expressive, allèrent jusqu’à se servir de leur propre corps comme de papier, et chez diverses populations polynésiennes les dessins du tatouage, qui s’enrichissait à chaque époque principale de la vie, étaient une véritable écriture. Aussi un savant allemand, M. H. Wuttke, à qui l’on doit une intéressante histoire de l’écriture, a-t-il avec raison consacré tout un chapitre au tatouage. Chez les Maoris de la Nouvelle-Zélande, il n’y avait pas un chef qui ne sût dessiner un fac-similé du tatouage de sa face. Ce dessin, qu’ils nommaient amoco, était pour chacun une marque personnelle et significative, une signature en quelque sorte. Les dessins compliqués que l’on a trouvés gravés sur les dalles formant les parois de certaines allées couvertes funéraires de l’époque de la pierre polie, par exemple de celle de Gavr’Innis dans le Morbihan, présentent toutes les apparences de dessins de tatouages. Ce sont de véritables, amocos qui servaient à désigner le guerrier dont le corps était déposé dans l’ossuaire commun, devant la dalle où l’on traçait ces signes. Naturellement la plupart des monuments de la pictographie primitive et préhistorique ont disparu, surtout chez les peuples qui ont su de très bonne heure s’élever au-dessus de ce procédé encore si imparfait et si rudimentaire de fixation et de transmission de la pensée, et en faire sortir une véritable écriture. C’est pour cela que nous avons dû aller en chercher les exemples chez d’autres nations, qui ne l’ont point dépassé. Mais toutes les écritures hiéroglyphiques impliquent nécessairement à leurs premiers débuts l’emploi d’une simple pictographie, qui les a engendrées. § 3. — LES ÉCRITURES HIÉROGLYPHIQUES. A l’état rudimentaire de pictographie, l’hiéroglyphisme ne constitue réellement pas encore une véritable écriture. Une le devient à proprement parler que lorsqu’à la peinture des idées il joint la peinture des sons. Pour élever l’hiéroglyphisme pictographique à ce nouveau point de développement, il fallait un progrès à la fois dans les idées et dans les besoins de relations sociales plus grand que ne le comporte la vie sauvage. La plupart des peuples ne sont point parvenus spontanément à ce degré de civilisation qui pouvait donner naissance à l’écriture ; ils y ont été initiés par d’autres peuples qui les avaient précédés dans cette voie, et ils ont reçu de leurs instituteurs l’écriture toute formée, avec la notion des autres arts les plus essentiels. Aussi, lorsqu’on remonte aux origines, toutes les écritures connues se ramènent-elles à un très petit nombre de systèmes, tous hiéroglyphiques au début, qui paraissent avoir pris naissance d’une manière absolument indépendante les uns des autres[1]. Ce sont : 1° Les hiéroglyphes égyptiens ; 2° L’écriture chinoise ; 3° L’écriture cunéiforme anarienne ; 4° Les hiéroglyphes ‘hittites, qui du nord delà Syrie ont rayonné dans une haute antiquité sur une portion de l’Asie Mineure ; 5° Les hiéroglyphes mexicains ; 6° L’écriture calculiforme ou katouns des Mayas du Yucatan. Ces différents systèmes, au nombre de six, tout en restant essentiellement idéographiques, sont parvenus au phonétisme. Mais, on admettant ce nouveau principe, ils ne l’ont pas poussé jusqu’au même degré de développement. Chacun d’eux s’est immobilisé et comme cristallisé dans une phase différente des progrès du phonétisme, circonstance précieuse et vraiment providentielle, qui permet à la science de suivre toutes les étapes par lesquelles l’art d’écrire a passé pour arriver de la peinture des idées à la peinture exclusive des sons, de l’idéographisme à l’alphabétisme pur, terme suprême de son progrès. Les systèmes fondamentaux d’écriture originairement hiéroglyphique, que nous venons d’énumérer, ne sont pas, du reste, encore connus d’une manière également complète. Il en est deux dont l’imperfection des notions que l’on possède, dans l’état actuel de la science, ne nous permettra pas de tirer parti pour y puiser des renseignements sur cette marche du progrès graduel des écritures vers la clarté et la simplification. Ce sont les hiéroglyphes ‘hittites, dont on n’a jusqu’ici qu’un petit nombre de monuments et dont le déchiffrement est encore à faire. Il n’y a que peu de temps qu’on en connaît l’existence et que l’on a commencé à s’en occuper, et aucun progrès décisif n’a commencé à soulever le voile mystérieux qui cache leur signification ! C’est tout au plus si les ingénieuses recherches de M. Sayce sont parvenues à déterminer la valeur de deux ou trois signes d’idées, comme celui de roi et celui de pays. On n’a jusqu’à présent aucune donnée sur la part que peut y tenir le phonétisme et sur la question de savoir s’il est syllabique ou alphabétique, bien que la première hypothèse paraisse la plus probable. Non moins mystérieuse est l’écriture des Mayas du Yucatan, quoique l’on sache à son sujet d’une manière positive, par le témoignage infiniment précieux de Diego de Landa, que ce système graphique était parvenu à un degré de perfectionnement très analogue à celui des hiéroglyphes égyptiens,qu’il admettait de même un élément alphabétique de peinture des sons. Il subsiste, de l’écriture calculiforme de l’Amérique centrale, des manuscrits et de très nombreuses inscriptions, dont malheureusement jusqu’ici les copies sont peu certaines et peu dignes de foi. Malgré ces ressources d’étude, on n’a fait pendant bien longtemps aucun progrès sérieux dans la voie de son explication. Tout récemment, la sagacité pénétrante de M. Léon de Rosny est parvenue enfin à poser quelques jalons de déchiffrement, et a donné pour la première fois un caractère réellement scientifique aux recherches sur la signification des hiéroglyphes spéciaux du Yucatan. Mais si les résultats obtenus paraissent cette fois solides, ils se réduisent encore à trop peu de chose pour que nous ayons pu les faire figurer ici. Remarquons, du reste, que toutes les écritures d’origine hiéroglyphique qui combinent le phonétisme et l’alphabétisme, après avoir commencé par être figuratives, c’est-à-dire par se composer d’images d’hommes, d’animaux, de plantes, d’objets naturels ou manufacturés, etc., ont subi, par l’effet de l’usage, une transformation inévitable, qui leur a donné un autre aspect et un autre caractère. A force d’être tracées rapidement et abrégées, les figures s’altérèrent dans leurs formes et finirent par ne plus offrir que des signes conventionnels, où il était souvent bien difficile de reconnaître le type originel. Le fait s’observe déjà quelquefois dans les peintures mexicaines, mais il se produisit sur une bien plus grande échelle en Égypte, où l’écriture hiéroglyphique était usitée depuis un temps immémorial. On y substitua, pour le besoin journalier, une véritable tachygraphie, qu’on trouve employée spécialement sur les papyrus, et que les égyptologues nomment écriture hiératique. Plus tard même on en imagina une plus cursive encore, reposant sur un système à certains égards plus avancé ; c’est celle qu’on appelle démotique, parce qu’elle fut en usage aux derniers temps des Pharaons et sous les Ptolémées chez presque toute la population égyptienne. En Chine, les images grossièrement tracées furent aussi promptement défigurées, et elles ne présentèrent plus qu’un ensemble de traits que le scribe exécuta avec le pinceau, et dont l’assemblage ne garde, la plupart du temps, aucune ressemblance avec les figures dont elles sont cependant l’altération. Dans les écritures cursives employées chez les Chinois, les signes se sont corrompus davantage, et n’ont affecté que des formes toutes conventionnelles. Parvenue à ce point, l’écriture figurative cesse d’être une peinture pour devenir une sémeiographie, c’est-à-dire un assemblage de caractères représentant des idées et constituant ce que l’on appelle des idéogrammes. L’écriture cunéiforme anarienne, qui comprend divers systèmes, contient une foule de signes de cette nature. Les traits offrant l’aspect de têtes de flèches ou de clous y forment par leur groupement, varié à l’infini, de véritables caractères. Ces groupes cunéiformes, comme les plus anciens caractères chinois, reproduisaient grossièrement à l’origine la configuration des objets ; mais les images se sont ensuite si fort altérées, qu’à de rares exceptions près on ne peut plus remonter aux prototypes iconographiques. On n’est en présence que de signes ayant un caractère purement mnémonique et dont un grand nombre affectent une valeur phonétique. La méthode sémeiographique n’évinça pas, d’ailleurs, les symboles, les emblèmes, les images combinées ; elle ne fit qu’en altérer l’aspect d’une manière à peu près complète. On retrouve dans l’hiératique égyptien, comme dans l’écriture chinoise actuelle, comme dans le cunéiforme assyrien, la même proportion d’idéogrammes originairement figuratifs ou symboliques que dans les écritures qui ont gardé leur ancien aspect hiéroglyphique et où les images sont demeurées reconnaissables. Quelquefois aussi, comme en Égypte, l’hiéroglyphisme figuratif est demeuré en usage, comme écriture décorative et monumentale, parallèlement aux tachygraphies sémeiographiques sorties de son altération. Dans ce cas, l’hiéroglyphisme figuratif, quelques progrès qu’il ait consommés comme instrument d’expression de la pensée par la peinture simultanée des idées et des sons, garde encore tant de son essence primitive de pictographie, que les signes qui le composent peuvent être groupés dans la décoration des édifices en forme de tableaux figurés et symboliques représentant une action, sans perdre pour cela leur signification d’écriture. Voici par exemple deux petits tableaux dont la répétition l’orme une frise à l’un des temples de Karnak, à Thèbes d’Égypte. Ce sont deux scènes religieuses et symboliques : le roi agenouillé, tenant un sceptre emblématique, qui varie dans les deux, et la tête surmontée du disque solaire, présente au dieu Ammon, assis, la figure de la déesse Ma, la justice et la vérité personnifiées ; quelques signes hiéroglyphiques, qui n’ont pas trouvé naturellement place dans la scène, sont disposés de manière à y former un soubassement général et un piédestal au dieu Ammon. Mais en même temps ces deux tableaux ne sont pas autre chose qu’une expression graphique du double nom du pharaon Ramessou IV, de la XXe dynastie, dont ils renferment tous les éléments, ingénieusement groupés dans une scène en action : Râ -mes -sou haq Ma meï Amoun. Râ -ousor -ma sotpou en Amoun. Dans leur disposition graphique ordinaire, ces éléments donneraient les deux cartouches hiéroglyphiques ci-contre. § 4. — DÉVELOPPEMENTS SUCCESSIFS DE L’IDÉOGRAPHISME. L’hiéroglyphisme, nous l’avons déjà dit, commença par une méthode exclusivement figurative, parla représentation pure et simple des objets, eux-mêmes. Toutes les écritures qui sont restées en partie idéographiques ont conservé jusqu’au terme de leur existence les vestiges de cet état ; car on y trouve un certain nombre de signes qui sont de simples images et n’ont pas d’autre signification que celle de l’objet qu’ils représentent. Ce sont ceux que les égyptologues, depuis Champollion, ont pris l’habitude de désigner par le nom de caractères figuratifs, et que les grammairiens chinois appellent siâng-hing, images. Mais la méthode purement figurative ne permettait d’exprimer qu’un très petit nombre d’idées, d’un ordre exclusivement matériel. Toute idée abstraite ne pouvait, par sa nature même, être peinte au moyen d’une figure directe ; car quelle eût été cette figure ? En même temps certaines idées concrètes et matérielles auraient demandé, pour leur expression directement figurative, des images trop développées et trop compliquées pour trouver place dans l’écriture. L’un et l’autre cas nécessitèrent l’emploi du symbole ou du trope graphique. Pour rendre l’idée de combat on dessina deux bras humains, dont l’un tient un bouclier et l’autre une hache d’armes ; pour celle d’aller, marcher, deux jambes en mouvement. La présence du symbole dans l’écriture hiéroglyphique doit remonter à la première origine et être presque contemporaine de l’emploi des signes purement figuratifs. En effet, l’adoption de l’écriture, le besoin d’exprimer la pensée d’une manière fixe et régulière, suppose nécessairement un développement de civilisation et d’idées trop considérable pour qu’on ait pu s’y contenter longtemps delà pure et simple représentation d’objets matériels pris dans leur sens direct. En outre les images affectèrent une signification particulière par le fait de leur association ; la métaphore, l’emblème, le trope, valurent à certains groupes ligures un sens qui naissait du rapprochement des diverses images dont ces groupes étaient composés. C’est surtout de la sorte qu’on rendit idéographiquement des conceptions qui ne se prêtaient pas ou se prêtaient niai à une simple peinture iconographique. Les Égyptiens employaient très fréquemment cette méthode, et on la trouve également appliquée dans les peintures mexicaines. On en saisit la trace dans l’écriture chinoise, où ces figures réunies de façon à rendre une idée constituent ce que l’on appelle, dans la langue du Céleste Empire, hoéï-î, sens combinés. Par exemple le signe de la bouche tracé à côté de celui de l’oiseau signifie chant, celui de l’oreille entre ceux des deux battants d’une porte, entendre ; le symbole de l’eau accolé à celui de l’oeil a le sens de larmes. Le même procédé tient une large place dans le mécanisme de l’écriture cunéiforme anarienne. Il n’est pas jusqu’aux Peaux-Rouges qui n’aient usé de pareils emblèmes, tant l’emploi s’en offre naturellement à l’esprit. L’écriture idéographique ne demeura donc pas longtemps une simple représentation iconographique ; elle forma bientôt un mélange d’images de significations très diverses, une suite de représentations prises tour à tour au sens propre et au sens tropique, d’emblèmes, de véritables énigmes dont l’intelligence demandait souvent une pénétration particulière. A cet état, dit M. Maury, l’écriture idéographique était un art difficile, parfois même un secret qui devait rester le privilège d’un petit nombre, de ceux qui l’emportaient par l’adresse de la main et par les lumières, conséquemment des prêtres ou des magiciens, des sorciers, qui en tiennent lieu chez les populations les plus barbares et les plus ignorantes. Le nom d’hiéroglyphes a donc été justement appliqué à ces systèmes graphiques. Dans le symbolisme qui y était étroitement lié se donnaient nécessairement rendez-vous toutes les sciences, toutes les croyances du peuple qui faisait usage de tels procédés. De là l’impossibilité de déchiffrer ces sortes d’écritures, si l’on ne s’est familiarisé avec les idées de ceux dont elles émanent. On peut bien, dans-les hiéroglyphes égyptiens, reconnaître du premier coup telle ou telle image, par exemple celle d’un homme qui est lié à un poteau, qui a les coudes attachés, qui fait une offrande ou porte une massue ; mais comment pourrait-on deviner que l’image du vautour traduit l’idée de maternité, si l’on ignorait que, du temps des Pharaons, les Égyptiens supposaient que cette espèce d’oiseau ne renferme que des femelles pouvant produire sans le concours des mâles ? Comment attacherait-on le sens de « fils » à la figure d’une oie si l’on ne savait que l’oie du Nil passait pour un modèle de piété filiale ? Gomment la figure d’un épervier posé sur un perchoir suggérerait-elle l’idée de « dieu, » si l’on n’était point informé que l’épervier était tenu pour l’emblème du Soleil, le dieu par excellence ? Du reste, l’écriture purement idéographique avait beau appeler à son aide toutes les ressources que nous venons de passer rapidement en revue, recourir, non seulement aux symboles simples formés par métonymie, par métaphore ou par convention énigmatique, mais encore aux symboles complexes, elle n’en restait pas moins un moyen déplorablement incomplet de fixation et de transmission de la pensée, et plus on marchait dans la voie du développement des idées et des connaissances, plus son imperfection se faisait sentir d’une manière fâcheuse. Avec l’emploi exclusif de l’idéographisme, on ne pouvait qu’accoler des images ou des symboles les uns à côté des autres, mais non construire une phrase et l’écrire de manière que l’erreur sur sa marche fût impossible. Il n’y avait aucun moyen de distinguer les différentes parties du discours ni les termes de la phrase, aucune notation pour les flexions des temps verbaux ou des cas et des nombres pour les cas. Une écriture de ce genre ne pouvait se plier d’une manière satisfaisante qu’à une langue monosyllabique et demeurée à la période rhématique, où il n’y à pas de distinction de nom, de verbe, ni d’aucune partie du discours, et où la grammaire se réduit à une syntaxe, à des règles de position pour les mots invariables qui expriment indifféremment tous les modes de l’idée. L’adoption par les Chinois d’un système d’écriture savant et compliqué, basé sur l’idéographisme, quand leur langue en était encore à cet état primitif, a certainement contribué dans une forte mesure à l’y figer définitivement, sans progrès ultérieur. En outre, le développement des idées et des notions à exprimer par l’écriture tendait à faire de cet art un chaos inextricable à force d’étendue et de complication, si un nouvel élément ne s’y introduisait pas, et si on continuait à vouloir représenter chaque idée, chaque notion, chaque objet nouveau par une image spéciale ou par un symbole, soit simple, soit complexe. Pour obvier à ces deux inconvénients, dont il fallait à tout prix se délivrer, si l’on ne voulait pas laisser la pensée à jamais emprisonnée dans des entraves qui eussent étouffé son développement d’une manière irréparable, les hommes furent, conduits, par une pente naturelle, à joindre la peinture des sons à la peinture des idées, à passer de l’idéographisme au phonétisme. De leur essence même, les écritures purement idéographiques des époques primitives ne peignaient aucun son. Représentant exclusivement et directement des idées, leurs signes étaient absolument indépendants des mots par lesquels les idiomes parlés des peuples qui en faisaient usage désignaient les mêmes idées. Ils avaient une existence et une signification propres, en dehors de toute prononciation ; rien en eux ne figurait cette prononciation, et la langue écrite était par le fait assez distincte de la langue parlée pour qu’on pût très bien entendre l’une sans connaître l’autre, et vice versa. Mais l’homme n’a jamais écrit que pour être lu ; par conséquent, tout texte graphique, quelque indépendant qu’il ait pu être par son essence de la langue parlée, a nécessairement été prononcé. Les signes des écritures idéographiques primitives représentaient des idées et non des mots ; mais celui qui les lisait traduisait forcément chacun d’eux par le mot affecté dans l’idiome oral à l’expression de la même idée. De là vint, par une pente inévitable, une habitude et une convention constante d’après laquelle tout idéogramme éveilla dans l’esprit de celui qui le voyait tracé, en même temps qu’une idée, le mot de cette idée, par conséquent une prononciation. C’est ainsi que naquit la première conception du phonétisme, et c’est dans cette convention, qui avait fini par faire affecter à chaque signe figuratif ou symbolique, dans son rôle d’idéogramme, une prononciation fixe et habituelle, que la peinture des sons trouva les éléments de ses débuts. § 5. — PREMIÈRES ÉTAPES DU PHONÉTISME. Le premier pas, le premier essai du phonétisme dut nécessairement être ce que nous appelons le rébus, c’est-à-dire l’emploi des images primitivement idéographiques pour représenter la prononciation attachée à leur sens figuratif ou tropique, sans plus tenir aucun compte de ce sens, de manière à peindre isolément des mots homophones dans la langue parlée, mais doués d’une signification tout autre, ou à figurer par leur groupement d’autres mots dont le son se composait en partie de la prononciation de tel signe et en partie de celle de tel autre. La logique et la vraisemblance indiquent qu’il dut en être ainsi, et des preuves matérielles viennent le confirmer. L’écriture hiéroglyphique des Nahuas du Mexique, née et développée spontanément, dans un isolement absolu et sans communication aucune avec les peuples de l’ancien monde, après avoir commencé par être exclusivement idéographique, fut conduite à recourir aux ressources du phonétisme parles mêmes besoins et la même loi de progrès logique et régulière, qui avaient conduit à un résultat semblable, dans d’autres âges, les Égyptiens, les Chinois primitifs et les Schoumers et Akkads, auteur de l’écriture cunéiforme anarienne. Mais dans la voie du phonétisme elle s’est arrêtée au simple rébus, sans faire un pas de plus en avant, et elle est devenue ainsi un précieux monument de cet état du développement des écritures, auquel elle s’est immobilisée. Un exemple suffira pour montrer comment on y passe de la prononciation des signes purement idéographiques, indépendants de tout son par leur essence, mais constamment liés dans l’usage à un mot de la langue parlée, au phonétisme réel par voie de rébus. Le nom du quatrième roi de Mexico, Itzcohuatl, le serpent d’obsidienne, s’écrit idéographiquement dans un certain nombre de manuscrits aztèques par l’image d’un serpent (cohuatl), garni de flèches d’obsidienne (itzlî). Cette figure constitue un idéogramme complexe, peignant la signification même du nom royal, directement, sans tentative d’expression phonétique ; mais qui, lu dans la langue parlée, ne pouvait, par suite des idées qu’il figurait, être prononcé que Itzcohuatl. Mais le même nom est représenté dans d’autres manuscrits par un groupe défigures, composé de la flèche d’obsidienne (itzli — racine itz), d’un vase (comitl — racine co), enfin du signe de l’eau (atl). Dans cette nouvelle forme on ne saurait plus chercher d’idéographisme, ni de peinture symbolique de la signification du nom, mais bien un pur rébus, une peinture des sons par des images matérielles employées à représenter le mot auquel elles correspondaient dans la langue. Au reste, les livres historiques ou religieux des anciens Mexicains, antérieurs à la conquête, se composaient exclusivement de tableaux figuratifs où l’écriture n’était employée qu’à former de courtes légendes explicatives à côté des personnages. Aussi l’élément phonétique, tel que nous venons de le montrer, n’y est-il guère appliqué qu’à tracer des noms propres. Si elles ne se sont pas arrêtées de même dans leur développement à la phase du rébus, les écritures qui ont su mener à un plus haut degré de perfection leurs éléments phonétiques, tout en restant pour une partie idéographiques, conservent des vestiges impossibles à méconnaître de cet état, et donnent ainsi la preuve qu’elles l’ont traversé pour passer, de l’idéographisme pur au phonétisme. Dans le cunéiforme anarien, les vestiges de rébus sont nombreux et jouent un rôle considérable. Mais ils se rapportent à l’époque primitive où cette écriture n’avait pas encore été transmise aux Sémites et demeurait exclusivement aux mains des populations de race touranienne, qui en avaient été les premiers inventeurs. On en observe aussi une certaine quantité dans le système hiéroglyphique des Égyptiens. Dans une langue monosyllabique comme celle des Chinois, l’emploi du rébus devait nécessairement amener du premier coup à la découverte de l’écriture syllabique. Chaque signe idéographique, dans son emploi figuratif ou tropique, répondait à un mot monosyllabique de la langue parlée, qui en devenait la prononciation constante ; par conséquent, en le prenant dans une acception purement phonétique pour cette prononciation complète, il représentait une syllabe isolée. L’état de rébus et l’état d’expression syllabique dans l’écriture se sont donc trouvés identiques à la Chine, et c’est à cet état de développement du phonétisme que le système graphique du Céleste Empire s’est immobilisé, sans faire un pas de plus en avant, depuis trente siècles qu’il a franchi de cette manière le premier degré de la peinture des sons. Mais, en chinois, ce n’est que dans les noms propres que nous rencontrons les anciens idéogrammes simples ou complexes employés isolément avec une valeur exclusivement phonétique, pour leur prononciation dans la langue parlée, abstraction faite de leur valeur originaire comme signes d’idées. Et, en effet, par suite de l’essence même de la langue, le texte chinois le plus court et le plus simple, écrit exclusivement avec des signes phonétiques, soit syllabiques, soit alphabétiques, sans aucune part d’idéographisme, deviendrait une énigme absolument inintelligible. Nous avons expliqué déjà, dans le chapitre précédent, comment dans tout idiome monosyllabique, et particulièrement en chinois, il se trouve toujours une très grande quantité de mots exactement homophones. Et nous avons indiqué par quel procédé, dans la langue parlée, on arrive à parera l’effrayante confusion résultant de ce fait. Dans l’écriture on eut recours à une combinaison presque constante de l’idéographisme et du phonétisme, qui est propre au chinois. Elle constitue ce qu’on appelle le système des clés, système analogue dans son principe à celui des déterminatifs[2] dans les hiéroglyphes égyptiens, mais dont les Chinois ont seuls fait une application aussi étendue et aussi générale, en même temps qu’ils le mettaient en oeuvre par des procédés à eux spéciaux. Le point de départ de ce système est la faculté, propre à l’écriture chinoise, de former indéfiniment des groupes complexes avec plusieurs caractères originairement distincts. Un certain nombre d’idéogrammes simples — 214 en tout — ont donc été choisis parmi ceux que comprenait le fond premier de l’écriture avant l’introduction du phonétisme, comme représentant des idées générales et pouvant servir de rubriques aux différentes classes entre lesquelles se répartiraient les mots de la langue. Et il faut noter en passant que les Chinois admettent comme idées génériques des notions qui pour nous ont bien peu ce caractère, car on trouve parmi les clés celles des grenouilles, des rats, des nez, des tortues, etc. Les idéogrammes ainsi choisis sont ce qu’on appelle les clés. Ils se combinent avec des signes originairement simples ou complexes, pris uniquement pour leur prononciation phonétique, abstraction faite de tout vestige de leur valeur idéographique, de manière à représenter toutes les syllabes de la langue. Ainsi sont formés des groupes nouveaux, à moitié phonétiques et à moitié idéographiques, dont le premier élément représente le son de la syllabe qui constitue le mot, et le second, la clé, indique dans quelle catégorie d’idées doit être cherché le sens de ce mot. Les trois quarts des signes de l’écriture chinoise doivent leur origine à ce mode de formation[3]. Un exemple en fera mieux comprendre le mécanisme. La syllabe pâ est susceptible, en chinois, de huit acceptions absolument différentes, ou, pour parler plus exactement, il y a dans le vocabulaire des habitants de l’Empire du Milieu huit mots homophones, bien que sans rapport d’origine entre eux, dont la prononciation se ramène à cette syllabe. Si donc le chinois s’écrivait au moyen d’un système exclusivement phonétique, en voyant pâ dans une phrase, l’esprit hésiterait entre huit significations différentes, sans indication déterminante qui pût décider à choisir l’une plutôt que l’autre. Mais avec le système des clés, avec la combinaison de l’élément idéographique et de l’élément phonétique, cette incertitude, cause permanente des plus fâcheuses erreurs, disparaît tout à fait. Il y a un signe adopté dans l’usage ordinaire pour représenter phonétiquement la syllabe pâ ; mais ce signe, dont la valeur idéographique primitive s’est complètement oblitérée, n’est employé isolément, comme phonétique simple, que dans les noms propres d’hommes ou de lieux. Si l’on y ajoute la clé des plantes, il devient, toujours en gardant la même prononciation, le nom du bananier ; qu’on remplace cette clé par celle des roseaux, en conservant le signe radical et phonétique, on obtient la désignation d’une sorte de roseau épineux. Avec la clé du fer, le mot pâ est caractérisé comme le nom du char de guerre ; avec la clé des vers, comme celui d’une espèce de coquillage ; avec la clé du mouton , comme celui d’une préparation particulière de viande séchée. La clé des dents lui donne le sens de dents de travers ; celle des maladies lui fait signifier cicatrices ; enfin celle de la bouche un cri. On voit, par cet exemple, combien la combinaison des éléments phonétiques et idéographiques, qui constitue le système des clés, est ingénieusement calquée sur les besoins et le génie propre de la langue chinoise, et quelle clarté elle répand dans l’expression graphique de cette langue, impossible à peindre d’une manière intelligible avec un système de phonétisme exclusif. Sans doute la faculté presque indéfinie de créer de nouveaux signes complexes, par moitié phonétiques et par moitié idéographiques, paraît dans le premier abord effrayante à un étranger, car, avec les idéogrammes simples et complexes, elle donne naissance à plus de 80.000 groupes différents. Mais il est toujours facile d’analyser ces groupes, dont les éléments se réduisent à 450 phonétiques et 214 déterminatifs idéographiques ou clés, et la méthode qui les produit était la seule par laquelle pût être évité l’inconvénient, bien autrement grave, qui serait résulté de la multiplicité des mots homophones. Mais l’identité de l’état de rébus et de l’état de syllabisme, qui confond en un seul deux des degrés ordinaires du développement de l’élément phonétique dans les écritures originairement idéographiques et hiéroglyphiques, n’était possible qu’avec une langue à la constitution monosyllabique, comme le chinois. Chez les Égyptiens et chez les Schoumers et Akkads du bas Euphrate, inventeurs de l’écriture cunéiforme, l’idiome parlé, que l’écriture devait peindre, était polysyllabique. Le système du rébus ne donnait donc pas du premier coup les moyens de décomposer les mots en leurs syllabes constitutives, et de représenter chacune de ces syllabes séparément par un signe fixe et invariable. Il fallait un pas de plus pour s’élever du rébus au syllabisme. Ce pas fut fait également dans les deux systèmes des hiéroglyphes égyptiens et de l’écriture cunéiforme ; mais les habitants de la vallée du Nil surent pousser encore plus avant et atteindre jusqu’à l’analyse de la syllabe, décomposée en consonne et voyelle, tandis que ceux du bassin de l’Euphrate et du Tigre s’arrêtèrent au syllabisme, et laissèrent leur écriture s’immobiliser dans cette méthode imparfaite de l’expression des sons. Chez les uns comme chez les autres, ce fut le système du rébus, première étape du phonétisme, qui servit de base à l’établissement des valeurs syllabiques. Tout idéogramme pouvait être employé en rébus pour représenter la prononciation complète, aussi bien polysyllabique que monosyllabique, correspondant dans la langue parlée à son sens figuratif et tropique. Voulant parvenir à la représentation distincte des syllabes de la langue au moyen de signes fixes, et par conséquent toujours reconnaissables, ce qui était surtout nécessaire pour l’expression des particules grammaticales dont l’agglutination constituait le mécanisme de la conjugaison et de la déclinaison, les Schoumers et Akkads delà Chaldée et de la Babylonie choisirent un certain nombre de caractères, primitivement idéographiques, mais devenant susceptibles d’un emploi exclusivement phonétique, par une convention qui dut s’établir graduellement plutôt qu’être le résultat du travail systématique d’un ou de plusieurs savants. Autant que possible le choix porta sur des signes dont la"prononciation comme idéogrammes formait un monosyllabe. Ainsi père se disait, dans la langue suméro-accadienne, ad, et l’idéogramme de père devint le phonétique ordinaire de la syllabe ad ; s’asseoir, résider se disait ku, et le signe qui représentait idéographiquement ce radical verbal fut le phonétique de la syllabe ku ; de même l’hiéroglyphe de l’eau devint le signe du son a et celui de la terre le signe du son ki, parce que le mot pour eau était a et pour terre ki. Mais dans d’autres cas, surtout pour former les phonétiques des syllabes fermées ou se terminant par une consonne, on prit des caractères dont la lecture comme idéogrammes était un dissyllabe, et on ramena cette lecture à un monosyllabe par la suppression de la voyelle finale. Une des lectures de l’idéogramme de dieu était ana, et on fit de ce signe l’expression phonétique de la syllabe an ; le caractère qui représentait la notion de monceau devint le syllabique isch, celui qui peignait la notion de vent le syllabique im, valeurs tirées des lectures ischi, monceau et imi, vent. C’était là le premier rudiment de la méthode que les anciens ont appelée acrologique, pour la formation de valeurs exclusivement phonétiques. Elle consiste à faire d’un signe hiéroglyphique d’idée un signe de son, en lui faisant représenter la première syllabe ou la première lettre du mot qui constituait sa prononciation la plus habituelle comme idéogramme. Ce sont surtout les Égyptiens qui ont fait un grand emploi de cette méthode acrologique. Elle a été la source des valeurs qu’ils ont assignées aux signes alphabétiques de leur écriture ; et déjà auparavant, dans un stage moins avancé du développement de cette écriture, c’est de la même façon qu’ils avaient dû déterminer l’emploi, dans la peinture des sons, des signes syllabiques que l’on continue à rencontrer en grand nombre dans les textes hiéroglyphiques, même après l’invention de l’alphabétisme. Car nous ne possédons aucun monument qui nous présente l’écriture figurative des Égyptiens à son état antérieur à cette invention. § 6. — LE SYLLABISME ET L’ALPHABÉTISME On a pu voir, par tout ce qui précède, combien fut lente à naître la conception de la consonne abstraite du son vocal qui lui sert de motion, qui donne, pour ainsi dire, la vie extérieure à l’articulation, muette par elle-même. Cette conception, qui nous semble aujourd’hui toute simple, car nous y sommes habitués dès notre enfance, ne pouvait devoir sa naissance première qu’à un développement déjà très avancé de l’analyse philosophique du langage. Aussi parmi les différents systèmes d’écriture, à l’origine hiéroglyphiques et idéographiques, que nous avons énumérés plus haut et qui se développèrent d’une manière indépendante, mais en suivant des étapes parallèles, un seul parvint jusqu’à la décomposition de la syllabe, à la distinction de l’articulation et de la voix, et à l’affectation d’un signe spécial à l’expression, indépendante de toute voyelle, de l’articulation ou consonne qui demeure muette tant qu’un son vocal ne vient pas y servir de motion. Ce système est celui des hiéroglyphes égyptiens[4]. Les autres s’arrêtèrent enroule sans atteindre au même raffinement d’analyse et au même progrès, et s’immobilisèrent ou, pour mieux dire, se cristallisèrent à l’un ou à l’autre des premiers états, de constitution et de développement du phonétisme. Cependant les inconvénients d’une notation purement syllabique des sons étaient si grands que l’on a peine à comprendre comment des peuples, aussi avancés dans la voie de la civilisation et des connaissances que l’étaient les Babyloniens et les Assyriens, ont pu s’en contenter, et n’ont pas cherché à perfectionner davantage un instrument de transmission et de fixation de la pensée demeuré tellement grossier encore et si souvent rebelle. Le moindre inconvénient du syllabisme était le nombre de caractères qu’il demandait pour exprimer toutes les combinaisons que la langue admettait par l’union des articulations et des sons vocaux, soit dans les syllabes composées d’une consonne initiale et d’une voyelle, ou d’une diphtongue venant après pour permettre de l’articuler, soit dans celles où la voyelle ou la diphtongue est initiale et la consonne finale. L’esprit et la mémoire de celui qui apprenait à écrire devait donc, là où la peinture des sons s’était arrêtée à l’état du syllabisme, se charger — en dehors de la notion des idéogrammes les plus usuels, car les écritures primitives qui nous occupent, en admettant l’élément phonétique, n’avaient point pour cela répudié l’idéographisme — se charger de la connaissance de plusieurs centaines de signes purement phonétiques, représentant chacun une syllabe différente dans l’usage le plus ordinaire. Delà une gêne très grande, un obstacle à la diffusion générale de l’art d’écrire, qui restait forcément un arcane restreint aux mains d’un petit nombre d’initiés, car, tant que l’écriture est tellement compliquée qu’elle constitue à elle seule une vaste science, elle ne saurait pénétrer dans la masse et devenir d’un usage vulgaire. L’inconvénient de complication, de défaut de clarté, de surcharge trop grande pour la mémoire, était le même, quelle que fût la famille et là nature de la langue à l’expression graphique de laquelle s’appliquait le système du syllabisme. Mais il n’était encore rien à côté des inconvénients nouveaux et tout particuliers auxquels donnait naissance l’application de ce système aux idiomes de certaines familles, dans lesquelles les voyelles ont un caractère vague, une prononciation peu précise, et où toutes les flexions se marquent par le changement des sons vocaux dans l’intérieur du mot, tandis que la charpente des consonnes reste invariable. Je veux parler des langues sémitiques et de leurs congénères les langues ‘hamitiques, à commencer par l’égyptien. Les inscriptions assyriennes nous montrent un idiome sémitique tracé avec une écriture dont tout le phonétisme est syllabique. Quelle bigarrure ! Quelle bizarre et perpétuelle contradiction entre le génie de la langue et le génie du système graphique ! Avec cette méthode on ne saurait parvenir à exprimer aucun radical de la langue, assyrienne, puisque ces radicaux se composent précisément, comme dans toutes les langues sémitiques, de la charpente, généralement trilitère, des consonnes, qui demeurent immuables, tandis que les voyelles se modifient. Pour exprimer le verbe et le substantif d’un même radical, il faut employer dés caractères absolument différents, puisque la vocalisation n’est plus la même et que, dès lors, son changement entraîne celui des signes syllabiques. Ainsi disparaît toute parenté extérieure, toute analogie apparente entre les mots sortis de la même racine. Celui qui aborde la lecture d’un texte cunéiforme assyrien, au lieu de discerner aussitôt du regard ces radicaux que tous les changements de voyelles el les additions de suffixes et de préfixes, n’empêchent pas de reconnaître intacts et invariables, et qui restent toujours eux-mêmes, n’a plus aucun des guides qui dirigent sa marche dans les autres idiomes sémitiques. Chaque voix, chaque mode, chaque temps, dans- la conjugaison des verbes, amenant une modification des voyelles, nécessite aussi le changement des caractères syllabiques employés à peindre la prononciation, de telle manière qu’à chaque fois c’est un mot nouveau, sans aucune analogie dans l’aspect et dans les signes mis en œuvre avec ceux qui expriment les autres voix, les autres modes, les autres temps du même verbe. Jamais système graphique n’a présenté une antinomie plus absolue avec l’essence et le génie de la langue qu’il était appelé à tracer, que le cunéiforme assyrien. Jamais les inconvénients inhérents au syllabisme n’ont été poussés jusqu’à un degré aussi extrême et ne se sont manifestés aux regards d’une manière aussi frappante dans la confusion et la presque inextricable complication à laquelle ils donnaient naissance. C’était un peuple dans la langue duquel les sons vocaux avaient un caractère essentiellement vague qui devait, comme l’a judicieusement remarqué M. Lepsius, abstraire le premier la consonne de la syllabe, et donner une notation distincte à l’articulation et à la voyelle. Le génie, même d’un idiome ainsi organisé conduisait naturellement à ce progrès capital dans l’analyse du langage. La voyelle, variable de sa nature, tendait à devenir graduellement indifférente dans la lecture des signes originairement syllabiques ; à force d’altérer les voyelles dans la prononciation des : mêmes syllabes, écrites par tel ou tel signe simple,, la consonne seule restait à la fin fixe, ce qui amenait le caractère adopté dans un usage purement phonétique à devenir alphabétique, de syllabique qu’il avait été d’abord ; ainsi, un certain nombre de signes qui avaient commencé par représenter des syllabes distinctes, dont l’articulation initiale était la même, mais suivie de voyelles différentes ayant fini par ne plus peindre que cette articulation du début, devenaient des lettres proprement dites exactement homophones. Telle est la marche que le raisonnement permet de reconstituer pour le passage du syllabisme à l’alphabétisme, pour le progrès d’analyse qui permit de discerner et de noter séparément l’articulation ou consonne qui, dans chaque série de syllabes, reste la même, quelque soit le son vocal qui lui sert de motion. Et ici, les faits viennent confirmer pleinement ce qu’indiquaient le raisonnement et la logique. Il est incontestable que le premier peuple qui posséda des lettres proprement dites au lieu de signes syllabiques, fut les Égyptiens. Or, dans la langue égyptienne, les voyelles étaient essentiellement vagues. Ce qui prouve, du reste, que ce fut cette nature des sons vocaux dans certains idiomes qui conduisit à la décomposition de la syllabe et à la substitution de lettres alphabétiques aux caractères syllabiques de l’âge précédent, est ce fait qu’en Égypte et chez les peuples sémitiques qui, les premiers après les Égyptiens, employèrent le système de l’alphabétisme, encore perfectionné, le premier résultat de la substitution des lettres proprement dites aux signes de syllabes fut la suppression de toute notation des voyelles intérieures des mots, celles de toutes qui étaient, de leur nature, les plus vagues et les plus variables, celles qui, en réalité, ne jouaient qu’un rôle complémentaire dans les syllabes dont la partie essentielle était l’articulation initiale. On n’écrivit, plus que la charpente stable et fixe des consonnes, sans tenir compte des changements de voyelles, comme si chaque signe de consonne avait été considéré comme ayant inhérent à lui un son vocal variable. On choisit bien quelques signes pour la représentation des voyelles, mais on ne s’en servit que dans l’expression des voyelles initiales ou finales, qui, en effet, ont une intensité et une fixité toute particulière, qui ne sont pas complémentaires mais constituent à elles seules une syllabe, qui, par conséquent, sont moins des voyelles proprement dites que des aspirations légères auxquelles un son vocal est inhérent. Ce fut seulement lorsque l’alphabet phénicien fut adopté par des peuples de race aryenne, tels que les Grecs, et appliqué à l’expression d’idiomes où les voyelles avaient un rôle radical, fixe et essentiel, que l’on choisit un certain nombre de ces signes des aspirations légères finales ou initiales pour en faire la représentation des sons vocaux de l’intérieur des mots. Les hiéroglyphes égyptiens ont conservé jusqu’au dernier jour de leur emploi lés vestiges de tous les états qu’ils avaient traversés, depuis l’idéographisme exclusif de leur origine jusqu’à l’admission de l’alphabétisme dans leur partie phonétique. Mais, aussi haut que nous fassent remonter les monuments écrits de là vallée du Nil, dès le temps de la IIIe et peut-être de la IIe dynastie, les inscriptions nous font voir ce dernier progrès accompli. Les signes de syllabes ne sont plus qu’en minorité parmi les phonétiques,’dont la plupart sont déjà de véritables lettres, qui peignent les articulations indépendamment de toutes les variations du son vocal qui vient s’y joindre. Les lettres de l’écriture égyptienne sont des figures hiéroglyphiques, au tracé plus ou moins altéré dans les tachygraphies successives de l’hiératique et du démotique, dont la valeur alphabétique a été établie en vertu du système acrologique. Chacune de ces figures représente la consonne ou la voyelle initiale de la prononciation de sa signification première d’idéogramme, soit figuratif, soit tropique, mais principalement du mot auquel, prise dans le sens figuratif, elle correspondait dans la langue parlée. Ainsi, parmi les phonétiques de l’usage le plus constant, nous voyons le son vocal vague flottant entre a et o, représenté par un roseau, dont le nom s’est conservé en copte sous la forme ake ou oke, ou par un aigle, ahom ; l’articulation m par une chouette, mouladj ; r par une bouche, rô ; ‘h par une corde tressée, ‘haghe ; kh par un crible, khai ; sch par un réservoir, schêi, ou par un jardin de papyrus, schnê. De ce principe acrologique de la formation des valeurs alphabétiques données à certains signes, résulte un fait particulier à l’écriture égyptienne. C’est que tout signe figuratif ou symbolique peut être pris phonétiquement dans le rôle d’initiale du mot exprimant sa signification idéographique, dans la langue parlée. Mais l’usage indifférent de tous lès signes comme de simples lettres, dans tous les cas. et dans toutes les positions, eût produit dans les textes une confusion sans bornes par la multiplication indéfinie des homophones. Aussi est-ce seulement à l’époque romaine, et dans la transcription des noms des empereurs, que nous voyons les hiérogrammates, par un raffinement de décadence et par une prétention d’élégance graphique, qui n’est que de la barbarie, employer jusqu’à quinze ou vingt signes différents pour peindre la même articulation, en dépouillant ces signes de toute valeur idéographique. Dans l’Égypte pharaonique, la plupart des caractères ainsi devenus de simples phonétiques sous la domination romaine n’ont encore qu’un emploi mixte, symbolico-phonétique, et ne revêtent une valeur de lettres qu’en initiales du mot de leur signification idéographique. Une convention rigoureusement observée, et dont l’établissement dut être graduel, limite à un petit nombre, deux ou trois au plus pour chaque articulation, les phonétiques d’un emploi constant et indifférent. § 7. — LA POLYPHONIE DANS LES ÉCRITURES D’ORIGINE HIÉROGLYPHIQUE. Tel est l’état où, de progrès en progrès, nous voyons parvenue celle de toutes les écritures hiéroglyphiques primitives de l’ancien monde qui atteignit au plus haut degré de perfectionnement, la seule qui s’éleva jusqu’à l’analyse de la syllabe et à la conception de la lettre alphabétique, l’écriture égyptienne. Avant tout, un mélange d’idéogrammes et de phonétiques, de signes figuratifs, symboliques, syllabiques, alphabétiques. En même temps, faculté pour tous les signes figuratifs ou symboliques de prendre une valeur phonétique accidentelle, comme initiales de certains mots, et, d’un autre côté, possibilité d’employer idéographiquement, dans un sens figuratif ou dans un sens tropique, les signes les plus habituellement affectés à la pure et simple peinture des sons indépendamment de toute idée. Tels sont les faits que l’écriture hiéroglyphique égyptienne présente à celui qui veut analyser sa constitution et son génie. Elle constitue, sans contredit, le plus perfectionné des systèmes d’écriture primitifs qui commencèrent par le pur idéographisme : mais combien ce système est encore grossier, confus et imparfait ! Que d’obscurités et d’incertitudes dans la lecture, qui, moins grandes pour les Égyptiens que pour nous, devaient cependant encore se présenter plus d’une fois pour eux-mêmes ! Quelle extrême complication ! Sans doute, les hiéroglyphes n’étaient pas, comme on l’a cru trop longtemps d’après une mauvaise interprétation des témoignages des Grecs et des Romains, un mystère sacerdotal révélé seulement à quelques adeptes choisis ; c’était l’écriture dont on se servait pour tous les usages où l’on a besoin d’écrire, en se bornant’ à abréger le tracé des caractères dans ses tachygraphies. Mais il est bien évident que, sans que les prêtres eussent besoin d’en faire un mystère, un système d’écriture aussi compliqué, dont la connaissance demandait un aussi long apprentissage, ne pouvait être très répandu dans la masse du peuple ; aussi, dans l’Égypte antique, par suite de la nature même du système graphique et non par volonté d’en faire un arcane impénétrable à la masse, les gens qui savaient lire et écrire, les scribes religieux ou civils, formèrent une sorte de classe à part et un groupe restreint dans la nation. Encore n’avons-nous pas parlé, jusqu’à présent, de là plus grande cause de difficultés et d’incertitudes dans toutes les écritures qui conservent une part d’idéographisme, la polyphonie. Pour définir ce fait et en faire bien comprendre l’origine, nous prendrons nos exemples dans les hiéroglyphes égyptiens. Nombre de signes hiéroglyphiques sont susceptibles d’être employés également avec une valeur figurative et une valeur tropique. Rien de plus simple et de plus naturel avec l’indépendance absolue de la langue graphique et de la langue parlée dans le système originaire de l’idéographisme pur. Mais clans la langue parlée les deux significations, figurative et symbolique, du même caractère, étaient représentées par deux mots différents. De là vint que, dans- l’établissement de la convention générale qui finit par attacher à chaque signe de la langue graphique un mot de la langue parlée pour sa lecture prononcée, le caractère ainsi doué de deux significations diverses, suivant qu’on le prenait figurativement ou tropiquement, peignit deux mots de la langue et eut par conséquent deux prononciations, souvent entièrement dissemblables, entre lesquelles le lecteur choisissait d’après la marche générale de la phrase, la position du signe et l’ensemble de ce qui l’entourait. Ainsi l’image du disque solaire s’emploie figurativement pour signifier a soleil, » et symboliquement, par une métonymie toute naturelle et bien simple, pour rendre l’idée de jour ; mais dans le premier cas, il a pour correspondant dans l’idiome parlé le mot râ, dans le second le mot hrou ; il est donc susceptible de deux prononciations ; il est polyphone. Mais là rie s’arrête pas le phénomène de la polyphonie. Le symbole, le trope graphique est proprement le mot de cette langue écrite qui, primitivement, lorsqu’elle ne peignait encore que des idées, était absolument indépendante de la langue parlée. Aussi l’on se tromperait si l’on croyait que sa signification est unique, fixe et invariable. Ses acceptions peuvent s’étendre autant que celles d’un mot de la langue parlée, et en vertu des mêmes analogies. Mais par suite de l’indépendance originaire de la langue écrite par rapport à la langue parlée, il est arrivé plus d’une fois que l’extension des sens d’un même symbole , a englobé des idées que des mots absolument divers représentaient dans l’idiome oral. Donc le symbole, suivant ses différents emplois, ses différentes acceptions, s’est lu encore de manières diverses et a eu des prononciations variées. Il y avait là une cause sérieuse d’erreurs et de confusions. Pour y parer autant que possible, pour augmenter la clarté des textes, on inventa ce que les savants ont appelé les compléments phonétiques. On joignit au symbole, susceptible de plusieurs acceptions ou de plusieurs lectures prononcées, tout ou partie des signes phonétiques habituels représentant la manière dont il devait être prononcé dans le cas présent — le plus souvent la fin du mot — de manière que Terreur ne fut plus possible. Ainsi, la figure d’une sorte de bande de métal, repliée plusieurs fois sur elle-même, correspondait aux trois idées de pli, d’entourer, circuler, et de livre pondérale, et, suivant ces trois significations, était lu par trois mots différents de la langue, keb, rer et ten ; et pour qu’on ne se méprît ni sur le sens, ni sur le mot, on y joignait fréquemment, suivant les cas, les compléments phonétiques b, r ou n. Mais dès lors, en réalité, l’idéogramme, susceptible de plusieurs sens, suivi de compléments phonétiques, devint un signe mixte, symbolico-phonétique, capable de représenter dans le rôle d’initiale plusieurs syllabes et plusieurs articulations diverses. De là à faire d’un caractère hiéroglyphique un polyphone purement phonétique, à lui faire représenter, abstraction faite de toute signification d’idéogramme, plusieurs valeurs de sons, il n’y avait qu’un pas. Et c’est ainsi que, sans compléments phonétiques, on trouve dans des textes pharaoniques l’image d’une oreille de veau exprimant indifféremment les syllabes et les combinaisons de syllabes ad, ankh, mest’er, sem, sedem, aten, ou la jambe humaine se lisant pat, vet, men, et ouar. Ces valeurs syllabiques polyphones, devenues d’un emploi indifférent et sans rapport avec aucune idée symbolique, n’empêchent pas quelquefois les caractères dé pouvoir être encore lus par des mots d’une prononciation toute différente, quand ils sont mis en œuvre comme idéogrammes. Ainsi la tête humaine, prise phonétiquement, représente les syllabes tep, ha et her, et de plus, comme idéogramme figuratif de tête, elle répond aux mots t’et et ap. A la décadence, sous la domination romaine, les exemples de polyphonie purement phonétique deviennent plus nombreux, avec la recherche qui, pour chaque lettre, fait multiplier indéfiniment les homophones. Ainsi les cartouches contenant les noms des empereurs romains nous montrent la figure du « bélier » employée tantôt comme uns, parce que mouton se disait soï, tantôt comme un v, parce que cette figure était le symbole de l’idée d’âme, vaï. Cet exemple est du reste, le seul où la polyphonie s’applique chez les Égyptiens à des valeurs alphabétiques ; mais pour ce qui est des valeurs syllabiques, le fait en question prend des développements inouïs à la basse époque, sous les Ptolémées et les empereurs romains ; le mauvais goût des scribes de décadence en multiplie les exemples à l’infini ; il envahit complètement les textes et y devient une cause de très grandes obscurités. Chez les Assyro-Babyloniens de langue sémitique nous retrouvons exactement les deux mêmes faits : 1° L’emploi des idéogrammes avec un complément phonétique, qui détermine, parmi les prononciations et les sens dont chacun est susceptible, celui qui doit être adopté dans le cas spécial, et qui transforme ainsi ces idéogrammes en phonético-symboliques polyphones dans le rôle d’initiales ; 2° La polyphonie syllabique appliquée à des signes qui remplissent dans l’usage le rôle de phonétiques indifférents pour des valeurs absolument diverses. Seulement les deux faits qui étaient dans un étroit rapport l’un avec l’autre et qu’on pouvait voir s’enfanter mutuellement dans l’écriture hiéroglyphique égyptienne — ce qui nous a conduit à en chercher la théorie dans cette écriture — se montrent indépendants et séparés dans l’écriture cunéiforme appliquée à la langue assyrienne. La raison en est facile à comprendre. En Égypte c’est chez le même peuple, et pour ainsi dire dans l’intérieur du même idiome, que se sont opérées toutes les évolutions successives dont nous avons cherché à suivre la trace, et qui ont conduit l’écriture d’une simple peinture d’idées, entièrement distincte de la langue parlée ; à la peinture des sons de cette langue. Pour ce qui est du cunéiforme ânarien, au contraire, il a été inventé par un peuple d’une toute autre race que les Assyriens, et c’est entre les mains de ce peuple qu’il est parvenu, par des progrès successifs, jusqu’à un svllabisme affecté de polyphonie dans une certaine mesure. C’est à cet état qu’il a été adopté par les Assyro-Babyloniens de langage sémitique, lesquels ont emprunté simultanément aux inventeurs suméro-aceadiens les valeurs phonétiques et les valeurs idéographiques des signes, entre lesquelles l’adaptation à une nouvelle langue, d’une famille toute différente, produisait un divorce complet. Non seulement, dans ce passage de l’écriture cunéiforme de l’usage d’une langue à celui d’une autre, chaque caractère a gardé simultanément sa valeur de phonétique, quand il en avait une, et ses significations, idéographiques, qui se sont lues désormais par des mots absolument autres que ceux qui exprimaient les mêmes notions dans l’idiome des inventeurs du système graphique en question : le signe, par exemple, qui était devenu le phonétique indifférent de la syllabe ad, at, parce qu’il était l’idéogramme de père, ad en accadien, gardant cette valeur phonétique et se lisant désormais abou en assyrien, dans son acception idéographique ; mais encore toutes les lectures attachées en accadien aux significations d’un même caractère, pourvu qu’elles fussent monosyllabiques, et même quelquefois quand elles étaient dissyllabiques, sont devenues, dans l’usage des textes assyriens sémitiques, des valeurs purement phonétiques. Ainsi un signe de l’écriture était chez les Schoumers et les Akkads l’idéogramme des notions de couper, trancher, décider, lu comme tel tar et gas, poser, fixer, koud, enfin chemin, sila ; dans l’usage assyrien il devient le phonétique indifférent des syllabes composées tar, ‘has, koud, kout, qout, sil, schil, et en même temps il garde toujours ses significations idéographiques, qui se lisent désormais nakasou, couper, trancher, dânou, décider, juger, schâmou, poser, fixer, et soûqou, rue, chemin. Un autre était l’idéogramme de mouton, lou, et du verbe prendre, dib ; en outre, il était devenu, d’après la première de ces deux acceptions, le phonétique ordinaire de la syllabe lou ; dans les textes assyriens il est celui de lou et de dib, et en même temps il garde les sens de mouton, auquel correspondent désormais les lectures çinou et immerou, puis de prendre, qui se lit en assyrien par les verbes çabatou et kâmou. Et ce n’est pas tout. Après avoir adopté comme valeurs purement phonétiques toutes les lectures accadiennes des signes qui rentraient dans certaines conditions de forme, les Assyriens sémites ont aussi formé quelques valeurs phonétiques nouvelles, et à eux propres, d’après les mots qui, dans leur langue, servaient de lecture aux caractères pris dans le rôle d’idéogrammes. Par exemple, il est un caractère cunéiforme qui a la signification idéographique de tête ; le mot qui exprime cette notion en accadien est schak ; celui qui l’exprime en assyrien est rischou. Le caractère dont nous parlons devient le phonétique indifférent des deux syllabes schak et risch, valeurs dont la première est d’origine accadienne et la seconde d’origine assyrienne sémitique. C’est de cette façon que la polyphonie phonétique prend dans l’écriture cunéiforme, et spécialement dans l’usage, des textes assyriens, un développement inconnu chez tout autre peuple ; à tel point qu’on y trouve certains signes qui, indépendamment de leurs lectures d’idéogrammes, sont susceptibles de représenter jusqu’à dix ou douze valeurs différentes comme signes de syllabes servant uniquement à la peinture des sons. § 8. — L’INVENTION DE L’ALPHABET. Même après que les Égyptiens furent parvenus à l’analyse de la syllabe et à l’abstraction de la consonne, il restait un pas énorme à franchir, un progrès capital à consommer, pour que l’écriture parvînt au degré de simplicité et de clarté qui pouvait seul la mettre en état de remplir dignement et complètement sa haute destination. Répudier toute trace d’idéographisme, supprimer également les valeurs syllabiques, ne plus peindre que les sons au moyen de l’alphabétisme pur, enfin réduire les phonétiques à un seul signe invariable pour chaque articulation de l’organe, tel était le progrès qui devait donner naissance à l’alphabet, consommer l’union intime de l’écriture avec la parole, émanciper définitivement l’esprit humain des langes du symbolisme primitif et lui permettre de prendre librement son essor, en lui donnant un instrument digne de lui, d’une clarté, d’une souplesse et d’une commodité parfaites. Ce progrès pouvait seul permettre à l’art d’écrire de pénétrer dans les masses populaires, en mettant fin à toutes les complications qui en avaient fait jusqu’alors une science abstruse et difficilement accessible, et de se communiquer chez tous les peuples, en faisant de l’écriture un instrument applicable également bien à tous les idiomes et à toutes les idées. L’invention de l’alphabet proprement dit ne pouvait prendre naissance chez aucun des peuples qui avaient créé les systèmes primitifs d’écriture débutant par des figures hiéroglyphiques avec leur idéographisme originaire, même chez celui qui était parvenu jusqu’à l’analyse de là syllabe et à l’abstraction de la consonne. Elle devait être nécessairement l’œuvre d’un autre peuple, instruit par lui. En effet, les peuples instituteurs des écritures originairement idéographiques avaient bien pu, poussés par les besoins impérieux qui naissaient du développement de leurs idées et de leurs connaissances, introduire l’élément phonétique dans leurs écritures, donner progressivement une plus grande importance et une plus grande extension à son emploi, enfin porter l’organisme d&cet élément à un très haut degré de perfection. Mais des obstacles invincibles s’opposaient à ce qu’ils fissent le dernier pas et le plus décisif, à ce qu’ils transformassent leur écriture eu une peinture exclusive des sons, en répudiant d’une manière absolue toute trace d’idéographisme. Le principal venait de la religion. Toutes les écritures, primitives, par suite de leur nature symbolique et de leur génie, avaient un caractère essentiellement religieux et sacré. Elles étaient nées sous l’égide du sacerdoce, inspirées par son esprit de symbolisme. Dans la première aurore de la civilisation des peuples primitifs, l’invention de l’art d’écrire avait paru quelque chose de si merveilleux que le vulgaire n’avait pas pu la concevoir autrement que comme un présent des dieux. Bouleverser de fond en comble la constitution d’une écriture ainsi consacrée par la superstition religieuse, lui enlever toute la part de symbolisme sur laquelle se fondait principalement son caractère sacro-saint, était une entreprise énorme et réellement impossible chez le peuple même où l’écriture avait reçu une sanction si haute, car c’eut été porter une atteinte directe à la religion. La révolution ne pouvait donc s’accomplir qu’à la suite d’un changement radical dans l’ordre religieux, comme il arriva par suite des prédications du christianisme, dont les apôtres déracinèrent chez beaucoup de peuples (en Égypte, par exemple) les anciens systèmes d’écritures, à l’essence desquels s’attachaient des idées de paganisme et de superstition ; ou bien par les mains d’un peuple nouveau, pour lequel le système graphique reçu du peuple plus anciennement civilisé ne pouvait avoir le même caractère sacré ; qui, par conséquent, devait être porté à lui faire subir le changement décisif au moyen duquel il s’appliquerait mieux à son idiome ; en devenant d’un usage plus commode. Ainsi ce ne sont pas les Chinois eux-mêmes qui ont amené leur écriture au pur phonétisme, et qui, rejetant tout vestige d’idéographisme, ont tiré de ses éléments un syllabaire restreint et invariable, avec un seul signe pour chaque valeur. Ce sont les Japonais qui ont emprunté aux types kiài et thsào de l’écriture mixte du Céleste Empire leurs syllabaires kata-kana et fira-kana, en abrégeant le tracé de certains signes pour les rendre plus faciles à écrire, et en modifiant légèrement celui de certains autres pour éviter les confusions qui auraient pu résulter de formes analogues. Les Assyriens, non plus, ne dégagèrent pas l’élément syllabique de l’écriture cunéiforme ; dans leur usage national il demeura toujours amalgamé aune proportion égale d’élément idéographique. Mais quand les habitants indigènes de la Susiane et la population de la Médie anté-aryenne, qui leur était étroitement apparentée, adoptèrent celle écriture à l’exemple des Assyriens, et d’après leurs enseignements, ils ne gardèrent qu’un nombre imperceptible d’idéogrammes et rendirent l’écriture presque exclusivement phonétique. Puis les Perses, à leur tour, tirèrent du syllabaire élamite et médique les éléments d’un véritable alphabet, auquel ils ne laissèrent associée qu’une si petite proportion de caractères idéographiques que, jusqu’à présent, on n’en a pas relevé plus de trois dans les inscriptions perses connues. Les Grecs de Cypre, dès une époque très ancienne et avant que les autres Hellènes eussent reçu l’alphabet des Phéniciens, empruntèrent au plus ancien type de l’écriture cunéiforme ou aux hiéroglyphes ‘hittites (ceci n’est pas encore complètement éclairci), mais dans tous lés cas à une écriture antérieure où l’idéographisme et le phonétisme étaient mélangés, les éléments d’un syllabaire purement phonétique qui resta désormais leur système graphique national. De même, les Égyptiens, après être parvenus jusqu’à la conception de l’alphabétisme, ne franchirent point le dernier pas et ne surent point en tirer l’invention de l’alphabet proprement dit. Ils laissèrent à un autre peuple la gloire de cette grande révolution, si féconde en résultats et si heureuse pour les progrès de l’esprit humain. Mais tous les peuples n’étaient pas à même de consommer l’invention de l’alphabet. Il fallait pour tirer ce dernier et suprême corollaire des progrès consommés par les Égyptiens, une réunion toute spéciale de conditions. Avant tout, il fallait un peuple qui, par sa situation géographique, touchât à l’Égypte et eût été soumis à une profonde influence de la civilisation florissant sur les bords du Nil. C’est, en effet, seulement dans cette condition qu’il pouvait prendre pour point de départ la découverte de la décomposition de la syllabe, base indispensable du progrès dernier qui devait consister à bannir de l’écriture tout élément idéographique, à assigner un seul signe à la représentation de chaque articulation, enfin de cette manière à constituer pour la première fois un alphabet proprement dit. Mais il fallait aussi d’autres conditions dans les instincts et le génie de la nation. Le peuple appelé ainsi à donner à l’écriture humaine sa forme définitive devait être un peuple commerçant et pratique par essence, un peuple chez lequel le négoce fut la grande affaire de la vie, un peuple qui eût à tenir beaucoup de comptes courants et de livres en partie double. C’est, en effet, dans les transactions commerciales que la nature même des choses devait nécessairement faire le plus et le plus tôt sentir les inconvénients, signalés par nous tout à l’heure, du mélange de l’idéographisme, ainsi que de la facilité de multiplier les homophones pour la même articulation, et conduire à chercher un perfectionnement de l’écriture dans sa simplification, en la réduisant à une peinture des sons au moyen de signes invariables et en petit nombre. De plus, l’invention ne pouvait être consommée que par un peuple qui, s’il avait été soumis à une très forte influence égyptienne, professât pourtant une autre religion que celle des bords du Nil, et dont le génie fût en même temps singulièrement positiviste. Tel est le génie des Japonais, en même temps que leurs conditions de situation géographique et de soumission à l’influence par rapport à la Chine, sont exactement celles où nous venons de dire qu’avait dû se trouver par rapport à l’Égypte le peuple à qui fut due enfin l’invention de l’alphabet. Aussi sont-ce les Japonais qui ont réduit l’écriture symbolico-phonétique des Chinois à un pur syllabaire de quarante-sept caractères. Dans le monde ancien, il n’y a eu qu’un seul peuple qui ait rempli à la fois toutes les conditions que nous venons d’énumérer, ce furent les Phéniciens. Et, en effet, le témoignage unanime de l’antiquité s’accorde à attribuer aux Kenânéens maritimes la gloire du dernier et du plus fécond progrès de l’art d’écrire. Tout le monde connaît les vers de Lucain à ce sujet : Phoenices
primi, famae si creditur, aussi Mansuram
rudibus vocem signare figuris. Nondum
flumineas Memphis contexere biblos Noverat
; et saxis tantum volucresque feraeque Sculptaque servabant magicas animalia Jinguas. Et ici les témoignages littéraires sont pleinement confirmés par les découvertes de la science moderne. Nous ne connaissons aucun alphabet proprement dit antérieur à celui des Phéniciens, et tous ceux dont il existe des monuments, ou qui se sont conservés en usage jusqu’à nos jours, procèdent plus ou moins directement du premier alphabet, combiné par les fils de Kenâ’an et répandu par eux sur la surface du monde entier. Nous reviendrons sur la question de l’alphabet phénicien, de son invention et de sa propagation, dans le livre de la présente histoire qui sera spécialement consacré à ce peuple. Nous étudierons alors comment les Kenânéens ont puisé parmi les phonétiques de l’écriture égyptienne dans son type hiératique, les vingt-deux lettres dont ils firent leur alphabet. Nous montrerons comment, sauf le cunéiforme perse, tous les alphabets de l’univers procèdent de l’invention unique dont le foyer fut en Phénicie ; nous établirons les différents courants de dérivation qui répandirent dans les directions les plus opposées l’usage de l’écriture purement alphabétique, et nous esquisserons alors la distribution et les caractères distinctifs des diverses familles d’écritures sorties de cette source, car il y en a d’aussi nettement délimitées que les familles de langues. Ici tous ces renseignements seraient moins bien à leur place. Nous avons voulu seulement y compléter l’ensemble des notions d’un caractère général, qui étaient indispensables à placer comme une sorte d’introduction en tète de nos récits d’histoire, en résumant, après avoir parlé des races et des langues, les phases originaires de l’art d’écrire jusqu’au moment où il atteignit à la perfection par l’invention de l’alphabet. C’était, d’ailleurs, comme le dernier chapitre de notre étude des origines de la civilisation. Celle-ci nous apparaîtra désormais constituée, au milieu de la pleine lumière de l’histoire, dans les annales des grandes nations de l’Orient antique, qui, désormais, rempliront les livres suivants de notre ouvrage. FIN DU TOME PREMIER |
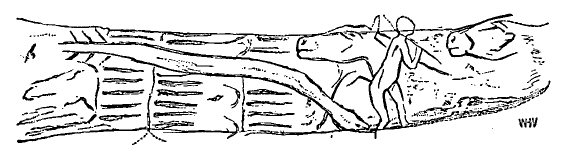
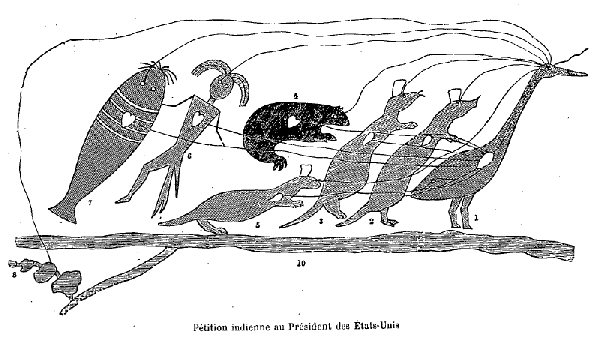
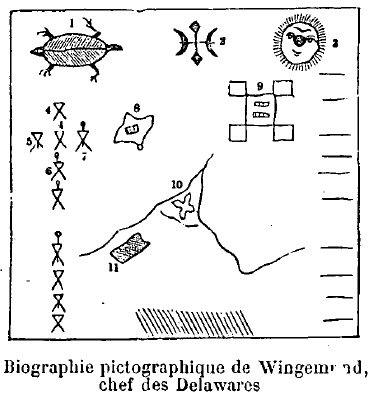 Le document pictographique que nous
reproduisons ici, contient la biographie de Wingemund, fameux chef des
Delawares. La figure n° 1 dénote qu’il appartenait à la plus ancienne tribu
de cette natioivqui a la tortue pour symbole ; 2 est son totem personnel ; en
3, le soleil et les dix lignes tracées au-dessous indiquent dix expéditions
guerrières auxquelles il a pris part. Les figures à la gauche du dessin
indiquent les résultats qu’il a obtenus dans chacune de ses expéditions ; les
hommes, 5 et 7, y sont distingués des femmes, 4 et 6 ; les prisonniers qu’il
a emmenés vivants sont pourvus d’une tête, 6 et 7 ; les ennemis qu’il a tués
n’ont plus de tête, 4 et 5. Les figures au centre représentent trois forts
qu’il a attaqués : 8, un fort sur le lac Krié ; 9, le fort de Détroit ; 10,
le fort Pitt, au confluent de l’Alleghany et du Monongahela. Les lignes
penchées notent le nombre de guerriers auxquels commandait Wingemund.
Le document pictographique que nous
reproduisons ici, contient la biographie de Wingemund, fameux chef des
Delawares. La figure n° 1 dénote qu’il appartenait à la plus ancienne tribu
de cette natioivqui a la tortue pour symbole ; 2 est son totem personnel ; en
3, le soleil et les dix lignes tracées au-dessous indiquent dix expéditions
guerrières auxquelles il a pris part. Les figures à la gauche du dessin
indiquent les résultats qu’il a obtenus dans chacune de ses expéditions ; les
hommes, 5 et 7, y sont distingués des femmes, 4 et 6 ; les prisonniers qu’il
a emmenés vivants sont pourvus d’une tête, 6 et 7 ; les ennemis qu’il a tués
n’ont plus de tête, 4 et 5. Les figures au centre représentent trois forts
qu’il a attaqués : 8, un fort sur le lac Krié ; 9, le fort de Détroit ; 10,
le fort Pitt, au confluent de l’Alleghany et du Monongahela. Les lignes
penchées notent le nombre de guerriers auxquels commandait Wingemund.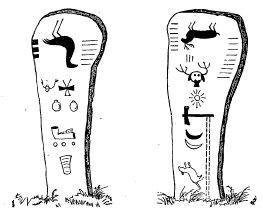 Enfin nous donnons encore la représentation
de deux de ces planches décorées de symboles (adjedatig) que l’on
dresse comme des stèles sur la tombe des personnages considérables. Toutes
deux sont celles de chefs renommés, enterrés sur les bords du lac Supérieur.
On ne connaît pas exactement l’interprétation de toutes les figures qu’elles
portent. Notons cependant que le totem du clan du chef, la grue pour l’un et
le renne pour l’autre, est placé à la partie supérieure de l’une et de
l’autre planche, et que sa position renversée dénote la mort. Les marques numérales,
accompagnant le totem, veulent dire que le premier des guerriers, celui à la
grue, a pris part à trois traités de paix (marques de gauche) et à six
batailles (marques de droite), que le second, celui au renne, a commandé sept
expéditions (marques de gauche) et figuré dans neuf batailles (marques de
droite). En outre, pour ce dernier, les trois traits verticaux au-dessous de
son totem rappellent trois blessures reçues à l’ennemi, et la tête d’élan un
combat terrible qu’il soutint contre un animal de cette espèce.
Enfin nous donnons encore la représentation
de deux de ces planches décorées de symboles (adjedatig) que l’on
dresse comme des stèles sur la tombe des personnages considérables. Toutes
deux sont celles de chefs renommés, enterrés sur les bords du lac Supérieur.
On ne connaît pas exactement l’interprétation de toutes les figures qu’elles
portent. Notons cependant que le totem du clan du chef, la grue pour l’un et
le renne pour l’autre, est placé à la partie supérieure de l’une et de
l’autre planche, et que sa position renversée dénote la mort. Les marques numérales,
accompagnant le totem, veulent dire que le premier des guerriers, celui à la
grue, a pris part à trois traités de paix (marques de gauche) et à six
batailles (marques de droite), que le second, celui au renne, a commandé sept
expéditions (marques de gauche) et figuré dans neuf batailles (marques de
droite). En outre, pour ce dernier, les trois traits verticaux au-dessous de
son totem rappellent trois blessures reçues à l’ennemi, et la tête d’élan un
combat terrible qu’il soutint contre un animal de cette espèce.