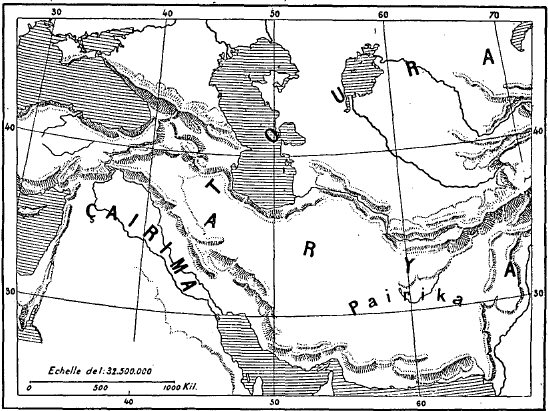Les origines, les races et les langues
LIVRE
II — LES RACES ET LES LANGUES
CHAPITRE PREMIER — LES RACES HUMAINES[1]
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
§ 1. — L’UNITÉ DE L’ESPÈCE HUMAINE ET SES VARIATIONS. La tradition sacrée nous enseigne que l’humanité tout entière, dans ses races les plus diverses, descend d’un seul couple primordial. A la parole divine seule il appartenait de prononcer d’une manière affirmative et précise sur cette question capitale au point de vue religieux, comme au point de vue philosophique, car elle intéresse le dogme fondamental du christianisme, celui de la rédemption. La science humaine ne saurait en pareille matière avoir des affirmations aussi absolues, qui échappent à ses recherches. Elle ne peut remonter que par induction au couple primordial ; le résultat qu’il est donné à ses investigations d’atteindre est la démonstration de ce fait que toutes les variétés de races d’hommes appartiennent à une espèce unique, ce qui suppose presque nécessairement le couple unique des premiers auteurs. Il existe aujourd’hui deux écoles de naturalistes adonnés à l’étude de l’homme, envisagé au point de vue de son organisation physique ; l’une admet, conformément à la tradition sacrée, l’unité de l’espèce humaine ; l’autre suppose plusieurs espèces d’hommes apparues dans les lieux divers, mais ses adeptes n’ont jamais pu s’accorder sur le nombre de ces espèces, qu’ils font varier de deux à seize. C’est ce qu’on appelle les monogénistes et les polygénistes. Entre les deux doctrines, les faits de l’ordre purement scientifique, ceux qui relèvent d’une manière exclusive de la méthode de l’histoire naturelle, les observations de l’anatomie et de la physiologie, ne permettent pas encore et ne permettront peut être jamais de trancher d’une manière définitive. Il s’agit, en effet, d’un problème que la nature particulière de l’homme rend nécessairement complexe comme elle-même. Les considérations philosophiques et même religieuses ne sauraient en être tenues à l’écart. Elles doivent forcément y intervenir, et l’on n’a pas le droit de les tenir en dehors. Elles exercent une influence décisive sur la manière d’envisager les faits et sur les conclusions qu’on en tire. Il n’est pas un monogéniste ou un polygéniste sur les théories duquel elles n’aient eu une action, qu’elles n’aient contribué puissamment à déterminer en faveur de l’un et de l’autre système. Nous n’éprouvons aucun embarras à l’avouer, c’est principalement cet ordre de considérations qui fait de nous un partisan résolu, de la doctrine de l’unité de l’espèce humaine. Il est dans le monde toute une série de problèmes que nul ne pourrait prétendre supprimer et qui pourtant sont insolubles pour la science pure. La nécessité d’une croyance philosophique et religieuse s’impose à chaque homme, et c’est toujours une croyance de ce genre qui le dirige et l’inspire dans ses travaux, fût-elle le scepticisme ou même le nihilisme le plus absolu. C’est en vain qu’une école s’intitule aujourd’hui positiviste, elle n’est pas plus positive que les autres, en ceci que, malgré sa prétention, elle ne se borne pas plus qu’une autre à recueillir des faits formellement constatés. Il lui faut les grouper, les interpréter, et elle ne peut le faire, elle non plus, qu’en prenant pour point de départ une pétition de principe, un axiome doctrinal, une théorie philosophique. Elle affirme supprimer la métaphysique, et en réalité elle ne fait pas autre chose qu’avoir sa métaphysique à elle propre. Pour nous restreindre ici, sans nous laisser entraîner dans des considérations plus générales, à ce qui est de l’unité ou de la pluralité de l’espèce humaine, du monogénisme ou du polygénisme, ce seront toujours les raisons et les arguments de l’ordre philosophique qui primeront ce débat et qui décideront les esprits à opter pour l’un et l’autre système, également soutenables au point de vue de la science positive. L’histoire naturelle, l’anatomie et la physiologie ne le tranchent pas, non plus que la linguistique ou l’ethnographie. Ce n’est pas réduire le rôle de ces sciences, c’est le définir exactement, que de dire qu’elles ont pour objet et pour mission de bien établir, sur des bases solides, les éléments du problème, mais non sa solution. Tout ce que la critique la plus rigoureuse a le droit d’exiger de celui qui affirme sa croyance à l’unité de l’espèce humaine, est qu’il la justifie comme n’étant en rien démentie par les faits que la science constate à l’aide de l’observation et de l’expérience ; que même sa doctrine, ou si l’on veut son hypothèse fondamentale, est celle qui explique le mieux l’ensemble de ces faits, en fournit la coordination la plus satisfaisante. Les preuves qui permettent de défendre au nom de la science pure la thèse de l’unité de notre espèce ont été récemment groupées une fois de plus en faisceau par M. de Quatrefages, le plus éminent des anthropologistes français, et présentées à certains points de vue d’une manière plus saisissante qu’on n’avait fait jusqu’alors, en profitant des derniers progrès des connaissances. C’est là que nous puiserons les éléments d’un rapide résumé d’une telle démonstration, qui sans doute appartient au domaine de la physiologie, mais qui. ne saurait être laissée de côté par l’histoire, sur les jugements et la méthode d’appréciation de laquelle la question de savoir si tous les hommes sont frères, ou si des différences d’espèces créent entre eux des barrières infranchissables, ne saurait manquer d’avoir une grande influence. L’origine de l’homme, d’ailleurs, est nécessairement le premier chapitre de son histoire. Et c’est là notre justification pour avoir placé, en tête d’une esquisse des annales des plus anciennes civilisations de l’humanité historique, ce livre et le précédent. L’homme, considéré au point de vue du naturaliste, est le siège de phénomènes communs à tous les êtres doués de vie et d’organisation. Lors donc qu’il présente un problème dont il ne peut par lui-même donner la solution, la marche à suivre est d’interroger sur ce point les animaux, les végétaux eux-mêmes, et de conclure d’eux à lui. C’est par cette voie qu’on arrive à justifier scientifiquement l’unité de l’espèce humaine. Mais d’abord il faut bien définir ce que c’est qu’une espèce : L’espèce est l’ensemble des individus, plus ou moins semblables entre eux, qui sont descendus, ou qui peuvent être regardés comme descendus d’une paire primitive unique par une succession ininterrompue de familles. Les individus qui s’écartent du type général d’une manière prononcée sont des variétés. La race est une variété qui se transmet par génération. Les caractères propres à chacune des races humaines ne doivent pas être considérés comme des caractères d’espèces, car les variations qu’on observe dans une même espèce chez les animaux, surtout les animaux domestiques, et qui vont jusqu’à affecter les parties les plus essentielles du squelette, sont bien autrement considérables que celles qui séparent le blanc du nègre, les deux types humains les plus éloignés. D’ailleurs on ne peut pas établir de séparation bien tranchée entre les races d’hommes, qui passent de l’une à l’autre par une infinité d’intermédiaires. Or, quand il s’agit d’espèces animales, quelque rapprochées qu’elles soient, on arrive h déterminer un ou plusieurs caractères, absents chez les unes, présents chez les autres, et qui les différencient nettement. Il n’en est pas ainsi des races. Les caractères s’entrecroisent pour ainsi dire, si bien que, lorsqu’elles sont un peu nombreuses, on a de la peine à dire quel est le trait qui les distingue réellement. Si nous consultons les croisements, ils révèlent à leur tour des différences fondamentales entre l’espèce et la race. Le croisement entre espèces est très rare dans la nature. Lorsqu’il s’opère sous l’influence de l’homme, il est infécond dans l’immense majorité des cas. Le croisement entre races est toujours fécond. Or les unions entre les types les plus opposés de l’humanité présentent constamment ce dernier caractère ; il arrive même quelquefois que la fécondité des races ainsi unies s’y augmente. La race, avons-nous dit, est une variété que l’hérédité parvient à propager. Les influences du milieu, c’est-à-dire l’action des conditions d’existence au milieu desquelles se développe un animal, est la principale des causes qui produisent dans une même espèce les variétés, origines des races. Cette influence des milieux, due au climat, à la nature du sol, au mode de vie, fut bien évidemment celle qui détermina la naissance des différentes races de l’humanité. Sans doute nous ne la voyons plus produire des effets aussi puissants dans les émigrations européennes des siècles modernes. Mais cela tient à la manière intelligente dont l’homme civilisé se défend contre le milieu où il réside. Cette lutte, il la soutient sans cesse, dans le lieu même qui fut le berceau de la race à laquelle il appartient ; émigrant, il agit de même avec plus de soin encore. L’habitant des zones tempérées qui arrive en Sibérie perfectionne ses moyens de chauffage ; dans l’Inde ou au Sénégal il s’efforce d’échapper à la chaleur, et il y réussit en partie ; partout il transporte avec lui des mœurs, des habitudes des pratiques qui font aussi partie du milieu et tendent à diminuer l’influence du changement. Toutefois l’homme a beau se défendre, il n’en subit pas moins dans une certaine mesure l’action du climat et du sol nouveau, où il fixe sa demeure. L’individu européen peut, quand il renonce à la lutte, être rapidement transformé au point de devenir méconnaissable pour ses compatriotes. La race anglaise qui, plus qu’aucune autre, emporte avec elle tout ce qui peut la protéger contre les actions dont il s’agit, est attaquée dès la première génération en Australie, où pourtant elle prospère merveilleusement. Aux États-Unis, elle s’est assez transformée pour pouvoir être considérée comme ayant donné naissance à une race nouvelle. S’il en est ainsi de nos jours, pour l’homme pourvu de tous les moyens de défense que fournit la civilisation la plus raffinée, combien ces influences auxquelles il ne parvient jamais à se soustraire entièrement, n’ont-elles pas dû avoir d’action sur les familles primitives qui se sont répandues dans le monde encore à l’état sauvage. Dans les conditions de cet âge de l’humanité, l’influence du milieu a été forcément la même sur l’homme que sur les animaux, et les changements qu’éprouvent toutes les espèces animales transportées dans de nouveaux climats, ne sont pas moindres que les différences qui séparent entre elles les races humaines. Un changement complet dans le mode de vie d’une population, sous le même climat, suffit d’ailleurs à produire des faits analogues à ceux qui se sont produits ainsi dans l’époque primordiale de l’humanité et qui ont donné naissance à ses races. On en a vu un exemple saisissant dans l’Irlande, à la suite des guerres du XVIIe siècle. Des populations entières, refoulées dans les contrées les plus sauvages de l’île et vouées pendant plusieurs générations à la misère, à la faim, à l’ignorance, sont pour ainsi dire revenues à l’état sauvage ; et leurs caractères physiques, profondément altérés, modifiés, en ont fait une race parfaitement distincte de celle d’où elles sont sorties et que l’on retrouve avec ses caractères primitifs dans les comtés voisins. Rien, du reste, ne prouve d’une manière plus manifeste l’unité de l’espèce humaine, sa descendance d’une même souche et la production de la variété de ses races par des influences de milieu, que le spectacle de la distribution géographique des différents rameaux de l’humanité sur la surface du globe, et du rapport de leurs types avec les conditions physiques et sociales dans lesquelles ils sont placés. Toutes les traditions, a dit M. Maury, auquel nous nous plaisons à emprunter ces pages si remarquables, toutes les traditions concourent à placer la formation de la race blanche, c’est-à-dire de la race la plus élevée dans l’échelle intellectuelle, celle qui possède au plus haut degré la convenance, la proportion, le parfait équilibre des forces et de l’organisation physique, dans la partie septentrionale de l’ancien monde, située pour ainsi dire à égale distance de ses deux extrémités. L’étude des migrations des peuples, la comparaison des langues, les témoignages historiques, s’accordent à faire rayonner la race blanche de la contrée située au pied du Caucase, comprise entre la Méditerranée, la mer Rouge et la mer des Indes, les steppes de l’Asie centrale et les montagnes de l’Himalaya. Plus nous nous éloignons de ce berceau de notre race, plus les caractères de ce beau type s’altèrent ou s’effacent. C’est en Europe qu’il se conserve davantage. Toutefois on ne retrouve déjà plus dans les traits des populations européennes cette régularité parfaite, cette noble symétrie qui nous frappent tant dans les figures des Orientaux, chez les habitants de l’Arménie, de la Perse, ou chez les femmes de la Géorgie et de la Circassie. Chez les Européens il y a, par contre, plus d’animation, plus de mobilité, plus d’expression ; la beauté est, en un mot, moins physique, mais plus morale. Pénétrons en Afrique, et nous allons rencontrer un autre ordre d’altérations. Déjà l’Arabe qui habite le voisinage de l’isthme de Suez, et qui peuple à la fois l’un et l’autre littoral de la mer Rouge et s’avance sur les bords de la Méditerranée, a les traits moins intelligents et moins réguliers. Son front est plus fuyant, et sa tête plus allongée ; son visage n’a ni la beauté du coloris, ni la fermeté des chairs du Persan ou de l’Arménien, ni la fraîcheur de l’Européen ; sa peau est jaunâtre et parfois bistrée. Avance-t-on au midi, au delà du tropique du Cancer, la couleur prend une teinte encore plus sombre, en même temps que les cheveux deviennent crépus, les lèvres épaisses. Telle est la physionomie des Gallas de l’Abyssinie. Plus avant vers le sud, sur la côte orientale de l’Afrique, ce type s’enlaidit encore. Alors apparaît le Cafre à la chevelure laineuse, aux lèvres épaisses, et dont les mâchoires sont déjà légèrement proéminentes. Enfin, à l’extrémité même de l’Afrique, au point le plus éloigné de ce côté du monde où l’espèce humaine puisse atteindre, ses caractères physiques et moraux sont arrivés à leur point extrême de dégradation. Le Hottentot nous présente le type le plus enlaidi et le moins intelligent de l’humanité. Sur la côte d’Afrique opposée, à des distances encore plus éloignées du berceau de la race blanche, la dégénérescence s’opère par une progression plus rapide. Les races berbères du Sahara se rattachent sans contredit à la souche blanche, mais déjà on découvre dans leur type comme les avant-coureurs de l’altération profonde qui s’opère dans le Soudan. La tête est allongée, la bouche forme une saillie prononcée, les membres sont maigres et mal proportionnés, la couleur de la peau se fonce. Le Fellatah du Soudan est déjà un nègre, mais un nègre dont la figure respire l’intelligence. Ce reste de noblesse dans les traits disparaît chez le noir de la Sénégambie, et est remplacé par un peu plus de laideur. Le nègre du Congo nous fournit enfin le type pur de sa race : front déprimé et rejeté en arrière, mâchoire inférieure proéminente, lèvres épaisses, nez camus, chevelure laineuse, occiput développé, intelligence bornée et confinée presque tout entière dans l’adresse manuelle. Enfin, aux extrémités de cette côte occidentale d’Afrique, le Buschman ou Boschiman nous offre les traits enlaidis, s’il est possible, du Hottentot. Cette dégénérescence graduelle du type humain qui vient d’être constatée, pour ainsi dire en latitude, des bords de la mer Caspienne au cap de Bonne-Espérance, on la retrouve non moins prononcée lorsqu’on s’éloigne du même berceau, dans la direction de l’est et du sud-est. Si nous pénétrons dans les steppes de l’Asie Centrale, nous rencontrons le Mongol aux pommettes proéminentes, aux yeux petits et bridés, relevés à leur angle externe, à la face triangulaire, aux formes carrées et épaisses. Toute harmonie dans les lignes a disparu. La race dravidienne, repoussée par les hommes de race blanche de la majeure partie de l’Hindoustan, réfugiée dans les montagnes de son ancienne patrie, la race malaie, qui en forme comme l’avant-garde et qui de la presqu’île transgangétique s’est répandue dans les îles, depuis les Moluques jusqu’à Madagascar, offrent des traits plus sauvages que les Mongols et une coloration plus prononcée. Chez les plus barbares, la peau est presque noire, et les membres laissent déjà percer cette maigreur et ces formes grêles qui, en Afrique, annoncent le voisinage de la race noire. L’Alfourou présente différentes teintes variant du brun clair au brun foncé. Sa chevelure affecte une disposition par touffes énormes, qui commence chez les populations malayennes les plus abruties. Enfin, au delà de la race alfourou qui les~repousse devant elle, çà et là répandus, des îles An’daman aux Philippines, à l’intérieur desquelles ils habitent, les Australiens et les Negritos, dont la patrie s’avance jusque dans la terre de Van-Diémen, nous offrent le dernier degré de la grossièreté et de la laideur, de la stupidité et de l’abjection. Si, au lieu de descendre au sud-est, on s’avance au delà des Mongols, dans la direction du nord et du nord-est, on observe une altération d’un autre genre, mais moins profonde. Comme l’espace ne s’offre pas aussi étendu à la migration des peuples, que notre espèce ne peut pas s’éloigner autant du point où elle atteint son plus haut degré de développement, la dégénérescence n’a point eu un champ si ouvert à ses progrès. Les races ougro-finnoises, qui s’étendent sur tout le nord du globe, depuis la Laponie jusqu’au pays des Esquimaux, rappellent encore la race mongole ; mais leurs yeux sont généralement moins obliques, leur peau ne prend plus une teinte jaune aussi prononcée, leur chevelure est plus abondante, leur front plus déprimé, leur figure respire moins d’intelligence. L’Amérique, en excluant la partie septentrionale habitée par la race boréale, renferme une autre race dont le mode de distribution ne correspond plus toutefois avec la loi que nous venons de constater. Dans l’Amérique du Nord, l’homme se présente avec un caractère d’énergie dans les traits tout particulier. Les lignes de la figure sont arquées, le front est extraordinairement fuyant, sans être pour cela déprimé à la façon de celui du nègre, la peau est rouge, la barbe est nulle ou rare, l’œil est très légèrement relevé sur les bords, les pommettes sont proéminentes. Ce type atteint son point culminant de beauté et d’intelligence dans les régions équatoriales du Mexique et du Pérou. Au delà de ces régions, à mesure qu’on descend vers le sud, la peau se fonce ou plutôt se brunit, les traits s’enlaidissent, les lignes perdent de leur courbure et de leur régularité, les membres de leur bonne conformation. Tel est le caractère des Guaranis, des Botocoudos, des Aymaras. Lorsqu’on arrive à l’extrémité méridionale de l’Amérique, on ne trouve plus que la plus difforme et la plus misérable des populations, la plus abrutie et la plus stupide, les Pécherais de la Terre de Feu. Cette distribution nouvelle et en apparence anomale des races du Nouveau Monde, loin d’être une exception à la loi qui nous présente le type humain d’autant plus parfait que les conditions climatologiques sont plus favorables, ne fait, au contraire, que la confirmer. L’Amérique a aussi sa contrée tempérée ; cette contrée est située plus au sud que celle de l’Europe, parce que ce continent est plus froid ; la chaîne de montagnes qui lui sert comme d’arête, détermine une succession de plateaux élevés. C’est en effet au Mexique et au Pérou c’est-à-dire dans des contrées placées, à raison de leur altitude, dans des conditions plus favorables à la vie, que la civilisation indigène américaine avait atteint son plus haut degré de développement. La diffusion de l’humanité dans toutes les parties du globe et sous tous les climats, dont nous venons d’esquisser le tableau, est encore un des faits où la science de l’anthropologie, guidée par l’analogie des observations les plus modernes sur la distribution géographique des animaux, découvre la justification de l’unité de notre espèce, en constatant qu’elle a dû se répandre partout en partant d’un point unique et restreint, où elle avait fait sa première apparition à la vie. Les animaux, comme les plantes, ne sont pas distribués au hasard sur le globe. L’observation nous apprend que chaque région a ses espèces, ses genres, ses types particuliers. L’expérience démontre que certaines espèces peuvent être transportées d’une région dans une autre, y vivre et y prospérer. Mais il n’existe pas une seule espèce qui soit naturellement cosmopolite. Aussi faut-il, pour les animaux et les plantes, abandonner l’idée d’un centre de création unique et accepter celle des centres de création multiples. Ces centres de création multiples, les partisans des doctrines polygénistes sont obligés de les admettre pour les hommes, du moment qu’ils en distinguent plusieurs espèces. Mais là encore ils viennent se heurter contre les lois que la science proclame comme ayant présidé à la répartition des êtres organisés. En effet, pour avoir une aire plus étendue que les espèces, les genres n’en présentent pas moins des faits de cantonnement analogues, car, comme l’a si bien dit M. de Candolle, les mêmes causes ont pesé sur les espèces et sur les genres. Plus l’organisation d’un végétal ou d’un animal devient complète, plus son aire devient restreinte. Dans la série des mammifères particulièrement, on peut suivre pas à pas le rétrécissement de l’aire occupée à mesure qu’on s’élève dans l’organisation. Quand nous en arrivons aux grands singes anthropomorphes, qui sont les animaux les plus rapprochés de nous au point de vue physique, nous constatons que presque chaque genre est représenté par une unique espèce, que pas un de ces genres n’est commun à l’Asie et à l’Afrique, pas un ne s’étend sur l’ensemble de la partie du monde qu’il habite, enfin que tous sont remarquablement cantonnés. Supposer donc que le genre humain se subdivise en plusieurs espèces, issues d’origines distinctes, admettre que ce type, le plus perfectionné de tous, même au point de vue purement organique, a pris naissance dans tous les centres de création, qu’il n’en a caractérisé aucun, ce serait faire de l’homme une exception unique aux lois de la nature. Ainsi l’observation directe et la science de la physiologie mettent en état d’affirmer, suivant l’ingénieuse expression de M. de Quatrefages, que tout est comme si l’ensemble des hommes avait commencé par une paire primitive et unique. Elles ne nous apprennent rien sur l’existence de ce couple originaire. La parole divine pouvait seule nous instruire à ce sujet. § 2. LE CANTONNEMENT PRIMITIF DE L’ESPÈCE HUMAINE ET SES MIGRATIONS. Est-il possible, dit M. de Quatrefages, d’aller plus loin que nous venons de le faire et de chercher à déterminer la position géographique du centre d’apparition humain ? Je ne saurais aborder ce problème dans ses détails ; je me bornerai à en préciser le sens et à indiquer les solutions probables d’après les données de la science actuelle. Remarquons d’abord que, lorsqu’il s’agit d’une espèce animale ou végétale, de celles même dont l’aire est la plus circonscrite, personne ne demande le point précis où elle a pu se montrer pour la première fois. La détermination dont il s’agit a toujours quelque chose de très vague et est forcément approximative. L’on ne saurait en demander davantage, quand il s’agit de l’espèce répandue aujourd’hui partout. Dans ces limites, il est permis de former au moins des conjectures ayant pour elles une certaine probabilité. La question se présente avec des caractères assez différents, selon que l’on s’arrête aux temps présents ou que l’on tient compte de l’ancienneté géologique de l’homme. Toutefois les faits ramènent dans les mêmes régions et semblent indiquer deux extrêmes. La vérité est peut-être entre eux deux. On sait qu’il existe en Asie une vaste région entourée au sud et au sud-ouest par l’Himalaya, à l’ouest par le Bolor ou Belour-tagh, au nord-ouest par l’Ala-Tau, au nord par l’Altaï et ses dérivés, à l’est par le Kingkhan, au sud et au sud-est par le Felina et le Kouenlun. A en juger par ce qui existe aujourd’hui, ce grand massif central pourrait être regardé comme ayant renfermé le berceau de l’espèce humaine. En effet, les trois types fondamentaux de toutes les races humaines sont représentés dans les populations groupées autour de ce massif. Les races nègres en sont les plus éloignées, mais ont pourtant des stations maritimes où on les trouve pures ou métisses de puis les îles Kioussiou jusqu’aux Andaman. Sur le continent elles ont mêlé leur sang à presque toutes les castes et classes inférieures des deux presqu’îles gangétiques ; elles se retrouvent encore pures dans toutes deux, remontent jusqu’au Népal et s’étendent à l’ouest jusqu’au golfe Persique et au lac Zareh, d’après Elphinstone. La race jaune, pure ou mélangée par places d’éléments blancs, paraît occuper seule l’aire dont il s’agit ; elle en peuple le pourtour au nord, à l’est, au sud-est et à l’ouest. Au sud elle se mélange davantage, mais elle n’en forme pas moins un élément important de la population. La race blanche, par ses représentants allophyles, semble avoir disputé l’aire centrale elle-même à la race jaune. Dans le passé nous trouvons les Yu-Tchi, les Ou-soun au nord du Hoang-Ho ; de nos jours dans le Petit Thibet, dans le Thibet oriental, on a signalé des îlots de populations blanches. Les Miao-tseu occupent les régions montagneuses de la Chine ; les Siaposch résistent à toutes les attaques dans les gorges du Bolor. Sur les confins de l’aire, nous rencontrons à l’est les Aïnos et les Japonais des hautes castes, les Tinguianes des Philippines ; au sud les Hindous. Au sud-ouest et à l’ouest l’élément blanc, pur ou mélangé, domine entièrement. Aucune autre région sur le globe ne présente une semblable réunion des types humains extrêmes distribués autour d’un centre commun. A lui seul, ce fait pourrait inspirer au naturaliste la conjecture que j’ai exprimée plus haut ; mais on peut invoquer d’autres considérations. Une des plus sérieuses se tire de la linguistique. Les trois formes fondamentales du langage humain se retrouvent dans les mêmes contrées et dans des rapports analogues. Au centre et au sud-est de notre aire, les langues monosyllabiques sont représentées par le chinois, le cochinchinois, le siamois et le thibétain. Comme langues agglutinatives, nous trouvons du nord-est au nord-ouest le groupe des ougro-japonaises ou altaïques, au sud celui des langues dravidiennes et des malaies, à l’ouest les langues turques. Enfin le sanscrit avec ses dérivés, et les langues iraniennes représentent au sud et au sud-ouest les langues à flexion. C’est aux types linguistiques accumulés autour du massif central de l’Asie que se rattachent tous les langages humains ; soit par le vocabulaire soit par la grammaire, quelques-unes de ces langues asiatiques touchent de très près à des langages parlés dans des régions fort éloignées, ou séparées de l’aire dont il s’agit par des langues fort différentes. Enfin c’est encore d’Asie que nous sont venus nos animaux domestiques les plus anciennement soumis. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire s’accorde entièrement sur ce point avec Dureau de la Malle. Ainsi, à ne tenir compte que de l’époque actuelle, tout nous ramène à ce plateau central ou mieux à cette grande enceinte. Là, est-on tenté de se dire, ont apparu et se sont multipliés les premiers hommes, jusqu’au moment où les populations ont débordé comme d’une coupe trop pleine et se sont épanchées en flots humains dans toutes les directions. Avons-nous besoin d’insister sur ce qu’a de remarquable et de frappant pour l’esprit l’accord de ces conclusions, fondées uniquement sur des considérations anthropologiques, avec celles où nous a conduit, dans le livre précédent, l’étude des traditions antiques des plus grandes races humaines sur le berceau de l’humanité primitive ? Le lecteur aura certainement relevé cet accord et en aura apprécié toute l’importance, sans qu’il nous soit nécessaire de le lui signaler. Mais, continue l’éminent anthropologiste que nous citons ici, les études paléontologiques ont conduit assez récemment à des résultats qui peuvent modifier ces premières conclusions. MM. Heer et de Saporta nous ont appris qu’à l’époque tertiaire la Sibérie et le Spitzberg étaient couverts de plantes attestant un climat tempéré. A la même époque, nous disent MM. Murchison, Keyserlink, de Verneuil, d’Archiac, les barenlands de nos jours nourrissaient de grands herbivores, le renne, le mammouth, le rhinocéros à narines cloisonnées. Tous ces animaux s’e montrent chez nous au début de l’époque quaternaire. Us me semblent ne pas être arrivés seuls. Les trouvailles de M. l’abbé Bourgeois démontrent à mes yeux l’existence en France de l’homme des âges tertiaires[2]. Mais tout semble annoncer qu’il, ne comptait encore chez nous que de rares représentants. Les populations de l’âge quaternaire, au contraire, étaient, au moins par places, aussi nombreuses que le permet la vie de chasseur. N’est-il pas permis de penser que, pendant l’époque tertiaire, l’homme vivait dans l’Asie boréale à côté des espèces que je viens de nommer et qu’il les chassait pour s’en nourrir, comme il les a plus tard chassées en France ? Le refroidissement força les animaux à émigrer vers le sud ; l’homme dut les suivre pour chercher un climat plus doux et pour ne pas perdre de vue son gibier habituel. Leur arrivée simultanée dans nos climats, l’apparente multiplication subite de l’homme s’expliqueraient ainsi aisément. On pourrait donc reporter bien au nord de l’enceinte dont je parlais tout à l’heure, et au moins jusqu’en Sibérie, le centre d’apparition humain. Peut-être l’archéologie préhistorique et la paléontologie confirmeront-elles ou infirmeront-elles un jour cette conjecture. Quoiqu’il en soit ; aucun des faits recueillis jusqu’à ce jour n’autorise à placer ailleurs qu’en Asie le berceau de l’espèce humaine. Aucun non plus ne conduit à chercher notre patrie originelle dans les régions chaudes, soit des continents actuels, soit d’un continent disparu. Cette, pensée, bien souvent exprimée, repose uniquement sur la croyance que le climat du globe, au moment de l’apparition de l’homme, était ce qu’il est aujourd’hui. La science moderne nous a appris que c’est là une erreur. Dès lors rien ne s’oppose à ce que nos premiers ancêtres aient trouvé des conditions d’existence favorables jusque dans le nord de l’Asie, où nous ramènent tant de faits empruntés à l’histoire de l’homme, à celle des animaux et des plantes. La tradition religieuse et la philosophie spiritualiste affirment l’unité spécifique du genre humain. La physiologie fournit des éléments de démonstration de cette thèse qu’il n’existe qu’une seule espèce d’homme dont les différents groupes humains sont les variétés et les races. La géographie zoologique conduit à admettre presque forcément que cette espèce a dû être primitivement cantonnée dans un espace relativement très restreint. Si donc nous la voyons aujourd’hui partout, c’est qu’elle s’est répandue en irradiant en tous sens à partir de ce centre primitif. Le peuplement du globe par voie de migrations est la conséquence nécessaire de ces prémisses. Les polygénistes, les partisans de l’autochtonie des races humaines ont déclaré ces migrations impossibles pour un certain nombre de cas, et ont présenté celle impossibilité prétendue comme une objection insurmontable à la doctrine monogéniste. Les faits historiquement connus, d’où l’on est en droit d’induire de quelle manière ont dû s’opérer les faits analogues dont le comment reste et restera toujours inconnu, répondent surabondamment à une telle objection. Car ils établissent au-dessus de toute contestation deux faits essentiels, qui suffisent à expliquer le peuplement du globe entier par voie de migrations, ayant un point de départ unique : la faculté spéciale qu’a l’homme de toutes les races de s’acclimater dans toutes les contrées et sous tous les climats ; non seulement la possibilité, mais la réalisation, dans des circonstances connues, de migrations ethniques qui se sont produites précisément dans les conditions où on les représentait, d’après des théories préconçues ; comme absolument impossibles. L’expérience, dit M. Maury, montre que l’acclimatation est possible dans un climat donné pour des hommes de toute race, mais qu’elle s’opère d’autant plus facilement que la race à laquelle ils appartiennent trouve des conditions plus analogues à celles de son berceau, et adopte un genre de vie plus conforme à celui que nécessite sa nouvelle patrie. Ce qui se produit pour certains animaux, tels que les bœufs et les chevaux, revenus à l’état sauvage en Amérique, y prospérant, s’y propageant aussi bien que sur la terre natale, a également lieu pour l’Européen établi aux États-Unis et dans l’Amérique du Sud, pour le Chinois transporté en Californie et le Nègre dans le Nouveau-Monde. Seulement cette acclimatation exige une véritable lutte pour l’existence, dans laquelle un grand nombre succombent. Les individus émigrés sous un ciel très différent du leur, comme cela s’observe pour les animaux et les plantes exotiques, languissent d’abord, et ne retrouvent qu’au bout d’un certain nombre de générations leur fécondité native. Il y a d’ailleurs des races qui sont plus propres à s’acclimater que d’autres. Il y a des contrées malsaines où toutes les races dépérissent, comme la côte du Gabon ; il en est, comme l’Australie, qui conviennent à toutes, parce qu’elles offrent des conditions moyennes auxquelles les races les plus distinctes peuvent s’adapter. Mais l’acclimatation est loin d’avoir toujours réussi. L’influence délétère des agglomérations trop nombreuses, des vices qu’apporte aux sauvages le contact de la civilisation européenne, des guerres d’extermination et de bien autres causes de destruction ont amené l’anéantissement de certaines races qui avaient émigré. Malgré ces faits, n’en subsiste pas moins la loi générale qu’à quelque race qu’il appartienne l’homme peut se faire à tous les milieux auxquels s’est déjà accommodé son semblable, qu’il peut se reproduire sous tous les climats. Cette loi permet donc d’admettre que des migrations se sont opérées dans les sens les plus divers, que les races ont dû non seulement se mêler, mais se substituer les unes aux autres, qu’aucune, en un mot, n’est irrévocablement, attachée à une contrée déterminée. Voilà pour ce qui est de la faculté spéciale d’acclimatation que possède l’homme, soit qu’on l’envisage au point de vue de l’ensemble de son Unité d’espèce ; soit qu’on le considère séparément dans chacune,de ses variétés et de ses races. Ecoutons maintenant M. de Quatrefages au sujet des objections élevées contre la possibilité matérielle du peuplement de la surface terrestre par des migrations ayant pour point de départ un centre d’origine commun et restreint. Les migrations se montrent à peu près partout dans l’histoire, dans les traditions et les légendes du nouveau comme de l’ancien monde. Nous les constatons chez les peuples les plus civilisés de nos jours et chez les tribus encore arrêtées aux plus bas échelons de la vie sauvage. A mesure que nos connaissances grandissent et dans quelque sens qu’elles s’étendent, elles nous font de plus en plus connaître les instincts voyageurs de l’homme. La paléontologie humaine, l’archéologie préhistorique ajoutent chaque jour leurs témoignages à ceux des sciences historiques. A ne juger que par cette sorte de renseignements, le peuplement du globe entier par voie de migrations, de colonisations, apparaît comme plus que probable. L’immobilité primordiale et ininterrompue d’une race humaine quelconque serait un fait en désaccord avec toutes les analogies. Sans doute, une fois constituée, elle laissera en place, à moins d’événements exceptionnels, un nombre plus ou moins considérable, et d’ordinaire la très grande majorité de ses représentants ; mais, à coup sûr, dans le cours des âges, elle aura essaimé. Les partisans de l’autochtonie insistent d’une manière spéciale sur deux ordres de considérations tirées les unes de l’état social des peuples dans l’enfance et dépourvus des moyens d’action que nous possédons, les autres des obstacles qu’une nature jusque-là indomptée devait opposer à leur marche. La première objection repose évidemment sur une appréciation inexacte des aptitudes et des tendances développées chez l’homme par ses divers genres de vie. L’imperfection même de l’état social, loin d’arrêter la dissémination de l’espèce humaine, ne pouvait que la favoriser. Les peuples cultivateurs sont forcément sédentaires ; les pasteurs, moins attachés au sol, ont besoin de rencontrer des conditions spéciales. Les chasseurs au contraire, entraînés par leur genre dévie, parles nécessités qu’il impose et les instincts qu’il développe, ne peuvent que se disséminer en tout sens. Il leur faut pour vivre de vastes espaces ; dès que les populations s’accroissent, même dans d’assez faibles proportions, elles sont forcées de se séparer ou de s’entre-détruire, comme le montre si bien l’histoire des Peaux-Rouges. Les peuples chasseurs ou pasteurs sont donc seuls propres aux grandes et lointaines migrations. Les peuples cultivateurs seront plutôt colonisateurs. L’histoire classique elle-même confirme de tout point ces inductions théoriques. On sait ce qu’étaient les envahisseurs du monde romain, les destructeurs du Bas-Empire, les conquérants arabes. Le même fait s’est produit au Mexique. Les Chichimèques représentent ici les Goths et les Vandales de l’ancien monde. Si l’Asie a tant de fois débordé sur l’Europe, si le nord américain a envoyé tant de hordes dévastatrices dans les régions plus méridionales, c’est que dans ces deux contrées l’homme était resté barbare ou sauvage. Les obstacles naturels étaient-ils vraiment infranchissables pour les populations dénuées de nos moyens perfectionnés de locomotion ? Cette question doit être examinée à deux points de vue, selon qu’il s’agit do migrations par terre ou par mer. Le premier cas nous embarrassera peu. On a vraiment trop exagéré la faiblesse de l’homme et la puissance des barrières que pouvaient lui opposer les accidents du terrain, la végétation Ou les faunes. L’homme a toujours su vaincre les bêtes féroces ; dès les temps quaternaires il mangeait le rhinocéros. Il n’a jamais été arrêté parles montagnes lors même qu’il traînait à sa suite ce qui pouvait rendre le passage le plus difficile ; ‘Hanniba’al a franchi les Alpes avec ses éléphants et Bonaparte avec ses canons ; Les hordes asiatiques n’ont pas été arrêtées par les Palus Méotides, pas plus que Fernand de Soto par les marais de la Floride. Les déserts sont chaque jour sillonnés par des caravanes ; et quant aux fleuves, il n’est pas de sauvage qui ne sache les traverser sur un radeau ou une outre. En réalité, — l’histoire des voyages ne le prouve que trop — l’homme seul arrête l’homme, Quand celui-ci n’existait pas, rien ne s’opposait à l’expansion de tribus ou de nations avançant lentement, à leur heure, se poussant ou se dépassant tour à tour, constituant des centres secondaires d’où partaient plus tard de nouvelles migrations. Même sur une terre peuplée, une race supérieure envahissante ne procède pas autrement. C’est ainsi que les Aryas ont conquis l’Inde, c’est ainsi qu’avancent les Paouins, qui, partis d’un centre encore inconnu, arrivent au Gabon sur un front de bandière d’environ 400 kilomètres. Les migrations terrestres suffisent, à expliquer le peuplement des trois parties, du continent de l’ancien monde et des îles qui y sont adjacentes, car l’occupation de celles-ci sortait à peine des conditions de ces migrations. Les bras de mer qu’il fallait franchir pour y pénétrer n’offraient pas, en général, pour leur passage de difficultés beaucoup plus grandes que celles que présente le passage des grands fleuves, qui n’ont arrêté aucune migration terrestre de peuples sauvages ou barbares. On conçoit facilement comment des tribus qui ne possédaient encore que des moyens de transport par eau tout à fait rudimentaires, ont pu cependant traverser de semblables bras de mer et passer du continent dans les îles voisines. Ce ne sont pas là, à proprement parler, des migrations maritimes. Dans le cours de l’histoire que nous avons entrepris de raconter, nous rencontrerons, nous saisirons pour ainsi dire sur le fait quelques migrations de cette dernière catégorie, qui se sont produites au milieu des temps pleinement historiques, dans le bassin de la Méditerranée et dans celui de la mer d’Oman : par exemple la migration d’une partie des populations pélasgiques d’Asie-Mineure en Italie, ou bien celles qui ont eu lieu entre l’Inde, d’une part, et, de l’autre, l’Arabie méridionale et la côte africaine du pays des Somalis. Mais ce sont, d’après leurs proportions mêmes, des faits de colonisation plutôt que proprement de migration. D’ailleurs nous lès voyons se produire dans des conditions qui les rendent aussi peu extraordinaires que celui de l’établissement et de la diffusion de la race blanche en Amérique depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours. Il s’agit de mouvements opérés, en prenant la mer pour grand chemin, par des populations habituées au métier de matelots, possédant des vaisseaux capables d’affronter des traversées d’une certaine étendue, connaissant les conditions d’une navigation hauturière qui, sans franchir encore de bien vastes espaces, ne craignait pas cependant de perdre pour quelques journées la vue des côtes, par des populations parvenues à un degré de civilisation déjà remarquable. Remarquons de plus qu’aucun de ces transports de tribus entières par la voie de mer ne dépasse l’aire du développement habituel de la navigation commerciale à l’époque où elles se sont produites. Tout cela est bien loin de ce que firent les Scandinaves, avec des vaisseaux qui n’étaient ni plus forts ni plus perfectionnés, lorsqu’au IXe siècle ils colonisèrent le Groenland, et que, du XIe au XIVe siècle, ils fréquentèrent habituellement le Vinland, c’est-à-dire le littoral de l’Amérique du Nord, en y fondant des établissements. La réalisation de migrations maritimes de ce genre n’a donc en réalité presque aucun rapport avec le problème, insoluble semble-t-il au premier abord, que présente le peuplement par migrations de certaines parties du globe qui se composent d’îles disséminées sur un immense espace, séparées entre elles par d’énormes distances, et que cependant les Européens ont trouvées habitées par des tribus sauvages qu’il était difficile de croire capables d’avoir franchi, avec les faibles moyens en leur possession, les effrayantes étendues de mer qui s’interposent entre ces îles et le continent où tout nous induit à placer le berceau unique et commun de l’espèce humaine. Et pourtant ce problème a été résolu d’une manière certaine par la science contemporaine, et cela précisément pour la région où le fait exigé par la doctrine monogéniste paraissait le plus invraisemblable. La plupart des défenseurs de la pluralité des espèces d’homme et de l’autochtonie des races ont reconnu que les migrations par terre n’avaient en elles-mêmes rien d’impossible ; mais il en était tout autrement, affirmaient-ils, des migrations par mer. En particulier, ils soutenaient que le peuplement de la Polynésie, par des immigrants venus de notre grand continent, était au-dessus de tout ce que pouvaient entreprendre et accomplir des peuples dépourvus de connaissances astronomiques et dé moyens perfectionnés de navigation. A les en croire, les conditions géographiques, le régime des vents et des courants devaient opposer une barrière insurmontable à toute entreprise de ce genre. Or, les admirables études de l’anthropologiste américain, M. Horatio Haie, puis de M. de Quatrefages, fondées sur les traditions orales des différents peuples de la Polynésie, sur les chants historiques qui s’y répètent de génération en génération, ainsi que sur les généalogies soigneusement étudiées de leurs maisons princières, ont permis de reconstituer sans, lacunes, avec une sûreté parfaite et en n’enregistrant que des faits positifs, l’itinéraire et les annales de la migration maritime des Polynésiens. Il est impossible de le contester aujourd’hui, la Polynésie, cette région que les conditions géographiques semblent au premier abord isoler du reste du monde, a été peuplée à une époque rapprochée de nous par voie de migration volontaire, et de dissémination accidentelle, procédant de l’ouest à l’est, au moins pour l’ensemble, et elle l’a été par une population qui ne possédait même pas l’usage des métaux, qui en était encore aux pratiques de l’âge de la pierre polie. Les Polynésiens venus de la Malaisie, et de l’île Bouro en particulier, se sont établis et constitués d’abord dans les archipels de Samoa et de Tonga ; de là ils ont successivement envahi .le monde maritime ouvert devant eux ; ils ont trouvé désertes, à bien peu près, toutes les terres où ils ont abordé et n’ont rencontré que sur trois ou quatre points quelques tribus peu nombreuses de sang plus ou moins noir. Il y a plus. On est parvenu à déterminer avec une approximation très rapprochée les dates des principales étapes de cette migration si extraordinaire. C’est vers l’époque de l’ère chrétienne que les ancêtres des Polynésiens sont sortis de l’île de Bouro, et dans les quatre premiers siècles de cette ère qu’a eu lieu leur première extension jusqu’aux îles Samoa et Tonga. Au Ve siècle ils occupaient les Marquises, au VIIIe les îles Sandwich, au XIIIe, dans une autre direction, les îles Manaïa, d’où partirent les colons qui s’établirent à la Nouvelle-Zélande entre 1400 et 1450. Ainsi c’est au plus tôt dans les premières années du XVe siècle de notre ère qu’ont pris terre, dans cette dernière contrée, ces Maoris dont on a voulu faire les enfants du sol qui les porte. Les dates que nous venons d’indiquer prouvent que cette migration est étrangère ta l’histoire ancienne, de même que le domaine où elle s’est développée est en dehors de l’aire géographique des civilisations dont les époques les plus antiques font le sujet du présent ouvrage. Il en est de même du peuplement de l’Amérique, dont l’époque et le mode ne sont pas aussi bien éclaircis, et où il faut sûrement admettre des époques différentes et des couches d’immigrations successives. La question se complique ici par le fait de l’existence sur le nouveau continent, dès l’époque quaternaire, d’une population humaine encore imparfaitement connue, qui n’a peut-être pas été étrangère à la formation de la race rouge, à laquelle appartient l’immense majorité des indigènes de l’Amérique. L’homme américain des temps géologiques a dû passer d’Asie en Amérique par le Nord, où les îles Aléoutiennes établissent entre l’extrémité orientale de l’Asie et le Nouveau-Monde une chaîne ininterrompue, dont les anneaux sont si rapprochés que le passage par cette voie rentrait plutôt dans la donnée des migrations terrestres que dans celle des migrations maritimes. Mais en dehors de la race rouge, le continent américain a présenté à ses premiers explorateurs des îlots de populations appartenant de la manière la plus formelle aux trois races, jaune, noire et Manche, isolés au milieu de la masse des indigènes, qui est de race rouge. Et l’existence de ces îlots sporadiques ne peut s’expliquer que par des faits de dissémination accidentelle, produits des tempêtes et des grands courants marins, faits ayant pour théâtres le littoral de l’Océan Pacifique, de la Californie au Pérou, le long du trajet du vaste courant que les Japonais appellent Kouro-Sivo ou fleuve noir, ou bien le littoral de l’Atlantique, là où portent le Gulf-stream et son contre-courant. Je ne veux pas, du reste, m’appesantir plus longuement sur des ordres de faits qui n’intéressent pas directement le sujet spécial de l’histoire que j’ai entrepris de raconter. Il était cependant impossible de les passer absolument sous silence, en touchant d’une manière générale à la question de la diffusion, sur toutes les parties de la surface terrestre, de l’homme, sorti d’une source unique sur un point déterminé du globe. Mais il me suffit d’y avoir trouvé dans le passé la justification de ces belles paroles du grand géologue anglais Lyell, aussi fermement convaincu de l’unité de l’espèce humaine, et de la sortie de tous ses rameaux d’un centre commun, que de son antiquité géologique : En supposant que le genre humain disparût en entier, à l’exception d’une seule famille, fût-elle placée sur l’Océan ou sur le nouveau continent, en Australie ou sur quelque îlot madréporique de l’Océan Pacifique, nous pouvons être certains que ses descendants finiraient dans le cours des âges par envahir la terre entière, alors même qu’ils n’atteindraient pas à un degré de civilisation plus élevé que les Esquimaux ou les insulaires de la mer du Sud. § 3. — GRANDES DIVISIONS DES RACES HUMAINES, TYPES FONDAMENTAUX ET TYPES SECONDAIRES. Entre les nombreuses variétés de l’espèce humaine, dont nous avons indiqué un peu plus haut, à grands traits, la distribution géographique, on ne peut pas toujours distinguer les plus anciennes, celles qui sont pures ou du moins constituées depuis des milliers d’années, de celles qui résultent de croisements. Toutefois, dit M. Maury, en s’appuyant sur ce fait fourni par la physiologie végétale que les espèces pures, varient peu ou restent dans leurs variations soumises à des lois végétales, tandis que chez les hybrides la forme se dissout, d’une génération à l’autre, en variations individuelles, on peut admettre que les races humaines dont le type est le plus persistant, sont les moins mélangées. En tenant, compte de toutes les variétés spécifiques, et en rangeant les unes à côté des autres, par ordre d’affinités, toutes les races humaines, on arrive à reconnaître qu’elles se groupent autour de trois types principaux : Un type blanc, Un type jaune, Et un type noir. On passe de l’un à l’autre type par une série de types intermédiaires, qui représentent des races mixtes. Quoique ta certains égards indépendant du climat et de latitude, quoique persistant un laps de temps fort long quand il est transporté en d’autres régions que celle où il est indigène, le type ne peut être considéré comme ayant une origine étrangère à la constitution du pays où il se produit. Au contraire, tout donne à penser aujourd’hui que la race, émigrée sous un autre ciel, revient peu à peu au type propre à ce nouveau climat. C’est ainsi que l’Anglo-Américain tend à se rapprocher du type indien, qu’il perd chaque jour davantage de sa physionomie européenne pour prendre celle des anciens indigènes, avec lesquels il évite pourtant de se croiser ; de même le nègre établi dans les contrées froides perd, après plusieurs générations, en partie le pigment noir de sa peau et prend une couleur grisâtre. Ce phénomène nous explique comment les populations aryennes ont pu en Europe revêtir un type tout septentrional. Inversement, les Portugais établis depuis plusieurs générations dans l’Inde, sans se croiser avec les Hindous, ont pris peu à peu, par l’action du climat, la coloration et le type de ceux-ci. Ce phénomène tend donc à faire attribuer un caractère plus géographique que physiologique à la distinction des races. Le type blanc semble avoir son berceau dans le plateau de l’Iran, d’où il a rayonné dans l’Inde, l’Arabie, la Syrie, l’Asie-Mineure et l’Europe, circonstance qui a fait donner à la race blanche le nom assez impropre de caucasique. Le type jaune existe en Chine depuis la plus haute antiquité ; il se présente dans toutes les contrées habitées par les populations mongoliennes ; de là l’épithète de mongolique appliquée à la race chez laquelle il s’observe. Cette race s’est répandue, au sud, jusque dans les deux presqu’îles de l’Inde et dans la Malaisie ; au nord, elle confine aux régions polaires. Le type noir répond à l’Afrique centrale et occidentale, et paraît s’être étendu sous la zone intertropicale, depuis la côte orientale de l’Afrique jusqu’en Australie. » Son centre primitif de formation a peut-être été dans une partie de l’Inde ou vers l’Ethiopie asiatique des anciens, le Beloutchistan actuel. C’est ainsi qu’on s’expliquerait le mieux le double courant divergent de migration qui a répandu les populations de ce type, d’un côté en Afrique, de l’autre dans l’Inde méridionale, dont les traditions semi-historiques conservent le souvenir de peuples noirs, dans les Philippines, où nous rencontrons les Negritos, dans la Papuasie et dans une portion de l’Océanie, dans celle qu’on appelle spécialement la Mélanésie. Les nègres du type le plus caractérisé ont le crâne allongé, comprimé, étroit surtout aux tempes. L’os de la mâchoire supérieure se projette en avant, par cette disposition que les naturalistes appellent prognathisme ; de là les traits les plus saillants du visage de la race noire, le peu de saillie du nez, son épatement à l’endroit des narines et le développement exagéré des lèvres. Les cheveux sont noirs, courts et crépus, le système pileux en général très peu développé, ce qui se remarque aussi chez les différents mammifères des pays qu’habite le nègre. Avec quelques particularités dans la forme du torse et une courbure sensible des jambes, ce sont là les caractères essentiels et distinctifs de la race noire, bien plus que la couleur, car il est tel peuple de race blanche, comme les Abyssins, à qui un long séjour dans l’Afrique équatoriale a donné une teinte de peau tout aussi foncée. Le crâne de la race jaune présente une forme arrondie ; l’ovale de la tête est plus large que chez les Européens. Les pommettes sont fortement saillantes, les joues relevées vers les tempes ; par suite, l’angle externe des yeux se trouve élevé, les paupières comme bridées et à demi-closes. Le front s’aplatit au-dessus des yeux. Le nez est écrasé vers le front, le menton court, les oreilles démesurément grandes et détachées de la tête. La couleur de la peau se montre généralement jaune et tourne au brun dans certains rameaux. Les poils sont durs et presque constamment noirs comme les yeux. Quant à notre race blanche, elle est avant tout caractérisée par la beauté de l’ovale que forme sa tête. Les yeux sont horizontaux et plus ou moins largement découverts par les paupières ; le nez est plus saillant que large ; la bouche est petite ou modérément fendue, les lèvres sont assez minces. La barbe est fournie, les cheveux longs, lisses ou bouclés, et de couleur variable. La peau, d’un blanc rosé, a plus ou moins de transparence, selon le climat, les habitudes et le tempérament. Sous le rapport intellectuel et moral, la race blanche a une supériorité marquée sur les autres. C’est parmi les peuples qui y appartiennent que nous rencontrons, depuis une haute antiquité, le plus grand développement de civilisation et les tendances les plus progressives. Peut-être faut-il joindre à ces trois types, comme celui d’une quatrième race fondamentale de l’humanité, le type rouge, propre à l’Amérique, où il s’est certainement constitué. Nous avons indiqué déjà plus haut les principaux traits qui distinguent le visage de l’homme de ce type, très voisin dans sa construction osseuse du type blanc, mais s’en distinguant par la couleur, toujours d’un brun rouge ou cuivrée, avec plus ou moins d’intensité dans le ton, puis par la rareté du système pileux, car toutes les populations américaines ont les cheveux rares et courts, et sont imberbes. On ne saurait déterminer toutes les variétés sorties des innombrables mélanges opérés entre les trois races primordiales, ou dues à l’action combinée des influences sous lesquelles chacune de ces trois grandes races a pris naissance. Quelques-unes ont cependant des caractères spécifiques assez tranchés, assez permanents pour constituer des sous-races particulières. Ce sont : La race boréale, qui embrasse toutes les populations habitant au voisinage du cercle polaire arctique, et qui est intermédiaire entre les races blanche et jaune. C’est à cette race, nous l’avons vu plus haut, qu’appartenait une partie des habitants de notre contrée à l’époque quaternaire, les tribus qui ont laissé leurs vestiges bien caractérisés à Grenelle, sur les rives de la Seine, et à Furfooz en Belgique ; La race altaïque ou ougro-japonaise, qui est sortie du même métissage de blancs et de jaunes et qui présente une série continue de transitions graduelles entre ces deux types extrêmes ; la race boréale n’en est presque qu’une exagération, et par quelques-uns des peuples qui la constituent, comme les Lapons, la race altaïque arrive à la toucher d’une manière intime ; les Samoyèdes, plus boréaux de type et de demeure, forment le lien et la transition entre les deux ; ce sont surtout le langage et l’habitat qui constituent à la race altaïque une individualité pleinement distincte de celle de la race boréale ; on serait assez disposé à les envisager comme deux branches d’une même famille humaine que des milieux divers ont différenciées[3], mais qui sortiraient originairement d’une seule souche ; La race malayo-polynésienne, qui participe à la fois des types nègre, mongolique et blanc, et dont le domaine s’étend, de chaque côté de l’équateur, depuis Madagascar jusqu’en Polynésie ; La race égypto-berbère, qui a peuplé le nord et le nord-est de l’Afrique ; elle participe des races blanche et noire, et présente un grand nombre de variétés où l’un ou l’autre élément est prépondérant ; La race hottentote, de l’extrémité méridionale de l’Afrique, qui se place entre la race nègre et la race jaune ; La race noire pélagienne, dont les Papous, les Negritos et les Australiens sont les principales variétés ; on peut la considérer comme une branche delà race nègre, distinguée par sa brachycéphalie, tandis que les noirs africains sont éminemment dolichocéphales. On est ainsi amené à reconnaître dix grandes familles d’hommes, dix types, tant secondaires que primaires, qui, dans leur distribution actuelle, répondent sensiblement à des régions zoologico-botaniques assez nettement tracées. Nous l’avons dit plus haut, l’influence des milieux el l’hérédité rendant permanente une variété d’abord produite accidentellement, ont été, sans aucune contestation possible, les deux principaux facteurs de la formation des races humaines. C’est à eux seuls qu’il convient d’attribuer l’apparition des types fondamentaux autour desquels se groupent tous les autres, plus indécis, moins nettement définis et occupant une position intermédiaire. Mais dans la formation des types secondaires, qui tous participent dans une certaine mesure à la fois de plusieurs des types primordiaux, et surtout des innombrables variétés qui les subdivisent à l’infini et font passer de l’un à l’autre par une série de transitions graduelles et presque insensibles, il n’est guères douteux qu’une autre action se soit aussi exercée, celle du métissage, c’est-à-dire des unions entre deux races différentes mises en contact, qui a produit des types nouveaux portant l’empreinte de leur double origine. Ici encore, c’est par l’analogie avec les faits qui se produisent sous nos yeux que nous pouvons juger ceux qui ont marqué les temps primitifs de l’espèce humaine et de sa diffusion sur la surface de la terre. La prodigieuse expansion de la race blanche européenne, comme commerçante, civilisatrice et conquérante, depuis le XVe siècle, a produit et produit encore de nos jours de très nombreux faits de métissage de cette race avec les races de couleur en Amérique, dans l’extrême Asie et en Océanie. On peut évaluer actuellement à 18 millions, c’est-à-dire à 1/62 de la population totale du globe, le nombre des métis modernes de ce genre. Mais la plupart des croisements qui les produisent ne s’opérant que passagèrement, ils n’ont pu engendrer de véritables races, d’un caractère permanent. Le sang qui finit par prédominer davantage ramène peu à peu au type qu’il représente. C’est ainsi que dans certaines parties de l’Amérique centrale et méridionale, l’infusion toujours de plus en plus grande du sang indien chez les créoles d’origine espagnole, tend à faire reparaître à l’état presque pur la vieille race, qui avait été d’abord repoussée dans les forêts et les savanes, et à rendre au Nouveau-Monde sa population indigène. Mais là où le métissage se reproduit sans cesse avec les mêmes éléments, une race croisée tend à se constituer, qui prend même parfois la place de la race indigène. En Polynésie, la population primitive est graduellement remplacée par un croisement d’Européens et de Polynésiens. Aux Philippines, notamment à Luçon, les métis de Tagals, de Chinois et d’Espagnols voient leur chiffre incessamment grossir, et ils se substituent peu à peu aux insulaires primitifs. Au Cap, le croisement des Hollandais et des Hottentots donna naissance à des métis appelés Basters, qui devinrent bientôt assez nombreux pour inspirer des craintes. On les bannit au delà de la Rivière Orange. Ils s’y sont constitués sous le nom de Griquas, et leur population s’accroît rapidement par elle-même. C’est certainement un phénomène tout semblable qui s’est produit en beaucoup de lieux dans le passé, et plusieurs des races qui tiennent déjà une place dans l’histoire ancienne n’ont pas d’autre origine. Il n’est que bien peu de’ peuples dans le monde que l’on puisse considérer comme appartenant à une race absolument pure. Le milieu et l’hérédité, dit M. de Quatrefages, ont façonné les premières races humaines, dont un certain nombre a pu conserver pendant un temps indéterminé cette première empreinte, grâce à l’isolement. Peut-être est-ce pendant cette période, bien lointaine, que se sont caractérisés les trois grands types, nègre, jaune et blanc. Les instincts migrateurs et conquérants de l’homme ont amené la rencontre de ces races primaires, et par conséquent les croisements entre elles. Quand les races métisses ont pris naissance, le croisement même n’a fonctionné que sous la domination du milieu et de l’hérédité. Les grands mouvements de populations n’ont lieu qu’à intervalles éloignés et comme par crises. Dans l’intervalle d’une crise à l’autre, les races formées par croisement ont eu le temps de s’asseoir et de s’uniformiser. La consolidation des races métisses, l’uniformisation relative des caractères à la suite du croisement, ont été forcément très lentes par suite du défaut absolu de sélection. Par conséquent, toute race métisse uniformisée est en même temps très ancienne. Les instincts de l’homme ont amené le mélange des races métisses, comme ils avaient produit celui des races primaires. Toute race métisse, uniformisée et assise, a pu jouer, dans de nouveaux croisements, le rôle d’une race primaire. L’humanité actuelle s’est ainsi formée, sans doute pour la plus grande partie, par le croisement successif d’un nombre encore indéterminé de races. Les races les plus anciennes que nous connaissions, les races quaternaires, n’en sont pas moins représentées encore de nos jours, soit par des populations généralement peu nombreuses, soit par des individus isolés, chez lesquels l’atavisme reproduit les traits de ces ancêtres reculés. C’est un fait que nous avons exposé déjà dans le livre précédent. § 4. — L’HOMME PRIMITIF. Il serait du plus haut intérêt, parmi les grands types primordiaux de l’humanité, que nous trouvons déjà complètement constitués et aussi distincts qu’aujourd’hui dès les temps les plus anciens où remontent l’histoire positive et les monuments de la civilisation, d’arriver à déterminer quel est le plus antique et s’il en est un qui représente encore avec un certain degré d’exactitude l’homme primitif. Malheureusement c’est là une question à laquelle la science est impuissante à donner une réponse formelle. Elle n’a pas d’éléments certains pour déterminer quel était le type primitif de notre espèce. Ce qui paraît bien probable, et même presque certain, c’est que ce type a dû, dans le cours des âges, s’effacer et disparaître, et qu’il n’était précisément celui d’aucune des races actuelles. Les conditions de milieu dans lesquelles l’homme est apparu sur la terre ont profondément changé, puisque c’étaient celles d’une autre époque géologique. Comment admettre que de tels changements aient permis la conservation du type exact des premiers humains ? Quand tout se transformait autour de lui, l’homme ne pouvait rester immuable. Et d’ailleurs, comme nous venons de le faire voir, le métissage a eu aussi sa part dans cette modification. Cependant, d’autre part, nous avons constaté que la tête osseuse de la plus ancienne race quaternaire se retrouve non seulement en Australie dans quelques tribus, mais en Europe et chez des hommes qui ont joué un rôle considérable parmi leurs compatriotes. Les autres races delà même époque, à en juger de même par la tête osseuse, ont parmi nous de nombreux représentants. Elles ont pourtant traversé une révolution géologique qui nous sépare de notre souche originelle. Il n’y a donc rien d’impossible à ce que celle-ci ait transmis à un certain nombre d’hommes, peut-être dispersés dans le temps et dans l’espace, au moins une partie de ses caractères. Malheureusement on ne sait où chercher ces reproductions, plus ou moins ressemblantes, du type primitif ; et, faute de renseignements, il serait impossible de les reconnaître pour telles si on venait à les rencontrer. Ici l’observation seule ne peut donc fournir aucune donnée. Mais, éclairée par la physiologie, elle permet quelques conjectures. Il y a des anthropologistes qui ont voulu chercher l’homme primitif dans les tribus placées aux derniers rangs de l’espèce humaine, comme les Hottentots ou les Australiens. Mais pareille opinion n’est pas scientifiquement admissible, car ces tribus attestent par leurs caractères’ physiques un état de dégradation qui indique un état antérieur plus élevé, et qui est le résultat des conditions d’existence au milieu desquelles les a conduits le passé de leur race. Par contre, il est bien difficile, surtout quand on voit combien elle s’altère quand elle retombe dans une vie presque sauvage, de ne pas admettre dans la race blanche un perfectionnement du type, dû aux conditions exceptionnellement favorables de climat dans lesquelles elle a vécu, et surtout à la longue pratique delà civilisation. On observe chez toutes les espèces animales qui présentent des variétés nombreuses, un genre de phénomènes que les naturalistes ont qualifié du, nom à’atavisme. C’est l’apparition sporadique, dans toutes les variétés, d’individus qui reproduisent, au lieu du type de leurs auteurs directs, le type originaire de l’espèce, antérieur à la formation des variétés. Certains faits, qui se reproduisent de temps à autre dans les différentes races de l’humanité, paraissent devoir être regardés comme des faits d’atavisme. Les anthropologistes les. plus habiles, tels que M. de Quatrefages et M. le docteur Pruner-Bey, les considèrent comme pouvant jeter quelque lumière sur ce qu’étaient les ancêtres primitifs de notre espèce. Deux points surtout paraissent en ressortir : c’est que le visage des premiers hommes devait présenter un certain prognathisme et que leur teint n’était pas noir. Le trait anatomique du prognathisme, surtout de la saillie de la mâchoire supérieure, existe chez toutes les familles de la race noire ; il n’est pas moins accusé chez une partie de la race jaune. On y remarque une tendance sensible dans le type de la plupart des variétés groupées dans la sous-race boréale. Considérablement atténué chez les blancs, il y reparaît pourtant assez fréquemment chez des individus isolés, parfois à peu près aussi marqué que dans les deux autres groupes. Il existait chez toutes les races d’hommes de l’âge quaternaire qui nous sont jusqu’à présent connues. Tout semble donc indiquer que ce caractère devait être assez fortement prononcé chez nos premiers ancêtres. « Les phénomènes d’atavisme portant sur la coloration, dit M. de Quatrefages, sont fréquents chez les animaux. On les constate également dans l’espèce humaine. Cette considération me fait attacher une importance réelle à l’opinion d’Eusèbe de Salles, qui attribue une chevelure rousse aux premiers hommes. On a signalé, en effet, dans toutes les races humaines, des individus dont les cheveux se rapprochent plus ou moins de cette teinte. Les expériences de Darwin sur les effets du croisement entre races très différentes de pigeons conduisent à la même conclusion. Il a vu, à la suite de ces croisements, reparaître dans les métis des particularités de coloration propres à Y espèce souche et qui avaient disparu dans les deux races parentes. Or, dans nos colonies, le tierceron, fils de mulâtre et de blanc, a souvent les cheveux rouges. En Europe même, selon la remarque de M. Hamy, il naît souvent des enfants à cheveux rouges, lorsque le père et la mère sont franchement, l’un brun et l’autre blond. Dans tous les cas de cette nature, on dirait que le caractère primitif se dégage par la neutralisation réciproque des caractères ethniques opposés accidentellement acquis. Il est permis d’être plus affirmatif sur ce point que les auteurs de notre espèce n’étaient pas noirs. Le ton plus foncé de la peau, le développement exagéré de la matière noire ou pigmentum, qui se forme sous le derme, est très positivement un effet des climats brûlants et de l’ardeur du soleil, qui ne se produit que dans la région intertropicale, où certainement le berceau primitif de l’humanité ne s’est pas trouvé. De plus, on voit assez fréquemment apparaître, par un effet d’atavisme, des individus blancs ou jaunes dans les populations nègres ; on ne voit jamais naître de nègres au sein des populations blanches ou jaunes. M. de Quatrefages est même d’avis qu’on pourrait aller encore plus loin, que d’après d’autres faits de même classe on serait dans une certaine mesure en droit de conjecturer que le type originaire de l’humanité devait plutôt se rapprocher de celui de la race jaune, dont les langues sont aussi celles qui se sont conservées à l’état le plus primitif. Mais nous n’osons pas le suivre sur ce terrain encore bien peu assuré, et nous préférons nous borner aux données suivantes, qui paraissent contenir tout ce que la science peut dire actuellement sur cet obscur sujet avec une certaine assurance. Suivant toutes les apparences, l’homme du type originaire devait présenter un prognathisme accusé, et n’avait ni le teint noir ni les cheveux laineux. Il est encore assez probable, quoiqu’à un degré qui approche moins de la certitude, que son teint, s’il n’était pas noir, n’était pas non plus absolument blanc, et qu’il accompagnait une chevelure tirant sur le roux. L’homme, dit encore l’illustre anthropologiste auquel nous avons fait tant d’emprunts dans ce chapitre, l’homme a d’abord sans doute peuplé son centre d’apparition et les contrées immédiatement voisines. Puis il a commencé l’immense et multiple voyage qui date des temps tertiaires (?) et dure encore aujourd’hui. Il a traversé deux (?) époques géologiques ; il en est à sa troisième. Il a vu le mammouth et le rhinocéros prospérant en Sibérie, au milieu d’une riche faune ; tout au moins, il les a vus chassés par le froid jusque dans le midi de l’Europe ; il a assisté à leur extinction. Plus tard, lui-même a repris possession des barenlands ; il a poussé ses colonies jusque dans le voisinage du pôle, peut-être jusqu’au pôle lui-même, en même temps qu’il envahissait les sables et les forêts des tropiques, atteignait l’extrémité des deux grands continents et peuplait tous les archipels. Depuis bien des milliers
d’années, l’homme a donc subi Faction de tous les milieux extérieurs que nous
connaissons, celle de milieux dont nous pouvons tout au plus nous faire une
idée. Les divers genres de vie auxquels il s’est livré, les différents degrés
de civilisation auxquels il s’est arrêté ou élevé, ont encore diversifié pour
lui les conditions d’existence. Était-il possible qu’il conservât partout et
toujours ses caractères primitifs ? L’expérience, l’observation, conduisent à une conclusion tout opposée. Envoyant l’Anglo-Saxon de nos jours, bien que protégé par toutes les ressources d’une civilisation avancée, subir l’action du milieu américain et se transformer en Yankee, il nous faut admettre qu’à chacune de ses grandes étapes, l’homme, soumis a des conditions d’existence nouvelles, a dû s’harmoniser avec elles, et pour cela se modifier. Chacune de ces stations principales a nécessairement vu se former une race correspondante. Les caractères primitifs, ainsi atteints successivement, se sont inévitablement altérés de plus en plus, en raison de la longueur du voyage et de la différence des milieux. Parvenus au bout de leur course, les petits-fils- des premiers émigrants n’avaient certainement conservé que bien peu des traits de leurs ancêtres. Le type humain primitif a probablement présenté, pendant, un temps indéfini, ses caractères originels chez les tribus qui restèrent attachées au centre d’apparition de notre espèce. Quand vint l’époque glaciaire, qui, selon toute apparence, rendit inhabitable la première patrie de l’homme, ces tribus durent émigrer à leur tour. Dès lors, la terre n’eut plus d’autochtones ; elle ne fut peuplée que de colons. En même temps, l’action modificatrice dès milieux pesa sur les derniers venus, qui, eux aussi, se transformèrent. A partir de ce moment, le type primitif de l’homme a été perdu ; l’espèce humaine n’a plus été composée que de races, toutes plus ou moins différentes du premier modèle. § 5. — LA DESCENDANCE DES FILS DE NOA’H DANS LA GENÈSE[4]. Noa’h, comme nous l’avons déjà dit, avait, suivant la Bible, trois fils, Schem, ‘Ham et Yapheth. Dans le dixième chapitre de la Genèse, l’auteur inspiré donne le tableau des peuples connus de son temps, rattachés à la filiation de ces trois grands chefs de races de l’humanité nouvelle, postérieure au déluge. C’est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la haute antiquité. On est même en droit de le considérer comme antérieur à l’époque de Moscheh (Moïse), car il présenté un état des nations que les monuments égyptiens nous montrent déjà changé sur plusieurs points importants à l’époque de l’Exode. De plus, l’énumération y est faite dans un ordre géographique régulier autour d’un centre qui est Babylone et la Chaldée, non l’Égypte ou la Palestine. Il est donc probable que ce tableau des peuples et de leurs origines fait partie des souvenirs que la famille d’Abraham avait apportés avec elle de la Chaldée, et qu’il représente la distribution des peuples connus dans le monde civilisé au moment où le patriarche abandonna les rives de l’Euphrate, c’est-à-dire 2000 ans avant l’ère chrétienne. Depuis longtemps il a été reconnu que, malgré la forme généalogique donnée à ce tableau du chapitre X de la Genèse, tous les noms qui le composent sont des noms de peuples. On a soutenu, il est vrai, que c’étaient primitivement des noms d’hommes, et qu’il y avait là, non pas une liste de peuples, mais une généalogie proprement dite des premiers ancêtres dont ces peuples sortirent. La forme même des noms constituant la liste ne permet pas une semblable interprétation. Le plus grand nombre d’entre eux ne sont pas au singulier, comme c’est l’habitude constante pour les noms propres d’hommes ; ils ont la forme du pluriel hébraïque en im. Ce sont donc des appellations plurielles qui désignent une collectivité ethnique, et non le patriarche d’où on la regardait comme descendue. D’autres sont des noms de pays : Kena’an, par exemple, un des fils de ‘Ham, signifie « le bas pays ; » Miçraïm est un duel qui désigne la Haute et la Basse-Égypte. On trouve même dans la liste des noms de villes ; par exemple, quand nous y lisons que Kena’an engendra Çidon, son premier-né, ceci veut dire que Sidon fut la première métropole des Phéniciens. On a aussi beaucoup discuté sur la question de savoir si le principe de construction delà liste a été purement géographique ou bien ethnographique ; en d’autres termes, comme le dit fort bien M. Philippe Berger, « si l’auteur a seulement décrit ce qu’il avait sous les "yeux, ou bien s’il s’est inspiré de la tradition, et si cette table représente avec plus ou moins d’exactitude non pas seulement les relations géographiques, mais la filiation des peuples qui y figurent. » Les partisans de l’interprétation géographique prétendent que la classification des peuples est artificielle dans le document biblique, et que sous cette triple division l’on a compris tout le monde connu : Yapheth désignant tous les peuples situés à l’ouest ou au nord ; ‘Ham les habitants de la côte méridionale de l’Asie et de l’Afrique ; enfin Schem, ceux qui habitaient la. Syrie et les pays voisins, jusqu’à l’Arabie d’un côté et au golfe Persique de l’autre. On a prétendu aussi que, dans cette table, des peuples de races différentes ont été groupés ensemble ; qu’ainsi les Kenânéens sont donnés comme frères des Égyptiens, qui appartiendraient à une autre race. Mais cette objection a été soulevée sous l’empire d’un préjugé, très répandu il y a quelques années encore, lequel consistait à voir dans le langage le critérium infaillible de la race. Ce préjugé est aujourd’hui déraciné dans la science, et nous ferons voir un peu plus loin à quel degré les faits le démentent. Bien souvent les divisions des langues ne correspondent pas à celles des races. Cette idée fausse écartée, toute base manque aux arguments qu’on en tirait contre le caractère réellement ethnographique du tableau de la descendance de Noa’h dans la Genèse. Mais la meilleure démonstration de l’exactitude de ce caractère ethnographique ou ethnogénique sera l’analyse même du tableau. Elle ne laissera pas, je crois, de doute dans l’esprit du lecteur sur ce que nous y avons une classification des peuples, non d’après leur position géographique, mais d’après leur parenté d’origine, telle qu’elle se déduisait de la tradition, et de la ressemblance de leur type physique. Ce document fournit donc une base d’un prix inestimable pour les recherches historiques de l’ethnographie, c’est-à-dire de la science qui s’occupe de rechercher les affinités des nations entre elles et leurs origines. L’étude attentive des traditions de l’histoire, la comparaison des langues et l’examen des caractères physiologiques des diverses nations, fournissent des résultats pleinement d’accord sur cette matière avec le témoignage dulivre inspiré. Nous allons exposer, aussi brièvement que possible, les faits qui ressortent des renseignements ethnographiques de la Genèse et les constatations de la science moderne, qui sont venues les compléter ou les éclaircir[5].
FAMILLE DE ‘HAM. — ‘Ham, dont le nom veut dire le noir, le brun, est le père de la grande famille dont les peuples de la Phénicie, de l’Égypte et de l’Ethiopie étaient primitivement descendus. Ce groupe do populations, que représentent encore de nos jours les fellahs de l’Égypte, les Nubiens, les Abyssins et les Touaregs, et avec un mélange de sang blanc, probablement yaphétite ou indo-européen, dont on peut déterminer historiquement la date d’une manière approximative, les Berbères ou Amazigs, présente tous les traits anatomiques essentiels de la race blanche. Mais il se distingue par le teint toujours foncé, qui passe du brun clair à la couleur du bronze et presque au noir, par la taille, peu élevée, le menton fuyant, les lèvres grosses sans être très proéminentes, la barbe clairsemée, les cheveux très frisés sans être jamais crépus. Les classifications de l’anthropologie, fondées uniquement sur les caractères physiques, le délimitent exactement de même que le texte sacré. C’est la sous-race que nous avons qualifiée plus haut d’égypto-berbère, et qui tient une place intermédiaire entre les deux races primordiales blanche et noire. Suivant la Genèse, Ham eut quatre fils : Kousch, Miçraïm, Pout et Kena’an. Ce sont quatre divisions principales, ethniques et géographiques, de la famille. L’identité de la race de Kousch et des Éthiopiens est certaine ; les inscriptions hiéroglyphiques de l’Égypte désignent toujours les peuples du Haut-Nil[6], au sud de la Nubie, sous le nom de Kousch. Mais ce nom, dans la Genèse, comme celui d’Éthiopiens dans la géographie classique, possède un sens bien plus étendu. Avec les habitants non nègres du Haut-Nil, il embrasse tout un vaste ensemble de populations, étroitement apparentées entre elles par le type physique, sinon par le langage, qui s’étendent le long des rivages de la mer d’Oman, de la côte orientale de l’Afrique aux embouchures de l’Indus. Nous en avons la preuve par la liste que le texte biblique donne ensuite des fils de Kousch, c’est-à-dire des sous-familles que son auteur rattachait à la famille principale. Cette liste suit un ordre géographique parfaitement régulier d’ouest en est, de la manière suivante : Seba, que d’autres textes bibliques représentent comme relégué au plus loin dans le sud et mettent en rapport avec l’Égypte et l’Ethiopie ; il faut en rapprocher la grande ville de Sabfe et le port de Saba (Sabat chez Ptolémée), que Strabon place sur la rive occidentale de’ la Mer Rouge, au nord du détroit de Bab-el-Mandeb. ‘Havilah, que l’on ne doit pas confondre avec le peuple sémitique de même nom, classé dans la descendance de Yaqtan ; dans celle de Kousch, ‘Havilah représente la nation des Avalites, habitant les bords du golfe que forme la côte d’Afrique au sud du détroit donnant accès dans la Mer Rouge, du golfe de Zeïlah. Sabtah, dont le nom correspond manifestement à celui de la ville de Sabbatha ou Sabota, devenue plus tard la capitale des Chatramotites de la géographie classique, c’est-à-dire des habitants du ‘Hadhramaut, et l’un des plus grands marchés de l’Arabie méridionale. Ra’emah, que les Septante et saint Jérôme transcrivent Regma, d’après la transformation fréquente du ‘aïm sémitique en un γ grec ; on rapproche généralement Ra’emah du port de Regma, situé sur la rive arabe du golfe Persique, bien qu’il y ait à cette assimilation une difficulté philologique, dans le fait que le nom arabe indigène correspondant à Regma est Redjam, et non Re’am ou Regham. Cependant les fils que la Genèse attribue à Ra’emah semblent la confirmer : car le premier, Dedan, correspond sûrement à l’appellation de Daden, donnée à l’une des îles Bahreïn. Le second, Scheba, est plus obscur ; tout d’abord on serait tenté, et c’a été l’avis delà majorité des commentateurs, d’y voir les fameux Sabéens de l’Arabie-Heureuse, qui reparaissent sous le même nom de Scheba dans la descendance de Yaqtan, double emploi par lequel l’auteur inspiré aurait exprimé le fait d’une double couche ethnique, d’abord kouschite, puis yaqtanide, qui aurait contribué à la formation de ce peuple. Mais, sans s’éloigner autant du site de Ra’emah et de Dedan, le nom de Scheba peut s’expliquer par le peuple des Asabes, que les géographes classiques placent sur la côte de l’Oman actuel, où l’on cite aussi la ville de Batra-sabbes, et un peuple de Sabéens mentionnés par Pline. Sabteka, dont l’appellation doit être mise en parallèle avec celles de la ville de Samydacê et du fleuve Samydacês, sur le littoral de la Carmanie, où la géographie classique place aussi un fleuve Sabis et un peuple de Sabæ. Cette liste nous conduit ainsi, pour l’extension des peuples de la souche de Kousch, jusqu’à la frontière de la Gédrosie, où les écrivains grecs placent leurs Ethiopiens orientaux ou asiatiques, semblables d’aspect aux Éthiopiens africains ; et de là nous gagnons l’Inde, dont les anciennes traditions nous parleront d’un peuple brun de Kauçikas, habitant le pays antérieurement à l’arrivée des Aryas et absorbé par eux, peuple dont le nom offre une bien remarquable coïncidence avec celui de Kousch. La Bible place encore des Kouschites dans la partie méridionale du bassin de l’Euphrate et du Tigre, quand elle fait sortir de Kousch Nemrod, le fondateur légendaire de la puissance politique et de la civilisation des Chaldéo-Babyloniens. La tradition recueillie par les Grecs parle aussi de la dualité ethnique des Chaldéens et des Céphènes comme ayant formé originairement la population de cette contrée ; et le nom de Céphènes est sûrement un synonyme de celui de Kousch ; des bords de la Méditerranée jusqu’à ceux de l’Indus, il s’applique toujours aux mêmes populations. Les textes cunéiformes nous font connaître un peuple de Kasschi, répandu dans une partie de la Babylonie et dans le nord-ouest du pays de ‘Elam ; nous lui verrons jouer un grand rôle dans l’histoire de ces pays à une date reculée. Ce sont les Cissiens de la géographie classique, qui met aussi dans le nord de la Susiane des Cosséens, dont le nom paraît également un reste de celui de Kousch. Tout ceci nous montre que, pour l’auteur du document que fournit le chapitre X de la Genèse, Kousch est une grande famille de peuples couvrant une zone méridionale de territoires depuis le Haut-Nil à l’ouest jusqu’au Bas-Indus à l’est, famille dont l’unité physique était encore plus accusée dans la haute antiquité que de nos jours, mais n’a cependant pas tout à fait disparu, malgré les migrations qui depuis ont superposé sur différents points d’autres races à ce substratum ethnique. En revanche, elle ne nous offre pas dans l’histoire la même unité linguistique, unité sans doute rompue de bonne heure par des circonstances historiques. Nous constaterons, d’ailleurs, par d’autres exemples que dans le système de classification des races qui a servi de base au tableau généalogique des descendants de Noa’h, ce ne sont pas d’après les affinités du langage que l’on s’est guidé, mais d’après le type et aussi d’après certaines données traditionnelles sur la filiation des peuples. Dans les Livres Saints, Miçraïm est l’appellation constante de l’Égypte, qualifiée de Mouçour ou Miçir par les Assyriens, de Moudrâya par les Perses. De nos jours encore les Arabes appliquent le nom de Miçr soit à la capitale de l’Égypte, soit à l’Égypte entière. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, Miçraïm a la forme du duel, à cause de la fameuse division de l’Égypte en deux parties, haute et basse. De même qu’à Kousch, le texte sacré donne une série d’enfants, représentant autant de divisions ethniques secondaires, à Miçraïm. Les Loudim sont sûrement les Égyptiens proprement dits, de la race dominante, qui s’intitulaient eux-mêmes, nous l’avons vu plus haut, Rot ou Lot[7] « la race » par excellence. Les ‘Anamim, sont les ‘Anou des monuments égyptiens, population qui apparaît aux âges historiques brisée en débris répandus un peu partout dans la vallée du Nil ; elle a laissé son nom aux villes d’Héliopolis (en égyptien ‘An), Tentyris ou Dendérah (appelée aussi quelquefois ‘An) et Hermonthis (‘An-res, la ‘An du sud) ; deux de ses rameaux gardèrent pendant un certain temps après les autres une vie propre, l’un dans une portion de la péninsule du Sinaï, l’autre dans la Nubie ; ce sont probablement les gens de ce dernier rameau, les ‘Anou-Kens des inscriptions égyptiennes, que l’auteur du document ethnographique de la Genèse a eu en vue : Les Naphtou’him sont les habitants du pays de Memphis, dont le nom sacerdotal indigène était Nu-Phta’h, le domaine du dieu Phta’h. Les Pathrousim sont ceux de la Thébaïde, appelée en égyptien p-to-res le pays méridional. Les Kaslou’him sont plus embarrassants ; ils ont donné lieu à beaucoup de conjectures, dénuées de fondement suffisant. Ce qui complique ici la question, c’est que ni les documents égyptiens, ni les documents assyro-babyloniens ne nous fournissent d’appellation analogue. Il faut cependant remarquer que les Septante ont eu ici sous les yeux un texte différent de notre texte hébraïque, et que ce texte substituait au nom de Kaslou’him celui de ‘Hasmoniim, les gens du pays du natron, en égyptien ‘hesmen. Ceci fournit une désignation certaine de la partie occidentale du Delta et du nome libyque des Grecs, synonyme de celle de Milou’h’ki ou Melou’h’hi, par laquelle les textes cunéiformes désignent la même contrée, comme le pays du sel, en copte mel’h[8] ; et l’appellation de Maréa, placée dans la même contrée par les géographes classiques, doit dériver du même prototype égyptien. Cependant les peuples que la Genèse fait sortir des Kaslou’him rendent difficile de croire que ce nom désigne seulement la partie occidentale du Delta ; il est plus probable que dans la pensée de l’auteur sacré il s’étendait à toute la partie maritime de l’Égypte, habitée par une population particulière et plus asiatique que celle du reste du pays, depuis la frontière de la Libye jusqu’à celle du pays des Philistins. On peut même conjecturer que ce nom doit être regardé comme embrassant en outre la couche la plus ancienne de la population du pays philistin, caractérisée comme Céphénienne dans les traditions que les. Grecs recueillirent. En effet, le document biblique dit que des Kaslou’him sortirent les Pelischthim, c’est-à-dire les Philistins. Ceux-ci nous apparaissent dans l’histoire comme une population de la souche pélasgique, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, établie dans le XIVe siècle avant notre ère sur la côte palestinienne. Il est clair qu’en les faisant fils des Kaslou’him, l’auteur de la Genèse a voulu marquer la fusion qui s’était opérée sur ce terrain entre les envahisseurs venus du Nord et l’ancienne population, sortie de la souche de ‘Ham, fusion qui avait donné naissance à un peuple mixte et nouveau. Et par un des éléments qui avaient contribué ù sa formation, ce peuple pouvait être à bon droit qualifié de petit-fils de Miçraïm ; car il est facile de remarquer que, dans sa construction sous forme généalogique, le tableau donné par la Bible multiplie les degrés de génération séparant de la souche fondamentale, à proportion des mélanges de sang étranger qui rendent un peuple de race moins pure. Quant aux Kaphthorim, que le texte biblique associe aux Pelischthim, comme sortis de la même source, ce sont les habitants de l’île de Kaphthor, qui dans nombre d’autres passages de la Bible est certainement la Crète. La parenté ethnique des Crétois et des Philistins est attestée par le témoignage unanime de toute l’antiquité. Enfin, le dernier des fils de Miçraïm n’offre pas de doute pour ce qui est de sa signification ethnographique. Les Lehabim sont sûrement les Libyens, les Lebou des monuments égyptiens ; mais l’appellation doit être ici entendue dans un sens restreint, comme s’appliquant "seulement aux Libyens voisins de l’Égypte, chez qui pouvait s’être infusée une part de sang égyptien. Ces Lehabim pénétraient certainement jusque dans une partie du Delta occidental. Pout, troisième fils de ‘Ham, est un peuple africain dans un grand nombre de passages de la Bible. La tradition juive en fait les habitants des côtes septentrionales de l’Afrique jusqu’à l’extrémité de la Mauritanie. Ceci est confirmé par l’appellation de Phaiat donnée en copte à la Libye, ainsi que par l’existence d’un fleuve Phthuth ou Fut, mentionné dans la Mauritanie par les géographes grecs et romains. Les inscriptions cunéiformes perses mentionnent un pays de Poutiya parmi ceux qui étaient soumis à l’empire des Achéménides, et il ne peut être que la portion de la Libye qui reconnaissait leurs lois. D’un autre côté, il est bien difficile de ne pas comparer, à la suite de M. Ebers, le nom de Pout avec celui de Pount, qui désigne dans la géographie des anciens Égyptiens les pays au sud-est delà vallée du Nil, c’est-à-dire la côte africaine des Somâlis d’aujourd’hui et la côte opposée de l’Arabie-Heureuse. Dans les bas-reliefs historiques de l’Égypte, les gens de Pount, qui forment ainsi en Arabie le substratum ‘hamitique auquel se sont superposés les Sabéens yaqtanides, sont représentés avec la même coloration que les Égyptiens, et des traits qui participent à la fois de ceux de ce peuple et de ceux des Sémites purs. Ceci correspond fort bien avec le type physique des Somâlis actuels, qui, dans leurs propres traditions, se disent apparentés à la population la plus antique du Yémen et du ‘Hdhramaout. Il semble donc que, dans le tableau ethnographique de la Genèse, Pout ait un sens géographiquement aussi étendu que Kousch. Il désigne tout le vaste ensemble des populations de race éthiopico-berbère répandues au sud de l’Ethiopie kouschite et à l’ouest du bassin du Nil. Ces populations forment deux groupes principaux, séparés par l’interposition d’éléments nègres : d’abord les peuples du Pount des Égyptiens, c’est-à-dire les Somâlis et leurs congénères et voisins de la côte orientale d’Afrique, à cheval, comme les Kouschites leurs proches parents, sur les deux rives du golfe d’Aden ; puis la grande famille des peuples libyens et berbères, occupant tout le nord du continent africain, depuis le voisinage de l’Égypte jusqu’à l’Océan Atlantique et même ayant occupé les îles Canaries indigène du pays de Pount dans cet océan. Les peuples de cette dernière famille se donnent à eux-mêmes le nom générique d’Amazigs (les nobles), que l’antiquité nous offre déjà dans les appellations des Mazices et des Maxitains, que les Phéniciens, qui fondèrent Carthage, trouvèrent à leur arrivée et qui paraissent identiques aux Maxyes ou Libyens laboureurs, appelés Maschouasch dans les documents égyptiens. Entre ces deux groupes de populations, auxquelles s’applique en commun le nom biblique de Pout, la parenté ethnographique et linguistique est très grande. Mais le type primitif et ‘hamitique de la famille paraît s’être mieux conservé qu’ailleurs chez les Somâlis et les autres peuples du même groupe. Les Berbères ou Amazigs ont reçu à. une époque ancienne une forte infusion de sang de la race blanche pure, qui les a sensiblement modifiés. C’est le résultat de la grande invasion maritime des Ta’hennou ou Tama’hou aux cheveux blonds et aux yeux bleus, que les monuments égyptiens du temps de la XVIIIe et de la XIXe dynastie nous montrent répandus dans la Libye, et rapportent à la même race que les Ha-nebou ou habitants du continent et des îles de la Grèce, ainsi que du midi de l’Italie. Sous le nom de Kena’an sont compris les Phéniciens et toutes les tribus étroitement apparentées à eux, qui, avant l’établissement des Hébreux, habitaient le pays compris entre la Méditerranée et le bassin de la mer Morte et du Jourdain, qui fut plus tard la Terre-Sainte. Le document biblique énumère de nombreux fils de Kena’an ; il pousse ici la subdivision jusqu’à un degré très minutieux, à cause des rapports étroits entre l’histoire des Kenânéens et celle du peuple choisi de Dieu. Il compte donc comme issus de Kena’an : Çidon, son premier-né, c’est-à-dire, comme nous l’avons déjà remarqué, la ville de Sidon (en phénicien Çidon), première métropole des Phéniciens ; ce nom représente ici tout le peuple des Kenânéens maritimes ou Phéniciens, qui se donnaient à eux-mêmes le nom de Çidonim ou Sidoniens. ‘Heth, qui représente le grand peuple des Kheta des monuments égyptiens, des ‘Hatti des Assyriens, établi entre l’Oronte, l’Euphrate et l’Aman us, peuple que nous verrons tenir une place de premier ordre dans l’histoire des contrées syriennes pendant six siècles au moins, depuis le temps où la XIXe dynastie monta sur le trône d’Égypte jusqu’à celui où les Sargonides régnèrent en Assyrie ; une petite peuplade de ’Hittim, colonie détachée de cette grande nation, est signalée auprès de ‘Hébron. Le Yebousi ou peuple de Yebous, localité qui devint ensuite Yerouschalaïm (Jérusalem). Le Amori, nation qu’à l’époque de la conquête de la Palestine par les Hébreux nous voyons habiter les montagnes d’Éphraïm et de Yehoudah (Juda) et se prolonger encore plus dans le sud ; les monuments égyptiens nous montrent aussi une peuplade isolée d’Amorim habitant plus au nord, auprès de Qadesch sur le haut Oronte. Le Girgaschi, peuple qui est encore nommé parmi ceux que dépossédèrent les Hébreux, mais dont on ne précise pas la situation dans le pays de Kena’an. Le ‘Hivi, dont les récits bibliques de la conquête de la Terre-Promise mentionnent des tribus à Schechem (Sichem), à Gib’eon et dans le voisinage du mont ‘Hermon. Le ‘Arqi, de Arca dans le Liban, un peu au nord de Tripolis. Le Sini ou peuple de la ville de Sin, située un peu plus haut dans la même région, en remontant du sud au nord, direction que la liste suit désormais très exactement. Le Arvadi, de la ville insulaire d’Arvad, l’Aradus de la géographie classique. Le Çemari, dont la cité est appelée Simyra des Grecs et des Latins. Le ‘Hamathi, de la grande ville de ‘Hamath dans la vallée de l’Oronte. L’inscription de Kena’an parmi les fils de ‘Ham a été le principal argument dont on s’est servi pour attaquer l’exactitude et le caractère ethnographique du tableau des peuples dans le chapitre X de la Genèse. On y objectait qu’ils devaient appartenir à la famille syro-arabe ou au sang de Schem, puisqu’ils parlaient un idiome purement sémitique, le même que celui des Hébreux. Aujourd’hui, dans le point de vue actuel de la science, cet argument linguistique a perdu beaucoup de sa force. Les érudits qui ont étudié le plus à fond les Phéniciens et les autres Kenânéens, comme M. Renan, reconnaissent qu’en dépit de leur langage sémitique et de la forte infiltration de sang syro-arabe qui dut nécessairement se produire parmi eux, une fois qu’ils furent établis dans la Palestine et dans la région du Liban, le fond premier de ces peuples était plus apparenté aux Égyptiens, avec lesquels ils ont tant de légendes religieuses communes, qu’aux nations de Schem. Ceci s’accorde avec la tradition, constante dans l’antiquité et chez les Phéniciens eux-mêmes, qui les faisait venir des bords du golfe Persique, c’est-à-dire d’un domaine,qui appartient exclusivement aux peuples de ‘Ham. Les Égyptiens, sur leurs monuments, donnent aux gens de Kefta, les Phéniciens, des traits et un costume qui se rapprochent beaucoup des leurs propres ; ils les peignent en rouge comme eux-mêmes. Et c’est à cette couleur de teint rouge qu’a trait le nom de Φοίνικες, qui leur a été donné par les Grecs. En même temps, quand on voit ce nom de Phéniciens prendre en latin la forme Poeni, qui s’applique spécialement aux Kenânéens auxquels, les Romains et les autres Italiotes ont eu le . plus anciennement affaire, c’est-à-dire aux Carthaginois, on en arrive à soupçonner que les Grecs ont dû helléniser en Φοίν-ικες, pour y donner un sens dans leur propre idiome, une appellation asiatique, dont Poeni aura mieux conservé la forme indigène et dont la ressemblance avec le Pount égyptien est à tout le moins digne d’attention. Au reste, la contradiction apparente que l’on a cru remarquer entre la place donnée à Kena’an dans le tableau ethnographique de la Genèse, et la nature de la langue que parlait ce peuple, tient surtout à l’habitude que l’on a prise, par suite de la confusion qui a longtemps régné entre les faits philologiques et les faits ethnographiques, d’appeler langues sémitiques le rameau syro-arabe des idiomes à flexion. Des savants de premier ordre, et dont l’opinion possède une autorité supérieure, ont déjà fait remarquer ce que cette expression a d’impropre. Une notable partie, sinon la majorité des peuples que la Bible rapporte à la descendance de ‘Ham, en particulier ceux du rameau de Kousch, parlaient des langues de cette classe. Le fait de Kena’an n’est pas isolé ; il appartient, au contraire, à tout un ensemble. Le ghez est parlé par une population dont le fond — les caractères physiques des Abyssins l’attestent — est resté en très grande majorité kouschite, et où les quelques éléments sémitiques qui se sont infiltrés de manière à devenir dominateurs, venant du Yémen, auraient apporté l’himyarite comme ils ont apporté l’écriture de l’Arabie méridionale, si le langage venait d’eux. La langue himyarite ou sabéenne elle-même, est l’idiome d’un pays où les peuples de Kousch et de Pount précédèrent les tribus de la descendance de Yaqtan, et formèrent toujours un élément considérable de la population. Si les Yaqtanides de l’Arabie méridionale eurent, au temps de leur civilisation, un langage différent de celui des tribus de même souche qui s’étaient établies, dans le reste de la péninsule, n’est-il pas très vraisemblable de penser qu’ils le durent à l’influence de la race antérieure, qui se fondit avec eux ? De même, quand nous exposerons l’histoire des civilisations du bassin de l’Euphrate et du Tigre, la langue de la famille syro-arabe, dite assyrienne, nous apparaîtra comme ayant été à l’origine la langue de l’élément kouschite de la population de la Babylonie, transmise ensuite, avec la civilisation chaldéo-babylonienne, au peuple d’Asschour, de la pure race de Schem. Tout ceci vient favoriser, au point de vue de la linguistique, et même, dans une certaine mesure, de l’histoire, la théorie de ceux qui voient dans les nations de ‘Ham la branche la plus ancienne de Cette famille de peuples répandus dans toute l’Asie antérieure, des sources de l’Euphrate et du Tigre au fond de l’Arabie, des bords du golfe Persique à ceux de la Méditerranée, et sur les deux rivages du golfe Arabique, en Afrique et en Asie. Cette branche ancienne de la famille sémitique, partie la première du berceau commun, disent les partisans d’une telle opinion, la première aussi parmi cette foule de hordes longtemps nomades, se fixa, puis s’éleva à la civilisation en Chaldée, en Ethiopie, en Égypte, en Palestine, pour devenir à ses frères demeurés pasteurs un objet d’envie et d’exécration tout à la fois. De là cette scission entre les enfants de Schem et ceux de ‘Ham, ces derniers au sud et à l’ouest, les autres à l’est et au nord, quoique tous fussent les membres d’une même famille originaire, parlant une même langue, divisée entre de nombreux dialectes, et qu’on est autorisé à nommer ethnographiquement dans son ensemble famille syro-arabique ou syro-éthiopienne, par opposition à la famille indo-persique ou indo-germanique (aryenne), autre grande section de la race blanche[9]. Cette manière de voir se concilierait d’une manière très heureuse avec la singulière facilité que les ‘Hamites montrent dans l’histoire à se confondre avec les Sémites purs, de manière à ne plus pouvoir s’en distinguer, toutes les fois qu’il y a eu superposition des deux éléments, comme dans l’Arabie méridionale. Mais, d’un autre côté, anthropologiquement il semble, dans l’antiquité comme de nos jours, y avoir entre les peuples de Schem et de ‘Ham une distinction qui n’existe pas dans le langage, et qui correspond à celle qu’établit la tradition biblique ; les peuples de ‘Ham ont aussi, dans une certaine mesure, un génie à part, plus matérialiste et plus industriel que celui des purs Sémites, à côté de bien des instincts communs ; enfin même, si une partie notable des ‘Hamites parle des langues décidément sémitiques, d’autres, comme les Égyptiens, ont des idiomes qui sont sans doute apparentés à la famille sémitique, mais possèdent cependant une originalité propre assez considérable pour qu’on doive en faire une famille à part. Peut-être est-il possible d’expliquer et de concilier ces données contradictoires, en modifiant la formule dans le sens des faits que l’anthropologie permet déjà d’entrevoir. Il faudrait supposer dans ce cas que le premier rameau détaché du tronc commun, celui des peuples de ‘Ham, subit un métissage avec une race noire ou mélanienne, qu’elle trouva antérieurement établie dans les pays où elle se répandit d’abord, tandis que les Sémites, demeurés en arrière, conservaient dans sa pureté le sang,de la race blanche. Le métissage aurait été suffisant pour faire des peuples de ‘Ham, au bout d’un certain temps de séparation, une race réellement différente de celle de Schem, sans cependant effacer les affinités originaires, surtout dans le langage. Mais en même temps, le mélange avec un autre sang, qui serait ainsi le caractère distinctif des ’Hamites, ne se serait pas opéré partout dans les mêmes proportions ; ici, le sang mélanien aurait prédominé davantage, et là moins. Ainsi les nations groupées par la Bible dans la race de ‘Ham offriraient en réalité comme une gamme de métissages plus ou moins prononcés, depuis des peuples aussi rapprochés des Sémites purs et aussi difficiles à en distinguer par certains côtés, que les Kouschites de Babylone ou les Kenânéens de la Phénicie, jusqu’à des peuples à la physionomie déjà nettement tranchée, comme les Égyptiens. Et il est à remarquer qu’en envisageant ainsi la race de ‘Ham, le plus ou moins d’affinité des idiomes de ses différents peuples avec les langues sémitiques coïncide avec le plus ou moins de ressemblance des mêmes peuples avec le type anthropologique des Sémites purs, marque incontestable d’une proportion plus ou moins forte de mélange d’un sang étranger, autre que celui de la race blanche. Les observations que nous venons de faire au sujet du langage laissent en dehors les Kouschites orientaux du tableau ethnographique de la Genèse, c’est-à-dire les peuples habitant à l’est du golfe Persique et rattachés encore par l’écrivain sacré à la descendance de Kousch. Ceux-là, en effet, aussi haut qu’on les rencontre dans l’histoire, s’y montrent parlant des idiomes radicalement différents de ceux des peuples de Schem et des autres peuples de ‘Ham. Mais ceci ne saurait être une raison suffisante pour contester formellement la tradition de leur parenté ethnique avec le reste des ‘Hamites. D’ailleurs il faut tenir compte de la façon dont ces peuples, les plus reculés dans l’est de l’horizon géographique de la Bible, se confondent par une série de transitions graduelles avec les Dravidiens de l’Inde, que l’antiquité n’a jamais distingués des Ethiopiens ou Kouschites. La côte entre le golfe Persique et l’Indus paraît avoir été, dès une époque extrêmement reculée, le point de rencontre et de fusion de deux races distinctes d’hommes à peau brune, inclinant plus ou moins vers le noir pur. Les ‘Hamites furent donc, des trois grandes divisions de l’humanité Noa’hide que la Bible montre se séparant après la confusion des langues, ceux qui s’éloignèrent les premiers du centre commun, se répandirent d’abord sur la plus vaste étendue de territoire et fondèrent les plus antiques monarchies. Ce fut chez eux que la civilisation matérielle fit d’abord les plus rapides progrès. Mais Noa’h avait maudit son fils. ‘Ham pour lui avoir manqué de respect dans son ivresse et pour avoir tourné en dérision la nudité paternelle. Tu seras le serviteur de Schem et de Yapheth, lui avait-il dit. Cette malédiction s’accomplit dans sa plénitude. Les empires fondés parles ‘Hamites se trouvèrent bientôt en contact avec les deux autres races, qui entrèrent en lutte avec eux, les vainquirent et s’emparèrent des pays qu’ils occupaient. Lés Sémites les remplacèrent dans la Chaldée, dans l’Assyrie, dans la Palestine et dans l’Arabie ; les Aryas dans l’Inde et la Perse. Les descendants du fils maudit ne maintinrent leur puissance qu’en Afrique et particulièrement en Égypte, où s’éleva la plus florissante de leurs colonies. Et même encore là, dans la suite des siècles, les effets de la malédiction paternelle ont fini par les atteindre. Si ‘Ham y est resté libre et maître plus longtemps qu’ailleurs, il n’y est pas moins à la fin devenu le serviteur de Schem. Après avoir été conquis par les Grecs et les Romains, descendants de Yapheth, la Phénicie, l’Égypte et le nord de l’Afrique obéissent depuis des siècles à des Arabes ; les Éthiopiens ont été conquis par des tribus sémitiques, qui se sont amalgamées avec eux. Si la famille de ‘Ham subsiste encore dans un certain nombre de pays et y forme toujours le fond de la population, nulle part, depuis des centaines et des centaines d’années, elle n’a une vie propre et nationale et ne forme un Etat indépendant. Les descendants de ‘Ham furent les premiers, parmi l’humanité Noa’hide, à marcher dans la vie de la civilisation matérielle, qu’ils poussèrent à un haut degré de développement. Mais s’ils avaient sous ce rapport des aptitudes remarquables, leur race garda toujours l’empreinte des tendances dépravées et grossières qui avaient attiré sur ‘Ham la malédiction paternelle. Les peuples ‘hamites ont été tous profondément corrompus, à part les Égyptiens, qui forment à cet égard parmi eux une éclatante exception. Leurs religions (en mettant aussi à part celle de l’Égypte) ne sortaient pas du matérialisme le plus absolu, exprimé sans pudeur, par des fables révoltantes et par des symboles d’une inconcevable obscénité. Aussi le triomphe des familles de Schem et de Yapheth a-t-il été partout la substitution d’une civilisation plus haute et plus épurée à celle que les ‘Hamites avaient établie, l’avènement d’une morale plus pure et d’une religion plus spirituelle, même au milieu des erreurs de l’idolâtrie. FAMILLE DE SCHEM. — Les descendants de Schem furent les seconds à se répandre dans le monde, en quittant la contrée que les enfants de Noa’h avaient habitée à la suite du Déluge. Ils occupèrent les pays qui s’étendent depuis la haute Mésopotamie jusqu’à l’extrémité méridionale de l’Arabie et depuis les bords de la mer Méditerranée jusqu’au delà du Tigre. L’énumération de leurs différentes branches, dans le chapitre X de la Genèse, suit un ordre géographique régulier, procédant d’est en ouest. Car on donne pour fils à Schem, ‘Elam, Asschour, Arphakschad, Loud et Aram. Le premier-né est donc ‘Elam. Ce nom, d’origine sémitique et signifiant le pays élevé, le pays des montagnes par opposition aux plaines de la Chaldée[10], est celui par lequel les Assyriens, les Hébreux et les peuples congénères désignaient la Susiane ou Élymaïs de la géographie classique, la contrée située entre le Tigre et la Perse. Au premier abord on est surpris de voir la population de ce pays donnée comme sémitique, car linguistiquement le pays de ‘Elam est absolument étranger au monde sémitique. La langue qu’on y parlait, et dont nous possédons un certain nombre de monuments écrits, était un idiome agglutinatif, tenant de très près à celui du vieux fond anté-aryen de la population de la Médie, et apparenté dans une certaine mesure aux langues altaïques, particulièrement à celles du rameau turc. Il ne paraît pas douteux aujourd’hui que la masse du peuple élamite ou susien ne se composât de tribus juxtaposées et en partie croisées, se rattachant les unes à la souche de ‘Ham comme les Cissiens et les Cosséens, les autres à la souche touranienne comme les Susiens proprement dits, comme les Susiens (Schouschinak dans leur propre langage), les Apharséens ou Amardes (Hafurti) et les Uxiens (nom tiré par les Grecs du Perse Ouoaja). Les sculptures assyriennes représentant des scènes des guerres des monarques ninivites dans le pays de ‘Elam, montrent qu’un type négroïde très caractérisé prédominait dans cette population de sang extrêmement mélangé. Mais en même temps elles justifient l’écrivain biblique en attribuant à la plupart des chefs de tribus et des hauts fonctionnaires de la cour des rois de Suse un type de race tout à fait différent de celui des hommes du peuple, des traits qui sont, sans aucun doute possible, ceux des nations syro-arabes. Il y avait donc eu dans le pays de ‘Elam, à une époque qu’il nous est impossible de déterminer, introduction d’une aristocratie se rattachant à la race de Schem, aristocratie qui avait rapidement adopté le langage du peuple auquel elle s’était superposée, mais qui, ne se mélangeant pas avec les indigènes des classes inférieures, avait conservé fort intact son type ethnique particulier. C’est là ce que le document sacré désigne sous le nom de ’Elam, fils de Schem. Asschour, second fils de Schem, personnifie la nation des Assyriens, qui joua un si grand rôle dans l’histoire de l’Asie occidentale. La langue et la civilisation sont communes aux Assyriens proprement dits et aux Chaldéo-Babyloniens ; mais les monuments figurés de ces peuples eux-mêmes montrent que leur type physique et anthropologique différait profondément. Les Assyriens ont tous les traits propres aux peuples syro-arabes ; ils peuvent en passer pour une des nations caractéristiques et typiques au point de vue de l’apparence extérieure, ce qui s’applique très bien à la place donnée à Asschour dans la descendance de Schem. Les Chaldéo-Babyloniens s’en distinguent d’une façon très accusée ; il suffit de voir leur figure dans les bas-reliefs exécutés avec soin pour reconnaître que, malgré la communauté de langue, ce sont des hommes d’une autre race. Et en effet, nous verrons en étudiant leur histoire que leur, nation s’est formée de la fusion de deux éléments ethniques : l’un à qui appartenait en propre à l’origine la langue de la famille syro-arabe dit abusivement assyrienne, mais que la Genèse, en parlant de son héros légendaire Nimrod, range dans la descendance de Kousch ; l’autre, parlant un idiome agglutinatif très particulier, est le peuple de Schoumer et d’Akkad, comme il s’intitulait lui-même, qui paraît devoir être rapporté à la souche touranienne. La distinction d’origine ethnique, que la Bible établit entre les Assyriens et les Chaldéo-Babyloniens, est donc parfaitement justifiée au point de vue scientifique. Le texte sacré ajoute que c’est de la terre où Nimrod avait établi son empire kouschite et où se trouvaient les quatre villes de Babel (Babilou, Babylone), Érech (Ourouk, Orchoé), Akkad et Kalneh (Koulounou), que sortit Asschour ; après quoi il bâtit Ninive et les cités voisines. Ceci encore est de la plus merveilleuse exactitude. Nous verrons, en effet, dans le livre de cette histoire qui sera consacré aux Assyriens, que la civilisation chaldéo-babylonienne était déjà depuis longtemps constituée, et parvenue à un haut point de splendeur quand les tribus de race sémitique pure, riveraines du Tigre, qui formèrent ensuite la nation assyrienne, étaient encore à l’état de hordes confuses, nomades et à demi barbares, auxquelles on donnait le nom collectif de Gouti, en hébreu Goim. Une colonie babylonienne, prenant sa route vers le nord, s’établit sur la rive occidentale du Tigre, à l’entrée du territoire de ces tribus, dans le lieu qui s’appelle aujourd’hui Kalah-Scherghât. Elle y fonda une ville, consacrée au culte du dieu Asschour, un des dieux du panthéon chaldéo-babylonien. Cette ville devint le foyer d’où la civilisation et la langue de Babylone rayonnèrent sur les Gouti et les conquirent. Peu à peu ils se groupèrent autour de ce centre, reconnurent sa suprématie et se formèrent en unité nationale sous le gouvernement de chefs, primitivement sacerdotaux, qui résidaient dans la ville d’Asschour. Le dieu Asschour, sous les auspices duquel ils s’étaient ainsi civilisés et constitués, devint leur grand dieu national, le peuple que forma leur groupement le peuple d’Asschour et leur territoire le pays d’Asschour. Le troisième fils de Schem, dans le tableau ethnographique de la Genèse, est appelé Arphakschad. C’est une souche ethnique que l’auteur représente comme se divisant, au bout de quelques générations, en deux grands rameaux, les Tera’hites ou les Hébreux et les peuples qui leur sont intimement apparentés, les Yaqtanides ou populations sémitiques de l’Arabie méridionale. Les premiers noms de la généalogie de cette section de la race de Schem, à laquelle l’écrivain sacré donne un développement tout spécial, parce que c’était celle à laquelle appartenait le peuple choisi dont il racontait l’histoire, ont un caractère à part ; ils ne sont évidemment ni personnels, ni ethnographiques ; leur sens est a la fois géographique et historique. Ils représentent les premiers faits de la migration d’est en ouest, de ce groupe des descendants de Schem après la constitution de son individualité propre et avant sa division en deux courants divergents. Arpha-Kschad signifie limite du Chaldéen ou plutôt limitrophe du Chaldéen ; c’est l’indication du point où fut le berceau du groupe. Schela’h, nom donné comme celui de son fils, exprime l’impulsion en avant, la mise en marche de ce rameau dépopulations, sortant de son premier séjour pour se porter vers l’occident. A la génération suivante ‘Eber représente le passage au delà (de l’Euphrate), qui dut, en effet, avoir lieu pour permettre aux Yaqtanides de gagner l’Arabie et aux Tera’hites de s’établir autour d’Our des Kaschdim ou Chaldéens, qui fut le point de départ de leur dernière migration. Il rappelle aussi que les populations de la Syrie, en vertu de ce même fait, donnèrent aux Tera’hites, quand ils vinrent s’établir au milieu d’elles, le nom de ‘Ebrim ou Béni ‘Eber, c’est-à-dire les gens venus d’au delà du fleuve, d’où l’on a fait Hébreux. C’est à la génération après ‘Eber, autrement dit après le passage sur la rive droite de l’Euphrate, que s’opère la division du tronc ethnique en deux rameaux. Le représentant de celui d’où sortirent les Tera’hites est Peleg, dont le nom exprime l’idée de « division, » et le texte sacré insiste sur cette signification ; le représentant du rameau qui prend dès lors sa route vers l’Arabie, a un nom ethnique, Yaqtan. Yaqtan revêt dans la tradition arabe la forme Qa’htan, qui est le nom d’un canton situé dans le nord du Yémen, sans doute celui d’où rayonnèrent toutes les tribus de cette race, qui se superposèrent aux anciens habitants ‘Hamites sur le littoral arabe de la mer d’Oman. Les peuples yaqtanides ou qa’htanides constituent dans la péninsule arabique la couche de populations que les traditions recueillies par les Musulmans appellent Moute’arriba. Ils habitèrent, dit le texte, à partir de Mescha, en allant vers Sephar, jusqu’à la Montagne de l’Orient. Ces points géographiques sont bien clairs : Mescha est la Mésène de la géographie classique, le Maisân des écrivains syriaques, auprès de l’embouchure commune de l’Euphrate et du Tigre, avec le Mésalik de nos jours, c’est-à-dire la partie de désert, actuellement habitée par la grande tribu arabe des Benou-Lam, qui s’étend immédiatement en arrière de la contrée fertile du ‘Iraq-’Araby ; Sephar est le Saphar des géographes grecs et latins, qui fut un temps la capitale des Sabéens, le Zhafâr d’aujourd’hui ; quant à la Montagne de l’Orient, cette désignation, par rapport à la péninsule arabique, a trait évidemment au massif montueux et fortement relevé du Nedjd. Ainsi les indications de la Genèse déterminent pour l’habitation des Yaqtanides une vaste zone qui traverse toute l’Arabie et comprend, à partir du Mésalik, le Djebel-Schommer, le Nedjd, le midi du ‘Hedjâz, le Yémen, le ‘Hadhramaout et le Mahrah. Sur ce territoire, l’écrivain biblique compte treize fils de Yaqtan ou peuples principaux issus de cette souche : Almodad, dont le nom présente l’article arabe al ; ce sont probablement les Djor’hom de la tradition arabe, l’une des plus puissantes nations issues de Qa’htan, qui habitait une portion du ’Hedjâz et dont les rois légendaires sont presque tous désignés par l’appellation de Modhadh. Schaleph correspond bien manifestement aux Salopeni de la géographie classique et au canton actuel de Salfieh, au sud-ouest de Çan’âa. ‘Haçarmaveth est la forme que devait revêtir régulièrement en hébreu le nom du ‘Hadhramaout, le pays des Chatramotites des Grecs. Yera’h ne peut être que la traduction hébraïque d’un nom de peuple, qui en arabe avait le sens de peuple de la lune ; les commentateurs hésitent pour l’application de ce nom entre les Benou-Helal ou fils de la nouvelle lune, ancien peuple du nord du Yémen, les Aliléens de la géographie classique, et la région du Djebel Qamar, la montagne de la lune, dans le ‘Hadhramaout oriental. Pas de doute que Hadoram ne corresponde aux Adramites des géographes classiques, donnés pour voisins des Chatramotites mais distincts d’eux. Ouzal représente le canton du Yémen ouest située la ville de Çan’âa, que les traditions arabes affirment s’être appelée Aouzâl jusqu’à la conquête éthiopienne du Ve siècle de l’ère chrétienne. Avec Diqlah nous sommes obligés de rentrer dans la voie des conjectures ; aucun canton de l’Arabie ne nous offre d’appellation analogue ; mais ce nom signifie palme en hébreu ; il doit donc désigner une contrée particulièrement riche en palmiers, ou bien où l’on rendait un culte religieux au dattier, comme le faisaient les habitants de Nedjrân ; la situation de ce dernier canton conviendrait fort au groupement de Diqlah avec les noms voisins. ‘Obal, qui peut répondre à un protype arabe Ghobal, rappelle à l’esprit les Gebanitae de Pline, qui habitaient à l’ouest du canton d’Aouzal, sur le bord de la mer, et dont la capitale, Tamna, était une si grande ville qu’elle comptait jusqu’à 65 temples. Abimaël, le père de Maël, représente un des cantons du pays de Mahrah, la région principale de production de l’encens ; le naturaliste grec Théophraste dit, en effet, que de son temps le meilleur encens venait du district de Mali, qu’on ne saurait manquer d’identifier avec Maël. Le sens de Scheba est certain ; ce sont les célèbres Sabéens, le peuple le plus considérable et le plus fameux de l’Arabie-Heureuse. Vient ensuite Ophir. Il ne saurait être ici question de l’Ophir indien, du pays d’Abhîra, près des bouches de l’Indus ; mais la conjecture la plus vraisemblable, au sujet de l’Ophir arabe, est que ce nom avait été appliqué dans l’usage à la région qui servait d’entrepôt ordinaire aux produits de l’Ophir indien, c’est-à-dire aux alentours du port de ‘Aden, où les vaisseaux de l’Inde avaient l’habitude d’apporter leurs marchandises, qu’y prenaient d’autres vaisseaux faisant la navigation de la mer Rouge. Et, en effet, nous voyons dans les géographes classiques la province du Yémen qui s’étend le long du détroit de Bal-el-Mandeb, depuis Muza (aujourd’hui Maouschid) jusqu’à ‘Aden, appelée pays de Maphar, appellation qui reproduit celle d’Ophir, avec une préformante m, très fréquente dans les noms de lieux sémitiques. ‘Havilah est le pays de Khaoulân dans le nord du Yémen, touchant à la frontière du ‘Hedjâz ; c’est jusque là, est-il dit plus loin dans la Genèse (XXV, 18), que s’étendirent au sud les tribus de la descendance de Yischmaël (Ismaël). Enfin le dernier des fils de Yaqtan est Yobab, dont le nom paraît être altéré et devoir se corriger en Yobar ; car Ptolémée mentionne des Iobaritæ dans l’Arabie méridionale, et les traditions arabes enregistrent un peuple Wabar, issu de Qa’htan, qui habitait à l’orient de ‘Aden jusqu’à la frontière du ’Hadhramaout. Pendant que la branche de Yaqtan se divise ainsi, la descendance de Peleg se continue par les générations successives de Re’ou (nom dont le sens implique la notion de la vie pastorale), Seroug, Na’hor et Tera’h. Après ce dernier personnage, l’ensemble des tribus tera’hites ou des ‘Ebrim, opère sa migration de la Chaldée occidentale en Syrie, où il a son premier établissement à ‘Haran, et la Bible nous le montre subissant une division triparti te, qui semble calquée sur celle des fils de Noa’h. Les trois fils de Tera’h sont Abraham, Na’hor et ‘Haran, tous trois chefs de divisions ethniques et pères de nombreuses tribus. Na’hor reste fixé dans le Paddan Aram ou Aram Naharaïm, c’est-à-dire dans le vaste plateau de Damas, arrosé de deux rivières, tandis que son frère Abraham se dirige vers le sud. Là il a douze fils[11], qui représentent autant de peuplades, qui se mêlent aux Araméens et s’étendent vers le sud, le long de la lisière du désert. Lot, fils de ‘Haran, suit la migration de son oncle Abraham ; la Genèse fait sortir de lui les peuples de Moab et de ‘Ammon, qui habitaient à l’Orient de la Mer Morte. Pour Abraham, il a comme fils, de sa femme légitime Sara, Yiçe’haq (Isaac), qui continue la lignée delà tribu aînée, et auparavant, de son esclave Hagar, Yischma’el (Ismaël), qui, s’unissant à une Égyptienne, donne à son tour naissance à douze fils, représentant les principales tribus de la dernière couche de population de l’Arabie, les Arabes proprement dits ou Moust’ariba des écrivains musulmans. Les tribus ismaélites, dont nous réservons l’examen détaillé pour une autre partie de notre histoire, sont désignées dans le texte biblique comme habitant, les unes dans des villages et les autres sous des tentes, depuis le pays de ‘Havilah jusqu’au désert de Schour à l’orient de l’Égypte, dans un sens, et de là jusqu’à la frontière d’Asschour, dans l’autre sens[12]. Enfin Abraham, après la mort de Sara, épouse une nouvelle femme, Qetourah, dont il a six fils, représentant encore autant de peuplades, dont la liste généalogique[13] suit l’ordre de leur position respective du sud au nord. La plus importante est celle de Midian, fameuse dans l’histoire des Hébreux, par ses conflits avec ce peuple ; et les autres appartiennent à son voisinage immédiat. L’auteur sacré indique même que, de ses concubines, Abraham a eu encore de nombreux fils, qu’il a envoyé au loin dans l’est, après les avoir dotés[14], et qui y sont devenus les auteurs de tribus nomades. La dernière division des Tera’hites se produit après Yiçe’haq, quand de ses deux fils l’un, Yaqob (Jacob), surnommé Yisraël, devient le père des Béni Yisraël ou Israélites, et de leurs douze tribus (ce nombre de douze, qui se reproduit dans la famille de Na’hor et dans celle de Yischnia’el, est évidemment artificiel et cherché), l’autre, ‘Esav (Esaü), surnommé à son tour Edom, est l’auteur des Édomites ou Iduméens. La Genèse attribue à ‘Esav cinq fils, nés de mères Kenânéennes ou Ismaélites[15] ; ils représentent cinq tribus qui, dans les montagnes de Se’ir, s’associent et se mêlent aux sept tribus des ’Horim, habitants antérieurs du pays[16]. Ainsi la nation des Édomites se montre à son tour formée encore de douze tribus, issues de deux origines différentes. Nous venons de suivre la vaste extension de la descendance d’Arphak-schad dans l’ouest et le sud-ouest, telle que le texte biblique la donne avec beaucoup plus de détails que celle d’aucun autre des rameaux congénères. Mais le rang de ce nom dans la liste des fils de Schem se rapporte à la position du berceau premier de tous ces peuples, et non au champ de leur développement postérieur. Les deux derniers fils de Schem sont Loud et Aram. Ils représentent les deux divisions, septentrionale et méridionale, des peuples Araméens ou Syriens. On a cherché dans Loud les Lydiens de l’Asie-Mineure, d’après une assonance de noms purement fortuite. Les Lydiens sont un peuple aryen de race et de langage ; et leur position géographique ne correspond aucunement à celle du Loud, fils de Schem, qui, d’après son rang dans l’énumération, habitait entre Asschour et Arphakschad, d’une part, et Aram, de l’autre. Sur ce qu’est ce dernier, pas de doute possible, son nom a gardé sa signification ethnographique et géographique dans toutes les langues orientales. Seulement, dans toute la Genèse, sa signification est beaucoup moins étendue que plus tard. Qu’on y emploie les noms d’Aram simplement, de Paddan Aram ou de Aram Naharaïn, ces expressions ne désignent jamais (nous en donnerons la preuve dans, le livre de cette histoire consacré aux Israélites) que le pays voisin de Dammeseq ou Damas, c’est-à-dire la Syrie méridionale. Et c’est aussi là que nous maintient la liste des fils d’Arum dans le tableau ethnographique du chapitre X. Ces fils sont, en effet : ‘Ouç, le peuple auquel appartient le Patriache Yiob (Job) ; le même nom reparaît dans les généalogies des descendants de Na’hor et de ceux des ‘Horim, ce qui indique que des éléments divers s’étaient mêlés dans le peuple qu’il désignait ; parmi les fils de Na’hor, ‘Ouç a pour frère Bouz, et les documents assyriens mentionnent, comme deux peuplades situées à côté l’une de l’autre dans le désert à l’est de la Syrie, ‘Hazou et Bazou ; le prophète Yirmiah (Jérémie) parle d’un pays de ‘Ouç touchant à celui d’Edom, du côté du nord, et c’est bien là qu’est la scène de l’histoire de Yiob ; d’un autre côté, le ‘Hazou des inscriptions cunéiformes assyriennes est plutôt voisin de la Trachonitide, où l’historien juif Josèphe place le ’Ouç, fils d’Aram ; enfin Ptolémée parle d’une peuplade de Aisitæ ou Ausitæ, errant dans le désert à l’ouest de l’Euphrate ; tout ceci donne l’idée d’un peuple qui s’est formé dans l’est de Damas et de la Trachonitide, et s’est ensuite brisé eu plusieurs tronçons, répandus sur différents points du désert de Syrie ; ‘Houl, dont le nom est celui du pays de ‘Houl ou ‘Houla, placé par les géographes arabes entre les contrées antiques de Baschan et de Golan ; le territoire de la population désignée par ce nom devait s’étendre jusque là où est située ‘Houleh, sur le lac Merom ; Gether est représenté dans les généalogies traditionnelles des Arabes comme la source des peuples de Themoud et de Djadis ; on n’est pas en mesure de discuter la valeur de cette donnée ; dans le document biblique, Gether paraît correspondre au canton que la géographie classique appelle l’Iturée ; Pour le quatrième fils d’Aram, Masch, les interprètes ont hésité entre la Mésène, que nous avons déjà vu désigner tout à l’heure sous la forme Mescha, et le Masius auprès de Nisibe ; la question est tranchée en faveur de la Mésène par ce fait que les inscriptions cunéiformes assyriennes y placent un peuple d’Arami ou Araméens ; cette fraction de la famille sémitique y avait établi de très bonne heure une de ses tribus ; peut-être même avait-ce été là le berceau premier d’où sa majeure part avait émigré pour la Syrie. Ce dernier nom nous éloigne donc de la Syrie méridionale, mais non pour nous amener dans la Syrie du nord, qui reste absolument en dehors de la descendance d’Aram, dans le tableau du chapitre X de la Genèse. Pour cette dernière région, c’est Loud qui l’y représente. C’est, en effet, de ce côté que la situation dans laquelle Loud est mentionné entre les fils de Schem, nous oblige à le chercher ; et les généalogies traditionnelles des Arabes nous confirment dans cette voie, en faisant, dans quelques-unes de leurs versions, de Loud un fils d’Aram. Ces généalogies n’ont pas, sans doute, une bien grande autorité ; cependant ici elles ne sauraient être absolument méprisées, car elles nomment Pharis comme un fils de Loud ou Laoud, et dans le seul passage biblique où il soit encore question du peuple asiatique de Loud[17], il est associé à Paras comme fournissant tous deux des mercenaires aux armées de Tyr. Mais ce qui est bien plus sérieux et qui doit entrer au premier rang en ligne de compte pour la solution du problème des deux derniers fils de Schem, c’est que les monuments égyptiens donnent le nom de Routen à l’ensemble des peuples connus plus tard sous l’appellation générique d’Araméens. Ils distinguent, du reste, ces peuples en deux groupes sous leur nom commun : le Routen inférieur ou Khar[18] qui correspond à l’Aram du tableau ethnographique de la Genèse, en y joignant le pays de Kena’an ou la Palestine ; le Routen supérieur, auquel appartient, du reste, plus spécialement et plus en propre le nom de Routen, et que désigne ce nom quand il est employé absolument. C’est la Syrie du Nord, entre la vallée de l’Oronte et l’Euphrate, avec la partie ouest de la Mésopotamie septentrionale, jusqu’à la frontière des Assyriens. Voilà le Loud de la Genèse, et il faut hésiter d’autant moins à l’y reconnaître que, dans la famille de Miçraïm, nous avons vu la forme biblique correspondre déjà à l’égyptien Rot=Loud ; or, le Loud, fils de Schem, est exactement dans le même rapport philologique et phonétique avec le Rout-en, Lout-en des documents hiéroglyphiques, sauf l’addition à ce dernier d’une désinence en n, qui n’appartient pas à la constitution philologique du nom. Dans les sculptures des monuments égyptiens dont l’exécution est la plus soignée, il y a une différence sensible de figure et de costume sous le type commun de race entre les gens du Routen inférieur et du Routen supérieur ou du Khar et du Routen, différence qui justifie la distinction biblique entre Aram et Loud. Mais elle s’efface de bonne heure ; en Égypte, Routen devient une appellation traditionnelle des peuples syriens, qui perd tout sens plus précis ; dans les livres hébreux le nom de Loud disparaît, et celui d’Aram s’étend sur son territoire. Les deux nations primitivement distinctes, se sont fondues et assimilées. Au vine siècle avant notre ère, après la ruine de l’empire des ‘Hittim, leur pays se fond aussi dans l’Aram. C’est qu’en effet, à ce moment, l’aramaïsme devient singulièrement envahissant. Grâce à des circonstances politiques et historiques que nous aurons à exposer plus tard, grâce à la faveur que lui témoignent les monarques assyriens, puis les Achéménides, il absorbe graduellement toutes les populations de la Palestine, de l’Arabie-Pétrée, de la Syrie et de la Mésopotamie. Il est pendant plusieurs siècles l’élément prédominant, qui tend à tout s’assimiler dans la race sémitique, jusqu’au moment où, avec la prédication de l’islamisme, c’est l’Arabe qui le supplante dans ce rôle et l’absorbe à son tour. Le groupe des populations que l’ethnographie biblique rassemble sous le nom de Schem, groupe dont les représentants principaux sont de nos jours les Arabes et les Juifs, est remarquablement un au double point de vue physique et linguistique. Il présente un type de la race blanche plus pur et plus beau que celui des populations ‘hamitiques. La barbe est mieux fournie, le teint beaucoup plus clair, quoique déjà bistré, la taille plus élevée, la complexion particulièrement sèche. Le visage est généralement long et mince, le front peu élevé, le nez aquilin, la bouche et le menton fuyants, ce qui donne au profil un contour arrondi plutôt que droit ; les yeux enfoncés, noirs et brillants. FAMILLE DE YAPHETH. — Nous avons déjà dit que le nom de ce troisième des fils de Noa’h, connu aussi de la tradition arménienne et de la tradition grecque, paraît emprunté aux idiomes aryens, que parlaient la plupart des peuples rattachés à sa descendance. Mais il a pris en hébreu une forme qui lui donne une signification dans cet idiome ; Yapheth veut dire extension, et cette forme a été adoptée pour exprimer la notion de l’immense étendue des pays couverts par cette division de l’humanité noa’hide. La Genèse donne sept fils à Yapheth : Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Thoubal, Meschech et Thiras. Pas de doute que Gomer ne corresponde aux Cimmériens de l’antiquité classique, dont Hérodote parle comme ayant constitué la population de la Chersonèse taurique avant l’invasion des Scythes et comme s’étant ensuite établis en Paphlagonie. Les Cimmériens, aux VIIIe et VIIe siècles avant J.-C, jouèrent un assez grand rôle dans l’histoire de l’Asie-Mineure, qu’ils désolèrent par leurs incursions. Les documents assyriens les appellent Gimirraï. Ils appartenaient à la souche des peuples thraco-phrygiens, les témoignages grecs nous le disent formellement. Gomer, dans le chapitre X de la Genèse, a un sens ethnique très étendu, comme tous les noms placés à la génération immédiatement après Yapheth, qui représentent une première grande division de sa race. On doit donc le prendre comme la personnification de l’ensemble des Thraco-Phrygiens établis des deux côtés du Pont-Euxin, en Europe et en Asie. Le document biblique lui prête ensuite trois fils, Aschkenaz, Riphath et Thogarmah, représentant une subdivision de la souche première entre les différents rameaux qu’elle présentait en avant du côté des Hébreux, c’est-à-dire en Asie-Mineure. Aschkenaz est associé dans un autre endroit aux peuples de l’Ararat et de Minni en Arménie[19]. Il est impossible de méconnaître dans leur nom celui des Ascaniens du nord de la Phrygie, dont l’antique extension est attestée par les dénominations du canton bithynien de l’Ascanie, des deux lacs Ascaniens situés au sud et au nord de Nicée, du golfe Ascanien et des îles Ascaniennes du littoral de la Troade, enfin du port Ascanien en Éolie. C’est ce nom d’Ascanie et d’Ascaniens qui suggéra la création du personnage mythique d’Ascanios ou Ascagne, donné pour fils à Énée et à Creuse. Aschkenaz représente donc la nation des Bryges ou Phryges, nation étroitement apparentée aux Thraces, émigrée de leur contrée en Asie-Mineure, où sa première station fut, dit-on, dans l’Ascanie, mais ayant laissé en arrière quelques tribus de même nom dans les cantons entre la Macédoine et la Thrace. Riphath, d’après l’ancienne tradition juive recueillie par Josèphe, est la Paphlagonie. Il n’y a rien de sérieux à objecter à cette donnée, qui s’accorde parfaitement avec la position de Riphath entre Aschketiaz, c’est-à-dire la Phrygie septentrionale, et Thogarmah, l’Arménie occidentale. On a rapproché avec raison, dit M. Maury, le nom de Riphath de celui des monts Riphées, attribué par les Grecs à une chaîne qu’ils représentaient comme s’élevant aux extrémités boréales de l’univers, et que, pour ce motif, ils ont successivement transporté à des montagnes de plus en plus éloignées vers le nord-est, à mesure que leurs connaissances géographiques s’étendaient. Lorsque le Caucase apparaissait aux Hellènes comme le point le plus reculé de la terre, ils durent lui appliquer le nom de Riphée. Encore au temps de Pline, cette chaîne était supposée se rattacher aux montagnes de ce dernier nom. La Paphlagonie, qui s’avançait presque jusqu’au pied du Caucase, et d’où l’on apercevait ses cimes les plus hautes, a. donc pu être jadis connue des Grecs, qui y envoyèrent de bonne heure des colonies, sous le nom de pays des Riphées, lequel aura ensuite passé chez les Phéniciens. Thogarmah est plusieurs fois encore mentionné dans la Bible. Le prophète Ye’hezqel (Ézéchiel) le qualifie de contrée voisine de l’aquilon et en parle comme étant voisin de Gomer[20]. D’où il suit que le pays de Thogarmah devait être situé au nord de l’Assyrie. Ailleurs[21], le même prophète nous dit que Thogarmah envoyait à Tyr des mules, des chevaux et des cavaliers. La contrée de ce nom ne pouvait, par conséquent, être prodigieusement éloignée de la cité phénicienne, d’où l’on devait s’y rendre par terre. La tradition des Arméniens et des Géorgiens leur attribue pour ancêtre Thargamoss ou Thorgom, père de Haigh, qui est visiblement Thogarmah. Josèphe, en avançant que, de ce même Thogarmah, était issue la nation des Phrygiens, s’éloigne peu de l’identification que cette tradition entraîne, puisque Hérodote, et avec lui l’unanimité des écrivains grecs, nous apprend que les Arméniens étaient une colonie des Phrygiens. Thogarmah représente donc l’Arménie, mais au sens le plus ancien de ce mot, restreint à l’Arménie occidentale, et laissant de côté les pays de l’Ararat et de Minni ou Manni (la Minyade des auteurs classiques du côté de l’actuel Van), que jusqu’au VIIe siècle avant J.-C. habitait un peuple tout à fait différent de race et de langage, les Ourarti des documents cunéiformes, Alarodiens d’Hérodote. C’est seulement à la fin du VIIe siècle et dans le VIe que les Arméniens proprement dits, apparentés étroitement aux Phrygiens, firent la conquête de ces dernières contrées où plus tard une infiltration lente de nouveaux éléments ethniques, sous la domination perse, en fit un peuple entièrement iranien de langue et même de type physique, comme le sont les Arméniens modernes. On donne généralement au nom de Magog une étymologie aryenne qui le décomposerait en Ma-gog et lui attribuerait le sens de grande montagne, que l’on rapporte au Caucase. Il y a dé sérieuses objections à faire à cette étymologie, et le plus sage est de chercher la situation de Magog sans s’occuper de l’origine, encore inconnue, de son appellation. Pour la plupart des interprètes depuis Josèphe, ce nom désigne les Scythes proprement dits ou Scythes européens, peuple qui appartenait certainement à la race aryenne, iranien suivant les uns, germano-slave suivant d’autres. Il n’est pas, en effet, douteux que ce ne soit aux Scythes passés au sud du Caucase dans la seconde moitié du VIIe siècle avant J.-C, ayant leur quartier général dans le canton de la vallée du fleuve Kour, au nord de l’Arménie, canton auquel leur séjour valut le nom de Sacasène, et promenant pendant un certain nombre d’années la dévastation sur toute l’Asie antérieure, comme nous le raconterons en traitant de l’histoire d’Assyrie, que font allusion deux des prophéties de Ye’hezqel (XXXVIII et XXXIX). Elles s’adressent à Gog, du pays de Magog, prince et chef de Meschech et de Thoubal. Ce sont ces oracles qui ont donné lieu à tant de bizarres et fantastiques légendes sur les peuples fabuleux de Gog et Magog. En réalité, il y est question d’un personnage parfaitement historique, dont la réalité a été révélée par les documents assyriens ; car les inscriptions du roi Asschour-bani-abal, à très peu d’années de distance de la prophétie de Ye’hezqel, parlent de Gagi, roi des Sakha ou Scythes habitant au nord de l’Ararat. Voilà bien le Gog du prophète, qui reprend sa place légitime dans l’histoire, et s’il est dit prince de Meschech et de Thoubal, c’est qu’à ce moment les hordes scythiques tenaient sous leur domination les deux peuples désignés par ces derniers noms. Mais Magog est-il bien le nom de son peuple, des Scythes ? Ceci n’est pas possible, car l’apparition des Scythes au sud du Caucase n’a été qu’un fait passager et récent. C’est au nord de cette grande chaîne de montagnes qu’est leur habitation normale, et certainement son interposition les met en dehors de l’horizon du tableau ethnographique de la Genèse. Magog, les termes employés par Ye’hezqel sont formels à cet égard, est le pays où le roi Gog et son peuple résidaient au temps du prophète, c’est-à-dire celui qui comprenait la Sacasène. Ceci s’accorde parfaitement avec la place de Magog dans le tableau ethnographique, où il occupe l’intervalle entre Thogarmah et Madaï, entre l’Arménie orientale et la Médie. Son territoire est donc, comme l’a très bien vu le grand géographe allemand, M. Riepert, celui de la 18e des satrapies établies dans l’empire perse par le roi Darayavous, fils de Yistaçpa (Darius, fils d’Hystaspe), laquelle comprenait les Saspires, les Alarodiens et les Matiens, en y ajoutant en plus le bassin du Kour jusqu’au pied du Caucase. Ethniquement, Magog représente les habitants de cette contrée jusqu au VIe siècle, c’est-à-dire non pas les Scythes, qui y firent seulement une apparition temporaire, mais les blancs allophyles du Caucase, dont le domaine se prolongeait alors de façon à comprendre l’Ararat et le pays de Manni ou Minni. La synonymie de Madai avec les Mèdes est si évidente qu’elle n’a pas besoin de justification. Pour l’auteur du chapitre X de la Genèse, les Mèdes sont encore cantonnés là où nous les font voir aussi les documents assyriens du IXe siècle avant notre ère, dans le pays de Rhagæ ou Médie Rhagienne, au nord de la Grande Médie ou Médie propre, où ils ne pénétrèrent qu’au VIIIe siècle. Madai est dans le texte biblique le seul représentant des peuples iraniens et de toute la grande division orientale des Aryas. Les trois fils aînés de Yapheth forment une première série, énumérée d’ouest en est et reculée à l’extrême plan septentrional. Les quatre autres en composent une seconde, plus au sud, énumérée dans le même ordre géographique régulier ; il est important de tenir grand compte de cette circonstance dans la recherche de leurs assimilations. Yavan est le nom des Grecs dans toutes les langues de l’Orient ; il correspond à Iones, dont la forme primitive était Iavones. Dans le tableau ethnographique de la Genèse, ce nom constitue la désignation générique la plus étendue de l’ensemble des peuples helléno-pélasgiques avec leurs deux divisions primitives, européenne et asiatique, si bien définies par M. Ernest Curtius. La migration aryenne qui s’était déversée dans l’Asie-Mineure, dit le savant berlinois, peupla le plateau de cette presqu’île de tribus de race phrygienne. Le peuple grec, en s’en séparant, constitua, par le développement de ses institutions et de sa langue, un rameau distinct, qui se subdivisa à son tour en deux branches. L’une traversa l’Hellespont et la Propontide,.... l’autre demeura en Asie et s’avança graduellement du plateau de l’intérieur, en suivant les vallées fertiles que forment les rivières, jusque sur la côte, où elle s’établit à leur embouchure, rayonnant de là au nord et au sud. On n’observe nulle part plus qu’en Asie-Mineure le contraste de la région de l’intérieur et de celle du littoral. Sur la côte, c’est comme une terre d’une autre constitution et soumise à un autre régime. La côte de l’Asie-Mineure avait donc sa nature propre ; elle eut aussi sa population et son histoire particulière. C’est sur le littoral que s’établit l’une des deux branches de la nation grecque, tandis que l’autre, s’avançant plus à l’ouest, traversait l’Hellespont et mettait définitivement le pied dans les vallées fermées et les plaines de l’intérieur de la Thrace et de la Macédoine, défendues par des montagnes. Ainsi déjà, sur la terre d’Asie, s’étaient séparées les deux races grecques, les Grecs orientaux et les Grecs occidentaux, autrement dit les Ioniens et les Hellènes, dans le sens strict du mot. Dès une époque fort reculée, ce peuple occupa la région environnant la mer Egée, qui devait devenir le théâtre de son histoire. Les Ioniens s’avancèrent dès le principe jusqu’au bord le plus extrême du continent asiatique, d’où ils se répandirent dans les îles ; les Hellènes, au contraire, se cantonnèrent dans la vaste contrée montagneuse située plus avant en Europe, et dans les vallées fermées où ils se fixèrent ; ils adoptèrent, par suite du développement de leurs mœurs, un système de constitution cantonale. Plus tard, inquiétés dans leurs défilés par de nouvelles migrations, repoussés au sud, ils vinrent s’abattre par masses successives dans la presqu’île européenne, sous les noms d’Eoliens, d’Achéens et de Doriens. Yavan, dans le chapitre X de la Genèse, a quatre fils, Elischah, Tharschisch, Kittim et Dodanim ou Rodanim. Ici encore nous avons un ordre géographique d’ouest en est. Elischah, d’après l’emploi de ce nom dans d’autres passages bibliques, est sûrement la Grèce européenne. Quelques commentateurs ont cherché à rapprocher cette appellation de celle des Hellènes ou de l’Elis ; mais la philologie repousse l’un et l’autre rapprochement, car la forme la plus antique d’Hellènes est Selloi et celle d’Êleioi est Valeivoi. Le nom grec qui a été ainsi transcrit dans le document sacré est celui des Eoliens, qui constituèrent, en effet, la plus ancienne couche des Grecs européens ou Hellènes, et à qui se rattachaient les Achéens, entre les mains desquels fut l’hégémonie des populations helléniques du Péloponnèse jusqu’à l’invasion dorienne. On doit noter que la transcription de Aiolievs en Elischah est tout à fait parallèle à celle du nom des Achéens dans les documents égyptiens de la XVIIIe dynastie, Akaiouscha, de Achaivos, forme primitive de ce nom grec. Tharschisch est à partir d’une certaine époque le nom de l’Espagne, où les Tyriens allaient commercer à Tartesse, dans le pays des Tardétans. Mais il est impossible que ce nom ait un tel sens dans le tableau ethnographique de la Genèse. En effet, Tharschisch y est un fils de Yavan, c’est-à-dire un pays colonisé par la race helléno-pélasgique, et de plus, sa position est entre Elischah et les Kittim, entre la Grèce et Cypre, ce qui nous reporte vers l’Archipel. C’est là, d’ailleurs, un de ces noms de pays lointains qui ont successivement reculé à mesure que les connaissances géographiques s’étendaient. Tharschisch est l’extrême ouest des navigations phéniciennes, comme Ophir est leur extrême est. D’abord beaucoup plus voisin de la côte de Kena’an, il a été reporté toujours davantage dans l’occident, jusqu’en Espagne, en se localisant là où des assonances de noms le permettaient. Dans l’ethnographie de la Genèse, il n’y a pas moyen de ne pas assimiler Tharschisch aux Touirscha des inscriptions hiéroglyphiques, d’hésiter à y voir, avec Knobel, les Tursanes ou Pélasges Tyrrhéniens. Et d’après la place que le document biblique leur assigne, ils y occupent encore leurs premières demeures sur les côtes occidentales de l’Asie-Mineure et dans les îles de la mer Egée, où quelques-unes de leurs tribus, restées en arrière dans la migration générale du peuple vers l’Italie, subsistaient encore isolément à l’aurore des temps classiques. Ici donc les documents mis en œuvre par le rédacteur de la Genèse remontaient certainement à une époque antérieure à la migration des Tyrrhéniens dans l’Occident, dont les monuments égyptiens nous permettront de déterminer la date. L’assimilation des Kittim est tellement certaine qu’elle ne demande pas de commentaire. Ce sont les habitants de l’île de Cypre, désignés d’après la grande ville de Kit ou Cition, qui était le principal port de communication des Phéniciens avec cette île. Les découvertes récentes de la science ont établi que la population de Cypre, où l’on a fait dans les quinze dernières années des fouilles si fructueuses pour l’histoire et l’archéologie, était dès la plus haute antiquité de la souche helléno-pélasgique, parlant un dialecte grec, qu’elle écrivait avec un système graphique particulier. Pour le quatrième fils de Yavan, au contraire, la question qu’il soulève reste fort douteuse, d’autant plus que l’on n’est même pas sûr de la forme exacte de son nom. Notre texte hébreu de la Genèse porte Dodanim ; mais dans celui que les Septante et les auteurs de la version samaritaine avaient sous les yeux, on trouvait Rodanim, et c’est la leçon que fournit le texte hébreu du livre des Chroniques (ou Paralipomènes, dans la Vulgate latine), à l’endroit où le tableau ethnographique de la Genèse y est reproduit. C’est donc Rodanim qui a pour soi le plus d’autorités, et en même temps il se prête à une assimilation beaucoup plus vraisemblable que Dodanim. Les commentateurs qui ont adopté cette dernière leçon y ont vu Dodone d’Épire, ce qui est impossible historiquement et géographiquement reporte beaucoup trop loin dans le nord-ouest, ou bien les Dardaniens de la Troade, qui sont aussi trop au nord, d’autant plus que pour les retrouver ici il faudrait corriger arbitrairement Dodanim en Dardanim. Rodanim, au contraire, nous fournit le nom de l’île de Rhodes, dont l’importance historique est si ancienne et dont la mention à côté de Cypre est toute naturelle. Il est probable, du reste, que sous ce nom sont aussi englobés les Cariens, au territoire desquels touchait Rhodes ; car la population de l’île et celle du district continental voisin paraissent avoir été identiques. Les deux fils de Yapheth qui succèdent à Yavan, sont accouplés étroitement dans le tableau ethnographique, Thoubal et Meschech, comme aussi dans presque tous les autres passages bibliques, assez nombreux, où ils sont nommés et où ils se présentent habituellement comme inséparables. Ce sont deux peuples de l’Asie-Mineure, guerriers et célèbres par leur métallurgie, qui habitaient côte à côte, vivant dans une intime alliance. Pas de doute qu’il ne faille, comme l’ont fait tous les commentateurs depuis Josèphe, reconnaître en eux les Tibaréniens et les Moschiens de la géographie classique. Seulement, au temps où les Grecs et les Romains nous en parlent, ces peuples avaient été refoulés dans d’étroits cantons des montagnes qui bordent le Pont-Euxin, tandis qu’il est évident que dans la Genèse leur territoire a une extension bien plus grande et surtout est placé bien plus au sud. Ici encore, les documents cunéiformes assyriens sont venus apporter les plus heureux éclaircissements à l’ethnographie biblique. Ils nous montrent, en effet, dans les peuples de Tabal et de Mouschki deux nations puissantes, presque toujours associées, qui du XIIe au VIIe siècle avant notre ère habitaient la Cappadoce, venant toucher au pays de Khilakki, c’est-à-dire à la Cilicie, et au Koummouhh ou Commagène, presque jusqu’au haut Euphrate. Au reste, l’ancienne extension des Moschiens dans la Cappadoce a été connue de Josèphe, qui affirme que la ville de Mazaca leur devait son nom, et du temps de Cicéron il y avait encore des clans de Tibaréniens dans le voisinage de la Cilicie, de même que bien plus au nord, dans les pays Pontiques. Enfin, pour ce qui est du dernier des peuples de Yapheth, Thiras, la presque unanimité des commentateurs, à commencer par Josèphe, y a vu les Thraces. La chose est pourtant philologiquement impossible ; les deux noms ne se correspondent aucunement. Thiras, avec un i long entre le th et le r et une sifflante à la fin, au lieu d’une gutturale, ne saurait être la transcription hébraïque d’un nom dont le radical était thrak. En outre, la race thraco-phrygienne est déjà représentée dans la famille japhétique par Gomer. Enfin Thiras, géographiquement, n’est pas reculé dans le nord-ouest comme les Thraces ; c’est un voisin de Thoubal et de Meschech, qui doit être plus oriental qu’eux ou un peu plus méridional. Ceci donné, c’est au nom delà grande chaîne du Taurus que j’identifie le sien. Et de cette façon je vois en lui le représentant de la population de la Cilicie, vaste contrée qui ne pouvait manquer d’avoir sa place dans la géographie du chapitre X de la Genèse, et à laquelle pourtant ne correspond aucune des appellations que nous avons jusqu’ici passées en revue. Quelques érudits, frappés de cette lacune inexplicable, ont cru pouvoir chercher la Cilicie dans Tharschisch, dont ils rapprochaient le nom de celui de Tarse. Mais cette conjecture a été définitivement écartée une fois qu’on est parvenu à lire là véritable forme sémitique du nom de la ville de Tarse, Tarz dans les légendes araméennes des monnaies qui y ont été frappées sous les Achéménides, Tarzi dans les textes assyriens. La Cilicie n’est pourtant pas absente du tableau ethnographique de la Bible, mais on y a jusqu’ici méconnu le vrai nom qui la désigne et qui est Thiras. On le voit par ce qui précède, la grande majorité des peuples classés dans la descendance de Yapheth appartiennent à cette grande race, la plus pure du type blanc et la plus noble de toute l’humanité, que l’on connaît sous le nom d’aryenne ou indo-européenne, et dont la science contemporaine, en se guidant sur les affinités physiologiques et linguistiques, est parvenue à reconstituer l’unité originaire. En Europe, les Grecs et les Romains, les Germains, les Celtes, les Scandinaves et les Slaves ; en Asie, les Perses, l’aristocratie des Mèdes, les Bactriens et les castes supérieures de l’Inde ; telles sont les principales nations de cette race, divisée depuis une très haute antiquité en deux grandes branches, l’une occidentale et l’autre orientale, les Européens, ainsi désignés d’après la partie du monde où ils terminèrent leur migration et trouvèrent leur demeure définitive, et les Aryas, comme ils s’intitulaient eux-mêmes. Ces derniers, réunis d’abord sous ce nom commun, restèrent longtemps concentrés dans les contrées arrosées par l’Oxus et l’Iaxarte, c’est-à-dire dans la Bac tri an e et la Sogdiane, région qui avait été le berceau premier de la race. De là un de leurs rameaux se dirigea vers le midi, franchit l’Hindou-Kousch et pénétra dans l’Inde en détruisant, ou subjuguant les populations antérieures, de souche thibétaine, kouschite (?) et dravidienne. L’autre s’établit dans le pays qui s’étend entre la mer Caspienne et le Tigre, et dans les montagnes de la Médie et de la Perse. L’auteur inspiré du chapitre X de la Genèse n’a donc compris dans son énumération ethnographique qu’une faible partie du vaste développement de cette race et, sauf Madaï, tous les représentants qu’il en nomme appartiennent à la branche occidentale. Naturellement son tableau embrasse seulement ceux des peuples aryens qui pouvaient être connus des Hébreux de son temps, ceux qu’il connaissait lui-même ; et il n’y a pas à hésiter pour reconnaître que ceux de ses commentateurs qui ont prétendu trop élargir son horizon géographique, l’étendre au même degré que celui des Grecs et des Romains, se sont absolument trompés. Mais pour ce qu’il a connu de peuples aryens, l’auteur sacré a discerné de l’oeil le plus sûr leur étroite Perso en costume national1. parenté, et il leur a assigné une origine commune, ce qui est déjà merveilleux, car chez aucun ancien l’on ne rencontre une vue ethnographique de cette profondeur et de cette justesse. C’est bien la race aryenne ou indo-européenne dans son ensemble qu’il a voulu représenter comme issue de Yapheth, et si la science actuelle trouve ici à élargir son cadre, elle n’a pas à le modifier. Cette race est celle à laquelle nous appartenons. C’est la race noble par excellence, celle à qui a été confiée la mission providentielle de porter à un degré de perfection inconnu de toutes les autres les arts, les sciences et la philosophie. Béni soit Yapheth, dit Noa’h suivant la Bible, que Dieu étende au loin sa postérité, qu’il habite dans les tentes de Schem et que ‘Ham soit son serviteur ! Cette bénédiction et cette prophétie se sont accomplies, car la descendance de Yapheth n’est pas devenue seulement la plus nombreuse et la plus étendue ; elle est aussi la race dominatrice du monde, celle qui chaque jour encore s’avance vers la souveraineté universelle. Avec les peuples aryens, l’auteur du tableau ethnographique de la Genèse a placé les populations caucasiennes et les peuples de Meschech et de Thoubal, qui certainement s’y rattachaient. Ce sont là ceux qui pouvaient être connus de lui parmi les peuples que l’on appelle les blancs allophyles, autrement dit ceux qui, sans différence notable et facilement appréciable dans le type physique avec les nations européennes, parlent des idiomes radicalement différents, qui semblent éloigner leur origine de la souche aryenne. Il est clair qu’ici c’est sur le type qu’il a basé son classement et non sur les idiomes, ce que lé simple bon sens indique, du reste ; car certainement, si la parenté des différentes langues de la famille sémitique ou syro-arabe était de nature à être appréciable pour la philologie si imparfaite des anciens, il n’en était pas de même de l’affinité des dialectes iraniens et du grec, de l’idiome de Madaï et de celui de Yavan ; et personne ne prétendra, je pense, que les écrivains bibliques aient eu une révélation spéciale ou même simplement une inspiration divine en matière de linguistique. Sans leur langue si spéciale, dit M. de Quatrefages, personne n’eût hésité avoir dans les Basques les frères des autres Européens méridionaux. Leur dolichocéphalie spéciale eût-elle été découverte, comme elle l’a été par M. Broca, on n’aurait pas eu l’idée d’en faire des blancs allophyles. Il en est de même des peuples du Caucase, si longtemps regardés, précisément à cause de leurs caractères physiques, comme la souche pure des populations blanches européennes. Remarquons, du reste, que précisément ces peuples présentent pour l’anthropologiste et l’ethnographe un problème des plus obscurs et des plus complexes, par suite du contraste même qui existe entre les affinités d’origine que semblent indiquer leur type et l’isolement où les placent leurs idiomes. Mais le langage coïncidant mal avec les caractères physiques peut être chez eux le résultat de faits historiques qui resteront pour nous à jamais inconnus, par exemple un héritage dépopulations antérieures d’une toute autre race, dont le type aura fini par s’effacer sous l’afflux toujours prédominant du sang blanc qui devait s’y mêler. C’est ainsi que les Ottomans ont fini, à force de métissages, opérés surtout par le choix de femmes européennes et caucasiennes, par devenir un peuple de race formellement blanche, tout en gardant la langue turque de leurs ancêtres d’un autre type. Bien téméraire serait donc celui qui oserait affirmer, sur la foi exclusive de la différence linguistique, qu’en classant les blancs allophyles du Caucase dans la famille de Yapheth, l’écrivain biblique n’a pas suivi des traditions formelles et autorisées, et que ce n’est pas lui qui est ici dans le vrai, aussi bien que Blumenbach et Cuvier en les classant avec les Aryens dans la même division de la race blanche, toutes réserves faites, d’ailleurs, sur le nom impropre qu’ils ont donné à cette grande division ethnique. La descendance de Schem, de ‘Ham et de Yapheth, telle qu’elle est si bien exposée et définie dans la Genèse, ne comprend, on vient de le voir, qu’une seule des races humaines, la race blanche, dont elle nous présente les deux divisions principales, sémitique ou syro-arabe et aryenne ou indo-européenne, avec la sous-race égypto-berbère, qui est certainement sortie de son métissage avec la race noire, et chez qui les caractères anatomiques, ainsi que tout ce qui, sauf la couleur, constitue le type physique extérieur, montre que c’est le sang blanc qui prédomine, qu’il s’agit en réalité de blancs modifiés par des alliances étrangères et des influences de milieu. Les trois autres races, jaune, noire et rouge, n’ont pas de place dans le tableau que donne la Bible des peuples issus de Noa’h. On ne saurait s’en étonner pour ce qui est de la première et de la troisième. Le rédacteur inspiré du livre de la Genèse ne pouvait parler aux hommes de son temps que des nations dont ils avaient connaissance. Or, de son temps on n’avait ni en Égypte, ni en Palestine, ni à Babylone aucune notion de l’existence des Chinois ou de la race rouge américaine. Les nègres, au contraire, étaient parfaitement connus. On en rencontrait sur tous les marchés d’esclaves de l’Asie ; l’Égypte, sur laquelle l’écrivain sacré avait tant et de si sûres notions[22], les voyait surtout ramener par milliers à l’état de captifs dans ses cités et dans ses campagnes, à la suite des grandes razzias décorées du nom d’expéditions militaires, que les Pharaons poussaient périodiquement dans le Soudan ; des représentations dé vaincus de race noire étaient sculptées sur les murailles de tous ses temples ; de nombreuses tribus de cette race, dans les régions du Haut-Nil, reconnaissaient sa suprématie politique et obéissaient aux gouverneurs qu’elle envoyait en Ethiopie. Sur plusieurs des points où s’étendaient leurs navigations, les Phéniciens, abordaient dans des pays habités par des nègres et commerçaient avec eux. L’auteur du tableau ethnographique’, si parfaitement renseigné sur les populations kouschites du Haut-Nil et de la côte orientale de l’Afrique, ne pouvait ignorer qu’elles étaient en contact direct avec les noirs. Il est encore plus impossible de croire qu’il n’ait pas connu le système de l’ethnographie égyptienne, où les trois grandes races des Rotou, des Âmou et des Ta’hennou ou Tama’hou correspondent si exactement, ainsi que nous l’avons déjà montré, à ses trois races de ‘Ham, Schem et Yapheth, et que, par conséquent, il n’ait pas su que les nègres y formaient une quatrième race,
sous le nom de Na’hasiou. Tout ceci rend inadmissible que ce soit par ignorance ou par omission qu’il ne les ait pas fait figurer dans son énumération des descendants des trois fils de Noa’h. On ne saurait douter que, s’il l’a fait, n’a été volontairement et avec une intention formelle, bien que nous ne puissions pas l’expliquer avec certitude.
Distribution géographique des races admises par les Égyptiens[23] Mais ce n’est pas la seule omission que le tableau ethnographique de la Genèse nous présente, de peuples importants qui n’ont pas pu être inconnus de sou auteur. Tandis qu’en énumérant les grandes divisions de la race de Yapheth reculées sur le plus extrême plan septentrional, il a mentionné les Mèdes qui habitaient si loin au nord-est, dû côté de Rhagæ ; en se rapprochant du centre autour duquel son regard rayonne, la barrière du mont Zagros semble opposer un obstacle infranchissable à sa vue et lui cacher absolument les peuples qui sont au delà. Et cependant Babylone, que tout indique comme ayant été sa principale source d’informations, entretenait avec ces peuples un commerce actif et constant ; on les y connaissait depuis la plus haute antiquité. Il n’a même pas un nom pour ceux qui habitaient les montagnes à l’est du Tigre, touchant aux nations d’Asschour ou de Nimrod. Ou du moins, s’il mentionne le pays de ‘Elam, ce foyer de civilisation prodigieusement ancien qui en occupait la partie méridionale, c’est uniquement pour y placer un fils de Schem. Il ne l’envisage donc qu’au point de vue de l’aristocratie peu nombreuse qui s’y était absolument dénationalisée, en adoptant l’idiome et la civilisation de l’élément prédominant dans la population à laquelle elle s’était superposée, et il ne tient aucun compte de la masse principale des habitants de ‘Elam. De même, en Babylonie et en Chaldée, il ne parle que des Kouschites et il passe sous silence l’antique peuple de Schoumer et d’Akkad, qui a eu pourtant un rôle si prépondérant dans la création première delà civilisation de ces contrées. Tout cela ne peut être qu’intentionnel. Il y a eu évidemment, chez l’écrivain biblique, volonté, formelle et arrêtée, d’exclure de sou tableau des Noa’hides, aussi bien que les nègres, les peuples situés à l’est de la Mésopotamie et appartenant à une même race, dans la formation de laquelle le sang jaune avait eu une part considérable, sinon la principale. Les différentes nations de cette race particulière parlaient toutes des langues, plus ou moins étroitement apparentées entre elles, et qui ont avant tout ceci de commun qu’elles appartiennent à la grande classe des idiomes agglutinatifs, que leur structure et leur mécanisme grammatical offrent une analogie fort rapprochée, d’une part avec ceux des langues altaïques, de l’autre avec ceux des langues dravidiennes. C’est pour l’ensemble de ces nations que nous adoptons l’appellation de Touraniens, sans prétendre trancher d’une manière formelle la question, encore profondément obscure et dans l’état actuel impossible à résoudre d’une façon affirmative de savoir si leurs affinités décisives sont plutôt avec les Altaïques ou avec les Dravidiens, ou s’ils ne forment peut-être pas une sorte de transition et comme des chaînons entre eux, de même que leur position géographique est intermédiaire entre les uns et les autres. Nous en avons déjà parlé plus haut, à l’occasion des origines de la métallurgie, en les envisageant surtout au point de vue de ce qui établit leurs rapports avec les peuples altaïques. Il importe d’y revenir ici, après avoir bien précisé le sens dans lequel nous entendons et employons ce terme de Touraniens dont on a tant fait abus, pour esquisser rapidement le tableau des principales nations de ce groupe, qui n’ont pu être ignorées du rédacteur de la Genèse, ou du moins des auteurs du document qu’il a mis en œuvre dans son chapitre X, car elles étaient trop bien connues à Babylone. Ce sont les nations qui, avec les Kouschites, et peut-être même avant eux, ont précédé de beaucoup les peuples de Schein et de Yapheth dans la voie de la civilisation matérielle et y ont été leurs institutrices. La Médie reste tout entière touranienne, habitée par une population dont la langue offre un des types les mieux étudiés jusqu’ici des idiomes du groupe, jusqu’au vin0 siècle avant notre ère, date de rétablissement des Mèdes proprement dits, de race iranienne, dans la contrée dont Hangmatana (Ecbatane) est la capitale. Et même après cette invasion, les Iraniens ne constituent qu’une caste dominante et peu nombreuse ; du temps des Achéménides, la masse du peuple parle encore sa vieille langue, qui est admise à l’honneur de compter parmi les idiomes officiels de la chancellerie des rois de Perses. La Médie touranienne ne garde pas seulement sa langue, mais son génie propre, et elle ne cesse que très tard de lutter, avec des chances diverses, contre le dualisme de la religion de Zarathoustra ; ses croyances particulières s’infiltrent jusque chez les conquérants de race iranienne et produisent, par leur amalgame avec les idées religieuses de ces conquérants, le système du magisme, qui balance pendant longtemps, jusque dans la Perse elle-même, la fortune du mazdéisme pur. Plus au sud, les Touraniens se montrent à nous comme formant une portion notable de la population de la Susiane ou pays de ‘Elam, foyer d’une culture antérieure à celle de la Babylonie même, et assez puissant pour entreprendre de lointaines conquêtes vingt-trois siècles avant notre ère. Ce curieux pays, placé à la limite commune de toutes les races diverses de l’Asie occidentale, les voyait, comme nous l’avons déjà dit, confondues et enchevêtrées sur son sol à l’époque historique. Mais depuis les temps les plus reculés, c’est à l’élément touranien qu’y appartenait la suprématie ethnique et morale ; c’est lui qui avait imposé sa langue aux autres, du moins dans l’usage officiel et comme idiome commun. Dans le bassin de l’Euphrate et du Tigre, en Babylonie et en Chaldée, aussi haut que nous fassent remonter les monuments et les traditions, nous nous trouvons en présence de deux populations juxtaposées et dans bien des endroits enchevêtrées, appartenant à deux races distinctes et parlant des idiomes divers, d’une part les Sémito-Kouschites, de l’autre le peuple de Schoumer et d’Akkad, apparenté aux Touraniens de la Médie et du ‘Elam. Laquelle des deux précéda l’autre sur ce sol, c’est ce qu’il est impossible de dire, car aux périodes les plus reculées où puisse atteindre notre regard, nous constatons leur coexistence. Mais ce que l’on peut dire d’une manière positive, c’est que Schoumer et Akkad constituaient un rameau particulier dans le groupe des Touraniens, rameau dont la langue s’était fixée et cristallisée à un état encore plus primitif de développement que celle des autres peuples de la même famille. Comme nous le ferons voir en traitant spécialement de l’histoire des Chaldéens et des Assyriens, c’est la fusion des génies et des institutions propres aux deux races opposées de Kousch et de Schoumer et Akkad, réunies sur le même territoire, qui donna naissance à la grande civilisation de Babylone et de la Chaldée, appelée à jouer un rôle si considérable sur toute l’Asie antérieure, qu’elle pénétra de son influence. Que si nous tournons maintenant nos regards vers le massif montueux d’où descendent les deux grands fleuves de la Mésopotamie, nous y trouvons encore les Touraniens, établis en maîtres exclusifs jusqu’au IXe et au VIIIe siècle avant notre ère. La parenté des noms géographiques et des noms propres d’hommes, cités en très grand nombre dans les inscriptions assyriennes, nous permet de rétablir une chaîne de populations de même race que les premiers habitants delà Médie, qui, à partir de ce dernier pays, s’étend dans la direction de l’ouest jusqu’au cœur de l’Asie-Mineure. Ce sont d’abord les vieilles tribus touraniennes de l’Atropatène, rejetées plus tard par les Mèdes iraniens dans les montagnes qui bordent la mer Caspienne, et désignées dans cette retraite jusqu’aux temps classiques par l’appellation de non aryens (Anariacæ). Viennent ensuite les nombreuses populations qui habitent, au sud des Alarodiens et des gens de Minni ou Manni, le pays désigné par les Assyriens sous le nom de Nahiri, c’est-à-dire les montagnes où le Tigre prend sa source, et où leurs descendants, complètement aryanisés dans le cours des siècles, gardent du moins encore aujourd’hui le nom de Kurdes, qui témoigne de leur parenté primitive avec les Chaldéens de race touranienne, de même que le nom d’Akkad, appliqué quelquefois par les Assyriens à cette région aussi bien qu’à une partie de la Chaldée. De là, toujours en marchant vers l’occident, nous atteignons les peuples de Meschech et de Thoubal, chez lesquels on discerne un vieux fond touranien, auquel s’est superposé et mêlé une couche de blancs allophyles caucasiens, qui justifie l’inscription de ces deux noms dans la descendance de Yapheth, tandis que nous avons déjà soupçonné que le substratum touranien des peuples en question était indiqué parle Thoubal-Qaïn de la lignée qaïnite. Dans le système de l’ethnographie des livres sacrés de l’Iran, exprimé par la division des trois fils de Thraetaona, ces Touraniens ont leur place ; ils y sont associés au rameau turc des Altaïques proprement dits et personnifiés avec eux par Toura, tandis que Çairima correspond au Schem biblique et Arya à Yapheth. En même temps la population méridionale et brune des Pairikas, qui figure dans les mêmes récits mythologiques, mais n’est plus rattachée à la descendance des fils de Thraetaona, s’identifie avec certitude aux Kouschites orientaux de la Genèse, c’est-à-dire à la division ethnique de ‘Ham. Voilà donc deux grandes classes de peuples que l’auteur biblique n’a pas pu ne pas connaître et qu’il a exclu systématiquement de la progéniture de Noa’h. Mais il faut encore pousser plus loin ces observations. Il est impossible de ne pas remarquer, en y attachant une véritable importance, qu’au milieu de tant de détails minutieux sur les populations de la Palestine et de l’Arabie, pas un nom du tableau ethnographique ne s’applique aux peuples primitifs qui habitaient ces contrées avant l’invasion kenânéenne, et dont tant dé tronçons isolés subsistaient encore au milieu des nations de Kena’an à l’époque où les Benê-Yisraël firent la conquête de la Terre-Promise, ‘Enaqim, Emim, Rephaïm, ‘Horim, Zouzim, Zomzommim, peuples dont la stature était beaucoup plus grande que celle des Hébreux et des Kenânéens (on les représente comme des géants) et dont le langage, absolument différent de celui de ces derniers venus, leur paraissait une sorte de balbutiement barbare et inintelligible. Il est très souvent fait mention de ces peuples dans le Pentateuque et dans le livre de Yehoschou’a (Josué), mais sans que jamais on les y relie à la généalogie d’un des fils de Noa’h ; au contraire, ils y apparaissent toujours comme isolés de la souche de Schem et de celle de ‘Ham. Il en est de même du grand peuple de ‘Amaleq, que le livre des Nombres (XXIV, 20) appelle l’origine des nations, c’est-à-dire le peuple le plus anciennement constitué, auquel les Hébreux se heurtèrent mainte fois dans le désert entre l’Égypte et la Palestine, jusqu’au moment de son anéantissement par Schaoul (Saul) ; qui tient enfin, sous le nom de ‘Amliq, une place si considérable dans les traditions les plus antiques des Arabes, lesquelles lui prêtent une très grande extension dans leur péninsule. L’omission de son nom dans les généalogies du chapitre X de la Genèse est encore plus extraordinaire. Elle ne peut manquer d’être significative, et cela d’autant plus que dans les noms, également fort nombreux, donnés pour l’Arabie méridionale par le tableau ethnographique et répartis entre les familles de Kousch et de Yaqtan, il n’en est pas un qui corresponde à celui du peuple prodigieusement antique, gigantesque et impie de ‘Ad, frappé par un châtiment terrible de la colère céleste, dont les vieilles traditions arabes racontent tant de légendes, en le représentant comme la nation des aborigènes du Yémen et en même temps comme un fils de ‘Amliq. Nous avons encore là tout un vaste groupe de peuples, qui précéda ceux de ‘Ham et de Schem dans la Palestine et l’Arabie, et auquel il est difficile de ne pas admettre que le rédacteur de la Genèse a refusé, avec une intention voulue et réfléchie, d’assigner un rang dans son tableau de l’humanité Noa’hide.
Système de l’ethnographie des livres sacrés iraniens. Le fait me paraît incontestable, et on peut le poser hardiment. Mais autre chose est d’en pénétrer la cause et l’intention. A ce sujet on ne peut émettre que des conjectures, et encore en les environnant de grandes réserves. Remarquons cependant qu’ici se pose de nouveau, presque nécessairement, un problème d’une gravité singulière, que nous avons déjà rencontré sur notre route, au cours du livre précédent, et sur lequel nous avons été amené à nous expliquer avec entière franchise et liberté, mais en même temps avec les ménagements qu’impose un sujet aussi délicat. C’est celui de savoir si, dans la pensée de l’auteur inspiré de la Genèse, le fait du Déluge avait eu toute l’extension que l’on a jusqu’ici conclu de certaine de ses expressions, prises au pied de la lettre ; si le chrétien était obligé de le tenir pour réellement universel, soit au point de vue de la surface terrestre, soit au point de vue des contrées habitées parles hommes et de l’anéantissement complet de la primitive humanité adamique. Nous avons déjà dit que l’interprétation affirmative, tout en ayant pour elle le poids bien considérable de l’unanimité de la tradition, n’était pas obligatoire de foi, et que des autorités religieuses considérables reconnaissaient aujourd’hui que la thèse contraire pouvait être soutenue sans se mettre en dehors de l’orthodoxie. Nous avons ajouté que, dans notre conviction personnelle, le fait du Déluge., en s’attachant même aux données de la Bible, devait être restreint, qu’à le bien peser et à le scruter jusqu’au fond, l’ensemble du texte de la Genèse, si l’on n’y prend pas isolément le récit diluvien, mais si l’on y met en parallèle quelques expressions très significatives de la généalogie des Qaïnites, donne l’impression que pour son auteur une partie des descendants du fils maudit de Adam avait échappé au cataclysme, et était encore représentée par des populations existantes au temps où il écrivait. Ce serait là, il faut bien le reconnaître, l’explication la plus naturelle et la plus simple des lacunes volontaires du tableau ethnographique du chapitre X. L’écrivain sacré y aurait tenu certains groupes de peuples bien déterminés en dehors de la généalogie des fils de Noa’h, parce qu’il les aurait regardés comme n’en dérivant pas, mais bien se rattachant à la souche antérieure des Qaïnites. Parmi les nations connues des Hébreux et de leurs voisins, ce sont trois groupes ethniques aussi nettement définis et aussi distincts que ceux de Schem, ‘Ham et Yapheth, qui sont ainsi omis, et la division des fils de Lemech dans la lignée qaïnite, parallèle à celle des fils de Noa’h dans la lignée de Scheth, est précisément tripartite. Peut-on attribuer cette coïncidence au simple hasard ? Je ne le crois pas, et d’autres indices, d’une incontestable valeur, viennent corroborer une telle hypothèse. J’ai déjà signalé plus haut le rapprochement si naturel que l’on est induit à faire entre Thoubal-qaïn ou Thoubal le forgeron et les Touraniens métallurgistes, d’autant plus que c’est aux domaines de la race jaune que paraît bien appartenir la ville, de ‘Hanoch, fondée par Qaïn lui-même. D’un autre côté, les deux fils de Lemech, que les expressions formelles du texte biblique désignent comme chefs de races pastorales, naissent d’une mère dont le nom, ‘Adah, n’est autre que la forme féminine de celui du peuple aborigène arabe de ‘Ad. Nous retrouvons encore une autre ‘Adah dans la Genèse (XXXVI, 2 et 4) comme une des femmes indigènes que ‘Esav, le frère de Ya’aqob, épouse en s’établissant au milieu des ‘Horim ; et le petit-fils de cette ‘Adah est appelé ‘Amaleq, autrement dit est le chef et la personnification d’une tribu qui participe du sang d’Edom et de ‘Amaleq, et se confond dans le peuple plus ancien de ce nom. Enfin, l’histoire de Moscheh (Moïse) nous offre une tribu, dont ‘Hobab, le beau-père du législateur des Israélites, était le phylarque, tribu dite formellement du sang de ‘Amaleq[24], bien qu’habitant au milieu de Midian ; et son nom est Qaini ou Qeni, c’est-à-dire le Qaïnite. Maintenant, pour ceux qu’effraierait la hardiesse de cette manière de voir et ce qu’elle a de contraire aux opinions jusqu’ici généralement reçues, ils n’auront qu’à constater que le texte de la Bible ne contient rien qui s’oppose à une autre hypothèse, celle-là d’accord avec la thèse de l’universalité du Déluge. C’est celle que Noa’h aurait eu, postérieurement au cataclysme, d’autres enfants que Schem, ‘Ham et Yapheth, d’où seraient sorties les races qui ne figurent pas dans la généalogie de ces trois personnages. Il ne contredit pas non plus une troisième hypothèse, encore soutenable, que certaines familles issues des trois patriarches Noa’hides aient pu s’éloigner du centre commun avant la confusion des langues et la dispersion générale des peuples mentionnés au chapitre X de la Genèse, et aient pu donner naissance à de grandes races, lesquelles, se développant dans un isolement absolu, auraient pris une physionomie tout à fait à part et seraient demeurées en dehors de l’histoire du reste des hommes. En un mot, il y a bien des manières possibles de concilier, suivant les tendances personnelles des esprits, la foi à l’unité de l’espèce humaine, descendue d’un seul couple premier, le respect religieux du texte biblique, poussé même jusqu’à en prendre toutes les expressions dans le sens littéral le plus étroit, et la croyance à l’universalité la plus absolue du Déluge, avec ce fait scientifique et positif que le rédacteur de la Genèse n’a compris et voulu comprendre, dans son tableau généalogique de la postérité des fils de Noa’h, que les trois divisions fondamentales de la race blanche, la race supérieure et dominatrice, à laquelle on ne saurait refuser la primauté sur toutes les autres. C’est à ce fait seul, longtemps méconnu, que nous nous attachons ici ; c’est celui que nous retenons pour l’histoire de l’antique Orient. |