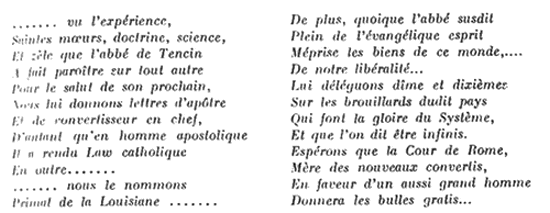HISTOIRE DE LA RÉGENCE PENDANT LA MINORITÉ DE LOUIS XV
TOME TROISIÈME
CHAPITRE LIX. — Les opinions et les sectes religieuses (1715-1723).
Cynisme dans les mœurs et indifférence religieuse. — La Calotte ; ses brevets. — Le haut clergé. — Le bas clergé. — Les laïques. — Situation du protestantisme. — Attitude de Georges Ier. — Réforme d’Antoine Court, — Rigueurs des Parlements. — Les condormants. — Les free masons. — Le parti et la secte janséniste. — Confrérie de régiment. — Juifs. — Superstitions.Cynisme dans les mœurs et indifférence religieuseJusqu’à nos jours les aspects économiques et sociaux n’avaient guère attiré l’attention, celle-ci se tournait de préférence vers les manifestations artistiques et littéraires, les portraits et les anecdotes, plus riches de variété et d’imprévu. Ainsi s’est-on familiarisé en France avec l’idée d’une Régence assez peu différente des saturnales antiques, idée qui ne se trouve, à l’étude, ni entièrement fausse ni tout à fait juste. Ce ne sont pas les mœurs seulement qui s’altérèrent, ce furent la monarchie, l’administration, l’esprit, le goût, les sciences, les lettres et les arts qui reçurent des nuances et s’accommodèrent d’une direction dont l’influence se fit sentir sur la destinée du royaume tout entier. Les mœurs se corrompirent, mais moins qu’on ne l’a pensé ; ce qui a fait croire le contraire c’est que le cynisme remplaça l’hypocrisie. La Cour et la capitale sous le feu Roi et sous le Régent furent fort immorales, il n’y eut qu’une question de degré dans l’impudence. Les désordres du duc d’Orléans sont aussi publics, l’ineptie du duc de Bourbon, la férocité du comte d-p Charolais, la dégradation du prince de Conti n’ont fait que s’affirmer, parce que tous les germes levaient déjà dans les âmes avilies de ces princes qui n’étaient encore, sous le dernier règne, que des enfants pervers. Quant au duc de Chartres, son père lui accorde libéralement toutes les tares : Aussi peu d’esprit que M. le Duc, aussi brutal que Charolais, aussi fou que Conti ! Et le public approuve[1]. A Paris la licence est grande dans les sociétés et dans les promenades, dans les rues et jusque dans les maisons la sécurité laisse à désirer ; vols et assassinats se multiplient mais la bande de Cartouche a-t-elle commis plus d’excès que les associés de la Voisin ? La bourgeoisie et les artisans pratiquent les mœurs d’autrefois, sans grande ferveur mais avec conviction. Buvat, Marais, Barbier, les Caumartin, l’auteur de la Gazette de la Régence sont tous favorables aux Appelants, pour faire la nique au Pape et aux Jésuites. « On vient de me certifier en bon lieu, écrit le gazetier, qu’il y a ici quelques épiscopaux anglais qui confèrent... et proposent une réunion de l’Église anglicane avec l’Église de France... Il se peut que cela se fasse pour alarmer la Cour de Rome et la rendre plus traitable ; il se peut qu’on y aille sincèrement. Cet événement serait rare et bien reçu de plusieurs et, à l’égard des autres, il faudrait bien qu’ils fassent comme du temps d’Henri VIII[2]. » On croirait en lisant ces mots que la foi catholique est très ébranlée. Simple boutade, qui se trouve contredite par le sentiment général d’hostilité à l’égard des protestants. Ce qui vacille, ce n’est pas la foi chrétienne, c’est l’attachement et le respect pour l’Église et le clergé catholiques. Les curés de Paris faisaient preuve d’un grand zèle contre les théâtres, sans parvenir à faire oublier les disputes intestines qui divisaient tous les prêtres et les religieux en deux camps irréconciliables. Quant aux prélats ils comptaient dans leurs rangs des personnages vénérés à coté d'autres justement méprisés ; loi chanoine s’habille en femme pour assister à la comédie[3] ; tel évêque, ayant eu « de grosses paroles » avec un officier, accepte un duel et tue son adversaire[4] ; les cardinaux enfin reçoivent collectivement un « brevet de la calotte[5] ». La Calotte ; ses brevetsLe Régiment de la Calotte est une sorte d’association burlesque qui distribue aux têtes légères une calotte de plomb, sous forme rimée. L’association, qui remontait à l’année 1710, enrôla tous les toqués et n’épargna personne ; dès 1710 elle devint une sorte de Fronde à laquelle tout était permis et par laquelle personne n’était épargné. Tels brevets ont eu pour rédacteurs Grécourt, Voltaire, Maurepas et ils conservent une valeur historique et littéraire réelle. Celui qui fut décerné à l’abbé de Tencin mérite d’être rappelé[6] :
Le haut clergéDubois sera plus malmené, mais que ne dit-on pas sur son compte[7]. A l’exemple du Régent, on lui prodigue les épithètes les plus avilissantes[8] ; Polignac est si endetté qu’il ne peut se risquer dans Rome où l’appelle le conclave[9]. Parmi les évêques, il ne s’en trouve que trop qui considèrent la résidence comme une sorte d’exil. Lefebvre de Caumartin nouvellement nommé au siège de Blois écrit ce badinage : « Je me sens dévoré de l’envie de visiter mon diocèse[10], pour bien des raisons pour ce monde-ci et pour l’autre ; celles de l’autre ne sont pas douteuses, celles qui regardent cette vie mortelle, c’est que quand une fois j’aurai visité mon terrain, je me sentirai bien libre dans ma trille, n’avant ni grande ville, ni grandes affaires, un terrain peu étendu et fort uni en quelque sens que vous le preniez. Je pourrai impunément aller demeurer où bon me semblera[11]. » Comment en irait-il autrement de la façon dont les bénéfices sont attribués : « Tout à la grâce et rien au mérite », comme l’avoue en plaisantant le Régent lui-même ; et voici les titres qu’on invoque : L’abbé de Broglie, agent du Clergé, sollicite l'abbaye du Mont-Saint-Michel et dit au Régent : « Ne m’oubliez pas sur votre liste, je suis un bon diable. » — « Je suis tourmenté par des diables plus méchants que vous » répond le prince, et ils se mettent à parler de vins et de bouteilles. Broglie vante un crû, Orléans veut en goûter, Broglie lui fait tenir trois cents bouteilles, Orléans accepte mais veut payer, alors Broglie rédige son mémoire par articles : le vin, les bouteilles, les bouchons, la ficelle, la cire d’Espagne, les paniers, le port, et, à la fin, il écrit : Total : L’abbaye du Mont-Saint-Michel. Et il est nommé ! Son premier soin, aussitôt sa nomination faite est d’envoyer à l’abbaye Saint-Germain demander le chiffre exact du revenu qui vient de lui échoir[12]. Le bas clergéLe clergé paroissial est très différent des dignitaires ; il conserve, malgré fies disputes théologiques, une charité, une mansuétude, une bienfaisance dont les fidèles sont les témoins édifiés et reconnaissants. Les ordres religieux font encore quelques généreux efforts pour observer leurs règles et lutter contre la tendance au relâchement ; les scandales sont rares parmi eux, et les chroniqueurs se trouvent réduits à plaisanter sur le procureur général des Chartreux qui « a fait un trou à la lune » et a passé en Angleterre en galante société. Ce n’est là, pour Barbier qu’« un bon tour » et, pour Marais, « ce n’est pas une grande perte qu’un mauvais moine[13] ». Chez les Jésuites, auxquels on ne pardon livrait rien, on ne blâme que l’ambition et la politique ; les mœurs sont intactes[14]. Les laïquesParmi cette société frivole et pervertie qui s’agite et fait grand-bruit, des princes, des grands seigneurs donnent une idée fausse de leur temps, d’autres princes — et ce sont les bâtards — d’autres grands seigneurs observent une morale irréprochable. A la Cour et jusqu’au Palais-Royal on rencontre des âmes pures et courageuses attachées à la pratique des vertus chrétiennes. L’assistance à la messe, l’observation du carême, l’horreur du sacrilège ne sont pas seulement des pratiques officielles ou des souvenirs de l'éducation entretenus par la contagion de l’exemple. Dans les rangs de la bourgeoisie, parmi les artisans et le peuple la foi se transmet, à travers la conception janséniste, qui lui laissera longtemps son empreinte. Mais il faut se souvenir que c’est pendant la Régence, dans la classe des artisans, que nous rencontrons ce Pierre Duhalde qui, âgé de vingt-huit ans, ruiné, ne disposant plus que d’une somme de 15.000 livres, décide, le 24 septembre 1719, de « consacrer son commerce en y associant Dieu pour cinq ans dans la vente des pierreries à dater du 1er octobre. A la liquidation de la Société, il prélèvera sa mise et « l’excédent sera, écrit-il, partagé entre Dieu et moi ». Son commerce prospère, Scotti lui obtient la moitié des fournitures de la Cour d'Espagne, et Duhalde meurt riche, laissant à un fils au berceau l'obligation de remettre aux mains des pauvres la part qui revient à Dieu[15]. Situation du protestantismeCette pensée d’une association commerciale avec Dieu n’est que l’expression vive d’une foi demeurée entière dans la Providence. D’autres incidents, des profanations exercées dans les églises, soulèvent l’indignation de ceux qui nous les apprennent et qui, eux aussi, demeurent croyants[16]. L’ardeur des luttes religieuses entre Jansénistes et Ultramontains ne laisse pas douter de l’intérêt qu’ils continuent à attacher à ces questions, pendant que leur hostilité à l’égard du protestantisme ne se relâche en quoi que ce soit. La situation des protestants restait précaire et le Conseil de conscience n’avait rien fait pour l’améliorer, au contraire[17]. De leur côté, les protestants s’accrochaient à tout ce qui paraissait leur être favorable. La vieille Madame était demeurée luthérienne de cœur, mais son intervention auprès du Régent ne tendait qu’à obtenir quelques grâces individuelles. Lord Stair s’était toujours montré plus entreprenant ; l’hôtel de l'ambassadeur et sa chapelle se trouvaient érigés en une sorte de lieu d’asile où tous les huguenots de la capitale et des environs étaient assurés de recevoir le sacrement de mariage moyennant vingt-cinq livres[18], le prêche du ministre fournissait l’occasion de quêter à trois reprises, ce qui ne laissait pas que de paraître importun à l’auditoire, composé parfois de plus de cinq cents personnes. Le cardinal de Noailles, averti qu’il s’y rencontrait des nouveaux convertis parmi les luthériens et les calvinistes, s’en plaignit au Régent comme d’un abus facile à réprimer : « Cela était bon sous l’autre règne, lui fut-il répondu ; mais dans celui-ci il semble qu’on doive plutôt penser à les convertir par la raison. Souvenez-vous aussi, Monsieur le Cardinal que c’est encore par la raison qu’on veut tacher de vous convaincre et ceux de votre parti sur ce qui concerne la Constitution[19]. » Cependant le concours des auditeurs devint si considérable que le Régent en parla à lord Stair, qui répondit qu’il appartenait à S. A. R. d'empêcher les sujets du Roi de s’y rendre, quant à lui ce n’était pas son affaire[20]. On n’insista pas. Le nombre des communions allait croissant. Le dimanche 2 janvier 1718, pendant le service, un valet de chambre de lord Stair vint dire à voix haute qu’on l’assurait que M. d’Argenson avait ordre de faire arrêter tous les Français à la sortie de l'ambassade. Stair dit qu’il n’y pouvait s’opposer, mais conseilla en même temps aux auditeurs de se faire, sans affectation, reconduire chez eux par les soldats suisses présents au culte ; ce qui s’exécuta sans aucune arrestation[21]. Stair exploitait ces réunions contre le gouvernement auprès duquel il était accrédité, il apercevait pour l’avenir un nid de difficultés profitables à l’Angleterre. Outre le chapelain de l’ambassade, il attire un ministre français qui prêche deux fois par mois et obtient un vif succès : pour l’entendre on déserte le chapelain anglais[22]. A quelque temps de là, le ministre de Hollande à Paris marche sur les traces de son collègue et fait tenir chez lui un prêche français chaque quinze jours ; une pointe de scandale se mêle à la vogue dont il jouit, car il est piquant d’entendre cet homme replet et rubicond prêcher le jeûne et exalter l’abstinence dont, pour sa part, il s’abstient soigneusement. L’auditoire déborde jusque dans la rue, les curés de Paris portent plainte, le curé de Versailles fait de même[23], le cardinal revient à la charge et le Régent avertit la police de procéder a quelques arrestations qui ne seront pas maintenues. Cette mésaventure ne les corrige pas. « Vous ne sauriez croire, écrit-on, combien la plupart de ces zélés sont opiniâtres à se former dans l’esprit que Dieu a résolu de rétablir en ce temps-ci leur religion en France et ils s’imaginent que le Régent se bouchera les yeux, mais ils se trompent, car, dans les derniers conseils, il n’y a pas une voix qui n’ait opiné qu’il fallait tenir plus que jamais la main à ledit sur le fait de la Religion, si l’on voulait prévenir une guerre civile, et comme le Régent craint, avec raison, toute sorte de troubles il est de l’avis de son Conseil[24]. » Si air avertit ses coreligionnaires qu’il les recevra toujours dans son hôtel, mais ne tentera rien en leur faveur si on les arrête ; cet avertissement est entendu et, le dimanche suivant, sa chapelle est presque solitaire. Pendant la semaine, quelques fervents s’y glissent, écoutent un prêche, communient et s’esquivent[25]. Attitude de Georges IerLes velléités de revenir sur la révocation de l’édit de Nantes ne pouvaient aboutir sans provoquer un soulèvement général de Georges Ier l'opinion publique qui n’ignorait pas tout des connivences criminelles du parti protestant avec les ennemis de la nation. Déçus dans leur espoir de tolérance et peut-être de bienveillance ouverte de la part du Régent dont le scepticisme était connu de tous, les protestants du Midi de la France avait compté tirer profit de l’alliance anglaise qui stipulerait en leur faveur. Ne voyant rien venir, ils s’étaient remués au point de devenir gênants et menaçants à l’heure où nos troupes faisaient campagne sur la frontière d’Espagne. Pressenti, harcelé, le roi d’Angleterre répondit de façon à détruire toute illusion. Par son ordre, Craggs écrivit à lord Stair que « estimant que son influence sur une population protestante pourrait être de quelque poids, le roi a jugé qu’il servirait le Régent en leur envoyant quelqu’un pour leur faire savoir en son nom combien il croit de leur intérêt aussi bien que de leur devoir de se comporter honnêtement et paisiblement[26] ». Réforme d’Antoine CourtUne sorte d’effervescence soulevait les communautés ; aux environs de Montauban et d’Anduze, des huguenots furent surpris chantant des psaumes et mis en prison ; à Clairac, les femmes et les enfants se laissèrent lier ou enchaîner en grand nombre ; à Valence, on se réunit souvent[27] et ces assemblées entretenaient la ferveur confessionnelle et l’hostilité politique, dans tout le « Désert » se faisait sentir l’influence d’un prédicant doué d’une âme de missionnaire et d’un tempérament d’organisateur. Antoine Court, né en Vivarais, orphelin de père, avait suivi sa mère, malgré elle, aux prédications du « Désert », sa jeunesse et son innocence l’y avaient fait désigner pour la lecture à haute voix des saintes Écritures, mais sa précoce maturité lui avait révélé le péril que courait le protestantisme en France, menacé de succomber entre l’indifférence des timides et le fanatisme des exaltés. La faiblesse des premiers et le dérèglement des autres renfermaient des germes de destruction plus efficaces que les lois persécutrices. Antoine Court conçut le plan d’une restauration du troupeau qui glissait, par la voie du prophétisme, vers l’anarchie. Dans ce but il préconisait le retour aux assemblées fréquentes, le rétablissement de la discipline et la formation théologique des pasteurs chargés de remplacer les prophètes et les prédicants. Le 21 août 1715, Court présida le premier synode des délégués des églises des Cévennes et du bas-Languedoc qui porta entre autres décisions, l’interdiction pour les femmes de prêcher et l’adoption de la Bible comme règle de foi. Dès lors les synodes du Désert devinrent fréquents et furent pris en considération. Court fut consacré ministre par Pierre Courteis et alla étudier quatre ans à Genève (1718-1722), d’où il revint en Languedoc à la fin de 1722. Son mérite et son originalité consistèrent à n’user de l’influence qu’il exerçait sur ses coreligionnaires que pour les persuader de renoncer aux voies belliqueuses et aux violences. En 1719, les excitations adressées par Alberoni aux protestants du Midi se heurtèrent à un refus dont l’attitude de Georges Ier et les harangues d’Antoine Court expliquent la fermeté. Le Régent n’ignora pas le rôle du pasteur vivarois et lui fit proposer une pension élevée ou bien la permission de vendre ses biens et d’aller s’établir à l’étranger. Court refusa tout, ne voulant que le succès de l’œuvre entreprise et la restauration de sa foi religieuse[28]. Rigueurs des ParlementsAu moment où il repoussait ces propositions, il continuait la lutte contre l’esprit sectaire dont les Parlements se faisaient les interprètes ; vers 1719, il publiait une Relation historique des cruautés envers quelques protestants en France pour avoir assisté à une assemblée tenue au Désert[29]. Mais l’heure n’avait pas sonné de la tolérance officielle ; le Parlement de Bordeaux condamnait à l’amende honorable et aux galères perpétuelles deux pauvres diables réputés pasteurs et tout au plus glossolales, l’un, Jean Millet, cabaretier, était parvenu à épeler les caractères de l’alphabet, l’autre, Jean Martin, laboureur, était complètement illettré. Une femme Faure, veuve et mère de sept enfants, reconnue coupable d’avoir abrité sous son toit une trentaine de personnes pour le chant des psaumes, fut condamnée à la réclusion perpétuelle ; un ouvrier en soie, Jean Bergue, fut exposé au pilori, fouetté, banni du royaume pour avoir gardé chez lui un apprenti lisant la Bible[30]. Les malheureux surpris à Anduze furent condamnés, les hommes, aux galères ; les femmes, à la détention perpétuelle : Madame obtint du Régent la grâce d’une soixantaine de coupables mais sous la condition qu’ils sortiraient du royaume. On exilait les adultes, on violentait les enfants, les jeunes filles arrachées à leurs parents, étaient enfermées dans des couvents où on leur imposait une éducation et des croyances réprouvées par ceux qui leur avaient donné la vie[31] ; quant aux relaps on se montrait sans pitié envers eux[32]. Les CondormantsPendant que le ministre Court épargnait à sa confession la suprême disgrâce, on voyait naître en France une secte rattachée par quelques liens au protestantisme. « En Angleterre, qui est un maudit pays, écrit Mathieu Marais, il s’est fait une assemblée qu’ils appellent la Société du feu d'Enfer, où certains hommes abjurent toute religion, professent l’athéisme, et prononcent toutes sortes de blasphèmes. Ils se donnent le nom de Lucifer, de Memnon, etc. Ils y ont attiré des femmes et des filles de condition qui prennent le nom des déesses païennes. On éteint les lumières à la fin de leurs assemblées, et ils se mettent tous ensemble à la manière des anciens gnostiques et des anabaptistes modernes. Il n’y a rien d’abominable qui ne passe par la tête de cet Anglais[33]. » Moins de deux années plus tard, on rencontre cette secte implantée en France. « On a découvert, écrit Barbier, en 1723, une plaisante secte à Montpellier, appelée les Condormants, ou les Multipliants[34] » et Caumartin les appelle des Trembleurs[35]. Deux cents personnes s’assemblaient chez la demoiselle Verchand où quelques prédicants leur débitaient des discours. L’Intendant fut informé de ces réunions et envoya pour les arrêter. On trouva quatre endoctrineurs habillés comme on décrit les lévites de l’Ancien Testament avec des étoles de soie marquées de caractères hébreux et d’autres qu’on ne connaît point, sur la tête un bonnet à peu près de la forme d’un turban garni de plumes. Ces gens s’assemblaient le soir et récitaient une espèce d’office, devant eux une table garnie de nappes blanches portait des pains, du vin, de l’eau-de-vie protégés par une douzaine de figurants tenant des étendards. Dans la salle, il se trouvait trois ou quatre lits de repos. Pendant l’office, on soufflait les lumières par intervalles et le rite secret s’accomplissait. On arrêta une douzaine de coupables, ils furent conduits en prison avec leurs ajustements. Un témoin a heureusement suivi le cortège et laissé la description de cette mascarade et du lieu des réunions sur lequel on lisait : Hôtel de la Fille de Sion. C’est un ramassis de meubles disparates et d’inscriptions en lettres rouges où sont mêlées « la tendresse et la religion ». A côté de la porte d’entrée deux matelas sur le plancher, des bancs d’église, une chaire à prêcher avec son degré, un grand laurier dans un vase, des bouteilles d’eau-de-vie, des dragées, des amandes pralinées, des bâtons parés de rubans et de lauriers, les tables de loi mosaïque, deux tambourins avec leurs baguettes, des trompettes d’enfant, une fontaine pour baptiser, une lampe à l’huile. Sur une table il est dit que le temps est venu où tous les hommes vont être égaux ; les pauvres vont être riches comme les riches, et les riches pauvres comme les pauvres ; Dieu veut que les hommes apprennent les femmes à prier. Ils leur apprenaient bien autre chose. La demoiselle Verchand se trouva grosse, sa fille âgée de douze ans devait être mariée la nuit même de l’arrestation, quant à la servante, « jolie comme un cœur », elle allait sous peu rivaliser avec la Samaritaine. On saisit le registre des mariages, celui des initiés, celui des baptêmes. M. de Bernage commença les noces, il y avait quatre cents personnes compromises et une centaine environ se hâta de prendre la fuite[36]. Les free masonsUne autre importation anglaise fut la franc-maçonnerie, à une date encore incertaine et qui sera longtemps difficile à préciser. La politique vacillante du Régent avait tour à tour, attiré et éloigné la nuée d’intrigants qui composaient le parti jacobite. Dans leurs rangs se trouvaient déjà les hommes qui, en 1726, organisèrent la première loge écossaise en France dont le but avoué, et peut-être véritable, tendait à conduire les hommes vers l'état de perfection fondé sur l’égalité absolue existant entre eux. L’idée, parce qu’elle était philosophique, ne demandait, pour prospérer, que d’être transplantée hors d'Angleterre : mais elle devait conserver en France bien des traits originels. Les signes et les emblèmes servant à rallier les associés s’inspirèrent du langage biblique, dénaturé en jargon ; familiers à l'entourage de Cromwell, ils offraient aux contemporains du Régent un je ne sais quoi de bizarre que le temps a rendu grotesque. Quant à l’idée égalitaire, elle trouvait dans le tempérament français un terrain de culture favorable. L’intelligence agile, l’ironie pénétrante, la logique rigoureuse qui forment les dons essentiels de ce tempérament ne pouvaient s’arranger longtemps des erreurs, des petitesses et des tares d’une classe privilégiée ; la noblesse et le clergé, si favorables à la franc-maçonnerie, devaient être sacrifiés à l’égalité qu’elle prêchait et qui ne s’arrêtait pas devant la Divinité elle-même. Tout ceci n’était pas de nature à déplaire au Régent, mais on n’a aucune preuve de son affiliation à la nébuleuse doctrine que les initiés Jacobites colportaient mystérieusement en France. Eux-mêmes devaient avoir peu de goût pour le prince athée et versatile dont leur maître, le Prétendant, avait eu plus à se plaindre qu’à se louer. Lors de la prise d’armes en Écosse, en 1716, le parti que dirigeait Charles Radclyffe, lord Derwentwater, avait succombé à Preston Condamné à mort, fugitif, lord Derwentwater put gagner la France, devint secrétaire de Charles-Edouard, se lia intimement avec Andrew-Michael Ramsay, fils spirituel et biographe de Fénelon. Dans ces entretiens fut élaboré le plan de cette association destinée à une expansion considérable et à une influence qui contribua à l’avènement de l’esprit républicain. Le parti et la secte jansénistesCe même esprit républicain se fait pressentir dans le parti janséniste et met en garde le Régent contre une alliance trop étroite avec ce parti. Dans un jour d’effusion, le prince avoue à lord Stair « qu’il n’y pouvait point avoir d’autre party que de se liguer contre la Constitution ; qu’à se déclarer pour ce party, il aurait tous les parlements du royaume pour lui ; mais qu’il y avait deux inconvénients de se déclarer pour les jansénistes : le premier, que le party était le plus faible ; et le second que ce party avait le sentiment républicain. » A cela, Stair réplique que le seul choix du prince fera en un moment du parti le plus faible, le plus fort, et qu’à tout prendre mieux vaut le plus faible que rien du tout. Quant aux sentiments républicains, ils se bornaient à une préférence et n’allaient pas jusqu’à souhaiter une subversion, et encore moins à y travailler[37]. C’est cependant dans les Parlements, abris discrets du jansénisme pendant le règne qui va s’ouvrir, que s’entretiendra la petite flamme destinée, à la fin du siècle, à déchaîner le vaste incendie de la persécution religieuse. L’histoire des tendances politiques du parti janséniste pendant la Régence ne semble pas relever d’aucun plan arrêté, pas plus que d’aucune ambition concertée. Impuissant à devenir un véritable parti, le jansénisme se vouait à n’être qu’une secte, ne visait qu’à éterniser des querelles ou à envenimer des conflits. Les mourants et les morts deviennent la proie que se disputent les constitutionnaires et les appelants. Un jour l’évêque d’Orléans se transporte chez un de ses chanoines malade à l’extrémité et l’interpelle de déclarer s’il ne veut pas rentrer dans le sein de l’Église ?[38] Un autre jour l’archidiacre Perochel refuse de faire l'enterrement du curé de Saint-Paul[39], ou bien le curé de Saint-Maclou à Pontoise fait enlever le corps du curé Cossart afin de le soustraire aux chanoines de Saint-Meulon, « scandale effroyable que Dieu jugera un jour » écrit un témoin[40], et pendant ce temps l’archevêque de Rouen vient à mourir, les moines de Saint-Ouen demandent qu’on porte le corps chez eux selon la coutume, le Chapitre s’y refuse, le Parlement de Normandie le lui ordonne ; alors île Chapitre « ayant appris cet arrêt se réunit et avant qu’il lui fut signifié, on ferma les portes, on leva le corps qui était dans une chambre de parade et l’ayant fait traîner jusques proche le tombeau de M. d’Amboise, on fit un trou proche de ladite tombe, on le poussa dans la cave et on le reboucha[41]. » Le souverain-pontife n’échappe pas à ces gentillesses macabres. Mathieu Marais s’empresse d'écrire dans son Journal : le Pape est mort sans confession[42] ; et un ami de la marquise de Balleroy : « Il est mort avec un transport au cerveau. Si pendant ce temps-là on lui avait donné un point de croyance à décider, aurait-il été infaillible ?[43] » Cette mort imaginaire provoque une plaisanterie. « Il arriva avant- hier à ma porte, écrit un parisien, un billet bien imprimé pour inviter à une cérémonie à Notre-Dame d’un service pour la mort du Saint-Père qui se devait faire hier. Comme je n’ai jamais ouï parler de prières mortuaires pour celui qui a le passe-partout du paradis, je crus et crus juste que c’était un godan du 1er avril. J’ai deviné la boutique d’où cela venait. Cela fait pourtant plus de chemin qu’on ne pensait. Il n’y avait eu environ que cinquante billets de distribués parmi les amis et connaissances de la maison d’où ils partaient. Il en est arrivé un par hasard en Sorbonne ; hier, au prima mensis, on déclara si l’on suivrait l’exemple de Notre-Dame ou si l’on n’en ferait pas un dans la Faculté ; docteurs de raisonner, chacun suivant sa mode ; les constitutionnaires outrés soutenaient un si saint Père au-dessus des prières. Dans le parti contraire, quelques-uns croyaient qu’il ne fallait pas prier pour un hérétique, d’autres qu’il avait grand besoin qu’on priât Dieu pour lui et que les prières étaient toujours bonnes ; pas un de ces grands personnages n’a imaginé que ce fût un poisson d’avril[44]. » Les rites de l’Église, ses sacrements, deviennent le prétexte des coups les plus inattendus et les plus perfides. Le P. de Linières, confesseur du Roi et jésuite se trouvant à l’archevêché, le cardinal de Noailles lui dit : — « Eh bien, Père de Linières, vous voilà donc chargé d’un grand fardeau ? — « Il est vrai, Monseigneur, mais je tâcherai de m’en acquitter le mieux qu’il me sera possible avec l’aide de Dieu. — « Il faut l’espérer, cependant... je vous en décharge ! » Et il s’éloigne à l’instant[45]. Un prêtre de la paroisse Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-Antoine[46] portait le viatique à un malade lorsqu'une servante s’agenouille et dit : « Je vous adore, ô mon Dieu, quoique vous soyez entre les mains d’un hérétique. » Son maître lui avait appris que tous ceux qui avaient juré la constitution Unigenitus étaient hérétiques[47]. Confrérie de régimentOn ne saurait compter parmi les sectes et à peine doit-on mentionner parmi les sociétés secrètes une tentative vite réprimée. Une lettre du secrétaire d’État au maréchal de Berwick nous apprend que les Jésuites essayèrent d’exercer une influence dans l'armée. Sous le nom de confrérie ils groupèrent des hommes sur lesquels ils croyaient pouvoir s’appuyer, tous choisis dans le Régiment de Soissonnais. « Il y a trois ans, écrit-il en 1719, que ces sortes d’associations étant devenues très fréquentes, le Conseil de la Guerre envoya des ordres circulaires à tous les régiments pour en empêcher la continuation[48]. » JuifsQuand aux Juifs on connaît peu de chose sur leur compte. Un Conseil du 21 février 1722 ordonna le recensement des Israélites dans les généralités d’Auch et de Bordeaux et le séquestre de leurs propriétés territoriales. On ne sait pas avec précision à quel calcul répondait cette avanie ; mais déjà des protecteurs appartenant à ce peuple mal famé obligeaient à faire compter avec eux. Samuel Bernard était, avec quelques coreligionnaires, en mesure d’avancer dix millions par mois au Roi sur le bail des fermes[49], et il est permis de croire que l’influence de ces gros manieurs d’argent ne fut pas étrangère à la révocation de l’arrêt ; le Régent fit plus encore, il consentit à lever l'espèce d’équivoque qui entourait encore l’existence des Israélites et les gratifia, pour la première fois, du nom de Juifs dans les lettres patentes qu’il leur accorda. Les Juifs de Metz servaient de proie au roué Brancas[50] et de quelque étiquette qu’on les affublât, Juifs portugais ou allemands, payaient chèrement l’hospitalité. Leur abjection morale allait de pair avec leur saleté physique et l’avilissement de la race paraissait garantir à la fois sa dégradation et sa sécurité. On les parquait comme des troupeaux, on les exploitait comme des bestiaux, on les taxait comme des négociants, mais la persécution les épargnait. Le clergé montrait cette race maudite comme un monument de la vérité des prophéties, et menait grand bruit autour de quelques conversions arrachées à l’avarice au moins autant qu’à la persuasion ; le Régent lui-même consentit à prendre part une fois à la cérémonie d’une abjuration[51]. Cette tolérance, d’où n’était pas étranger le calcul, s‘exerçait dans le temps où les protestants étaient proscrits, les jansénistes exilés et où le gouvernement veillait à ce que les Français ne pussent manger gras les jours maigres[52]. SuperstitionsCette protection officielle n’exclut pas l’indulgence pour les plus ridicules aberrations de l’esprit. Le duc d’Orléans avait pris plaisir à des évocations et des diableries dans les carrières de Vanves et de Vaugirard ; le duc de Richelieu s’adonnait à Vienne, à des divertissements de même genre, le duc de Noailles et le marquis de Mirepoix attachaient à ces folies une importance qu’ils se fussent reproché d’accorder aux enseignements de la religion révélée ». Le comte de Boulainvilliers se livrait à l'astrologie, tirait l’horoscope, écrivait l’Apogée du Soleil et ne perdait pas assez complètement la tête dans les sciences occultes et la philosophie hermétique pour n’être plus capable d’écrire quelques ouvrages raisonnables qui « lui assurent une meilleure réputation », et pour ne pas oublier, sentant la mort prochaine, d’envoyer Noailles son ami, lui chercher le P. de la Borde pour entendre sa confession[53]. Quant au petit peuple ses prétentions sur l’avenir étaient plus modestes ; Voltaire nous apprend qu’on ne consulta jamais plus qu’alors le marc de café. |