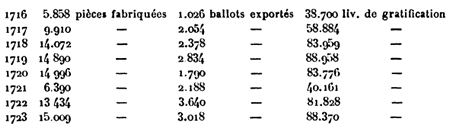HISTOIRE DE LA RÉGENCE PENDANT LA MINORITÉ DE LOUIS XV
TOME TROISIÈME
CHAPITRE LVIII. — L'industrie et les manufactures (1715-1723).
Étatisme de Colbert. — Création et méthodes du Conseil de commerce. — Disgrâce générale du commerce. — Le bureau de commerce. — Les manufactures. — Draperie et tissage. — Filatures. — Verreries. — Glaceries. — Manque de capitaux. — Privilège. — Monopole. — Accaparements. — Petits fabricants. — Ouvriers mercenaires. — Salaires ouvriers. — Ouvriers déserteurs. — Ouvriers étrangers. — Le droit d’association. — Les chambrelans. — Demandes d’arbitrage. — Grèves. — Les Colonies.Etatisme de ColbertLa France, en 1715, était plongée dans une crise industrielle très grave. Au commencement du XVIIIe siècle, les Manufactures subissaient encore toutes les directives despotiques de Colbert et les industriels se soumettaient aux enquêtes des inspecteurs, rigoureux interprètes des règlements généraux. Les édits prescrivaient le nombre, la longueur, la qualité des fils ou des laines employés au tissage d’une pièce de drap ou de toile, et l’observation de ces règles n’était pas facultative ; l’industriel ou l’ouvrier transgresseur courait risque de la prison ou du carcan et ses marchandises seraient saisies, lacérées ou brûlées sur la place publique. Ces précautions rassuraient les consommateurs sur la bonté des produits, mais elles ruinaient les producteurs, nonobstant les privilèges qu’on leur prodiguait. Tout ceci n’était, au jugement du ministre, que « béquilles » qu’il faudrait supprimer lorsque l’industrie serait redevenue assez prospère et vigoureuse pour s’en pouvoir passer. Il laissa à d’autres ce soin et Louvois, ni Pontchartrain, ni Desmaretz ne songèrent à libérer l’industrie de cette tutelle oppressive, loin de là, ils aggravèrent les dispositions restrictives de la liberté des fabricants ; l’Etatisme se fît fie plus en plus envahissant et, à partir de l’année 1700, au lieu de relâcher les entraves du Colbertisme on les renforça. Création et méthodes du Conseil de CommerceAu début de la Régence, la création des conseils avait eu la prétention de pourvoir à tout, mais, après quelque temps, on s’aperçut que le commerce avait été négligé, et on s’empressa de réparer cette omission trop excusable de la part d’un gouvernement de gentilshommes (14 décembre 1710). Le vieux Daguesseau, président d’âge, parut rarement au Conseil de commerce et Amelot de Gournay, son neveu, exerça la présidence effective. D’abord on répartit l’administration du commerce en cinq départements à la tête desquels était un membre du conseil. Daguesseau eut la direction du « commerce de France aux Indes orientales et côtes d’Afrique, depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et de tout ce qui est au-delà dudit cap du côté de l’Asie ; la direction du commerce des Compagnies de Commerce établies et à établir, et des entreprises et voyages de long cours pour les objets de commerce ; les chambres de Commerce établies en différentes villes du royaume ; les permissions ou défense de la sortie des Bleds et autres grains et légumes sèches ; les Règlements des Tarifs ; le commerce avec l’Écosse, l'Espagne du côté de l’Océan et avec le Portugal, et tout ce qui dépend de ces deux couronnes ; le commerce et les manufactures. — Au sieur Amelot le commerce et les manufactures des province de Normandie, Picardie, Artois, Flandre Française, Trois évêchés, Alsace, Franche-Comté, Auvergne et de la généralité de Limoges ; le commerce avec les Pays-Bas appelés Espagnols, avec la Hollande, l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande ; avec le Nord qui comprend la Suède, le Danemark, les Etats du Czar de Moscovie, Dantzig, les villes hanséatiques et autres pays dans la mer Baltique ; avec la Lorraine et le pays de Liège ; enfin avec l’Allemagne. » Nointel avait sous ses ordres plusieurs généralités, les pêches maritimes et les colonies ; d’Argenson dirigeait le commerce de Paris, de Picardie, de Normandie, de Champagne et de l’Ile-de-France, il devait tenir la main à l’exécution dans toute la France des ordonnances prohibant les toiles peintes et étoffes du Levant, des Indes et de la Chine. Machault dirigeait le commerce et les manufactures du Midi et du Sud-Est[1]. Le règlement indiquait les méthodes de travail : « Les Intendants et Commissaires départis dans les provinces, les Chambres de Commerce, les Marchands négociants et les Inspecteurs de Manufactures adresseront leurs lettres, Mémoires et Représentations sur les matières qui regarderont le commerce, à chacun des Conseillers dudit Conseil du Commerce suivant leurs départements. Les réponses qui porteront décisions ne pourront y être faites qu’après en avoir référé au Conseil. » Toutes ces matières une fois délibérés et réglées étaient présentées au Conseil de Régence. Daguesseau mourut, Nointel reçut une mission diplomatique, d’Argenson devint garde des sceaux, et le conseil du commerce resta aux mains de Amelot et de Machault et en 1718, lors de la suppression des Conseils, le conseil de commerce fut épargné, la prépondérance d’Amelot reconnue, ce qui lui valut « entrée, séance et voix délibérative au Conseil pour les affaires de commerce ». Pas plus que l’agriculture, le commerce ne pouvait retenir l’attention du Régent uniquement préoccupé de spéculation et ne levant qu’opérations financières et vastes entreprises coloniales. Le manque de capitaux dont la France souffrait en 1715 avait amené la fermeture et la disparition de beaucoup de manufactures et la peste de 1720 avait interrompu le trafic. Le bureau de Commerce« C’était une disgrâce générale à laquelle le temps seul pou- voit porter quelque remède[2] », disaient les membres du Conseil. Ceux-ci voyaient leur nombre augmenter et leurs attributions se restreindre jusqu’à ce que, pour en venir à bout plus vite, on substitua au conseil un bureau. « En faisaient partie : le sieur Contrôleur Général des finances, un des sieurs conseillers du conseil de Marine, et le sieur Lieutenant Général de la Police de la Ville de Paris, et les cinq autres choisis par Sa Majesté, entre ceux de son Conseil qui auront le plus d’expérience au fait du Commerce[3]. » Amelot et Machault furent rappelés à ce titre. De plus, l’arrêt prévoyait l’entrée dans le bureau de commerce des « députés des principales villes de commerce du royaume et des fermiers généraux qui avaient entrée au Conseil royal du Commerce » : ainsi furent introduits : Paignon, marchand drapier à Paris, Pasquier de Rouen, Billatte de Bordeaux, Clapeyron de Lyon, Grégoire de Marseille, Moreau de La Rochelle, Bouchaud de Nantes, Van Hove de Lille, de La Borde de Bayonne et Cilly, raffineur à Cette. Les manufacturesLa situation à laquelle on avait à faire face était troublante. Entre 1700 et 1712 presque toutes les manufactures créées par Colbert avaient disparu, à l’exception de quelques fabriques de drap en Languedoc, les établissements de Sedan, Rouen, Amiens, Abbeville, les tissages de toiles dans le Beaujolais et la Bretagne, les soieries de Lyon, les Gobelins et Beauvais. En 1714 on pensa à une reprise des affaires, mais l’illusion dura peu. Dès 1716, le chômage recommence. Le commerce et les manufactures de toiles de Caen se soutiennent à peine[4], partout se ferment les ateliers[5]. Non seulement le manque de capitaux arrête le travail, mais il empêche le payement des salaires et les entrepreneurs de la manufacture de tapisserie établie à Beauvais et au Petit-Paris, au faubourg Saint-Antoine sont contraints à recourir à une loterie, les gagnants recevront les stocks de marchandises qui n’ont plus de débouchés[6] et malgré ces procédés, en 1721, la manufacture de Beauvais tombe en ruines. Les tapissiers réclament dix-huit semaines de salaire et, sur seize qu’ils sont encore, onze d’entre eux ont donné congé[7]. A Boufflers, leurs camarades moins endurants menacent de « tout faire vendre pour se payer[8] ». L’étranger profite de cette situation pour exporter ses produits, on signale à l’intendant de Lille l’introduction en fraude de vieux vêtements anglais[9]. Pour rendre vie aux tissages, on fermera volontiers les yeux sur le retour de protestants comme Lemonnier et son fils, fabricants de draps à Elbeuf[10], mesure incomplète et tardive car tandis que se rouvre une manufacture des fabriques se ferment dans le Gévaudan d’où on exportait des cadis en Italie[11]. Draperie et tissage« La draperie et le tissage sont toujours les industries les plus répandues. On permet en 1716, aux fabricants de toile du Fresnay de bâtir dans leur ville une halle et d’établir tel nombre de « blancheries » qu’il leur plaira[12]. Gluck et de Jullienne, teinturiers des Gobelins, voient leurs privilèges confirmés[13]. On construit un moulin à foulon à Montauban ; la dépense s’élève à deux mille soixante quinze livres, et c’est l’État qui trouve moyen de la payer[14]. Arles possède, en 1719, une nouvelle manufacture de draps[15], ainsi que Pau[16]. Roch Quinson, négociant de Lyon, établit dans cette ville une manufacture de velours ciselés et à rainages, à l'imitation de ceux de Venise. Il obtient une prime de trois livres par aune d’étoffé qu’il tisse et deux ans après la communauté est subrogée à son privilège[17]. Afin de favoriser le commerce de cette ville, on va jusqu’à enfreindre les règlements. Le sieur Verdun, tisseur, obtient la permission de fabriquer deux mille pièces de taffetas d’Angleterre, « d’une largeur contraire aux règlements et qui devront être débitées hors du royaume ». Les inventeurs aident d’ailleurs le pouvoir royal dans son œuvre de restauration. Un sieur Garon invente une machine pour lever les cordages de la plus grosse tire ; une fille de quinze ans peut désormais accomplir cette tâche qui demandait auparavant trois tireuses des plus robustes. Raymond frères et Michel font encore mieux ; leur appareil supprime les tireuses de cordes ; aussi leur accorde-t-on un privilège exclusif de fabrication pour quinze ans et le droit d’exiger soixante livres de ceux qui s’en serviront. Avec l’invention de Juvinet, « l’Hautel-Dieu épargnera plus de soixante à quatre-vingts licts que lesdites tireuses occupent actuellement, leurs maladies causées par la rigueur de leur travail provenant de la pesanteur de la tire[18]. » En 1721, alors que Marseille périclite, Niort paraît reprendre une certaine vigueur, « les métiers battants semblent augmenter[19] ». Ploos van Amstel, un Hollandais, établit à Auch une manufacture de draps et autres étoffes façon de Hollande[20]. Même industrie est introduite en Lyonnais, à Neuville[21]. Un « marchand retordeur de fils » de Malines élève une manufacture à Péroux pour apprêter les lins qui serviront à faire les tissus du point et de la dentelle[22]. Martigues possédera tine usine où le sieur Silvy fabriquera des camelots grâce à la générosité des États de Provence qui accordent une prime de dix livres par pièce[23]. L’hôpital de Dijon orée un tissage de draps à l’instar des hôpitaux de Lyon[24] et le commerce de Beauvais, si faible en 1721, est assez satisfaisant en 1720[25]. Mais où nous trouvons le plus de prospérité ou mieux le moins de misère, c’est en Languedoc. Les États de cette province, extrêmement active, font d’important sacrifices pour maintenir les industries dont Colbert l’avait gratifiée. On compte à Nîmes seize cents maîtres, fabricants de bas[26]. Il est vrai que quelques-uns d’entre eux chôment. Les manufactures de draps de laine sont assez prospères. La crise industrielle qui sévit dans toute la France ne fait sentir ses effets qu’en 1716. La fabrication des draps pour le Levant qui avait atteint en 1715 dix mille trente-huit pièces tombe à cinq mille huit cent cinquante huit. Mais aussitôt elle se relève[27] :
« Il n’y a pas lieu de s’étonner si les manufactures de cette région prospèrent alors que dans toute la France « c’est une disgrâce générale à laquelle le temps seul pourra apporter quelque remède[28]. » Les États accordent jusqu’à cent soixante mille livres de gratifications annuelles. Aussi en 1720, les 17 et 19 novembre, deux manufactures de Saint-Chinian sont déclarées royales[29]. En décembre de la même année, même privilège est accordé à la draperie de Cuxac[30]. A Montpellier, on fabrique des basins et cotonnades blanches et rayées ; Baillargues travaille pour les manufactures de la même ville. Il y a encore à Montpellier des fabriques de couvertures de laine, à Ganges et à Saint-Bauzille des manufactures de sempiternes[31]. On vend des cadis à Brissac, Saint-Jean de Buèges, Aniane, Saint-Martin, Villefort, Saint- Guilhem-du-Désert[32]. A Cessenon, on installe un moulin à foulon perfectionné[33]. « Tandis que les manufactures de laine subsistent, on s’efforce de créer dans le haut Vivarais des filatures et des dévidages du soies. Dans ce but Jean Mège installe des métiers à Privas[34], un sieur Chataly fabrique des rubans[35], et une importante pépinière de soixante mille pieds de mûrier est plantée près de Tournon[36]. « Il ne faudrait pas croire que les nouvelles créations de manufactures sont localisées dans le Languedoc et spécialisées dans la draperie et la soierie. Cette même époque de crise industrielle qui va de 1716 à 1725 voit la création de plusieurs verreries dans la forêt de Lions[37], à Fresnes-sous-Condé[38]. Un arrêt du 14 novembre 1724 confirme l’établissement fait par Gaspard Thévenet dans la maison appelée le Vivier, près le château de Fallembray, marquisat de Coucy, d’une manufacture de carafons et bouteilles façon d’Angleterre. En 1724, Desandreïs installe une seconde fabrique de bouteilles de gros verre à Fresnes[39], tandis qu’un établissement semblable était créé à Sainte-Menehould en 1722[40] et dans le faubourg de la Conférence ou de Chaillot, paroisse de Passy, en 1725[41]. » GlaceriesLes cristalleries de Saint-Gobain sont assez prospères ; leurs directeurs, d’ailleurs très actifs, veillent à ce que la manufacture ne perde aucun de ses privilèges. Un ancien directeur réussit à détourner un habile ouvrier et ils s’associent à un maître verrier en Nivernais pour fonder une glacerie clandestine. La compagnie fait mettre l’ancien directeur et le maître verrier à la Bastille et l’ouvrier au Fort l’Évêque, le procès dure deux ans et l’arrêt du 27 mars 1716 « répète qu’il est interdit aux ouvriers de quitter la manufacture et même de s’en éloigner d’une lieue, sans congé écrit, sous peine d’amende, d’emprisonnement, même de punition corporelle, et qu’il est défendu de les recevoir[42]. » Manque de capitauxLe grand développement industriel prêt à se produire sera retardé d’un quart de siècle comme conséquence de la perturbation amenée par le Système de Law. Les capitaux se sont cachés, la monnaie circule à peine et des mesures d’une «maladresse insigne rendent leurs détenteurs justement craintifs, l’obligation faite aux étrangers de payer leurs achats en numéraire et non en lettres de change tarit instantanément les commandes des acheteurs mal pourvus de réserve métallique. Le décri des billets de banque n’est pas moins funeste, en sorte que des établissements fondés depuis de longues années et réputés prospères se trouvent dans l'embarras. Le directeur de la manufacture royale de tapisseries de Beauvais « demande que les vingt-deux actions de la compagnie des Indes acquises en billets de banque par suite des ventes de tapisseries dont les payements ont été faits avec ces billets, tiennent lieu de fonds effectifs dans la manufacture[43]. » Les États de Languedoc, en 1721, s’efforcent d’aider les fabricants à triompher de cette crise. Ils enquêtent et se renseignent et aboutissent à cette conclusion qu’elle tient à deux causes : l’une de l’interdiction de tout commerce avec la ville de Marseille, l’autre de la rareté de l’argent[44]. Les États du diocèse de Velay sont tellement frappés de ce manque de capitaux qu’ils décident, en 1721, un emprunt de cent mille livres pour être distribuées « aux négociants de la ville et du diocèse qui donneront des cautions ou des nantissements suffisants et qui s’obligeront de rendre la même somme[45]. » PrivilègeLa situation industrielle de ces négociants serait parfois alarmante s’il ne leur était loisible de recourir aux bienfaits à peine déguisés du gouvernement ou des grands seigneurs. Il est rare qu’une usine importante n’arrive pas à se parer du titre de manufacture royale ou à s’assurer d’un privilège. Le moyen d’obtenir ces avantages est de s’adresser aux intendants, aux évêques, aux princes du sang ou bien au contrôleur général en personne et, de préférence, aux maîtresses de ces hauts barons de l’administration. Mais à force d’être sollicités, ceux-ci s’avisent parfois de prendre l’exploitation à leur compte. Le 11 février 1716, un arrêt du conseil autorise M. le Duc à faire ouvrir et fouiller les mines dans les terres et deux lieues aux environs de la baronnie de Chateaubriand, soit que les terres où elles se trouvent appartiennent aux propriétaires laïques ou ecclésiastiques, en payant aux particuliers à qui les terres se trouveront appartenir, deux sous par pipe de mine en la manière accoutumée. » Le Régent ne demeure pas en reste sur son cousin, mais il cède à une compagnie, sous le nom de Jean Galobin, sieur du Joncquier, le droit d'exploiter, pendant trente ans toutes les mines, et ce privilège est circonscrit au ressort du Parlement de Pau. L’exemple donné par les princes est suivi par la noblesse qui se jette dans le commerce avec ardeur sans aucune préoccupation de déroger[46]. Cet envahissement est sanctionné par l’octroi de lettres patentes concédant le titre de manufacturiers royaux ou privilégiés qui équivaut parfois à la reconnaissance d’un monopole de fabrication. Sous la Régence, on vit se multiplier les manufactures royales[47], nonobstant les réclamations. En 1719, le Conseil du Commerce fait prévenir les industriels que, désormais, toutes les demandes de privilèges royaux seront rejetées[48] et, peu de semaines après cet avertissement, la fabrique de cire et de bougies d’Antony est, gratifiée du titre prétendument réservé. On s'explique qu’il fût recherché en lisant la teneur des avantages qu'il confère. Parfois la noblesse pour le manufacturier et pour ses descendants, ou bien des lettres de naturalité française s’il est étranger. Souvent le Roi paye sur ses deniers les appointements du directeur ou bien lui accorde une pension annuelle ; si la manufacture a besoin de secours, le Roi recommande à ses trésoriers ou aux États provinciaux de lui consentir des prêts sans intérêt. Le terrain sur lequel s’élève la manufacture, les machines qui s’y trouvent sont en partie ou en totalité acquis au frais du Roi. Les directeurs échappent maintes fois à la juridiction ordinaire des manufactures et ne dépendent que du contrôleur général ou du Conseil de Commerce. Les ouvriers ne sont pas moins bien traités ; ils sont déchargés de toutes tailles, subsides, logements de gens de guerre, tutelle, curatelle, exempts de service militaire, nommés maîtres dans les communautés après de longues années passées à la manufacture ; en revanche, comme on l’a vu pour Saint-Gobain, ils ne peuvent quitter la fabrique ni s’en éloigner trop. MonopoleLa conséquence du privilège c’était le monopole. Quelques Monopole directeurs de manufactures royales se montraient insatiables, en 1710, ils saisissaient le conseil d’une demande« dans le but de défendre à tous autres qu’à eux de tisser des draps fins pour le Levant » ; le directeur de Pennautier demandait et obtenait « l’autorisation de se servir lui seul exclusivement des tisserands dudit lieu ». Outre les draps du Levant dont le Languedoc s’efforce d’accaparer l’industrie pour la réserver à quelques manufacturiers favoris, d’autres fabrications font également l’objet d’un monopole. Lyon a celui des soies et profite de cette circonstance pour établir des droits sur diverses sortes de soies, opération d’autant plus profitable que les lettres patentes de différents rois défendaient aux manufacturiers de recevoir d«s soies qui n’eussent pas traversé Lyon auparavant. En 1720, on supprima ce monopole parce qu’on s’aperçut qu’il empêchait la lutte de la soierie française contre les soieries étrangères. Il fut décidé qu’on laisserait la concurrence s’établir à l’intérieur entre les diverses régions produisant la soie ; les droits de transports de province à province seraient supprimés et l’on ne percevrait que vingt sols par quintal de matières étrangères entrant en France. Ce régime ne se soutint guère. Le 22 janvier 1721 il fut fait à nouveau « très expresse inhibition et défense a toutes personnes de faire entrer aucune soie dans le royaume ni de les commercer sans quelles aient été transportées dans la ville de Lyon, et y avoir acquitté les droits ; même d’en faire aucune vente, débit ni entrepôt depuis les lieux par lesquels les soies étrangères entreront dans le royaume jusqu’à leur arrivée dans la ville de Lyon, à peine de confiscation des soies, des chevaux, charrettes, mulets, bateaux, et autres équipages, et de trois mille livres d’amende[49] ». Le 20 janvier 1722, on rétablit un droit de quatorze sols par livre sur les soies étrangères et de trois sols six deniers sur les soies indigènes exportées. Le prétexte à ces nouveaux impôts était « d’acquitter plusieurs dettes contractées par le Roi pour le service de l’Etat, même dans les pays étrangers[50]. A côté des privilèges généraux prennent place les privilèges particuliers, et les fabricants se plaignent de ces monopoles accordés sans discernement et sans scrupule ; voici, par exemple, le 29 mai 1717, requête du sieur Duvernet par laquelle il demande un privilège exclusif pour établir dans les provinces du Languedoc et de Dauphiné une manufacture de mousselines et de toiles de coton[51] ; le 1er mars 1719, projet d’arrêt accordant au sieur Jean Rognon le privilège d’exploiter pendant dix années, la manufacture de faïence établie par fui à Montereau, faubourg Saint-Nicolas[52] ; 1720, exemption de droits de ville sur les vins, bières, bois de chauffage, accordée au sieur Déguillon pour la manufacture de tissus croisés établie à Douai[53] ; 1723, demande de privilège exclusif à Bartholomy et ses associés pour faire l’amidon avec des racines[54]. Bien plus, ces pétitionnaires veulent engager l’avenir et transmettre leur privilège à leurs enfants ou à leurs héritiers[55] ; très souvent ils obtenaient gain de cause parce que les intérêts particuliers l’emportaient toujours sur le bien public. AccaparementsInsatiables, les manufacturiers se liguent entre eux afin d’imposer le prix qu’il leur plaît fixer ; le Roi lui-même n'échappe pas à leurs prétentions. En 1724, Louis XV veut acheter des armes à Saint-Étienne, les armuriers lui font savoir qu’ils ne peuvent lui en fournir. Deux marchands de Lyon, Perrin et Poinat, avaient accaparé tous les fers « de toutes les forges de France, de Lorraine et ceux qui venaient du Levant. Ils avaient ainsi fait hausser les prix considérablement ». Le Conseil du Commerce intervint en « ordonnant que les traités que les quincailliers de Lyon avaient faits n'auraient aucune valeur dans l’avenir[56] ». En regard de ces ligues ou associations passagères apparaissent des compagnies : en 1716, Hermossel et Héquet, pour la moquette[57] ; en 1722, Milhe et ses associés pour le drap[58] ; « Messent fils et Cie » pour les Cuirs ouvrés[59], et en cette même année le Conseil accorde à une seule compagnie le droit d’exploiter toutes les mines du royaume, celles de fer exceptées[60]. Petits fabricantsContre l’État et contre les particuliers associés ou privilégiés, tous plus ou moins nantis d'un monopole ou tendant à le posséder, le petit fabricant est désarmé et impuissant, il végète et tarde de louvoyer entre les défenses, les interdictions, les amendes. Tout est réglementé. Les papetiers n’ont pas liberté d'acheter leurs chiffons où bon leur semble, les chapeliers n’ont pas licence d'employer des poils de chèvres, les toiliers ne peuvent faire de futaines sans autorisation, les usiniers ne peuvent agrandir ni modifier leurs fourneaux, ainsi du reste. Par dessus les petits et leurs besoins, Amelot veille à ce que les règlements soient observés, dussent les industries succomber. Machault et lui tiennent les intendants en haleine. La confection de bas au métier[61], les importations d’indiennes[62], les tissages de petites étoffes de laine du Velay et du Gévaudan[63], des draps de Sedan[64], des toiles de Bretagne[65] sont l’objet de dispositions minutieuses qui rappellent les règlements les plus sévères de Colbert. Amelot prend la peine de rappeler fréquemment aux inspecteurs que les fabricants « doivent observer les arrêts promulgués sur les manufactures[66] » ; et il ne badine pas, il faut travailler, dût-on se ruiner ; si des négociants essaient de passer à l’étranger et d’y transporter leurs métiers, Amelot les punit sévèrement[67]. Pour favoriser les privilégiés on accable les petits fabricants en élevant des tarifs qui rendent illusoire la concurrence étrangère favorable à ces derniers ; ainsi on gêne la vente, on fait obstacle à l’échange. Le gouvernement fixe le prix du verre[68], interdit le port de tel tissu, fixe les heures réservées à la vente des toiles. Ouvriers mercenairesLe petit fabricant vit en contact quotidien avec l’ouvrier dont il se distingue à peine, et avec qui il finit par se confondre. A mesure que l’industrie prend un essor plus large, vise des clients plus lointains et tend à les attirer et à les retenir par l’abaissement des prix, le petit fabricant indépendant se retire devant la production trop rapide, trop considérable et trop peu rémunératrice, il disparaît en tant que fabricant, mais comme il lui faut travailler pour vivre il devient ouvrier mercenaire. Un rapport de 1723 indique à Rouen, pour la ville et les faubourgs un total de trois mille quatre cent quatre-vingt-quinze métiers se décomposant ainsi : 1.643 pour les siamoises, 524 pour les toiles fil et coton, 650 pour les toiles coton, 102 pour les mouchoirs fil et coton, 516 pour les mouchoirs coton, 60 pour les futaines ; douze hommes sont nécessaires alors pour mettre en train un métier pour les siamoises et huit pour les métiers à toiles. Ceci donne un total de trente-trois mille six cent cinquante-six ouvriers ou tisserands dans cette région pour la fabrication des toiles ; la fabrication des draps n’exige pas moins de monde, et ces chiffres semblent excessifs aux contemporains qui voudraient voir une partie au moins de ces tisserands employés à l’agriculture dans le Poitou ou dans le Bourbonnais[69]. On voit en effet un arrêt du 20 juin 1723 qui ordonne, pour remédier à la disette de bras utiles à la culture des terres, l'interruption du travail dans les manufactures de toiles et étoffes de fil et coton de Normandie, à l’exception de Rouen et Darnetat, à partir du 1er juillet de chaque année jusqu'au 15 septembre inclusivement[70]. Salaires ouvriersJusqu’en 1720, les salaires furent modérés. Après le Système le prix de toutes choses fut considérablement relevé, parfois jusqu'au triple, et les salaires suivirent cette progression. Le commis général s’inquiète, le Conseil de commerce lui fait écho et on décide de mettre les ouvriers à la raison afin qu’ils se contentent d’un salaire permettant de vendre les étoffes à un prix modéré. La majoration des salaires a, dit-on, dépassé leurs nécessités et ils usent du surplus pour vivre plus commodément qu’il ne convient à leur état. En conséquence, les intendants reçoivent l’ordre de fixer le maximum des salaires et des denrées. Celte solution despotique et impraticable recevra le démenti des faits parce que les salaires ne dépendent ni de l’entrepreneur, ni de l’ouvrier, encore moins de l’État. Ouvriers déserteursColbert n’avait rien négligé pour attirer de bons ouvriers d’Allemagne, d’Italie ou d’Angleterre ; non seulement il les protégeait et les favorisait, mais encore il veillait à leurs intérêts dans leurs pays d’origine, n’hésitant pas à recourir à la voie diplomatique pour sauvegarder les biens menacés ou saisis de ces dévoués serviteurs. Par contre, ce ministre ne tolérait pas l’émigration des ouvriers français. Les successeurs de Colbert sont tout aussi intraitables à l’égard des ouvriers émigrants qu’ils gratifient sans hésitation du titre de « déserteurs », et pour les mieux atteindre les accusent d’espionnage ou de fuite pour ne pas tirer à la milice[71], les patrons s’ingénient de leur côté pour prévenir le départ des bons ouvriers et la perspective des amendes qui les frapperont suffit parfois à détourner ceux-ci de l’esprit d’aventure. Si un conflit surgit entre patrons et ouvriers et menace de s’envenimer, « Il voit intervenir Amelot : « A l’égard des contestations qui naissent entre les marchands et les ouvriers vous devez, écrit-il à l’inspecteur des manufactures de Reims, avoir une attention toute particulière à les terminer à l’amiable, et je vous autoriserai dans toutes les choses raisonnables que vous avez proposées pour maintenir la paix[72]. » Ainsi l’ouvrier est, en quelque manière, la chose du patron qu’il ne peut quitter à son gré, tandis que le manufacturier n’est astreint à garder aucune mesure à l’égard de l’ouvrier ou de l’apprenti. Ce dernier, au cas où il ne serait pas payé, n’en était pas plus indépendant ; son unique recours était, comme l’ouvrier,« de se pourvoir par devant les juges de police des lieux, pour en obtenir, si le cas y échet, un billet de congé » et encore fallait-il achever les ouvrages commencés. « Les étrangers sont fort empressés de nous enlever nos ouvriers », observe Gournay. Chaque ambassade possède quelques fonctionnaires presque uniquement occupés à débaucher les plus habiles spécialistes. En 1717, la Russie nous enlève cent cinquante ouvriers parisiens qui s’embarqueront au Havre « pour se rendre de là à Pétersbourg en Moscovie, horlogers, doreurs, peintres, carrossiers, tailleurs et autres. Ils seront deffrayés de tout sur cette route, on leur a donné à chacun des gratifications depuis cinquante jusqu’à deux cents pistoles suivant la qualité des professions, dans la convention qu’ils ont faite avec le Tsar ils s’engagent pour cinq ans à travailler chacun dans son espèce, dans ses manufactures Impériales et pour le public quand ils en auront la permission de ce Prince ; on assignera la des pensions, ils seront exempts de tous impôts et de logements de gens de guerre, on leur donnera des places pour y bâtir ; le terme de cinq ans expiré, il leur sera libre de rester encore ou de se retirer où ils voudront et de vendre leurs maisons et effets pour en emporter l’argent. Ils ont liberté entière de conscience[73]. » Après cet exode le gouvernement revient aux anciennes maximes et interdit rigoureusement l’émigration des ouvriers à qui il suscite des rivaux en attirant, comme par le passé, ceux de l'étranger. Ouvriers étrangersOn lit, en effet, dans le Journal de Pierre Narbonne : « A l’époque où Law fut nommé contrôleur des finances, il fit venir d’Angleterre environ deux cents ouvriers, qui établirent à Versailles, hôtel Deslouits[74], une manufacture de montres. Ils fondirent une quantité prodigieuse de louis d’or de Noailles de la fabrication de 1716 pour faire des boîtes et des cadrans à leurs montres[75]. » Cette arrivée d’« horlogeurs », comme on les appelait[76] avait obtenu l’acquiescement du Régent et soulevait le mécontentement parce qu’ils tenaient leur prêche quasi publiquement[77]. Bientôt leur nombre s’accrut au point que, au mois de mai 1719, Jean Buvat parle de « neuf cents ouvriers en horlogerie à Versailles et en d’autres manufactures », recevant chacun trente livres par mois et trente sols par jour pour leur nourriture[78]. Ce nombre considérable s’explique sans peine par le fait que les patrons, en Angleterre, avaient l’habitude de faire trop d’apprentis ; ceux-ci voulant devenir maîtres sans trop attendre s’établissaient sans capital, se ruinaient, émigraient sur le continent où ils apportaient des méthodes parfois ingénieuses et ignorées. Ce fut ainsi que Law créa ses grandes manufactures d’horlogerie à Versailles, de lainage à Chaillot, de draps à Charleville et à Tancarville, de verrerie et de fer à Harfleur et à Saint-Germain, les chantiers de construction navale à Port-Louis. Tout cela dura peu de temps. « Les ouvriers anglais, horlogers, doreurs et menuisiers qui étaient à Versailles, écrit encore Buvat, prirent le parti de s’en retourner en leur pays, ayant appris qu’on allait confisquer leurs biens et les déclarer rebelles s’ils n’y retournaient pas au plus tôt, et de ce que personne ne se présentait pour acheter leurs ouvrages[79]. » Il est aisé de comprendre ces rigueurs à l’égard de nationaux qu’on n’était pas éloigné de considérer comme des transfuges et les organisateurs d’une concurrence commerciale criminelle. C’étaient là, en tous pays, les idées de ce temps. Les immigrants étaient eux-mêmes bien loin d’avoir vu tous leurs vœux comblés. Outre que « personne ne se présentait pour acheter leurs ouvrages », on les payait en billets de banque dont la dépréciation gagnait de jour en jour. Déçus, dégoûtés, certains demandèrent à être rapatriés. Retenus de force, ils réclamèrent la protection de l’ambassadeur. Lord Stair fut trop heureux de l’occasion qui s’offrait de causer une avanie aux Français, Sutton, son successeur, mit des formes plus courtoises, mais s’interposa également en faveur de ses compatriotes ; ils obtinrent la mise en liberté d’un certain nombre d entre eux qu’on avait arrêtés à Rouen et à Dieppe, et que Law avait rengagés d'autorité. Les manufactures encore à leur période de croissance n’avaient pas eu le temps d’acquérir l’expérience et les capitaux suffisants pour les. mettre à l’abri des conséquences de ces départs ; elles périclitèrent, la chute du Système les acheva ; et Sutton, en rapatriant à outrance le plus possible de ces ouvriers, se félicita que Law y eût perdu une dépense de sept à huit millions[80]. Le Droit d’associationDans tout ce qui a trait à l’industrie et au commerce, nous voyons le gouvernement envisager les rapports entre patrons et ouvriers d’un point de vue particulier, le point de vue de Police. Il soumet l’ouvrier au patron afin que celui-ci en retire un travail considérable, en qualité excellente et aux moindres frais possibles. Favoriser et améliorer la production, garantir le patron, satisfaire l’acheteur, on ne vise pas à autre chose, l’ouvrier n’est pas dédaigné, il est négligé par système et sacrifié par précaution. La Police est concentrée entre les mains du Roi, gardien de la paix publique ; à ce titre, l’article 11 de l’ordonnance de 1670 porte à sa connaissance les assemblées illicites, les séditions et émotions populaires. L’assemblée est illicite non seulement quand elle est attentatoire à l’autorité du prince, mais par le simple fait qu’elle existe. Un arrêt du Parlement de Paris, du 17 juin 1717 condamne vingt-six particuliers qui avaient présenté une requête à cette Cour, non qu’elle fut perturbatrice ou irrévérencieuse, mais parce qu’elle était le produit d’une assemblée illicite. Se réunir pour discuter les intérêts et arrêter la conduite des compagnons d’un métier prend un air de complot depuis que le code Michaud, en 1629, a défendu de faire aucunes assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret ; aussi en arrive-t-on à interdire aux saveteurs, tant maîtres que compagnons « de faire aucune dépense par ensemble, ni s’assembler ni aller au cabaret à peine de vingt livres d’amende ». Le 23 février 1723, le conseil d’État défend aux ouvriers et compagnons imprimeurs de s’assembler[81]. Quiconque s’avise de contrevenir à cette législation s’en trouve mal. En 1720, le lieutenant-général de Paris poursuit un sieur Le Poupet compagnon imprimeur et ses camarades. Le Poupet a quitté « par cabale » l’ouvrage commencé, il s’est trouvé aux attroupements dans les cabarets pendant trois jours, il sera condamné solidairement avec ses camarades à payer deux cents livres de dommages et intérêts envers le patron. Ils doivent en outre lui faire réparation dans la Chambre syndicale, en présence de six maîtres imprimeurs, etc.[82] En 1721 à La Rochelle, un jugement est pris en faveur des maîtres contre « les nommés Niordiais, Le Breton et autres compagnons selliers qui les condamnent en cinquante livres d’amende et leur fait défense de plus s’assembler pour embaucher les arrivants..., comme aussi défense à tous cabaretiers autres de souffrir qu’ils s’assemblent en leur maison ni leur donner de chambre pour y faire la dépense[83]. » Il en est ainsi pour tous les corps de métier, traqués dans les villes de province comme dans la capitale. Contre eux on invoque les règlements et ordonnances de police qui ont force exécutoire non pour un cas donné, mais contre toutes les associations du ressort de leur juridiction. Le lieutenant-général de police veille et, au-dessous de lui, l’intendant de justice, police et finances. L’intendant peut faire des règlements administratifs cependant pour plus de sécurité, il préfère recevoir un arrêt du Conseil du Roi, sauf sur un point où il ne craint pas de s’aventurer : lorsqu’il s’agit de prohiber les associations ouvrières. Les assemblées ne se faisaient pas sans entraîner beaucoup d'inconvénients. Dans l’exposé des motifs d’une ordonnance du Lieutenant-général de police de Paris « on lit que les compagnons maçons, couvreurs, plombiers, s’assemblent tous les matins en grand nombre sur la place de Grève, au lieu de s’y comporter honnêtement et d’attendre avec tranquillité que les bourgeois ou les maîtres maçons qui ont besoin d’ouvriers viennent les louer, se liguent les uns contre les autres de différentes provinces et après s’être dit des injures, battus et maltraités à coup de pierre et instruments dont ils se servent dans leurs travaux de façon que plusieurs d’entre eux ont été très dangereusement blessés ce qui a alarmé les bourgeois demeurant dans le voisinage, d'autant qu’ils ont été accablés de pierres dans leurs boulimies[84]. » (10 mai 1719). Ces rixes sont la rançon du compagnonnage, pratique indéracinable. Les chambrelansDe bonne heure on rencontre des ouvriers bien persuadés que les requêtes ni la soumission ne peuvent améliorer leur sort, ils s’efforcent d’échapper aux étreintes du régime corporatif et se font chambrelans, c’est-à-dire qu’ils travaillent pour leur compte en dehors de l’organisation officielle du travail. La corporation n’apportant que gêne et contrainte, le meilleur parti était de s’v soustraire, mais le pouvoir royal ne se résignait à ce parti que contraint, il n’accordait à l’ouvrier l’autorisation de travailler à domicile que dans les villes ou régions où il n’existait pas de corporations : tisseurs de toiles en Picardie et en Bretagne ; tisseurs de toiles et de rubans en Beaujolais, Lyonnais, Forez, Velay. En ville, le chambrelan était pourchassé et sa sécurité personnelle aussi menacée que la prospérité de ses affaires. Demandes d'arbitrageNe pouvant ni se concerter, ni se réunir, pas même pour régler le prix qu’il convient d’exiger pour leurs journées[85], les ouvriers n’ont que deux issues à choisir : l’arbitrage ou la grève. Au XVIIe siècle, il n’est pas rare qu’on s’attroupe en armes et la réclamation devient une émeute ; au siècle suivant le développement de la grande industrie, le progrès du machinisme multiplient la foule des ouvriers et favorisent leur union contre les patrons. En 1716 nous rencontrons deux exemples de réclamations originales. Les ouvriers de la manufacture de Boufflers « tous ouvriers fi leurs de chaînes travaillant depuis longtemps » se plaignent au Régent « que depuis plus de six mois le sieur du Mérou entrepreneur de ladite manufacture, sans aucun sujet de plainte ni mécontentement a cessé de leur donner du travail leur ayant dit pour ces raisons que le Roy lui devant considérablement, et étant chargé pour une somme notable de marchandises, il ne pouvait jusqu’à ce qu’il lui fut rentré des fonds continuer les travaux...[86] » La même année, les ouvriers de la manufacture Van Robais à Abbeville envoient au Régent un placet pour exposer qu’on les laisse sans travail et « dans une sorte de servitude ». Ce chômage voulu par les directeurs créait un état de malaise considérable. Les Van Robais de répondre : Les ouvriers se forment une idée tout opposée au bon sens et à la raison ; ils se figurent que si on interrompt le travail, c’est pour les réduire en servitude et ils ont surtout le grave défaut de penser « que la manufacture est faite uniquement pour les entretenir et ne font point réflexion que la manufacture n’est point faite pour eux, mais qu’eux-mêmes sont faits pour la manufacture ». Puis s'il est vrai qu’il ya du chômage, on doit ajouter qu’aux époques où le travail abonde « au lieu de conserver quelque chose dans les temps d’abondance pour s’en servir dans ceux de disette et de nécessité, ils s'adonnent à la débauche sans penser à l’avenir ». Qui croire ? Le conseil du commerce envoie deux députés, Godeheu et Gilly qui cherchent à apaiser les révoltés ; mais on leur répond par des cris violents. On envoie des troupes pour protéger les deux représentants du Conseil ; l’intendant vient sur les lieux et demande aux ouvriers de nommer une délégation de vingt personnes qui exposeront leurs griefs. Toutes les personnes, présentes veulent parler ; on leur fait savoir qu’on reprendra le travail, mais que les principaux cabaleurs seront punis. Ils protestent, car on doit accueillir tout le monde, sinon personne ne rentrera dans les ateliers. Ordre est alors donné d’arrêter ceux qui tiennent un semblable langage ; de plus, quelques compagnons qui se dirigeaient sur Paris pour soumettre leur différend au conseil du commerce furent emprisonnés ainsi que le « bâtonnier » d’Abbeville et quelques autres bourgeois ayant fait « un acte » avec les tisseurs où l’on se promettait appui et soutien mutuel. Le travail fut alors repris « avec une exactitude et une sagesse qu’on n’avait point encore vues[87] ». Malgré l’arbitrage qui y met fin, c’est presque une grève caractérisée et la pensée d’où est sortie cette discipline des grèves apparaît très nette à propos des majorations de salaire. En 1720, « les compagnons des marchands de toutes espèces des arts et métiers de Paris se mettent sur le pied de caballer ensemble tant pour quitter leurs maîtres que pour les forcer à donner des salaires extraordinaires. Ils s’attroupent pour cet effet en grand nombre dans différents endroits[88]. La crise des salaires qui va éclater en 1724 rendra possible d’autres excitations[89]. Parfois la grève menace de dégénérer en émeute. En 1717, à Lyon, les canuts frappent des soldats, ils sont arrêtés et condamnés à faire amende honorable, nus, en chemise, la corde au col, tenant en leur main une torche de cire ardente du poids de deux livres ; en 1721, à Sedan, on redoute les excès auxquels semblent vouloir se porter quinze cents tisserands chômeurs[90] ; vers le même temps, à Amiens, on ne parvient à réprimer un soulèvement que « par l’emprisonnement de quelques cabaleurs[91] ». *****Les coloniesIndustrie et commerce sont inséparables des colonies, mais malgré l’existence de Compagnies coloniales[92] et l'aventure du Mississipi[93], cette période de huit années est trop rapide pour offrir matière à une étude sur la politique coloniale de la Régence. A peine trouve-t-on à glaner quelques faits de caractère anecdotique qui ne sont guère plus que les amorces de l’histoire future. Quelques jours après la mort de Louis XIV, un bâtiment de guerre prend possession de l’île de France au nom du Roi ; cet accroissement de notre domaine pouvait doubler la valeur de Bourbon, où on venait d’introduire la culture du café, richesse subite qui effraya les habitants au point de les porter à détruire cet arbuste qui leur valait une abondance de biens qui pourrait amener leur perte[94]. Le café et le thé obtinrent en France un débit immense qui ne fut pas étranger au développement du trafic colonial. Au cours de l’hiver de 1719 à 1720, la Compagnie des Indes expédia à destination de Pondichéry, Surate, la Chine, Moka et la mer du Sud dix-huit vaisseaux dont les cargaisons étaient estimées vingt-cinq millions et trente vaisseaux à destination du Sénégal, de la Guinée et de Madagascar. En mai 1720, cette Compagnie possédait cent cinq bâtiments outre les brigantins et frégates, et son fonds dépassait trois cents millions. Les colonies d’Amérique étaient rejetées dans l’ombre par l’éclat dont jouissait la Louisiane. De Saint-Domingue on savait peu de chose, sinon que les femmes s’y étaient révoltées un jour à l’occasion des altérations monétaires ruineuses. De la Martinique on apprenait que les habitants avaient « empaquetés » le gouverneur et l’intendant et les avaient déposés sur un Vaisseau en partance pour La Rochelle avec une lettre au Régent. M. de La Varenne et M. de Ricouart ne purent nier ce qu’on savait déjà, qu’« on avait laissé la colonie manquer de bien des choses, mauvaises farines, mauvaises chairs salées et qu’on y vendait tout cela au double de ce que les Anglais le vendaient dans leurs colonies ». Il était question d’envoyer une escadre contre les rebelles, de secourir la garnison composée de cent quatre-vingts invalides, finalement on ne se trouva pas en état d’armer deux frégates, et il fallut prier humblement les deux chefs de l’insurrection de nous rendre l’île. Hauterive, procureur-général et Dubuc, que les colons avaient fait gouverneur, y consentirent. La guerre de la succession d’Espagne et plus encore l’incurie du ministre Pontchartrain avaient été funestes à notre marine de guerre où figuraient à peine quelques carcasses de ces vaisseaux, fameux jadis, et qui pourrissaient dans nos ports. La flotte de commerce subsistait, sans qu’on put dire d’elle qu’elle était florissante, et cette situation avait fort relâché le lien entre la métropole et les colonies. Mais la mer formait alors un monde à part, exclu, semblait-il, des stipulations de l’alliance franco-anglaise. A des distances si considérables de l’Europe, la rivalité séculaire, les compétitions commerciales, la facilité et la quasi-impunité des coups de force, les accidents mystérieux de la navigation, par dessus tout l’ambition de s’agrandir et de s'enrichir concouraient à maintenir une sorte d’état de guerre entre la marine anglaise et ce qui subsistait de la flotte de Louis XIV. L’âpreté britannique ne prenant jamais conseil que de ses intérêts, son égoïsme, inconscient à force d’être convaincu avait créé parmi les Anglais une sorte d’incapacité à concevoir l'existence d’un droit ou d’un intérêt différent du sien ou opposé au sien. Dans l’alliance conclue à la Haye, l’Angleterre avait surtout aperçu l’exploitation avantageuse pour elle des embarras parmi lesquels se débattait le gouvernement du Régent et le bénéfice qu’elle pouvait retirer de l’introduction d’éléments nouveaux dans l'équilibre des puissances européennes. Cette situation s’expliquait aisément. Les complications territoriales et les compétitions dynastiques en Europe étaient contingentes et passagères, les ambitions coloniales étaient permanentes ; aussi arrivait-il que, nonobstant l’esprit des traités et la lettre de leurs articles les plus formels, les représentants de l’amirauté et de la politique de l’Angleterre n’avaient devant les yeux qu’un seul but à atteindre : étendre leur domaine colonial et en écarter les Français. Ils marchaient vers ce but avec une énergie plus incontestable que la loyauté des moyens auxquels ils recouraient. Tous les moyens, en effet, leur étaient bons : chicanes, violences, trahisons ; et s’il ne leur convenait pas de se découvrir d’une façon compromettante, les peuplades sauvages, faciles à soudoyer, formaient un appoint toujours disponible pour agir contre nous. Aux termes de l’article X du traité d’Utrecht, des commissaires français et anglais devaient régler les limites entre les colonies françaises et britanniques dans l’Amérique du Nord (baie d’Hudson, Acadie) ; l’article XII du même traité cédait l’Acadie, ou Nouvelle-Ecosse, en entier, « conformément à ses anciennes limites » la ville de Port-Royal, « et généralement tout ce qui dépend desdites terres et îles de ces pays-là avec la souveraineté, propriété... » La France conservait le Canada et, pour en protéger l’accès conservait l’Ile Royale[95] et l’Ile Saint-Jean formant au sud-est le vaste estuaire du Saint-Laurent. Mais les limites respectives de la Nouvelle-Ecosse et du Canada n’avaient pas été fixées. Le gouvernement de Boston dans la Nouvelle-Angleterre s’autorisa de ce vague laissé dans l’article XII pour continuer de conquérir au nom et sous le couvert du traité d’Utrecht. Dubois ne put s’abstenir d’en faire l'observation timide sous forme d’un Mémoire[96] transmis le 5 mai 1719 et exposant que le marquis de Vaudreuil, gouverneur du Canada, se plaint des empiétements du gouverneur de Boston, des envahissements des officiers britanniques sur toutes les terres du golfe du Saint-Laurent. Le Régent propose une réunion de commissaires à Paris pour régler les limites entre la baie d’Hudson et l’Acadie. Comme suivant leur méthode invariable, les Anglais ont commencé par chasser les étrangers, par s’emparer de leurs provisions et détruire leurs établissements afin de bien affirmer la prise de possession britannique, le Régent réclame des restitutions et la reconnaissance du droit de pêche des Français de la baie des Chaleurs au cap des Rozières[97]. Le 24 mai, Dubois réclame des restitutions pour les pêcheurs maltraités dans la baie de Canso. Le secrétaire d’État, J. Craggs se dérobe à instances, oppose des plaintes aux réclamations, invente des griefs, gagne du temps. Chammorel chargé de poursuivre cette affaire passe son temps et dépense sa dialectique à convaincre qu’il n’est pas dupe à Londres97 pendant qu’à Paris, Dubois et Sutton, qui a succédé à lord Stair, joutent au plus rusé sur la possession des îles du Canso98. Enfin, le Régent, impatienté par ces chicanes, prescrit à Chammorel de faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir justice, afin que cette contestation n’atteigne pas la bonne entente entre les deux nations[98]. La solution n’interviendra qu’en 1722 lorsque Georges Ier, excédé de réclamations, allouera une indemnité de huit cents livres sterling pour réparer les saisies opérées indûment au Canso[99]. Avec la Turquie, la politique française ne fut guère plus habile qu’avec les colonies. L’ambassade de Mehemet-Effendi était bien autre chose, dans la pensée du grand-vizir Ibrahim, qu’une manifestation cérémonieuse. Cet homme d’Etat avait compris les causes persistantes de la décadence de la nation ottomane et, loin de s’y résigner, il tentait de relever cette grandeur déchue ; mais au lieu de faire appel au fanatisme musulman, désormais impuissant il se tournait vers la civilisation occidentale. Une rivalité séculaire avec l’Empire, les souvenirs cuisants des défaites essuyées à Belgrade et à Peterwardein détournaient le Sultan d’une entente avec l’Empereur ; le roi de France, au contraire, entretenait depuis deux siècles, de cordiales relations avec la Turquie et, de part et d’autre, on faisait taire les croyances pour n’écouter que les intérêts. Ibrahim resta dans celle voie traditionnelle en s’adressant au Régent pour lui demander de l’aider à contenir l’ambition envahissante de l’Autriche et de la Russie. L’ambassade de Mehemet était une avance courtoise qui fut accueillie avec une affectation d’indifférence. Les disputes sans cesse renaissantes entre les divers ordres religieux établis dans les Lieux-Saints avaient abouti à un double résultat ; ils cherchaient à se soustraire à la protection du roi de France et laissaient dans l’abandon les édifices dont ils avaient la garde. Depuis des années, Louis XIV réclamait, sans pouvoir l’obtenir, la permission d’entreprendre la restauration : et de refaire la toiture de l’église latine du Saint-Sépulcre à Jérusalem ; Mehemet apportait cette autorisation, on parut y attacher peu de valeur. Dubois trouvait ces Turcs assez ennuyeux avec leur prétention à se faire protéger, ce qui ne pouvait plaire à ses parrains, le roi d’Angleterre et l’empereur d’Allemagne, et pouvait les indisposer contre lui et lui coûter le chapeau. L’ambassadeur turc ne parvint pas à aborder le sujet de sa mission et quitta la France indigné contre ce ministre qui n’ouvrait la bouche que pour « lâcher l’écluse de son réservoir de mensonges », Mehemet emporta de riches présents et une vive admiration pour les arts et ln goût français (1721)[100]. Deux années plus tard, en 1723, la Turquie fut menacée par l’ambition de Pierre Ier, qui envahit le nord de la Perse. La Turquie s’inquiéta de voir un état musulman démembré par un « infidèle » et le Sultan Ahmed III allait déclarer la guerre à la Russie quand le Tsar eut l’adresse de détourner cette menace en faisant intervenir l’Autriche et la France. La diplomatie française vint à bout de décider les Turcs à s’entendre avec les Russes au lieu de les combattre ; la guerre, sur ce point fut, pour un temps, écartée. |