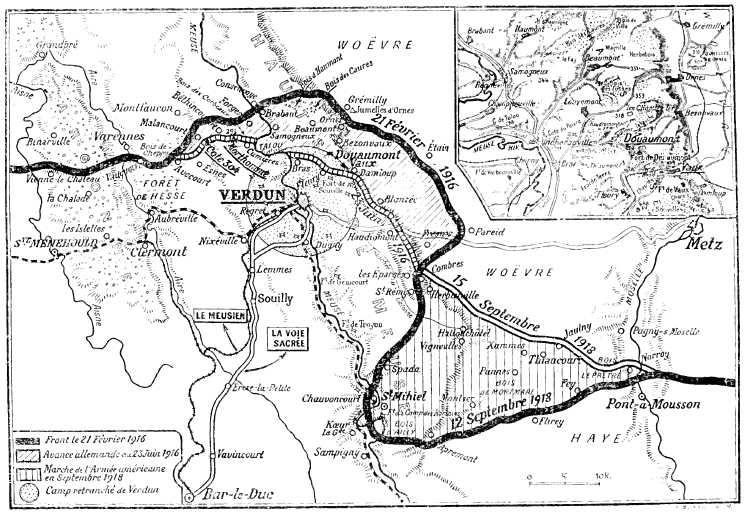HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE II. — LES OPÉRATIONS MILITAIRES.
CHAPITRE IX. — VERDUN.
|
I. — LES PROJETS DES DEUX ADVERSAIRES POUR 1916. LES Alliés n'avaient pas réussi, en 1915, à coordonner leur action. Mais, dès la fin de l'automne, on put compter sur un outillage suffisant pour que cette action d'ensemble fût possible au printemps de 1916. Les 6, 7 et 8 décembre, le général Joffre réunit à Chantilly, dans une conférence, les représentants des armées alliées, pour décider de la conduite à tenir. Il fut posé en principe que la décision devait être recherchée sur les théâtres principaux, où l'ennemi maintenait le gros de ses forces, c'est-à-dire sur les fronts russe, franco-anglais et italien. On admit que les conditions du succès étaient la puissance de ces attaques et leur concordance dans le temps. On agirait le plus tôt possible, pour enlever à l'ennemi sa liberté d'action. Toutefois, la date, en raison des conditions climatériques et du degré de préparation des diverses armées, ne pouvait être encore fixée. Enfin, on convint que si l'ennemi, devançant l'offensive générale des Alliés, attaquait une des puissances séparément, celle-ci pourrait demander l'aide des autres, qui devraient attaquer avec toutes leurs ressources du moment. Le 15 décembre, le général Joffre prescrivit aux commandants de groupes d'armées de faire les études préparatoires dans une série de secteurs qui semblaient propres à une grande offensive. Le groupe d'armées du nord étudiera la région comprise entre la Somme et Lassigny. Le groupe d'armées du centre étudiera la région entre les hauteurs de Craonne et celles de Berry, ainsi que la région entre Moronvilliers et l'Aisne, autrement dit toute la plaine de Champagne, des deux côtés du massif de Reims. Le groupe d'armées de l'est étudiera la région entre la forêt d'Apremont et le bois le Prêtre (front de Woëvre et de Haye), la région entre la forêt de Bazange-la-Grande et les Vosges, enfin la trouée de Belfort. Il y avait intérêt que l'attaque française et l'attaque britannique fussent jointives : elles n'auraient que deux flancs au lieu de quatre, et réaliseraient au mieux l'unité dans le temps et l'espace. Sir John French venait d'être remplacé à la tête des armées britanniques par sir Douglas Haig. Le général Joffre soumit la question au nouveau commandant anglais, dès la première visite que celui-ci fit à Chantilly au milieu de décembre : les Britanniques pourraient attaquer sur le front de leur 3e armée, entre Arras et la Somme ; l'activité y était assez faible pour qu'on pût espérer surprendre l'ennemi. Si les Britanniques acceptaient d'attaquer sur ce front, l'action principale des Français aurait lieu au sud de la Somme. Le général Haig avait des préférences, qu'il garda toujours, pour une attaque en Flandre. Cependant, il adhéra le 14 février 1910 à l'idée de l'attaque jointive sur la Somme, dont les Français prendraient à leur compte les deux rives. Cette attaque aurait lieu vers la fin de juin. Assuré de la coopération britannique, le général Joffre avertit aussitôt les commandants de groupes d'armées que son intention était de rechercher la rupture du dispositif ennemi par une offensive générale des forces franco-britanniques sur le front des armées du nord, tenue prête pour le 1er juillet. Des attaques secondaires, destinées à attirer les réserves de l'ennemi, seront exécutées quelques jours avant l'offensive principale ; en Champagne par le groupe d'armées du centre, en Lorraine et en Alsace par le groupe d'armées de l'est. Le général Foch, qui aura la direction de l'offensive principale, disposera de 39 divisions d'infanterie et de 3 divisions territoriales, formant 3 armées, avec environ 1 700 pièces lourdes largement approvisionnées. Ces moyens doivent permettre une offensive sur un front de 43 kilomètres environ, de la Somme à Lassigny. Elle sera prolongée au nord par l'offensive britannique de la Somme à Hébuterne. Le front total de l'attaque sera ainsi de 70 kilomètres. L'offensive alliée était donc décidée et ses grandes lignes arrêtées, quand brusquement, le 21 février 1916, les Allemands attaquèrent sur Verdun. En 1915, l'armée allemande avait réussi, très péniblement, à se maintenir sur le front occidental. Sur le front oriental elle avait infligé un coup sévère à la Russie. Les armées du tsar avaient été rejetées sur une profondeur qui atteignait 500 kilomètres. L'état-major allemand jugeait la Russie hors d'état de l'inquiéter. Si les chefs et les troupes des puissances Centrales faisaient leur devoir, écrit le général von Falkenhayn, aucun péril sérieux n'était plus à craindre de là. Déjà des éclairs lointains, mais nettement reconnaissables, annonçaient les orages de la révolution qui se levait sur l'empire des tsars. Au mois d'octobre, la Bulgarie s'était jointe aux puissances Centrales, et avait pris en flanc les armées serbes, qui avaient été écrasées. L'anéantissement de la Serbie était un soulagement considérable pour l'Autriche. Enfin, à travers la Bulgarie, les puissances Centrales communiquaient librement avec la Turquie. Le blocus de la Russie par la mer Noire était devenu définitif. L'année 1915 avait été incontestablement très favorable pour les empires Centraux Quels plans formaient-ils pour la campagne de 1916 ? L'Autriche-Hongrie proposait une offensive contre l'Italie. Elle demandait le concours de 9 divisions allemandes, en dehors de celles qui opéraient déjà en Galicie, pour rendre disponibles autant de divisions autrichiennes du front Galicien. En revanche, l'Italie hors de cause, l'Autriche-Hongrie promettait 400.000 hommes disponibles pour enlever la décision sur le front occidental. L'état-major allemand ne se laissa pas plus tenter par cette diversion que l'état-major français ne se laissait tenter par une diversion en Orient. Le 16 décembre, le général von Falkenhayn répondit au commandement autrichien, non seulement en refusant les divisions demandées, mais en demandant à son tour que toutes les forces qui ne seraient pas indispensables sur le front italien fussent employées à relever les divisions allemandes sur le front russe au sud du Pripiat. Ces divisions deviendraient ainsi libres pour les opérations actives que l'état-major allemand projetait, et dont le lieu n'était pas encore fixé. A la Noël, le général von Falkenhayn remit à l'empereur d'Allemagne un rapport, qui contenait les idées de l'état-major sur la campagne de 1916. Ce rapport présentait la France comme arrivée aux limites de l'épuisement, la Russie comme rendue inoffensive, la Serbie comme anéantie, l'Italie comme déçue, mais toutes maintenues par la volonté de la Grande-Bretagne qui renouvelait contre l'Allemagne ce qu'elle avait fait contre Napoléon. Malheureusement elle était très difficile à atteindre, soit dans ses possessions lointaines, par des opérations qui ne sauraient être décisives, soit dans son ile, soit sur le continent. En Flandre, le sol empêche de l'attaquer avant le milieu du printemps. Entre Arras et la Somme, sur le front de l'armée Allenby, une offensive exigerait 30 divisions. En faisant sur les fronts orientaux les plus extrêmes prélèvements, l'Allemagne ne pouvait réunir sur le théâtre occidental qu'une réserve de 25 à 26 divisions. Il faudrait les employer toutes, en laissant sans secours possible tous les points dangereux du front, Champagne, Woëvre, Lorraine. De plus, l'état-major allemand était arrivé dès ce moment à attendre peu de succès de ces grandes attaques frontales, comme les Français venaient d'en faire une en Champagne : Les leçons que l'on peut tirer, dit le rapport, de l'échec des assauts en masse de nos adversaires, se prononcent nettement contre une imitation de ces méthodes de combat. Les tentatives de rupture en masse contre un adversaire moralement intact, bien armé et qui n'est pas trop inférieur en nombre, même en accumulant les hommes et le matériel. ne peuvent pas être considérées comme ayant beaucoup de chances de succès. Le défenseur réussira dans la plupart des cas à verrouiller les zones enfoncées. Cela lui est facile s'il se résout à rompre volontairement. Il est à peu près impossible de l'en empêcher. Les poches, fortement exposées à l'action des feux de flanc, menacent de devenir un cimetière pour les masses qui les occupent. La difficulté technique de conduire et de ravitailler ces masses devient si grande qu'elle parait presque insurmontable. Quant à attaquer l'armée britannique avec des forces moindres, il n'y fallait pas songer ; car les forces à employer étaient fonction de l'objectif à atteindre, et cet objectif ne pouvait être que de rejeter les Anglais à la mer et les Français derrière la Somme. Un moindre résultat, exigeant de moindres forces, ne servirait de rien. Ce but même atteint, l'Angleterre ne renoncerait pas à la lutte, et la France pas davantage. Il faudrait donc une seconde opération. Il était douteux que l'Allemagne disposât des forces nécessaires. Quant, à en créer cet hiver mémo de nouvelles, on ne le pouvait sans soumettre le pays à une tension dangereuse. L'Angleterre ne pouvait être frappée directement. Mais elle pouvait être désarmée. Ses armes étaient les forces militaires de l'Entente. Supposez-les hors de combat, l'Angleterre devrait renoncer à ses desseins : si ce n'était pas une certitude, c'était du moins une forte vraisemblance ; il est rare qu'à la guerre on puisse obtenir davantage. Naturellement, il faudrait en même temps lui porter le plus grand préjudice possible sur son propre sol, soit en s'alliant aux nations encore enchaînées dans sa dépendance (c'était l'affaire des politiques), soit en poussant à l'extrême la guerre sous-marine. C'était là, selon les termes du rapport, une arme comme une autre. D'après les données de l'amirauté allemande, la guerre sous-marine contraindrait l'Angleterre à plier dans le cours même de l'année 1916. Dès lors, l'hostilité des États-Unis, que cette guerre provoquerait, serait sans effet, l'intervention de l'Amérique étant impossible dans ce délai. Le problème se posait donc ainsi : comment, l'Allemagne briserait-elle les instruments de l'Angleterre sur le continent, c'est-à-dire les armées de l'Entente ? Où rechercherait-elle la décision ? Le rapport repoussait la suggestion autrichienne d'une opération en Italie, parce que sa répercussion sur l'Angleterre serait à peu près nulle. Il écartait pareillement l'opération contre la Russie, parce que le climat ne permettait de la commencer qu'en avril, et parce que la seule direction possible, celle de l'Ukraine, manquait de communications, et présentait le flanc à la Roumanie. Quant à une opération sur Pétersbourg, elle n'amènerait pas de décision. Une marche sur Moscou, c'est l'entrée dans l'illimité. Il ne reste donc plus qu'une offensive possible, contre la France. La France est à la limite des sacrifices qu'elle peut faire, et qu'elle fait avec courage. Si on démontre au peuple français qu'il n'a pas à espérer de victoire militaire, la limite sera franchie. Il n'est pas nécessaire de recourir au moyen douteux, et très onéreux pour l'Allemagne, de la rupture en masse. On peut arriver au but avec de moindres forces. Il y a, derrière le front français, à petite distance, des points tels que le commandement français est contraint d'engager jusqu'au dernier homme pour les défendre. S'il le fait, l'armée française s'épuise dans cette défense, que l'objectif soit pris ou non par l'assaillant. S'il ne le fait pas, et si l'objectif tombe aux mains des Allemands, l'effet moral est immense en France. Ainsi, de toute façon, le but est atteint. L'opération, limitée en étendue, n'exige pas de forces très considérables, et il reste à l'Allemagne assez de forces pour répondre aux diversions que l'Entente pourra tenter sur d'autres points. Les objectifs réalisant ces conditions sont Belfort et Verdun. Ce qu'on vient de dire,
conclut le rapport, s'applique à ces deux places.
Toutefois, Verdun mérite la préférence. Les lignes françaises y sont toujours
à 20 kilomètres des communications allemandes. Verdun est le plus puissant
point d'appui pour toute tentative que ferait l'ennemi de rendre intenables,
avec des frais relativement peu élevés, tout le front allemand en France et
en Belgique. Écarter ce danger est un objectif accessoire si important, du
point de vue militaire, que l'évacuation de la Haute-Alsace, succès politique
qu'entrainerait l'opération sur Belfort, pèse bien peu auprès de lui. Tel est le sens de la bataille de Verdun. Les Allemands ont voulu mettre les Français dans un de ces cas de défense obligée, dont on sait qu'ils sont désastreux pour le défenseur. Le projet de guerre sous-marine fut écarté en février par le chancelier. Le commandement allemand avait en soin, pour tromper amis aussi bien qu'ennemis, de faire exécuter les travaux préparatoires à une attaque en Haute-Alsace. Des préparatifs analogues, mais moins importants, furent prescrits aux IVe, Ve, VIe et IIIe années. Ces travaux continuèrent après que ceux de Verdun eurent commencé, de sorte que les Français restèrent longtemps incertains du point oh ils seraient attaqués. D'après Falkenhayn, ce furent des conversations imprudentes à Berlin et les révélations d'un déserteur qui leur fournirent les premières nouvelles sûres, à la fin de janvier, ou même en février. Il est exact que le commandement Français fut averti le 8 février, par un déserteur, de la présence du IIIe corps, et du VIIIe de réserve, et, le 11, par un agent, d'une concentration de troupes, où figurait le XVe corps, et d'artillerie lourde sur la rive droite de la Mense. Mais dès le mois de janvier les préparatifs ennemis avaient été décelés par les aviateurs, et, tout en doutant s'il ne serait pas attaqué en Artois ou en Champagne, le commandement français s'était préoccupé de Verdun. II. — LA PRÉPARATION DE L'OFFENSIVE ALLEMANDE. L'AUTONOMIE des places fortes avait été supprimée par deux décrets du 5 août 1915. On avait besoin de leur artillerie, inutile à Langres ou à Épinal, pour l'offensive de Champagne (2.300 pièces lourdes approvisionnées à 1.600.000 coups, et 1.800 pièces de campagne à 1.450.000 coups). On avait besoin de leurs garnisons pour les travaux du front. Une seule de ces places était vraiment sur la ligne de combat : Verdun. Un ordre du 10 août en fit une région fortifiée, dite B. F. V., qui fut mise sous les ordres du général Herr, commandant le 2e corps. Le 15, deux autres régions fortifiées furent créées, à Dunkerque et à Belfort. La région fortifiée de Verdun allait de Béthincourt, à gauche, à Kœur-la-grande, à droite. Elle était rattachée au groupe d'armées de l'est. Dès le 9 août, le général Dubail indiquait au général Herr le rôle de la R. V. F. Ce rôle, purement défensif, était d'assurer l'inviolabilité du front en reliant la 3e armée, en Argonne, à la 1re, en Woëvre. Pour cela, il fallait transformer la place, organisée circulairement, en un système parallèle de défenses successives. Le 8 novembre, une instruction du groupe d'armées définit les travaux à exécuter : quatre positions, les deux premières sur les deux rives, et les deux autres en arrière, sur la rive gauche. De son côté, le haut commandement, inquiet de la poussée du XVIe corps allemand en Argonne, prescrivait, dans une suite d'ordres dont le premier est du 14 août, la création d'une série de défenses sur la rive gauche, pour le cas où il aurait fallu évacuer Verdun. Le général Herr s'est donc trouvé en présence d'une double obligation : d'une part renforcer son front sur les deux rives et se souder aux armées voisines ; d'autre part préparer un repli éventuel sur la rive gauche, et organiser cette rive. Or le général Herr disposait de moyens très restreints. Il était fatal, écrit le lieutenant-colonel de Thomasson, que les organisations défensives de la rive droite, comme celles de la rive gauche, fussent incomplètes. Le 1er février 1916, il existait théoriquement sur la rive droite quatre positions : une première position Brabant-Ornes, une deuxième Samogneux-Bezonvaux, une troisième côte du Talou-massif d'Haudromont, une quatrième Froideterre-Douaumont, avec une avancée Bras-Douaumont. Deux positions intermédiaires à contre-pente étaient prévues, entre la première position et la seconde, entre la troisième et la quatrième. Mais, en fait, la première position seule existait. En arrière, tout restait à faire. Entre la première position et la deuxième il n'existait pas de boyaux. Les deuxième, troisième, quatrième positions avaient été commencées à la fin de 1914, selon les idées alors reçues ; mais les travaux, sans cesse abandonnés, n'étaient pas utilisables, sauf ceux de la quatrième position. Le colonel Driant, député de Nancy, qui commandait un groupe de chasseurs dans la région fortifiée de Verdun, au bois des Caures, communiqua ses inquiétudes à ses collègues de la commission de l'armée, le décembre. Le président de la commission, général Pedoya, avertit le ministre de la Guerre, général Gallieni. Le colonel Driant aurait vu aussi le président du Conseil, M. Briand ; celui-ci pria par téléphone Gallieni de recevoir Driant, et, au Conseil des ministres, lui demanda d'écrire au général Joffre. Le 16 décembre, Gallieni écrivit au commandant en chef que des défectuosités lui étaient signalées dans la mise en état de défense du front : particulier dans la région de la Meurthe, de Toul et de Verdun, le réseau des tranchées ne serait pas complet. Il ajoutait que cette situation présentait lus plus graves inconvénients, et qu'une rupture rire Iront, dans ces conditions, engagerait la responsabilité du gouvernement tout entier. Les enseignements les plus récents de la guerre prouvant que les premières lignes pouvaient être forcées, mais que les lignes suivantes pouvaient arrêter quand même l'attaque, il priait, le général Joffre de le mettre en mesure de pouvoir donner l'assurance que, sur tous les points de notre front, l'organisation au moins sur deux lignes a été prévue et réalisée avec tous les renforcements indispensables en obstacles passifs (fils de fer, blancs d'eau, abatis, etc.). Le général Joffre répondit le 18 décembre en se référant à son instruction du 22 octobre précédent. Cette instruction ordonnait : 1° L'amélioration des 1re et 2e positions existant sur tout notre front et comprenant chacune plusieurs lignes de tranchées : 2° L'organisation en arrière de ces 1re et 2e positions d'un ensemble de régions fortifiées dont une partie était déjà à cette époque (22 octobre) en voie d'organisation. Le général Joffre ajoutait : Les défenses existantes de nos grandes places lie l'Est ont été transformées pour entrer dans ce système de régions fortifiées on elles présentent plusieurs lignes de défense successives. Toute cette organisation, étudiée d'après nu plan d'ensemble, est en voie de réalisation depuis longtemps et achevée sur nombre de points du front. — Ici le général Joffre ajoutait en note : A ce sujet la construction des obstacles passifs a été retardée et continue à être retardée, malgré mes nombreuses demandes, par l'insuffisance des ressources en lit de fer barbelé. Je puis néanmoins donner au gouvernement l'assurance que, sur tout le front, au moins les deux positions principales de défense sont munies des obstacles passifs nécessaires pour leur assurer toute la résistance voulue. Le commandant en chef concluait : En définitive, j'estime que rien ne instille les craintes que vous exprimez au nom du gouvernement dans votre dépêche du 16 décembre.... Cependant, quand les préparatifs de l'ennemi furent manifestes, le général Joffre envoya en mission dans la région fortifiée, le 20 janvier, le général de Castelnau. Celui-ci était devenu le 11 décembre 1915 major-général de l'armée. Le général de Langle de Cary lui avait succédé dans le commandement du groupe d'armées du centre, remplacé lui-même à la tête de la armée par le général Gouraud. Le général de Castelnau visita sur le front nord le bois des Caures, le bois d'Ham-nord (rive droite) et le bois des Corbeaux (rive gauche) ; sur le front sud, le bois des Chevaliers. Il reconnut que l'organisation de la première position correspondait aux directives du général en chef. Il y prescrivit seulement la création d'abris-places d'armes pour les réserves, et l'établissement de réduits fermés en arrière et à contre-pente. Quant à la deuxième position, qui était encore très faible, il prescrivit de la renforcer, et de reporter la ligne de résistance à contre-pente. A son retour, le général de Castelnau demanda et obtint que les moyens d'action fussent augmentés. Le général Herr reçut l'autorisation d'employer aux travaux la 31e, puis la 67e division, qui étaient en réserve. Les unités combattantes furent aussi renforcées. Du 11 au 16 février, dit un rapport, après des discussions où la manière de voir du chef d'état-major général finissait par l'emporter, le commandant eu chef mettait à la disposition du groupe des armées du centre, pour renforcer plus particulièrement la région de Verdun, six divisions d'infanterie, six régiments d'artillerie lourde attelée et à tracteurs, de l'artillerie lourde à grande puissance et de l'artillerie lourde sur voie ferrée. Le 1er février, la R. F. V. passa du groupe d'armées de l'est au groupe d'armées du centre. A cette date, elle avait, pour défendre un front de 112 kilomètres, 53 bataillons actifs et 31 territoriaux. Une seule division, la 72e, occupait, à cheval sur la Meuse, tout le front de Béthincourt à Ornes. — Le 20 février, le front, porté à 166 kilomètres, était défendu par 150 bataillons, dont 80 en ligne. Le secteur de la rive gauche était tenu par le groupement Bazelaire (29e et 67e division) ; sur la rive droite, le groupement Chrétien (30e corps et troupes territoriales) avait deux divisions, 72e et 51e, entre la Meuse et Ornes, sur le plateau, et la 14e division avec les troupes territoriales plus à droite, en Woëvre. — A la droite du groupement Chrétien, le 2e corps (132e, 3e et 4e divisions) formait le retour, de Fromezey aux Paroches. Deux divisions, la 37e et la 48e, étaient en réserve de groupe d'armées. — L'artillerie comprenait, sur le front qui allait être attaqué, pour l'une et l'autre rive, 388 pièces de campagne et 244 lourdes. Un des points faibles de Verdun, c'étaient les communications. Tandis que les Allemands avaient dès le mois de décembre construit quatorze voies ferrées de pénétration, le front français ne pouvait rien attendre des voies normales, dont l'une, venant du sud, était déjà coupée par l'ennemi, et dont l'autre, venant de l'ouest, serait évidemment coupée, et le fut en effet, dès le commencement des opérations, au coude d'Aubréville. Restait un tortillard, le Meusien, et une route, qui venait de Bar-le-Duc par Souilly, parallèle au Meusien. Le Meusien avait été amélioré. Mais sa capacité était au maximum de 800 tonnes par jour. Or, il t'allait amener à Verdun 2.000 tonnes de munitions par jour ; ravitailler en vivres et matériels divers quinze ou vingt divisions, à raison de 100 tonnes par division ; transporter, tant en troupes montantes que descendantes, 15 à 20.000 hommes par jour ; etc. Restait la route. Le 18 février, le service automobile recul l'ordre de se préparer pour une poussée allemande sur la Meuse. Le 19, une réunion des représentants des différents organes de transport cul lieu à la gare de Bar-le-Duc. Le capitaine Doumenc, représentant le service automobile, prit l'engagement de transporter par jour.000 tonnes et 12.000 hommes, sous réserve que le service automobile serait le maitre absolu de la route. La première commission régulatrice automobile fut immédiatement instituée. Le 20 février, la circulation était organisée. La route de Verdun, écrit le commandant Doumenc, se présentait sous la forme dune roule à double circulation construite en matériaux tendres. Il fut décidé qu'on aurait un courant montant et un courant descendant, qu'on exclurait complètement de cette route tous les convois à chevaux et à pied, en les rejetant sur des itinéraires parallèles ; enfin qu'on n'interromprait en aucun cas la circulation pour faire des réfections méthodiques de la chaussée... — Les convois non automobiles la traversaient, mais sans pouvoir s'y engager —. Quant à l'entretien, il ne pouvait être l'ait qu'en répartissant le long de la route des matériaux routiers provenant, en principe, de carrières ouvertes à proximité même : le calcaire tendre serait jeté tout le long des chemins sous les roues des voitures.... Cette artère unique à double voie devait être outillée comme une voie ferrée. Elle avait des cantons, avec un système de blocage analogue à celui des chemins de fer, chaque canton possédant des moyens de liaison, de surveillance et de dépannage qui devaient lui permettre de garder libre sa portion de route. Toute voilure qui ne pouvait être remorquée devait être jetée au fossé. Personne n'avait le droit de s'arrêter, sauf panne grave ; aucun camion ne pouvait en dépanner un autre. Les troupes étaient embarquées en camions au saut du train, dans la région Revigny-Bar-le-Duc-Ligny ; les munitions, à Bar-le-Duc et à Baudonvilliers. Le débarquement se faisait pour les munitions dans de véritables gares de camions, le long des circuits de Regret et de Nixéville, pour les hommes dans de véritables gares de personnel. Il y eut, dès le 29 février, 3.000 camions qui montaient et redescendaient en une chaîne sans fin ; il y en eut bientôt 3.500, formant 51 groupes, qui transportaient par semaine 90.000 hommes et 50.000 tonnes de munitions. Il faut y ajouter près de 2.000 voitures de tourisme, 48 sections sanitaires avec 800 voitures, 27 sections de B. V. F. avec 200 voitures, enfin tous les véhicules des services des armées, soit au total 9.000 voitures automobiles, et 11.500 au mois de juin. Sur cette petite route départementale, large au plus de 7 mètres, qui sinue au flanc de collines basses, il passa, dit M. Heuzé, jusqu'à 6.000 véhicules en un seul point par vingt-quatre heures, soit une moyenne d'un véhicule par quatorze secondes. Les fréquences de passages furent parfois d'un véhicule par cinq secondes pendant des heures. Cette route de Bar-le-Duc à Verdun, ainsi gardée sur 75 kilomètres, s'appelle, pour l'histoire, la Voie Sacrée. Les vivres étaient transportés par le Meusien. Ainsi la défense s'organisait quand l'attaque commença le 21. Le service automobile devait commencer à fonctionner le 22 à midi. Le même jour, le 20e corps devait débarquer dans la région de Bar-le-Duc. Le 1er corps était en marche. Réduit à sa forme géométrique, le champ de bataille de Verdun est un plateau de calcaire dur, incliné vers l'ouest où il plonge sous les collines d'Esnes, à l'altitude de 250 mètres, et relevé vers l'est, où il culmine à 388 mètres, et où il se termine net, en dominant la Woëvre par un à-pic. La Meuse s'est creusé dans ce plateau un couloir nord-sud, sur la corniche duquel s'est placée la ville de Verdun. La régularité de ce plan incliné a été altérée par le travail des eaux. Sur la rive droite surélevée, les eaux de pluie, assemblées en ruisseaux, ont du, pour descendre soit à la Meuse, soit à la Woëvre, s'encaisser profondément. Le ravin qui aboutit à la Meuse près de Bras descend de 140 mètres sur la longueur d'une lieue. Les ravins opposés qui descendent vers la Woëvre sont dans des conditions analogues : celui du Bazil naît entre Fleury et Douaumont, à 320 mètres ; à moins d'une lieue plus loin, après avoir longé le village de Vaux, il entre en Woëvre à 250 mètres seulement. Ces ravins donnent au paysage son aspect tourmenté, presque montagneux. Ce ne sont que têtes de vallons aux creux profonds, éperons et replis, isthmes qu'on suit entre les dépressions, arêtes transversales qui barrent l'horizon, hautes murailles qui enferment des vallons. Les forêts qui couvraient les versants ont été hachées, les trous d'obus jointifs martèlent partout le sol. La roche broyée a pris le contour mou des dunes, et les fonds sont changés en hideux marécages. Le paysage silencieux est tantôt blanc et tantôt d'un roux brun ; les cratères pleins d'eau sont couleur de turquoise. Les forts eux-mêmes, écrasés par tant d'obus, ressemblent à tics écueils rongés par la mer ; une broussaille de fer rouillé sort du ciment. Entre les deux systèmes de ravins, ceux qui se dirigent à l'ouest vers la Meuse et ceux qui se dirigent à l'est vers la Woëvre, règne une arête qui les sépare, et qui dans ce terrain découpé forme le seul faite continu. Ce faîte domine le pays et commande dans tous les sens toutes les têtes de ravins : c'est le plateau de Douaumont. A son point culminant se trouve un fort. Vue de l'autre rive, la colline qui porte ce fort s'élevait comme un cône couronné de fumées. De la rive droite au contraire, elle semble une île longue à profil tourmenté. Sur la rive gauche de la Meuse, le plateau s'abaisse, et va s'enfouir sous les collines d'Esnes, qui le dominent par un front à pic d'éperons très découpés. Un de ces éperons allait jouer un rôle dans la bataille sous le nom de cote 304. De môme qu'une côte est précédée d'îles, les falaises d'Esnes ont projeté vers l'est des îles, qui s'élèvent entre les collines et la Meuse, posées sur le sol comme des verrues. Tel est. en face de la cote 304, l'observatoire du Mort-Homme. C'est un petit massif formé de deux collines jumelles, la plus basse (265 mètres) au nord-ouest, la plus haute (295 mètres) au sud-est. Le chenal entre 304 et le Mort-Homme s'appellera, comme tant d'autres ravins, le Ravin de la Mort. Les positions allemandes, depuis 1914, entouraient Verdun sur la plus grande partie de la circonférence. Les Français avaient seulement réussi, à la fin de 1914 et en 1915, à desserrer l'étreinte et à se donner un peu d'air. Les lignes commençaient, à l'ouest, à la butte de Vauquois, partagée entre les deux adversaires. De là, elles tournaient vers l'est, les Allemands bordant la lisière sud du bois de Cheppy et les Français la lisière nord de la forêt de Hesse, les deux adversaires étant séparés par la vallée de la Buanthe. Puis les lignes s'infléchissaient au nord-est, les Allemands suivant toujours la lisière des bois, les Français s'appuyant sur Avocourt. Elles traversaient ensuite, sans changer de direction, la corne sud-est des bois de Malancourt. A la sortie de ces bois, c'était le ruisseau de Forges qui séparait les deux fronts, jusqu'à la Meuse, les Allemands tenant sur la rive nord le bois de Forges, les Français, sur la rive sud, la côte de l'Oie. Sur la rive droite, les positions françaises avançaient en saillant par Brabant, conquis le 15 octobre 1914, la corne sud-est du bois de Consenvoye, conquise le 21 décembre 1914, le bois d'Hautmont (15 octobre 1914), le bois des Causes, et l'Herbebois. Là elles butaient à un monticule isolé, les Jumelles d'Ornes, qui, malgré tous les efforts, n'avaient jamais pu être enlevées. Elles en contournaient donc le pied, dessinaient dans la plaine de Woëvre une large poche conquise au printemps de 1915, et revenaient au sud-ouest retrouver les Hauts-de-Meuse aux Éparges. Elles se prolongeaient, toujours en direction du sud-ouest, pour repasser la Meuse au nord de Saint-Mihiel, qui était à l'ennemi. En somme, il y avait sur le front de Verdun quatre grands secteurs : la rive gauche, de Vauquois à la Meuse ; puis, en passant sur la rive droite, le secteur nord-est, où les positions françaises faisaient un bombement comprimé à l'ouest par le bois de Forges, à l'est par les Jumelles d'Ornes ; le secteur est, tout entier dans la plaine de Woëvre ; le secteur sud-est, en retour des Éparges à Saint-Mihiel, sur un plateau boisé et difficile. Les Allemands choisirent pour la rupture le secteur nord-est. L'attaque par la Woëvre les eût menés par un terrain détrempé au pied des Hauts, qu'il eût fallu escalader : opération extrêmement difficile. L'attaque par le secteur sud-est, que le commandement français avait d'abord crainte, devait traverser des taillis impraticables, où les troupes se disloqueraient. Restaient les secteurs nord, sur la rive gauche et sur la rive droite, de Vauquois à Ornes. C'était un front d'attaque de 40 à 50 kilomètres. Pour l'utiliser dans toute son étendue, dit Falkenhayn, il aurait fallu beaucoup plus de troupes, d'artillerie et de munitions que l'armée allemande n'en pouvait employer. Sur 26 divisions disponibles pour le front occidental, celle-ci devait en garder un tiers en réserve générale, pour parer aux contre-offensives de diversion, le front allemand n'étant tenu par les divisions en ligne qu'à la densité d'un homme par mètre courant. L'état-major allemand avait pensé raccourcir le front en supprimant le saillant de Noyon, et en prenant la corde d'Arras à Laon ; mais, à l'étude, on s'aperçut qu'on récupérerait seulement 2 ou 3 divisions ; et, pour ce maigre avantage, il aurait fallu abandonner des positions améliorées depuis plus d'un an, en l'aire construire de nouvelles par des milliers de travailleurs, perdre du matériel, désorganiser l'arrière, renoncer à des communications importantes. D'autre part, on ne pouvait ni créer de nouvelles unités, ni prélever des renforts sur les armées alliées : les soldats turcs n'avaient pas l'instruction nécessaire ; les Bulgares ne s'étaient pas obligés à intervenir sur le front occidental ; les troupes autrichiennes supporteraient mal la rude guerre du front français, et, si on prenait les meilleures, la double monarchie se trouverait en péril. Au total, l'armée allemande ne disposait donc pour l'opération sur Verdun que de 17 ou 18 divisions. Elle comptait en consacrer 9 à la première attaque, L'état-major allemand ne doutait pas que cette attaque ne dût avoir lieu sur la rive droite. On a vu en effet que les positions françaises formaient lit un bombement qui privait être battu de feux concentriques. Évidemment, après une certaine avance sur la rive droite, les Allemands étaient exposés à recevoir des feux de flanc de la rive gauche. Ils devraient donc avancer aussi leurs positions sur cette rive. Mais ils ne pouvaient prélever pour cette seconde attaque que fort peu de divisions. Elle se présentait d'ailleurs mal, purement frontale, sur un espace étroit, en mauvais terrain, et elle rejetait les Français sur des positions de plus en plus fortes. Avec des forces si faibles, l'opération de la rive gauche, si elle était menée simultanément avec celle de la rive droite, ou si elle la précédait, avait chance d'échouer ; or, on n'avait pas les moyens de la renouveler, et son échec paralyserait toute la bataille. Au contraire, si l'on attendait pour attaquer à l'ouest de la Meuse que le succès fût déclaré à l'est, on trouverait la ligne française probablement dégarnie. On pourrait de plus l'attaquer en potence sur deux faces. Le commandement décida donc de retarder l'attaque de la rive gauche après le succès sur la rive droite. Ce retard avait encore cet avantage, que les divisions destinées à l'attaque de la rive gauche restaient provisoirement disponibles, si les Alliés tentaient une diversion. Le 26 septembre 1915, au lendemain de l'attaque française en Champagne, le commandement avait formé pour le Kronprinz allemand un groupe d'années, le premier du front occidental, qui comprenait la IIIe armée, attaquée eu Champagne, la Ve qui était devant Verdun, et les détachements qui tenaient la ligne jusqu'à la Suisse. Quelques jours avant la Noël, avant donc que le rapport qu'on a vu fût soumis à l'empereur, le Kronprinz fut averti, mais seulement de vive voix, et sous la condition du secret, que l'attaque devant Verdun était résolue, et qu'il la dirigerait. Pour ne pas disperser son action, on le débarrassa du soin de la Me armée, et on lui laissa seulement, avec la Ve armée, les détachements von Strantz en Woëvre, von Falkenhausen en Lorraine et Basse-Alsace, et Gaede en Haute-Alsace. On mit à sa disposition pour l'attaque 9 divisions d'élite. D'autres furent désignées pour relever les divisions d'assaut. On réserva 3 divisions particulièrement choisies pour l'attaque éventuelle sur la rive gauche. Enfin, pour détourner l'attention des Français et les inquiéter, la Ille année attaqua le 9 janvier à Maisons-de-Champagne, le 12 février à Sainte- Marie-à-Py, le 13 à Tahure. La IIe armée enleva le 28 et le 29 janvier le village de Frise au sud de la Somme. La Vie armée attaqua le 26 janvier à Neuville-Saint-Vaast, le 8 février à l'ouest de Vimy, le 21 février à l'est de Souchez. Le détachement Gaede assaillit le 13 février les lignes françaises à Seppois-le-Haut. III. — LA BATAILLE DE VERDUN. LE 21 février, à quatre heures du matin, écrit le correspondant de la Gazette de Francfort, la place forte de Verdun fut réveillée de son assoupissement par un obus lourd allemand. C'était un coup de canon de réjouissance, et il signifiait le commencement des grands combats autour de la ceinture fortifiée de la place. Le bombardement véritable commença à sept heures quinze. Ce fut une formidable avalanche d'obus de tous les gros calibres, depuis le 420 jusqu'au 240, en passant par le 380 et le 305 autrichien. L'artillerie au-dessous du 210 ne prit point part à la préparation. La densité du tir était extraordinaire. Les aviateurs français qui volent sur la forêt de Spincourt s'accordent à dire que cette région est le centre d'un véritable feu d'artifice. Le petit bois de Gremilly, au nord de la Jumelle, accuse une telle densité d'ouvertures de feu que les observateurs en avions renoncent à pointer sur leurs cartes les batteries qu'ils voient en action (Bulletin des armées, récit du 22 mars). Ces régions, farcies de canons, ne présentent plus aux aviateurs qu'un nuage traversé d'innombrables lueurs. A quatre heures de l'après-midi, l'intensité du feu redouble. Enfin, vers cinq heures, la première attaque d'infanterie allemande est lancée contre notre centre. La bataille est engagée. C'est le moment de définir la tactique particulière que les Allemands y ont employée. Ils sont partis de cette idée que l'on ne pouvait faire lutter des hommes contre du matériel. En conséquence, ils ont mis beaucoup de soin dans la préparation d'artillerie. Leur système ordinaire a été de choisir un objectif restreint, 500 mètres de front par exemple, qu'ils arrosaient d une manière méthodique, jusqu'à les avoir transformés en labour.
VerdunIls ont creusé beaucoup moins de boyaux que nous ne l'avions fait en Champagne. Ils n'ont pas établi de parallèles de départ. C'est la tranchée de première ligne qui en a servi, creusée d'abris profonds où les troupes s'entassaient, et protégée par une masse couvrante. Ils n'ont pas cherché non plus à pousser ces tranchées jusqu'à la distance d'assaut. Dans certains secteurs, par exemple devant l'Herbebois, ils ont attaqué à la distance, presque incroyable dans cette guerre, de 1.100 mètres. Cette absence de parallèles et cette distance au départ ont servi à la surprise, les Français croyant les préparatifs inachevés. Les Allemands reprendront la même méthode contre la 5e armée britannique, le 21 mars 1918, et la surprendront de même. Les assauts ont été exécutés sur des objectifs précis, démolis par l'artillerie. Pour s'assurer de l'écrasement des lignes, une reconnaissance conduite par nu officier se portait en avant, forte l'ordinaire d'une quinzaine d'hommes, mais en comprenant parfois jusqu'à 60. Venait ensuite la première vague d'assaut. Elle était déployée en tirailleurs é très larges intervalles ; chaque peloton des compagnies d'assaut y avait détaché un ou deux groupes, qui étaient accompagnés de grenadiers et de pionniers. La deuxième vague comprenait le gros des pelotons en ligne dense. Enfin, une dernière vague, reste de chaque peloton, venait combler les vides, apportait les matériaux nécessaires pour retourner la position conquise et les munitions pour la défendre. Les vagues se succédaient à 20 ou 30 pas de distance. — Si l'infanterie rencontrait un obstacle non détruit, elle s'arrêtait, et la préparation d'artillerie recommençait. Si, au contraire, le nivellement de la position avait été suffisant pour que la défense fût impossible, l'infanterie prenait possession du terrain, s'y retranchai t, et ne poussait pas plus avant. C'était, en somme, l'artillerie qui conquérait ; et l'infanterie qui occupait. On pensait, par ce procédé, avancer avec très peu de pertes. Le plan d'ensemble des Allemands n'était pas moins bien calculé que leur tactique de détail. Ils avaient mis sur le plateau, à l'est de la Meuse, trois de leurs quatre corps de choc : c'étaient, de leur droite (ouest) à leur gauche, le VIIe de réserve, le XVIIIe et le IIIe. Le dernier, le XVe, était plus a l'est, dans la plaine de Woëvre. La 113e division, qui complétait les troupes d'assaut, était en soutien. Cette masse était elle-même encastrée dans l'armée du Kronprinz, qui lui avait fait place, entre le VI' corps de réserve et le Ve. Le premier choc a été donné par les trois corps placés sur le plateau, à l'est immédiat de la Meuse, entre Brabant et Ornes. Pendant ce temps, le XVe corps attendait, avec, le dessein sans doute de se porter contre la droite française quand la victoire serait dessinée sur le plateau, et de compléter ainsi la rupture frontale par une attaque de flanc. Le reste de l'armée s'engagea plus tard encore, le VIe corps de réserve le 6 mars seulement, et le Ve corps de réserve le 8 mars. On peut donc admettre, comme nous l'avons déjà indiqué, que les Allemands comptaient sur une rupture brutale et centrale, les conséquences de cette victoire devant être ensuite exploitées par les ailes, qui se refermeraient pour ainsi dire sur les masses françaises rompues et pelotonnées dans la région sans issue de la Meuse. Tout indique que les Allemands comptaient que ce mécanisme de précision fonctionnerait avec une exactitude foudroyante. Avant la bataille, tous les commandants de régiments avaient été appelés à Charleville, au grand quartier général, et là, en présence de l'empereur, sur un terrain analogue à celui de Verdun, ils avaient exécuté une véritable manœuvre de cadres, une répétition générale de la bataille. Jamais une grande action militaire n'a été préparée avec plus de méthode, outillée avec plus de puissance, machinée avec plus de calcul, déclenchée enfin avec un mélange plus étonnant de circonspection et de vigueur. La première attaque d'infanterie, le 21 février vers seize heures quarante-cinq soir, par une froide journée d'hiver, fut lancée sur le bois d'Haumont. Ce bois, malgré la disposition en glacis du terrain qui l'entoure et qui favorise la défense, fut enlevé. Le bois des Caures, attaqué à dix-sept heures, fut également perdu par nous, mais sa partie méridionale fut reprise. Plus à droite, dans le bois de Ville, dans les taillis de l'Herbebois, l'ennemi, maitre des tranchées avancées, fut arrêté sur les positions de soutien. Le 22, la lutte recommença sous la neige. La perte du bois d'Haumont ouvrait dans la ligne un trou par où les Allemands prirent à revers le bois des Coures, qui fut perdu ce jour-là, ainsi que la bois de Ville. La perte de ces positions découvrit la Wavrille, c'est-à-dire la corne sud-est, du bois de Ville, qui fut prise le 23, et la perte de la Wavrille, découvrant à son tour le flanc gauche de l'Herbebois, en amena la perte le même soir après un furieux combat. Le 23 au soir, la première position était perdue. La seconde position tenait dans son ensemble. A la gauche seulement, Samogneux avait été pris, mais l'ennemi ne pouvait en déboucher. Au centre, il ne pouvait déboucher davantage de la Wavrille. Mais, dans la matinée du 24, la seconde position tombe brusquement. C'est l'événement capital de ces premiers jours. L'ennemi, qui s'est renforcé d'une division prélevée à son extrême gauche sur le Ve corps de réserve, débouche par sa droite de Samogneux, en débordant la cote 344, qui est prise. Au centre, il emporte Beaumont et le bois des Fosses ; à sa gauche, le bois des Chaumes. A deux heures de l'après-midi, toute la seconde position est perdue. L'ennemi exploite aussitôt son succès. Au centre, il lance une masse fraîche, qui pénètre jusqu'à Louvemont ; à droite, il emporte la ferme des Chambrettes et pénètre dans le bois de la Vauche. A l'extrême gauche, la côte du Talou est abandonnée et n'appartient à personne. La situation était si grave que le général de Langle de Cary, commandant le groupe d'armées du centre, incertain de savoir si l'on tiendra sur la rive droite, donne aux troupes établies plus à l'est en Woëvre, et qui, en cas de rupture du front de Verdun, auraient été très compromises, l'ordre de se replier dans la direction de l'ouest, sur les Hauts-de-Meuse. Ce mouvement doit s'effectuer dans la nuit même du 24 au 25. A Chantilly, les mauvaises nouvelles arrivent dans la soirée du 24. Aussitôt le général Joffre constitue une nouvelle armée avec les troupes actuellement sur la rive gauche de la Meuse, et celles qui y débarqueront prochainement. Il met en même temps de nouveaux effectifs en mouvement. Cette nouvelle armée a pour mission, dans le cas où les troupes engagées seraient obligées de se replier sur la rive droite, de les recueillir, et, en tout cas, d'interdire le passage de la Meuse à l'ennemi. Mais il faut voir la situation sur place. Dans cette même soirée du 24, le chef d'état-major général, le général de Castelnau, à qui le commandant eu chef donne pleins pouvoirs, part pour Verdun. Il s'arrête à Avize, quartier général du groupe d'armées du centre, le 25, à quatre heures du matin. Le moment est grave, certes, mais non désespéré. Les deux divisions de première ligne, qui se battent depuis quatre jours contre cinq divisions allemandes, ont dû céder le terrain, mais elles ne sont pas submergées. Déjà les premiers soutiens sont arrivés ; la 37e division a relevé la 72e, les 305e et 306e brigades ont formé, sur les ordres du général Deligny, un groupement qui a appuyé la 51e. Enfin, le 25, à 10 heures du matin, le 30e corps est relevé par le 20e. D'autre part, l'ennemi, qui a avancé devant notre gauche de 7 kilomètres, va être obligé de déplacer son artillerie. On a donc le temps, le 23, d'organiser les positions de combat sur la rive droite et de faire passer de nouvelles divisions. Dans ces conditions, il n'y a plus de doute. Après avoir prévu le pire, le commandement français pouvait ordonner le mieux. On tiendrait sur la rive droite. Le chef d'état-major téléphone au commandant de la région fortifiée de Verdun : La défense de Verdun se fait sur la rive droite. Il ne peut donc être question que d'arrêter l'ennemi à tout prix sur cette rive. Lui-même arrive à Verdun le 25 vers sept heures du matin, et renouvelle son ordre : tenir coûte que coûte, là où l'on est. A Verdun, le général de Castelnau trouve un extrême désordre. A l'état-major du général Herr, il est impossible d'avoir une situation d'ensemble, une carte des emplacements des troupes, une idée exacte des ordres donnés. Sur les routes encombrées, les hommes des dépôts et des services de la place, mêlés à des réfugiés et à des convois, refluent vers l'arrière. Il faut avant tout remettre de l'ordre. Or, il y a en février 1916 un état-major d'armée disponible : celui de la 2e armée, commandée par le général Pétain, et qui a été retirée du front après la bataille de Champagne. Le 24, Pétain a été appelé par dépêche à Chantilly. Il s'y est rendu dans la matinée du 25. Il a reçu le commandement de l'armée qu'on forme en arrière de Verdun, et qui va donc devenir la 2e armée. Parti sur-le-champ pour Bar-le-Duc, il a reçu à Châlons une dépêche de Castelnau, qui le mande à Verdun. Il arrive à Dugny, prés de Verdun, le 25 au soir, et il reçoit la direction de la bataille. Il entre en fonctions à minuit. Il prend le commandement des troupes de la région fortifiée et des troupes disponibles de la rive gauche. Il a pour unique mission d'enrayer l'effort de l'ennemi. La région fortifiée de Verdun cesse d'exister : elle devient simplement le front de la 2e armée. C'est une nouvelle phase qui commence. Pendant que ces événements se passent, dans la journée du 23, les Allemands font encore de nouveaux progrès. Journée confuse, dont l'histoire est mal éclaircie. Devant la gauche française, formée maintenant par la 37e division, une patrouille de trois soldats allemands apparaît à l'aube sur la cote 344 ; à deux heures de l'après-midi, toute la position est aux mains de l'ennemi ; en fin de journée, il a descendu la pente sud, et enlevé au pied de cette pente le moulin de Cotelettes, une de nos anciennes positions d'artillerie. La 37e division se replie sur la côte de Belleville, découvrant la côte du Talon et la côte du Poivre. Mais l'ennemi est arrêté par une batterie de cent pièces de 7 :3 spontanément formée à Froideterre par le colonel Tardy. Ce barrage donne le temps à la 39e division du 20e corps de dépasser la 37e eu retraite, et de couvrir la ligne Bras-Houdromont. Cette division s'aperçut de plus qu'en avant de son front les Allemands n'avaient pas occupé la côte du Poivre, et elle s'y établit le 27. Quant à la côte du Talon, pareillement intenable pour les deux adversaires, ce fut une région neutralisée. Revenons à la journée du 23. Pendant que se produit à la gauche l'incident de la 37e division, les Allemands sont contenus au centre devant Louvemont, qui se défend jusqu'au lendemain. A la droite française, les Allemands enlèvent le village de Bezonvaux. Les éléments du groupement Deligny, qui avaient poussé le 24 au soir jusqu'au ravin de Bezonvaux, sont ramenés vers le sud, et des éléments du IIIe corps brandebourgeois, poussant jusqu'à la ligne des forts de la défense permanente, pénètrent par surprise dans le fort de Douaumont. Cette prise de Douaumont, quoiqu'elle fût l'effet d'un incident de combat, et non d'une attaque de vive force, était un événement grave. Le double succès du 25 est en même temps la fin de l'avance allemande. La réorganisation du commandement et de l'état-major, l'arrivée des renforts vont maintenant faire sentir leurs effets. A son arrivée, le général Pétain a voulu aller à Verdun. Son automobile s'est égarée. Il est revenu à Souilly, qui va être son quartier général, avec une congestion pulmonaire dont son médecin aura seul le secret. Pendant huit jours, il garde la chambre. C'est de là qu'il organise le champ de bataille. Il trace d'abord la ligne qui doit être inviolable. C'est la ligne Bras-Houdromont-Douaumont, confiée au 20e corps. A l'abri de cette barrière il organise le terrain. Le champ de bataille est divisé en quatre secteurs : Duchesne en Woëvre, Balfourier de la Woëvre à Douaumont, Guillaumat à cheval sur la Meuse, et Bazelaire sur la rive gauche, jusqu'à Avocourt. L'artillerie qui arrive est répartie entre ces quatre commandements. De nombreuses positions de batteries sont établies, et reliées par des fils téléphoniques. Les avions reprennent la maîtrise de l'air. Une division entière, la 59e, est employée à creuser une nouvelle ligne de défense, de la côte de Froideterre au bois de l'Hôpital. Des ponts sont jetés sur la Meuse. Treize bataillons sont employés à l'entretien de la Voie Sacrée. Le 26 au matin, cinq énergiques contre-attaques reportent le front en avant du fort de Douaumont ; un petit groupe de Brandebourgeois reste cramponné dans les ruines ; entouré de trois côtés, il réussit à maintenir par un boyau ses communications avec les lignes allemandes, et reste là en flèche. Les Allemands essaient en vain d'élargir ce coin. A l'ouest, ils attaquent sur le village de Douaumont, qui est du 25 au 29 le théâtre de combats furieux. A l'est, ils enlèvent la position d'Hardaumont et attaquent les bois de la Caillette. Enfin, le 29, épuisés, ils s'arrêtent. C'est la première trêve après huit jours de lutte acharnée. Le général de Castelnau juge la situation calée et rentre à Chantilly. Le 2, la lutte recommence autour de Douaumont, menée à l'ouest par la 21e division allemande qui se fait massacrer au bois Chauffour, à l'est par la 113e division, remplaçant le IIIe corps désorganisé, et qui le 4 enlève le village de Douaumont. Les Français se retranchent à 200 mètres du village. De la masse de choc allemande, deux corps sont hors de combat, le XVIIIe et le IIIe ; le VIIe de réserve a une division retirée et au repos ; l'autre division est à la côte du Poivre, ayant perdu relativement peu de monde ; le XVe corps n'a été engagé que partiellement ; la 113e division a fortement souffert à la prise de Douaumont. La première mise des Allemands est en grande partie dépensée sans que le but ail été atteint. Cependant, la crainte de voir les Français tenter une diversion avait disparu ; toutes les disponibilités françaises filaient sur Verdun ; pour les accroître, les Anglais avaient étendu leur front, ce qui supprimait momentanément le danger d'une diversion britannique. Les Allemands, tranquilles de ce côté, pouvaient donc, à leur tour, employer leurs réserves à Verdun. Or, une opération s'imposait à eux : c'était d'avancer sur la rive gauche, d'où l'artillerie française paralysait leur avance sur la rive droite. Dès le premier jour, le général Pétain avait craint cette attaque. Il avait donné au général de Bazelaire toute l'artillerie du 7e corps : il lui avait prescrit d'établir une ligne Avocourt-cote 304-Charny, et d'achever, plus en arrière, la ligne commencée Esnes-cote 310-fort de Marre. Le 6 mars, les Allemands attaquèrent sur la rive gauche avec le VIe corps réserve, appartenant il l'armée du Kronprinz et en ligne dans cette région, et avec le Xe corps de réserve, tiré de la réserve générale, et qui apparait pour la première fois dans l'action. Après une très violente préparation d'artillerie, ils enlevèrent par leur gauche, le long de la Mense, la côte de l'Oie. Le 10, ils emportèrent, à l'ouest de cette colline, le bois de Cornières, qui, logé dans un pli de terrain, leur donnait, une bonne position de départ pour attaquer la double hauteur du Mort-Homme. L'attaque sur le Mort-Homme eut lieu le 14. L'infanterie allemande, qui marchait sous la protection d'un barrage d'artillerie, enleva le sommet inférieur (cote 265). Le sommet supérieur (cote 295), intenable pour les deux adversaires, devint un no man's land, avec les tranchées allemandes sur le versant nord, et les tranchées françaises sur le versant, sud. La ligne française s'appuyait, comme sur deux piliers, sur le Mort-Homme et plus à l'ouest sur la colline 304. Le 20 mars, le Kronprinz lança sur 304 une division fraiche, la 11e bavaroise. Elle s'empara du bois d'Avocourt, qui couvre la position ; mais, dès qu'elle apparut en terrain nu, elle fut prise sous de tels feux croisés qu'elle dut renoncer à poursuivre l'attaque. En même temps qu'il attaquait sur la rive gauche, l'ennemi étendait son front d'attaque à l'aile opposée, entre Douaumont et le fort de Vaux. Il remettait en ligne le IIIe corps et la 21e division du XVIIIe corps, unités relevées et recomplétées. Le I He corps avait été regarni avec des recrues de la classe 1916, qui dans certains régiments formaient jusqu'aux deux cinquièmes de l'effectif. Le 8 mars, une attaque est lancée sur le front Douaumont-Hardaumont, avec le IIIe corps, la 113e division et deux régiments du XVe corps. Sauf devant l'ouvrage de Hardaumont, qui fut pris, l'attaque échoua ; le Me corps épuisé fut définitivement renvoyé à l'arrière. Le 9, le front d'attaque fut élargi des deux côtés : à l'ouest, le VIIe corps de réserve attaqua la côte du Poivre, et la 21e division acheva de se faire massacrer dans la région de ravins et de crêtes comprise entre la côte du Poivre et Douaumont ; — à l'est, le Ve corps de réserve attaqua le village et le fort de Vaux, où il subit le 9 et le 10 un sanglant échec. Une nouvelle attaque entre le village et le fort eut lieu le 16 et fut renouvelée le 18. Toutes deux échouèrent avec de lourdes pertes. Un calme relatif s'établit dans le secteur de Vaux. Ainsi, vers le dernier tiers de mars, la double attaque d'ailes qui, sur la rive gauche comme sur la rive droite, avait succédé à l'attaque centrale du début, était à son tour arrêtée. Une trêve suivit, du 22 au 28 mars. Mais abandonner Verdun eût été pour les Allemands l'aveu d'un tel désastre qu'ils ne voulurent pas considérer la partie comme finie. Ils avaient amené de nouvelles forces encore : la 192e brigade parait sur la rive gauche ; — 3 divisions au centre (121e, 58e, et 29e de réserve) viennent avec la 113e remplacer le XVIIIe et le IIIe corps définitivement hors de combat ; une division de Russie est signalée à la gauche. Le 28 mars, une troisième bataille commence. Elle débuta sur la rive gauche. Nous avons vu que, de ce côté, les Français tenaient en février une avant-ligne Avocourt-Forges, derrière laquelle se dressaient les deux piliers de la ligne principale, la colline 304 et le Mort-Homme. Les Allemands avaient forcé l'avant-ligne aux deux bouts, à l'est par Forges (6 mars), à l'ouest par le bois d'Avocourt (20 mars). Maître des extrémités de l'avant-ligne, l'ennemi avait cru en pouvoir négliger la partie centrale, et se porter directement de là sur les positions principales, de Forges par le bois des Corbeaux sur le Mort-Homme, du bois d'Avocourt sur la colline 304. Mais ces tentatives avaient échoué le 14 et le 22 mars : le Mort-Homme avait résisté, et la colline 304 n'avait pas même pu être attaquée. Il fallait donc revenir à une avance méthodique, et faire tomber tout ce qui restait de notre avant-ligne, de Malancourt à Béthincourt. Ce fragment demeuré debout de notre position initiale formait désormais une pointe très avancée, avec des ailes repliées, eine Sackstellung, disaient les Allemands. Il s'agissait pour eux de réduire ce sac. L'opération commença mal pour l'ennemi. Le 28, la 11e division bavaroise, renforcée par la 192e brigade, attaqua sur Malancourt et Haucourt ; l'attaque échoua ; pris sous le feu à découvert, les assaillants tourbillonnèrent, et quelques éléments purent seuls atteindre les lisières nord de Malancourt, on ils se barricadèrent. Le 29, les Français reprennent le bois d'Avocourt qu'ils avaient perdu le 20, et s'y maintiennent malgré le bombardement et les contre-attaques. Mais Malancourt, placé en saillant, et défendu maison par maison, ne peut être conservé. L'église tient encore le 31 mars. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, le général Pétain donne l'ordre de reporter la défense au sud du ruisseau de Forges, qui, avec ses fonds fangeux hérissés de fils de fer, couvrira maintenant notre première ligne. Béthincourt seul sera conservé. L'ennemi ne s'aperçoit pas du mouvement. Le 2, il exécute une préparation d'artillerie intense sur les tranchées vides de la rive nord, leur donne l'assaut, n'y trouve personne, et, comme il s'y installe, il reçoit de l'artillerie française le feu le plus meurtrier. Deux jours de calme relatif suivent. Puis, le 4, les Allemands attaquent notre nouveau front, formé à gauche par Haucourt (immédiatement au sud-est de Malancourt) et à droite par Béthincourt. Ils échouent devant Béthincourt, où ils laissent le terrain rouvert de cadavres. Haucourt tient jusqu'au 5 avril, défendu par deux compagnies du 79e, puis par une troisième qui a réussi à les renforcer. Il faut pour l'enlever une brigade entière. — Béthincourt, le seul village qui nous reste désormais sur le ruisseau de Forges, fut évacué le 8 avril. Ainsi les Français avaient entièrement perdu leur avant-ligne. Leurs tranchées s'appuyaient maintenant à gauche au réduit d'Avocourt, passaient aux premières pentes de la colline 304, au versant sud du Mort-Homme et au nord de Cumières. Sur la rive droite, la tin de mars a été marquée aussi par une avance allemande. Le 31 mars, le même jour où il achevait de prendre Malancourt, l'ennemi attaquait la partie ouest de Vaux, que nous tenions encore. On voit aisément le but de ces attaques combinées sur l'une et l'autre rive : elles affaiblissent nos réserves en les divisant. Après une forte préparation, l'îlot ouest du village est attaqué en trois vagues, fortes chacune d'un bataillon. La première est fauchée, les deux autres enveloppent les trois compagnies françaises qui tenaient la position. Ainsi le village de Vaux est enlevé. Le 2, l'étang qui est derrière le village est pris à son tour, tourné du nord par le bois de la Caillette. Le 3, un régiment français reprend les tranchées de la Caillette, et pousse le 5 ses postes d'écoute jusqu'à la crête de Douaumont. C'est à ce moment que, le 2 avril, le secteur de la rive droite est mis sous le commandement du général Nivelle, le secteur de la rive gauche étant sous le commandement du général Berthelot. De leur côté, les Allemands, ayant élargi en mars leur front d'attaque, l'avaient subdivisé en secteurs, le général von Mudra dirigeant les opérations sur la rive droite, le général von Gallwitz sur la rive gauche. Ils furent eux-mêmes remplacés, le général von Mudra par le général von Lochow en avril, le général von Gallwitz par le général von François en juillet. Le 9 avril, le Kronprinz lance sur les deux rives, d'Avocourt à la crête du Poivre, une attaque d'une violence et d'une ampleur qu'on n'avait pas vues depuis les premières attaques de février. Sur la rive gauche, où a lieu le gros de l'attaque, il a disposé entre Haucourt et la Meuse onze régiments, dont trois appartiennent à des divisions neuves, la 43e de réserve et le 105e. La préparation d'artillerie égale celle des premiers jours. L'attaque d'infanterie se déclenche à midi. Le résultat est insignifiant : quelques progrès des deux côtés du Mort-Homme, et la prise d'un bois près de la côte du Poivre. Le 9 avril, dit le général Pétain dans son ordre du jour du 10, est une journée glorieuse pour nos armées. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés.... Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage. On les aura. Il fallait dégager le Mort-Homme, que les progrès faits par les Allemands le 9 enserraient. Après deux petites opérations, le 12 et le 18, l'attaque a lieu le 20, à cinq heures du soir, après une minutieuse préparation d'artillerie. La ligne est reportée au-delà du sommet. L'ennemi réagit aussitôt et, du 21 avril au ter mai, une lutte acharnée se poursuit pour la possession du Mort-Homme. Malgré les efforts des Allemands, les Français ont reconquis leur ligne du 8 avril. Un nouveau succès, le 3 mai, au nord-ouest de la colline, le consolide. La gloire de cette lutte épique revient à la 40e division. A la fin d'avril, le général Pétain, appelé au commandement du groupe d'armées du centre, passe la 2e armée au général Nivelle. Le 3 mai, les Allemands, qui viennent d'échouer devant le Mort-Homme, renouvellent l'attaque sur l'autre pilier de la rive gauche, la colline 304. Après une préparation formidable qui dure le 3 et le 4, ils enlèvent les pentes nord et la crête militaire, sans pouvoir arriver au sommet. Le combat continua avec fureur jusqu'au 10. Le 8, l'ennemi avait occupé, à l'ouest de 304, le bois Camard. Il essaya en vain d'en déboucher le 13 et le 16. Il jeta alors dans la lutte un corps frais, le XXIIe de réserve. C'est ce XXIIe corps, et les deux divisions du XIe (54e et 58e), qui vont fournir le grand effort sur la rive gauche du 18 au 24 mai. Le 22, une division nouvelle, la 22e de réserve, y prendra part à son tour. Cette lutte acharnée, confuse, mêlée d'attaques et de contre-attaques, aboutit le 24 à la prise de Cumières par les Allemands. Mais, pendant ce temps, sur la rive droite de la Meuse, les Français ont monté une attaque sur Douaumont. Les Allemands, obligés de parer de ce côté, n'ont plus de disponibilités pour relever les unités fatiguées qui tiennent Cumières. Les Français en profitent pour contre-attaquer le 26, et reprendre une partie de leurs tranchées. Le 10, en effet, les Français avaient commencé sur la rive droite un tir de destruction sur Douaumont. Le 22, trois régiments de la 10e brigade partent à l'assaut, l'un sur le fort, les deux autres à gauche et à droite. Le soir, la superstructure est conquise ; mais l'ennemi occupe les casemates, sauf celle de gauche. Malheureusement, le régiment de droite a été arrêté net, et celui de gauche n'a pas atteint ses objectifs. Le 24, l'ennemi, tournant le fort par la gauche, en chasse les Français, qui se maintiennent immédiatement au sud. Leur flanc gauche, un instant compromis le 25, est rétabli le 26. Dans ces combats, les Allemands ont engagé le Ier corps bavarois récemment arrivé, et qui était primitivement destiné à la rive gauche. De ce fait, les attaques sur la rive gauche sont enrayées. Sur ces entrefaites, la bataille a changé de caractère. Les Allemands ont remarqué les préparatifs d'offensive sur la Somme, devant le front de leur IV armée. Ils ont vu d'autres préparatifs devant la VIe et la VIIe armée, et devant le détachement Falkenhausen. Ces dernières attaques, qui se font sur le front français, sont visiblement des feintes, et les Allemands ne s'y laissent pas prendre. Car, comment croire que les Français aient les moyens de monter seuls une attaque de grand style ? En revanche, l'attaque britannique devant la 11e armée leur parait sérieuse. La question est de savoir si les Français y participeront. L'état-major allemand pense que, par l'emploi intensif des troupes coloniales, les Français pourront recompléter au moins une partie de leurs réserves, redevenues capables de reprendre le combat. Pour interrompre ces processus, écrit Falkenhayn, un nouveau succès sur la Meuse était devenu nécessaire. De là les grandes attaques de juin. De leur côté, les Français, qui préparent leur offensive sur la Somme, ont intérêt à retenir sur la Mense le plus grand nombre de divisions ennemies qu'il se pourra. Ils y arriveront par d'énergiques contre-offensives, comme celle du 22 mai sur Douaumont. A l'état-major français il y a, sinon unanimité, du moins forte tendance à créer ce qu'on y appelait alors des foyers ouverts, où l'ennemi vînt se fondre. Verdun était le principal de ces foyers. D'autres objectaient que le défenseur s'épuisait autant et peut-être plus que l'assaillant. Le commandant de la 2e armée attend, non sans impatience, dans le mois de mai, que l'attaque de la Somme vienne le délivrer. Pour la même raison, les Allemands sentent qu'il faut en finir. La principale position de défense des Français sur la rive droite est maintenant formée par la ligne Côte de Froide-Terre-Fleury-Fort de Souville. Elle est couverte à l'est par le fort de Vaux, à l'ouest par la crête de Thiaumont. Sur la crête de Thiaumont, il y a un ouvrage ; en avant de l'ouvrage, vers l'ennemi, une ferme. A gauche, le terrain s'abaisse dans un profond et vaste ravin, le plus tragique paysage sans doute de tout le champ de bataille, le ravin de la Dame. Ce sont ces deux positions de Vaux et de Thiaumont que les Allemands doivent d'abord enlever. Le 31 mai, le bombardement s'accroît sur toute la région du fort de Vaux, depuis la Caillette jusqu'à la Laurée. L'ennemi a en ligne, sur un front de 4 kilomètres, trois divisions, la Ire, la 50e, et une division composée d'un régiment de la Ire, et de deux régiments du XVe corps (126e et 105e) ; au total, 8 régiments, qui seront renforcés le 5 juin par une brigade du corps alpin. Les Français ont en ligne deux régiments, le 101e et le 142e. L'attaque commence le 1er juin. Après une résistance héroïque, le fort est pris le 9 juin. En même temps qu'il attaquait le fort de Vaux, l'ennemi attaquait plus à l'ouest la position de Thiaumont. Le 1er juin, il prend la ferme de Thiaumont. Il la reperd le 2, la reprend le 9 ; du 12 au 17, il attaque en vain l'ouvrage de Thiaumont, et ne réussit qu'à occuper, à gauche et en contrebas, le ravin de la Dame. Pendant ce temps, il a également repris son attaque sur la rive gauche, interrompue le 24 mai. Elle recommence le 29, débouchant du bois des Corbeaux ; non plus à l'ouest contre le Mort-Homme, mais au sud contre Cumières. Le 30, les Français doivent se replier. Le 31, l'ennemi cherche à rompre définitivement leur ligne et à s'ouvrir ainsi un passage qui lui permette de tourner le Mort-Homme par le sud. Mais il échoue. 11 reprend alors l'attaque par l'autre bout des positions de la rive gauche, sur le flanc ouest de la cote 304. Il y a là un bois, dit le bois Camard, dont il est maître. Le 4 juin, il essaie en vain d'en déboucher. Le 9, il renouvelle quatre fois ses tentatives, accompagnées de .jets de flammes, à cinq heures, cinq heures trente, neuf heures et douze heures. Elles sont repoussées par des troupes du 15e corps et de la 38e division. Ainsi, sur les pentes sud-ouest de 304 comme au Mort-Homme, l'ennemi a été repoussé. Le 15 juin, ce sont les Français qui passent à la contre-attaque. Deux bataillons enlèvent un kilomètre de tranchées sur les pentes du Mort-Homme. Telle est la situation vers le 20 juin. Cependant le temps presse de plus en plus l'ennemi. Le 4 juin, en Volhynie, le général Broussiloff a déchaîné une offensive qui s'est rapidement étendue du Styr au Pruth, et qui a obtenu d'éclatants succès. Un autre orage s'amoncelle sur la Somme. Il faut emporter Verdun au plus vite. On a pu savoir, dit un récit officieux français, que le kaiser avait donné des ordres au début glu mois de juin pour que les attaques fussent brusquées et que le drapeau allemand y flottât, le 15. De son côté, le général Joffre, dans son ordre général du 9 juin, adjurait la 2e armée de tenir conte que conte. Pour permettre à l'offensive générale des Alliés de continuer à développer ses succès, il faut que l'armée de Verdun tienne toujours et ne recule pas d'un pas. Le salut de la France est en jeu aucun sacrifice ne sera trop lourd pour l'assurer. Et, le 12 juin, annonçant aux troupes françaises les victoires de Galicie, le commandant en chef leur dit : Soldats de Verdun, c'est à votre héroïque résistance qu'on le doit, c'est elle qui e été la condition indispensable du succès, c'est sur elle que reposent nos victoires prochaines : car c'est elle qui a créé sur l'ensemble du théâtre de la guerre européenne une situation d'où sortira demain le triomphe définitif de notre cause. C'est dans ces conditions que l'ennemi va faire sur la rive droite la grande tentative du 23 juin. Pour arriver à Verdun, l'ennemi doit enlever une première position, jalonnée, comme nous l'avons vu, par l'ouvrage de Froide-terre à notre gauche. le village de Fleury au centre et le fort de Souville à notre droite. Il aura ensuite à emporter une seconde position, la dernière ceinture de collines qui couvre Verdun du nord à l'est, la ligne Belleville-Saint-Michel-Belrupt. Le revers intérieur de cette dernière position donne directement sur la conque de Verdun. Le 21, le bombardement commence. Les Allemands, résolus à en finir, ont avancé leurs batteries et amené les plus gros calibres, de 380 et de 420. Le 22 au soir, ils couvrent de plus de 100000 obus asphyxiants le plateau de Souville, la côte de Froideterre, et les ravins à l'arrière. L'objectif est, d'après les prisonniers, d'enlever toute la ligne Froideterre-Fleury-Souville. L'attaque s'étend à l'ouest jusqu'au bois Nawé, à l'est jusqu'au bois Fumin, les ailes extrêmes ayant surtout pour mission de retenir des forces françaises. Elle sera exécutée par 10 régiments, appartenant à 7 divisions. L'attaque centrale est menée par 12 régiments, dont. 7 engagés pour la première fois. L'assaut commence dans la nuit du 21 au 22. La journée du 22 fut indécise. Le 23, le général Nivelle adressait aux troupes un ordre pressant : Les Allemands lancent sur notre front des attaques furieuses, dans l'espoir d'arriver aux portes de Verdun, avant d'être attaqués eux-mêmes par les forces unies des armées alliées ; vous ne les laisserez pas passer, mes camarades. Au centre, le corps alpin enleva Fleury. A l'ouest, le corps bavarois prit l'ouvrage de Thiaumont, et des éléments arrivèrent jusqu'à l'ouvrage de Froideterre, où ils furent refoulés. A l'est, la 103e division enleva la première ligne devant Souville, et fut écrasée devant la seconde. L'ennemi avait enlevé un objectif seulement sur trois. Cependant la situation des Français était si critique que, le 23 juin, le général Pétain avertit le général Joffre. Le fléchissement est plus considérable qu'on n'avait pu le prévoir, écrit J. Reinach dans l'Année de Verdun. Les Allemands ont pris pied dans les têtes des ravins qui descendent de Froideterre vers la Meuse, menaçant de couper la retraite aux défenseurs de la côte du Poivre.... Il réitère son avis que, si l'ennemi atteint la ligne de contre-pente, il faudra songer à passer sur la rive gauche. La décision sera à prendre trois ou quatre jours avant l'exécution du mouvement. Le tiers de l'artillerie est sur la rive droite. Il la faut évacuer avant que l'artillerie ennemie ne batte les ponts de la Meuse. Le 27, le général Joffre répondit par l'ordre formel de continuer la défense sur la rive droite. Le 24, les tirs de préparation de la bataille de la Somme avaient commencé. La bataille de Verdun va dès lors entrer dans une nouvelle phase. Le 11 juillet, une dernière attaque est menée par 12 régiments, depuis le fort de Vaux à gauche jusqu'au fort de Sou-ville, qui est l'objectif principal, à droite. Elle expire sur les pentes mêmes de Souville. Une nouvelle offensive, menée par 8 divisions, échoue encore le ter août. Le 3 août, les Français reprennent l'ouvrage de Thiaumont, le 4 le village de Fleury. Le 8, les Allemands reprennent l'ouvrage de Thiaumont. Une lutte locale acharnée dure tout le mois d'août. Une dernière offensive allemande a lieu le 3 septembre. Si violentes et si acharnées qu'aient été les poussées d'infanterie qu'on vient d'énumérer, ce qui donne à la bataille sa physionomie propre, c'est le duel d'artillerie d'une violence incroyable qui s'est poursuivi pendant ces quatre mois. Sur toute la surface du champ de bataille jusqu'aux arrière-lignes, une pluie de fer s'est abattue jour et nuit sans interruption. Des crêtes situées en arrière de Verdun, on voyait l'horizon entièrement recouvert par les explosions comme par les nuées d'un éternel orage. Sous cette averse épouvantable, les troupes qui montaient et qui descendaient perdaient, pour arriver aux lignes, le quart de leur effectif. Les corvées, les communications se faisaient sous cette tempête mortelle. C'est là ce qui est proprement la bataille de Verdun. Sous ces explosions continues, il n'y avait plus de tranchées. Dans les premières lignes, les hommes tenaient comme ils pouvaient dans des trous d'obus. Les relèves, très difficiles et très coûteuses, devaient néanmoins cire fréquentes. C'est dans ces conditions qu'est née l'idée de laisser sur le champ de bataille d'une façon fixe des organisations permanentes, artillerie lourde, aviation, états-majors de corps d'armée, et de faire défiler ces divisions à l'intérieur de corps d'armée immobiles. Cette idée deviendra la règle des batailles suivantes. Du 21 février au 15 juin, en cent seize jours, la 2e année, avec un effectif moyen de 24 divisions, en a vu passer sur son front 66. — Le nombre total des divisions françaises était alors de 95 —. L'artillerie, qui se compose de 4.100 pièces de 75, de 223 pièces de 80 à 105, de 390 pièces d'artillerie lourde et d'artillerie à grande puissance, a consommé 10.300.000 coups de 75, 1.200.000 coups de 80 à 105 et 2.600.000 coups de gros calibres. Quant aux Allemands ils avaient engagé du 21 février au 1er juillet, 42 divisions et demie. Mais ce nombre de divisions, inférieur à celui des divisions françaises, ne rend pas compte de l'usure. En effet, tandis que les Français remplaçaient les divisions, les Allemands les alimentaient sur place, à l'aide de dépôts installés à 20 ou 30 kilomètres derrière le front. Les corps engagés dans la bataille ont pu, grâce à ces réservoirs, se renouveler plusieurs fois sans être relevés. |