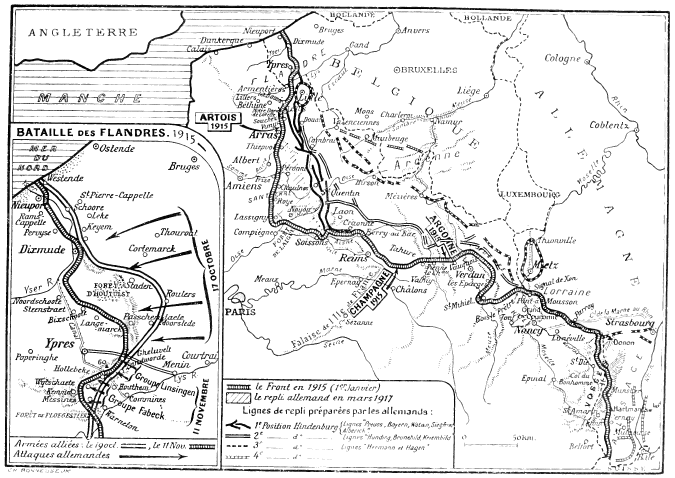HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE II. — LES OPÉRATIONS MILITAIRES.
CHAPITRE VI. — LES TRANCHÉES.
|
I. — LE FRONT STABILISÉ. LE 12 novembre, au moment même où la bataille d'Ypres finissait, la IXe armée Mackensen prenait l'offensive sur le front oriental. Cette offensive aboutissait à la bataille de Lodz. Les Allemands reconquéraient une partie de la Pologne, et s'arrêtaient, à la corde du grand arc que forme la Vistule, sur un front fortifié, dit front des Quatre-Rivières. Ainsi, sur les cieux théâtres, les adversaires se trouvent fixés l'un devant l'autre, et, sans qu'aucun l'ait voulu, les forces étant en équilibre, la guerre de siège succède à la guerre de mouvement. Comment est établi ce front occidental qui va rester presque immobile pendant quarante et un mois ? Paris, assis sur le calcaire où sont creusées les catacombes, y est au centre d'une dépression. Ce calcaire, enterré, se relève autour de la capitale, affleure et, devenu le terrain visible, prend l'aspect d'un plateau. Le bord extérieur de ce plateau est taillé à pic, et il apparaît sur les plaines qui le supportent comme une falaise sur la mer. Ainsi l'Île-de-France est bien une île, dont le rivage escarpé présente son abrupt au nord à la Picardie, à l'est à la Champagne. Pour achever la ressemblance, l'Île-de-France projette au delà de ses rivages des flots, qui surgissent au milieu des plaines extérieures. Le front nord est précédé à l'ouest de l'Oise par le massif de Lassigny, à l'est de l'Oise par le massif de Laon, exactement comme l'Armorique est précédée par Ouessant, ou la Cornouaille par les Sorlingues. Pénétrons dans ces plaines qui enveloppent l'Île-de-France. Du côté du nord, elles sont formées par une étendue de craie. qui, comme une mer calme, est une suite de houles. Toutefois, à 150 kilomètres environ dans le nord de Paris, l'une de ces boules se rompt, comme une vague qui déferle. Le pli, au lieu de former un bombement, se brise, et présente un abrupt vers le nord-est. Cet abrupt, dans sa partie occidentale, s'appelle colline de Notre-Dame de Lorette, dans sa partie orientale la colline de Vimy ; entre ces deux collines, il s'écrête et laisse passer la Sourdiez ; la ville de Souchez se trouve dans le col, que suit une très ancienne route, menant de Paris à Béthune. Au pied nord de l'escarpement se trouvent des formations houillères, de telle sorte que, du haut des collines de Lorette et de Vimy, en regardant vers l'extérieur, vers le nord ou vers l'est, on voit partout une région industrielle, avec ses crassiers, ses puits de mines, ses cheminées, ses chevalements, ses cités agglomérées. La plaine de craie qui baigne l'Île-de-France finit à son tour à quelques kilomètres au nord, et l'on en débouche, par des défilés entre des bourrelets, dans une autre plaine en contrebas, horizontale, composée d'argile : c'est la Flandre. Le contraste est saisissant. Les ondulations de la craie offraient des espaces secs et nus, de gros villages entourés de vergers et pareils à des bois, de rares vallées touffues au fond desquelles les villes se cachaient. L'argile des Flandres porte au contraire des eaux partout abondantes, qui nourrissent, des haies vives et des rideaux de peupliers. Aux grandes fermes blanches de la Picardie, succèdent de petites maisons de briques, partout disséminées, et dont les longues files bordent les roules. Au contact de la craie et de l'argile, des villes se sont installées, comme un cordon frontière entre les deux provinces : Lillers, Béthune, la Bassée. La Flandre elle-même n'est pas absolument plate. Les mêmes mouvements du sol, que nous avons vus dans la craie, y font bomber l'argile, conjugués avec d'autres rides à angle droit ; quelquefois deux de ces systèmes orthogonaux de collines, en se joignant l'un à l'autre, donnent l'impression d'une équerre ou d'une faucille : tel est l'arc de hauteurs qui entoure Ypres. Les crêtes portent, au-dessus de l'argile, du sable qui se couronne de bois. Quelle ne fut pas la satisfaction ingénue des soldats canadiens, quand, en 1917, ayant enfin conquis Passchendaele par des assauts poursuivis dans des torrents de boue gluante, ils trouvèrent sur la crête le sable sec ! Des fonds argileux, des collines parfois sableuses ; sur ceux-là des eaux stagnantes qui les transforment en boue, sur celles-ci des boqueteaux, voilà la Flandre ; mais, si on continue vers le nord, avant d'atteindre la nier, le paysage change encore une fois ; les dernières collines expirent en dominant Dixmude, et on entre dans une région plate et sans arbres, où l'Yser coule en méandres ; golfe desséché, que la mer n'a fini d'évacuer qu'au mie siècle. Des canaux entre des digues, des routes sur des remblais le sillonnent, et s'élèvent au-dessus au niveau moyen du sol. Voilà le terrain au nord de Paris, jusqu'à la mer. Sortons maintenant de la capitale par l'est. Le rebord de l'Île-de-France tombe à pic, vers Sézanne, sur la plaine de Champagne. La ville même de Sézanne est cachée dans les mouvements de la falaise. Suivons ce rebord comme si nous cabotions le long d'une côte. A une cinquantaine de kilomètres au nord de Sézanne nous trouvons un cap boisé, qui est la montagne de Reims. La ville même de Reims est enfermée entre la falaise à l'ouest et des îlots protecteurs à l'est, comme au fond d'une rade. Plus au nord, la falaise tombe sur la plaine par une suite d'éperons, formés de tables plates et de socles boisés. Ces éperons sont parfois très découpés. Tel est, au nord de l'Aisne, celui de Craonne, rattaché à la masse par l'isthme de Heurtebise. Au pied et à l'orient de ces hauteurs, s'étend la plaine de Champagne : un sol sec et crayeux, des buttes convexes, de maigres boqueteaux de pins, des maisons en torchis, la solitude. La Champagne à son tour se relève vers l'est, pour retomber pareillement par un à-pic sur une autre dépression. A une cinquantaine de kilomètres dans l'est de Reims, la craie est déjà exhaussée à plus de 200 mètres ; et elle s'arrête brusquement en formant une falaise qui domine la haute vallée de l'Aisne. Cette falaise, de craie tendre, s'est laissé découper par les eaux ; l'un de ses éperons est la main de Massiges, qui devait devenir si célèbre en 1915 ; un autre, un peu plus au sud, porte le moulin de Valmy. Mais voici qu'une troisième fois le phénomène recommence ; la plaine née au pied des falaises extérieures de la Champagne se relève à son tour, et s'achève vers l'est par un bord rehaussé, et ce bord, formé d'une roche siliceuse, blanchâtre et poreuse sous un manteau de forêts, s'appelle l'Argonne ; au pied est de l'Argonne, nouvelle chute du relief, nouvelle plaine, nouvel exhaussement progressif de cette plaine vers l'est, cette fois jusqu'à près de 400 mètres de hauteur, et nouvelle chute brusque, par une falaise qui s'appelle les Hauts-de-Meuse. La Meuse elle-même a un cours très singulier ; elle coule en rainure, parallèlement aux crêtes, sur la plaine qui s'élève, de sorte que sa rive droite est beaucoup plus haute que sa rive gauche ; la rive gauche ne dépasse pas 301 mètres, cote que la guerre a rendue célèbre, et 310 mètres un peu au sud ; la rive droite atteint 388 mètres, à Douaumont et à Souville. La Meuse, coulant du sud au nord parallèlement à l'arête du pays, redouble de son fossé le mur que cette arête oppose à l'envahisseur venu de l'est. A ce barrage naturel, les hommes ont ajouté le renforcement d'une forteresse, qui est Verdun. Au pied est des Hauts-de-Meuse, nouvelle plaine argileuse tout imprégnée d'eau qui miroite au soleil, la Woëvre. Et, pour la cinquième fois, le terrain se relève : l'argile est remplacée par un calcaire sec, qui s'achève, comme tous les terrains précédents, par un mur à pic, et ce mur domine la Moselle. On voit la différence entre la Moselle et la Meuse : la Meuse coule à dos de plateau, à l'ouest de la falaise ; la Moselle coule au pied du plateau, à l'est de la falaise, comme un ruisseau au bas d'un trottoir. Sur sa rive orientale, il n'y a plus que des hauteurs isolées, comme le rocher de Mousson, ou comme la file de collines, distinctes comme des îles, et dont l'archipel, couvrant Nancy à l'est, a reçu le nom de Grand-Couronné. C'est sur cette succession de terrains variés que les deux adversaires se sont mutuellement fixés, et qu'ils restent immobilisés, au hasard des positions de fin de combat. Nous décrivons ces positions, et l'ordre de bataille sommaire, tel qu'il était au milieu de 1915. Dans l'ensemble, la ligne a la forme d'une grande équerre, avec une branche nord-sud, de Nieuport à Noyon, et une branche ouest-est, de Noyon à Pont-à-Mousson. Si le hasard de la lutte a fixé le détail des positions. on reconnait cependant dans l'ensemble un certain dessein. A l'extrême gauche, entre la mer et l'Yser débordé, il y a, le long de la côte, une étroite bande praticable, formée par les dunes. Les deux adversaires s'y poussent jusqu'au 22 janvier 1915, où le combat s'arrête. Les Allemands restent en possession de la grande dune, qui domine toutes les autres, et d'où ils auront un observatoire excellent. Dans le sable de ces dunes, les deux adversaires font leurs terriers. Du côté français, qui est tenu par la 38e division, ces terriers sont des galeries hautes et propres, bien boisées, dont les couloirs sont éclairés de lampes électriques ; le pavage est fait avec les briques des maisons démolies. Sur le bord même de l'estran, un boyau camouflé sous des toiles est en balcon sur la mer, qu'on entend frémir et dont on voit l'ourlet. Au sud de Nieuport commence le secteur belge, en grande partie inondé, et très soigneusement aménagé, avec tout un système de caillebotis aboutissant à des postes d'écoute. C'est un paysage léthéen, une eau livide et des roseaux. L'armée belge comprend 6 divisions d'infanterie et 2 de cavalerie. Au sud des Belges, le secteur de Steenstraete est occupé par deux divisions françaises, le 45e et le 87e territoriale, qui les encadrent au midi, comme la division de Nieuport les encadre au nord. Ces trois divisions forment le 36e corps, commandé par le général Hély d'Oissel, quartier général à Rosebrugge. Le secteur de Steenstraete, avec ses terrains bas, humides, où les tranchées sont impossibles et où les travaux sont en superstructure, ce marécage étoilé de trous d'obus, dominé par la rive ennemie qui l'orme banquette, est extrêmement pénible. Au sud commence, avec le secteur d'Ypres, la zone d'opérations des armées britanniques. A gauche. de Langhemarcq à Armentières, s'étend la 2e armée, commandée par le général Smith Dorrien. A droite, d'Armentières à Vermelles, s'étend la 1re armée commandée par le général Douglas Haig. Pendant la course à la mer, chaque adversaire a essayé de saisir les points d'appui, villes ou collines importantes, qui étaient sur le parcours. Ypres, et une partie des collines à l'est, est resté aux Alliés. Au sud de la ville, les Allemands occupent le plateau dominant de Messines-Wylschaete. En face d'eux, les Alliés les tiennent en respect à l'ouest par l'observatoire du mont Kemmel, au sud par la forêt de Plœgsteert. Par ce système de positions les deux adversaires se neutralisent. En l'ace des Français, des Belges, et de la gauche britannique, les Allemands maintiennent, de la mer jusqu'à l'est d'Ypres, la IV' armée, du duc de Wurtemberg, toujours formée des quatre corps nouveaux amenés en octobre, et encadrés au nord par un corps de marine, au sud par deux brigades de landwehr. La VIe armée lui succède au sud. Elle occupe Lille, tandis que les Alliés occupent Armentières, et les tranchées passent entre les deux villes, à quatre lieues environ dans l'est d'Armentières. Plus au sud, d'Armentières à la Bassée, les Allemands occupent un long mouvement de terrain orienté du nord-est au sud-ouest, qui s'appelle la crête d'Aubers, d'où ils dominent les lignes anglaises qui bordent le pied des hauteurs. Enfin, les Allemands ont saisi le gros point d'appui de la Bassée, où les chemins de fer, les routes, les canaux se rassemblent, et ils le couvrent à l'ouest et au sud. Au sud de la Bassée, ils avaient gravi la colline de Notre-Dame de Lorette. Le 21e corps les a refoulés, sans parvenir à les déloger entièrement. Ils restent accrochés à l'extrémité est. En arrière, ils occupent toute l'agglomération de Lens, la crête, de Vimy par laquelle ils couvrent la plaine de Douai, et ils viennent jusqu'aux abords d'Arras. Mais Arras est aux Français, avec ses avancées est et sud. Là s'arrête la VIe armée allemande. Du côté allié, la 1re armée britannique finit à Vermelles ; la 10e année française lui succède au sud et s'étend jusqu'à la Somme. Au sud d'Arras, les Allemands tiennent un point d'appui important : c'est le plateau de Thiepval, dans le coude de l'Ancre, sorte de forteresse couverte par ce fossé, et qui donne des vues lointaines dans les positions alliées. Les lignes passent ensuite à l'est d'Albert, franchissant la Somme à Frise, et courent désormais sur l'étendue plate du Santerre. Les Allemands ont Chaulues et Boye. Toute cette région est occupée par la IIe armée Bülow. C'est une région tranquille. Aussi les effectifs, très considérables à la IVe et à la VIe armée, deviennent beaucoup plus clairsemés. Il y a 8 corps et demi à la VIe armée ; la IIe n'en comprend que 4 et demi avec une brigade de landwehr. Du côté allié, le front est tenu, de la Somme à l'Oise, par la 2e armée française. Au sud-est de Roye, on voit se dessiner sur l'horizon le massif de Lassigny, cet ilot projeté au nord par l'Île-de-France. Les deux adversaires s'y sont accrochés, et ils s'affrontent dans ses replis boisés. Les lignes passent ensuite l'Oise vers Pimprez. A l'est de l'Oise, le front, après s'être moulé sur la forêt de l'Aigle, court à travers le grand plateau agricole étendu au nord de l'Aisne. Cette partie de l'Île-de-France est une table calcaire, qui repose sur un socle de sable. Deux rivières la limitent, l'Ailette au nord, l'Aisne au sud. Elle ne présente pas à l'Aisne un mur rectiligne. Des vallons l'ébrèchent et y dessinent des concavités où sont logés des villages. A son extrémité est, l'entaille est si profonde que le promontoire de Californie est presque rescindé, et ne tient à la masse que par un pédoncule étroit, l'isthme sur lequel se trouvait la ferme de Hurtebise. Ce front est tenu du côté français par la 6e armée, qui s'étend entre l'Oise et la Vesle. Du côté allemand, la Ire armée est à cheval sur l'Oise : densité de secteur tranquille, 4 corps et 2 brigades de landwehr. A l'est du plateau de l'Île-de-France, s'étend en contrebas la plaine de Champagne. Les lignes, partant de l'éperon de Craonne, se dirigent vers le sud-est, et viennent s'appuyer, au sud de Berry-au-Bac, sur un mamelon, la cote 105, partagée entre les deux adversaires. De là, elles suivent le canal en direction de Reims, par la rive ouest jusque vers Loivre, ensuite par la rive est. Et elles enveloppent Reims, laissant aux Français la ville, aux Allemands les hauteurs qui l'encadrent au nord et à l'est. Le front depuis la Vesle jusqu'à Reims était tenu par la 5e armée française. Elle avait en face d'elle la VIP armée allemande, accourue d'Alsace pendant la bataille de la Marne, et qui comprenait à la fin de 1914 quatre corps, et 1 brigade de landwehr. Comme sa voisine la Ire armée, la VIIe a été réduite à une densité de pure défensive. A partir de Reims, les lignes tournent vers l'est, encadrant par le sud les massifs de Nogent et Moronvilliers, qui sont aux Allemands. A l'est de ces hauteurs, le front barre jusqu'à l'Aisne une plaine désolée, mamelonnée de buttes de craie plantées elles-mêmes de boqueteaux de sapins. C'est la zone d'action de la 4e armée française, opposée à la IIIe armée allemande. Après qu'on a traversé l'Aisne, on arrive dans la masse boisée de l'Argonne. La 3e armée française y lutte contre l'aile droite de la Ve armée allemande, l'armée du Kronprinz. Les Français tiennent l'unique bonne route qui traverse le massif d'est en ouest, celle qui va de Varennes à Vienne-le-Château. Les Allemands essaient de la débloquer par une pression continue. Le reste de l'armée du Kronprinz enveloppe Verdun. Le détachement von Strantz la prolonge à gauche, jusqu'à la Moselle, à travers la Woëvre et la Haye. Du côté français, à droite de l'armée Sarrail, s'étend la 1re armée. De la Moselle à la frontière suisse, les Allemands n'ont que des formations d'Ersatz et de landwehr qui forment les détachements Gaade et Falkenhausen. Les lignes passent au nord de Pont-à-Mousson. La rive gauche de la Moselle est escortée d'une file de plateaux tabulaires, couronnés de bois. Le front s'est fixé sur celui qui porte le Bois le Prètre, qu'on se dispute furieusement. Sur la rive droite, la ligne française s'appuie entre la Moselle et la Seille à une butte qu'on appelle le Signal de Xon. Immédiatement au sud, commence l'arc de collines qui couvre Nancy. Le front passe dans la plaine, au pied est de ces hauteurs. Il s'en va ainsi rejoindre la dépression qui suit le canal de la Marne au Rhin, en s'appuyant à la forêt de Parrot' conquise arbre par arbre. Au sud du canal, il n'y a plus de lignes proprement dites. On se couvre par des grand'gardes et par des petits postes, comme dans l'ancienne guerre de manœuvres. Nous voici aux Vosges. Le front les coupe obliquement ; à partir du col du Bonhomme et plus au sud, les Français ont franchi la ligne de faîte qui sert de frontière depuis 1871, et ils ont pénétré plus ou moins profondément dans les vallées qui vont au Rhin. Dans celles qui descendent sur Munster, ils atteignent, par des combats qui durent du milieu de juin 1915 jusqu'au dernier tiers d'août, la ligne Lingekopf-Reichackerkopf-Braunkopf. Dans la vallée plus méridionale de Saint-Amarin, ils ont poussé jusqu'au débouché eu plaine à Thann, les Allemands restant en face d'eux à Cernay. La montagne qui couvre Thann au nord, le Hartmannswillerkopf, est violemment disputée entre les deux partis. En janvier 1915, les Allemands enlèvent le sommet à la faible grand'garde française qui le tient. Les Français mirent un mois d'assauts continus à le reprendre, du 25 février au 26 mars. De Thann, les lignes vont droit au sud, à travers la Haute Alsace, s'appuyer à la frontière suisse, en longeant le cours de la Largue. Du côté français, le front est tenu en Lorraine par le détachement d'armée de Lorraine (D. A. L.), et en Alsace par la 7e année. Dans le cours de 1915, les deux adversaires sont amenés à créer, entre le commandement suprême et les différentes armées, un échelon intermédiaire, le groupe d'armées. Du côté français, trois groupes d'armées sont définitivement constitués le 13 juin : groupe d'armées du nord (Foch) avec le 36e corps, les 10e et 2e armées ; groupe d'armées du centre (Castelnau) avec les 6e, 5e et 4e armées ; groupe d'armées de l'est (Dubail) avec les 3e et 1re armées, le D. A. L. et la 7e armée. Les Allemands suivirent lentement l'exemple. Ils créèrent un premier groupe pour le Kronprinz allemand le 26 septembre 1915 ; puis un autre pour le kronprinz de Bavière le 28 août. 1916 ; enfin un troisième pour le duc de Wurtemberg le 25 février 1917. II. — LA GUERRE DE TRANCHÉES. SUR ces lignes, les deux adversaires se sont fait peu à peu une installation de plus en plus compliquée. Sur le plateau de Lorette, domaine du 21e corps, voici comment les choses se sont passées. Un bataillon français arrive sur le plateau le 8 octobre, pour reprendre la Chapelle occupée par les Allemands. Le bois de Bouvigny est enlevé, et le 9 au matin les tirailleurs atteignent une petite crête à l'est de ce bois ; ils s'y terrent dans des trous individuels. A onze heures ils se reportent en avant, et à dix-sept heures ils sont arrivés à une haie qui est devant la Chapelle. La nuit est venue. Un bataillon frais vient relever celui qui vient de se battre. Ce bataillon organise le terrain et creuse des tranchées. Le 10 au soir, il enlève la Chapelle, où il laisse une section ; dans la nuit, il a relié la Chapelle à la Haie, par de petites tranchées de demi-section, échelonnées en arrière et à droite. De leur côté, les Allemands remuent la terre à l'est de la Chapelle. Le bataillon français au repos a employé le temps à creuser des abris sur le revers nord du plateau. Dans les semaines suivantes, le plateau se couvre d'ouvrages. Un retour offensif des Allemands a chassé les Français de la Chapelle et les a ramenés sur la Haie. La première ligne est là avec des tranchées à 100 ou 200 mètres plus à l'est. Mais le plateau de Lorette, allongé comme le fuselage d'un avion, est encadré de villages en contrebas. A son pied sud, les Allemands tiennent Ablain, d'où ils envoient des feux dans le flanc droit des troupes qui sont sur le plateau. Il faut donc faire face de ce côté. Un éperon descend sur Ablain. Dans le dernier tiers d'octobre, des patrouilles françaises, venant du plateau, se sont glissées sur cet éperon ; une section les a suivies : un petit fortin s'y ébauche. Cependant les Allemands, grands remueurs de terre, ont fait de longues tranchées qui montent de Souciiez. L'exemple de l'ennemi agit par contagion sur les Français, et aussi la nécessité de se garer des 77, 105, 150 et 210, concentrés autour du plateau. Nous aurons donc, nous aussi, écrit le commandant Henri René, notre réseau défensif établi et réalisé d'après un plan logique, avec des lignes de feu et d'abris, avec des gites pour les unités réservées, avec des boyaux pour les communications avec l'arrière, avec des magasins pour les munitions, avec des postes de commandement pour les officiers, avec des téléphones, voire même avec un petit Decauville. En même temps, l'artillerie lourde française commence à riposter. Deux batteries de 120 long travaillent dans le secteur. Quelques 220 sont même envoyés sur Ablain. Vers le milieu de novembre, la continuité de la première ligne, hérésie théorique, mais nécessité pratique, sera réalisée. La position est en équerre, une tranchée en belvédère face au sud, avec une ramification sur l'éperon au-dessus d'Ablain, où l'on voit les Allemands à la lorgnette ; une tranchée face à l'est, à la Haie, à 100 mètres seulement de la tranchée allemande. Aussi est-il très difficile de la couvrir d'un réseau de fils de fer. Fantassins et sapeurs vont à contre-cœur à cette besogne dangereuse, et l'obstacle passif reste insuffisant. Il y a plus. Depuis une huitaine de jours, les Allemands s'approchent la nuit à 20 mètres, lancent des grenades et s'enfuient en courant : les Français restent d'abord stupéfaits de cette résurrection d'une arme archaïque ; puis ils fabriquent des grenades à leur tour. Derrière la première ligne, une deuxième ligne s'ébauche. En arrière, dans le bois, se multiplient les abris : ceux des artilleurs, près de leurs pièces, profonds ; ceux des fantassins, éparpillés en village nègre, et plus propres à les défendre des intempéries que des obus. La vie s'organise : corvées d'eau, rondes de brancardiers. Les postes de secours sont poussés en avant. Mais les cimetières aussi se multiplient. En décembre, les Allemands, par une vigoureuse attaque partie d'Ablain, ont enlevé le fortin qui les dominait sur le Grand-Éperon. Sur l'autre face de la position, ils ont organisé, sous les ruines de la Chapelle, un réduit d'où ils envoient les ordres à leur artillerie, et d'où débouchent d'incessantes attaques. Leurs minenwerfer écrasent les tranchées françaises sous d'énormes torpilles. Il faut en finir, et, le 17 décembre, les Français attaquent. On a amené des pièces de siège, et on a fait une préparation d'artillerie, consistant en trois reprises d'artillerie lourde et de campagne, séparées par des repos de vingt minutes. Les obus lourds sont destinés à la destruction, les obus de campagne à la contre-batterie. Les mitrailleuses tirent pendant les repos pour contribuer à détruire les réseaux. L'infanterie doit donner l'assaut à la fin de la troisième reprise, vers treize heures dix, sans que le départ ait été fixé à une minute près, comme on fera plus tard. Les unités sortant les unes après les autres, les premières sont écrasées sous des feux concentrés, les secondes hésitent, celles dont le retard était plus considérable sont clouées dans leurs tranchées par des barrages d'obus et des gerbes de mitrailleuses. Les liaisons entre l'infanterie et l'artillerie sont rompues, et celle-ci allonge ses salves au jugé. Cependant quelques tranchées sont prises ; et le front est sinueux et incertain. Une partie de ces tranchées est reperdue ; on en établit de nouvelles à leur contact immédiat. Telle est une bataille d'assaut à la fin de 1914. L'hiver passe, si rude dans les tranchées qu'il a fallu multiplier les relèves : sinistre cortège d'hommes changés en blocs de boue, et qui s'avancent par les boyaux, en file indienne, dans la nuit profonde, sous la pluie. Toute la nuit, les grenades tombent avec un claquement sourd, les torpilles éclatent avec une détonation formidable. La perte est chaque jour de 10 à 15 hommes par bataillon. L'artillerie contrebat les batteries ennemies, entretient sur les tranchées allemandes un tir de démolition, coupe les boyaux les plus fréquentés, arrose les zones où des mouvements de troupes sont signalés, bombarde parfois, mais avec circonspection et à regret, les villages, bat la nuit les itinéraires de relève, enfin cloue par les terribles barrages du 75 les attaques ennemies. — Le rôle de l'aviation est encore incertain. Les reconnaissances n'ont plus autant d'intérêt dans cette guerre fixée, et l'hiver y est peu favorable. Le bombardement aérien ne dispose pas encore de moyens puissants. Mais déjà l'aviation développe sa collaboration aux réglages d'artillerie. Elle rapporte aussi des clichés précieux. Les tranchées se multiplient : on pousse vers l'ennemi des sapes dont les tètes forment des postes d'écoute. Depuis l'affaire du 17 décembre, il y a des tranchées qui appartiennent en partie aux Français, en partie aux Allemands, et où les adversaires cohabitent, séparés par des sacs à terre. Nez à nez, les adversaires se fusillent, se battent à la grenade, s'insultent, se bousculent à coups de crosse. Des sapes souterraines poussent leurs galeries sous la position ennemie qu'on va faire sauter ; à l'arrière, les territoriaux dévident le ruban des boyaux et des parallèles de soutien. Le 3 mars, les Allemands attaquent. à leur tour. Ils ont fait le 2 une débauche d'obus et de torpilles. A cet ouragan a succédé une nuit silencieuse ; puis, le 3, à sept heures du matin, une formidable rafale, obus, torpilles. sans doute explosion de mines, a éclaté. L'infanterie allemande s'est jetée en niasse sur les tranchées françaises et les a occupées avant que les défenseurs aient pu saisir leurs armes. L'artillerie allemande arrose les bois en arrière pour empêcher les réserves de s'y rassembler. Au nord, les assaillants ont dépassé la Haie et pénétré dans les boyaux mais au sud le boyau de la crête méridionale est resté aux mains de défenseurs énergiques, qui se trouvent avoir une position de flanc sur l'adversaire, et qui l'arrêtent. La leçon que les Français tirent de l'aventure du 3, c'est qu'un front, pour être inviolable, doit comporter, derrière la tranchée de tir, une deuxième tranchée tenant la première sous son feu et pouvant servir, en cas de malheur, de hase de départ pour une contre-attaque immédiate. Cette contre-attaque, les Français, remontés dans les bois, la donnent le 5. Ils reprennent les premiers boyaux. Sur les tranchées suivantes, l'artillerie fait une préparation de 75 en feu roulant à pleine vitesse pendant une heure, ce qui ne s'était jamais entendu. Après quelques secondes de silence, les chasseurs chargent en rangs serrés et reprennent le terrain jusqu'à la Haie. Le 15 mars, les Français attaquent, sur la face sud de la position, les tranchées du Grand-Éperon, que les Allemands ont conquises en novembre. Préparation violente. Les officiers d'artillerie sont dans la tranchée avec les fantassins, presque au point d'arrivée de leurs obus, reliés à leurs batteries par le téléphone. Après cette préparation, le bataillon d'infanterie chargé de l'assaut a enlevé la position allemande en cinq minutes. Mais alors la situation se retourne. Ce sont les batteries allemandes qui concentrent un feu formidable sur la position conquise. Ces représailles seront le danger de toutes les attaques partielles. Les fantassins tiennent. Le 18 au soir, ils sont relevés par les chasseurs. Ceux-ci, avant d'avoir bien pu connaître la position, sont surpris le 20 au matin par une contre-attaque et perdent la plus grande partie de l'éperon. Ni leurs retours offensifs, ni les attaques d'un bataillon d'infanterie qui leur succède, ne peuvent regagner le terrain perdu. Enfin, le 15 avril, réédition de l'affaire du 15 mars. Un bataillon français reprend définitivement le Grand-Éperon. Cette fois, un élément nouveau a pris part à la préparation : ce sont les canons de tranchée de 58, qui lancent une torpille à ailettes. Telle est la physionomie et tels sont les progrès de la guerre de tranchées depuis l'automne de 1914 jusqu'au printemps de 1915. Dans la vie quotidienne des tranchées, les positions relatives des deux adversaires ont une importance considérable. Celui qui voit dans les lignes de l'autre le gène et prend aussitôt un grand avantage. De là, une véritable guerre locale pour les observatoires, pendant toute la fin de 1914 et toute la première partie de 1915. Tels sont, à l'est de l'Argonne, les combats pour l'observatoire de Vauquois, à l'est de Verdun, les combats pour l'observatoire des Éparges, qui nous reste, et pour celui des jumelles d'Ornes, que nous ne réussissons pas à enlever. La stabilisation |