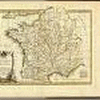HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE IV. — LES TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE JUSQU'EN 1914.
CHAPITRE VI. — LE MOUVEMENT INTELLECTUEL.
|
IL serait vain de prétendre en un chapitre décrire les œuvres et la vie des écrivains, des artistes et des savants d'un demi-siècle où la production intellectuelle a été intense, c'est le rôle de l'histoire spéciale des lettres, des arts et des sciences. On a renoncé à énumérer ici tous les noms qui mériteraient d'être cités ; on se borne à indiquer les conditions sociales de la production intellectuelle, la succession des théories et des modes, les courants généraux de la littérature, des arts et des sciences. Les personnages sont mentionnés ici, non en raison de la célébrité de leurs œuvres, mais comme initiateurs ou types représentatifs d'un genre. I. — LA LITTÉRATURE. A partir de 1860 les conditions sociales deviennent plus favorables à la production littéraire. La compression du gouvernement sur la presse se relâche et, depuis la loi de 1880, la liberté est absolue. Plus important est l'accroissement de l'aisance et de l'instruction, qui augmente le nombre des lecteurs et élève leur niveau. Pour ce public plus large s'accroissent le nombre et l'importance des entreprises littéraires, journaux, revues, théâtres, conférences, maisons d'édition. La demande des œuvres littéraires augmente considérablement ; le roman-feuilleton, le conte, la chronique deviennent une partie permanente des journaux quotidiens ; les théâtres nouveaux des boulevards, puis les petits théâtres et les théâtres à côté consomment une quantité croissante de pièces nouvelles. Cette production — dont la majeure partie ne s'élève pas jusqu'au niveau de l'art — contribue du moins à répandre dans le public le goût de la lecture et la réputation des écrivains, et à procurer des moyens d'existence aux hommes de lettres. La rémunération des œuvres inédites dans les revues et les journaux, les droits d'auteur pour l'édition en volumes, les droits de reproduction dans les périodiques, perçus par la Société des gens de lettres, constituent aux romanciers et aux critiques un revenu analogue à celui des professions libérales. Les droits d'auteur sur les représentations scéniques, perçus par la Société des auteurs dramatiques, assurent même la richesse aux fabricants de pièces en vogue, depuis que le grand nombre des spectateurs, renouvelant chaque soir le public, permet à un théâtre de donner souvent de suite plus de cent représentations de la même pièce. L'augmentation des gains littéraires accroit le nombre des personnes qui vivent de la littérature et rend le métier d'auteur plus lucratif. Le goût, sincère ou affecté, pour les lettres se répand dans la société, il élève le niveau social des écrivains et même des acteurs. L'hostilité cesse entre le bourgeois et l'artiste ; les gens de lettres sont accueillis dans les salons et les plus notables y sont traités avec déférence. La carrière d'écrivain, mieux rétribuée et plus considérée, devient plus régulière. — Ce progrès se limite aux genres en faveur, le théâtre, le roman, la critique. La poésie, qui laisse indifférente la grande masse du public, ne devient pas une profession ; elle reste un art désintéressé, pratiqué par des hommes de loisir ou des hommes de lettres qui trouvent dans un travail d'un autre genre leur moyen d'existence. Beaucoup d'écrivains, et des plus notables, ne s'enferment plus dans un genre unique ; le théâtre surtout, par la perspective des grands succès d'argent, attire ceux qui ont débuté dans d'autres genres. Un des caractères de cette période est le grand nombre d'auteurs dramatiques qui ont été en même temps romanciers, poètes ou même critiques. Le public, plus varié à mesure qu'il augmentait, a fourni un champ plus large où chaque auteur a trouvé plus facilement des lecteurs et des spectateurs prêts à accueillir des œuvres conformes à son goût propre, ou favorables à des idées ou à des formes nouvelles. Il s'est créé dans chaque genre plusieurs publics différents de goûts ou de conceptions. La production, délivrée des exigences d'un public uniforme, a été plus variée, moins dépendante des règles et de la tradition, plus ouverte aux innovations audacieuses. Les écrivains, devenus plus indépendants, plus libres de choisir leur voie, ont produit des œuvres plus individuelles, qu'il est difficile de classer par genres ou par écoles. Ils se sont groupés surtout d'après leurs relations ou leurs sympathies personnelles, à Paris où étaient concentrés les théâtres, les périodiques littéraires, les maisons d'éditions. Des groupements se sont formés auprès d'un théâtre, d'une revue ou d'un éditeur qui se risquait à publier les œuvres des poètes. Ils faisaient l'office d'une association d'aide et de publicité mutuelle sans communauté de doctrine. Ils ont pris parfois l'allure d'un cénacle, et en sont venus à formuler des théories et à lancer des manifestes qui ont donné au groupe l'apparence d'une école littéraire. Dans ces réunions d'hommes d'un même âge s'est formé un sentiment d'opposition aux écrivains en renom d'où est sortie une réaction violente contre la conception et les procédés littéraires de la génération antérieure. Le groupe nouveau prend le contre-pied de ses devanciers ; l'évolution de la littérature parait alors brusquement interrompue par un courant en sens opposé, semblable à un changement subit de la mode. Le champ de la production originale se précise et se limite. L'éloquence s'est concentrée dans la politique et s'y est fondue ; elle n'a plus de caractère artistique : celles du barreau et de la chaire, devenues des imitations conventionnelles, ont cessé d'émouvoir. L'histoire, après Taine et Renan, cesse d'être un genre littéraire. Ni Fustel de Coulanges ni Sorel ne sont des écrivains d'art ; le mérite de l'œuvre historique se mesure désormais à la valeur scientifique des faits et à l'art de les composer avec méthode et de les exposer clairement. — Le roman historique après Salammbô (1862) végète, malgré les tentatives pour le remettre à la mode. — Le drame historique en vers n'a qu'un renouveau éphémère (vers 1820), fait en partie d'opposition aux nouveautés du Théâtre libre et du Théâtre de l'Œuvre, et arrêté après le triomphe de Cyrano en 1898. — Il ne reste de genres prospères que la poésie lyrique, le roman contemporain ou le conte philosophique, la comédie en prose et la critique. Le mouvement littéraire parait d'abord très lent. Pendant un quart de siècle la production dans tous les genres se fait par les survivants de la génération antérieure et leurs disciples directs. En poésie, Victor Hugo continue à produire en abondance des œuvres fortes et inégales ; revenu à Paris, il reste le Maître auquel la jeunesse rend un culte. Leconte de Lisle, dont les Poèmes barbares paraissent en 1862, passe au rang de modèle ; il partage ce rôle avec Th. de Banville, qui a publié ses Odes en 1857. Baudelaire, bien que ses Fleurs du Mal datent de 1857, ne sera que plus tard reconnu le grand poète atroce de la mort et de la perversité. Tous trois enseignent par leur exemple la perfection de la langue et le soin de la technique poétique. Le Parnasse contemporain, publié par l'éditeur Lemerre (de 1866 à 1876), réunit les jeunes poètes leurs admirateurs, sans pourtant constituer une école ; car Sully-Prudhomme, poète élégiaque puis philosophique, et Coppée, le poète des humbles diffèrent des autres membres du groupe. Mais la plupart des Parnassiens ont eu en commun l'allure impersonnelle, impassible ou désenchantée, l'amour de la forme parfaite, la probité du métier poétique ; ils recherchent les sonorités des mots, les images éclatantes, la rime riche, les formes pleines ; ils s'intéressent à la facture du vers et acceptent la devise de l'art pour l'art. Le représentant accompli du genre, J.-M. de Heredia, a réuni dans les Trophées des sonnets qu'on a comparés à des épopées. Le théâtre reste occupé par deux auteurs dont la renommée s'est faite au début de l'Empire, A. Dumas et Augier. Ils continuent jusqu'à leur mort à produire des comédies de mœurs contemporaines où ils mettent en scène la bourgeoisie riche, avec l'intention de la moraliser. La pièce à thèse sociale se développe chez Dumas, surtout dans ses préfaces, jusqu'à la prédication ; elle s'impose à un public frivole et inspire l'admiration aux critiques par la solide charpente et le dialogue animé. Sardou, qui dans sa longue carrière a fabriqué des comédies, des vaudevilles, des drames historiques, n'a employé son habileté dramatique qu'à rechercher le succès. Le roman et la critique subissent la direction de deux hommes qui viennent d'atteindre la maturité, Taine et Renan, dont les œuvres principales relèvent du genre historique et l'influence d'un maître de la science biologique, Claude Bernard, dont l'Introduction à l'élude de la médecine expérimentale paraît en 1865. Leur idée commune est la précellence de la science fondée sur l'observation de la nature ; les historiens prétendent l'étendre à l'étude de l'homme dans le passé, faite au moyen des documents, qu'ils distinguent mal de l'observation. Taine lui donne une forme systématique par la théorie de la race, du milieu, et du moment, et un caractère matérialiste par la fameuse formule : Le vice et la vertu sont des produits comme le sucre et le vitriol (Introduction à l'Histoire de la littérature anglaise, 1863). Renan, plus prudent et plus sceptique, artiste plutôt qu'érudit, dans ses Origines du christianisme (1863-81), pratique l'art de solliciter les textes et de se figurer les diverses façons dont les choses ont dû se passer ; il se fait des disciples par le charme de son style souple et familier et de sa pensée finement nuancée. Leur influence sur la jeunesse se prolongera en devenant politique avec les Origines de la France contemporaine de Taine, 1875, — et la série des romans philosophiques de Renan, depuis Caliban (1876) jusqu'à l'Abbesse de Jouarre (1886). Leur action théorique s'exerce sur les romanciers, combinée avec l'exemple de Flaubert, devenu depuis Madame Bovary le modèle de la nouvelle génération. Les frères de Goncourt, après des travaux historiques sur les arts et les mœurs, venus dès 1860 au roman de mœurs contemporaines, prétendent travailler sur le document humain sous forme de notes d'observation qu'ils comparent à la clinique. Leur style tourmenté, affecté, haché, s'efforce de se modeler sur leurs impressions, — ce qui les a fait qualifier d'impressionnistes. A. Daudet travaille sur des notes, mais il anime le récit par une sensibilité mélangée d'ironie et de pitié. Le représentant typique de l'école. Zola, continue la tradition du réalisme sous le nom de naturalisme ; admirateur de la science, il veut l'introduire dans la littérature. L'œuvre d'art, dit-il, n'est qu'un procès-verbal... elle n'a que le mérite de l'observation exacte. C'est le roman expérimental qui étudie l'homme soumis aux lois physico-chimiques . Zola a marqué son intention en intitulant sa série de romans Les Rougon-Macquart, histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire. Comme les réalistes, il montre le côté animal, vulgaire et attristant de la nature humaine, mais il y apporte un don de représenter les foules en mouvement qui donne parfois une impression épique. Maupassant, élève et ami de Flaubert, se rattache an naturalisme par l'observation précise clos aspects extérieurs des hommes exprimée dans une forme impassible. Entre 1880 et 1890 se produit parmi les jeunes écrivains une fermentation d'idées et de formes qui se manifeste par une abondance d'œuvres obscures, fragmentaires, incohérentes, de tentatives de style et de prosodie informes, parfois extravagantes, de critiques acerbes, de projets grandiloquents. de déclarations bruyantes, publiés dans les petites revues qui ne sont guère lues que par leurs collaborateurs. Ces jeunes en révolte contre leurs aînés transforment tous les genres littéraires. La poésie lyrique change à la fois de but et de technique. La jeune école (qui a pour éditeur Vanier) reconnaît pour précurseur Rimbaud, adolescent baudelairien obscur et bizarre, pour maître un parnassien, Mallarmé, qui exerce une influence personnelle par le charme de sa conversation. La poésie, dit-il, doit essayer, non de montrer les objets comme la peinture, mais de les suggérer comme la musique par des mots choisis pour leurs qualités complémentaires. C'est l'image s'envolant des rêveries. Cet effort pour évoquer les choses par allusion sans les nommer mène à rechercher les formes affectées et obscures, les mots rares, les néologismes, les tours de phrase inusités ; il fait rentrer dans la poésie l'émotion bannie par les Parnassiens et aboutit au symbole et au mystère. L'école, surnommée décadente pour ses excès de raffinement, a gardé le nom de symboliste. Son représentant le plus parfait, Verlaine, a exprimé, dans une forme musicale et nuancée, des sentiments personnels intenses. En opposition à la technique rigide du Parnasse, les symbolistes, en quête de rythmes nouveaux, ont bouleversé la versification, adoptant d'abord le vers libéré, affranchi des règles de la césure, de l'hiatus, de la rime, puis le vers libre, construit suivant un rythme varié indépendant du nombre des syllabes. De ce mouvement — qui s'est prolongé jusqu'à la guerre — est sortie une génération nombreuse de poètes, où se sont distingués les étrangers, le Grec Moréas, chef de l'école romane, les Américains Viélé-Griffin et Stuart-Merrile, les Flamands Maeterlinck et Verhaeren. Dans le roman la rupture avec le naturalisme est annoncée (1887) par un manifeste contre l'imposture de la littérature véridique à propos de la Terre de Zola, signé de cinq de ses disciples. Les romanciers reviennent aux anciens genres français, la plupart au roman d'analyse psychologique (Bourget, Hervieu, Huysmans, Rod, Estaunié, Boylesve) ; d'autres, à la suite de Renan, au conte philosophique, où Anatole France se met hors de pair par une langue d'une simplicité raffinée. Sous l'influence du roman étranger (russe et anglais) les romanciers, renonçant à la forme impassible, laissent paraître leur sympathie pour leurs personnages. L'observation des aspects extérieurs se continue dans le roman exotique ; le représentant le plus brillant en est Pierre Loti, dont les descriptions se mélangent d'impressions personnelles ; il ouvre la voie à la littérature coloniale descriptive et lyrique. L'observation extérieure se déploie dans le roman régional qui décrit les paysages et les coutumes des différentes provinces. C'est le seul essai fait pour décentraliser la production littéraire française, — sauf la tentative des félibres de restaurer la poésie en provençal, à la suite de Mistral, dont le chef-d'œuvre, Mireille, est antérieur à 1860. A l'extraordinaire floraison du roman contemporain les femmes ont pris une part sans précédent ; elles y ont apporté des nuances nouvelles de sensibilité et de sentiment de la nature ; les plus originales sont d'origine étrangère, une Roumaine, la comtesse de Noailles, poète et romancier ; Myriam Harry, de Jérusalem ; Gérard d'Houville, pseudonyme de la fille de Heredia. Le théâtre, plus lent à se modifier, n'entre dans le courant naturaliste qu'au moment où les autres genres en sortent, avec le Théâtre libre fondé (1887) par Antoine, qui introduit le naturel dans les jeux de scènes et fait l'éducation artistique des acteurs et des spectateurs. Les jeunes auteurs groupés auprès d'Antoine reconnaissent pour précurseur et maitre Becque, qui, se donnant pour tâche de représenter la vérité, n'a mis en scène, dans les Corbeaux (1882) et la Parisienne (1885), que les réalités désolantes de la vie. Le public ne tarda pas à se révolter contre ce naturalisme amer, surnommé le théâtre rosse. La réaction commença avec la fondation du théâtre de l'Œuvre par Lugné-Poe (1893) ; il fit connaître en France les pièces des étrangers contemporains, surtout d'Ibsen, d'inspiration idéaliste et poétique. Puis il s'ouvrit à la littérature symboliste qui, rompant avec les règles de la technique scénique, inaugura un spectacle idéaliste, parfois mystique, qu'on a surnommé le théâtre d'idées. De ces deux révolutions l'art scénique est sorti plus souple et plus varié. La critique, pratiquée surtout par les universitaires, se partagea entre deux méthodes : l'une, visant surtout à communiquer les impressions du critique, est représentée par Jules Lemaitre ; l'autre, qui revenait à la critique doctrinale, fut celle de Brunetière. Un trait caractéristique de cette période est l'abondance des œuvres de pur amusement ; sous l'Empire la littérature des boulevards, l'opéra-bouffe et la chansonnette ; plus tard les fantaisies satiriques du cabaret du Chat-Noir à Montmartre (1885-97), rendez-vous des artistes, et les facéties des écrivains appelés humoristes, bien que leur moquerie désabusée soit très différente de l'humour anglais, et auteurs gais bien qu'ils laissent une impression amère. Quelques-uns, en évoluant, sont revenus aux genres littéraires, Courteline à la satire sociale, Donnay et Tristan Bernard à la comédie de caractères, Pierre Mille au conte philosophique. La littérature française, se dégageant des doctrines et des règles d'école, est rentrée dans la voie de la tradition classique, l'observation de la nature et l'analyse psychologique, mais sur un domaine élargi, étendu à toutes les classes et à tous les pays. Elle est revenue à l'expression de la sensibilité, par la compassion pour la souffrance humaine. Elle a repris le souci de la forme précise, ferme, châtiée, simple et claire, mais en gardant le vocabulaire riche et les rythmes variés créés durant le XIXe siècle. Elle n'a produit aucun de ces génies surhumains, destinés à devenir le bien commun de l'humanité ; mais aucun temps n'a vu paraître un si grand nombre de talents personnels. Par l'abondance, la variété, la perfection des œuvres, la France a pris le premier rang dans la littérature du monde. II. — LES CONDITIONS SOCIALES DU TRAVAIL ARTISTIQUE. L'ACCROISSEMENT de la richesse et de la culture artistique dans le public riche, en France et à l'étranger, élargit les conditions de la production artistique et élève la situation sociale des artistes. L'art, surtout la peinture, devient un sujet de conversation à la mode. Une clientèle de plus en plus riche d'amateurs et de parvenus, en France et à l'étranger, surtout aux États-Unis, se dispute les œuvres d'art, et leur concurrence fait élever les prix très rapidement. Après 1880 les prix des peintures contemporaines, pour la première fois, dépassent ceux des tableaux des maîtres anciens ; l'Angélus de Millet est vendu 750.000 francs. Paris devient le centre artistique le plus puissant du monde, le grand musée d'exposition, le plus grand marché de tableaux, la plus grande école de peinture et de sculpture. Avec la hausse des prix, l'art, surtout la peinture, devient une profession plus régulière ; le nombre des artistes et la quantité des œuvres augmentent vite. La condition des artistes s'élève ; les plus connus sont des personnages à la mode, recherchés dans les salons, dont les journaux publient les paroles et décrivent la vie privée. Les artistes s'affranchissent des autorités officielles. Dès 1863, l'empereur, pour laisser le public juge de la légitimité des réclamations contre le jury du Salon, faisait ouvrir dans le même bâtiment une exposition des œuvres refusées. L'augmentation du nombre des artistes et des acheteurs donna carrière à une plus grande diversité de genres ; il se forma plus d'artistes originaux et chacun trouva plus facilement son public. On vit alors les œuvres se diversifier, les artistes suivre plus librement leur tempérament et les écoles se dissoudre. Le Salon annuel des Champs-Élysées de la Société des Artistes Français, qui maintenait la tradition académique par son jury d'admission et son système de récompenses, se dédoubla (1890). La plupart des artistes de tendance moderne firent scission, et fondèrent la Société Nationale des Beaux-Arts, qui exposait au salon du Champ-de-Mars et ne distribuait ni prix ni médaille ; il se créa un Salon des indépendants, où les œuvres étaient reçues sans examen. Les cieux salons, transférés au Grand Palais après l'Exposition de 1900, restèrent séparés, et tous deux ouverts au printemps. Il se créa un Salon d'automne. Les expositions individuelles d'œuvres d'un seul artiste devinrent fréquentes, et les galeries des marchands d'œuvres d'art prirent dans la publicité une importance croissante. III. — LA PEINTURE. LE Salon des Refusés de 1863 réunit les œuvres des jeunes peintres destinés à devenir des maîtres (Manet, Fantin-Latour, Pissaro, Vollon, Whistler, Lansyer, les paysagistes Cazin, Chintreuil, Harpignies). Cette nouvelle génération reconnaissait pour maitre Courbet, le réaliste, le peintre du plein air. L'école de Barbizon (formée dès 1848) arrivait enfin au succès à l'Exposition universelle de 1861 ; Corot atteignait la gloire dont il allait jouir jusqu'à sa mort (en 1875) ; Millet, refusé en 1859, obtenait en 1867, avec l'Angélus du Soir, la médaille d'or. La jeune école adopta une nouvelle formule. L'origine en fut un mot de Manet, qui, refusé au Salon, avait ouvert une exposition de ses œuvres (1867), et déclarait dans le catalogue : C'est l'effet de la sincérité de donner aux œuvres un caractère qui les fait ressembler à une protestation, alors que le peintre n'a songé qu'à rendre son impression. Son exposition excita la moquerie ; le public, habitué aux lumières atténuées des toiles peintes dans un atelier, ne supportait pas la lumière blanche et le bleu dur des ciels de grand jour, et jugeait absurdes les ombres violettes au soleil ; il confondit sous le nom d'impressionnistes tous les peintres dont le sujet ou la manière insolite le choquait : c'étaient surtout ceux de l'école du plein air. Les impressionnistes, en opposition au Salon, se firent connaître par des expositions séparées (1874-86), et arrivèrent à forcer le succès ; leurs tableaux dès la fin du siècle atteignirent des prix élevés, la pression des connaisseurs les fit admettre au Musée du Luxembourg. Leur groupe (Manet, Pissaro, Renoir, Monet, Degas et Cézanne) avait sa technique et sa théorie. Ils cherchaient, comme Courbet, leurs sujets dans la vie contemporaine, à Paris et dans la banlieue, et peignaient en plein air, avec l'intention de représenter l'homme dans la vérité des choses, mais surtout dans le milieu artificiel civilisé. Ils tendaient à rendre visible l'atmosphère qui enveloppe les objets et à peindre les variétés de lumière que la peinture avait évitées jusque-là, le grand soleil et les lumières artificielles. Par application des théories de l'optique, ils décomposaient les couleurs en tons simples, qu'ils juxtaposaient pour produire sur l'œil du spectateur par un mélange optique l'impression de la couleur composée. Ils cherchaient les tons clairs et vifs et simplifiaient le dessin pour mieux faire jouer la lumière. Manet, qui avait ouvert la voie, fut le représentant le plus connu de l'école, par ses scènes de genre, sur l'eau, ou en plein soleil. Le représentant le plus parfait aux yeux des connaisseurs, Monet, peignit des séries représentant le même paysage dans une lumière différente ; il atteignit à la fin de sa carrière la maîtrise de sa technique dans la série des 48 tableaux différents d'un même étang. A côté des impressionnistes groupés pour la lutte, les peintres apparaissent une foule désordonnée ; on ne peut les classer ni d'après leur atelier d'origine, car ils ont subi des influences variées ou adopté des techniques très éloignées de celle de leur maître, ni d'après leur genre de peinture, car la plupart ont travaillé à la fois dans plusieurs. On en pourrait compter une centaine d'un talent personnel dans ce demi-siècle fécond. Les grands succès sont allés aux peintres signalés par les faveurs officielles, qui, dans le choix des sujets et la composition, maintenaient la tradition académique en adoptant, quelques procédés de la technique nouvelle, avec prudence pour ne pas dérouter les habitudes de vision du public ; Hébert, Gérôme, Meissonier, dont les petites toiles, d'une exécution finie, atteignirent les prix les plus élevés, — Bouguereau, dont les tons roses et verts réalisèrent l'idéal du client sans éducation artistique. Quelques-uns, sans oser rompre avec la tradition, cherchèrent à la renouveler par l'étude des maîtres : Paul Baudry, disciple des primitifs et de Véronèse, Henner, imitateur de Corrège ; Gustave Moreau, génie littéraire plutôt que pictural, qui agit par son enseignement plus que par sa peinture. L'orientalisme fut ramené vers la nature par l'observation directe, avec Fromentin, peintre des oasis et du cheval arabe, Guillaumet, Binet. La rénovation issue du réalisme se produisit plus librement dans les genres qui visaient à représenter un modèle réel. Tandis que la composition académique, la technique lisse à contours nets, et la lumière d'atelier se maintenaient dans la scène de genre anecdotique et la scène de mœurs provinciales (surtout de la Bretagne et des différents Midis), la vie des paysans fournit la matière d'une peinture sincère à J. Breton, continuateur de Millet, à Bastien-Lepage mort avant sa maturité, à Lhermitte. — Le paysage fut renouvelé par les peintres du plein air, Harpignies, de l'école de Barbizon, Cazin, peintre de la lumière grise, Ziem, peintre des lagunes de Venise, Roll, paysagiste animalier et peintre du nu féminin en plein air. — Le portrait, libéré des conventions traditionnelles de l'école et des habitudes de la clientèle, s'ouvrit à la technique du plein air. En opposition avec la tendance générale du temps à la représentation exacte, deux hommes travaillèrent à transfigurer la nature et la lumière suivant un idéal personnel : Puvis de Chavannes, régénérant l'allégorie par l'étude du modèle vivant et de l'antiquité grecque, rassembla en de vastes compositions des personnages nus ou drapés dans des poses calmes sous une lumière voilée, spécialement adaptée à la peinture murale ; Carrière peignit des personnages ou des groupes dans des intérieurs éclairés d'une lumière crépusculaire semblable à un brouillard. D'autres, employant la technique nouvelle, évoluèrent de façon à laisser libre cours à la fantaisie personnelle : Fantin-Latour dans ses compositions mythologiques ; Besnard, dans ses portraits, ses paysages d'Orient aux couleurs éclatantes, ses compositions décoratives ; Henri Martin dans des scènes allégoriques de la vie contemporaine. Un dessinateur industriel, Cherest, éleva à la hauteur de l'art l'affiche en couleurs. —La caricature, développée après 1870 par le succès des périodiques illustrés, reprit la tradition, créée par Daumier, de la charge politique satirique en la poétisant sous l'influence de la fantaisie comique des Anglais ; une telle floraison de talents comiques ne s'était jamais vue en France. En réaction volontaire contre le courant qui depuis 1848 portait l'art vers la représentation de la nature, deux groupes se proposèrent un idéal nouveau. — Le premier, en relation avec le symbolisme, prétendit créer un art symbolique où les attitudes, le paysage, la lumière exprimaient une conception mystique. L'exposition de la Rose-Croix déconcerta le public par l'anatomie irréelle et l'étrangeté de la composition des couleurs et de la lumière. — Au début du XXe siècle, l'école néo-impressionniste, poussant à l'extrême l'analyse des impressions visuelles, n'employa que des couleurs pures appliquées sous forme de points, d'où le surnom de pointillisme. La doctrine, formulée par Seurat, appliquée par Signac dans ses peintures de bords de l'eau, eut son représentant complet dans Maurice Denis, qui, don nant à la peinture l'aspect d'une tapisserie, la remena à l'art archaïque de la décoration. Les néo-impressionnistes, fatigués de la perfection de la technique et épris de la gaucherie naïve des primitifs, travaillèrent à désapprendre le métier, et créèrent un art archaïsant dont les maladresses voulues devaient suggérer une impression idéaliste. D'autres réduisirent les formes à des lignes géométriques : ce fut la peinture cubiste, si déconcertante qu'elle parut un procédé pour forcer l'attention du public. Du chaos de tant de productions différentes se dégage une évolution générale : la peinture s'affranchit des anciennes conventions de sujet, de composition, de dessin, de lumière, de couleur, et tend à représenter de plus en plus fidèlement les êtres vivants, le paysage, la lumière. Même les artistes qui prétendent plier la réalité à leur idéal cherchent des procédés nouveaux conformes à leur nature personnelle. Les progrès de la technique servent, non plus à s'écarter de la nature, niais à s'en rapprocher. IV. — LA SCULPTURE. LA convention académique en sculpture fut abandonnée d'abord par les animaliers, que l'étude de leurs modèles ramenait à l'observa Lion, Frémyet, élève de Barye, puis Cain, élève de Rude. Carpeaux, élève de Rude, revint à la nature en reproduisant le mouvement et la vie du corps humain ; ses bustes firent revivre la tradition du portrait réaliste du XVIIIe siècle ; il devint le sculpteur à la mode. Ses œuvres maîtresses sont du nu féminin, la Danse, à l'entrée du nouvel Opéra, qui parut un scandale réaliste (un flot d'encre fut jeté une nuit sur l'une des danseuses), les Quatre parties du Monde. Son succès affranchit la sculpture française de la convention académique et de l'interprétation servile du modèle. La rénovation continua par les élèves de l'École qui avaient vu en Italie les œuvres des maîtres toscans du xve siècle, Paul Dubois, qui traita surtout des personnages contemporains, et Falguière, qui se rapprocha peu à peu de la vie dans le nu féminin. L'éducation académique laissa encore sa marque dans la préférence pour les sujets antiques et le penchant à la virtuosité, surtout chez les sculpteurs venus du midi, A. Mercié, Injalbert, Marqueste, Barrias. Bartholdi montra sa puissance d'exécution dans les œuvres colossales, le Lion de Belfort, la Liberté éclairant le monde de New-York. Les plus originaux se formèrent en dehors des influences de l'école. Bartholomé se créa, par l'imitation des imagiers gothiques, une technique adaptée à un art sévère, dont l'œuvre maîtresse fut le Monument aux morts du Père Lachaise. Dalou, influencé par le Belge Constantin Meunier, traita les ouvriers au travail. La dernière tentative de rénovation de la sculpture se fit sous l'influence directe du symbolisme littéraire, par Rodin, issu de la tradition de Carpeaux, qui après s'être efforcé dans les Bourgeois de Calais de rendre le geste, l'attitude, la physionomie, en vint dans le Balzac et le Penseur à une simplification excessive, employée comme procédé de symbolisme. Il est resté le maître le plus admiré du XXe siècle par les sculpteurs. Cet art vigoureux, qui se donnait pour idéal de reproduire la vie avec des moyens d'expression larges, a acquis à la France une prééminence incontestée dans la sculpture. V. — L'ARCHITECTURE. LE décret de 1863, pour affranchir l'architecture de la domination de l'École des Beaux-Arts, confia au chef de l'École romantique, Viollet-le-Duc, une chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Les percées faites à travers Paris par les nouveaux boulevards et les larges rues, en ouvrant un large champ à la construction, renforcèrent le désir d'une architecture appropriée aux conditions de la vie contemporaine. Le chef de l'école nouvelle en opposition à la tradition académique, Vaudremer, enseigna à tenir compte de la destination de l'édifice et à tirer un effet artistique de la nature des matériaux laissés apparents. Ses chefs-d'œuvre, Saint-Pierre de Montrouge et le lycée Buffon, donnèrent l'exemple d'un art rationnel ; ses élèves, écartés des commandes officielles, construisirent pour la clientèle privée des maisons bien distribuées et d'une jolie allure. L'architecture religieuse, qui continuait à reproduire les types gothiques ou romans, maintint dans la construction des églises un art sain et sans originalité. Les commandes des édifices publics se partageaient entre les académiques et les éclectiques qui tentaient de concilier les règles traditionnelles avec la destination des édifices et la nature des matériaux. Le plus original, Charles Garnier, architecte du nouvel Opéra (1868-1874), adopta un plan rationnel et simple avec un escalier intérieur d'une courbe majestueuse et élégante ; mais le goût du Second Empire se marqua par l'abus de l'or, des cristaux et des marbres de couleur. Les matériaux nouveaux, le fer et la brique émaillée, permettant des constructions plus élevées, suggéraient une architecture plus légère, plus variée de formes et de couleurs. Cet art nouveau parut réalisé à l'Exposition de 1889 dans la Tour Eiffel, où l'harmonie géométrique des proportions atteignait à la beauté, et, dans la Galerie des Machines et les Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux, édifiés en fer, en verre, en terres émaillées, élégants, solides. économiques. Mais fart académique maintint l'emploi de la pierre et du ciment, les façades plaquées, les coupoles et les combles inutiles, et continua à négliger l'aménagement intérieur de l'édifice. L'Exposition Universelle de 1900 fut la revanche de la pierre ; elle reparut avec les façades académiques du Grand Palais et du Petit Palais. Le style moderne ne réussit pas à s'implanter en France. Malgré le nombre des grandes constructions nouvelles il n'a paru que très peu d'œuvres originales. La France n'a pas tenu en architecture le rang prééminent qu'elle a conquis dans les autres arts. VI. — LA MUSIQUE. LES conditions de la vie musicale ne se sont modifiées que lentement. Le public, peu nombreux et peu cultivé, ne se plaisait qu'à la musique de théâtre ; il restait même indifférent à la musique sérieuse de Berlioz, dans les Troyens, et forçait à retirer le Tannhauser de l'Opéra (1861) après trois représentations. La chanson populaire était remplacée par la chanson de café-concert, qui atteignit sa plus grande vogue vers la fin de l'Empire avec la chanteuse Thérésa. Les sociétés chorales (orphéons) et les fanfares instrumentales, créées par toute la France, n'apprenaient aux Français ni à chanter juste ni à connaître les œuvres des musiciens. Les trois scènes musicales de Paris (Opéra, Opéra-Comique, Théâtre lyrique) n'accueillaient que les compositeurs déjà connus, surtout les cieux éclectiques, Ambroise Thomas qui inclinait vers le genre italien et Gounod plus influencé par la musique allemande, apte surtout à exprimer le désir et les sentiments tendres. Le succès soutenu de Faust et de Mignon caractérisa le goût du public français jusqu'à la fin du siècle. — Un genre comique, l'Opéra Bouffe, fut créé sous l'Empire par deux compositeurs en quête de succès. Un Allemand, Offenbach (pseudonyme de Lévy), composa sur des livrets d'écrivains alertes (Meilhac et Halévy) des bouffonneries dont le succès prodigieux caractérise le goût du public des Boulevards ; sa musique abonde en mélodies franches habilement instrumentées. Un Français du Nord, Hervé, acteur, compositeur et librettiste. composa sur des livrets extravagants d'amusantes parodies musicales. Un genre nouveau de concert préparait le changement du goût musical. Un Allemand, Wolfgang (francisé en Pasdeloup) importait à Paris le concert populaire de musique classique ; il faisait connaître les œuvres symphoniques des maîtres allemands à un public jeune d'étudiants et d'amateurs, et parvenait, malgré une opposition bruyante, à faire applaudir des fragments de l'œuvre de Wagner. La renaissance de la musique se produisit après 1870 sous l'action d'une éducation musicale qui changea le goût du public français. En 1871 la Société Nationale se donna pour but de favoriser la production et la vulgarisation de toutes les œuvres musicales sérieuses... des compositeurs français. Ses concerts de musique d'orchestre et de musique de chambre (350 jusqu'en 1903) firent entendre tous les grands musiciens français. Saint-Saëns, qui la dirigeait, s'en retira quand elle décida de jouer aussi des œuvres d'étrangers. Des orchestres d'instrumentistes et de chanteurs, recrutés parmi les bons exécutants, donnèrent des concerts hebdomadaires. Ceux de l'Association artistique, au théâtre du Châtelet, dirigés par Colonne (de 1874 à 1903), vulgarisèrent l'œuvre de Berlioz et les symphonies de Beethoven. Les Concerts Lamoureux, de la Société des nouveaux concerts (de 1881 à 1897), firent entendre surtout la musique de Wagner, mais s'ouvrirent aussi aux œuvres nouvelles des compositeurs français. La Société de l'Harmonie Sacrée se consacra exclusivement à l'œuvre de Sébastien Bach. La formation de ce public de concert prépara le terrain pour les compositeurs de musique symphonique. La musique dramatique restait indépendante des théâtres de Paris. La scène du nouvel Opéra, par son appareil fastueux de décors et de cortèges, imposait des frais qui faisaient hésiter à monter des pièces nouvelles ; la direction préférait jouer l'ancien répertoire où dominaient Meyerbeer et Gounod. C'est l'Opéra-Comique qui accueillit les productions originales ; la plus puissante. Carmen, de Bizet (1875), inspirée de la musique populaire espagnole, par ses mélodies franches, ses danses pittoresques et le pathétique de la scène finale, resta l'œuvre musicale la plus populaire. L'opérette, mi-comique, mi-sentimentale, jouée sur les petites scènes des boulevards, reprit la tradition des mélodies alertes et gaies du vieil opéra-comique français. Une école nouvelle se forma sous deux influences. 1° La musique de Wagner, après avoir conquis le public des concerts, força après 1890 l'accès de la scène et s'imposa comme modèle dramatique, tandis que ses théories se propageaient par les critiques. Les musiciens français adoptèrent la mélodie continue variée par des modulations, l'emploi fréquent des dissonances et de la septième diminuée, et même le leit-motiv. 2° L'École de musique religieuse et classique, fondée en 1853 par Niedermayer, avait formé des chanteurs, des organistes, des maîtres de chapelle et des compositeurs (Fauré, Messager). Le chef de la renaissance fut un Belge naturalisé français, César Franck (né en 1822), professeur d'orgue au Conservatoire (1872), qui groupa les jeunes compositeurs dégoûtés de la musique d'Opéra et de l'enseignement académique ; ses œuvres, Rédemption, les Béatitudes, d'un style archaïque et mystique inspiré de Bach, employaient des procédés harmoniques nouveaux. Ses disciples, d'Indy, Chausson, Ropartz, Lekeu, Pierné, Vidal, Augusta Holmès, formèrent une école de symphonie et de musique de chambre. Cette renaissance influença les compositeurs déjà connus, Saint-Saëns, célèbre par sa science musicale et son habile orchestration, Massenet, devenu, par ses opéras-comiques, le favori du public. Ils représentent un art intermédiaire entre le wagnérisme et les anciennes formes ; c'est aussi celui des compositeurs élèves du Conservatoire qui ont cherché leur voie dans des genres divers, Guiraud, Paladilhe, Chabrier, Charpentier. La musique religieuse se diffusa par la société des Chanteurs de Saint-Gervais, fondée en 1892, et surtout par la Schola cantorum, fondée en 1894 pour restaurer la musique religieuse, devenue un établissement de concerts, puis transformée (1900) en École supérieure de musique nationale, pour remettre en honneur les vieux musiciens français. Sous l'influence de Wagner et de Bach s'exerçant par l'intermédiaire de Franck, les jeunes compositeurs, en opposition contre la musique française d'Opéra, ne voulurent travailler que pour le concert ; puis ils finirent par imposer leur formule au théâtre. Le plus original, Debussy, qui prétendit créer un art affranchi des règles antérieures, obtint, avec Pelléas et Mélisande (1902), le plus grand succès de la génération ; sa musique savante et délicate tirait partie des sonorités des divers instruments et des diverses combinaisons harmoniques. La musique issue de cette renaissance des études n'est plus, comme l'ancienne musique française, un art populaire national. Elle reste inintelligible au peuple et ennuie le public bourgeois qui lui préfère l'opérette ou l'ancien répertoire. Il faut une culture spéciale pour la goûter sincèrement, et, même grossi des snobs artistiques qui affichent l'admiration pour toute nouveauté, le public musical reste un cénacle. La musique française est devenue un art savant qui ne descend plus dans les profondeurs de la nation. Mais la production abondante d'œuvres solides dans tous les genres sérieux, oratorios, symphonies, suites, poèmes symphoniques, chant, opéra, drame lyrique, a inspiré à l'étranger le respect pour la science et l'élévation de sentiment des compositeurs français. Aucun pays depuis un demi-siècle n'a produit un si grand nombre de musiciens L'Allemagne ayant cessé de créer des œuvres originales, la France a pris le premier rang. VII. — L'ORGANISATION DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE. LA recherche scientifique abandonnée jusque-là à l'initiative des travailleurs isolés, attire enfin l'attention du gouvernement qui, peu à peu, réorganise l'enseignement supérieur de façon à augmenter le nombre des savants préparés aux recherches personnelles et à les pourvoir des instruments de la production scientifique. Le premier pas fut fait sous l'Empire par la création de chaires au Collège de France pour trois hommes qui venaient de révéler leur puissance de création : Berthelot, Claude Bernard, Renan. Duruy, ne pouvant réformer les Facultés, créa une École pratique des Hautes Etudes qui, n'obligeant à aucun examen et ne préparant aucune carrière, devait par des exercices pratiques former des élèves capables de faire avancer la science ; la section d'Histoire et philologie, recrutée de jeunes érudits qui avaient étudié à l'étranger, introduisit en France les méthodes de travail des séminaires des Universités allemandes. La catastrophe de 1870 disposa l'opinion publique à des réformes sur le modèle de l'Allemagne. Les écoles spéciales furent maintenues avec leur plan d'études invariable destiné à préparer à une profession spéciale. Mais les Universités reconstituées (voir chap. II, § 7) reposèrent sur l'union intime entre la science et l'enseignement ; les professeurs, recrutés parmi les travailleurs scientifiques par des recherches originales, devaient par leurs travaux personnels faire avancer la science ; l'enseignement devait viser moins à communiquer des résultats acquis qu'à faire comprendre aux étudiants la méthode par laquelle se constitue la science. L'installation matérielle se régla sur les exigences de la technique scientifique. Plus la masse des connaissances s'accroissait, plus la découverte de faits nouveaux comportait d'opérations minutieuses qui exigeaient un long apprentissage et obligeaient les travailleurs à limiter le terrain de ses recherches ; le progrès de la science imposait la division du travail et la spécialisation des savants. Plus la technique s'est perfectionnée, plus les instruments de mesure et d'expérimentation (balances, appareils graphiques, microscopes, machines électriques, appareils de pression, fours, calorimètres) sont devenus compliqués et puissants, plus se sont élevés les frais d'installation et de recherches. Le travail scientifique ne s'est plus guère fait que dans les laboratoires des établissements publics aménagés exprès pour la technique spéciale de chaque branche de science. Les travaux d'observation et de classification des sciences descriptives étaient liés de même façon aux collections méthodiques de matériaux réunies dans les musées (histoire naturelle, minéralogie, art, archéologie) ; même les sciences morales, dont la technique se réduit à des habitudes psychologiques (d'analyse, de critique et de raisonnement), avaient pour instrument nécessaire une bibliothèque bien pourvue et bien classée. Le travail scientifique désormais fut fait presque uniquement par les professeurs. L'augmentation des travaux produite par l'accroissement du nombre des travailleurs et la spécialisation plus étroite résultant d'une plus grande division du travail ont rendu de plus en plus difficile le travail indépendant des chercheurs isolés et ont obligé les savants à se concerter pour se partager le travail et employer les mêmes procédés d'observation et de notation. Il s'est établi entre tous les pays une collaboration par les congrès, les publications, les sociétés scientifiques, fortifiée par les relations personnelles entre savants. Il en résulte une communauté de méthode et de conceptions, un contrôle réciproque des travaux par les discussions des corps savants et les comptes rendus critiques, une concentration rapide des résultats des recherches dans les périodiques spéciaux, une condensation des conclusions définitivement acquises sous la forme de manuels scientifiques. Cette coordination de tous les travaux en vue d'un but unique et cette coopération de tous les travailleurs ne s'enferment pas dans les frontières d'une nation. La production scientifique est devenue une œuvre internationale, où il est de plus en plus difficile de discerner la part des Français. VIII. — LES SCIENCES EXACTES. C'EST dans les sciences mathématiques que le caractère international s'est marqué le plus fortement par la création d'institutions officielles, le Bureau international des poids et mesures de Saint-Cloud (1875), la carte photographique du ciel (1887), la conférence internationale de l'heure (1919). Le petit nombre des mathématiciens originaux et l'universalité de la langue mathématique facilitent la concentration internationale de la production mathématique. En mathématiques pures, les savants de la génération antérieure, Chasles, Joseph Bertrand, Ossian Bonnet, Hermite continuèrent isolément sous l'Empire l'étude des courbes et des surfaces. Avec la réorganisation de l'enseignement supérieur, une nouvelle génération de mathématiciens jeunes dans les chaires de Paris (Appell, Poincaré, Picard, Painlevé, Hadamard et Borel) ouvrit une période brillante par le nombre, l'originalité, l'élégance des productions, l'emploi de méthodes nouvelles. La géométrie dans un espace imaginaire à plus de trois dimensions construisit la science de l'espace sur un fondement dégagé de l'observation ; — l'algèbre universelle trouva des procédés de calcul pour les questions restées insolubles. Les mathématiques s'élevèrent à des formes si abstraites que les titres mêmes des travaux ne sont plus intelligibles qu'aux spécialistes. — En astronomie, la France tint sa place dans les travaux d'observation au télescope. de photographies et de calculs, et les missions scientifiques pour l'étude des éclipses et des passages de Vénus sur le soleil. La physique et la chimie, jusque-là opérant sur deux domaines indépendants, furent reliées, par la découverte des caractères communs aux phénomènes physiques et chimiques, en une conception d'ensemble, la chimie physique. Elles ont progressé par une combinaison d'inventions techniques, d'expérimentations et de théories faites dans différents pays ; l'œuvre des savants français a été si étroitement unie à celle des étrangers qu'elle n'est intelligible que par l'étude de la science internationale. L'origine de la révolution fut l'invention du spectroscope en Allemagne ; l'analyse spectrale de la lumière, permettant de déceler la présence des corps chimiques, bouleversa l'astronomie, jusque-là purement mécanique, en faisant connaître la composition des astres, et constater l'unité chimique de la matière dans l'univers. — La photographie, d'origine française, devint un instrument d'enregistrement scientifique dans toutes les sciences expérimentales et fit découvrir les phénomènes lumineux invisibles à l'œil humain. L'invention de la pompe à mercure (1861), obtenant un vide beaucoup plus parfait que la machine pneumatique, permit, par l'étude de l'action de l'électricité sur l'air très raréfié, de découvrir les rayons cathodiques. Ces découvertes amenèrent à comparer avec précision la marche des phénomènes différents, et à apercevoir la ressemblance profonde entre les lois du mouvement, de la chaleur, de la lumière, de l'électricité ; ainsi fut établie la continuité entre toutes les branches des sciences physiques, et fut constatée l'unité des lois de la matière. La théorie cinétique des gaz expliqua la pression des gaz par l'agitation de leurs molécules, analogue à la gravitation des astres et, par la conception d'une matière en mouvement continu, ramena la statique à la mécanique. Cailletet obtint la liquéfaction des gaz les plus rebelles, l'azote (1870), puis l'oxygène et enfin l'hydrogène. Pendant que s'opérait l'unification de la science physique, la science chimique achevait de s'unifier. — Berthelot, en même temps qu'il obtenait des synthèses nouvelles, mesurait l'énergie correspondant à chacune des réactions chimiques et constituait la thermochimie, qui, en montrant l'unité entre les phénomènes de chaleur et les réactions chimiques, reliait la chimie à la physique. Tandis qu'il faisait maintenir dans l'enseignement français la notation chimique en équivalents, les chimistes alsaciens, Wurtz et Friedel, faisaient adopter dans les Facultés de médecine la nouvelle notation atomique fondée sur la relation entre les poids des atomes de chaque corps et le poids de l'atome le plus léger, l'hydrogène, qui donnait de la structure intime des corps une représentation mieux adaptée aux besoins de la chimie organique. Ils étudiaient la série des combinaisons possibles entre les quatre éléments constitutifs de tous les corps organiques (hydrogène, oxygène, azote, carbone), qui réduisait la chimie organique à un système simple et rationnel. Après 1880, la chimie fut rattachée à la physique par une nouvelle science, la chimie physique, issue de la stéréochimie (renouvelée par les études de Pasteur sur les cristaux). Elle procédait, non plus par l'examen des réactions entre les différents corps, mais par l'étude de la structure intime de chaque corps, en déterminant l'arrangement des molécules et des atomes. La connaissance des relations entre molécules et atomes s'établit par des considérations théoriques sur les poids atomiques ; l'observation directe fut rendue possible par l'invention du microscope à immersion (1878) ; l'expérimentation se porta sur les substances à l'état colloïdal par l'étude du mouvement brownien, qui donna une méthode pour le dénombrement des atomes. Le four électrique (de Moissan) permit de réduire les composés les plus résistants, et de dégager le fluor (1893), le calcium (1899). La révolution des sciences physiques se produisit à la fin du siècle par la découverte accidentelle d'une espèce inconnue de phénomènes. Les expériences sur les rayons cathodiques obtenus par une décharge électrique dans l'air très raréfié firent découvrir les rayons X, qui traversent plus rapidement les parties légères des corps et sont arrêtés par les parties denses (1895). Cette découverte fit naître la radiographie (des parties résistantes aux rayons X) et l'étude de la radioactivité. Becquerel trouva dans les sels d'uranium d'autres rayons analogues (1896). M. et Mme Curie découvrirent (1898) dans la pechblende un résidu qui émet des rayons beaucoup plus puissants que ceux de l'uranium, et parvinrent à mesurer la chaleur émise par ces sels, puis à isoler le radium (1903). L'étude des phénomènes radioactifs élargit les conceptions fondamentales de la physique en substituant à l'explication des phénomènes par ondulations (sonores, lumineuses, électriques) l'hypothèse de l'émission. Les transformations successives des émanations du radium en une série de corps que leurs propriétés chimiques avaient fait classer dans la série des corps simples, transforma les idées sur la classification des corps. L'hypothèse d'atomes constitués par un nombre prodigieux d'électrons fit apparaître la matière sous la forme d'un vide où se meuvent d'un mouvement incessant et très rapide des parcelles discontinues séparées par des distances aussi grandes en proportion que celles qui séparent les planètes du soleil. IX. — LES SCIENCES BIOLOGIQUES. LES sciences biologiques furent régénérées, à partir de 1860, par une révolution des idées produite par la théorie de Darwin, et une transformation des procédés de travail résultant d'une méthode inventée par Pasteur. En même temps, Claude Bernard fondait la physiologie générale, par des expériences sur le fonctionnement des organes (l'action des glandes et le rôle de la sécrétion interne) et par l'exposé dans la Médecine expérimentale (1865) d'une méthode d'expérimentation qui permettait l'analyse précise des phénomènes. Pasteur, travaillant sur les ferments, inventa les procédés techniques pour l'étude des microorganismes : filtrage de l'air, solution dans l'éther, bouillons de culture, colorants chimiques. Ses expériences l'amenèrent à constater l'action des germes d'organismes inférieurs répandus partout. Il créa la microbiologie et établit que toute fermentation est due à un phénomène biologique. En étudiant les microbes qui engendrent les maladies des animaux, le choléra des poules (1877) et le charbon des moutons, il découvrit le procédé pour atténuer un virus par des cultures successives et pour l'inoculer à un animal vivant de façon à l'immuniser contre la maladie. Il l'appliqua dès 1885 à la rage. Cette découverte passionna le public. L'Institut Pasteur, fondé par souscription, devint un établissement de recherches et de traitements microbiologiques. La bactériologie détermina les microbes spécifiques des maladies infectieuses en les examinant au microscope à l'état vivant, précisa leur mode d'action en étudiant les poisons (toxines) qu'ils produisent, et rechercha les moyens d'immuniser les organismes. C'est en France que fut formulée la théorie générale de la lutte entre les microbes pathogènes venus du dehors et les leucocytes et les phagocytes de l'organisme atteint. Tandis que l'expérimentation établissait la physiologie sur un fondement scientifique, les sciences biologiques descriptives, zoologie, botanique, anthropologie (et la géologie) furent bouleversées par une explication nouvelle de l'origine des phénomènes actuels, donnée par deux Anglais : le géologue Lyell expliqua la formation des terrains géologiques par l'accumulation lente de petits changements analogues à ceux qui continuent sous nos yeux ; le naturaliste Darwin, complétant la théorie française de Lamarck sur la transformation des animaux par l'action du milieu, attribua la création des espèces nouvelles à la transformation graduelle d'une espèce antérieure par une longue succession de changements individuels résultant de la sélection naturelle et transmis par l'hérédité. Ce système fournit à la botanique et la zoologie un principe de classement général, qui ramenait à l'unité la multitude infinie des espèces. Ces deux systèmes, résumés dans la formule évolution, supposaient une durée de la terre calculée par centaines de milliers de siècles, contrairement à la chronologie de l'Écriture Sainte. Ils excitèrent de vives protestations, lorsque Darwin, appliquant à l'espèce humaine la loi générale du transformisme, admit que l'homme descendait du singe. En France, les professeurs du Muséum défendirent la doctrine de l'immutabilité des espèces fondée par Cuvier ; le transformisme fut accueilli avec enthousiasme par les matérialistes et les positivistes en lutte contre le spiritualisme. L'étude des races humaines, entreprise sur les collections du Muséum par Geoffroy Saint-Hilaire, fut reprise par Broca, professeur de médecine, qui fonda l'anthropologie sur la mesure des proportions du crâne. L'étude des vestiges préhistoriques, abondants dans les cavernes des montagnes, fut organisée en anthropologie préhistorique par de Mortillet, qui classa les populations d'après leurs instruments et leurs systèmes d'ornementation. L'école anthropologique et l'école préhistorique, unies par leur conception matérialiste de l'évolution, fondèrent une École d'anthropologie privée, qui devint le centre des recherches anthropologiques. La théorie de l'évolution, en opposition à l'enseignement officiel, pénétra peu à peu parmi les naturalistes ; ils remplacèrent la classification fondée sur la structure actuelle des êtres par un système simple reposant sur la filiation des espèces ; ils complétèrent l'analyse anatomique et physiologique des végétaux et des animaux par la comparaison entre les différentes familles et l'observation des changements de structure résultant du milieu et de la sélection. Le travail, en botanique, fut fait par les expérimentations dans les laboratoires de biologie végétale, où les plantes étaient cultivées de façon à obtenir des variations rapides, — en zoologie, dans les laboratoires maritimes (Concarneau, Roscoff, Banyuls, Wimereux), annexés aux Facultés, par l'étude des espèces marines qui fournissaient les termes de comparaison nécessaires à la zoologie générale. — La géologie fut rattachée à la biologie par la paléontologie et l'étude des fossiles qui servent au classement des terrains. Le perfectionnement des procédés d'observation, microtome pour les coupes fines, colorants électifs, microscope à immersion, appareils graphiques pour inscrire les mouvements, permit l'observation précise des fonctions et de la reproduction des organismes invisibles qui, par l'étude du protoplasma et par l'embryogénie des cellules, démontra l'identité des phénomènes élémentaires de la vie dans tous les êtres organisés. Ainsi la biologie fut ramenée à l'unité. Le système évolutionniste, ébranlé par des critiques de principe et des rectifications de faits, fut attaqué depuis la fin du siècle ; la formation de nouvelles espèces par évolution pendant une durée hypothétiquement illimitée ne parut pas s'appuyer sur l'expérience du présent. Au darwinisme on opposa le mendélisme (théorie des croisements), puis la théorie des mutations brusques. Les naturalistes français, revenant à la tradition de Lamarck, préférèrent expliquer les transformations par l'action du milieu. La révolution des sciences biologiques se répercuta sur les études médicales en médecine mentale et en médecine pratique (chirurgie et thérapeutique). L'école française de psychiatrie, par une méthode combinée d'observations anatomiques et de remarques psychologiques, avait étudié les phénomènes de mentalité anormaux. Ces études, d'abord isolées, furent organisées en deux systèmes antagonistes, par l'École de la Salpêtrière (Charcot), célèbre dans le monde des lettres par ses théories sur les phases de l'hystérie, et l'École de Nancy, qui donna une théorie des phénomènes de mémoire inconsciente et précisa les précautions à prendre, dans les observations psychopathiques, contre le spiritisme magnétique des médiums. La microbiologie transforma la chirurgie, l'hygiène et la thérapeutique en introduisant l'antisepsie, puis l'asepsie, qui firent disparaitre la septicémie et permirent de traiter par la chirurgie les lésions des organes internes. L'hygiène publique, fondée sur l'observation des transmissions de germes microbiens, donna le moyen d'arrêter les épidémies de peste et de choléra, et d'atténuer la typhoïde et la fièvre paludéenne. L'hygiène privée, fondée sur la chimie biologique, permit de régler la quantité et la nature des aliments d'après les besoins réels des organes. La connaissance des microbes spéciaux rendit la thérapeutique plus rationnelle en fondant le diagnostic sur la constatation des microbes. Le progrès de la chimie permit de remplacer les médicaments naturels par des alcaloïdes dosés exactement. La plupart de ces innovations vinrent de l'étranger ; c'est en France qu'a été créée la sérothérapie, qui traite les maladies infectieuses par l'injection des sérums, et qu'a été constatée empiriquement l'anaphylaxie, dans les cas où l'inoculation, au lieu d'immuniser l'organisme, diminue sa résistance. X. — LES SCIENCES MORALES ET SOCIALES LA rénovation des
sciences naturelles s'étendit au domaine des sciences morales. L'augmentation
du personnel et des crédits de l'enseignement supérieur activa les
publications d'érudition, les fouilles archéologiques et les missions de
recherches de l'École d'Athènes, de l'École de Rome (fondée en 1874), de l'École du Caire (fondée en 1880). Des explorateurs français découvrirent la
plus ancienne inscription sémitique (la stèle
de Mesa), les monuments d'une ancienne ville de Chaldée, les palais
des rois de Perse à Suse. L'État, les corps savants, les sociétés privées,
les maisons d'édition se chargèrent des entreprises trop coûteuses pour un
travailleur isolé : catalogues de manuscrits, inventaires d'archives,
Répertoire archéologique et Dictionnaire topographique des départements, Corpus
des inscriptions sémitiques et de la Gaule antique, collections de documents
des Académies et de la Société des anciens textes français, collection des Grands
Écrivains de la France. Les revues spéciales[1], rendues
nécessaires par la masse des travaux, constituèrent dans chaque branche
[d'études un procédé d'information périodique rapide, par les bibliographies
et les comptes rendus critiques, et un centre de publication pour les travaux
des spécialistes. Les érudits, en lutte contre les généralisations hâtives et les formules vagues du genre académique et contre les improvisations du romantisme, enseignèrent que toute connaissance historique générale doit reposer sur un examen critique des sources d'information et une étude minutieuse des faits particuliers. Les travaux[2] prirent la forme d'éditions critiques de textes, d'études de sources, de monographies, dont les vertus maîtresses furent la prudence, la précision, la sincérité. Ce fut surtout l'œuvre des professeurs de l'enseignement supérieur et de leurs élèves. La production se concentra à Paris ; l'érudition locale s'éteignit peu à peu avec les groupes d'érudits de province. Le travail se porta d'abord sur les anciens domaines de l'érudition, philologie, archéologie, épigraphie, histoire de l'antiquité et du pré-moyen âge, où la publication des matériaux était plus avancée et où l'érudition allemande avait préparé les voies ; puis sur le moyen âge français, champ d'études des Chartistes et des romanistes ; enfin, avec les publications de documents, sur les temps modernes et (depuis 1880) sur la Révolution. Les connaissances accumulées par les recherches des spécialistes furent condensées sous forme de dictionnaires, répertoires, manuels scientifiques dans chaque branche d'études ; puis sous forme d'histoires générales de haute vulgarisation, pourvues de références bibliographiques, rédigées en collaboration par des spécialistes. La conception de l'évolution, transportée des sciences naturelles dans les sciences morales, élargit le champ d'études et transforma la méthode. On admit que les idées et les actes de tout homme dépendent de la société où il vit et que tout état d'une société résulte d'une évolution prolongée. Les institutions officielles, seules jusque-là jugées dignes d'étude, n'apparurent plus que comme la forme exceptionnelle et artificielle de faits dont les usages populaires représentent les formes spontanées ou les survivances. Les phénomènes sociaux furent étudiés, non plus seulement dans leur état actuel, mais dans leur succession ; les sciences sociales devinrent des sciences historiques. L'étude des organisations officielles fut complétée par l'étude des formes populaires ; chaque histoire spéciale se doubla d'une histoire des phénomènes rudimentaires (patois, folklore, mythes, coutumes juridiques, contes et poésies populaires, art spontané), observés chez les sauvages ou dans la vie populaire. Cette transformation fut retardée en France par la résistance de la tradition dans les enseignements officiels, la rhétorique, la critique dogmatique, la théologie, le droit, l'économie politique. L'observation des conditions de vie des travailleurs manuels, inaugurée par Le Play (1867) sous forme de monographies de familles, donna naissance à l'école de la science sociale, qui aux procédés déductifs des économistes opposa la pratique des observations d'économie sociale. Les socialistes français, adversaires du régime capitaliste, combinant le matérialisme historique de Marx avec l'idée française de la justice sociale, attaquèrent le principe fondamental de l'économie politique libérale. Les partisans de la politique sociale, fonctionnaires et hommes politiques, réclamèrent l'intervention de l'État dans l'exécution du contrat de travail. La création de chaires d'économie politique dans les Facultés de droit renforça ce mouvement, qui eut son organe dans la Revue d'économie politique. La recherche des conditions de la production (capital, salaire, commerce, crédit, monnaie) fut complétée par l'étude de la distribution et de la consommation. La philosophie, par la nature de son objet, échappa à la transformation en science historique. L'observation des sensations par la méthode expérimentale donna naissance à la psychophysique, tardivement introduite d'Allemagne en France. La classe de philosophie rétablie (1863) dans l'enseignement secondaire et l'agrégation de philosophie assuraient à la France un personnel de professeurs et d'élèves plus compact qu'en aucun autre pays. La nouvelle génération fut disputée entre deux influences opposées. Ribot, disciple de l'évolutionnisme anglais, recommanda la méthode positive d'observation des phénomènes psychologiques, pratiquée en physiologie et en psychiatrie. L'école idéaliste, — dont les deux chefs, Ravaisson et Lachelier, par leurs fonctions de président du jury d'agrégation et d'inspecteur général, exercèrent une action continue sur les études de philosophie, — maintint le travail philosophique sur le terrain de la spéculation transcendante. Elle fut renforcée par la théorie philosophique du mathématicien H. Poincaré sur le caractère anthropomorphique de la science, et par le pragmatisme, d'origine américaine, représenté en France par Bergson, qui tend à réduire la science à un ensemble de procédés commodes pour la pratique. Sous l'action de la politique sociale, la philosophie retourna à l'étude de la morale, non plus individuelle, mais sociale, résultant de la solidarité entre les membres de la société. Un groupe reprit, avec le nom de sociologie emprunté à A. Comte, la lutte contre la méthode d'observation psychologique des phénomènes de conscience ; il tenta de créer une méthode objective par l'étude des phénomènes, surtout religieux, de conscience collective. Son organe fut l'Année Sociologique, fondée (1896) par E. Durkheim. La Revue de métaphysique et de morale (1901) marqua un retour à la morale individualiste. Toutes les sciences, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ont donc subi des transformations analogues ; chacune a dû renoncer à atteindre le but visé par les chercheurs primitifs, la réalité des choses, la substance, la cause ; elle a aperçu l'immensité des phénomènes dans les deux sens, en grand dans l'univers, en petit dans l'atome ; elle a constaté que les impressions produites sur nous par les phénomènes ne ressemblent pas à la représentation qu'une étude précise nous oblige à nous en faire. La science, renonçant à trouver l'absolu, s'est limitée à chercher les rapports entre les phénomènes et s'est déclarée relativiste ; ses adversaires en ont profité pour la déclarer impuissante à connaître la vérité : Brunetière a proclamé la faillite de la science, les pragmatistes l'ont réduite à une collection de recettes pratiques. En se limitant à l'étude des rapports, les sciences ont constaté la permanence des rapports sur laquelle repose la certitude théorique des lois, qui a permis la prévision des effets assez sûrement pour réaliser les applications pratiques au travail humain. En constatant la ressemblance entre les lois de phénomènes qui apparaissent à nos sens comme des espèces différentes, elles ont montré l'uniformité fondamentale de l'univers. Chaque espèce s'est reliée à une espèce plus simple, les phénomènes sociaux aux phénomènes psychologiques, la psychologie à la physiologie, la physiologie à la chimie, la chimie à la physique, la physique à la mécanique. La science ainsi unifiée satisfait l'esprit par la simplicité de ses conclusions et le rassure par leur certitude ; elle est l'œuvre la plus solide et la plus désintéressée de l'intelligence humaine. FIN DU HUITIÈME VOLUME |