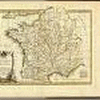HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE IV. — LES TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE JUSQU'EN 1914.
CHAPITRE IV. — LA POPULATION INDUSTRIELLE.
|
I. — LE MOUVEMENT DE LA POPULATION. LA population industrielle — dans laquelle le recensement réunit les travailleurs des deux sexes occupés à l'extraction, à la transformation et au transport des matières, — est en augmentation continue ; elle a passé de 4.594.000 en 1866, malgré la perte de l'Alsace, à 5.642.000 en 1901, et 7.846.000 (dont 2 895.000 femmes) en 1911. La proportion à la population totale a monté de 31,5 p. 100 en 1881 à 38,8 en 1911. La répartition, déjà très inégale entre les départements l'est devenue encore davantage ; le pourcentage en 1906 dépassait la moitié de la population active, c'est-à-dire exerçant une profession, dans 5 départements des régions industrielles du Nord et de l'Est (Nord 64 p. 100, Pas-de-Calais 51, Meurthe-et-Moselle 53, Ardennes 53, Vosges 32), 3 départements de grandes villes (Seine 55, Bouches-du-Rhône 55, Rhône 54) et un département minier (Loire 57). La proportion des femmes (33,7 en 1901) accrue encore en 1911, dépassait celle des pays industriels, Angleterre, Allemagne, Belgique, à cause de la grande activité dans la couture, la mode, la lingerie, la blanchisserie, les fleurs et les plumes. Le recensement professionnel divise la population en catégories, d'après la matière du travail, mais dans chacune il réunit en un total unique les petits patrons, les artisans et les salariés. La catégorie la plus nombreuse est restée le travail des étoffes, qui comprend la confection (couturières et, tailleurs), les modes, la lingerie, la blanchisserie, en augmentation de 1.304.000 en 1896 à 1.531.000 en 1906. Puis viennent, par ordre de grandeur, les industries textiles 914.000, en augmentation, laine (171.000), coton (167.000), soie (124.000), en diminution, toile (114.000) ; — la métallurgie et le travail des métaux (fer et acier, construction, ferronnerie, coutellerie, armes, ferblanterie, automobiles), en augmentation rapide de 664.000 en 1896 à 828.000 en 1906 ; — l'industrie du bois 705.000, menuiserie (151.000), sciage, charpente, ébénisterie, brosserie, tabletterie ; — le terrassement et la construction en pierre, 550.000 maçons (287.000, en forte diminution), plombiers, peintres ; — l'industrie des transports et manutention, 513.000, transports par terre (124.000), chemins de fer (270.000) ; — les industries d'alimentation 479.000, boulangerie (176.000), meunerie (84.000 en décroissance rapide de 29.000 en dix ans) charcuterie (46.000), pâtes alimentaires, beurre et fromages, distillerie, brasserie, conserves ; — les cuirs et peaux 331.000, stationnaire, chaussures (207.000 en diminution), tannerie, sellerie, ganterie ; — les mines et carrières, comprenant la houille (170.000), les mines de métaux, les carrières d'ardoise et de pierre (131.000) ; — les terres au feu 165.000, briques, tuiles et poteries (56.000), verre et émail (53.000), chaux et plâtre, faïence et porcelaine ; — les industries chimiques en augmentation rapide de 81.000 en 1896 à 125.000 en 1906, gaz, tabacs, huiles, stéarine, savon, parfums, engrais, la polygraphie, où domine l'imprimerie (80.000), qui a passé de 83.000 en 1896 à 107.000 en 1906 ; — le papier, carton et caoutchouc (85.000). Le recensement de 1866 donnait un total de 2.936.000 ouvriers, travaillant dans 1.450.000 établissements, en moyenne 2 ouvriers par patron ; la population industrielle se composait surtout de petits patrons travaillant pour leur compte, et de leurs compagnons. Le recensement de 1911, mettant à part les industries d'extraction et des transports, la plupart organisés en grandes sociétés anonymes, compte 2.412.000 ouvriers et 1.000.000 de patrons ; le nombre encore très élevé des patrons indique la persistance de la petite industrie. II. — LES ARTISANS. BIEN que le nom d'artisan ait été dans l'usage remplacé par celui d'ouvrier, les travailleurs manuels de l'industrie étaient en majorité, en 1866, des artisans travaillant isolément, les uns pour leur compte, soit en vendant leurs produits aux clients, soit en recevant d'eux directement leur salaire, les autres comme compagnons d'un autre artisan avec la perspective de s'établir plus tard à leur compte. La proportion en a diminué depuis 1866 ; mais elle reste élevée : car on peut considérer comme artisans plus des ⁴/₅ des patrons et un très grand nombre des ouvriers recensés en 1911. L'accroissement de la fabrication en gros et à la machine a supprimé ou réduit plusieurs métiers d'artisans. L'abandon des moulins à eau et à vent remplacés par les minoteries a fait disparaître presque tous les meuniers. La chapellerie, la cordonnerie, la quincaillerie, fabriquées en grands établissements, ont ruiné le métier de chapelier et réduit celui de cordonnier au raccommodage des chaussures, celui de ferblantier aux travaux de réparation. La confection des vêtements et la lingerie organisées en entreprises ont l'ait disparaître la plupart des tailleurs et une partie des couturières. La fabrication des meubles, des portes et des fenêtres a réduit le nombre des menuisiers. Le métier s'est partagé, la production est allée à la grande industrie, la vente des produits au commerce. Le travail d'artisan reste, sauf dans les très grandes villes, celui des industries d'alimentation travaillant pour la consommation immédiate, boulangers, charcutiers, pâtissiers, confiseurs ; des industries du vêtement, couturières et tailleurs, modistes, blanchisseuses ; des sabotiers ; du travail du bâtiment, maçons et charpentiers, menuisiers, serruriers. vitriers, peintres, plombiers ; des voituriers, maréchaux ferrants, bourreliers, charrons. Les artisans continuent à former presque toute la population industrielle des petites villes, des bourgs et des régions agricoles (le Midi, l'Ouest et les montagnes du Centre). Le recensement professionnel de 1906 n'indique par exemple dans la Dordogne (113.000 âmes, avec une population industrielle de 17 p. 100) que 13 professions occupant plus de 1.000 personnes : couture (5.486), maçonnerie (3.446), charpente (2.248), boulangerie (2.078), chaussure (1.893), tailleurs (1.639), menuiserie (1.624), ferronnerie (1.597), meunerie (1.563), lingerie (1.407), charbonniers (1.312), sabotiers (1.080) ; tous des métiers d'artisans, sauf la construction métallique (1.081). La tradition a conservé les procédés de travail anciens, modifiés par le perfectionnement des outils et l'usage de matières nouvelles. L'artisan a, dès l'adolescence, appris le métier en le pratiquant comme apprenti sous la direction d'un maître artisan auprès duquel il a vécu. L'apprentissage, consistant en relations personnelles, est devenu impossible à pratiquer dans les grands ateliers où l'apprenti vit, non plus avec le patron, mais avec des ouvriers salariés qui ne se soucient pas de lui enseigner le métier. Mais la crise de l'apprentissage, menaçante pour le recrutement de la grande industrie, a beaucoup moins atteint les métiers d'artisans. Les sociétés de Compagnons du Tour de France, recrutées dans 31 métiers, surtout du bâtiment, subsistaient encore en 1860 avec leurs insignes, leurs réunions secrètes, leurs organisations de secours, leurs épreuves d'initiation ; il n'en est resté au XXe siècle que des survivances dans quelques métiers. Les artisans ont perdu l'ancien esprit corporatif, sans entrer dans le syndicalisme moderne. Les artisans établis à demeure, souvent de père en fils, attachés à la ville où ils ont leur clientèle, vivent dans les mêmes conditions que les petits commerçants ; ils ont même nourriture, même costume, mêmes divertissements, même niveau social ; ils forment une même classe, unie par des mariages. Nés dans le pays, ils conservent l'aspect physique, le tempérament, l'accent des paysans de la région. Ils n'en diffèrent que par les habitudes acquises dans la vie urbaine, et par la pratique d'un travail plus spécialisé qui exige plus de précision ; leur parler est moins patois parce qu'ils ont plus d'occasions de parler français ; ils sont d'intelligence plus vive, plus sociables, plus accessibles au sentiment, plus sensibles à l'amour-propre professionnel, plus enclins au plaisir et à la dépense, plus ouverts aux innovations. Avec l'accroissement de l'aisance et la diffusion de l'instruction, leur genre de vie s'est rapproché de celui de la bourgeoisie commerçante, leurs femmes en ont pris le costume et les manières. Mais, sous ces dehors uniformes, ils conservent les caractères propres à chaque région. III. — LES OUVRIERS DE LA GRANDE INDUSTRIE. LA révolution résultant des progrès de la technique a bouleversé les proportions entre les différentes espèces d'ouvriers de la grande industrie, nom commun donné à tous les salariés qui fabriquent pour le compte d'un entrepreneur en gros des produits destinés à une clientèle inconnue. Les ouvriers à domicile, travaillant isolés, dans leur maison et à leurs heures, comme les artisans, mais pour le compte d'un fabricant qui commandait le travail, et en vendait le produit, formaient encore en 1860 la grande majorité dans plusieurs industries anciennes, le tissage de la toile, des étoffes de soie, et même de laine, la lingerie, la dentelle et la broderie, la ganterie, la coutellerie, l'horlogerie. Ils vivaient dans la condition la plus précaire, sans salaire régulier, exposés tantôt au chômage, tantôt au surmenage, suivant les hasards de la commande, soumis à l'arbitraire de l'entrepreneur qui leur distribuait le travail, en fixait la rémunération et en mesurait le produit. Le tissage à domicile, atteint, après la crise de la guerre de Sécession, par un dépérissement continu, a presque disparu de l'industrie du coton, de la laine, de la toile, et a fortement diminué clans la soierie. Le travail à domicile s'est conservé clans la coutellerie, la vannerie, la tabletterie, la fabrication des jouets, la taille des pierres précieuses. Il persiste, comme moyen d'exploiter la main-d'œuvre à bas prix des femmes, dans la lingerie et la confection pour le compte des grands magasins, dans la ganterie, la dentelle et la broderie, où il fournit un salaire d'appoint à des femmes vivant à la campagne. Dans les grandes villes où il constitue seul le revenu de l'ouvrière, il maintient le régime de salaire insuffisant, de travail illimité, de logement insalubre décrit par J. Simon sous l'Empire, que les Anglais appellent sweating system. La grande industrie a de plus en plus réuni les ouvriers dans l'atelier, la mine ou le chantier, sous une surveillance directe, avec des heures de travail fixes et un salaire à la journée ou à l'heure. Cotte concentration se mesure par les chiffres des recensements successifs. Le nombre moyen d'ouvriers par établissement n'était encore évalué en 1866 dans les industries les plus concentrées qu'à 84 dans la métallurgie, 21 dans les mines et carrières, 17,4 dans les industries chimiques ; il est monté en 1906 à 711 dans la métallurgie du fer, 449 dans les mines, 96 dans la verrerie ; l'augmentation a été rapide entre 1896 et 1906, clans les mines de houille de 857 à 984, dans les hauts fourneaux de 508 à 711. Le nombre des salariés dans l'industrie et les transports a monté, de 3 304.000 en 1896 à 3 871.000 en 1906, concentrés dans des établissements de plus en plus grands. On ne compte plus dans les petits établissements occupant de 1 à 10 personnes, en 1896 que 36 p. 100 des ouvriers, en 1906 que 32 p. 100 ; il y en a moins de 10 p. 100 dans la métallurgie, les textiles, la faïence, la verrerie et les industries récentes, gaz, alcool, sucre, explosifs, caoutchouc. Dans les établissements au-dessus de 100, le nombre d'ouvriers a monté, en dix ans, de 1.124.000 à 1.542.000. La concentration a été activée par l'emploi des machines, mais ne se confond pas avec le machinisme ; un très grand nombre des ouvriers réunis en grands établissements travaillent à la main avec des outils individuels. Le salaire, qui détermine les conditions de la vie matérielle des ouvriers, a varié dans un sens presque continu ; l'élévation des salaires a été générale, sauf pour les ouvriers du sucre, du tulle et les forgerons. Le travail est devenu de plus en plus régulier, la moyenne des jours de travail était au début du XXe siècle évaluée à 290 par an — le maximum à 327 dans les industries chimiques, le minimum à 255 dans la construction —, et le gain annuel moyen à 1.010 francs. Le nombre des chômeurs — connu approximativement depuis les études de l'Office du travail — a constamment diminué ; la moyenne annuelle est descendue de 9,4 p. 100 du total des ouvriers entre 1904 et 1908 à 5,2 en 1913, — dans la métallurgie de 3,7 à 2,5, dans les textiles de 7,7 à 4,1. La variation des salaires, ne pouvant être calculée exactement que si l'on connaît le total des salaires payés par an et le total des ouvriers et des journées de travail, n'est connue que pour les ouvriers des mines de charbon ; leur salaire moyen a monté de 2,50 en 1860, par une progression presque continue, jusqu'à un taux fixe de 3,58 vers 1881, puis à 4,82 en 1901, et à 5,19 en 1912. Pour les autres industries on en est réduit aux évaluations du salaire moyen faites par les maires des chefs-lieux, par l'Office du travail (depuis 1893), par les conseils de prudhommes (depuis 1896), et aux bordereaux de salaires payés par l'État et les villes aux ouvriers du bâtiment. Sur ces données, le salaire moyen en France chaque année a été calculé en faisant dans chacun des chefs-lieux la moyenne du salaire normal de 34 métiers choisis parmi les plus importants. Ainsi a été établie la courbe du salaire moyen ; on l'a exprimée en ramenant le salaire de l'année 1900 au nombre indice 100, auquel on compare le chiffre des autres années. Le salaire moyen, évalué en 1862 à 62, monte jusqu'à 75 en 1875, dépasse 90 en. 1890, et s'élève en 1910 jusqu'à 115 par une progression presque régulière. Le salaire étant évalué en argent, et le pouvoir d'achat de l'argent étant variable, c'est le rapport entre le salaire et les prix qui règle le niveau de vie réel. On en a étudié la variation en calculant la dépense totale annuelle, appelée le coût de la vie, d'après la quantité des articles de consommation habituelle consommée en un an. Le résultat de ces calculs — faits sur les prix de vente en gros, les prix de détail étant trop variés pour être réduits à une moyenne, — est que la dépense pour un ménage d'ouvriers de quatre personnes, en prenant pour nombre indice l'année 1900, s'élevait en 1858 à 125, atteignait un maximum de 135 en 1871, baissait jusqu'à 1888, remontait, puis descendait en 1902 à 90. Le coût de la vie, en supposant une consommation restée identique, a suivi la hausse des salaires jusqu'en 1875, puis a diminué jusqu'en 1905, s'écartant de plus en plus de la courbe des salaires. Le pouvoir d'achat du salaire a donc augmenté. Les ouvriers ont profité de ce que leurs ressources étaient accrues pour augmenter leurs dépenses et améliorer leur genre de vie. Le progrès, insensible avant 1860, devenu apparent avant la fin de l'Empire, s'est accéléré surtout depuis la reprise de l'activité industrielle vers la fin du siècle. La nourriture, devenue moins coûteuse depuis la baisse des denrées alimentaires après 1880, s'est rapprochée de plus en plus de celle de la bourgeoisie. Les produits fabriqués, ustensiles de ménage, meubles, objets d'art, offerts à bas prix dans les magasins, ont pénétré dans les intérieurs ouvriers. Le vêtement ouvrier a fait place à l'habillement de confection sur le modèle bourgeois, uniforme pour toutes les classes ; l'ouvrière a adopté le costume, la coiffure et la parure des dames, en même temps qu'elle s'habituait à être appelée Madame. L'ouvrier des grandes villes a partagé les divertissements de la bourgeoisie, les journaux, le café, le spectacle, les courses ; il a commencé même à se déplacer, à voyager en chemin de fer, à aller aux bains de mer. Le logement s'est beaucoup moins amélioré. Les ouvriers attachés à quelques grandes entreprises ont seuls bénéficié des habitations construites par les patrons pour être louées ou vendues à leur personnel, soit de petites maisons avec jardin dans le genre des cités ouvrières ; de Mulhouse, soit de logements dans de grands bâtiments neufs. Les familles ouvrières des villes industrielles ont continué de s'entasser dans les vieux logements étroits, mal aérés, mal éclairés, malpropres, malsains. Les pouvoirs des commissions d'hygiène n'ont suffi qu'à faire interdire quelques maisons scandaleusement insalubres l'indifférence de l'opinion française et la résignation des ouvriers ont laissé subsister un grand nombre de taudis ; en matière d'habitation ouvrière, la France est restée en retard sur les pays anglais et allemands. L'accroissement général de l'aisance s'est marqué par la décroissance des cas de dégénérescence provenant de surmenage, de déformation, d'alimentation insuffisante, par la diminution de la mortalité des enfants et de la proportion des conscrits réformés, par l'apparence de la population ouvrière devenue plus vigoureuse et plus alerte, malgré l'alcoolisme et la tuberculose. Tandis que les artisans sont disséminés presque également sur tout le territoire, en vue de la vente à la clientèle locale, les ouvriers de grande industrie sont agglomérés là où les fondateurs d'établissements ont été attirés par des conditions favorables à la production, proximité des matières premières ou bas prix de la main-d'œuvre. La répartition en a toujours été très inégale. La population ouvrière est restée concentrée, soit dans les régions industrielles du Nord et de l'Est au voisinage des pays de grande industrie, Belgique, Allemagne, Suisse, soit auprès des mines de houille et, de fer distribuées autour du Massif Central. La répartition en a été modifiée depuis 1860 par la création de nouvelles entreprises, l'accroissement inégal des anciennes et le déplacement des industries facilité par le bas prix du transport des matières[1]. La région du Nord est restée celle des plus grandes agglomérations et des plus grands établissements : en 1906, les ouvriers des mines de houille (63.000 dans le Pas-de-Calais, 29.000 dans le Nord) formaient plus de la moitié du total de la France (170.000) ; la grande métallurgie occupait 74.000 personnes. La proportion des ouvriers en laine s'élevait à 4,2 p. 100 de la population totale, celle des ouvriers en coton à 1 p. 100. — En Picardie, la population ouvrière a diminué dans la fabrication des étoffes et s'est accrue dans les industries à travail individuel en petits ateliers appropriées à l'ouvrier picard, adroit et indépendant : serrurerie dans le Vimeu, tabletterie, brosserie et vannerie dans l'Oise. La région lorraine, qui — sauf les grands établissements isolés de cristallerie et de faïence — ne pratiquait d'autre grande industrie que la fabrication du fer brut dans les forges chauffées au bois employant très peu d'ouvriers, est devenue la seconde région industrielle de France par les progrès techniques, qui ont permis d'utiliser le minerai phosphoreux de Lorraine ; par le transfert après 1871, dans les Vosges lorraines, des industries alsaciennes de filature, tissage, imprimerie, blanchisserie ; et des établissements métallurgiques de Mulhouse à Belfort. L'accroissement de la population ouvrière a été rapide dans les régions de mines de fer, de hauts fourneaux et de grands établissements de métallurgie du Berry, du Nivernais et du Bourbonnais, et le bassin houiller au pied du Morvan (Montchanin, Montceau et le Creusot). Il a été moindre dans la région de Lyon et de Saint-Étienne. Le tissage des étoffes de soie a émigré de Lyon dans les villages de la région. Les autres groupements ouvriers du Centre sont restés disséminés en industries locales. La seule région industrielle de l'Ouest, la Normandie, n'a maintenu qu'aux alentours de Rouen l'activité de la filature et du tissage de la laine et du coton. La décroissance de la population ouvrière a été rapide en basse Normandie, à Vire et à Condé, plus encore dans les pays du tissage des toiles de lin et de coton. L'industrie en croissance est la fabrication des chaussures : à Tours, et surtout à Fougères, où elle a été établie par un habitant revenu des États-Unis et opère avec des machines américaines louées. Le Midi n'a de grandes agglomérations ouvrières que dans la zone minière au pied du Massif Central, dans le Gard, l'Aveyron (Decazeville et Aubin), le Tarn à Carmaux et à Mazamet, où s'est créée l'industrie du délainage des peaux brutes, et dans les Pyrénées où se sont créées les fabriques de chaussures du Béarn et la menuiserie de Tarbes ; les industries locales très variées du Midi et les industries des grands ports n'occupent qu'un petit nombre d'ouvriers. Dans le Sud-Est, la population ouvrière, groupée surtout dans les environs de Grenoble, s'est accrue rapidement depuis le recensement de 1906, par l'installation de puissantes usines de force électrique dont l'énergie, transmise à distance. actionne les machines de la papeterie, du tissage et surtout de la grande construction métallique. Paris est resté le centre des industries artistiques qui exigent des ouvriers adroits, imprégnés de l'élégance parisienne traditionnelle qui fait la vogue de l'article de Paris et des industries de femmes. Le travail y est fait à la main ou à la machine individuelle à domicile ou en petits ateliers : les établissements de grande industrie mécanique se sont créés surtout dans la banlieue. IV. — L'ORCANISATION LE LA CLASSE OUVRIÈRE. UNE législation spéciale maintenait encore en 1860 les ouvriers français dans l'isolement et la dépendance et les empêchait d'améliorer leur condition ; ils se sont émancipés et groupés et ont obtenu une amélioration notable du travail et des salaires, due à la fois aux efforts des ouvriers, à l'intervention des pouvoirs publics, aux concessions volontaires des patrons. Dès l'Empire des lois ont aboli les restrictions et les inégalités légales imposées aux ouvriers. La loi de 1864, supprimant le délit de coalition, leur a donné la liberté de se concerter pour discuter avec le patron les conditions du travail et de se mettre en grève pour l'obliger à céder. Le privilège du patron d'être cru sur sa parole en cas de contestation a été aboli. L'obligation du livret a été abolie par la loi de 1890. Ainsi a été établie l'égalité légale entre patrons et ouvriers. La durée et l'organisation matérielle du travail étaient réglées uniquement par le contrat de travail établi par la seule volonté du patron sans restrictions ni contrôle ; la tradition d'économie de la bourgeoisie française empêchait la plupart des patrons d'abréger le temps d'un travail payé à la journée ou de taire une dépense pour l'hygiène ou la sécurité de leurs ouvriers : une série de lois sociales, imitées des pays de grande industrie, l'Angleterre et l'Allemagne, a protégé la santé des travailleurs. La loi de 1848 qui limitait la journée de travail dans toute la grande industrie n'ayant pas été appliquée, la législation ouvrière, renonçant à protéger les adultes, s'est limitée aux êtres réputés impuissants à se défendre. La loi de 1874 a interdit de faire travailler les enfants au-dessous de douze ans, et d'employer les femmes et les filles mineures à un travail de nuit ou dans les travaux souterrains des mines. La limitation de la journée de travail, rejetée par le Sénat en 1882, n'a été établie que par la loi de 1892 à dix heures pour les femmes, dix ou onze pour les mineurs de vingt et un ans dans les usines, manufactures, mines, carrières, ateliers. La loi de 1900 l'a étendue aux deux sexes dans tout établissement mixte. La journée de travail fixée par règlement patronal — suivant l'usage variable du métier, du temps et du lieu, — s'est abrégée peu à peu sous la pression de l'opinion et de l'agitation pour la journée de huit heures et par l'initiative des patrons, dans les grands établissements à travail mécanique, parce que la journée plus courte augmentait le rendement et diminuait les accidents. La législation sur la salubrité et la sécurité a commencé par les mines : la loi de 1890 a créé les délégués mineurs élus pour trois ans par les ouvriers, ayant le droit de visiter chaque mois tous les puits et de consigner leurs observations sur un registre transmis au Préfet : la moyenne annuelle des accidents par le grisou a diminué de 1883 à 1898 des neuf dixièmes. La loi de 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs a ordonné des mesures de propreté, d'éclairage, d'aération, de fourniture d'eau, et des précautions contre l'incendie et les accidents de machines ; le décret de 1894 a interdit de nettoyer ou réparer une machine en mouvement et de souffler du verre. La loi de 1898, prenant le contre-pied du principe antérieur, a déclaré le patron responsable de tout accident du travail à moins de prouver que l'ouvrier en a été cause volontairement ou par une faute lourde ; elle a mis à la charge du patron l'indemnité calculée d'après la gravité de l'accident et le salaire, deux tiers pour incapacité absolue et permanente de travail, la moitié pour incapacité partielle ou temporaire, en cas de mort une rente de un vingtième à la veuve, de un quinzième à un quarantième pour les orphelins. L'effet de la loi a été de faire assurer les risques par les patrons aux compagnies d'assurances. Le nombre des accidents déclarés a augmenté rapidement ; l'Office du travail l'évaluait en 1911 à 534.000, dont 105.000 dans le travail des métaux. Les retraites ouvrières, établies dès 1894 pour les mineurs, ont été étendues aux autres ouvriers par la loi de 1905, qui a fixé l'âge et un taux de retraite proportionné au salaire et à la durée des versements : la caisse est alimentée par une retenue sur le salaire de l'ouvrier, un versement égal du patron, une subvention de l'État. La loi de 1906 a rendu obligatoire le repos hebdomadaire d'une durée de vingt-quatre heures au minimum. — le dimanche sauf urgence ou autorisation du Préfet. Le changement le plus profond dans la vie des ouvriers s'est opéré par leur groupement. Les formes d'association proposées en 1848 avaient donné de faibles résultats, les associations coopératives de production, au nombre de 450 en 1914, avaient un total de membres inférieur à 20.000 ; les coopératives de consommation, beaucoup plus prospères, groupaient plus d'employés que d'ouvriers ; les sociétés de secours mutuel, remplies de membres de toutes les professions, n'intéressaient plus les ouvriers. La seule forme satisfaisante pour le sentiment ouvrier resta le groupement entre salariés, coalition temporaire de grève ou syndicat permanent. La grève. licite depuis 1864, devint un procédé de pression effectif sur le patron ; le syndicat professionnel, imité de la trade-union anglaise, d'abord toléré, rendu légal par la loi de 1884, devint l'organe de discussion des conditions du travail. Grève et syndicat se soutenaient réciproquement : les ouvriers, rapprochés par une grève spontanée, s'organisaient en syndicat, le syndicat préparait et dirigeait la grève. Ces unions, formées exclusivement d'ouvriers en opposition aux patrons, éveillaient un sentiment d'antagonisme qui s'exprima dans la formule socialiste de la lutte des classes ; la plupart des syndicats adhérèrent au socialisme, on les appela rouges. Quelques chefs de grands établissements tentèrent de leur opposer des syndicats d'ouvriers dociles ; celui de Montceau (1899) avait une bannière à gland jaune : le surnom de jaunes, donné par leurs adversaires, s'étendit à tous les syndicats sympathiques aux patrons eu opposition aux rouges. Une fédération nationale des jaunes, fondée en 1902, ne dura pas. Les syndicats socialistes n'eurent plus d'autres concurrents que les sociétés catholiques d'ouvriers. Les syndicats ouvriers s'étendirent à tous les métiers de la grande industrie ; le nombre en augmenta rapidement ; de 68 en 1.884 il s'éleva en 1893 à 1 926 et en 1913 à 5.046 ; le total des membres monta de 402.000 en 1893 à 1.027.000 en 1913 (dont 778.000 dans des syndicats de plus de 10.000). Le nombre des grèves n'a pas suivi une progression régulière, il a dépendu des crises de l'industrie. Depuis que l'Office du travail a commencé à les dénombrer, il s'est élevé d'une moyenne annuelle de 368, entre 1800 et 1893, avec une moyenne de 302 grévistes, à 1.073 en 1913, avec un nombre total de 220.000 ouvriers dans 8 479 établissements. Le total des journées perdues, évalué en 1893 à 2.850.000, n'équivalait qu'à un tiers de journée par an ; il avait baissé en 1913 à 2.223.000. La proportion des grèves terminées par le succès des ouvriers avait baissé de 25 p. 100 en 1898 à 11,63 en moyenne de 1903 à 1912, la proportion des échecs baissait aussi de 43 p. 100 à 36 ; les grèves se terminaient de plus en plus par un compromis. Depuis que la loi de 1892 avait créé une procédure d'arbitrage volontaire entre patrons et ouvriers, la moyenne des recours en conciliation avait été de 21 p. 100. La conscience de la solidarité entre tous les ouvriers, fortifiée et propagée par les syndicats, se manifestait par les grèves de solidarité faites pour soutenir des camarades d'un autre métier. Elle se créait des organes d'abord dans les unions de syndicats, les bourses du travail, puis les fédérations nationales de métiers (Livre, Métaux, Bâtiment), enfin dans la Confédération générale du travail qui, après des années de lente croissance, apparaissait en 1914 comme la représentation du prolétariat conscient et organisé. |