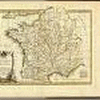HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE IV. — LES TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE JUSQU'EN 1914.
CHAPITRE III. — LA POPULATION AGRICOLE.
|
I. — TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL AGRICOLE. L'AGRICULTURE conservait en 1860 les pratiques traditionnelles : la jachère, le fumier, les près naturels et les pacages, les anciens outils de labourage, de moisson et de battage ; les procédés nouveaux n'avaient guère pénétré que dans les pays privilégiés du Nord. Les cultures industrielles, plantes textiles, mûrier, colza, olivier, qui exigeaient plus de soin, étaient plus prospères que le labour et l'élevage. Ces conditions du travail agricole furent bouleversées par deux révolutions, dans le commerce, et dans la technique. La révolution technique résulta du progrès de la mécanique, de la chimie et des sciences naturelles. Les machines agricoles remplacèrent peu à peu la faucille, le fléau et la faux : les enquêtes agricoles en évaluent l'accroissement entre 1862 et 1892 de 9.000 à 23.000 pour les moissonneuses, de 9.500 à 38.000 pour les faucheuses, de 10.000 à 52.000 pour les semoirs, de 100.000 à 231.000 pour les batteuses ; de 1392 à 1911, la valeur annuelle des machines importées de l'étranger s'est élevée de 5 millions et demi à 45. L'accroissement a porté plus sur la battaison et la moisson, que sur les semailles et le labour. La machine s'est généralisée après que la main-d'œuvre est devenue rare ; elle a été plutôt un expédient pour suppléer aux travailleurs qu'un procédé pour diminuer le travail ; n'étant employée qu'une petite partie de l'année, elle peut, moins que dans l'industrie, rendre des services qui compensent les frais des réparations, des déplacements et du salaire d'un personnel spécial. L'application des moteurs à essence au travail agricole est trop récente pour faire prévoir le succès de la motoculture. Mais les instruments de travail commodes, les outils américains (fourches, râteaux, bêches, herses), la charrue perfectionnée, les chars légers, l'écrémeuse danoise ont pénétré partout, supprimant le fléau et chassant la baratte à beurre, la faucille et l'araire du Midi. La production a été activée surtout par les engrais chimiques. La quantité en a été fortement accrue par l'exploitation des phosphates, par les scories de déphosphoration, provenant du traitement des minerais de fer phosphoreux, par l'importation des nitrates d'Amérique et des sels de potasse — l'importation des engrais chimiques a monté de 98.060 tonnes en 1892 à 239.000 en 1911 —. L'engrais chimique, s'adaptant suivant sa composition ou sa dose à tous les terrains et à toutes les plantes, a ouvert une perspective illimitée à la culture ; en permettant de cultiver plusieurs années de suite les mêmes plantes, il a accru le rendement moyen du froment à l'hectare de 14 hectolitres en 1862 à 18 et demi de 1905 à 1909. La culture des plantes fourragères (luzerne, trèfle, sainfoin, betterave), devenue phis méthodique, a permis l'accroissement illimité de l'élevage ; la sélection des semences, des tubercules et des plants a amélioré les produits. La sélection des reproducteurs a perfectionné le bétail et la volaille. Les connaissances techniques ont pénétré peu à peu dans la masse des cultivateurs par la diffusion de l'instruction et de la lecture, les conférences des professeurs d'agriculture départementaux, et surtout l'exemple des innovations réussies. Les paysans français, très défiants envers les théories agricoles et les résultats obtenus par les grandes exploitations, se sont montrés accessibles à l'expérience dans la mesure où elle s'adaptait aux conditions de leur travail. Ils ont choisi les innovations qui donnaient les résultats les mieux appropriés à leurs faibles capitaux et à leur petite exploitation : les outils américains, les machines à traction animale, l'écrémeuse. le pulvérisateur, les cultures fourragères, les espèces nouvelles de blé, de pomme de terre, de betterave. En même temps que la production augmentait par le progrès technique, la valeur des produits s'accroissait par le progrès des transports. Les chemins vicinaux facilitaient le transport des denrées et du bétail jusqu'aux petites gares, les chemins de fer leur ouvraient les marchés lointains. L'accroissement de la population des villes et des régions industrielles grossissait leur clientèle ; les ouvriers et les commerçants consommaient de plus en plus les produits jadis réservés à la bourgeoisie, viande, volaille, vin ordinaire. Les produits de luxe perdaient l'avantage que leur légèreté leur avait, donné sur les denrées de consommation courante. La technique a introduit dans l'agriculture la méthode du travail industriel : remplacer la main-d'œuvre par la machine, élever le rendement de la production en augmentant les frais, spécialiser la production dans une branche unique (légumes, fleurs, fruits, engraissage, laitage). Les progrès des transports ont rapproché l'agriculture du commerce ; elle a produit moins pour la consommation du cultivateur et les clients du marché local, davantage pour la vente, soit aux courtiers du commerce en gros, soit aux établissements industriels qui transforment ses produits, distilleries, brasseries, raffineries de sucre, minoteries, féculeries, confitureries, fabriques de conserves. Elle a travaillé en vue de la quantité plutôt que de la qualité, pour produire des denrées d'un type courant vendues sur les marchés lointains. Le cultivateur, entraîné dans le courant du commerce universel, est tombé sous la dépendance des spéculateurs, négociants en gros, transporteurs, fabricants, qui lui imposent leurs prix et leurs conditions ; il a subi les variations de cours et les méventes provenant de la concurrence universelle ; son sort a dépendu moins du produit de son travail personnel que des prix du marché du monde. L'agriculture s'est industrialisée et commercialisée. Le paysan a cessé d'être un producteur isolé et libre, il est entré dans la solidarité du régime capitaliste, mais beaucoup moins que l'ouvrier de la grande industrie. II. — LES TRANSFORMATIONS DES CULTURES. LA quantité des produits de l'agriculture a augmenté considérablement, bien que la population agricole ait diminué et que la quantité des terres cultivées ait peu changé : d'après les enquêtes. la surface ensemencée aurait diminué de 7.137.000 hectares en 1862 à 6.534.000 en 1910 ; l'agriculture est devenue plus intensive. L'accroissement a été interrompu par des crises partielles ou générales. Avant 1860, la sériciculture, localisée dans la région du Rhône, était bouleversée par les maladies du ver à soie ; la production diminuait depuis 1854, il fallait acheter à haut prix la graine de vers à soie du Japon, qui donnait une soie moins belle. On parvint (après 1870) à régénérer la race suivant la méthode de Pasteur par un choix des papillons reproducteurs examinés au microscope. Mais la concurrence des pays à main-d'œuvre à bas prix, l'Italie, l'Inde, la Chine, fit baisser les prix moyens de fr. 30 le kilo de cocons frais à 1 fr. 25 de 1876 à 1890, puis, après 1900, à 3 francs ou 3 fr. 30. Les cultivateurs français se détournèrent de l'élevage du ver à soie. La production totale, évaluée de 1862 à 1873 à 11 millions de kilos par an, retomba en 1891 à 7, puis, malgré la prime par kilo de cocons frais (de 0 fr. 50 en 1892 et 0 fr. 60 en 1898), à 6 millions en 1909. Les cultures industrielles de la Provence furent ruinées par la concurrence avec d'autres produits : la garance, qui donnait la teinture rouge pour les pantalons des soldats, fut remplacée par les couleurs d'aniline extraites de la houille ; l'huile d'olive, par les huiles d'arachides et de sésame (d'Afrique occidentale) ; le prix baissa au point que l'oliveraie, estimée vers 1860 entre 8.000 et 10.000 francs l'hectare, tomba au XXe siècle entre 2.000 et 1 500. La concurrence ruina les cultures du colza et des plantes textiles, lin et chanvre, pratiquées dans les régions d'agriculture avancée. La crise du vignoble fut beaucoup plus générale. L'oïdium, qui avait ravagé la vigne, était dès 1860 efficacement combattu par le soufre, et la récolte totale en vins dépassait les chiffres antérieurs : on l'évalua en 1863 à 63 millions d'hectolitres. Le phylloxéra, importé d'Amérique avec des plants américains dans les environs d'Avignon avant 1870, se propagea rapidement dans les terrains secs et légers, et finit entre 1880 et 1890 par détruire tous les vieux vignobles français ; la production du vin, évaluée en 1875 à 83 millions d'hectolitres, tomba à moins de 26 millions en 1879. Ni le sulfure de carbone, ni la replantation en vignes françaises n'arrêtèrent le mal ; l'immersion ne s'appliquait qu'aux terrains bas et exigeait une irrigation abondante. On finit par arracher toutes les vignes. Le vignoble fut reconstitué avec des plants américains résistant au phylloxéra sur lesquels on greffait la vigne française ; on le défendit par des solutions de sels de cuivre projetées par un pulvérisateur. Mais les dépenses très élevées imposèrent aux propriétaires une charge très lourde. L'étendue du vignoble français, évaluée en 1871 à 2.117.000 hectares, diminua, à 1.764.000 en 1891 et à 1.525.000 en 1914. Quand la vigne américaine plantée en plaine, d'un produit plus abondant, eut relevé le total de la récolte jusqu'à 66 millions d'hectolitres (en 1904), la viticulture souffrit d'une crise commerciale. La surproduction des vignobles de plaine, aggravée par le sucrage et la concurrence des vins étrangers et algériens, fit tomber les prix au-dessous de 10 francs l'hectolitre. La mévente des vins devint depuis 1900 une calamité sociale qui aboutit à des troubles politiques (voir livre II, chap. VIII). L'enquête de 1908 montra les propriétaires de vignobles grands ou petits dans toute la France chargés d'une dette hypothécaire très lourde, et le prix de la vigne en baisse beaucoup plus forte que celui des terres ; l'hectare ne valait plus en moyenne la moitié de ce qu'il valait en 1882, et, dans quelques pays du Sud-Ouest, la vigne ne trouvait plus d'acquéreurs. Le relèvement des prix après 1909 ne rendit pas au vignoble son ancienne prospérité. Les crises des cultures industrielles n'atteignaient guère que les régions méridionales. Les cultures alimentaires, qui formaient le fond de la production agricole, bénéficièrent depuis 1860 de la hausse des prix des denrées, qui se répercuta dans la hausse des prix de vente et de location des terres. Une enquête officielle sur les souffrances de l'agriculture, attribuées aux traités de commerce, constata un progrès (très inégal suivant les régions), l'accroissement du rendement moyen, l'élévation des salaires, l'amélioration de la nourriture et du vêtement, et ne signala à ce tableau d'autres ombres que la maladie du ver à soie et la baisse du prix des laines. Ce progrès fut arrêté, depuis 1881, par la concurrence des produits des pays lointains, surtout d'Amérique, les blés, les laines, le bétail, obtenus à très bas prix et importés par mer à peu de frais. La crise, générale en Europe, atteignit surtout les terres à blé autour de Paris ; on signala même sur les plateaux du Soissonnais des terres abandonnées. La diminution des bénéfices de la culture fit baisser brusquement la valeur des terres et le taux des fermages. L'évaluation du total des loyers agricoles, qui de 1851 à 1879 avait monté de 1.903 millions à 2 643, descendit en 1891 à 1981 millions. Le prix des denrées agricoles remonta vers la fin du XIXe siècle et la valeur des terres se releva lentement, mais l'enquête agricole de 1908 évaluait encore la dépréciation à un tiers pour les terres. La crise frappa surtout les propriétaires, en diminuant leurs revenus et la valeur de leurs immeubles. Les cultivateurs compensèrent leurs pertes sur la vente des denrées par la diminution des prix de fermage et d'achat des terres. Ils parvinrent même à retrouver des bénéfices supérieurs, soit en augmentant le rendement par une culture intensive et une sélection des semences, soit en produisant les denrées moins exposées à la concurrence des pays lointains, viande, lait, beurre, œufs, volaille, fromage, légumes, fruits et fleurs, dont la consommation augmenta rapidement dans les villes. Ils accrurent l'étendue des herbages, des cultures fourragères, luzerne, trèfle, sainfoin, betteraves, navets (dont la superficie passa de 7,6 millions d'hectares en 1886 à 15 millions en 1912) ; ils augmentèrent l'engraissage des porcs et des animaux de boucherie, et l'élevage des vaches laitières. Le nombre des animaux augmenta beaucoup moins que leur poids, leur valeur et leur rendement en viande et en lait. Les évaluations donnent, en millions de tètes, pour l'espèce bovine, 12,8 en 1862 et 14,3 en 1909, pour les porcs 6 en 1862 et 7,3 en 1909, pour l'espèce ovine 29,5 millions en 1862 et 47 en 1909. L'augmentation la plus rapide fut celle du jardinage dans les environs des grandes villes, et des primeurs, fleurs et fruits dans les pays à climat favorisé, côte de Provence, Vaucluse, presqu'île de Bretagne. La production de l'horticulture évaluée en 1902 à 200 millions avait passé en 1913 à 622. Une crise spéciale à la France provient de l'usage de distiller, soit les fruits de sa récolte, cerises ou prunes, soit les résidus du pressage, le marc de raisin ou le marc de cidre. La loi reconnaissait au bouilleur de cru — qui faisait distiller les produits de sa récolte — le droit de ne pas payer l'impôt sur l'alcool consommé par sa famille. Ce privilège, en empêchant les agents du fisc de contrôler la distillation, lui donnait le moyen de vendre son eau-de-vie sans acquitter les droits. L'Assemblée nationale soumit les bouilleurs de cru à la surveillance des agents et limita à 40 litres d'alcool pur la quantité exempte de droits (1872) ; puis elle l'établit le régime antérieur (1875). Le privilège, devenu impopulaire, fut supprimé par la loi de 1903, qui soumit les bouilleurs à la surveillance en limitant à 20 litres d'alcool pur la consommation exempte. Mais les députés du Midi viticole, effrayés par la mévente des vins, se joignirent au groupe des bouilleurs de cru à la Chambre, et firent passer un amendement à la loi des douzièmes provisoires (février 1906) qui dispensa les propriétaires de toute déclaration et les affranchit de l'exercice. Le déplacement du travail agricole, motivé par une interversion entre les bénéfices des deux espèces d'agriculture, a transformé la profession du cultivateur. Les cultures industrielles, jadis placées au premier rang, ont été dépréciées par la concurrence croissante sur le marché universel, qui a rendu les prix instables, et les bénéfices aléatoires. La primauté traditionnelle du blé dans l'exploitation agricole a été ébranlée ; la préférence est allée aux cultures fourragères et maraîchères, qui assurent un bénéfice plus régulier. Le paysan est devenu de moins en moins laboureur, de plus en plus éleveur, laitier, fromager, ce qui le rapproche du commerçant, ou jardinier, ce qui le rapproche de l'artisan. La femme, chargée du laitage et de la basse-cour, très souvent du jardinage, a pris un rôle plus actif, qui a augmenté son influence dans la maison. Cette transformation ne s'est pas opérée par un progrès spontané du travail, dû à l'initiative du cultivateur. Comme en tout autre temps, le peuple des campagnes a subi passivement l'action des villes, sources des innovations ; il a changé ses procédés de travail en suivant le progrès de la technique industrielle, il a changé ses cultures sous la pression de la concurrence commerciale. III. — LES TRANSFORMATIONS DANS LA VIE DES CAMPAGNES. LE chiffre de la population agricole n'est connu exactement que, depuis les recensements professionnels (de 1896 et 1906) ; les chiffres antérieurs ne sont ni sûrs ni comparables entre eux. Le total de la Population agricole y compris les familles était en 1861 de 19.800.000. Les recensements des individus directement occupés dans l'agriculture donnent 8.715.000 en 1906, et 8.517.000 (dont 3.226.000 femmes) en 1911. La proportion au total de la population française est allée toujours décroissant, de 53,7 p. 100 en 1866 à 47,1 en 1896 et 44,2 en 1911. Les différentes catégories de la population agricole ne sont connues que par les enquêtes agricoles ; mais l'évolution générale n'en est pas douteuse. Les grands propriétaires et les gros fermiers, entrepreneurs de culture qui dirigent de grandes exploitations sans prendre part au travail manuel, appartiennent, par leur genre de vie, leur éducation, leur condition sociale, à la classe des nobles ou des bourgeois. Le nombre, inconnu .officiellement, n'en est pas élevé, car les fermiers de grandes exploitations ne se trouvent guère qu'autour de Paris et dans l'Ouest où les gentilshommes vivent sur leurs terres une partie de l'année ; l'agriculteur exploitant en personne reste une exception, comme le montre le chiffre très faible des régisseurs (10.000 en 1862 et 16.000 en 1891). Bien que le nombre soit grand des familles vivant du revenu de leurs domaines, l'agriculture n'est guère pratiquée que par les travailleurs manuels qualifiés cultivateurs, confondus sous le nom commun de paysans, parce que, malgré une inégalité parfois très grande d'aisance, ils font ensemble les mêmes travaux, demeurent et mangent ensemble, et ont le même genre de vie. La classe des paysans propriétaires se réduit presque aux propriétaires cultivant exclusivement leurs terres. Le nombre en a peu augmenté : de 1.812.000 en 1862 à 2.199.000 en 1892. Il en faudrait défalquer les grands propriétaires et y ajouter les fermiers-propriétaires de Picardie ; mais aucun de ces deux nombres n'est élevé. L'enquête de 1908, résumant l'impression des professeurs d'agriculture, conclut qu'il y a eu légère augmentation. Le total des paysans propriétaires, probablement inférieur à 2 ½ millions, resterait fort au-dessous de l'opinion courante. La proportion la plus forte se trouve dans le Sud-Est et l'Est et dans les vallées des fleuves. Le nombre des fermiers (soit par bail écrit, soit par location verbale) semble avoir oscillé et s'être maintenu : de 1.034.000 en 1862 à 1.061.000 en 1892. Le nombre des métayers est en diminution, de 404.000 en 1862 à 344.000 en 1892 ; le métayage forme d'exploitation primitive imposée par la rareté du numéraire, reste limité à l'Ouest, au Sud-Ouest et au Bourbonnais. Ce sont les salariés qui ont le plus diminué depuis un demi-siècle, surtout pendant la crise agricole de 1882 à 1892 : les journaliers ont baissé de 2.002.000 en 1862 à 1.210.000 en 1892 ; ics domestiques, de 2.012.000 à 1.832.000 en 1892 et 864.000 en 1906. La dépopulation des campagnes s'est donc opérée par le départ des travailleurs qu'aucun intérêt n'attachait au sol ; les propriétaires et les fermiers sont restés sur la terre qu'ils exploitaient pour leur compte. L'exode rural des salariés a eu des motifs indiscutables : ils sont allés dans les villes où les attiraient des salaires plus élevés et plus réguliers, un travail moins pénible, une nourriture plus agréable, des divertissements plus fréquents ; le courant général qui porte l'homme à accroître son gain et ses plaisirs et à diminuer ses fatigues et ses privations les a menés vers les villes où étaient concentrés les emplois, les spectacles, les écoles, toutes les occasions de gain, d'amusement et d'instruction. Le mouvement a été activé par les chemins de fer qui facilitent le voyage, les journaux, les livres, les catalogues, les écoles, qui parlent au campagnard des choses de la ville, les lettres des parents ou des amis et les conversations avec les citadins en villégiature, qui vantent les charmes de la ville, le service militaire qui transplante les jeunes paysans dans les villes, la domesticité dans les familles bourgeoises qui y attire les jeunes filles et y retient les hommes libérés de l'armée. Les salariés, en quittant la campagne, n'ont abandonné qu'un travail de saison, excessif en été, insuffisant en hiver, des salaires bas, un logement misérable, une nourriture grossière, une vie monotone ; ils ont trouvé à la ville un niveau de vie plus élevée et un rendement supérieur de leur travail. Leur départ a fait disparaître les petites industries rurales et le tissage à la main qui les aidaient à passer la morte-saison agricole ; il n'a pas diminué la production ; la machine a remplacé l'homme. Si la batteuse a dépeuplé les campagnes, c'est en libérant le travail pour un emploi plus rémunérateur. La main-d'œuvre devenue plus coûteuse a été plus ménagée. La petite exploitation a tâché de se suffire avec le travail de la famille. La grande exploitation s'est organisée avec un petit personnel permanent de domestiques, complété au moment des récoltes par des ouvriers temporaires (saisonniers) venus des pays pauvres à population dense : dans la région parisienne des Belges, des Bretons et des Polonais, dans les vignobles du Midi des Espagnols et des Italiens. Le changement de proportions entre les catégories de cultivateurs a modifié les proportions entre les modes d'exploitation. L'enquête de 1909, conduite avec une tendance favorable à la petite exploitation, conclut qu'elle donne des bénéfices supérieurs à la grande dans 41 départements, égaux dans 9, inférieurs dans 16 (la plupart au Nord-Ouest). Si la grande exploitation a l'avantage d'un outillage supérieur, d'un personnel plus spécialisé, d'une meilleure instruction technique, d'un plus grand fond de roulement et de réserve pour acheter en gros et choisir le moment de vendre, elle dépend de la main-d'œuvre coûteuse de salariés, difficiles à recruter et à commander. La petite exploitation emploie la main-d'œuvre gratuite de la famille, et compense le défaut de capitaux et d'instruction par un travail assidu, l'ardeur au gain, l'attention à ne rien laisser perdre ; elle produit plus de bétail et emploie plus de fumier, elle réussit mieux dans les travaux qui exigent du soin, le jardinage, le laitage, la basse-cour. La moyenne exploitation, pratiquée surtout par des fermiers sur les terres des bourgeois, donne des résultats inférieurs. La petite propriété, combinée d'ordinaire avec la petite culture, s'est accrue en étendue dans 52 départements et n'a diminué que dans 5 ; la grande propriété diminuait ou restait stationnaire, sauf les hauts plateaux, les sables et les terrains de chasse devenus propriétés d'agrément. La population agricole n'évoluait donc ni vers la concentration de la propriété ni vers l'accroissement du prolétariat, mais plutôt vers la diffusion de la propriété et de l'aisance, et la diminution du nombre des salariés. La dépopulation des campagnes n'a pas abaissé le niveau de vie des cultivateurs ; la population en se desserrant s'est trouvée plus à l'aise. L'aisance s'est manifestée dans la vie matérielle, qui s'est notablement améliorée et rapprochée de celle de la ville. La nourriture est devenue plus variée et plus coûteuse ; le pain noir ou bis fait à la maison a été peu à peu remplacé par le pain blanc apporté de la boulangerie ; la viande et le vin sont entrés dans l'alimentation, même des femmes. Le boucher, le boulanger, l'épicier, le débitant de boissons ont étendu leur clientèle jusqu'au fond des campagnes. — L'habillement, la chaussure, la coiffure propres au paysan, la veste de droguet, la blouse, les sabots, le bonnet sont presque partout sortis lentement de l'usage ; les femmes ont adopté le costume, le chapeau, les parures, même les souliers à talons hauts des dames de la ville. Sauf les costumes locaux conservés en Bretagne et dans les Pyrénées, le vêtement s'est uniformisé. — Les procédés d'éclairage primitif ont été supplantés par la lampe au pétrole ; le poêle au charbon s'est ajouté aux combustibles locaux. — Le logement a moins changé : le paysan s'y intéresse peu et ne peut l'améliorer sans s'imposer la gêne d'une reconstruction les anciennes habitations sont demeurées ; et ont maintenu les formes et les matériaux d'architecture traditionnels dans chaque pays. Mais les toits de chaume ont été remplacés par l'ardoise ou la tuile, la terre battue par les planchers. L'ameublement s'est complété par des meubles, des poteries, des horloges, des ornements venus de la ville ; les lits clos ont presque disparu, sauf en Bretagne. L'isolement des paysans s'est atténué, l'association a pénétré dans les campagnes. Les propriétaires bourgeois en ont pris l'initiative ; à la loi de 1884 autorisant les syndicats ouvriers, ils ont fait ajouter un amendement : et agricoles et ont créé des syndicats agricoles où sont entrés les paysans. Le nombre total en 1910, d'après la statistique du Travail, était de 5.407 (le chiffre de 778.000 membres donné par l'annuaire parait trop élevé). Les promoteurs espéraient faire du syndicat agricole une école d'aide mutuelle et d'enseignement professionnel, une coopérative, un contre de placement et de patronage. Il s'est borné à l'achat en commun d'instruments agricoles ; d'engrais, de semences et de plants de vigne ; il est resté un magasin et n'a pas établi de liens personnels entre ses membres. D'autres formes d'associations, prospères en Allemagne et en Italie, ne se sont pas acclimatées en France : on ne comptait en 1910 que nO.000 adhérents aux caisses de crédit agricole. La seule forme française d'association a été la société coopérative pour la production et la vente du laitage : on en comptait 2.600 (en 1910), dont 1.800 sont les anciennes fruitières de l'Est, productrices de fromage. Les syndicats entre salariés, analogues aux syndicats ouvriers, ont été créés pour résister aux patrons, d'ordinaire à la suite d'une grève, et sont restés localisés dans les pays où les conditions du travail étaient exceptionnelles : dans les forêts du Cher et de la Nièvre en 1892, la Fédération des bûcherons qui n'avaient pu obtenir un salaire de 1 fr. 50, — en 1904 la Fédération agricole de la région du Midi, formée par les ouvriers des vignes du Languedoc, — en 1904 la Fédération des syndicats des métayers du Bourbonnais en lutte contre l'impôt colonique et les conditions arbitraires imposées par les fermiers généraux, — en 1907 les syndicats des résiniers des Landes créés après les grèves contre les propriétaires des bois de pins, — les syndicats des moissonneurs en Seine-et-Marne, — la Fédération horticole. Ces syndicats d'ouvriers agricoles (la statistique du Travail en comptait 628) étaient des groupements temporaires, nés de soulèvements passagers ; l'essai de les fédérer en une Union terrienne n'a pas abouti. La vie morale des campagnes s'est transformée, non par l'association entre campagnards, mais par l'imitation des villes. Les paysans ont abandonné peu à peu les usages, les divertissements, les sentiments traditionnels qui faisaient leur originalité, et ont pris modèle sur la société urbaine. La fête patronale a pris l'aspect banal d'une fête foraine. La vie intellectuelle locale s'est éteinte avec la disparition des veillées qui entretenaient la tradition ; la pensée a été de plus en plus modelée sur un type uniforme par l'école primaire, l'Église, le régiment et le journal. L'autorité de la famille s'est ébranlée, les enfants ont perdu le respect des vieux, les jeunes gens ont moins bien accepté de travailler pour le compte des parents ; la contrainte morale de l'opinion publique et de la religion s'est relâchée. Les vertus paysannes, l'amour de la terre, la passion de l'épargne, le besoin du travail, se sont affaiblies ; les dépenses de luxe se sont accrues, pour le tabac, l'alcool, le jeu, la toilette. Le cultivateur, devenu moins paysan et plus commerçant, moins enfantin et moins respectueux, plus clairvoyant et plus énergique, s'est rapproché, par les mœurs comme par la vie matérielle, de la petite bourgeoisie des villes. IV. — LES DIFFÉRENCES RÉGIONALES. LA population agricole, attachée au sol par son travail, maintenue dans les conditions de vie propres à chaque lieu, se perpétuant par des unions entre gens du même pays, a conservé plus purement que dans les villes les caractères distinctifs de chaque région ; c'est elle aujourd'hui qui montre le plus nettement les traits physiques et les tendances morales provenant de l'origine des habitants. Ce n'est pas qu'il subsiste en France aucune race formée par des individus semblables, pourvus chacun du même ensemble de traits permanents et héréditaires. Les anthropologistes qui ont tenté de classer les populations d'après la structure du corps, la forme du crâne, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, ont reconnu dans les Français des métis provenant de mélanges en proportions infiniment variées entre les races (ou variétés) communes à l'Europe. Partout en France la grande majorité consiste en individus de caractères indécis et mélangés ; l'ensemble de traits qui constitue le type du pays ne se trouve que dans une minorité, souvent petite, qu'on remarque parce qu'elle tranche sur la masse indistincte. Le caractère de la population d'une région ne se constate que sur la minorité qui en représente le type. C'est en ce sens seulement qu'on peut tenter de définir les différentes populations de France. La région du Nord (au sens large), grande plaine d'alluvions entre la côte et le massif des Ardennes, formée d'argile calcaire, profonde, humide et fertile — sauf les pays sablonneux et caillouteux des confins, — parsemée de grandes agglomérations industrielles, région d'agriculture intensive la plus avancée de France, est habitée par une population grande, fortement charpentée. avec une notable proportion de cheveux blonds, d'yeux bleus ou gris, de teints clairs caractéristiques de la race nordique, population laborieuse et entreprenante, paisible et silencieuse dans le Nord, violente ou frondeuse en Picardie. Elle parle le dialecte picard, sauf en Flandre où se conserve le flamand, langue germanique. La terre, devenue propriété des bourgeois, était cultivée par des fermiers, dans le Nord en petites exploitations louées à très haut prix pour une culture intensive, — en Picardie en exploitations d'étendue moyenne cultivées en céréales ou en betteraves par un paysan aisé propriétaire de son manoir, de son jardin et de quelques terres qu'il complète en affermant des parcelles par un marché de terres ; — au voisinage de Paris (Valois, Soissonnais), en grands domaines affermés pour la culture du blé ou l'élevage en grand à des entrepreneurs qui emploient des salariés et embauchent pour la saison des ouvriers ambulants. La révolution de la vie agricole y a produit des effets rapides et profonds ; la facilité des transports par les routes et les chemins de fer d'intérêt local — dans un pays où le sol argileux et détrempé entravait les communications, — a permis d'amener les engrais pour la culture intensive et d'exporter les produits. Les machines agricoles, même les charrues à vapeur, donnant tout leur effet utile en terrain plat et dans des terres très fortes, sont devenues d'usage général et ont accru le rendement en diminuant la main-d'œuvre. Le progrès de la technique a permis de surmonter les crises produites dans la culture du lin par la concurrence du coton, dans la culture du colza par la concurrence du pétrole et des huiles d'Afrique, dans l'élevage du mouton par la concurrence de l'Australie, qui avait fait tomber le prix de la laine de 3 fr. 50 à 1 franc le kilo ; après 1882, la crise du blé par la concurrence de l'Amérique, après 1884 la crise de la betterave par la concurrence de l'Allemagne. Le colza et le lin ont été abandonnés, sauf en Flandre ; la culture du blé, améliorée par les engrais phosphatés et la sélection des semences, a accru le rendement jusqu'à 35 et 40 hectolitres à l'hectare ; la culture de la betterave a été renouvelée par des espèces allemandes plus riches en sucre : le rendement moyen par tonne de betteraves a monté de 47 kilos en 1881 à 117 en 1899. Les éleveurs de mouton ont élevé des animaux de grande espèce (flamande ou anglaise) destinés à produire de la viande plutôt que de la laine, et les ont nourris à l'étable avec des plantes fourragères et de la pulpe de betterave. La population agricole est restée dense dans le pays de petites fermes, et s'est clairsemée dans la région des moyennes et des grosses exploitations, où il est demeuré surtout des paysans aisés travaillant avec leur famille, et pourvus d'un outillage moderne. La région de l'Est, vaste plateau accidenté incliné vers Paris, bordé par les massifs au sol maigre des Ardennes, des Vosges et du Jura, peu fertile, sauf les vallées, et de climat extrême, couvert en partie de forêts et de pacages, doit sa prospérité au travail humain plus qu'à la nature. La population paraît un mélange d'origines différentes. Dans les montagnes (Vosges et Jura) se trouve en forte proportion un type brun, de taille moyenne, plutôt brachycéphale, apparenté à la race dite alpine du centre de l'Europe. La population, beaucoup plus nombreuse, du pays plat, est d'une taille supérieure à la moyenne de la France et présente une forte proportion d'individus à large ossature, crâne dolichocéphale, extrémités grandes, yeux et cheveux de nuance claire, apparentés à deux rameaux de la race nordique, les Francs d'Austrasie en Lorraine et dans les Ardennes, plus mélangés et moins caractérisés en Champagne, les Burgondes en Bourgogne et en Franche-Comté. Ces peuples, vigoureux, capables de travail assidu et de passions fortes, souvent enclins à la boisson, diffèrent par leurs habitudes sociales : réservés et silencieux en Lorraine, expansifs et gouailleurs en Bourgogne, sociables et moqueurs en Champagne ; leurs parlers sont différents, le champenois est du français faiblement patoisant, le lorrain et le bourguignon sont deux dialectes de langue française inintelligibles aux Français. Les terres à blé et les pâturages d'ordinaire appartenant aux bourgeois, sont exploités en fermes de moyenne étendue, sauf le voisinage de Paris (la Brie) organisé en grosses fermes. Les terres maraîchères des vallées ou des environs des villes et les vergers à fruits (prunes et cerises) sont exploités par les propriétaires paysans. Il s'est conservé une survivance de l'assolement triennal obligatoire qui a été jusqu'au XIXe siècle le régime de l'Europe du Nord et de la France jusqu'à la Loire et à la Saône ; le territoire de tout le village est réparti en plusieurs quartiers (soles), découpés chacun en bandes longues et minces dont la longueur (200 mètres) représente le chemin fait par la charrue avant qu'on fasse tourner les bœufs. Chaque domaine se compose de plusieurs bandes dispersées dans les divers quartiers ; chaque cultivateur a ses terres enclavées entre les autres ; tous étaient obligés de faire chaque année la même culture et de laisser après la récolte pâturer sur leurs terres le bétail de toute la commune. La loi de 1837, en abolissant ces restrictions, avait laissé au conseil général du département le pouvoir de maintenir le droit de vaine pâture. Là où il avait été maintenu, en Lorraine. en Haute-Marne et en Haute-Saône, le propriétaire, gêné par la dispersion et l'étroitesse de ses parcelles, était resté enchaîné aux vieux procédés de culture, empêché par l'absence de clôture d'adopter les cultures fourragères et d'augmenter son bétail. Ce régime a retardé le progrès de la culture et de l'élevage. La vigne plantée sur les coteaux, d'un produit peu abondant et aléatoire dans ce climat rude, devait sa prospérité à sa vieille réputation : les célèbres vins de Champagne et de Bourgogne, produits de vignobles de faible surface (60.000 hectares près de Reims et les crus de la Côte), avaient créé des centres puissants de commerce qui absorbaient la production des vignes sur de larges étendues ; les vins du Jura étaient recherchés par les consommateurs du pays. Les vignerons, petits propriétaires en Champagne, en Lorraine, dans le Jura et en Basse-Bourgogne, journaliers dans la Côte, se rapprochaient des artisans par leur genre de vie. Les vignobles détruits par le phylloxera ont été reconstitués, sauf près de Toul où l'on a renoncé à la vigne ; mais les vignerons propriétaires sont restés grevés d'une dette hypothécaire et en Champagne sont devenus dépendants des grands commerçants. La très forte baisse de prix des terres et des fermages depuis 1882 s'est consolidée. La dépopulation s'est aggravée dans les pays peu fertiles de la Haute-Marne et de la Haute-Saône, et partout la main-d'œuvre s'est raréfiée au point de rendre difficile le travail agricole. La culture n'est redevenue prospère qu'au voisinage de Paris et des nouveaux centres industriels de Lorraine. L'élevage, qui a besoin de peu de main-d'œuvre, a profité depuis 1905 de la hausse des prix du bétail ; il a accru ses bénéfices, surtout par le laitage. La fabrication du fromage s'est organisée en industrie technique dans la Brie ; la production du Gérardmer dans les Vosges, du Gruyère dans le Jura continue sous la forme ancienne de la fruitière coopérative, qui recueille le lait chez les éleveurs, fabrique le fromage et répartit entre eux les produits. La région de l'Ouest (au sens large), pays accidenté de faible altitude à climat très tempéré, arrosé par des pluies fréquentes, s'étend en bordure de la mer depuis la Picardie jusqu'à la Gironde, et se termine de trois côtés par des plaines de sédiments, au nord le Vexin, le plateau crayeux de Caux et la plaine de Caen, à l'est la Beauce, au sud-ouest la plaine du Poitou et le terrain bas de la Charente. La plus grande partie, formée d'un sol maigre de schistes ou de granit, est partagée en prairies naturelles et en champs séparés par des haies ou des talus épais (fossés) plantés d'arbres, donnant au pays un aspect boisé, d'où le nom de bocage. Elle est coupée par la large vallée d'alluvions de la Loire, bordée de coteaux. La population, disséminée dans le Bocage, concentrée en gros villages dans les plaines, présente un mélange très varié de deux types très nettement différents, qui semblent provenir de deux origines. Le type normand, de haute taille, fortement charpenté, aux extrémités grandes, dolichocéphale, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, au teint coloré, fréquent en Normandie (surtout dans le pays de Caux et le Calvados), là où se trouvent les noms de lieu danois, est le plus nordique de tous les types de France, et parait de provenance scandinave. Il est joint à la vigueur physique, à une parole lente et à un accent traînant, à un caractère avisé, entreprenant, processif, traditionaliste, à la passion du gain, au penchant à la boisson. Le parler normand est un dialecte du français. Ces caractères se retrouvent atténués dans les pays voisins, le Vexin et la Beauce à l'est, le Perche et le Maine au sud, le Cotentin et la Bretagne française, qui a un parler intermédiaire entre le normand et le français de la Loire. L'autre type de l'Ouest, à taille moyenne, structure mince, attaches fines, extrémités petites. cheveux bruns, yeux bruns ou gris, le plus voisin de la moyenne de la France, passe à l'étranger pour le type français ; c'est aussi le plus fréquent chez les Bretons de langue celtique venus de Grande-Bretagne, qui diffèrent peu des populations de la Bretagne française. C'est un peuple sédentaire et pacifique, d'intelligence vive et claire, de parole facile, sans fortes passions, travaillant régulièrement de façon modérée, aimant le plaisir sans excès. Sauf la Bretagne. où s'est conservée une langue celtique parente du gallois, les parlers de l'Ouest sont du français dégradé en patois locaux, élégant et pur en Touraine. Au temps où les cultures dépendaient de la nature du sol, la Normandie. la plus riche région agricole de France, cultivait le froment et le colza. et élevait les bœufs à l'engraissage et les vaches laitières dans les herbages plantureux d'où venaient les fromages réputés de Gournay (en Bray), de Livarot, du pays d'Auge ; les vergers de pommiers produisaient le cidre devenu la boisson locale. Les herbages du Maine et du Perche servaient à l'élevage du cheval. Les terrains maigres de l'Ouest produisaient le seigle et le sarrasin. sauf la zone de Bretagne voisine de la mer, la ceinture dorée où la culture du froment prospérait grâce aux amendements de calcaires marins. Les plaines calcaires, Vexin, Beauce, plaine de Caen, Poitou, étaient cultivées en froment. La vallée fertile de la Loire, surnommée le Jardin de la France, pays de cuisine fine, de châteaux et de villégiatures, était réputée pour ses fruits et ses légumes ; ses coteaux produisaient des vins blancs légers. Les vins de la Saintonge, plus alcooliques, servaient à distiller la célèbre eau-de-vie de Cognac. Le Poitou élevait, surtout pour la vente en Espagne, le mulet produit de croisement du baudet, âne de grande espèce, avec la jument mulassière. Il restait des étendues désertes, les landes de Bretagne, les marais de Sologne, la Brande. La terre, propriété des bourgeois ou des gentilshommes, restait partagée en exploitations d'une étendue moyenne (10 à 20 hectares), données en fermage dans les terres à froment et les herbages, en métayage dans les pays de Bocage moins fertiles, de Bretagne, du Maine, et du Poitou. Les petits propriétaires étaient concentrés surtout dans les cultures maraîchères et les vignobles de la Loire, le pays de Léon où se pratiquait l'élevage du cheval, les îles de l'Océan, la plaine du Poitou et les vignobles de Saintonge. La région de l'Ouest a profité plus qu'aucune autre des progrès de la technique et des transports et de la hausse des prix. Les crises agricoles n'en ont atteint que quelques parties, et de façon temporaire. En Normandie, la hausse des prix des terres résultant de celle du blé, de l'huile et de la viande a été arrêtée vers 1880, et la population rurale a diminué rapidement. Mais la richesse n'a pas décru. Les champs ont été transformés en herbages, n'exigeant pas de main-d'œuvre, et nourrissant un bétail de choix ; l'agriculture a maintenu ses bénéfices en vendant à Paris et en Angleterre des produits de grand luxe, beurre, fromage, œufs, volaille, à des prix très élevés. L'usage de l'alcool (extrait du marc de cidre) s'est étendu aux femmes et même aux enfants, et menace de ruiner la vigoureuse race normande. Les herbages du Perche et du Maine ont accru leur valeur par l'engraissage du bœuf de boucherie et l'élevage du fort cheval de trait (percheron). La culture des plantes fourragères, du chou et de la betterave, considérablement accrue, a beaucoup augmenté l'élevage, aux confins de la Beauce, en Haute-Bretagne, en Poitou. La culture du froment en Poitou, très médiocre avant 1860, est devenue prospère par un travail très soigné et l'emploi des engrais qui a permis un rendement de 35 hectolitres à l'hectare. Le vignoble détruit par le phylloxera a été reconstitué sur les coteaux de la Loire ; en Charente, après une tentative vaine, les petits propriétaires l'ont remplacé par la culture fourragère pour l'élevage des vaches laitières. L'élevage du mulet, abandonné presque partout après la baisse des prix, a été remplacé par l'élevage des vaches de la race de Parthenay. Une coopérative pour la fabrication et la vente en gros du beurre, créée en 1878 par 40 associés paysans, a donné l'exemple suivi dans la région' : chaque laiterie envoie prendre le lait dans les maisons et le transforme en beurre qu'on expédie à Paris ; le bénéfice se partage suivant le nombre de vaches. Les laiteries se sont fédérées en une Association des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou, qui, en 1908, avait 70.000 associés. L'abaissement du prix des transports a facilité la pratique du chaulage qui, en introduisant le calcaire dans les terrains maigres du Bocage, a étendu la culture du froment (en Mayenne). Il a amené l'emploi des engrais chimiques dans les parties de la Bretagne favorisées par leur climat pour la culture des légumes et des primeurs, et a propagé l'usage des machines agricoles adaptées à la petite culture. Le prix des terres après la hausse générale s'est maintenu, il a même haussé dans les pays de culture maraîchère intensive. Le paysan est devenu plus aisé, en conservant son genre de vie traditionnel, les coiffures des femmes en Bretagne et même les costumes locaux dans le Finistère. La natalité en Bretagne est restée élevée ; la population agricole a continué de s'accroître, atteignant une densité très forte en pays de culture intensive ; les Bretons des pays pauvres s'en vont au loin pour les travaux de saison. La population agricole de l'Ouest, ayant profité du climat pour augmenter les productions en hausse (le laitage, et le jardinage), a amélioré, sans grands efforts, ses procédés de travail et sa condition. Le paysan a bénéficié de la baisse du prix des terres et de la mise en vente par parcelles des domaines des grands propriétaires ruinés ; il est devenu plus indépendant. Les journaliers ont beaucoup diminué. Les petits propriétaires ont augmenté en nombre, le prix des terres cultivées par eux n'a pas baissé. La petite exploitation est nettement supérieure à la grande en rendement brut et en bénéfice net. La région du Centre consiste en un plateau accidenté incliné au nord-ouest vers la Loire, partagé par une chaîne volcanique et, appuyé sur des versants en pente rapide, à l'est vers la Saône et le Rhône. au sud vers la plaine du Languedoc, à l'ouest vers la Dordogne ; le climat, plus régulier sur le versant atlantique, est assez humide pour les prairies, assez chaud pour les fruits. La population, presque toute disséminée, sauf dans la partie nord, est en majorité de taille moyenne et de structure mince, avec des extrémités fines, des yeux et des cheveux brun clair, semblable à celle de l'Ouest, dont elle se distingue à peine dans la région de la moyenne Loire, — plus grande, plus massive, de couleurs plus claires au voisinage de la Bourgogne, en Nivernais, Charolais, Mâconnais, plus fine et de teint plus clair à l'ouest, en Haut-Limousin, — plus lourde, plus sombre de couleur, de peau plus brune en Auvergne, où l'on a voulu voir les restes d'un peuple préhistorique. Dans les montagnes, la population est laborieuse, patiente, économe, prudente, sobre, d'esprit positif, indifférente aux arts ; elle est plus hardie aux abords de la Bourgogne, plus élégante, plus indolente, plus littéraire du côté de la Loire. — Le parler est un français patoisant dans le pays de la Loire (Berry, Nivernais, Bourbonnais), un dialecte intermédiaire entre le français et la langue d'oc en Lyonnais et Forez ; dans le Massif Central, depuis le Rhône jusqu'au Poitou, c'est un dialecte roman méridional, le limousin. La plus grande partie des terres est constituée en domaines d'une étendue moyenne (15 à 30 hectares), propriétés de bourgeois exploitées par un fermier (à bail ou à location verbale). Le métayage s'était conservé en Beaujolais et Lyonnais pour la vigne, combiné avec la possession des prés, et en Bourbonnais, où le grand propriétaire, souvent un noble, affermait son domaine à un fermier général qui le partageait en métairies (de 20 à 40 hectares) pour l'élevage du bétail. Les paysans propriétaires étaient nombreux en Morvan et dans les pays de petite culture intensive, les vergers du Berry, les limagnes d'Auvergne, les vignobles des coteaux de la Loire, de la Saône et du Rhône, et les vallées d'alluvions. La population, devenue trop dense dans les pays pauvres des montagnes, pratiquait l'émigration temporaire ; les Limousins allaient à Paris ou à Lyon comme maçons, les Auvergnats à Paris comme charbonniers ou en Espagne comme marchands de parapluies, les femmes du Morvan à Paris comme nourrices. La nature du sol avait déterminé les cultures. Le froment était réduit aux vallées de la Loire et de la Saône et aux petites plaines d'alluvions d'Auvergne. Dans les terrains granitiques légers du Massif Central et du Morvan, le seigle était cultivé en terrasses soutenues par des murs en pierres sèches, alternant avec la pomme de terre employée pour l'engraissage des porcs. Les vignes occupaient les coteaux pierreux en bordure des fleuves ; la culture des fruits, pommes, poires, pêches, abricots, se pratiquait en Berry et dans la Limagne de Clermont ; les versants est et sud du Massif portaient sur les pentes fraîches les châtaigniers, dans les fonds de vallées les noyers qui donnaient l'huile de noix. Les herbages humides du Charolais, du Nivernais, du Bourbonnais, du Morvan, nourrissaient le bétail de boucherie et les bœufs de labour ; les pâturages naturels de la haute montagne et les prés irrigués par des rigoles aménagées le long des torrents servaient surtout à produire le beurre et les fromages. Il restait de vastes étendues incultes, les forêts du Morvan exploitées par les bâcherons. ; les pacages du Berry et les bruyères du Limousin abandonnés aux moutons, les pentes arides couvertes de broussailles ou de taillis de chênes. Le progrès agricole s'est fait ici beaucoup plus par la transformation commerciale du marché que par le perfectionnement de la production. Ces pays d'accès difficile ont profité des facilités de transport et de la hausse des prix. L'aisance du paysan a beaucoup augmenté dans les pays pauvres des montagnes, en Morvan où le chaulage a permis la culture du froment, et sur les versants du Massif Central, où le débouché ouvert par les chemins de fer a activé l'élevage du porc et la production du beurre, du fromage, des pommes, des marrons de Lyon. Les prix des terres et des fermages, après avoir monté jusqu'en 1880, ont baissé fortement et rie se sont pas relevés ; la population des montagnes a rapidement diminué par l'émigration. L'outillage agricole s'est amélioré lentement : le terrain trop accidenté convient mal aux machines, et c'est récemment que la baratte à beurre a été remplacée par l'écrémeuse danoise. Les régions planes de la Loire et du Cher et les pays d'élevage du bœuf ont progressé à la façon de l'Ouest. Les pays de vignoble, après avoir été enrichis par le haut prix des vins, ont été éprouvés depuis 1890 par la destruction de la vigne, puis par la reconstitution et la mévente qui a laissé les propriétaires endettés. Le nombre des paysans propriétaires a un peu augmenté — sauf en Limagne où ils étaient devenus trop nombreux pour un sol trop morcelé, et en Lozère où, depuis la maladie du châtaignier, on a signalé des terres abandonnées. Le Midi (nom commun des pays de climat chaud depuis l'océan jusqu'à l'Italie) comprend trois régions, le Sud-Ouest océanique, le Languedoc méditerranéen, la Provence, formées de grandes plaines d'alluvions terminées sur les deux mers par des zones de sables ou de marais, appuyées au versant en pente rapide des Pyrénées et aux premières pentes des Alpes et du Massif Central. La population, nettement différente de ses voisines du Nord par l'aspect et le tempérament, présente (outre les Corses) cinq types localisés, qui semblent provenir de peuples différents de la race méditerranéenne. Au Sud-Ouest, pays des Aquitains antiques, les Gascons, Landais, Béarnais, petits, robustes, agiles, aux extrémités fines, aux yeux et aux cheveux noirs ou brun foncé, à la peau brune, sont d'intelligence vive, de parole facile, sobres, médiocrement laborieux, volontiers hâbleurs ; ces caractères s'atténuent dans les montagnes. — A l'extrémité ouest des Pyrénées, les Basques, laborieux, sévères, silencieux, perpétuent, avec leur langue d'origine inconnue, un type de plais grande taille dont le trait caractéristique est la minceur du nez. — Sur la Méditerranée, les Catalans se distinguent par une couleur plus foncée et un caractère laborieux, entreprenant et violent. — La population de la plaine entre les Pyrénées et le Rhône (le Languedoc), de chevelure plus noire, de structure plus lourde, moins agile, moins vive d'esprit, semble mélangée d'anciens peuples du Massif. — Entre le Rhône et les Alpes, la population de Provence, petite, aux extrémités fines, au teint très brun, aux mouvements vifs et à la parole rapide, semble parente de celle de la côte de Gênes. Sauf la vieille langue basque étrangère à la famille indo-européenne, tout le Midi parle des dialectes romans, le gascon, le catalan, le languedocien, le provençal, plus proches de l'espagnol ou de l'italien que du français ; le corse et le niçois sont des dialectes de l'italien. La plus grande partie des terres était la propriété des gentilshommes ou des bourgeois. Le régime habituel était, en Provence, le fermage, — dans le Sud-Ouest, du Périgord aux Pyrénées, le métayage, pratiqué en Languedoc au moyen du maitre-valet, régisseur paysan payé en nature. Les grands propriétaires de vignobles en Bordelais et en Languedoc employaient des journaliers. Les paysans propriétaires étaient nombreux en pays basque, dans les régions d'élevage des Pyrénées, dans les cultures intensives des vallées, dans le vignoble et sur les coteaux à fruits de Provence. La distribution très ancienne des cultures avait dépendu du sol et du climat. Les coteaux et les sables du Médoc produisaient. les vins de Bordeaux, les graviers au bas des Pyrénées donnaient un vin distillé pour l'eau-de-vie d'Armagnac. Les plaines de sédiments calcaires se partageaient entre la culture du froment et les plantes fourragères qui suppléaient aux prés dans ce climat trop sec ; les vallées fertiles étaient exploitées en cultures intensives, prune, raisin, tabac, lin et chanvre. Les vignes de plaine donnaient les vins très alcooliques du Roussillon et du Languedoc, et les vins doux fabriqués à Cette. La Provence cultivait sur les coteaux maigres les pêchers, les amandiers, les figuiers, — dans les terrains abrités, l'oranger et l'olivier et les champs de fleurs destinés à la parfumerie, — dans la plaine du Rhône la garance et le mûrier. Les montagnes servaient à l'élevage des vaches sur le versant océanique en Béarn et pays basque, du cheval dans le pays de Tarbes, du mouton dans les régions sèches des Pyrénées et des Alpes ; la chèvre était le bétail de la Corse et des pacages arides. Il restait des étendues désertes, les Landes au sol imperméable et marécageux, les Causses arides ; la Crau où les troupeaux transhumants pâturaient l'hiver ; les monts des Mores couverts de forêts. Les cultures qui faisaient la richesse agricole du Midi ont subi l'effet des crises de concurrence ; le lin, la garance, la soie ont été abandonnés en Vaucluse ; en Provence, les oliveraies sont tombées au quart de leur valeur, et la culture des arbres fruitiers a déchu au point de réduire les petits propriétaires à se faire journaliers. La production abondante des vignes de plaine, combinée avec la hausse du prix des vins, avait jusqu'en 1880 amené en Languedoc une richesse soudaine qui se manifestait par les dépenses de luxe extravagantes des vignerons. La destruction de la vigne, les dépenses de reconstitution, puis la mévente des vins ont appauvri et endetté les propriétaires et fait baisser fortement le prix du vignoble ; il a remonté lentement avec la hausse des vins ; mais beaucoup de petits propriétaires avaient vendu et émigré. Les grands propriétaires assez riches pour résister à la crise ont agrandi leurs domaines, mais la diminution de la main-d'œuvre a aggravé leurs frais, les journaliers du pays se sont mis en grève et ont créé des syndicats socialistes pour obtenir le relèvement des salaires et la réduction de la journée de travail. Le vignoble du Bordelais, d'un produit moins abondant mais plus recherché, a connu la même succession d'enrichissements et d'appauvrissements, mais moins intenses ; il est resté gêné par la rareté de la main-d'œuvre. Le vignoble de l'Armagnac ne s'est pas reconstitué. La plaine du Sud-Ouest, prolongée par les pentes méridionales du Massif Central, a eu d'abord, pendant la hausse des terres, un accroissement du rendement du blé par les engrais chimiques et du bétail par l'extension des cultures fourragères, puis, sans crise aiguë, elle s'est dépeuplée et la main-d'œuvre est devenue insuffisante ; l'enquête de 1908 y signale une très forte baisse du prix des terres, et, dans le Lot et le Gers, des terres en friches. Pendant que les régions riches du Midi s'appauvrissaient par la décadence des anciennes cultures, d'autres s'enrichissaient par l'effet de conditions nouvelles. La plantation des pins transformait le désert marécageux des Landes en une exploitation prospère de la résine récoltée au pied des arbres et du bois employé en poteaux de mines et de télégraphe ; il se créait une population de résiniers opérant en métayage. Les régions humides des Pyrénées bénéficiaient des facilités de transport qui faisaient prospérer l'élevage des vaches et du cheval, la création des stations balnéaires et l'afflux des touristes faisaient hausser les prix et les salaires ; les petits propriétaires augmentaient en nombre, bien que la population diminuât par l'émigration vers les villes et l'Amérique du Sud. En Provence l'irrigation par les canaux de la Durance transformait peu à peu la Crau en une terre maraîchère. La plaine du Rhône, profitant de son climat, s'aménageait pour la culture intensive des légumes de primeurs avec un outillage moderne de châssis, de bâches, de chaudières et de tuyaux pour réchauffer le sol ; le prix de la terre montait de 50 francs l'hectare à 6.000, les journaliers devenaient des propriétaires jardiniers. Vaucluse devenait la région agricole la plus prospère de France. Sur le littoral de Provence, l'accroissement rapide du commerce des fleurs coupées et la villégiature de la Côte d'Azur faisaient monter le prix des terres jusqu'à 15.000 francs ; beaucoup d'ouvriers du jardinage devenaient propriétaires. Le Sud-Est, qui par le climat et la population forme une région distincte, comprend le massif des Alpes et la plaine d'argile marécageuse qui la prolonge jusqu'à la Saône et au Jura ; pays de climat extrême et de relief irrégulier, à sommets élevés, pentes abruptes, larges vallées. La population, plutôt grande et de forte structure, où les yeux bleus ou gris et les cheveux et les teints clairs ne sont pas rares, n'a ni l'aspect physique ni le caractère des Méridionaux. Dauphinois, Savoyards, Bressans, laborieux, tenaces, entreprenants, réservés en paroles, ressemblent aux hommes de l'Est. Le parler est un dialecte intermédiaire entre le français et le provençal. Le régime d'exploitation est la propriété bourgeoise avec le fermage dans les pays d'élevage des montagnes et de la Bresse, la petite propriété dans les vallées des Alpes, la grande propriété dans les Dombes. Les vallées d'alluvions calcaires des Alpes et la plaine de la Bresse, sauf les prairies du bord de la Saône étaient partagées entre la culture du froment et du maïs et les cultures industrielles et fruitières, le colza et le mûrier, la vigne disposée en hautains ; les côtes du Rhône portaient des vignobles de vieux renom. Les montagnes, dans la région humide du Nord, en partie revêtues de forêts, fournissaient les pâturages frais où se faisait l'élevage des vaches pour le laitage ; la région aride du Sud, désert de roches nues, coupé de vallées ravagées par les torrents, n'avait guère que de maigres cultures et des pacages de chèvres. La crise des cultures industrielles a atteint surtout la région du Sud ; l'abandon de la vigne et du mûrier dans la Drôme n'a pas été compensé par l'exploitation du chêne truffier ; beaucoup de petits propriétaires ont vendu et émigré, les fermiers ont presque disparu. Dans les liantes et Basses-Alpes, la dépopulation et la dévastation du sol se sont aggravées. Les petits propriétaires, devenus moins nombreux, ont agrandi leur domaine, mais la terre a diminué de valeur au point que la propriété moyenne par l'étendue mérite d'être appelée petite (c'est la conclusion de l'Enquête). La région humide a profité au contraire de la hausse des prix du laitage et de la viande dans les grandes villes et les centres ouvriers du voisinage, l'élevage a accru ses bénéfices, et le vin a maintenu ses prix. Le nombre des journaliers a diminué au point qu'une partie des grands domaines, à défaut de main-d'œuvre, ont été vendus en détail. Les petits propriétaires, enrichis par la hausse des prix, ont amélioré leur outillage et acheté des terres. Le Dauphiné et la Savoie sont devenus une région de paysans propriétaires aisés. |