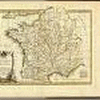HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE IV. — LES TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE JUSQU'EN 1914.
CHAPITRE II. — TRANSFORMATIONS DES CONDITIONS DE LA VIE SOCIALE.
|
EN aucun temps, la transformation de la société française n'a été si rapide que dans le dernier demi-siècle. Pour en donner un tableau précis, il faudrait décrire les innovations qui ont bouleversé les conditions de la vie en France, et montrer comment elles se sont propagées dans les diverses régions. Il n'est possible ici que d'en tracer une esquisse générale. La plupart de ces transformations résultent de la révolution économique produite par les progrès de la technique et des échanges ; les autres sont d'origine politique : elles dérivent de l'établissement du régime électif démocratique. I. — L'ACCROISSEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION. L'ÉTUDE des progrès de l'industrie et de l'agriculture appartient à l'histoire spéciale des différentes techniques, et, comme ces progrès s'opèrent par la collaboration de tous les pays civilisés, l'histoire en devrait être internationale. Le domaine de l'histoire générale de la France se limite à leur action sur la société française. Le progrès caractéristique de cette période est l'abondance croissante des objets et des services, qui a rendu la vie matérielle des Français plus aisée et plus variée. L'accroissement, d'une rapidité sans précédent, est dû à la transformation des moyens d'action de l'homme sur la matière. Tandis que les procédés de travail, depuis l'origine de la civilisation, se transmettaient par tradition, ne se renouvelant que par des tâtonnements empiriques et des inventions dues au hasard, de nos jours la découverte des lois scientifiques de la nature a donné directement l'idée et les moyens de réaliser les innovations techniques. Depuis l'application de la science à l'industrie, les inventions ont été perfectionnées, non plus d'une façon empirique, mais par des recherches scientifiques, avec l'intention d'augmenter le rendement ou l'économie des forces de travail (réunies par la langue scientifique sous le nom d'énergie), en les mettant au service de la fabrication ou de la traction, au moyen d'appareils techniques qui transforment l'énergie naturelle en travail utile. Aux sources traditionnelles d'énergie — le travail de l'homme et des animaux, le vent et les chutes d'eau et l'action directe du feu — les inventions empiriques en avaient dès le XIXe siècle ajouté de beaucoup plus puissantes, la machine à vapeur, les hauts fourneaux, les marteaux-pilons, les laminoirs, les machines à forer, le gaz, fourni par la distillation de la houille. — Mais ces procédés encore imparfaits n'étaient employés que dans un petit nombre d'établissements : l'œuvre du dernier demi-siècle a été de les perfectionner et d'en étendre l'usage. La vapeur a beaucoup accru son rendement par l'invention de la chaudière multitubulaire et la création de machines plus grandes, plus solides, faites d'un métal plus résistant. L'usage en est devenu beaucoup plus fréquent, le chiffre des machines à vapeur contrôlé par les inspecteurs s'est élevé de 14513 en 1860 à 82.238 en 1910. — Le domaine de la métallurgie s'est agrandi depuis 1873 par l'invention du procédé Thomas, qui a permis d'extraire la fonte du minerai de fer phosphoreux (minette) de Lorraine, jusqu'alors difficile à utiliser. L'abondance du feu a activé la fabrication des outils et des ustensiles, et plus encore la construction métallique, qui a fourni à l'architecture des matériaux plus légers et plus résistants, les charpentes en fer, les ponts métalliques et, depuis 1889, le ciment armé, fait avec une armature en métal. Le rendement des industries textiles a été multiplié par l'invention de broches et de métiers à tisser à marche plus rapide, tandis que la machine à coudre abrégeait singulièrement le temps de la couture. Les machines-outils (d'origine américaine), remplaçant le travail à la main, révolutionnaient la fabrication de la chaussure, la ganterie, la chapellerie, l'horlogerie. La machine à composer monotype (puis linotype) et la presse rotative rendaient possible l'impression rapide des journaux quotidiens à très fort tirage, la machine à écrire donnait naissance à la profession de dactylographe. Le gaz devenait d'un emploi si habituel pour l'éclairage des rues, des édifices publics et des magasins, que chaque ville avait son usine à gaz, et la distillation de la houille se perfectionnait au point que les sous-produits (coke, goudron, alcool, teintures, parfums) acquéraient une valeur supérieure à celle du gaz. Ces progrès restaient dans la voie ouverte au XIXe siècle : le fer servait de matière, la houille fournissait l'énergie sous forme de chaleur et de lumière ; on la surnommait le pain de l'industrie. Un peuple de mineurs se rassemblait auprès des lieux d'extraction du minerai et du combustible, la grande industrie s'établissait dans leur voisinage et y concentrait la population ouvrière. Avant la fin du siècle, de nouvelles sources d'énergie ont préparé une nouvelle série de transformations. Le pétrole a fourni un combustible liquide plus léger et d'un plus grand pouvoir calorique. Le moteur à explosion (depuis 1876), en remplaçant l'action indirecte de la vapeur par Faction directe du gaz sur le piston, a permis de supprimer la chaudière encombrante et coûteuse et d'obtenir un rendement très supérieur de force utilisée. Créé d'abord avec le gaz d'éclairage, il a ensuite employé le gaz pauvre obtenu par le passage de la vapeur d'eau sur le coke chauffé au rouge, les gaz des combustibles liquides (essence, benzine, alcool), et même les gaz des hauts fourneaux, jusque-là brûlés sans profit. Les moteurs à gaz ont été employés surtout dans les ateliers de la petite industrie, où ils prenaient, peu de place et permettaient un travail intermittent. Mais, comme leur rendement en travail est très supérieur à celui de la vapeur, on a commencé à employer des moteurs puissants pour actionner les souffleries et les appareils de la grande métallurgie. Une révolution plus profonde est préparée par l'emploi de l'énergie électrique sous trois formes, électro-technique, électrothermie, électro-chimie. La dynamo réversible, réalisée dès 1873 par la combinaison d'un générateur et d'un récepteur, a permis de transformer le travail mécanique en force électrique, et inversement ; une chute d'eau tombant sur une turbine fournit sous forme mécanique l'énergie au moteur électrique. L'eau des montagnes — surnommée la houille blanche — remplace la combustion de la houille ; le moteur électrique, qui utilise au moins 60 p. 100 de l'énergie, sans frottement, sans fumée, sans bruit, remplace la machine à vapeur, bruyante, sale et trépidante, qui perd en chaleur inutilisée, en mise en service, en frottement de l'arbre de couche, des courroies ou des engrenages plus des quatre cinquièmes de la force dépensée. La force électrique, transportée à grande distance par fil métallique sous forme de courant alternatif à haute tension, est amenée de l'usine électrique jusqu'au lieu où elle est employée. L'énergie, rendue transportable et divisible, peut être distribuée aux petits moteurs dispersés, tours, métiers à tissage, qui, en rétablissant le travail individuel à domicile, libèrent l'ouvrier des contraintes imposées par la concentration auprès de la machine. L'électro-thermie, en transformant l'électricité en chaleur. a obtenu un chauffage intense qui a donné naissance à des inventions pratiques. Le four électrique, où la température atteint 3.000 degrés, a permis de traiter les corps réfractaires. L'éclairage électrique par incandescence, réalisé, soit par la lampe à filaments de carbone dans le vide, soit par l'arc électrique à l'air libre, a donné un rendement optique très supérieur à la combustion de l'huile et du gaz avec une transmission moins coûteuse ; il a pu, en utilisant les chutes d'eau, s'installer en pays de montagnes jusque dans les villages. L'électro-chimie, opérant par l'électrolyse, a fourni pour décomposer les corps des procédés plus actifs et moins coûteux que les réactions chimiques ; elle a été appliquée à la fabrication du cuivre pur, de l'aluminium, du chlore, de la potasse et de la soude. La fabrication de la glace artificielle par réactions chimiques a rendu possible la conservation des viandes frigorifiées ; la liquéfaction des gaz par la compression et la détente brusque, en réalisant des températures très basses, a donné naissance à l'industrie du froid, qui, conservant intacts les corps organisés, prépare une révolution dans toutes les industries d'alimentation. Le progrès continu de la chimie a prodigieusement accru l'activité des industries chimiques, photographie, verrerie et faïence, distillerie, tannerie, blanchisserie, caoutchouc, et la fabrication des engrais chimiques, des explosifs, des teintures, des parfums, des médicaments. La microbiologie a transformé la chirurgie par l'emploi de l'asepsie, la médecine par l'étude des microbes et des toxines, l'hygiène par les appareils de désinfection ; l'étude des ferments a perfectionné la brasserie et l'industrie des vins. Le progrès de la technique a activé surtout la production industrielle, dont le rendement s'accroît presque en proportion du travail employé à transformer la matière ; l'effet en a été moindre sur l'agriculture, parce que l'homme ne peut accélérer à son gré le lent travail naturel de la végétation et de la croissance des plantes et des animaux. La production agricole ne s'est guère accrue que par les innovations dues à la métallurgie, à la chimie et à la biologie, les machines agricoles qui ont économisé la main-d'œuvre, les engrais chimiques qui ont augmenté le rendement des cultures, la sélection des semences et des animaux reproducteurs. II. — LE PROGRÈS DES PROCÉDÉS DE TRANSPORT. LE progrès de la technique augmentait aussi la facilité des transports. Le chemin de fer, encore réduit à l'ancien réseau, formé seulement des grandes lignes, partagé entre six grandes Compagnies fermières, ne comprenait en 1860 que 9.525 kilomètres. Le nouveau réseau fut formé des lignes secondaires, où le trafic devait être plus faible. Pour décider les Compagnies à le construire, l'État, par des conventions nouvelles (1860), leur assura une garantie d'intérêts, et s'engagea à compenser le déficit résultant de l'exploitation par des avances remboursables sur le, prix de rachat à l'expiration de la concession. Le total des voies ferrées était monté en 1880 à 26 198 kilomètres ; il restait inférieur, en proportion de la population, à l'Angleterre et la Belgique. Le troisième réseau, que l'État entreprit de construire en 1880, fut dès 1883 cédé aux Compagnies moyennant une garantie d'intérêts (voir livre II, chap. II). La longueur des voies ferrées en 1912 atteignit 51 217 kilomètres, sans compter 8 690 kilomètres de tramways. La force de traction, accrue par l'emploi de chaudières perfectionnées et de locomotives plus puissantes, permit d'augmenter le poids et la vitesse des transports ; les trains rapides atteignirent 125 kilomètres à l'heure. L'accroissement d'activité se mesure au chiffre annuel des marchandises en petite vitesse, passé de 23 millions de tonnes en 1860 à 80 millions en 1880 et à 198 en 1912, et au total des voyageurs, monté de 56 millions en 1860 à 241 millions en 1890 et 525 en 1912 ; tandis que les recettes montaient de 418 millions en 1860 à 1 061 en 1880 et 1 997 en 1912. Le réseau des grandes routes, nationales et départementales, achevé en 1860, n'augmentait plus en longueur, mais le réseau des chemins vicinaux, portés de 143.000 kilomètres en 1869 (1re année de la statistique) à 250.000 en 1912, se complétait par une longueur de chemins ruraux montée de 180.000 à 288.000 kilomètres, qui accroissait les facilités données à l'agriculture. Les chemins français, réputés pour le bon entretien de leur macadam, s'amélioraient par l'emploi du rouleau à vapeur. La circulation sur les grandes routes, très ralentie par la disparition du roulage et des relais de poste et la décadence continue des diligences, reprit une activité nouvelle à la fin du siècle par l'effet de deux inventions : la bicyclette, après 1886, devenue commode et rapide grâce à la chaîne de multiplication, au roulement à billes et à la roue garnie de caoutchouc ; pu l'automobile, réalisée par la combinaison du moteur à explosion avec les roues à bandage pneumatique. La supériorité des routes françaises attirait les amateurs d'automobilisme du monde entier. Bien que la renommée de la cuisine française et la variété des sites ne suffit pas à compenser pour les voyageurs étrangers la négligence traditionnelle des hôtelleries en matière de logement, il se créait, à l'imitation de l'étranger, dans les stations balnéaires et les pays de villégiature, des établissements pour une clientèle habituée au confort moderne. L'aéroplane, qui réussit son premier vol en 1908, malgré des progrès extraordinairement rapides, n'avait pas eu le temps en 1914 de se transformer en un procédé pratique de transport. Le transport des lettres et des imprimés s'accrut en quantité et en vitesse, suivant le progrès des chemins de fer devenus l'instrument du service des postes. Le total annuel des lettres monta de 265 millions en 1860 à 1 752 millions en 1913, les recettes des postes de 63 millions à 292 millions de francs, tandis que la taxe d'affranchissement diminua de 0 fr. 20 en 1860 à 0 f. 15 en 1878 et 0 fr. 10 en 1906. Un mode nouveau de transmission instantanée des dépêches par le télégraphe électrique avait rapidement couvert la France d'un réseau de fils plus serré que celui des chemins de fer. L'accroissement se mesurait aux recettes, qui de 5 millions en 1860 avait monté à 70 en 1913. — Une invention plus récente, le téléphone, créé en Amérique, généralisé en France surtout au XXe siècle, permit la communication orale instantanée, surtout entre les habitants d'une même ville. — La télégraphie sans fil, opérant par l'émission d'ondes électriques ouvrait de larges perspectives, mais n'avait pas eu le temps en 1914 de produire des effets appréciables. Le progrès des transports par eau a été beaucoup plus faible, malgré une grande étendue de côtes, un grand nombre de ports, une forte population maritime de pêcheurs. Ni la prime de construction ni la prime de navigation accordées par l'État n'ont activé la navigation sur mer. Le nombre des navires à vapeur, qui en 1872 était de 512 (avec un tonnage total de 177.000 tonnes), n'avait monté en 1900 qu'à 1.272 (avec un tonnage de 527.000 tonnes) ; il s'est accru jusqu'à 1 935 navires (avec 1.043.000 tonnes) en 1914. La France est descendue du second rang au quatrième. III. — LES PROGRÈS DU COMMERCE ET DU CRÉDIT. L'AUGMENTATION des produits industriels et agricoles, accessibles à la consommation par la baisse des prix et le progrès des transports, bouleversa les conditions du commerce. A mesure que le réseau des chemins de fer s'étendit, chaque gare devint un centre d'expédition des denrées locales, rassemblées par les courtiers-revendeurs pour la vente au loin, et un centre de réception pour les marchandises destinées à la vente au détail dans le pays. L'abondance et la facilité de transport des marchandises accrurent considérablement le nombre et l'importance des opérations commerciales et du personnel commerçant. Le commerce, comme l'industrie, en augmentant de volume, se concentra, et la concentration eut pour effet d'activer le commerce en gros et de changer les méthodes du commerce de détail. Le détaillant, opérant avec un petit capital, un faible chiffre d'affaires et une clientèle limitée, cherchait à vendre en petite quantité à gros bénéfice et à un prix variable débattu avec le client ; le marchandage se pratiquait dans les boutiques comme sur le marché des denrées agricoles ou pour la vente des immeubles. Les grands magasins adoptèrent, une méthode inverse, se contentant d'un bénéfice faible sur chaque vente, et augmentant le nombre des ventes par un renouvellement rapide des marchandises, de façon à récupérer rapidement le capital engagé et à l'employer en nouveaux achats. Pour activer la vente, ils attiraient la clientèle par les avantages du bon marché et du prix fixe, par la tentation d'une entrée libre, d'un étalage élégant, d'un grand choix d'articles, par la facilité de se faire envoyer les achats à domicile, par une large publicité d'annonces, de presse et de catalogues. L'exemple vint de Paris et du commerce de vêtements appelé nouveautés, décrié par des faillites nombreuses. Des maisons anciennes se transformèrent en s'installant dans un local construit pour ce nouveau commerce, le Bon Marché repris en 1863 par Boucicaut, transformé en 1867, la Belle Jardinière installée à neuf en 1868, le Louvre agrandi au moyen de ses bénéfices ; le Printemps fut créé en 1865, la Samaritaine en 1869. Le modèle fut imité dans les grandes villes, d'ordinaire sous le nom de bazars, avec entrée libre, prix fixe et marqué, étalage d'articles variés. Les grands magasins s'agrandirent, en augmentant la quantité et la variété de leurs objets de vente, et en ajoutant à leurs spécialités primitives (draperie, mercerie, bonneterie, rouennerie, confection de vêtements) des rayons nouveaux, quincaillerie, brosserie, ameublement, papeterie, librairie, parfumerie ; dans l'épicerie, où le public se plaignait de l'altération des denrées et de la vente à faux poids, l'exemple fut donné à Paris (après 1859) par la maison Potin, qui diminua les prix, vendit à poids exact, et réduisit ses frais généraux à 5 p. 100. Elle créa des entrepôts pour ses stocks, des fabriques de chocolat, de sucre, de sirop, de vins mousseux, de pruneaux, et finit par s'adjoindre presque tous les commerces d'alimentation. Elle servit de modèle aux épiceries parisiennes fondées dans un grand nombre de villes. Les grands magasins occupèrent un nombre croissant d'employés salariés ; le nombre des boutiques vendant au détail augmenta néanmoins avec l'accroissement de la consommation des ouvriers et des paysans, et parce que la grande industrie (quincaillerie, ferronnerie, menuiserie, cordonnerie, confection) livra en masse les objets jadis fabriqués par des artisans qui devinrent des articles de commerce. Mais la méthode des grands établissements s'imposa au commerce de détail, car, en indiquant le prix des articles à leurs étalages et dans leurs catalogues, ils instruisirent les clients et obligèrent les détaillants à renoncer aux prix tenus secrets, au marchandage et aux forts bénéfices. L'accroissement du commerce intérieur, qui ne peut être évalué en chiffres, est prouvé par l'augmentation de la population employée à des professions commerciales, qui de 073.000 en 1866 s'est élevée en 1911 à 2.053.000. Le commerce extérieur est mesuré approximativement dans les statistiques du commerce spécial grâce à la surveillance des douanes dans les ports et les stations des frontières. La commission des valeurs en douane, fixant chaque année la valeur de chaque article, permet de calculer la quantité des marchandises, non d'après leurs poids (qui ne pourraient être ni constatés ni additionnés), mais d'après la valeur en argent. Le commerce extérieur de la France ne résultait pas seulement du travail spontané des échanges avec l'étranger, il dépendait de l'action artificielle des douanes imposées par l'État et de la politique commerciale du gouvernement. Le régime douanier inauguré en 1860 par les traités de commerce tendait à faciliter les échanges en abaissant les droits de douane et en donnant aux commerçants la sécurité des opérations à long terme. La coalition des industries textiles avec la métallurgie obtint le retour au régime de haute protection, avec des droits de douane fixés par des tarifs en forme de lois sans aucun engagement avec les États étrangers (voir livre II, chap. III). Ce régime tendait à réserver le marché français aux industriels de France, en réduisant les échanges au dehors à l'importation de matières premières et à l'exportation des produits de luxe français, de façon à obtenir un excédent d'exportations. Le total des importations est monté de 1.897 millions en 1860 jusqu'à un maximum de 5.033 en 1880 ; descendu lentement jusqu'en 1886, il a remonté, avec des intermèdes de baisse (1891-96, 1901-1905), à un maximum de 8 421 en 1913. L'augmentation a porté surtout sur les matières premières : de 1 443 millions en 1860 à 4 945 en 1913. L'importation des objets fabriqués, montée jusqu'en 1883 à 768 millions, a baissé jusqu'en 1896, et a remonté, lentement jusqu'en 1905, rapidement depuis 1910, à 1.658 millions en 1913. L'exportation a monté, de 2.277 millions en 1860, lentement avec de faibles oscillations, à 4.108 en 1900, plus rapidement à 6.880 en 1913. L'augmentation a porté surtout sur les produits fabriqués, très lente de 1860 à 1900 (de 1.428 millions à 2.254), rapide jusqu'en 1913 (4.183). L'importation totale, inférieure à l'exportation en 1860, l'avait dépassée dès 1870 ; l'excédent d'importation, après avoir diminué de 1890 à 1000, augmentait rapidement ; comme les pays riches créanciers des autres pays, la France employait les intérêts de ses capitaux placés à l'étranger à importer des objets de consommation. En même temps que le commerce, et par les mêmes procédés, le crédit augmentait d'activité et se concentrait. De nouvelles sociétés anonymes devenaient de grands magasins de capitaux, cherchant leur gain dans des opérations à faible bénéfice, mais rapides et très étendues : le Crédit Lyonnais créé par H. Germain (1863), la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie (1863), le Crédit Industriel, le Comptoir d'Escompte (créé en 1848) et les grandes banques parisiennes d'escompte. La loi de 1867, supprimant l'autorisation préalable de l'État exigée pour toute création de Compagnie anonyme par actions, facilita la fondation des sociétés de crédit. Les établissements nouveaux évitèrent les opérations à long terme à taux d'intérêt élevé, qui immobilisaient le capital et n'atteignaient qu'une clientèle limitée d'industriels et de commerçants connus ; ils préféraient les opérations à bénéfice faible et immédiat, émission d'emprunts publics moyennant une commission, création de sociétés anonymes, achat et vente de valeurs, garde de titres et encaissement des coupons échus pour le compte des clients. Ils ouvraient un compte aux particuliers dont ils recevaient les dépôts d'argent remboursables à vue, de façon à capter le capital à mesure qu'il se formait. Ils attiraient les clients en ouvrant des succursales dans un grand nombre de villes, et en employant des méthodes de travail rapide qui facilitaient les dépôts et les retraits de fonds, les comptes courants et les chèques, l'achat et la vente des valeurs. Les dépôts à vue de la clientèle fournissaient à l'établissement un fonds très supérieur à son capital social, qui permettait de larges opérations à petit bénéfice et à échéance courte, sans immobiliser un capital qui devait rester toujours prêt au remboursement : tandis que la Banque de France maintenait son taux d'escompte entre 2 et 3 p. 100 (1896-1899), les grands établissements offraient aux maisons de commerce l'escompte au-dessous de 1. Cette révolution dans la méthode du crédit fit disparaître la plupart des banques locales, impuissantes à soutenir la concurrence, et excita des colères contre les grands établissements. On leur reprocha de faire des opérations de Bourse plutôt que de banque, de drainer l'épargne française vers les marchés étrangers, et de la mettre au service des industries rivales de l'industrie française. L'accroissement rapide de la quantité des titres (actions, obligations, rentes, emprunts publics) bouleversa les conditions du marché des valeurs. Les 80 agents de change de la Bourse de Paris, seuls autorisés à faire les achats et les ventes, ne pouvaient suffire à la masse croissante des opérations ; à côté de ce personnel officiel, le parquet, opérant dans l'édifice de la Bourse, des courtiers sans titre opéraient au dehors dans des maisons privées surnommées la coulisse. Les agents de change, invoquant la loi qui leur réservait le rôle d'intermédiaires pour faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, citèrent en justice les coulissiers et les firent condamner (juin 1859). Mais la coulisse survécut, et la jurisprudence, tournant la loi, partagea le marché : réservant aux agents de change la vente des effets admis à la cote officielle de la Bourse par la Chambre syndicale, elle laissa la coulisse opérer sur les valeurs en banque non cotées. Le coulissier rendait à ses clients des services interdits à l'agent de change : il les guidait dans leurs opérations, leur fournissait la contrepartie, leur donnait des garanties, endossait les marchés, et se faisait payer une commission moindre que le courtage d'un agent ; il se tenait à leur disposition, tandis que le marché du parquet ne durait que deux heures par jour. La coulisse se prêtait beaucoup mieux aux spéculations sur le marché à terme qui faisaient la vie de la Bourse. Le volume des affaires alla augmentant, et la spéculation devint de plus en plus active ; le public se pressait autour de la corbeille du parquet, où les agents de change mettaient en vente les valeurs ; la Bourse était pleine d'une foule bruyante dont on entendait au loin les clameurs. La fièvre de spéculation arriva au comble au temps de l'Union générale : le capital nominal des émissions en 1881 et 1882 fut évalué à 2 milliards (voir livre II, chap. I). La crise de 1882 changea l'allure du marché. Les clients, devenus prudents, se portèrent sur les valeurs à revenu fixe, et firent moins d'opérations à terme. Les cours n'eurent plus que de faibles variations ; la spéculation se concentra sur quelques valeurs mal assises (le Rio Tinto, les mines d'or). Le tapage cessa à la Bourse. Les grands établissements de crédit, qui se chargeaient des achats et des ventes pour leurs clients, devinrent le principal marché des valeurs. L'accroissement de l'activité du crédit peut se mesurer par le chiffre annuel des effets compensés à la Chambre de compensation de Paris, créée sur le modèle anglais. Il s'est élevé de 1 milliard en 1872 à 7 milliards en 1900 et à près de 30 milliards en 1913. IV. — L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA RICHESSE. LE progrès des procédés de travail, de transport et de crédit a amené une augmentation énorme de la production des objets et de leur valeur exprimée en numéraire. Les statistiques permettent d'en suivre les variations, avec une approximation différente suivant le procédé employé pour constater les faits. Les statistiques de la production agricole, dressées (depuis 1852) d'après les renseignements des commissions cantonales, ne reproduisaient que des évaluations sans critique ni contrôle ; on a cherché à les rendre plus exactes en créant des commissions communales aidées par les professeurs d'agriculture. Elles indiquent avec une approximation grossière le total annuel des principaux produits. L'accroissement est très irrégulier pour les récoltes, qui dépendent des conditions climatériques, variables suivant les années. La production du froment n'a monté que de 101 millions d'hectolitres en 1860 à 118 en 1912 (avec un maximum de 133 en 1874). Mais le rendement moyen à l'hectare s'est élevé de 15 hectolitres en 1860 à 21 en 1912, par une hausse continue depuis 1900. La variation a été plus grande pour la pomme de terre, qui a passé de 70 millions de quintaux métriques en 1860 à 150 en 1912, plus encore pour le vin, qui a atteint un maximum de 83 millions d'hectolitres en 1875, un minimum de 24 en 1887, avec un rendement à l'hectare très variable. L'accroissement a été plus régulier pour les cultures fourragères, qui ont monté de 374 millions de quintaux en 1886 à 930 en 1912, plus rapide pour l'horticulture, dont les produits étaient évalués en 1902 à 100 millions de francs et à 622 millions en 1913. Les statistiques des produits de l'industrie reposent sur des données plus solides pour les objets soumis au paiement d'un droit, qui comporte un contrôle fiscal. La production du sucre s'est accrue, avec des fluctuations résultant de l'inégalité des récoltes, de 128 millions de tonnes en 1860 à 140 en 1900. La quantité d'alcool ayant acquitté les droits — sans compter la contrebande des bouilleurs de cru — s'est élevée de 671.000 hectolitres en 1857 à 2.656.000 en 1900, et en 1912 à un maximum de 3.309.000. L'extraction des combustibles minéraux, consistant surtout en houille, est montée de 8 millions de tonnes en 1860 à 33 en 1900, et a dépassé 40 en 1913. La production de la fonte s'est élevée de 898.000 tonnes en 1860 à 2.716.000 en 1900 et à plus de 5 millions en 1913. La valeur du fer et de l'acier estimée en argent s'est accrue de 171 millions en 1860 à 652 en 1911. Dans presque toutes les industries la quantité des produits depuis 1860 a au moins doublé, et, comme la valeur des marchandises importées de l'étranger a dépassé fortement celle des produits français exportés, la population française a disposé d'une masse beaucoup plus grande d'objets. Le nombre des habitants n'ayant que faiblement augmenté, la proportion moyenne de consommation par tête d'habitant s'est beaucoup élevée (pour l'alcool taxé, de 2,27 litres en 1860 à 4 en 1911). Le mouvement de la consommation échappe à la statistique, mais il est évident que la population consomme une beaucoup plus grande quantité de viande, de vin, d'étoffes, de chaussures de cuir, de mobilier, d'ustensiles, de verrerie, d'articles de luxe ; qu'elle dépense beaucoup plus en voyages, en spectacles, en divertissements, en livres et journaux, en correspondances. L'accroissement du luxe est rendu frappant par les statistiques des objets de consommation tout à fait inutiles, soumis à une taxe qui révèle la dépense annuelle. La consommation du tabac s'est accrue de 27.000 tonnes en 1861 à 35.000 en 1885 et 43.000 en 1912. Le chiffre des recettes des théâtres de Paris, monté de 14 millions en 1860 à 25 en 1885, a atteint (y compris les cafés-concerts depuis 1893) 68 millions en 1913 ; le pari mutuel aux courses de chevaux s'est élevé de 102 millions en 1891 à 404 en 1912 ; la taxe sur les jeux des cercles et casinos s'est accrue de 14 millions en 1907 à 55 en 1912. L'accroissement énorme de la production et de la consommation est le signe certain d'une augmentation de la richesse de la France. Mais le total de la richesse, capital ou revenu, ne peut être évalué en numéraire que par des calculs sur des données partielles complétées par des conjectures. La valeur vénale de la propriété non bâtie (terres, prés, vignes, jardins, bois, landes), estimée vers 1851 à 61 milliards, s'était élevée en 1881 à 91,5 milliards ; après la crise agricole elle a baissé en 1912 à 61,5 milliards. La propriété bâtie (d'après les enquêtes de 1853, 1889, 1900, 1910) s'est élevée de 20 milliards en 1851, 53 à 64,5 en 1910. La richesse mobilière, plus difficile à évaluer, consiste surtout en titres représentatifs de la richesse réelle. On a essayé de calculer le capital de la France en additionnant les immeubles privés, les propriétés publiques, la valeur des chemins de fer et des travaux publics, le numéraire en circulation, l'outillage et le mobilier, et le bétail, et en y ajoutant la valeur des titres étrangers possédés par les Français, évaluée vers 1880 entre 15 et 18 milliards, après 1900 entre 20 et 27. L'évaluation variait, vers 1878, de 200 à 222 milliards ; au XXe siècle, de 200 milliards en 1902 (Leroy-Beaulieu) à 229 en 1906 (Colson). Les plus hautes en 1911 atteignaient 283 milliards (Pupin) et 282 (E. Michel). Quant au revenu total, l'évaluation n'en pouvait être fondée sur les statistiques fiscales, en l'absence d'un impôt sur le revenu. On a tenté de la faire en additionnant les salaires des employés, les bénéfices des patrons, les rentes, les traitements, les produits consommés en nature. Le résultat, suivant les méthodes, variait entre 20 et 30 milliards ; l'évaluation la plus forte (Pupin) donnait 16,5 milliards en 1872, 27,8 en 1903 et 39 milliards en 19H. L'augmentation se marquait par plusieurs signes : le total des successions et donations soumises aux droits s'est élevé de 3.526 millions en 1850 à 7 755 millions en 1900, malgré des dissimulations considérables ; le total des sommes en dépôt dans les Caisses d'Épargne est monté de 377 millions en 1860 à 4 milliards en 1913. L'accroissement de la richesse se faisait par l'épargne, traditionnelle dans la bourgeoisie et à la campagne ; le bas de laine du paysan français devenait proverbial. Le revenu des particuliers n'était pas absorbé par leurs dépenses ; l'excédent se transformait en capital. L'usage ancien de placer les fonds disponibles en achats de terres ou en hypothèques avait fait hausser la valeur des immeubles et baisser le revenu des terres jusqu'à 2 p. 100. Depuis la crise agricole de 1882, les placements, se détournant de la terre, se portèrent sur les valeurs mobilières, à revenu fixe, rentes françaises, obligations, emprunts étrangers ; la proportion en était estimée aux trois quarts de la fortune mobilière en France, au quart seulement en Allemagne, où l'on préférait les actions à dividende variable. Le revenu de ces placements accélérait l'accumulation des capitaux placés chaque année ; on l'estimait après 1900 entre 1 milliard et demi et 2 milliards, en 1913 à plus de 4 milliards. L'abondance de l'argent faisait baisser le taux de l'intérêt ; l'évolution se produisait à la fois dans l'estimation du revenu, le taux de l'escompte commercial et le cours des rentes françaises. En 1860, l'intérêt normal des meilleurs placements est de 5 p. 100, une fortune d'un million représente 50.000 francs de rente ; l'escompte est en moyenne à 4,50 ; la rente 3 p. 100 est à 71,40, et atteint en 1870 le maximum à 75,10. — La guerre raréfie le capital, fait baisser la rente jusqu'à 50, monter l'intérêt de l'argent au-dessus de 5 p. 100, et l'escompte à 5,70. — Depuis 1873, le taux va toujours en baissant, jusqu'à ce que l'intérêt normal des bons placements soit descendu à 3 p.100, et qu'un million ne rapporte plus que 30.000 francs de rente. L'escompte se fixe de 1883 à 1892 autour de 3 p. 100, et descend à 2 vers 1896. La rente 3 p. 100 atteint le pair à 100 francs en 1892, et le dépasse jusqu'à 105,25 en 1897. Au XXe siècle, l'intérêt remonte un peu au-dessus de 3 p. 100 ; l'escompte, depuis 1899 revenu à 3 p. 100, s'y maintient (sauf pendant la crise de 1907), et s'élève en 1913 jusqu'à 4 ; la rente descend au-dessous du pair dès 1.900 jusqu'à un minimum de 90,80 en 1913. L'abondance croissante des capitaux que le travail français ne suffisait pas à occuper abaissait le loyer de l'argent en France et poussait de plus en plus aux placements à l'étranger. Le peuple français, possesseur d'une réserve croissante de fonds disponibles, opérait de plus en plus comme un rentier vivant d'un travail antérieur au moyen de créances sur les autres peuples. V. — LES VARIATIONS DES PRIX ET DES SALAIRES. L'ACCROISSEMENT de la richesse se faisait suivant une marche irrégulière, interrompue, à des intervalles inégaux, par une crise provenant d'une production industrielle supérieure à la consommation, d'une estimation exagérée des valeurs de spéculations, d'un excès de crédit fait par les banques est suivie d'une diminution de la production et des opérations de crédit. L'étude des cours de la Bourse, du portefeuille, de l'encaisse et du taux d'escompte de la Banque de France a permis de préciser la succession des périodes d'activité et de crises que la France a traversées. La fièvre de spéculation excitée par les chemins de fer s'arrêta avec la crise universelle de 1857 commencée en Amérique et en Angleterre. Après une dépression de trois ans, commença en 1861 Une période de prospérité industrielle, interrompue par des accidents, la crise cotonnière de 1863 résultant de la guerre de Sécession, la guerre de 1866, la faillite des chemins de fer d'Espagne en 1868. — La guerre de 1870 amena l'arrêt brusque des affaires, le cours forcé des billets de banque émis pour 3 milliards, la chute du cours des valeurs (le 3 p. 100 tomba en 1871 à 50,35, l'obligation du Nord à 275). — La crise fut intense, mais courte, les affaires reprirent dès 1871, la Banque de France escompta en 1873 pour 11 milliards d'effets. — La crise allemande et autrichienne très intense de 1873 (Krach de Vienne) n'eut à la Bourse qu'un contrecoup de courte durée. La hausse générale continua sur les marchandises, les terres et les valeurs, et atteignit un maximum en 1881. La plus intense de toutes les crises de Bourse, celle de 1882, qui éclata avec la faillite de l'Union Générale, fut le début d'une dépression profonde, de longue durée, attribuée à des causes économiques universelles, la concurrence des produits agricoles d'Amérique, la diminution du numéraire amenée par la démonétisation de l'argent. La baisse atteignit les produits de l'industrie, les denrées agricoles, le prix des terres et des fermages ; la production industrielle se ralentit, le chômage devint intense. L'activité, rétablie lentement, était redevenue normale dès 1889 dans l'industrie et le commerce, les prix et les valeurs avaient repris leur niveau ; la hausse des produits agricoles tarda plus longtemps (jusque vers 1897). Le cours des valeurs devint plus régulier ; les capitaux se détournèrent de la spéculation et se portèrent sur les placements fixes. La France se distingua de plus en plus par la stabilité du cours de ses valeurs, l'abondance croissante de ses capitaux disponibles, la faiblesse de ses crises, contre-coups atténués des crises des autres nations. Elle ne subit que des oscillations entre de légères excitations au moment des Expositions (de 1889 à 1891, de 1897 à 1901), et de légères dépressions (de 1892 à 1896, de 1901 à 1904). Après la crise américaine de 1907, commença dans tous les pays civilisés une période de prospérité sans précédent dans l'histoire du monde ; l'accroissement de la production, la hausse des prix des objets et des valeurs mobilières, la création de nouvelles entreprises et les émissions de titres coïncidèrent avec un taux peu élevé de l'intérêt de l'argent ; la Banque de France eut à la fois une très forte encaisse et un portefeuille très chargé. Les prix des objets de grande consommation, qui intéressent le plus directement la population, ne suivirent pas le même mouvement que les autres valeurs, parce qu'étant réglés par l'équilibre entre l'offre et la demande, ils dépendaient de la quantité des objets produits ou importés, de la densité de la population, de ses habitudes de consommation, de la quantité des métaux précieux en circulation. La France, attachée au bimétallisme, maintint la frappe libre de l'or et de l'argent avec une valeur relative invariable, fixée à 15 ½ ; la variation dans la différence réelle se traduisait par une prime. Jusqu'en 1867 l'argent fit prime sur l'or, produit en abondance par la Californie et l'Australie. La France conclut (1865), avec ses voisines bimétallistes (Belgique, Suisse, Italie), l'Union latine qui, pour compenser la hausse de l'argent, abaissa à 0,835 le titre des monnaies divisionnaires. L'augmentation de la production de l'argent amena d'abord une prime de l'or, puis obligea (1876) à renoncer à la frappe libre de l'argent qui, descendu à la moitié de sa valeur conventionnelle, ne servit plus que de monnaie d'appoint ; l'or resta l'étalon unique du commerce international. La variation du prix de chaque denrée a été établie en ramenant le prix de chaque année à une évaluation moyenne, donnée par la commission des valeurs en douane. Le froment, de 32,801es 100 kilos en 1860, baisse rapidement depuis 1881 jusqu'à 19 francs, où il reste de 1885 à 1892, puis à 13,50 en 1895, remonte à 23 francs en 1898, redescend en 1903 à 15,50, et remonte jusqu'à 22. La pomme de terre oseille entre un minimum de 0,01 le kilo en 1863 et un maximum de 0,12 en 1879, et monte brusquement en 1900 de 0,07 à 0,10, puis en 1910 à 0,13. Le beurre, à 2,90 le kilo en 1860, hausse jusqu'en 1878, baisse jusqu'à 2,30 en 1898, remonte en 1900 et se fixe jusqu'en 1913 autour de 3 francs. Le sucre raffiné, de 0,80 le kilo en 1860, baisse lentement à 0,71 en 1882, puis brusquement à 0,12 en 1881 et jusqu'à 0,22 en 1902, pour remonter à 0,39 en 1913. D'après l'enquête sur les prix des vivres, le pain, après un maximum de 0,45 le kilo en 1867, aurait baissé à 0,40 jusqu'en 1880, puis à 0,35 et à 0,30 ; le bœuf aurait monté jusqu'en 1873 à 1,70 le kilo, baissé jusqu'en 1888, puis remonté ; les prix ayant augmenté moins vite que les revenus, la vie est devenue plus aisée. La quantité des objets à consommer s'étant accrue beaucoup plus fortement que la consommation, l'excédent n'est absorbé qu'en partie, par le gaspillage et le luxe des familles en possession de la fortune, le reste sert à augmenter la consommation de la masse. La France emploie le surplus de sa richesse, non à accroître sa population, mais à élever le niveau de sa vie matérielle. VI. — LES TRANSFORMATIONS SOCIALES D'ORIGINE POLITIQUE. L'ÉVOLUTION politique qui a mené la France de la monarchie personnelle absolue et bureaucratique à la république parlementaire libérale et démocratique a transformé le personnel chargé des affaires publiques. La direction du pays sous l'Empire était concentrée dans un petit groupe de hauts fonctionnaires chefs de service soustraits au contrôle de la presse et des assemblées élues, servis par des agents subalternes soumis à une autorité hiérarchique et par des maires choisis parmi les riches notables. Un nouveau personnel, formé de bourgeois républicains, se saisit en 1870 du gouvernement de Paris et des fonctions administratives de la France ; il les partage en 1871 avec les notables des anciens partis restés à l'écart depuis 1851. Ces deux personnels se disputent dès lors les fonctions et les sièges des assemblées et des conseils élus. La noblesse et la haute bourgeoisie royalistes occupent d'abord une grande partie des emplois supérieurs. Le compte fait par un journaliste royaliste des personnages nobles ou prétendant à la noblesse (dont le nom est précédé d'un de) donne pour l'année 1874 un total de 3.143, dont 5 ministres, 226 membres de l'Assemblée, 105 diplomates (sur 133), 225 généraux (sur 552), 101 officiers supérieurs de marine, 43 préfets, 131 sous-préfets, 138 présidents de Cour. Le personnel des fonctions publiques, menue après l'avènement du parti républicain, continua à se recruter dans les mêmes classes sociales qu'autrefois ; la tradition et l'esprit de corps se conservaient surtout dans les carrières les plus anciennes et les plus honorées, diplomatie, magistrature, cavalerie, marine. La transformation fut beaucoup plus rapide dans le personnel électif des Chambres, recruté par le choix des électeurs dans toutes les classes de la population. L'indemnité parlementaire (de 9.000 francs) attribuée aux mandats législatifs fournissait un moyen d'existence suffisant pour faire de la politique une profession. Les mandats des conseils élus (municipal et général) restaient gratuits, ainsi que les emplois de maires, devenus tous électifs. Mais les municipalités parvenaient à indemniser les maires des grandes villes et des conseillers municipaux de Paris, et les mandats gratuits même étaient recherchés comme un stage pour parvenir aux mandats rétribués ; il tendit à s'établir un avancement par échelons : conseiller municipal, maire ou conseiller général, député, sénateur, Ainsi se créa une carrière politique, ouverte sans conditions, dépendant uniquement du bon vouloir du public, comme les professions commerciales, carrière pénible et hasardeuse, mais séduisante parce qu'elle donnait, outre la notoriété locale, le moyen de vivre à Paris, avec la perspective de ce poste de ministre demeuré au sommet de la hiérarchie sociale, qui donnait l'illusion du pouvoir suprême. Le terme de politicien, créé aux États-Unis pour les hommes qui font de la politique une profession, entra dans la langue française, avec une nuance de mépris, souvenir d'un temps où la politique ne procurait que des honneurs. À mesure que les électeurs, initiés à la vie politique par la pratique des élections, échappèrent à l'influence des anciens partis monarchiques, les hautes classes furent rejetées hors des assemblées élues. Dans les campagnes, les grands propriétaires, nobles ou bourgeois, furent de plus en plus écartés de la mairie et même du conseil et remplacés par des paysans ou de petits commerçants. Ainsi la possession du pouvoir public se sépara de la richesse et du prestige social, et ce divorce entre l'autorité et l'influence devint un caractère nouveau de la société française. Un relevé des ministres nobles ou prétendus tels, sous les présidences successives, en compte 16 sous Mac-Mahon, 5, de très petite noblesse, sous Grévy, 3 sous Carnot, 3 sous Loubet, 1 sous Fallières. Dans les Chambres, il est toujours resté des nobles (presque tous de l'Ouest), des grands propriétaires, des grands industriels et des financiers, mais peu nombreux ; les circonscriptions où l'argent suffisait à faire élire un député ont toujours été en très petit nombre. Le personnel politique s'est recruté de plus en plus dans la moyenne bourgeoisie locale, surtout dans les professions qui sont en relations fréquentes avec les électeurs, hommes de loi, médecins, fonctionnaires ; les politiciens de profession étaient moins nombreux dans les régions industrielles du Nord et de l'Est et les pays riches, que dans les pays pauvres, où s'ouvrent peu de carrières lucratives. Les partis de gauche ont fait entrer à la Chambre des journalistes, des professeurs, puis des instituteurs, des employés de commerce et quelques ouvriers (les premiers ont été deux mineurs élus en 1885). Mais, comme les frais de la campagne électorale sont restés à la charge des candidats, la très grande majorité des Chambres n'a pas cessé de se recruter dans la bourgeoisie. La lutte électorale pour la possession du pouvoir, compliquée d'une concurrence professionnelle pour la conquête de la carrière politique, a porté le conflit jusqu'au fond des campagnes. Depuis que les conseils municipaux élisent les électeurs sénatoriaux, toutes les élections sont devenues politiques. La politique, pénétrant toute la vie sociale, a séparé la société française en cieux camps hostiles ; la séparation, manifeste dès le 24 mai 1873, s'est aggravée par la concurrence entre l'école laïque et l'école congréganiste. Du côté des conservateurs se sont rangés la noblesse et la haute bourgeoisie, le clergé, la plus grande partie de la moyenne bourgeoisie et des fonctionnaires, avec les paysans, artisans et commerçants restés dans leur dépendance ou sous leur influence. Le parti républicain a réuni la masse des ouvriers, des paysans propriétaires, des employés et des petits fonctionnaires, encadrés dans une petite minorité de bourgeois. La rivalité continue a engendré des rancunes qui ont rompu les relations personnelles : les familles en lutte ont cessé de se fréquenter ; il était devenu difficile avant 1914 d'organiser en commun une fête, un divertissement, une œuvre de bienfaisance. Chaque camp dans une ville avait son club, dans un bourg sa fanfare, son médecin, son notaire, ses fournisseurs. La séparation était moins tranchée dans le Nord et l'Ouest, plus nette dans le Midi, qui dès 1849 se divisait en blancs et en rouges. Depuis que la province s'est éveillée à la vie politique par les luttes électorales, elle a cessé d'obéir à Paris, qui s'est réduit à une opposition frondeuse, d'abord radicale, puis nationaliste, et elle a pris la direction politique par le moyen de ses élus, auxquels le parcours gratuit sur les chemins de fer permettait de revenir chaque semaine dans leur pays. Paris est resté le centre de la vie intellectuelle. La vie sociale a été modifiée dans un sens libéral et démocratique par la législation sur les libertés politiques, le service militaire, le régime du travail. La liberté de la presse — portée jusqu'à l'impunité par l'indulgence du jury — a endurci l'opinion aux critiques, aux scandales et même aux injures. La liberté de réunion a fait adopter l'usage anglais du meeting. La liberté d'association a fait entrer dans les mœurs la pratique des groupements permanents pour une œuvre sociale ou économique. La liberté du divorce, rétabli dans des limites étroites, mais élargies par la jurisprudence, a servi surtout à la bourgeoisie des grandes villes. Le service militaire, rendu personnel en 1872, égal en 1905, a mis les jeunes gens de toutes les classes en contact personnel à la caserne et aux manœuvres ; il a pour la première fois donné aux bourgeois l'expérience directe des paysans et des ouvriers. Les lois ouvrières ont relevé la condition des travailleurs ; l'opinion, jusque-là indifférente et ignorante, s'est intéressée à la vie, au travail et aux réclamations des ouvriers. VII. — TRANSFORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT. LORSQUE Duruy, nommé ministre de l'Instruction publique, préluda à ses essais de réforme par un inventaire en 1863, la statistique de l'enseignement primaire indiquait 20.700 écoles publiques de garçons et 17.680 mixtes avec un personnel de 38.000 titulaires et 7.041 adjoints, 1.986.000 élèves laïques et 412.000 congréganistes, et un budget total de 28 millions et demi (dont 12,7 millions fournis par la rétribution scolaire, 11 payés par les communes), 11.000 écoles publiques de filles, dont 8.000 tenues par des congréganistes, avec G 845 maîtresses laïques, 17.566 congréganistes, 1.014.000 élèves (dont 31 p. 100 laïques), et un budget de 10 millions. L'enseignement libre comptait 208.000 garçons dans 3 108 écoles avec 6 807 maîtres, 713.000 filles dans 13 207 écoles avec 31 550 maîtresses. Il y avait 7G écoles normales de garçons avec 3 139 élèves, 11 de filles avec 440 élèves ; le tiers seulement des maîtresses sortait d'une école normale. Tout en France, bâtiment, mobilier scolaire, méthodes d'enseignement, discipline, restait en retard sur les pays allemands. On comptait en 1860 33 p. 100 de conscrits ne sachant ni lire ni écrire, et dans les mariages 30 p. 100 d'hommes, 45 p. 100 de femmes incapables de signer. L'enseignement secondaire public n'existait que pour les garçons : on comptait 27.300 élèves dans 80 lycées dont l'État faisait les frais, 28.500 dans 230 collèges municipaux, entretenus par les villes, soit en régie, soit par un contrat avec le principal. Le personnel d'un lycée, sauf à Paris, comprenait une quinzaine de professeurs et presque autant d'administrateurs et de surveillants. Légalement les professeurs du lycée (sauf en 7e et 8e) et le proviseur et le censeur devaient avoir le titre d'agrégés de l'Université, qui s'obtenait par un concours centralisé à Paris. Mais la plupart des emplois, au lieu d'are pourvus d'un titulaire, étaient donnés avec un traitement inférieur à un chargé de cours, simple licencié. Seule une petite minorité de professeurs sortait de l'École Normale supérieure, où elle avait fait des études du degré supérieur. Tous les autres, licenciés et même agrégés, avaient passé l'examen ou le concours, sans avoir reçu d'autre enseignement que celui du lycée. Ils transmettaient à leurs élèves ce qu'ils avaient appris comme écoliers, sans pouvoir renouveler ni les connaissances ni les procédés. L'enseignement, dominé par le latin et les mathématiques, traitait en accessoires les études de réalités, sciences physiques, chimiques et naturelles, histoire, langues vivantes, même la littérature. Il consistait en exercices traditionnels, — récitations, dictées, thèmes, versions, analyses grammaticales, vers latins, discours latins et français, rédactions d'histoire, problèmes et théorèmes, ne laissant guère qu'une connaissance verbale de morceaux d'auteurs, de règles abstraites, de nomenclatures apprises par cœur ; dans les meilleures classes il se réduisait à l'art d'écrire avec des ornements conventionnels ou de résoudre des problèmes traditionnels de mathématiques. La discipline restait claustrale et militaire ; les internes, qui formaient la grande majorité des élèves, portaient l'uniforme et marchaient en rangs et au pas. Un règlement identique pour toute la France fixait la durée des classes, des études, des récréations, l'heure du lever et du coucher, l'échelle des punitions et des récompenses, les sorties et les promenades. La règle était moins rigide dans les petits collèges. Le nombre total des bacheliers était en 1860 de 2.505 pour les lettres, 2.092 pour les sciences. L'enseignement supérieur public se partageait entre les écoles spéciales pour le recrutement d'un service public (Polytechnique, Artillerie, Génie, Saint-Cyr, Santé, Normale, Vétérinaires, Ponts et Chaussées, Mines, Chartes), recrutées par concours et presque toutes organisées en internats, et les Facultés fréquentées par les étudiants libres pour obtenir les diplômes des carrières pratiques, le droit et la médecine ; elles avaient en 1860 reçu 765 licenciés en droit et 350 docteurs en médecine. Les Facultés des lettres et des sciences, formées chacune de cinq professeurs, n'avaient pas d'étudiants ; leur rôle se réduisait aux examens de baccalauréat et de licence et à des cours publics devant un auditoire flottant. Le budget de l'enseignement supérieur, fourni surtout par les droits d'examen, était en 1861 de 3 millions et demi. La réforme tentée par Duruy, paralysée par le manque d'argent, se réduisit à trois créations : les cours secondaires de jeunes filles faits par les professeurs des lycées de garçons, l'enseignement spécial sans latin pour la préparation au commerce et à l'inclus-trie, annexé aux lycées, l'École pratique des hautes études, ouverte sans conditions pour les recherches de science pure. Jusqu'à l'avènement du parti républicain, le progrès de l'instruction continua par l'accroissement du personnel enseignant, qui dans les écoles primaires publiques de garçons monta en 1880 à 46.000 instituteurs laïques et 9.900 congréganistes, dans les écoles de filles, à 26.000 laïques et 39.000 congréganistes ; le nombre total des élèves monta à 5.049.000, dont 1.772.000 congréganistes. La proportion des conscrits illettrés descendait au-dessous de 17 p. 100, celle des époux illettrés à 16 pour les hommes, 25 pour les femmes. La réorganisation commencée en 1880 porta sur l'enseignement primaire, rendu gratuit et obligatoire. L'instituteur, payé par l'État, devint indépendant du conseil municipal, du maire, du ministre du culte et des familles ; il ne dépendit plus que des autorités scolaires et du préfet. La dépense monta en 1880 à 108 millions, en 1907 à 292. Le personnel s'éleva de 122.000 en 1880 à 157.000 en 1900 (dont 57.000 instituteurs et 50.000 institutrices laïques), et en 1910, après la suppression des congrégations, à 150.000 dont 66.000 instituteurs et 89.000 institutrices. Le nombre des élèves des écoles laïques monta de 3.276.000 en 1880 à 5.631.000 en 1912 (dont 2.125.000 filles). Les écoles neuves eurent des salles grandes, de larges fenêtres, des préaux couverts, des logements pour les instituteurs, un mobilier scolaire conforme à l'hygiène. La discipline devint humaine : il fut interdit de frapper les enfants ; des procédés rationnels rendirent faciles la lecture et l'écriture. L'école transformée n'inspira plus la crainte et se fit aimer des enfants. Le certificat d'études primaires fut créé pour consacrer la sortie de l'école. Le personnel enseignant des cieux sexes fut de plus en plus recruté dans les écoles normales de département ; le nombre de leurs élèves atteignit un maximum de 5.291 en 1906 pour les instituteurs, de 5.230 pour les institutrices. Il diminua quand les traitements parurent trop inférieurs à ceux des emplois analogues devenus plus lucratifs. Pour préparer le personnel des écoles normales, furent créées l'école de Saint-Cloud pour les hommes, l'école de Fontenay pour les femmes. Un examen d'aptitude pédagogique fut institué pour recruter les emplois supérieurs d'inspecteurs et de professeurs. Des écoles primaires supérieures des deux sexes furent créées dans un grand nombre de villes, avec des professeurs sortis les uns du primaire, les autres du secondaire, et des élèves externes choisis après examen. Ainsi se constitua une carrière d'enseignement primaire, avec un avancement par degrés parallèles pour les deux sexes : élève-maître d'école normale, instituteur adjoint, instituteur titulaire, directeur d'une école à plusieurs classes, professeur d'école normale ou d'école primaire supérieure ou inspecteur primaire, directeur d'école normale, professeur à Saint-Cloud ou à Fontenay, inspecteur général. La carrière, ouverte gratuitement, se recruta dans le peuple et la petite bourgeoisie ; elle acquit un rang social inconnu aux anciens maîtres d'école, et même une influence politique dans les campagnes, où les fonctions de secrétaire de mairie étaient confiées d'ordinaire à l'instituteur. Les familles d'instituteurs, constituées souvent par des mariages entre collègues, formèrent un monde d'un niveau de culture intermédiaire entre les paysans et les bourgeois, en contact avec le peuple des campagnes auquel il apporta un peu de vie intellectuelle. L'enseignement secondaire fut modifié par des réformes partielles. Un enseignement moderne sans latin remplaça l'enseignement spécial de Duruy, avec un baccalauréat moderne qui ouvrait moins de carrières que l'enseignement classique. La réforme de 1902 le supprima et, partageant la durée des études en deux cycles successifs, créa 4 sections, puis deux parallèles, l'une sans latin, aboutissant à 4 baccalauréats pourvus de droits égaux. Le programme, élargi par des réformes successives, fit une place plus large aux sciences physiques et naturelles, à l'histoire et à la géographie, et surtout aux langues vivantes, qu'on essaya d'enseigner oralement par la méthode directe. Les procédés d'enseignement furent rendus moins mécaniques, les exercices en latin et les discours disparurent, il fut prescrit de s'adresser moins à la mémoire verbale. La discipline devint plus souple et plus humaine ; la marche au pas, le silence au réfectoire, l'uniforme militaire ne furent plus obligatoires. L'externat, encouragé officiellement, devint la règle, les externes furent plus nombreux que les internes. Le nombre des élèves des établissements publics s'éleva à 100.000 en 1913. Le personnel enseignant, de plus en plus recruté parmi les étudiants des facultés, fut pourvu d'une instruction régulière. Le nombre des licenciés s'accrut au point qu'il ne resta plus pour eux assez d'emplois de professeurs dans les collèges : on comptait en 1898 dans les lycées un tiers de répétiteurs licenciés. La réforme de 1909. transforma les répétiteurs en professeurs adjoints chargés des suppléances, et créa pour les fonctions de surveillance des surveillants d'internat, recrutés en partie dans le personnel primaire. Un enseignement secondaire public pour les jeunes filles fut créé en 1880 sous la forme de lycées et de collèges, organisés en externats, auxquels pouvait être annexé un internat. Le personnel était exclusivement féminin ; pour le préparer, on créa l'École normale supérieure de Sèvres, où l'enseignement était donné par des hommes, et on institua des certificats spéciaux et des concours d'agrégation pour les femmes. Ainsi fut créée une carrière de professeurs féminins qui n'était pas séparée de la carrière primaire par la barrière du latin. Le nombre des élèves s'éleva, lentement d'abord, de 1.517 en 1882 à 13.190 en 1900 ; la suppression des couvents de religieuses, qui recevaient comme internes les jeunes filles de la bourgeoisie, fit monter rapidement le chiffre à 29.600 en 1910 et 32.200 en 1913. L'enseignement supérieur, sans toucher aux écoles spéciales, se transforma par la réorganisation des facultés. Les crédits de l'État, portés de 6 millions en 1870 à 15 en 1893, et les subventions des villes furent employés à construire des bâtiments, des laboratoires, des bibliothèques. Des facultés nouvelles de médecine et de droit furent créées. Dans les facultés des sciences et des lettres, le nombre des professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences, fut considérablement accru ; sans cesser d'être des bureaux d'examens, elles devinrent des établissements d'enseignement. Elles eurent pour étudiants les boursiers de licence (1877) et d'agrégation (1880), futurs professeurs de l'enseignement secondaire, auxquels s'ajoutèrent en nombre croissant les étudiants libres (attirés de 1889 à 1905 par la dispense de service de deux ans attachée au titre de licencié), puis les étudiantes ; en sciences, les étudiants en médecine, obligés de faire une année préparatoire d'études de sciences physiques, chimiques et naturelles, et les élèves des instituts techniques (électricité, brasserie, agriculture) annexés à la faculté. Le régime fut transformé sur le modèle des Universités allemandes, en cieux étapes : en 1885 l'autonomie fut donnée à chaque faculté avec la personnalité civile, un budget, le droit d'élire son doyen et de présenter les candidats aux chaires ; celles d'une même ville furent reliées par un conseil des Facultés formé de délégués élus. Le lien fut resserré en 1895 par la création des Universités (suivant l'ancien sens français du nom), pourvues de la personnalité civile et d'un budget administré par un conseil d'Université. Le nombre des étudiants monta de 16.587 en 1890 (4.500 en droit, 5.800 en médecine, 1.218 en sciences, 1.830 en lettres) à 42.037 en 1914 (16.400 en droit, 8.500 en médecine, 7.300 en sciences, 6.566 en lettres). |