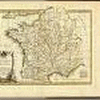HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE IV. — LES TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE JUSQU'EN 1914.
CHAPITRE PREMIER. — LA POPULATION DE LA FRANCE.
|
I. — L'ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION. LE chiffre total de la population au recensement de 1861, après l'annexion de la Savoie et de Nice, était de 37.396.000[1] ; abaissé par la perte de l'Alsace-Lorraine (1.560.000 âmes) à 36.102.000 au recensement de 1872, il n'a cessé d'augmenter, s'élevant en 1881 à 37.572.000. — en 1891 à 38.342.000, — en 1901 à 38.961.000, — en 1911 à 39.601.000. Mais l'accroissement annuel moyen, de 5,8 par 1.000 entre 1836 et 1841, descendu entre 1861 et 1866 à 3,6, est tombé à 0,6 et à 0,9 entre 1886 et 1896 et ne s'est relevé qu'à 2,3 et 1,5 entre 1896 et 1906. La population ne s'est accrue que de 4 millions dans ce second demi-siècle au lieu de 8 dans le premier ; la France est le pays d'Europe où l'accroissement est le plus lent. Ce ralentissement exceptionnel, coïncidant avec un progrès rapide de la production et de la consommation, a surpris les économistes. Ils croyaient que la population est réglée par les moyens d'existence et varie en proportion des subsistances ; jusqu'à la fin du me siècle on e cherché par des calculs statistiques une corrélation entre le mouvement de la population française et le prix des céréales. Mais la disproportion entre le chiffre des habitants et les ressources du pays est devenue si évidente qu'on a dû chercher une autre explication. On ne la trouvait ni clans les décès ni dans les mariages ; le total annuel moyen des décès a diminué de 857.000 (1861-70) jusqu'à 736.000 (1908-1912), la mortalité annuelle descendant de 23,5 pour 1.000 jusqu'à 17,8 en 1913, et le chiffre annuel moyen des mariages est allé en augmentant de 284.000 entre 1883 et 1887 à 308.000 entre 1908 et 1912, la proportion des mariages à la population restant voisine de 15 p. 1.000, comme en Belgique et en Angleterre. Il a fallu reconnaître que l'augmentation exceptionnellement faible de la population en France provient uniquement du petit nombre des naissances. Le total annuel moyen des naissances d'enfants vivants a baissé de 951.000 entre 1861 et 1870 à 858.000 entre 1891 et 1897, puis à 765.000 entre 1908 et 1912, et n'a été en 1913 que de 716.000. La natalité (proportion des naissances à la population) est allée diminuant, de 26,1 par 1.000 entre 1861 et 1870, à 22.1i entre 1891 et 1897, jusqu'à 19,7 en 1907 et 18,7 en 1912. Le nombre moyen d'enfants par famille, était descendu dès 1896 à 2,2. Le mariage ne suffisait plus à recruter la population française, elle ne se maintenait que par l'appoint des enfants naturels. Avec la natalité diminuait l'excédent des naissances sur les décès : d'une moyenne de 93.000 entre 1861 et 1870, il était tombé à 28.000 entre 1891 et 1897 : le chiffre des décès a même dépassé celui des naissances en 1890-1892 (au temps de l'épidémie d'influenza), en 1900 et en 1907. L'excédent, remonté jusqu'à 84.000 en 1902, retombé à 27.000 en 1906, n'était que de 42.000 en 1913. La proportion de l'excédent était descendue de 2,5 par 1.000 entre 1618 et 1870 à 0,7 entre 1891 et 1900, et n'est remontée qu'à 1 en 1905. La population française ne s'accroissait plus que par l'immigration des étrangers. L'étude comparée de la natalité entre les divers États, les diverses régions, les divers quartiers des villes, les classes de la population, a montré que les faibles natalités accompagnent, en moyenne, non la misère mais l'aisance. Les naissances les plus nombreuses se produisent dans les nations les plus arriérées, les régions les plus pauvres, les quartiers les plus misérables, les familles les plus dénuées, journaliers des campagnes et ouvriers des villes. Ce sont les nations les plus civilisées, les pays les plus fertiles, les maisons les plus confortables, les familles de paysans aisés et de bourgeois qui fournissent le moins d'enfants. Le petit nombre des naissances résulte, non d'une incapacité physiologique ou économique à procréer ou à entretenir les enfants, mais de la volonté d'en éviter la charge, soit que la femme redoute le péril ou les peines de la maternité, soit que les parents veuillent s'épargner les dépenses d'une éducation ou éviter le partage de leur succession. La population cesse de s'accroître, non quand elle est trop pauvre pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais quand elle est trop aisée pour vouloir supporter les charges de l'accroissement. Aussi la diminution des naissances est-elle commune aux nations et aux classes les plus aisées : on l'a constatée aux États-Unis et dans l'Empire britannique. La baisse de la natalité, qui en France date du milieu du XIXe siècle, a commencé avant la fin du siècle et s'est accrue rapidement au XXe, en Angleterre de 29,5 à 25,6 par 1.000 (1901-1914), en Belgique de 29.4 à 23,2 (1901-1913), en Allemagne, où, de 39,2 entre 1876 et 1880, elle est descendue à 27,4 en 1913. La France n'a fait que devancer dans cette voie les nations les plus civilisées. La diminution anormale de la natalité a mis la France en infériorité numérique envers les autres pays. Après avoir au XVIIIe siècle tenu le premier rang en Europe par son chiffre de population, elle a passé au cinquième, après la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, et elle est serrée de près par l'Italie. La densité de la population en France n'a monté en un demi-siècle (1861-1911) que de 68 à 73,8 (au kilomètre carré en 1913), tandis qu'elle a atteint en Belgique 252, en Angleterre 239, en Allemagne 120, en Italie 121. Cette différence croissante a fait craindre aux Français de devenir incapables de résister à leurs voisins, soit dans la guerre, soit dans la concurrence économique. Cette crainte a inspiré la fondation de Alliance nationale pour l'accroissement de la population française en 1896, et plusieurs propositions de loi pour encourager les familles nombreuses. II. — LES VARIATIONS DANS LES PROPORTIONS. LA proportion entre les différentes catégories d'habitants a varié dans ce demi-siècle. Entre les sexes la proportion a peu changé : les naissances masculines ont toujours été en excédent, d'environ 5 p. 100 ; en 1861, 515 masculines pour 490 féminines, en 1913, 389 masculines pour 364 féminines. Ce rapport se maintenait dans la population au-dessous de l'âge de vingt ans — en 1861, 36,23 p. 100 des habitants mâles, 35,38 p. 100 de la population féminine, en 1911 34,64 pour les hommes, 33,18 pour les femmes —. L'égalité s'établissait entre les deux sexes de vingt à quarante ans. La proportion entre les âges a varié beaucoup plus par l'affaiblissement de la natalité. La proportion des enfants et des adolescents (au-dessous de vingt ans) a diminué, de 36,23 p.100 dans la population masculine et 35,38 dans la population féminine en 1861, à 34,64 et 33,18 en 1911. La proportion des hommes de vingt à quarante ans baissait jusque vers 1881, revenait en 1901 au niveau de 1861, et le dépassait en 1911 (30,82), tandis que la proportion des femmes restait moindre qu'en 1861. Entre quarante et soixante ans la proportion augmentait, de 1861 à 1911, moins pour les hommes (de 22,87 à 22,97) que pour les femmes (de 22,58 à 23,10). La proportion des vieillards (au-dessus de soixante ans) augmentait surtout dans la population féminine. La pyramide de la population, employée pour traduire en figure géométrique la proportion entre les différents figes, prend en France une forme exceptionnelle, étroite à la base, avec des pentes très raides, et ne s'amincissant que vers le sommet. La proportion des étrangers augmentait par une émigration croissante des pays voisins : de 13,5 en 1861, pour 1.000 habitants, elle s'élevait en 1891 à 29,7, avec un total de 1.130.000. Ce chiffre s'abaissa en 1901 à 1.033.000 (soit 26,9), par l'effet de la loi de 1889 qui, pour empêcher les fils d'étrangers établis en France d'échapper au service militaire, naturalisa Français tous les habitants nés en France. Le chiffre remonta en 1911 à 1.132.000, dont 535.000 femmes. L'augmentation provenait surtout des Italiens et des Espagnols ; entre 1906 et 1911 les Belges avaient diminué de 322.000 à 286.000, les Allemands augmenté de 89.000 à 101.000. La population française ne se maintenait que par l'appoint des étrangers, et de plus en plus se recrutait dans les nations méridionales de la Méditerranée. III. — LES VARIATIONS DANS LA RÉPARTITION TERRITORIALE. LA répartition locale de la population en France est constatée par deux sortes de statistiques dressées suivant deux principes différents. 1° D'après la disposition des habitations, les habitants qui demeurent dans des maisons groupées en villages ou en villes forment la population agglomérée, les habitants des maisons isolées et des hameaux forment la population éparse. La proportion de la population éparse (37,3 p. 100 en 1876, 33,1 en 1911) reste exceptionnellement élevée pour un Étal européen, surtout dans les régions de montagnes et de bocage du Centre et de l'Ouest, où la fréquence des points d'eau facilite la dispersion, et où se perpétue l'usage commun aux anciens peuples de langue celtique de placer l'habitation auprès des terres. D'après le nombre d'habitants de l'agglomération au chef-lieu de la commune, les statistiques classent la population en urbaine si le chiffre dépasse 2.000, rurale s'il reste inférieur ; principe conventionnel qui fait ajouter à la population urbaine les paysans de la banlieue des villes et à la population rurale les artisans et commerçants des bourgs et les ouvriers des villages industriels. La proportion de la population rurale ainsi définie a diminué à chaque recensement : de 71,1 p. 100 en 1861 à 65,2 en 1881, et en 1911 à 55,8. La population urbaine s'est accrue en proportion inverse, de 20 à 44, surtout par l'accroissement des grandes villes. Le total pour les villes au-dessus de 100.000 habitants a monté de 4.163.000 en 1887 à 5.376.000 en 1913 ; Paris atteignait 2 888.000 âmes, Marseille 550.000 (dont 442.000 agglomérés), Lyon 523.000 (dont 471.000 agglomérés), Bordeaux 251.000, Lille 17000. On comptait, outre Paris, 14 villes au-dessus de 100.000 âmes (dont 7 de 120.000 à 150.000), 63 villes de 30.000 à 100.000, 55 villes de 20 à 30.000, 163 villes entre 10 et 20.000, et 373 villes entre 5.000 et 10000. L'accroissement a été cependant beaucoup moins rapide et les grandes villes sont beaucoup moins nombreuses qu'en Grande-Bretagne, ou on en comptait 47 au-dessus de 100.000 âmes, et en Allemagne où on en comptait 45. La répartition régionale, calculée par départements, a subi une évolution constatée dès 1851, et qui s'est accélérée. La population n'a pas cessé de diminuer dans les régions agricoles et d'augmenter dans les centres urbains. D'un recensement à l'autre grossit le nombre des arrondissements dont la population a diminué et s'abaisse le nombre de ceux où elle a augmenté. Entre 1861 et 1886 il y a augmentation dans 40 départements, diminution dans 47 ; entre 1886 et 1901, augmentation dans 26, diminution dans 60 ; de 1901 à 1906, l'augmentation se limite à 17 départements. L'accroissement ne se produit plus que dans les communes urbaines, par l'afflux des gens venus du dehors. La dépopulation atteint le maximum dans les pays où elle était déjà forte avant 1861, les Hautes et les Basses-Alpes, dévastées par le déboisement et les inondations, — la région de la Garonne (Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne), pays de très faible natalité et d'émigration, — la région des plateaux à climat rude et sol médiocre (Haute-Saône, Haute-Marne, pays de Châtillon et de Tonnerre), — la Normandie, pays riche de faible natalité, dépeuplé par la transformation des cultures en herbages et. la disparition des tisserands à domicile. La dépopulation, commencée dans quelques départements des Pyrénées et du Massif Central, s'est étendue depuis 1861 à toutes les régions de montagnes, d'où les habitants ont émigré vers les villes et les plaines ; et elle est devenue de plus en plus rapide. Elle a fini au XXe siècle par atteindre toutes les régions agricoles sauf la Bretagne, et même un grand nombre de petites villes. Les adultes sont partis ; il est resté à la campagne les enfants et, les gens âgés, ce qui diminue la proportion des mariages et des naissances dans la population rurale. La dépopulation, restreinte avant 1861 à quelques régions, est devenue générale sur tout le territoire. L'accroissement de la population, regardé autrefois comme le fait normal, s'est limité aux grandes villes et à leur banlieue, aux régions de mines et de grande industrie, et à la Bretagne, où la natalité est restée plus élevée et la vie plus semblable à celle d'autrefois. La population des villes présente une proportion plus forte d'adultes des deux sexes provenant des immigrés de la campagne. Mais le nombre des mariages et des naissances y reste inférieur à la proportion normale par rapport au nombre des adultes en âge de se marier et de procréer ; sans doute, parce qu'il y est plus difficile d'entretenir des enfants. Ainsi les campagnes, mieux appropriées à la vie des enfants, sont désertées par les gens aptes à les produire ; les villes, qui attirent les adultes, les font vivre dans des conditions défavorables à la natalité. La dépopulation des campagnes et la concentration dans les villes ont transformé la répartition de la densité de population sur le territoire accru l'inégalité entre les régions et diminué la proportion des pays à densité proche de la moyenne de la France. Il ne restait plus en 1911 que 91 départements au-dessus de la moyenne : les trois départements des grandes villes, Seine (8.664), Rhône (322), Bouches-du-Rhône (153), et les deux plus grands de la région industrielle, Nord (339), Pas-de-Calais (158). Les autres étaient les 5 départements bretons, — deux pays de jardinage et villégiature, Seine-et-Oise (144), Alpes-Maritimes (95), — deux pays de vignobles, Gironde (77), Hérault (77), — six pays de grande industrie : Belfort (166), Seine-Inférieure (144), Oise (133), Meurthe (107), Somme (83), Vosges (73.5), — 1 département maritime, Manche (74,3) en décroissance. 8 seulement dépassaient la densité moyenne de l'Allemagne (120) et de l'Italie (121), 3 celle de la Belgique. 11 départements de grande richesse agricole approchaient de la moyenne, de 71,4 à 66,7. La densité tombait au-dessous de 40 dans 10 départements, dont 3 de la région Sud-Est (Gers, Landes, Lot), 5 de montagnes, Corse, Cantal, Lozère (23,7), Hautes-Alpes (18,1), Basses-Alpes (15,3). Les accroissements et les diminutions s'étaient compensés entre les parties du territoire situées à égales distances du centre dans les différentes directions. Le centre de population — qui aux États-Unis s'est avancé de façon rapide et continue de l'est vers l'ouest — est demeuré en France presque immobile. Entre 1801 et, 1901 il ne s'est déplacé que de 20 kilomètres en direction du nord-nord-est, restant toujours dans le Cher, près du méridien de Paris (en 1801 à 12 kilomètres à l'ouest, en 1901 à 2), près du centre géométrique du territoire. IV. — LES VARIATIONS DANS LA COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ. L'ÉVOLUTION de la structure de la société française ne peut, même de nos jours, être constatée avec précision, faute de renseignements sûrs. Des différents caractères employés pour reconnaître dans quelle catégorie chaque individu doit être classé, aucun ne permet un classement satisfaisant. La profession est désignée par des termes officiels généraux qui font connaître son genre d'occupation, mais non sa place dans la société. La qualité de chef (patron) ou employé fait connaître le rôle de l'individu dans le travail, mais non son rang social, qui dépend de l'importance de l'entreprise. La fortune personnelle et le genre de vie d'un homme, seuls caractères qui révèlent sa position véritable clans l'échelle sociale, ne peuvent être constatés avec précision, parce qu'ils résultent d'un ensemble complexe de conditions trop variées pour être désignées par les termes précis indispensables à un recensement. On est donc réduit à des approximations grossières, fondées sur des données numériques insuffisantes ou sur des impressions dépourvues de preuves. La tentative de constater les professions, en 1851, s'était heurtée à la difficulté de classer les femmes, les enfants, les domestiques. L'essai fut repris en 1866, en comptant séparément les individus qui exercent une profession et, leur famille et leurs domestiques qui en vivent indirectement. Mais la comparaison entre les résultats des recensements successifs a montré que la méthode reposait sur une analyse insuffisante des conditions d'un dénombrement, et avait été appliquée sans critique. Les termes qui désignent les professions ont un sens élastique, qui varie suivant les appréciations. La statistique de 1866 attribuait aux professions agricoles 19,6 millions d'âmes ; aux professions industrielles 10,96 millions ; aux professions commerciales 1 million et demi ; aux professions libérales, jointes aux gens vivant de leurs revenus, 3,9 millions. Mais ce dernier chiffre ne concordait pas avec les chiffres des propriétaires d'immeubles, rentiers, et pensionnés. Et tous s'accordaient mal avec le recensement de 1872. Le classement des habitants par profession n'est connu exactement que depuis les recensements professionnels organisés en 1896 et 1906 par l'Office du Travail au moyen de déclarations contrôlées et d'opérations statistiques vérifiées par des machines à calculer. Entre 1896 et 1906, la proportion a baissé pour les professions agricoles (agriculture, pêche, forêts) de 47,1 à 44,8 p. 100, et monté pour les professions industrielles de 35,4 à 36,5, pour les professions commerciales de 9,2 à 10,5 ; elle s'est maintenue pour les professions libérales et les gens vivant de revenus à 8,3 ou 8,2. Le classement des habitants d'après la richesse peut se faire avec les données statistiques de l'impôt sur le revenu, en Angleterre et en Prusse. Mais, en France, la volonté de garder le secret des fortunes privées s'est opposée jusqu'en 1914 à établir un impôt sur le revenu global, qui eût permis de dénombrer les revenus. L'impôt sur le capital se réduisait à l'impôt perçu par l'enregistrement sur les successions, et la statistique officielle n'en faisait connaître que le montant annuel, l'annuité successorale, qui ne renseignait que sur le total des fortunes. Depuis 1904 elle a publié le chiffre des successions individuelles classées d'après leur valeur. L'inégalité entre les fortunes s'est révélée plus grande qu'on ne supposait. Sur 100.000 successions, 98.129 étaient inférieures à 100.000 francs, et leur total n'atteignait pas 42 p. 100 de l'ensemble. Les successions de 100.000 francs à 1 million de valeur (au nombre de 1.748) en représentaient 34 p. 100 ; les successions supérieures à 1 million (au nombre de 123) environ 35. La moitié au moins des défunts (dont 26 p. 100 morts avant vingt ans), ne laissait pas de succession. L'aisance était moins générale en France et la fortune individuelle plus concentrée qu'on ne l'imaginait ; les pauvres y étaient plus nombreux, et aussi les millionnaires. Peut-être l'inégalité provenait-elle en partie de l'accroissement récent des valeurs mobilières. |