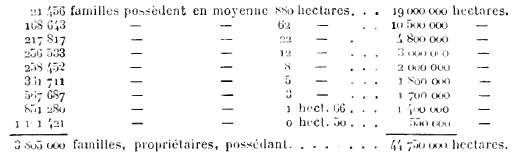HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE III. — LES PARTIS ET LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE.
CHAPITRE III. — LA CONDITION DES PERSONNES.
|
I. — LES REVENUS ET LES SALAIRES. LA France compte 31.851.545 habitants d'après le recensement de 1820. Depuis dix ans, la population s'accroît d'à peu près 193.000 habitants par an ; on compte une naissance pour 31.535 habitants et un décès pour 39.423. A ce taux, la population française doublerait en 105 ans. La grande majorité des Français habite la campagne. Trois villes seulement ont plus de 100.000 âmes : Paris, 890.431 ; Lyon et ses faubourgs, 170.275 ; Marseille, 115.913. Cinq villes ont entre 50 et 100.000 âmes, et vingt-deux de 20 à 50.000. On n'a pas l'évaluation exacte de la population dite urbaine, c'est-à-dire des agglomérations de plus de 2.000 habitants ; mais on sait la population des chefs-lieux d'arrondissement : elle est de 4 3-21 039 en 1821, de 4.619.136 en 1831. C'est à peu près le septième de la population totale. Une statistique de 1826 répartit les 31.851.545 Français en trois groupes de professions : 251.515 agriculteurs ; 4.300.000 ouvriers ; 5.300.000 marchands, fonctionnaires ou personnes exerçant une profession libérale. Il est impossible de se faire une idée exacte du revenu moyen de chaque groupe. On sait que sur 10 233 461 individus inscrits aux rôles de l'impôt direct en 1826, 7.998.939 paient moins de 20 francs, 660.336 moins de 30, 639.139 moins de 50, 522.149 de 50 à 100, 322.659 de 100 à 300, 49.606 de 300 à 500, 28.660 de 500 à 1.000, 11.533 plus de 1.000 francs. Mais c'est tout au plus si l'on en peut conclure qu'il y a un contribuable sur mille qui possède un revenu supérieur à 6.000 francs. On compte, en 1815, 10.083.751 cotes foncières, et 10.296.693 en 1826, mais on n'en saurait induire le nombre même approximatif des propriétaires[1]. D'ailleurs, l'insuffisance de tous les calculs qui essaient de déterminer le montant de la fortune d'après l'impôt direct est visible. Ils ne tiennent compte ni des ressources que l'impôt ne peut atteindre, comme les traitements de fonctionnaires. ni de celles qu'il ne frappe pas à proportion de leur valeur, comme les bénéfices commerciaux et les revenus des professions libérales. Si le calcul, qui déterminerait le montant du revenu moyen des types représentatifs de chaque catégorie d'individus, était possible, il ferait sans doute ressortir des chiffres plus faibles que ceux qu'un calcul analogue établirait pour l'heure actuelle. Mais le problème ne serait encore que reculé. Car derrière le chiffre de monnaie auquel nous serions arrivés, il resterait encore à chercher la valeur réelle, c'est-à-dire une combinaison de désirs, de besoins et de croyances, qui sont choses subjectives. Or, le travail n'est pas fait qui nous renseignerait 'avec exactitude sur l'état d'âme et le genre de vie des diverses catégories sociales, qui, seuls, donneraient un sens intelligible à un chiffre de fortune. Peut-être est-il impossible de reconstituer au moyen de documents l'état d'opinion moyenne auquel il faudrait poser cette question : à partir de quel revenu un cultivateur, un bourgeois est-il réputé aisé ou riche, et se croit-il tel ? Encore les réponses ne seraient-elles valables que pour une région donnée. Il y a certainement, vers 1820, dans le genre de vie, dans les besoins, plus de différence d'un armateur de Bordeaux à un bourgeois de Guérande, qu'entre ce bourgeois breton et un paysan voisin. On ne peut, à vrai dire, se rendre un compte exact des conditions matérielles de la vie que pour la classe d'hommes qui n'a pas de loisirs et dont le revenu n'excède jamais ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins primordiaux. Le nombre d'heures de travail d'un ouvrier, le chiffre de son salaire, le prix du pain qu'il achète, définissent sa vie avec assez de netteté. Mais ces éléments, très variables suivant les métiers et les régions, sont assez mal connus. Les calculs de Dupin évaluent le salaire annuel d'un ménage agricole à 451 francs dans le Midi et à 508 francs dans le Nord ; il juge que ce salaire donne le nécessaire à l'ouvrier qui possède sa maison : le cantonnier logé ne meurt pas de faim, et il touche de l'administration des Ponts et Chaussées 36 francs par mois, soit 432 francs par an. Mais on ne sait pas si les salaires agricoles augmentent ou diminuent de 1814 à 1830. L'état des salaires industriels est mieux connu. Ils sont en baisse régulière de 1814 à 1830, tandis qu'augmente le nombre des heures de travail et le prix des denrées de première nécessité. Duchâtellier, député du Finistère, établit en 1830 que, dans tous les corps de métiers, le salaire a baissé en moyenne de 22 p. 100 depuis 1800, tandis que le prix des objets de consommation a monté de 60 p. 100. Villermé, dont l'enquête est faite sous le gouvernement de juillet, mais qui s'est renseigné autant qu'il l'a pu sur la période de la Restauration, affirme la même baisse, dans toutes les industries, et quels que soient la région ou le mode de production. Les ouvriers mousseliniers de la région de Tarare, qui travaillent à domicile, en famille, gagnent en 1820 40 à 45 sous ; quinze ans plus tard, 28 à 30. Les 100.000 cotonniers de la Seine-Inférieure ont subi une réduction de salaire qui est de moitié au moins, souvent des deux tiers ; pour certains articles l'avilissement de prix est presque incroyable : les prix payés à Rouen en 1815 pour une douzaine de mouchoirs variaient, suivant la largeur, de 5 francs à 30 francs ; ils tombent à 1 fr. 50 et à 4 fr. 30 ; l'ouvrier qui en fabrique de deux à quatre douzaines par semaine a vu ainsi son salaire hebdomadaire passer de 20 francs à 6 francs et de 60 francs à 9 francs. Les tullistes de Calais, qui travaillaient à façon, ont connu en 1823 des salaires de 15 et 20 francs par jour ; ils tombent à 1 fr. 50 et 3 francs. Dans le département du Nord, où, sur 902.000 habitants, il y a 221.300 ouvriers (1820), les salaires de 6 francs tombent à 3 francs ; ceux de 3 francs, à 1 fr. 50 ; ceux des femmes, de 1 fr. 25 à 0 fr. 60, de 2 fr. 50 à 1 fr. 25. Qu'il s'agisse de blanchisseurs de tulle, de constructeurs de machines, de fondeurs de fer, de brodeuses au crochet, tous les salaires sont réduits de moitié. Les 21.700 ouvriers de Sainte-Marie-aux-Mines, qui, presque tous, travaillent à domicile au tissage du coton, gagnent par semaine : les tisserands de 8 à 10 francs ; les diviseurs de 4 francs à .1 fr. 50, les bonnetiers de 7 francs à 8 fr. ; les enfants touchent de 1 fr. 50 à 3 francs. Dans le Haut-Rhin, Mulhouse est le centre d'une industrie considérable de filatures, de tissage et d'imprimerie d'indiennes (44.840 ouvriers en 1827) ; les salaires de la filature sont tombés à 0 fr. 33 par jour pour les enfants, 0 fr. 75 pour les dévideuses, 3 francs pour les hommes ; dans le tissage, ils s'échelonnent de 1 fr. 50 à 2 fr. 50. Les enfants et les femmes qui préparent le fil reçoivent de 0 fr. 25 à 0 fr. 50. Les canuts de Lyon, qui sont des chefs d'atelier, propriétaires d'un ou plusieurs métiers, et qui travaillent à façon la soie fournie par les fabricants, voient le revenu de leur travail diminuer sans cesse. En pleine prospérité, vers 1824, un métier ne rapporte pas plus de 3 francs par jour, mais le gain est partagé entre le chef d'atelier et le compagnon. En 1826, une crise de production les réduit à la misère, et, après la reprise, en 1820, le préfet constate une diminution effrayante dans le prix de la façon des étoffes. En 1830, un ouvrier lyonnais ne gagne pas le tiers de ce qu'il gagnait en 1810, ni la moitié de ce qu'il gagnait en 1824. D'après Dupin, qui écrit en 1826, les salaires des drapiers d'Abbeville sont de 1 fr. 50 à 2 francs et ceux des femmes et enfants de 0 fr. 60 à 0 fr. 75 ; ceux des forges et filatures du Doubs varient de 1 franc à 1 fr. 50 ; les 1.500 horlogers de Besançon gagnent 2 francs ; les papetiers de Pontarlier, 1 fr. 20 à 1 fr. 50 ; les forgerons de la Nièvre, 1 fr. 50 ; les faïenciers de Nevers, 1 fr 75 ; les 8.000 bonnetiers de l'Aube, 1 franc. — Le salaire annuel moyen de l'ouvrier français varierait, selon Dupin, entre 492 francs et 587 francs. Pour obtenir cette rémunération, l'ouvrier fournit à Lyon 15 à 16 heures de travail quotidien ; 14 et 15 heures à Sedan, 13 heures dans le Nord, 12 à 12 heures et demie à Sainte-Marie-aux-Mines, 13 heures et demie dans le Haut-Rhin. La journée de 12 heures est très rare. Obligés à un tel effort et soumis à un pareil tarif, l'ouvrier et l'ouvrière ne gagnent, pour la plupart, pas assez pour se loger et se nourrir décemment. Un tiers seulement des Français mange de la viande ; sur les deux autres tiers, l'un mange seulement de l'avoine, du maïs, (les pommes de terre. Le pain a coûté à Paris, les 2 kilos (consommation moyenne d'un ménage), 0 fr. 60 à 0 fr. 65 en 1814 et 1815 ; de 0 fr. 75 à 1 franc en 1816 et 1817 ; de 0 fr. 70 à 0 fr. 80 de 1818 à 1820. Le prix moyen varie de 0 fr. 68 à 0 fr. 575 de 1821 à 1824, avec des maxima de 0 fr 80. Les logements sont — cela va de soi réduits au minimum. Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, parle de leur aspect sordide et misérable, de l'entassement, de l'incroyable saleté. Les caves de Lille sont célèbres Les taudis où s'abritent les ouvriers de Mulhouse sont loués de 6 à 9 francs par mois. La misère est profonde Sur les 224.300 ouvriers du Nord, 163.000 sont inscrits en 1828 aux bureaux de bienfaisance. A Paris, le chiffre des indigents secourus par les hospices et les hôpitaux est de 167.436 ; les bureaux de charité distribuent des secours à domicile à 86 415 individus en 1818 ; en 1821, à 200.000, en 1829, à près de 300.000. En avril 1829, le pain (de quatre livres) est à 17 sous et demi, écrit Mansion, et une ouvrière reçoit 15 sous d'une journée de onze heures. On compte à peu près 1 200 mendiants dans les rues de Paris, malgré l'ordonnance du 20 septembre 1828 qui interdit la mendicité et malgré un budget d'assistance qui est de 12 millions. Les fabricants du Haut-Rhin signalent lin autre genre de misère, le dépérissement rapide des enfants dans les manufactures. Villermé parle du dénuement et de l'alcoolisme des ouvriers lillois, de leur déchéance morale, de la prostitution de leurs filles. Il naît à Mulhouse 1 enfant illégitime sur 5 ; à Paris, 9.288 sur 23.159 en 1817 ; en 1824, 10.221 sur 28.812 ; et, sur ces 10.221, 7.843 sont recueillis comme enfants trouvés. A Lyon, le nombre des enfants abandonnés double entre 1814 (4.778) et 1828 (9.032). Dans l'ensemble de la France, la progression est presque aussi rapide : 82.748 enfants sont déposés dans les tours en 1815 ; 118.485 en 1830. Les enfants sont, en grand nombre, privés de toute instruction. Malgré l'ordonnance du 29 février 1816 prescrivant à toute commune de pourvoir à l'instruction de ses enfants, il n'y a en France que 28.000 écoles primaires en 1821, et 30 090 en 1820. Ou n'a pas le chiffre exact de leurs élèves, mais on sait qu'à Paris, toutes les écoles primaires gratuites réunies (enseignement mutuel, écoles de charité, paroissiales, congréganistes) réunissent 15.433 élèves en 1819 ; c'est un peu plus du cinquième des enfants parisiens de cinq à douze ans. — Dans toute la France, pour 100 conscrits, 42 seulement savent lire ; sur 25 millions d'adultes, il y a 15 millions d'illettrés ; sur 39.000 communes, 15.000 n'ont pas d'écoles. Combattu par les royalistes, l'enseignement mutuel, qui avait 990 écoles en 1821, n'en a plus que 254 en 1826. Le gouvernement s'en préoccupe tardivement. C'est seulement le 14 février 1830 qu'une ordonnance complète celle de 181G en prescrivant aux communes de délibérer sur les moyens de pourvoir, même à l'aide d'une imposition extraordinaire, aux frais d'entretien des écoles : le Conseil général est chargé de déterminer le minimum des émoluments de l'instituteur. Cette mesure préludait au grand effort que le gouvernement de juillet réalisa en 1833. II. — LES INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE, DE PRÉVOYANCE ET DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE. LA situation des classes ouvrières provoque un mouvement de philanthropie. C'est l'extinction de la mendicité qui préoccupe d'abord, parce que la mendicité est une cause d'insécurité et qu'elle frappe plus directement la sensibilité publique. Mansion propose la création d'ateliers nationaux, où les travailleurs seraient libres, et qui seraient ouverts à tous ceux qui s'y présenteraient. C'est l'idée de l'assistance par le travail : les salaires y seraient fixés d'après les prix courants des objets fabriqués ; il y aurait des lits pour les pensionnaires, des ateliers distincts pour les hommes et pour les femmes ; les enfants des assistés, à partir de cinq ans, seraient envoyés aux écoles nationales. La loi du 24 vendémiaire an 11, qui avait prescrit pour chaque département un dépôt de mendicité, est inappliquée. Çà et là, on essaie de suppléer à l'abstention des pouvoirs publics. Bordeaux crée une maison de refuge et de travail pour les mendiants (1827). A Paris, en 1829, un groupe de philanthropes s'occupe d'imiter cet exemple et provoque des souscriptions. Dans un rapport au Conseil provisoire chargé des travaux préparatoires de la fondation d'une maison de refuge et de travail destinée à procurer l'extinction de la mendicité à Paris, Cochin, maire du XIIe arrondissement, explique que l'indigent malade est suffisamment secouru ; il faut créer pour les mendiants valides une maison de refuge, avec un bureau d'interrogation, un lieu de séjour temporaire, et des ateliers permettant au mendiant d'acquérir des économies. La philanthropie s'efforce aussi de développer la prévoyance. Une société de prévoyance fut établie à Rive-de-Gier en 1817, alimentée par des dons volontaires et par les versements des compagnies exploitantes à raison de U fr. 01 par hectolitre de houille et des propriétaires de la surface à raison de 0 fr. 02 par hectolitre à eux livré à titre de redevance : la société devait venir en aide aux ouvriers mineurs. La première Caisse d'épargne, autorisée le 29 juillet 1818, fondée à Paris par Benjamin Delessert et le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, accepte des dépôts depuis 1 franc, et place ses fonds en rentes sur l'État. Elle réussit : en 1829, elle reçoit 6.278.131 francs en 138.722 versements. De 1819 à 1830, treize villes imitent l'exemple de Paris. Les ouvriers ont, de leur côté, spontanément fondé ou fait revivre des sociétés de prévoyance et de secours mutuels. Quelques-unes sont antérieures à 1792 ; la plupart sont postérieures à 1800 ; elles groupent des ouvriers d'un même corps de métier, ou, sous une même appellation, des ouvriers de professions diverses ; car la police, craignant que l'union, la discussion entre gens de même profession ne suscite des cabales, des coalitions tendant à relever le prix de la main-d'œuvre, exige souvent le mélange des métiers. A Paris, 138 sociétés fonctionnent en 1821, avec 11.143 adhérents ; 33 ont plus de 100 membres ; 5 plus de 200. En 1826, il y a 184 sociétés et 17.112 membres. Eu province, elles sont innombrables ; il y en a 113 dans le Nord, en 1828, qui groupent 7.667 adhérents. Lyon, Marseille en ont autant que d'industries ; souvent même un seul métier en compte plusieurs qui rivalisent. Ces sociétés ouvrières sont vues avec sympathie par les bourgeois philanthropes. La Société philanthropique de Paris se donne pour but de leur servir de lien et de centre commun ; elle les encourage ; elle tâche de les connaitre toutes, d'en dresser la liste, elle veut être leur intermédiaire auprès des pouvoirs publics, et diriger sur elles les libéralités des budgets. Elle garantit leur docilité, leur bon esprit ; elle signale qu'on voit le buste du Roi dans la salle de leurs séances, qu'elles font dire des messes pour le duc de Berry. Aussi, à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux, le Conseil municipal fait-il distribuer 50.000 francs aux sociétés de Paris. La Société philanthropique qui les protège ne tolérerait pas de rébellion. Des compagnons paveurs s'étant assemblés en 1826 pour fonder une société, quelques-uns ont voulu profiter de cette réunion pour engager leurs camarades à ne point travailler pour leurs manses, à moins que ceux-ci ne consentissent à augmenter le prix de leurs journées ; la police, informée, s'est opposée à ce qu'ils se réunissent de nouveau. Si une proposition aussi contraire à l'ordre public, dit le rapporteur de la Société philanthropique, était jamais faite dans une société déjà formée, la police devrait la dissoudre à l'instant. En réalité, la société de prévoyance est une garantie d'ordre. C'est pour les patrons un moyen de conserver la direction murale de leurs ouvriers, d'exercer sur eux une influence salutaire : Si l'on imposait aux manufacturiers, aux entrepreneurs, aux chefs d'usines, dit un rapport de la Société philanthropique, la condition d'organiser en société de prévoyance les personnes emploient, de s'en rendre les patrons, de présider leurs assemblées, de verser de temps en temps de pelles sommes dans leurs caisses, on détruirait peut-are ces déplorables habitudes si nuisibles à l'aisance et à la santé des artisans.... On a peur des coalitions, elles sont moins à craindre de la part de sociétaires que d'individus vivant isolément, sans règles ni principes. Il arrive pourtant que les sociétés de prévoyance soient aussi ou puissent devenir des sociétés de défense des intérêts professionnels. A Lyon, en 1817, un tarif ayant réduit les prix des façons de chapeliers, ils cessèrent le travail grâce à la bourse commune de leur société, et obtinrent une amélioration ; la caisse de secours s'est donc transformée en caisse de grève. Il y en eut assez d'exemples à Lyon pour que le maire, inquiet, plaçât toutes les sociétés de secours mutuels sous la surveillance de la police (ord. du 6 nov. 1829), et les réglementât minutieusement : Les assemblées, même celles du bureau, n'auront lieu qu'en présence du commissaire de police ; elles ne pourront pas garder en caisse plus de 300 francs ; le surplus sera déposé au Mont-de-Piété et n'en sera retiré qu'avec le visa du commissaire ; il sera interdit d'employer les fonds à d'autres usages qu'à des secours. Cette surveillance détermine les ouvriers à revenir aux vieilles formes de l'association secrète, dont le compagnonnage, encore vivant chez les charpentiers et les cordonniers, fournit le modèle. C'est en 1827 que l'ouvrier eu soie Charnier, de Lyon, fonda la Société du Devoir Mutuel (les Mutuellistes), dont l'intention et le programme dépassent la simple prévoyance et la distribution de secours. Il a décrit lui-même, avec une précision naïve, l'effort qui était à faire et le but qu'il était désirable d'atteindre : Depuis plusieurs années, j'employais le temps qui s'écoulait en attendant d'être servi dans la cage à causer avec les chefs d'atelier sur l'art et les besoins de s'associer. Cet art consistait tout simplement à former des réunions de vingt, correspondantes entre elles afin d'éluder l'article 291 du Code pénal. Ces besoins, c'était l'indispensable nécessité de saper les nombreux et ruineux abus dont nous étions victimes : en tête, je citais l'inexécution des promesses des fabricants lorsqu'ils nous faisaient monter des métiers dispendieux pour un laps de temps qui est indispensable pour pouvoir couvrir les frais de montage. Ces promesses, leur disais-je, comme vous le savez, ne se réalisent presque jamais. Apprenons aux fabricants que nous savons compter et que nous connaissons nos droits. Mais avant, étudions ces droits, et nous sentirons que nous sommes protégés par la loi, que, si nous ne l'invoquons pas en temps et lieu, cette loi protectrice, ce n'est pas la faute du législateur, mais bien la nôtre. Réunissons-nous et instruisons-nous. Formons un foyer de lumière. — Si ce n'est pas par amour pour autrui, que ce soit au moins pour nos intérêts particuliers. Je sens que l'égoïsme ne peut s'extirper d'un seul coup. L'opération serait impraticable. Je vous le répéterai donc souvent. C'est pour nous-mêmes que nous devons aimer les autres. Nous avons dans nos ateliers une grande réforme à opérer. C'est l'insubordination, toujours croissante, résultant de l'inexécution de la loi sur les livrets d'ouvriers. La conséquence la plus onéreuse de l'inexécution de cette loi, c'est l'inexécution des contrats d'apprentissage. Nous ne paraitrons au grand jour que pour nous montrer hostiles contre l'insubordination de nos subalternes. Vous sentez que les fabricants crieraient hourra contre notre frété et naissante institution. Ils auraient promptement recours aux menaces de privation d'ouvrage contre ceux qui s'affilieraient avec nous, ils emploieraient même les sollicitations auprès de l'autorité pour nous intimider et nous désunir, au lieu qu'eut prêchant subordination et rien que subordination, nous endormirons nos argus, et réunirons les timides ; vous savez combien ces derniers sont nombreux parmi nous. La timidité, vous ne le savez que trop, est le type du canut. Nulle autre profession n'est si peu ouverte tune la mitre. C'est notre vie sédentaire, que dis-je, sédentaire, que ne dis-je plutôt casanière, qui influe ainsi sur notre moral ; il est étiolé comme notre physique. Il faut, pour remédier à ce double étiolement, créer à notre profession un esprit de corps. Pour y parvenir, il n'y a qu'une seule route, c'est l'association. Dans l'association, nous pourrons puiser toutes les connaissances de mécanique, de droit industriel, toutes les consolations à nos maux. Nous apprendrons que l'homme pauvre n'est pas un pauvre homme, que cette dernière dénomination n'appartient qu'à un homme dépourvu de probité. Axiome puissant pour nous procurer la résignation nécessaire à notre sort. Quand nous serons tous pénétrés de notre dignité d'homme, les autres habitants de la cité, dont, sans nous en douter, nous faisons depuis si longtemps la gloire et la richesse, cesseront d'employer le mot canut dans un sens railleur et injurieux. Le projet de Charnier aboutit d'abord (1827) à un programme timide de prévoyance, d'entente amicale, de services fraternels, d'indication mutuelle, entre gens qui ne sont pas seulement du même métier, mais tous d'une probité irréprochable, mariés, de bonnes vie et mœurs.... Le mutuellisme est basé sur l'équité, l'ordre et la fraternité ; telles sont les qualités que doivent avoir ceux qui le composent. Le but du mutuellisme est indication, secours et assistance ; tels sont les devoirs de chaque membre. En conséquence, le but du mutuellisme est donc, entre tous ses fondateurs, et ceux qui seront reçus frères : 1° de s'indiquer avec franchise et loyauté tout ce qui peut leur être utile et nécessaire, concernant leur profession ; 2° de sr secourir par te prêt d'ustensiles autant que possible, et pécuniairement au moyen de cotisations dans les malheurs arrivés à l'un d'eux ; 3° de s'assister de leur attention, de leur amitié et de leurs conseils, et lors de leurs funérailles et celles de leurs épouses, en se regardant et traitant comme frères jusque-là. Mais, tôt après, la société organise la résistance à la baisse des salaires. Elle prend le sentiment net qu'elle défend des intérêts de classe. Ses statuts modifiés excluent du Devoir mutuel les chefs d'atelier qui auraient plus de 6 métiers et de 2 apprentis, ceux qui seraient pères ou fils de négociants en soieries. Ses membres s'engagent à unir leurs efforts pour obtenir un salaire raisonnable... pour détruire les abus qui existent en fabrique à leur préjudice... L'année 1828 sera pour les canuts l'an 1er de la Régénération. La Société reste peu nombreuse, mystérieuse. Elle semble même s'être tenue à l'écart du grand mouvement qui, après 1830, enveloppa les tisseurs de Lyon dans une commune révolte contre la misère. Mais elle est significative d'un état d'esprit, d'un sentiment de classe dont la puissance éclatera bientôt. A cette heure, pour arrêter tout mouvement, la répression judiciaire suffit. Les tentatives de grève sont toutes châtiées par des jugements de tribunaux. En 1821, 60 tourneurs de Paris sont condamnés, pour délit de coalition, les chefs à deux ans, les autres à un mois de prison ; 16 charpentiers, de un à trois mois ; en 1822, 16 maçons, à un mois ; la grève des fileurs de coton du Houlme (Seine-Inférieure), en 1824, est sanglante, un gendarme est tué : un gréviste est condamné à mort, et trois autres aux travaux forcés. Le ministère de la Justice, qui dresse depuis 1825 une statistique annuelle, note 92 affaires de grèves en 1825, 40 en 1826, 29 en 1827, 28 en 1828, 13 en 1829, 40 en 1830. Ces incidents ne produisent aucune impression sur les
pouvoirs publics. Ils n'y voient que désordres qui relèvent de la police.
Tenir la main à la stricte exécution de la loi sur les livrets d'ouvriers,
empêcher les rassemblements séditieux, surveiller les fauteurs de coalition
et les punir, donner la chasse aux recruteurs qui, dans les moments de
chômage et de troubles, embauchent des ouvriers français pour l'étranger,
voilà à quoi se borne le rôle de l'État. Car la condition des ouvriers ne
préoccupe pas les partis. Les libéraux s'en tiennent à la législation
révolutionnaire ; si, à droite, on a parlé de la détruire, c'est par intérêt
politique et non par crainte de ses conséquences économiques. Les prud'hommes
de Lyon ont demandé en 1814 à Alexis de Noailles, commissaire extraordinaire
de S. M., de rétablir le règlement de 1744 pour la fabrique de soieries ;
excès de zèle royaliste, analogue à celui des fabricants de papiers peints de
Paris ou du député de la Chambre introuvable, Feuillant, qui proposèrent, les
premiers en 1814, le second en 1816, le rétablissement des jurandes et des
maîtrises. La Requête au roi et mémoire sur la nécessité de rétablir les
corps des marchands et les communautés d'arts et métiers, présentés à S. M.
le 16 septembre 1817, par les marchands et artisans de la ville de Paris
assistés de M. Levacher-Duplessis, leur conseil, avocat, signale avec
indignation la honteuse licence qui a envahi
le commerce et les manufactures, l'insubordination
dans les ateliers, la mauvaise foi la plus insigne dans le commerce...
l'autorité domestique des maîtres détruite,
l'indiscipline des simples ouvriers, l'apprentissage presque abandonné...
le commerce inondé d'ouvrages mal fabriqués qui
déshonorent l'industrie française. Quelques Conseils généraux émettent
chaque année, depuis 1817 jusqu'en 1825, le vœu de voir reconstituer les
anciennes corporations. Le président du tribunal d'Arras écrit en 1823 un Mémoire
sur l'établissement des jurandes. Mais, dès les premières manifestations
de ce genre, le Conseil des manufactures proteste contre ces opinions inconsidérées. Il voudrait (8 décembre 1814) qu'un avis bien
motivé et bien manifesté eût l'effet d'écarter pour toujours une question qui
a été résolue négativement par la grande majorité des personnes instruites.
En 1817, devant l'insistance des manifestations, il nomme une commission de
sept membres dont le rapport, approuvé unanimement, conclut qu'il n'y a lieu
ni à rétablir les corporations telles qu'elles existaient avant la Révolution
ni à les rétablir avec des modifications. La Chambre de commerce de Paris,
deux fois, en octobre 1817 et en février 1824, se prononce dans le même sens.
Ce sont là des discussions académiques. Le gouvernement s'oppose à toutes les
tentatives faites pour rétablir des règlements particuliers sur les heures de
travail ou sur le prix des façons. Dans l'opinion générale, le retour à
l'ancien régime apparaît comme aussi chimérique que la réforme radicale de la
société que préconisent Fourier et Saint-Simon. L'idée d'une intervention du gouvernement entre les patrons et les ouvriers reste également étrangère aux pouvoirs publics. Il y a eu pourtant, sous l'ancien régime, sous la Révolution, sous l'Empire, des tarifs débattus en commun par les représentants des uns et des autres ; ces tarifs sont de véritables contrats collectifs revêtus de la sanction administrative du préfet. Les Conseils de prud'hommes s'y conforment dans leurs jugements. Certains même ont été renouvelés au début de la Restauration. Tel, le tarif minimum du prix de façon des chapeaux, arrêté par le Conseil général des prud'hommes de Lyon et rendu obligatoire par le maire de Lyon (22 oct. 1817), rapporté un mois après devant les protestations des ouvriers, et remplacé par le tarif de 1807. Mais ils ne sont plus respectés ; l'administration, depuis 1819, cesse de les soutenir et ne conteste plus la doctrine du libre contrat individuel entre le patron et l'ouvrier[2]. C'est pourquoi, la quantité de main-d'œuvre disponible ayant augmenté après la cessation des guerres et la réduction de l'armée, les ouvriers ont dû offrir leurs bras à meilleur marché. Les économies imposées par la concurrence n'ont porté que sur les salaires, qui ont été comprimés et qui ont baissé sans discontinuer. Mais le souvenir du temps peu éloigné où fonctionnait le tarif n'est pas aboli chez les ouvriers. Le seul remède à leur misère, ils le voient dans un tarif équitable, réglé sur les besoins indispensables de la vie, et non uniquement sur l'intérêt du patron à diminuer son prix de revient. C'est l'idée qui, confusément, apparaît dans les grèves de la fin de la Restauration, et qui provoquera après 1830 la première grande émeute ouvrière, celle de 1831. Les ouvriers attendent vaguement de l'État un rôle de protection, de tutelle à l'égard des faibles, qui, dans la lutte économique, réduits à leurs seules forces, sont nécessairement vaincus. Un médecin, savant et philanthrope, a traduit leur pensée et dressé le programme de l'intervention de l'État. Dans son Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, Fodéré se prononce pour la tarification des salaires : Il serait éminemment utile que les salaires fussent taxés comme on taxe le pain, et ce, par une autorité indépendante des maitres et des ouvriers, telle que le Conseil du commerce et des arts industriels. Il voudrait aussi que le salaire fut complété par la participation aux bénéfices : La taxe (c'est-à-dire le salaire), pour être toujours équitable, devrait être divisée en taxe ordinaire et extraordinaire. La taxe ordinaire serait réglée en proportion des choses nécessaires à chaque classe d'ouvriers et en proportion du prix du blé. J'entends par taxe extraordinaire une augmentation temporaire du salaire en proportion du débit des productions et du profit que feraient les maitres surie travail de leurs ouvriers, augmentation qui cesserait avec le profit. L'intervention tutélaire de l'administration publique ne s'en tiendra pas là : elle doit être prévoyante pour les masses, de la même manière qu'elle l'est pour les enfants et les mineurs. La loi assurera une retraite aux vieux ouvriers de l'industrie et des champs. Ce que la philanthropie a fait faire spontanément à quelques-uns — Fodéré cite l'usine de fer-blanc de Fallacieux à Bains dans les Vosges, où les ouvriers, grâce à une retenue sur les salaires, ont. à soixante ans, une pension de 300 francs —, il faut que la loi le rende obligatoire partout. L'État ne fait-il pas une retenue sur le salaire des fonctionnaires ? De même, la caisse de consignation du Trésor royal recevra les versements mensuels des ouvriers, en accumulera les intérêts. Le patron et le propriétaire seront responsables du versement, que garantira une première hypothèque sur les biens-fonds et les fabriques. Enfin, la loi doit dire que le patron a l'obligation de réparer les dommages causés aux ouvriers par les travaux qu'ils accomplissent pour son compte. Il faut un règlement qui prescrive à tout entrepreneur de travaux dont la nature peut devenir essentiellement préjudiciable aux ouvriers, de s'obliger, par première hypothèque, à payer une pension aux ouvriers qui éprouveraient une mutilation en travaillant, ou dont la santé, pavement altérée par ces travaux, les mettrait dans l'impuissance de continuer à gagner leur vie, — une pension réversible sur les enfants jusqu'à leur majorité. Ce programme de législation sociale, tarif des salaires, retraites ouvrières. indemnités en cas d'accidents du travail, resta sans doute ignoré ; il ne donna lieu à aucun mouvement appréciable d'opinion ; il est certain qu'il n'attira pas l'attention des Chambres. Les députés et les pairs, qui consacrèrent une notable partie de leur temps et de leurs travaux à assurer, par des lois, aux classes supérieures les bénéfices qu'elles attendaient du monopole du marché national, n'eurent sûrement pas même l'idée qu'on pouvait utilement légiférer dans l'intérêt des classes inférieures. Les seuls intérêts économiques légitimes sont les intérêts représentés dans les assemblées politiques ; les autres sont considérés comme des affaires privées, abandonnés au jeu des lois naturelles, ou à la sensibilité des philanthropes. La satisfaction de ces intérêts n'est pas une affaire d'État, puisqu'il n'y a aucun inconvénient politique à les négliger ; aucun événement grave ne permet encore de voir un danger matériel dans les revendications qu'ils soulèvent ; on n'est encore poussé à agir ni par l'intérêt, ni par la peur. |