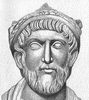JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
VII. — JULIEN EMPEREUR. - LES ENNEMIS DE LA BARBE. - LES PERSES.
|
Séjour de Julien à Antioche. — Adonis, Astartée, Christ et Babylas sont les quatre divinités favorites des Antiochiens. Comment Julien s'attire l'inimitié des Antiochiens. Caricatures, anapestes. Julien fait concurrence aux, agioteurs et aux galiléens ; il en triomphe. — Le Misopogon. — Julien marche contre les Perses. — Lettre caractéristique de Julien. — La Mésopotamie. — Julien veut refaire l'expédition d'Alexandre. — Retraite. En même temps que Julien accomplissait comme souverain pontife une suite d'actes supérieurs, propres à donner du premier coup à l'Église hellénique cette unité, cette cohésion que l'Église chrétienne devait mettre six siècles à obtenir, il exécutait comme souverain temporel une suite d'actions fort médiocres, propres à lui aliéner ceux que ses réformes ecclésiastiques lui avaient acquis. Ou plutôt, comme l'estime ou le mépris que les peuples font de celui qui exerce le pouvoir dépend bien moins de sa valeur intellectuelle que de la franchise ou de la fausseté de la position que le passé lui a faite, tout ce que Julien accomplissait comme souverain pontife lui réussissait, parce qu'une religion universelle et une forte unité spirituelle étaient les besoins de son temps ; et tout ce qu'il faisait de plus noble et de plus sage comme empereur tournait contre lui, parce que l'unité temporelle devenait tous les jours plus lourde et plus vexatoire, même pour ceux qui s'obstinaient à en rester théoriquement les admirateurs. La Mésopotamie, pays riche, mais ouvert et difficile à conserver comme frontière, passait sans cesse entre les mains des Perses auxquels il fallait la reprendre. Il n'y avait qu'une mesure sage, c'était de l'abandonner et d'essayer d'y fonder, comme en Arménie, une royauté indépendante, ayant les traditions romaines, liée à l'empire par la religion ; mais il fallait encore un siècle de triste expérience pour habituer les Gréco-Romains à l'idée d'une pareille solution ; si elle eût pu entrer dans la tête de Julien, il n'eût osé affronter la honte de l'exécution. Restaient donc deux conduites politiques à l'égard des Perses : celle de Constance, qui lui avait si peu réussi qu'il était au moment de l'abandonner quand il mourut, et qui consistait à reprendre une à une les villes tombées au pouvoir des Perses, à liguer contre eux les Sarrasins et autres peuplades barbares qu'il ne faut, dit A. Marcellin, nous souhaiter ni comme amis ni comme ennemis ; ou bien la grande politique qu'avait suivie Trajan, et qui convenait seule au vainqueur du Rhin : dompter les Perses. Cette entreprise devint la plus grande affaire du règne de Julien ; il dépensa dans les préparatifs immenses de la guerre des sommes auprès desquelles celle qu'il consacrait au culte et au clergé helléniques et à la charité publique paraissent peu de chose. Ces dépenses absorbèrent et au delà les économies qu'il avait obtenues par une meilleure collection d'impôts, par la suppression de la maison de l'empereur et des largesses dont Constance était prodigue ; elles le forcèrent à être d'une dureté blessante, souvent illégale, pour toutes les demandes d'exemptions, et à créer des taxes bizarres. Les habitants des grandes villes de Grèce et d'Asie eurent bientôt contre lui un second grief : l'habitude qu'il avait prise en Gaule de rendre personnellement la justice. Cette habitude attire à un souverain les éloges pompeux des historiens et des panégyristes, elle a même un certain prestige pour les contemporains qui vivent loin de la personne du monarque ; mais les peuples des villes qui en voient la pratique la considèrent le plus souvent comme un travers. On sait les innombrables contradictions que présentait alors le droit romain. Pour le moindre procès entre particuliers, il était d'usage d'invoquer les plus habiles jurisconsultes, car il y avait pour chaque question quatre ou cinq décisions contraires pouvant s'appuyer sur des textes. Julien, avec la naïveté philosophique, s'en fiant au bon sens et au sentiment inné du juste, jugeant d'un coup d'œil la bonne foi ou la perfidie des parties, tranchait résolument la question de droit dès qu'il avait décidé sur les faits, expédiait les causes et rendait des arrêts qu'A. Marcellin lui-même trouvait quelquefois doublement arbitraires. Julien arrivait au prétoire à pied, vêtu d'une grosse toge du temps de Marc-Aurèle, accompagné seulement d'un ou deux de ses intimes ; il y trouvait foule compacte, car on savait devoir s'amuser. Il parlait avec volubilité dès l'entrée, faisait des jeux de mots et des plaisanteries toutes les fois que les débats s'y prêtaient, souffrait les réflexions lancées par les personnes de l'auditoire, les raillait ou les approuvait. On riait, mais au retour on se disait que le nouvel empereur n'avait ni dignité, ni convenance, ni souci de son rang. On se rappelait Constance, qui de sa vie ne se moucha en public, qui parcourait les provinces sur des chars triomphaux, couvert de drap d'or et de tissus de perles, roide et immobile, s'interdisant même le mouvement des yeux, baissant seulement la tête quand il passait sous un arc de triomphe, comme pour faire croire que nulle porte n'était à sa taille ; et grâce à la magie du souvenir, on n'était pas loin de trouver que Constance avait été un vrai roi, que Julien était un roi de comédie. Si les airs négligés et familiers de Julien faisaient regretter les attitudes gourmées de Constance aux capitales d'Orient, amoureuses de toute parade et de toute fausse grandeur, la suppression de la maison impériale et des jeux de cirque et de théâtre payés par l'empereur fit à Julien encore plus de tort dans leur esprit. Comme chef et réformateur du clergé hellénique, son économie et la modicité de son train de maison étaient touchantes ; comme empereur, elles étaient ridicules et impolitiques. Les habitants de Constantinople n'en avaient pas trop senti les inconvénients, à cause des pompes et des sacrifices dont il avait fêté la restauration de l'hellénisme ; mais dès qu'il eut fixé son séjour à Antioche pour diriger les préparatifs de la guerre, il ne tarda pas à s'attirer l'inimitié ou le dédain des habitants, en raison même de toutes les espérances de plaisir et de richesse que la nouvelle de son arrivée avait fait naitre : on se souvint bientôt comme d'un mauvais présage qu'il était arrivé pendant les cérémonies de la passion d'Adonis. Au temps où Julien arriva à Antioche, le parti hellénique, qui s'était conservé puissant et zélé dans les villes voisines d'Émèse et d'Aréthuse, y était à peu près vaincu ou fort tiède ; il était représenté par quelques familles consulaires et sénatoriales, grands propriétaires fonciers dans les environs, exempts des charges municipales quand ils n'acceptaient pas de magistratures, et par les professeurs et les rhéteurs, dont Libanius était le plus illustre. Le parti galiléen au contraire était puissant et convertisseur ; c'étaient les armateurs, les banquiers, les gros négociants, les spéculateurs sur les grains, presque tous Juifs et Phéniciens hellénisés ; ils dominaient dans la curie, et sous le règne de Constance ils avaient obtenu pour le commerce d'Antioche des privilèges, des règlements protecteurs et, des fournitures qui les avaient fort enrichis. Leurs femmes avaient une grande influence sur le peuple par leurs aumônes journalières, et faisaient élever une foule d'enfants dans le galiléisme[1]. Au-dessous de ces deux partis s'agitait l'immense peuple d'Antioche, composé au moins pour moitié d'acteurs, de danseurs, de courtisanes, de gitons, de cochers et de mendiants, qui n'avaient d'autre moyen d'existence que les largesses des fêtes publiques, civiles et religieuses, et les repas que les femmes des galiléens leur donnaient aux saints sépulcres[2]. La religion de ce peuple était un singulier mélange de croyances chaldéennes, galiléennes et helléniques. Les quatre cultes également chéris du peuple étaient celui d'Adonis, celui d'Astarté, celui du Christ et celui de saint Babylas[3]. Les cultes d'Adonis et d'Astarté étaient les cultes nationaux, et, pour ainsi dire, officiels d'Antioche ; galiléens et hellènes y rivalisaient de luxe et de largesses pour s'attirer les bonnes grâces du peuple. La fête d'Adonis avait depuis longtemps quitté son ancienne forme syrienne pour prendre celle d'un mystère hellénique, analogue à celui de Iacchus ; il se célébrait à l'époque de la moisson : on y pleurait avec délices. Au contraire, la fête de la Maiume, célébrée spécialement en l'honneur d'Astarté, était une fête toute joyeuse ; elle avait lieu à l'époque de la floraison. Julien nous apprend que les moindres citoyens d'Antioche voulaient contribuer aux frais[4]. Le mystère en l'honneur du Christ se célébrait avec beaucoup moins de pompe et de solennité que celui d'Adonis, mais il revenait plusieurs fois l'an, et par cette fréquence tenait une grande place dans le culte et dans les dépenses municipales. La 'plupart des Antiochiens voyaient dans Christ, dans le Chi, comme ils l'appelaient, non Jésus de Galilée, mais le Messie, le terrible juge qui devait apparaître à la fin du monde. Enfin le culte de saint Babylas tenait une plus grande place encore à Antioche, parce qu'il était journalier. Apollon avait été jadis le patron de la ville ; le temple qu'il avait dans le faubourg de Daphné était célèbre dans l'Asie par les cures merveilleuses dont il était le théâtre, et plus encore par les merveilleux jardins dont il était entouré. Mais, sous le règne de Constance, les galiléens avaient réussi à faire accepter aux Antiochiens un nouveau patron[5], le martyr Babylas, dont les reliques avaient bientôt accompli des miracles auprès desquels ceux que faisait jadis Apollon avaient paru tout à fait méprisables. Dans un jour d'enthousiasme, les mendiants, que nourrissaient les galiléens, avaient pris les restes du saint, les avaient transportés dans le temple de Daphné, et avaient placé sa statue sur l'autel au lieu de celle d'Apollon. Dès lors Babylas avait hérité de tous les attributs du dieu de Daphné : cures merveilleuses, dons prophétiques, secours extraordinaires accordés à ses fidèles. Les jardins, où l'on avait placé d'autres sépulcres, étaient pleins, la nuit, de dormeurs, le jour, de prophétisants et de mendiants prenant leurs repas. Tous les Antiochiens, galiléens, hellènes, gens du peuple, apprirent avec une égale allégresse la prochaine arrivée de Julien dans leur ville. Le peuple espérait des parades, des revues de troupes, des jeux extraordinaires de cirque et de théâtre ; il comptait enfin que la piété du prince allait célébrer avec la même pompe qu'à Constantinople la restauration de l'hellénisme, et que les largesses et les sacrifices du souverain pontife laisseraient bien en arrière les repas et les aumônes des galiléens. Les galiléens, comptant sur ses promesses de tolérance, ne pensaient qu'aux avantages pécuniaires qui accompagnent la présence du prince dans une capitale ; ils espéraient de nouveaux privilèges et de nouveaux règlements protecteurs pour le commerce d'Antioche, et les fournitures de l'armée. Les hellènes enfin saluaient avec joie le chef et le restaurateur de leur culte. Au bout d'un mois, Julien avait déplu à tout le monde. La foule qui vint à sa rencontre fut fort désappointée de le voir arriver presque sans escorte, avec ses amis, tous plus ou moins prêtres ou sophistes, Maxime, Priscus, Oribaze, Himérius et Théodore. Il alla aussitôt sacrifier au temple du Génie et à celui de Jupiter, et comme il était salué par les acclamations, il fit défendre ces manifestations indécentes dans l'enceinte sacrée. Il se rendit ensuite au palais, dont il n'occupa avec ses compagnons qu'une petite partie, et congédia la foule sans lui promettre pour l'avenir aucune espèce de jeux. On sut bientôt que, loin de couronner comme son frère Gallus les cochers vainqueurs et les acteurs en vogue, il faisait profession de railler le cirque et le théâtre, et de n'y paraître jamais. Il s'immisça, quelques jours après son arrivée, dans les affaires municipales, apprit aux curiales que le lieu de réunion des troupes ne devait pas être dans leur ville, mais à Hiérapolis, enleva à Antioche tous les privilèges qui lui parurent contraires à l'intérêt des villes voisines ; et s'apercevant que le parti galiléen dominait dans la curie, il y fit rentrer violemment tous les grands propriétaires hellènes, refusant de reconnaître aucun droit acquis qui les dispensât de concourir aux charges municipales. Les rentes de la ville ainsi augmentées, il jugea qu'elle pouvait largement subvenir aux dépenses de ses différents cultes, et que, pourvu qu'elle répartit équitablement ses revenus entre tous, le trésor n'avait pas besoin d'aider le culte hellénique : Le seul acte qu'il se permit en faveur de sa religion fut la suppression du scandale de Daphné. Il ordonna de rapporter les reliques de Babylas dans l'intérieur de la ville, et rétablit Apollon dans son temple. Tout le monde se trouva ainsi déçu et mécontent, les hellènes plus que tous les autres, car les charges municipales dont ils se voyaient frappés étaient en raison de l'importance de leurs biens. Comme Julien ne laissait pas de montrer en toute rencontre son zèle pour les dieux, les Antiochiens saisirent la première occasion de lui faire voir qu'ils aimaient mieux moins de discours et de démonstrations de piété, et plus d'aumônes, de repas publics, de piété effective. Vers le dixième mois, dit Julien dans le Misopogon, se célèbre
l'ancienne solennité d'Apollon ; la ville devait se rendre à Daphné pour
célébrer cette fête. Je quitte le temple de Jupiter et j'accours, me figurant
que j'allais voir toute la pompe dont Antioche est capable. J'avais
l'imagination remplie de parfums, de victimes, de libations, de jeunes gens
aux blanches robes, symbole de la pureté de leur cœur ; mais tout cela
n'était qu'un beau songe. J'arrive dans le temple,
et je n'y trouve pas une victime, pas un gâteau, pas un grain d'encens. J'en
suis étonné ; je crois alors que les préparatifs sont faits dans les jardins, et que par respect pour ma qualité de souverain
pontife on attend mes ordres pour entrer. Je demande donc au prêtre ce que la
ville offrira dans ce jour si solennel : Rien, me répondit-il ; voilà
seulement une oie que j'apporte de chez moi. Alors — remarquez, je
vous prie, combien je suis de mauvaise humeur et combien je cherche à être haï !
— je fis à
votre sénat une verte réprimande. La réprimande n'y fit rien ; on fut ravi de voir que le coup avait porté ; on chansonna le prince en vers anapestes. Il y était question du chi et du kappa[6], qui avaient plus fait pour la ville qu'Apollon et son grand prêtre ; on y parlait de cette barbe de bouc qui ne permet pas d'appliquer lèvre contre lèvre, et qui ôte au baiser tout ce qu'il a de voluptueux. Que pouvait faire ce prince à la fleur de l'âge, au fond de sa cellule, où n'entrait jamais aucune femme ? Se contentait-il de converser avec ses prétendus philosophes qui le visitaient chaque jour ? Au lieu de se livrer à des débauches secrètes, un jeune prince, soucieux de son rang, aurait dû paraître sans cesse dans les théâtres et dans les rues, entouré de danseuses et de courtisanes magnifiquement vêtues, comme il n'en manquait pas par la ville, et de beaux esclaves dont les laines éclatantes et les membres élégants réjouissent la vue du peuple. Sur ces entrefaites, le feu prit au temple de Daphné ; Julien ne douta pas que ce ne fût une vengeance des amateurs de songes et des fidèles de saint Babylas, et il fit immédiatement fermer l'église où il avait fait transporter les os du martyr. Cette dernière mesure n'était point propre à calmer les Antiochiens, et comme ils savaient n'avoir point affaire à un Caracalla, ils montraient avec impudence leur mécontentement, écrivant leurs vers sur les murs, y dessinant les caricatures de Julien et de ses intimes dans des postures ridicules, et chantant sur le passage de l'empereur leurs refrains satiriques. Julien avait la faiblesse de s'affliger profondément de la haine des Antiochiens, d'autant plus qu'il avait compté s'attirer leur amour, en faisant partout régner l'ordre, la bonne administration, en délivrant les pauvres de l'oppression des riches. Mais tout tournait contre lui. S'étant aperçu dès son arrivée que les galiléens, ne craignant aucune concurrence du dehors, et sûrs, d'autre part, de trouver dans les pays environnants des débouchés pour leurs marchandises, tenaient les denrées de première nécessité à un prix exorbitant, il les pria de baisser leurs prix et de se contenter d'un gain légitime. Ceux-ci l'amusèrent trois mois par de belles promesses, et la récolte ayant été mauvaise, ils en profitèrent pour faire monter au delà de toute mesure le prix des grains. Julien, voyant qu'il n'obtiendrait rien de leur avidité, établit des maximum pour le pain, le vin, l'huile et la viande de boucherie. Cette mesure maladroite produisit son effet habituel ; le lendemain, la ville n'eut pas de marché, et le peuple affamé se mit à parcourir les rues en hurlant, et, assiégeant le palais, à injurier Julien, auteur de la famine. Le prince, pour la première fois de sa vie, entra dans une violente colère, et, oubliant la modération philosophique, il fit jeter en prison tout le sénat d'Antioche. La ville resta frappée de stupeur. Libanius, à la prière des femmes des incarcérés, courut chez son élève, lui représenta avec fermeté combien ces maximum et ces emprisonnements étaient peu propres à faire cesser la misère du peuple, combien ils étaient injustes, et Julien, rappelé au bon sens par son ami, fit relâcher immédiatement les sénateurs. Il renonça à leur imposer des maximum, mais il jura de sortir vainqueur de sa lutte contre eux ; il se fit marchand contre les marchands, et, ne reculant devant aucune dépense, il fit venir du blé et du bétail de Chalcédoine, d'Hiérapolis et des villes voisines, et, peu après, d'Égypte, et vendit le tout à moitié prix du cours. La concurrence resta d'abord inefficace, parce que les galiléens et les propriétaires se liguèrent pour acheter eux-mêmes sous main, par leurs clients et leurs esclaves, le blé et le bétail de Julien, au moment de leur arrivée. Mais Julien, qui s'en aperçut, fit vendre de son côté au détail sur le marché, et il les força enfin à baisser leurs prix, sous peine de ne plus vendre. L'abondance régna de nouveau dans la ville ; mais le peuple, qui avait maudit Julien pour la disette, ne lui sut point gré du bien-être qu'il lui devait. L'habitude était prise de le railler, et les anapestes dirent que c'était bien l'acte de cet esprit et de ce palais grossiers de s'inquiéter de fournir Antioche de pain et de viande, mais d'oublier le poisson, les huîtres et la volaille. Cependant les immenses préparatifs de guerre étaient achevés, Julien allait se rendre à Hiérapolis ; avant de quitter les Antiochiens, il voulut leur laisser une réponse à leurs anapestes, un monument de son indignation et de leur injustice, et il écrivit le Misopogon. C'est en effet un monument unique, un plaidoyer où les faits sont exposés avec une clarté parfaite, et une satire souverainement dédaigneuse et du meilleur ton ; on y voit un monarque absolu qui a souffert pendant une année les reproches injustes et les insultes d'une ville, sans avoir ordonné aucune arrestation ; qui cependant a le cœur ulcéré des injures de ses sujets, mais qui ne veut se venger de leurs écrits que par un meilleur écrit ; de leurs railleries que par une meilleure raillerie ; de la caricature qu'ils faisaient de ses mœurs rigides que par la simple peinture de leurs mœurs dissolues. Comme tous les habitants des grandes villes, les Antiochiens étaient amoureux des nouveautés littéraires et des moqueries spirituelles ; celle-ci eut un prodigieux succès : en huit jours, l'opinion tourna, et Julien fut porté aux nues. Il leur disait qu'il avait diminué leurs impôts d'un cinquième, et cela était vrai ; qu'il les avait délivrés de l'oppression des agioteurs et des gros propriétaires, et cela était vrai ; que, grâce à lui, les différents cultes se toléraient et recevaient dans une mesure équitable les secours municipaux, et cela était vrai ; enfin, il leur disait que celui-là a les mœurs les plus douces qui sait supporter celles d'autrui, quelque différentes qu'elles soient des siennes propres ; que, pour lui, il s'était résigné à supporter les leurs, mais qu'ils n'avaient pas supporté les siennes. Il ajoutait qu'il n'aurait tenu qu'à lui d'avoir raison d'eux par la force, car il était le maître, mais qu'ils pouvaient continuer à l'insulter librement, car il n'emploierait contre eux d'autre arme que la plume. Le jour de son départ, ce fut sur son passage un concours et un enthousiasme pareils à ceux qui avaient accueilli son arrivée. Ce n'étaient que vivat à Julien Auguste, triomphateur du Rhin et de l'Euphrate, que souhaits de victoires éclatantes, de riches dépouilles, de prompt retour dans Antioche. Mais Julien ne se laissa pas toucher ; il leur criait qu'ils le regardassent bien, car il ne remettrait jamais les pieds dans leur ville ; et il disait aux sénateurs d'Antioche, qui lui faisaient la conduite, que Tarse allait devenir la nouvelle capitale de l'Asie, que c'était là qu'il résiderait au retour. Julien avait choisi Libanius pour être l'historiographe de ses conquêtes ; à chaque grande station de l'expédition, il lui écrivit le gros des événements. De ces lettres, nous ne possédons malheureusement que la première, celle qu'il écrivit de Hiérapolis. Nous la donnons ici, sauf quelques passages : rien ne montre mieux ce que fut Julien. On y voit cet homme d'une activité surhumaine, dormant et mangeant à peine, passant la plus grande partie de son temps, ses- nuits surtout, à évoquer les anges, à jeter et rejeter les sorts, à étudier les entrailles, à rédiger avec son grand vicaire Maxime, qu'il emmenait avec lui, des bulles qu'il comptait dater d'Arbelles, de Suse et d'Ecbatane ; puis, au sortir de ses travaux pontificaux, de ses opérations théurgiques, au réveil de ses extases mystiques, se retrouvant l'esprit frais, dispos, lucide pour écrire une lettre d'homme du monde, archéologue et observateur, ou pour s'occuper avec minutie des mille détails qui ont trait à l'approvisionnement et à la sûreté d'une grande armée en marche. Ma première étape a été Litarbes. Le hasard m'a fait découvrir sur la route les restes d'un campement d'hiver du temps des Antiochus. Cette route se dessine entre des terrains marécageux et une montagne ; le paysage en somme est aride. Du côté du marais sont des pierres, évidemment groupées de main d'homme, mais non régulièrement taillées, quelque chose comme les pavés de nos villes. Elles sont liées par un ciment, mais la vase a remplacé la chaux. Au premier relais, j'avais reçu les députés de votre sénat. Ils
t'ont sans doute adressé déjà leurs plaintes. Je te raconterai la scène en
détails, si les dieux permettent
que nous nous revoyions bientôt. De Litarbes, j'ai été d'une traite à Berrhée. Là, Jupiter m'a donné les signes les plus propices ; j'y suis resté un jour entier ; après avoir visité la citadelle, et offert un taureau blanc à Jupiter, suivant la coutume des souverains, j'ai voulu discuter avec les sénateurs les affaires du culte. Ils ont commencé par approuver tout ce que je disais, mais en gens qui ne devaient en tenir aucun compte. Je savais d'avance à qui j'avais affaire, et que la plupart d'entre eux étaient des bien-pensants[7]. Mais, bientôt enhardis par mon aspect, ils ont peu à peu jeté le masque, et ont enfin montré toute leur impudence. Mon Dieu ! puisqu'il y a des gens qui par respect humain cachent leurs bons sentiments, ne faut-il pas qu'il y en ait aussi qui tirent vanité de la rapacité, du sacrilège, et de l'oisiveté de l'esprit et du corps ? Quel contraste avec Batné ! Voilà un séjour
incomparable ! Pour moi je préférerais Batné à l'Ossa, au Pélion, à l'Olympe,
aux illustres vallées de la Thessalie, et à Daphné même, si Jupiter Olympien
et Apollon Pythien n'y avaient leur séjour. Ce nom de Batné est barbare, mais
le pays est hellène ; on y vit, pour ainsi dire, enveloppé de l'odeur de
l'encens. Partout je voyais étalée la pompe des sacrifices, et cette vue me
plaisait et me déplaisait à la fois. Car j'aime, tu le sais, que
l'accomplissement des devoirs religieux ait un
caractère
d'intimité ; je veux que les cérémonies n'aient pour témoins que ceux qui s'y
intéressent directement par les sacrifices ou les vœux. Ce sont là de ces
sortes d'abus auxquels mes règlements vont bientôt mettre bon ordre. Batné est un champ fertile parsemé de cyprès en fleur. Le palais n'a rien de somptueux : c'est un bâtiment de terre glaise et de bois sans ornements. Le jardin est modeste, non dans le goût d'Alcinoüs, mais de Laërte ; au fond, un bosquet de cyprès ; longeant chaque mur, une allée de grands arbres bien alignés ; au milieu, une grande variété d'arbres fruitiers et de légumes. Qu'as-tu fait dans ce lieu ? diras-tu. Suivant mon habitude, j'ai sacrifié dans la soirée et à l'aube. Mes dévotions faites, je suis descendu à la ville, j'ai trouvé les citoyens venant à ma rencontre. J'ai été accueilli chez un hôte que je voyais pour la première fois, et qui cependant était depuis longtemps mon ami. Tu devines qui ? Je veux cependant écrire ici son nom, car je bois le nectar quand je peux entendre parler, parler moi-même d'un si beau sujet. Mon hôte est donc Sopater, le gendre et l'élève du divin Jamblique. Il faudrait être injuste ou criminel pour ne pas chérir un tel homme ; mais, étant devenu son hôte, j'ai un motif de plus de lui être attaché. Jadis il a été l'hôte de mon cousin et de mon frère, qui l'ont vivement pressé de renoncer à la vraie foi ; il a eu le courage de leur résister ; tu sais que c'était chose difficile. Voilà tout ce qui nous concerne personnellement, tout ce que nous voulons te mander de Hiérapolis, où nous nous trouvons présentement. Quant aux affaires militaires et politiques, il faudrait te voir pour t'en informer. Le détail exact en serait trop long pour être compris dans une, deux et trois lettres ; en voici seulement le résumé. J'ai invité les tribus sarrasines à se joindre à notre armée ; j'ai fait partir des agents habiles qui arrêteront les espions de l'ennemi et empêcheront nos projets d'être déjoués ; j'ai publié une ordonnance sur les délits militaires, que je crois à la fois douce et efficace ; j'ai réuni pour le service de l'armée quantité de chevaux et de mulets, ainsi que des navires qui transporteront sur l'Euphrate le froment, le biscuit et le vinaigre. Tu t'imagines le tracas que tout cela m'a causé ; tout ce que
j'ai dû dire et faire ne tiendrait pas dans la plus longue lettre du monde.
Je t'épargne donc l'énumération de toutes les lettres qu'il m'a fallu écrire,
et le détail des notes que j'ai prises sur les signes propices qui m'ont
accompagné jusqu'ici. Plaise aux dieux qu'ils m'accompagnent jusqu'au bout ! Les Perses Sassanides étendaient leur empire, plus ou moins régulier, jusqu'aux Indes, dans toutes les contrées qui avaient appartenu quelque temps à la monarchie des Séleucides ; dompter les Perses, c'était donc refaire les conquêtes d'Alexandre et renouer des alliances avec les princes grecs de l'Indus. C'était bien ainsi que Julien comprenait sa mission. En refaisant l'œuvre d'Alexandre, le souverain pontife comprenait qu'il soumettait du même coup les génies iraniens aux dieux hellènes, qu'il ôtait à la propagation du christianisme sa principale force, et empêchait cette religion détestée d'envahir la Gaule, l'Italie et l'Espagne, comme elle avait envahi l'Asie Mineure et la Grèce. Julien aurait bien voulu suivre le chemin d'Alexandre, et se rendre directement de Hiérapolis à Arbèles ; mais il n'y avait point de chance que les Perses lui disputassent, dans ces illustres campagnes, la domination de l'Asie ; ils n'attendaient que le moment où il aurait passé le Tigre pour envahir l'empire sur ses derrières. Il lui fallut donc avant tout les refouler jusqu'à Ctésiphon et ruiner tous leurs établissements dans la Mésopotamie. Il chargea son parent Procope de suivre la grande route de l'Asie, avec un corps d'armée qui devait compter trente mille hommes quand il aurait été rejoint par les contingents du roi d'Arménie, et lui-même, à la tête d'une armée deux fois plus nombreuse, il s'engagea en Mésopotamie, ayant à sa droite ; sur l'Euphrate, une flotte de douze cents navires chargés de vivres. La conquête de la Mésopotamie ne fut qu'une promenade militaire, illustrée par quelques combats d'avant-garde et quelques sièges. Tout le pays fut ruiné ; toute ville prise, rasée. Après la prise de Maogumalque, qui avait été brillante : Enfin, s'écria Julien, voici quelques matériaux pour le sophiste d'Antioche ! Le seul obstacle sérieux que les Romains rencontrèrent fut celui des eaux. Une foule de canaux établissaient des communications entre le Tigre et l'Euphrate ; les Perses lâchèrent les écluses, le camp romain fut un jour inondé, les chemins devinrent impraticables. Julien, par- des contre-travaux d'irrigation, fit chaque fois rentrer les eaux dans leur lit, ou, aidé de sa flotte, construisit des chaussées de bois et des radeaux. Julien arriva ainsi en face de Ctésiphon, dont il n'était plus séparé que par les eaux vastes et rapides du Tigre. Ce fut en amont de cette immense capitale, pleine de troupes, qu'il résolut de faire passer le fleuve à son armée. Il fit exécuter un canal un peu au-dessus de Ctésiphon, ou retrouva peut-être celui de Trajan, et ses navires, une fois parvenus sur le Tigre, lui servirent à transporter pendant une nuit ses troupes sur la rive gauche. Les bords du Tigre sont escarpés et difficiles ; les Perses, qui s'attendaient chaque nuit au passage, y faisaient bonne garde ; le combat fut rude et dura douze heures. L'armée perse rentra en désordre dans Ctésiphon, ou se dispersa sur la route de la Susiane. Il y avait alors environ un mois que Julien était entré sur le territoire des Perses ; il pouvait prendre enfin la route d'Alexandre. Auguste ne songea point à entreprendre le siège de Ctésiphon. La ville, bien munie et bien fortifiée, était trop vaste pour être investie ; elle eût été pendant tout le siège en communication avec les armées de Sapor. Julien était sûr de réussir à la longue à s'emparer de la ville, mais il y eût épuisé les forces de son armée et il eût fallu borner là l'expédition. Or les empereurs avaient déjà ruiné trois fois Ctésiphon sans avoir ébranlé pour cela l'empire des Perses. C'était au fond de l'Orient que Julien voulait les chercher pour détruire leur puissance. D'après les calculs de Julien, Procope et le roi d'Arménie, s'avançant le long de la rive gauche du Tigre, ne devaient plus être qu'à quelques journées de marche. II alla à leur rencontre, faisant remorquer sa flotte par ses troupes, dont elle occupait chaque jour un bon tiers. Mais Procope était encore à Nisibe à attendre le roi d'Arménie qui ne devait pas venir. Quelque importante que fût à plus d'un titre sa jonction avec un corps d'armée aussi considérable que celui de Procope, Julien se lassa bientôt d'attendre et de perdre un temps précieux. Impatient de s'avancer dans l'intérieur des terres, il brûla sa flotte, qui ne pouvait plus lui être d'aucune utilité et qu'il ne voulait pas laisser au pouvoir de l'ennemi, puis marcha à la rencontre de Sapor dans la direction de la Susiane, On était à la fin de juin ; l'armée romaine s'avançait dans de fertiles plaines couvertes de moissons déjà mûres, où le bétail et les cheveux trouvaient ample nourriture. Sapor, frappé de terreur, ne songeait point à attendre l'ennemi de pied ferme ; ses propositions de paix venaient d'être repoussées avec une inexorable hauteur ; il comprit qu'il était perdu si les Romains, tournant les montagnes, se répandaient dans la vallée du Gyndès ; il employa la suprême ressource des monarchies despotiques : il résolut de faire un désert devant l'armée de Julien. Les Romains virent donc se propager tout autour d'eux la fumée des moissons incendiées ; l'armée, en même temps qu'elle perdait tout espoir de renouveler ses provisions, était obligée de s'arrêter plusieurs jours de suite dans le même campement pour attendre que le feu fût éteint. Julien, égaré par la maladresse de ses guides, ou peut-être trompé à dessein par eux, jugea qu'il n'aurait pas le temps d'arriver jusqu'à Suse avant l'achèvement de ses subsistances ; il rebroussa brusquement, puis se porta vivement vers le nord, pour gagner la Cordouène à travers la haute Assyrie. Dès que les Romains rétrogradèrent, l'ennemi, jusqu'alors invisible, se montra. C'était ce qu'espérait Julien, qui comptait sur les batailles pour ranimer le soldat abattu par la chaleur et l'ennui. Il y eut un premier combat de cavalerie le 17 des calendes de juillet, où les Perses furent facilement repoussés ; il y eut un grand combat, soixante-dix stades plus loin, dans un lieu nommé Maranga, où la victoire resta encore aux Romains. Le Mérane, chef de lu cavalerie puma, et deux fils du roi y étaient présents. L'armée commençait à manquer de vivres, Julien fit distribuer les provisions des comtes. Ne se nourrissant que de bouillie, il n'eut aucun égard à leurs récriminations. Les Perses, instruits par leur défaite, semblaient vouloir se borner à des escarmouches, quand un matin on annonce à Julien, qui, sans avoir pris le temps de s'armer, poussait en avant une reconnaissance, que les Perses ont commencé une attaque générale. Il prend le premier bouclier venu, et, sans cuirasse, il court au combat. Il apprend en chemin que l'avant-garde, qu'il vient de quitter, lâche pied. Il y court. Pendant ce temps, les cataphractes perses chargent en flanc l'aile gauche, qui plie, et s'acharnent, à coups de lances et de traits, sur les escadrons romains déjà ébranlés par les cris et l'odeur des éléphants. Cependant la vue du prince, qui se multiplie pour faire face partout au danger, provoque un élan de l'infanterie légère, qui, prenant les Perses à dos, taille en pièces les hommes et coupe les jarrets des éléphants : Par ses cris et ses gestes, Julien signale aux siens cet avantage, il les anime à le poursuivre ; lui-même donne l'exemple, oubliant qu'il combat nu. Vainement ses gardes lui crient de se défier de cette masse de fuyards comme d'un édifice qui s'écroule : un javelot de cavalier, lancé par une main inconnue, effleure la peau de son bras, lui perce les côtes et s'enfonce dans le foie. Julien ne peut arracher le trait, dont le fer à double tranchant lui entame les doigts. Il tombe de cheval. On l'entoure, on le relève. Il est transporté au camp et mis entre les mains de ses médecins. |