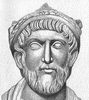JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
IV. — EUSÉBIE ET JULIEN. - SAINT JULIEN ET SAINT BASILE. - IACCHUS ET CHRIST.
|
L'empereur attire Gallus en Europe et lui fait trancher la tête. Indignation et douleur de Julien ; il est arrêté ; sa position critique. — Il est aimé de l'impératrice, qui lui sauve la vie ; elle le fait envoyer à Athènes. — Ce qu'était Athènes au quatrième siècle. — Longue intimité de Julien et de saint Basile ; extrême analogie de leur style, de leur caractère, de leurs croyances religieuses. Julien assiste au grand mystère d'Éleusis ; ce que ce mystère était devenu au quatrième siècle. — Iacchus est, comme le Christ, le Verbe incarné. — Eusébie obtient pour Julien le commandement des Gaules et le titre de César. — Résistance de Julien : sa gaucherie sous l'habit militaire. — Mariage de Julien avec Hélène : jalousie et cruautés de l'impératrice. Pendant ce temps, Gallus gouvernait l'Asie comme un enfant brutal. Il tenait toutes les promesses de son adolescence. Les courses et les pantomimes étaient devenues pour lui des plaisirs fades. Les combats du ceste, que la délicatesse de mœurs du Bas-Empire avait fait supprimer comme dégoûtants, furent rétablis par lui. Quand il voyait six boxeurs se briser les dents de leurs gants de plomb et se couvrir le corps d'épouvantables meurtrissures, il éprouvait plus de joie que s'il eût gagné une bataille. Quand des circonstances fortuites amenaient la famine dans une ville, il excitait le peuple à massacrer les gouverneurs, trouvant là un moyen facile de se rendre populaire, ou même partageant les préjugés de la foule. C'étaient décidément les femmes qui régnaient avec Constantine à la cour d'Antioche. Un certain Clémace, noble Alexandrin, ayant résiste aux désirs incestueux de sa belle-mère, celle-ci se rendit auprès de la reine, et obtint d'elle cul ordre immédiat de saisir et d'exécuter Clémace, qui fut mis à mort avant d'avoir pu ouvrir la bouche, et sans qu'on prît la peine de l'accuser d'aucun crime. Une autre fois, une femme de basse condition révéla à Constantine un prétendu complot contre les jours de César. Celle-ci combla de présents la délatrice, et, la plaçant dans son carrosse, la fit sortir du palais par la porte d'honneur. L'accusation d'aspirer à l'empire était pour Constantine le prétexte de meurtres continuels, soit qu'elle fût simplement avide des confiscations qui suivaient les condamnations pour crime de lèse-majesté, soit qu'elle crût à la réalité des complots, et qu'elle voulût se débarrasser de rivaux, réservant pour son époux seul ce genre de crime. Les jugements étaient de sinistres comédies, les rôles des juges et des accusateurs étaient réglés d'avance, et, pour qu'ils ne s'en écartassent point, la reine, cachée derrière une tapisserie, prêtant l'oreille, intervenait sans cesse dans les débats par des messages. Les plaintes de la noblesse d'Orient arrivaient jusqu'à Constance, et, bien que son gouvernement ne le cédât en rien pour l'arbitraire et la cruauté à celui de Gallus, il ne trouvait pas bon d'être imité à ce point. H avait d'ailleurs des sujets d'inimitié plus graves contre son beau-frère ; il n'ignorait pas que la force seule manquait à César pour s'élever contre lui, et cette force pouvait lui venir subitement. L'armée d'Orient venait de remporter l'avantage sur les Perses ; le soupçonneux Constance tremblait qu'elle ne s'éprit de la beauté et de la jeunesse de Gallus. Il essayait donc de retirer à César son armée ; employant dans ses lettres le ton le plus doux et le plus amical, il feignait de craindre que le soldat, devenu turbulent par l'inaction, n'en vint à conspirer la perte de Gallus. Il engageait celui-ci à se contenter des palatins, des protecteurs, des scutaires et des gentils. En même temps il le priait de venir le trouver à Milan. Ils devaient prendre ensemble des mesures polir lesquelles les correspondances et les messages étaient insuffisants. Ces entrevues devaient faire cesser les malentendus qui avaient paru les séparer. Gallus, ou plutôt Constantine, vit bien qu'il ne fallait ni refuser ni obéir. Entrer en révolte ouverte, il n'y fallait pas songer. L'armée d'Orient demandait autre chose qu'un Gallus, une autre gloire et une autre fermeté, pour oublier que Constance était l'héritier légitime du grand Constantin, et qu'elle avait elle-même égorgé les Flaviens pour lui assurer l'empire. Constantine résolut donc d'envoyer lentement et une à une les cohortes en Europe ; en même temps, elle faisait répondre que César se rendrait auprès d'Auguste dès que sa présence en Orient ne serait plus rendue indispensable par les complots qui se tramaient chaque jours contre les souverains. — C'était ajourner à jamais le voyage, car on trouvait toujours à souhait des crimes de lèse-majesté. A cette réponse, Constance se livra en présence de ses eunuques aux plus violentes imprécations ; mais, comme il avait peur, il n'en laissa rien paraître en public et se contenta d'envoyer à Antioche le préfet Domitien. La mission dont il le chargeait était des plus délicates ; il devait intimider Gallus, lui montrer qu'il se perdait en n'obéissant pas à l'ordre d'Auguste, et en même temps le traiter avec un respect et une cordialité tels que César se décidât sans soupçon au voyage d'Italie. Domitien, voulant dès l'abord frapper un grand coup et se placer vis-à-vis de César comme représentant de l'autorité supérieure, ne trouva rien de plus habile en arrivant à Antioche que de passer devant le palais en grande pompe, et, sans y entrer, de se rendre droit au prétoire. Le fier Gallus, indigné de ce manque de convenance, le somme vainement pendant plusieurs jours de se présenter au consistoire. Enfin Domitien se décide à y paraître, et dès l'entrée il s'écrie brusquement : César, il faut partir, comme on te l'ordonne ; si tu tardes, je fais immédiatement cesser les envois de bouche pour ta table et ta maison. Après ces paroles insolentes, il se retire et refuse dès lors de reparaître à la cour, malgré les injonctions réitérées de César. Celui-ci, ignorant les colères prudentes de Constance, s'assura de la personne du préfet et le fit garder par les protecteurs. Montius, questeur, ayant excité les palatins à délivrer Domitien, Gallus le fit massacrer par les soldats qui, une fois excités au meurtre, allèrent chercher le préfet dans sa prison, le garrottèrent et le traînèrent par les rues de toute la vitesse de leurs jambes. Domitien mort, son gendre et plusieurs autres fonctionnaires d'Asie furent saisis et accusés d'un complot contre les jours de César. Les rapports entre les deux princes allaient toujours s'empirant. Les nouveaux meurtres accomplis juridiquement, Constantine se décida à se rendre auprès d'Auguste, comme précédant l'arrivée de son mari. Elle espérait beaucoup en son influence sur son frère ; et peut-être en effet aurait-elle réussi à l'intimider, à le tromper et à lui arracher des concessions ; mais, à peine arrivée en Bithynie, elle mourut d'un accès de fièvre. — Cette mort était celle de Gallus. Avec sa femme, il perdait son âme et sa résolution ; il ne sut plus qu'obéir aux ordres de Constance, et se dirigea vers l'Italie. Le tribun des scutaires, Sendélon, émissaire de Constance, esprit fin et rusé sous l'enveloppe de la bonhomie militaire, finit par le convaincre de la sincérité de son beau-frère et de la tendre impatience qu'il avait de le revoir. Gallus était si rassuré, qu'en arrivant à Constantinople il y donna des courses de chars et voulut couronner le cocher vainqueur. Pendant ce temps, Constance, craignant toujours une arrière-pensée de sa victime, retirait les garnisons des villes où il devait passer ; puis il envoyait à César, sous prétexte de pourvoir aux grands offices de sa maison, divers personnages qui n'étaient en réalité que des gardiens. Gallus eut bientôt lieu de le connaître. Quand il arriva à Andrinople, il apprit que des détachements de la légion thébaine envoyaient vers lui une députation ; ses gardiens l'empêchèrent de s'aboucher avec les légionnaires, qui voulaient lui offrir l'appui de leurs corps et l'engager à ne pas aller plus loin. A mesure qu'il avançait, les respects et les soins diminuaient ; il n'eut bientôt d'autre ressource que les plaintes, les prières et les malédictions. Enfin, quand on fut arrivé à Pétobion, ville de Norique, un cordon de sentinelles fut mis autour de sa maison, et le comte Barbation, autrefois capitaine de ses gardes, entra chez lui, lui ôta les habits royaux, le revêtit d'une tunique et d'un manteau communs, et, tout en protestant que les ordres du prince n'allaient pas au delà, il le fit monter dans une charrette et le conduisit à Polla d'Istrie. C'était dans cette ville que le fils de Constantin avait été exécuté par ordre de son père. Là on fit subir au pauvre Gallus, devenu plus pâle que Némésis, un interrogatoire sur les meurtres ordonnés par lui à Antioche. Il trouva à peine assez de voix pour les rejeter sur sa femme Constantine. On lui lia les mains et on lui trancha la tête. Dès que Gallus fut exécuté, l'empereur fit saisir Julien à Nicomédie. On le conduisit à Milan et on le garda à vue. Cette mesure n'était pas une précaution inutile : Julien, aveuglé par son amitié pour son frère, ne crut jamais à sa culpabilité. Tout au plus avoue-t-il qu'il était un peu brutal, encore rejette-t-il ce défaut sur Constance, qui lui avait fait donner une mauvaise éducation. L'indignation de Julien fut donc aussi grande que sa douleur en apprenant la mort ignominieuse de Gallus. Il voyait dans Constance le meurtrier de son père, de son frère et de tous les siens ; il ne pouvait douter, et il avait raison, que Constance ne voulût aussi le condamner à mort ; s'il avait été en position de s'aboucher avec la légion thébaine, il eût sans doute accepté sans hésitation la révolte. L'empereur vit donc juste en le faisant saisir et en ordonnant qu'on l'impliquât dans le procès de son frère. Mais Constance avait affaire à trop forte partie, à un jeune homme qui, en danger de mort violente depuis son enfance, avait appris à dissimuler et à manœuvrer avec un sang-froid et une habileté supérieurs. Constance ne devait pas persister longtemps dans ses résolutions excessives. Le premier soin de Julien lut de faire agir en sa faveur les évêques ariens qui, dupes de ses démonstrations pieuses, le croyaient un des plus fidèles appuis de leur secte, et décidé, s'il régnait jamais, à achever leur triomphe sur les athanasiens. Ayant ensuite connu les mauvaises dispositions des eunuques, dont la police était mieux faite que celle des évêques, qui savaient à quoi s'en tenir sur son compte, et qui étaient d'ailleurs les ennemis nés de tout caractère viril, il se tourna vers l'impératrice. — Le mépris qu'il avait pour les femmes en général tombait devant celle-ci, et, si son intérêt ne l'avait exigé, la sympathie seule l'aurait engagé à se lier avec elle. Cette sympathie était réciproque ; depuis longtemps Eusébie désirait le connaître ; la réputation de science et surtout d'austérité de ce tout jeune homme avaient éveillé sa curiosité. Dès qu'elle l'eut vu, elle fut entièrement sous le charme et dominée par lui ; elle devint plutôt son élève et son admiratrice que sa protectrice. Julien était loin d'être beau ou élégant ; petit, la tête enfoncée dans les épaules, son air n'avait rien de militaire ni de majestueux[1]. Quand il n'avait pas de raison pour se surveiller, qu'il se laissait aller à sa nature, et qu'il s'animait en parlant, il avait une abondance de gestes qui tournait à la contorsion. Sa conversation était aussi abondante que son geste et son style : il allait de côté et d'autre, abordant tous les sujets, jetant sur tous la lumière et les images saisissantes, mais sans méthode ni plan. Il y montrait la vivacité de son imagination et la profondeur de son esprit, mais il éveillait la pensée sans instruire. C'était ce qu'il fallait pour séduire une femme telle qu'Eusébie. Il dut se l'attacher bien plutôt par le feu avec lequel il traitait les sujets généraux et lui racontait ses visions célestes que par la peinture de ses infortunes. Quelque peu habitué qu'il fût à flatter les femmes, son érudition lui fournit, avec aisance et naturel, les comparaisons les plus agréables pour Eusébie entre elle et les prêtresses et femmes poètes qu'avait célébrées l'antiquité. Elle dut facilement se persuader qu'elle était aimée. Si en effet une femme à jamais tenu une place importante dans la pensée et l'imagination de Julien, ce qui est douteux, c'est la seule Eusébie. Marié depuis à une autre femme, Julien parait s'en être peu occupé et être devenu veuf sans grand regret. L'amour qu'Eusébie crut inspirer ne flattait pas seulement ses goûts, mais ses intérêts. Beaucoup plus jeune que Constance, n'ayant pas su lui donner d'enfants, elle devait envisager avec effroi la perspective d'un veuvage prochain, qui la livrerait sans protection à la vengeance des eunuques. Du moment qu'elle se décidait à faire vivre le plus proche héritier du trône, il fallait se l'attacher, et se l'attacher, s'il était possible, par un sentiment plus vif que celui de la reconnaissance. Elle dut souvent caresser l'espoir de devenir une seconde fois impératrice, non plus avec un valet d'eunuque, mais avec un homme intelligent et actif qui, à vingt-quatre ans, passait pour le premier parmi les sages, et dont bientôt elle allait faire, malgré lui, le premier homme de guerre de son temps. Ils commencèrent donc à se voir autant qu'ils le pouvaient sans exciter les soupçons, s'écrivant lorsque la prudence les forçait à ajourner leurs entrevues, et profitant de la politesse excessive qui était alors de mode dans les lettres pour se dire tout le bien qu'ils pensaient l'un de l'autre : L'autorité d'Eusébie sur Constance eut pour effet immédiat d'ajourner le procès de Julien, et par conséquent lui sauva la vie. Elle sollicita ensuite pour son protégé une entrevue de l'empereur, en présentant à celui-ci son panégyrique que Julien venait de terminer. Auguste résista six mois. Comme tous les gens faibles, il ne connaissait qu'un moyen d'échapper à l'influence d'une personne, c'était de ne pas la voir. Envoyer à la mort Julien qu'il connaissait à peine, c'était pour ce prince timide une décision facile ; mais l'avoir devant soi, l'entendre discuter sa vie, se voir forcé peut-être de changer de décision, c'était pour Constance un sujet de terreur. Cette terreur était légitime, car Julien sortit de cette entrevue justifié et presque en faveur. On l'accusait d'avoir, pendant ses voyages en Asie, mené une existence mystérieuse et lié commerce avec les émissaires de Gallus ; en second lieu, d'être allé à Constantinople sur le passage de Gallus. Quand il avait su que son frère arrivait à Constantinople, il s'était en effet départi de sa prudence habituelle et de cette loi qu'il s'était faite de ne jamais voir son frère, de ne jamais lui écrire ; il avait espéré pouvoir le dissuader d'aller plus avant. Mais il était trop tard ; Gallus était cerné, et une surveillance active avait empêché les deux frères de s'entretenir un seul instant en particulier. Julien se défendit avec une froideur respectueuse, parlant de son frère comme d'un inconnu, sans prendre son parti ni accuser sa mémoire. Il répondit d'abord la même chose sur les deux chefs d'accusation. Toutes les fois qu'il s'était déplacé, ne fût-ce que pour aller de Nicomédie à Constantinople, il avait toujours préalablement demandé et obtenu l'autorisation de l'empereur et de ses préfets. Il parla ensuite de son existence depuis sa sortie de Macelle ; il dit que ses seules préoccupations dans ses voyages, dans ses séjours à Constantinople, à Éphèse et à Nicomédie, avaient été les lettres, les sciences et la théologie ; que tout rôle politique lui serait insupportable. Il en fournit des preuves et démontra par des détails caractéristiques qu'il avait mis là, en effet, sa vie et son bonheur. Il sut flatter par le récit de ses recherches et de ses découvertes la manie littéraire de Constance. Il mit aux pieds de l'empereur toute la science qu'il avait acquise, lui disant qu'il l'avait eu pour premier instituteur, et que c'était en composant les discours dont Auguste daignait autrefois lui fournir les sujets qu'il avait acquis le goût de l'étude. Le succès de Julien fut tel, que les eunuques eurent peur. Ils empêchèrent une seconde entrevue qui devait avoir lieu entre les deux cousins, et firent intimer à Julien l'ordre de retourner en Orient. Eusébie, sur la demande expresse de Julien, lit modifier cet ordre et obtint pour lui la permission d'aller à Athènes. Julien se rendit à Athènes, non plus suivi du pompeux cortège convenable au frère de César, mais dans le simple appareil philosophique qu'il préférait à tout. Sa renommée ne l'en précéda pas moins. Il était connu pour une fontaine de science, et les étudiants, occupant la route où il devait passer, le conduisirent à grand bruit jusqu'au bain, suivant la coutume. Athènes était alors plus riche et plus peuplée qu'au temps de son importance politique ; les fils de famille y venaient étudier et dépenser leur patrimoine de toutes les parties de l'empire. Pas d'honnête homme qui n'y eût passé quelques années. Bien que tout y fût construit dans de petites proportions, que les chambres fussent de vraies cellules d'ascètes et de rhéteurs, les situations pittoresques, les distances bien prises des bains, des temples et des portiques lui donnaient un aspect plus grand que celui d'Antioche ou de Césarée. Dans les cours intérieures entourées de colonnes, dans les lesché, sur les places, en plein air, on y menait la vie de libre discussion. C'était la ville des phrases bien tournées et des spéculations subtiles ; tout y parlait et y argumentait. Des portefaix et des marchands de poisson, devenus par le contact beaux diseurs et théologiens, y fondaient des écoles, comme jadis Ammonius à Alexandrie. Les utopies de la République de Platon y étaient réalisées. Dès que Julien fut arrivé, il fut admiré et admira ; il se sentit chez lui, il fut pénétré de ce parfum unique, il aima Athènes d'un grand amour, il souhaita d'y vivre et d'y mourir. Il ne devait la quitter, pour reprendre le combat de la vie, qu'avec des larmes. Cet effet produit par Athènes, tous les jeunes gens distingués du quatrième siècle le ressentaient comme Julien. Basile et Grégoire de Nazianze, qui s'y trouvaient alors, expriment les mêmes sentiments. Ils nous parlent d'Athènes comme d'une ville sainte, qu'on ne quitte qu'avec une profonde douleur. Bien que la vue des délicats y fût souvent choquée par les débauches des étudiants vulgaires, l'esprit trouvait dans le commerce des sages des compensations qui restaient seules dans le souvenir une fois qu'on avait quitté la Grèce. Là, la justice et la sagesse apparaissaient aux jeunes gens dans toute la rigueur de leurs lois, dans toute la beauté de leurs proportions, comme objet de recherches scientifiques, intéressantes par elles-mêmes, indépendantes et absolues, dégagées de tous les compromis et de toutes les inconséquences de la pratique. Plus tard, Basile, mêlé à la vie active, devait se courber humblement devant l'autorité ecclésiastique, puis se roidir contre la tyrannie des empereurs, faire des concessions sur ses doctrines, ou ne les dire qu'à moitié pour éviter le scandale dans l'Église et ne pas avoir toutes les hérésies à combattre à la fois ; Julien, devenu l'ennemi de Basile, devait succomber sous une tâche au-dessus de ses forces ; mais à Athènes, tous deux amants de la même sagesse, du même idéal, rapprochés par Libanius, leur maître et leur ami commun, devaient vivre dans la plus agréable intimité. Il ne faut donc pas croire Grégoire de Nazianze lorsqu'il nous dit qu'en examinant Julien pendant son séjour à Athènes, il avait remarqué en lui Je ne sais quoi d'égaré et d'hypocrite, et qu'il avait deviné dès lors toute sa perversité. C'est là un de ces mensonges de bonne foi comme en font toujours les hommes mûrs lorsqu'ils racontent les opinions de leur jeunesse. il faut se souvenir qu'au moment où Grégoire parlait ainsi, Julien venait de faire subir à l'Église une persécution d'un genre unique, bien autrement sensible à un poète, à un orateur, à un grand seigneur érudit comme Grégoire de Nazianze, que n'aurait pu l'être une persécution brutale qui n'en aurait voulu qu'à ses biens et à sa vie. Persécuteur hautain et délicat comme peuvent seuls l'être les apostats qui n'ignorent aucun secret du sanctuaire, Julien venait de convaincre les chrétiens d'ignorance et d'inconséquence théologique, de grossièreté d'esprit, et, leur défendant la lecture d'Homère et de Démosthène, il les avait réduits au grec barbare de saint Lue et des traducteurs de la Bible[2] : les souvenirs de cette tyrannie et de cette honte, qui blessaient Grégoire dans ses goûts les plus chers et ses prétentions les plus justifiées, doivent rendre son témoignage suspect. En tout cas, si, pendant son séjour à Athènes, il prit Julien en antipathie, ce sentiment avait une tout autre cause qu'un dissentiment religieux. Basile et Grégoire habitaient la même maison ; ils étaient liés d'une étroite amitié. Quand Julien vint se mettre de la partie, il put exciter la jalousie de Grégoire. L'instruction de celui-ci était plutôt littéraire que scientifique, et Basile s'occupait alors avec ardeur d'astronomie et de géométrie, sciences dans lesquelles Julien était un des hommes les plus versés de son temps. Basile, averti par Libanius, dut donc saisir l'occasion de s'instruire et négliger le poêle pour le savant. Quand on lit l'Hexameron
à côté du discours sur le soleil-roi, on trouve une telle analogie entre les
deux cosmologies qui y sont exposées, qu'elle semble n'être pas suffisamment
expliquée par l'analogie d'éducation, et qu'elle parait être le résultat de
la longue intimité de Julien et de Basile. A quelques noms près, il y a
identité. Ceux que Julien appelle indifféremment des dieux ou des anges,
Basile les appelle seulement des anges, réservant le nom de Dieu pour l'Être
suprême. Ce Dieu suprême, Julien l'appelle le Dieu-soleil, le soleil idéal et
invisible ; Basile, le nomme la Lumière idéale et invisible : c'est le même
Dieu. Quand Basile parle des réservoirs d'eau que le Dieu de la Bible établit
dans le ciel pour fournir du feu jusqu'à la consommation des siècles,
n'est-ce pas le Dieu-océan du discours au soleil-roi, la forme icosaédrique,
divisible en tétraèdres : Quand Basile, pour prouver que la Genèse a été
véritablement dictée par Dieu, vante la sublimité de cette ex pression : Que le sec
paraisse, et qu'il s'écrie : Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit la terre ?
parce que terre est le nom de la matière, du sujet, mais que le sec en caractérise la nature intime ; ne croit-on pas entendre
Julien admirant quand même la sublimité d'un rite ou d'une pratique
hellénique ? Pour Basile comme pour Julien, le monde invisible précède le
inonde visible ; ce dernier n'est que la détermination dans l'espace et le
temps des idées ou formes contenues dans le premier et que l'énergie du Verbe
a fait sortir du sein du Père[3]. Mais pour
Julien, le monde invisible précède le monde visible dans l'ordre des causes
et non dans celui des temps. Julien, qui ne croit pas à la fin du monde, ne
croit pas non plus à son commencement ; tandis que Basile croit qu'un certain
point dans le temps, comme dans l'espace, a été choisi librement par le
démiurge pour créer l'univers. Grande différence entre leurs doctrines, qui
devait faire de Basile un saint et qui avait déjà fait de Julien un apostat. Mais, à l'époque de son séjour à Athènes, cet unique dissentiment ne devait pas être aussi sensible à Basile qu'il le fut depuis. Il n'était alors chrétien que par tradition de famille, et il cherchait plutôt la sagesse dans la Bible qu'il ne l'avait trouvée. Il ne s'était pas encore éveillé, comme il nous le dit, du profond sommeil de la science ; il n'était qu'un jeune homme désireux de s'instruire, et il n'avait pas encore regardé la vraie lumière de l'Évangile. D'ailleurs, si Basile différa d'opinion avec Julien sur la création du monde et sur sa fin par la venue du Christ, il resta toujours d'accord avec lui sur un point plus important : il crut toujours, avec Origène et Julien, que les hommes étaient des anges déchus, enfermés dans le corps comme dans une prison. Il se plaisait à croire qu'il s'envolerait après sa mort dans la région de l'inaltérable, et le dogme de la résurrection de la chair blessait malgré lui sa délicatesse patricienne. Aussi saint Basile respecta toujours le souvenir de son ancien compagnon d'études. Il resta lié intimement et entretint un commerce de lettres jusque dans sa vieillesse avec Libanius, le panégyriste et l'admirateur déclaré de Julien et de sa religion. Il détesta les desseins de Julien, mais non sa personne. La parenté de ces deux esprits était trop étroite : même style recherché, même amour pour les comparaisons hasardées et les fleurs de rhétorique[4], même amour pour les nombres, la physique, même manque de mesure, même mépris pour la chair, même besoin de courir au-devant de la souffrance physique et de s'imposer de privations et des labeurs. Saint Grégoire de Nazianze (Ép. VIII) plaisante agréablement saint Basile, qui l'avait engagé à venir vivre dans sa solitude. Il s'en sauva bien vite. Le pain, dit-il, était si dur, que les dents glissaient dessus ; il y serait mort de faim, de soif et de froid, emportant plutôt la compassion des hommes que leurs louanges, sans le secours de la mère de Basile. Julien, qui, à Paris, défendait qu'on allumât du feu dans sa chambre au plus fort de l'hiver ; Julien, qui aimait le célibat comme plus élevé que l'état de mariage ; Julien, rigoureux observateur dos jeûnes imposés par la religion hellénique, aurait été heureux de vivre ainsi en compagnie d'un homme tel que Basile. Comme Basile, il ne haïssait point les véritables ermites, mais ceux qui, comme il le dit, vendaient des biens insignifiants pour prendre ce titre d'ermite, et qui, au lieu de vivre dans de pieuses colonies, pourvoyant eux-mêmes à leurs besoins, abusaient de leur prétendu désintéressement pour vivre d'aumônes, envahir les palais des grands et des princes, leur en imposer par de prétentieux bavardages et des airs de sainteté, et se livrer, sous couleur de mysticisme, à toutes leurs passions, surtout à leur paresse incurable. Cette engeance n'était point une plaie particulière au christianisme ; c'était le grand malheur du temps. L'hellénisme avait aussi ses faux ermites, et Julien confond les deux espèces dans le même mépris. Il avoue même que, si les galiléens avaient pris l'intolérance aux Juifs, c'était aux hellènes qu'ils avaient pris la paresse érigée en système comme un nouveau et véritable culte de la Divinité. Julien passait donc sa vie à Athènes à fréquenter les écoles, à discuter sur l'essence des choses avec chacun, et surtout à lire et commenter la Genèse avec Basile ; essayant de lui prouver que Moise ne connaissait pas aussi bien que Platon la nature des anges et la manière dont le monde visible était sorti du sein du démiurge[5]. Il profita en outre de son séjour à Athènes pour assister aux mystères d'Éleusis. Il y avait dans les mystères d'Éleusis une telle majesté, ils étaient défendus par une antiquité si haute, par de tels souvenirs, par une si grande sympathie de la foule, qu'ils continuaient à être célébrés sous les empereurs chrétiens avec la même pompe et le même concours que dans les siècles précédents. Sauf quelques modifications dans les pratiques préparatoires, les galiléens en suivaient les cérémonies avec la même ardeur que les hellènes. Les fêtes de Noël et de Piques, telles que nous les célébrons aujourd'hui, n'étaient pas encore régulièrement instituées ; elles ne purent l'être qu'après le triomphe définitif du christianisme. Depuis longtemps Iacchus avait pris le principal rôle dans les Éleusinies ; il avait presque entièrement remplacé Proserpine : les chrétiens pouvaient voir dans le nom de ce dieu une épithète donnée au Messie, ou du moins associer la naissance, la mort et la résurrection de cette divinité à celles du Sauveur. Julien put donc suivre ces mystères sans exciter les soupçons, et ce fut avec délices qu'il se vit pour la première fois en position de faire publiquement acte d'hellène. L'idée qu'il pourrait donner carrière à son ardente piété n'avait pas été étrangère à la joie qu'il avait ressentie en partant pour Athènes. D'après les conseils de Maxime, il s'était lié dès son arrivée avec l'hiérophante. Bien que ces fonctions exigeassent le célibat, elles se conservaient dans les mêmes familles, et il dut trouver dans ce pontife un homme savant dans les choses sacrées et capable d'éclairer sa foi. Quand Julien arriva à Athènes, le temps des petites Éleusinies, où l'on fête la naissance du dieu, était passé ; il résolut de suivre les grandes Éleusinies comme myste, c'est-à-dire non en simple curieux, mais en accomplissant tous les rites, en recevant tous les sacrements, en étant à la fois acteur et spectateur. Pendant le mois qui précède l'équinoxe d'automne, il s'abstint de grains, de raves et de poisson[6], et se disposa par des sacrifices et des prières à se rendre digne des faveurs célestes. Dix jours avant l'équinoxe, la foule des fidèles venus de tous les pays grecs se rassembla tumultueusement devant le Pœcile. L'hiérophante parut et lut les conditions exigées pour assister au mystère. Cette lecture n'était plus alors qu'une formalité, et tout le monde pouvait voir les Éleusinies ; toutefois, la partie du programme qui recommandait aux mystes l'ordre, la décence et le silence ne fut pas sans effet. Le lendemain, le bord de la mer était plein de fidèles se livrant aux ablutions et aux purifications prescrites. Ensuite vint le sacrifice solennel dans le temple de Cérès à Athènes, puis le jour des Épidauries, où l'on demande à Esculape la santé de l'esprit et du corps. Enfin, le lendemain, la longue procession se mit en marche. Les mystagogues portaient l'image du dieu ; les mystes, des rameaux à la main, les suivaient en chantant dés hymnes et en exécutant les danses sacrées. La foule les accueillait par des cris de joie tout le long de la voie Sacrée, et jetait des manteaux devant la statue. On arriva à Éleusis aux flambeaux ; on se livra encore à la joie pendant la nuit et pendant la journée du lendemain ; mais, dès que la première veillée fut venue, les récits et les cérémonies funèbres commencèrent. Le temple de Cérès Éleusine datait du plus beau temps de l'art grec, c'est-à-dire qu'il était plus petit que la moindre de nos églises. Il était aussi le temple le plus riche de la Grèce, car les eunuques n'avaient osé le piller. Il servait dans les Éleusinies aux sacrifices et autres cérémonies officielles du culte hellénique. Au pied de la colline, où se dessinaient nettes et harmonieuses ses colonnes doriques, s'étendait une immense basilique, destinée spécialement à la célébration du mystère[7]. C'était là que se passaient les veillées, c'était dans le chœur que les mystagogues faisaient la représentation. C'est de ces basiliques, qui servaient à la représentation des mystères helléniques, que furent imitées les basiliques chrétiennes. Autour de la basilique étaient tendues sur des piquets les toiles bigarrées sous lesquelles, pendant la semaine sainte, le peuple dormait le jour et prenait ses repas. La célébration du mystère était l'occasion d'une foire, et la basilique était entourée de nombreuses boutiques. Tant que durait le jour, les cris des marchands, les bruits de toute sorte, l'agitation de la foule, donnaient à Éleusis l'aspect le plus animé ; mais, dès que le soleil était couché, un religieux silence s'établissait, et on n'entendait plus que le chant des prêtres et les lamentations des mystes. La première veillée commença par un chant pour sine seule voix. Un des prêtres rappela le sujet des petites Éleusinies : Cora[8], ayant cueilli la fleur du narcisse, avait été plongée dans les ténèbres d'Hadès. Alors la terre avait été plongée, comme Cora, dans les ténèbres et la désolation. Cérès avait demandé sa fille à l'univers, mais en vain. Enfin Jupiter, touché de ses larmes, avait visité la déesse, et il lui était né un fils, Iacchus, auquel étaient réservées les plus hautes destinées, et qui devait réparer le mal causé par l'imprudence de Cora. Ce fils avait grandi, il allait combler l'homme de biens et entrer en lutte avec ses ennemis. C'était l'histoire de ces luttes qui faisait le sujet des grandes Éleusinies. Quand le prêtre eut chanté, la représentation commença. Dans les temps primitifs, elle avait la forme d'un véritable drame ; mais, à mesure que l'ancienne naïveté s'était éteinte, les coups de théâtre, les chars ailés et les trappes avaient paru moins propres à exalter le sentiment religieux ; les représentations se réduisaient alors à certaines pratiques figurées, à des distributions de pain et de vin, symboles de la chair et du sang, de la vie solide et fluide ; à des allées et venues dans le chœur, accompagnées de récits chantés et de prières auxquelles les fidèles prenaient part : comme nos messes et nos offices solennels, qui représentent tout un drame pour celui qui sait les comprendre, mais qui n'ont pas cet aspect à première vue. Ce fut d'abord la représentation du séjour du dieu sur la terre et de ses conquêtes pacifiques. Iacchus rendait aux hommes le pain et le vin. Il conviait ses Compagnons à de grands repas, il leur attestait qu'il était né pour délivrer Cora, pour la faire paraitre de nouveau devant les dieux, et que ce jour serait pour tous les humains le signal et le gage de la félicité que les dieux leur réservaient. Puis commençait la lutte du dieu avec les agents des ténèbres. Un jour que Iacchus se promenait sur le bord de la mer, des pirates voulaient l'enlever ; mais le dieu se changeait en lion et réduisait ses ennemis à la fuite. Une autre fois, le serpent l'enserrait de ses plis, mais le dieu l'étouffait entre ses bras robustes. La lutte prenait beaucoup d'autres formes ; enfin Iacchus succombait : il était tué par le sanglier[9]. Alors tous les flambeaux furent éteints dans la basilique, et la foule se dispersa. A la veillée du lendemain, le tombeau du dieu avait été dressé dans le chœur. A la lueur vacillante des cierges, sous un tissu de soie transparente, on entrevoyait Iacchus moissonné dans sa fleur et sa beauté, la tête penchée et les bras étendus. La nuit fut remplie par les lamentations des mystes. On couvrait le lit funèbre d'oranges et de fleurs. Les femmes coupaient leurs cheveux et baisaient la plaie du jeune dieu. Le lendemain fut consacré à l'ensevelissement de Iacchus et aux douleurs de Cérès. Elle arrachait les bandelettes de sa chevelure, et couvrait son visage d'un voile. Elle n'avait donc enfanté une seconde fois que pour connaître de nouvelles douleurs. Celui qui devait lui ramener sa fille avait été vaincu par Hadès Il ne lui restait plus aucune espérance ; elle devait aussi souhaiter la mort, et les promesses de Jupiter étaient vaines. Alors, penchée sur le tombeau de son fils, elle appelait les dieux ; mais rien ne répondait à sa voix que les lamentations de la foule. Le lendemain, cette grande douleur recevait peu à peu des soulagements. Hermès paraissait, et annonçait à la mère affligée que Jupiter n'avait rien oublié, que lui-même avait conduit son fils aux enfers. On ouvrait le tombeau et Iacchus n'y était plus. Alors les compagnes de Cérès reprenaient courage ; elles rappelaient les bienfaits continus dont la divinité a toujours comblé les hommes : Ceux-ci savent tous les matins que le soleil va reparaître, et cependant ils n'ont d'autre motif de le croire que leur confiance dans les dieux. Le fils de Jupiter ne pouvait pas mourir ; sans doute il avait reparu dans le ciel ; plus heureux qu'Orphée, il avait ramené celle qu'il était venu chercher. Alors la déesse, le cœur plein d'espérance et de crainte à la fois, s'enveloppait d'un manteau d'azur et allait trouver les dieux supérieurs. Le lendemain, grand et dernier jour des Éleusinies, était entièrement consacré à la joie. La scène était transportée au ciel. Cérès y voyait son fils s'avançant dans sa gloire, accompagné par les dieux qui le reconnaissaient pour maître ; il tenait Cora par la main et la conduisait aux pieds de Jupiter. Cérès la tenait longtemps embrassée, se livrant aux transports de sa tendresse. Les dieux félicitaient la jeune fille ; ils lui donnaient mille témoignages de leur affection ; il était décidé qu'elle resterait neuf mois dans les régions supérieures, et trois mois seulement dans les ténèbres. Julien n'avait pas manqué un seul détail des cérémonies ; il avait vu dans chaque figure et chaque symbole une excitation à la sainteté, à la reconnaissance envers les dieux, car aucun n'avait été pour lui vide de sens. Son exaltation croissait à mesure que le mystère marchait vers sa fin. Il voyait dans Iacchus le génie qui conserve et propage les espèces végétales et animales par l'accouplement des sexes ; il savait que Iacchus était par un autre côté le ciel intermédiaire, le démiurge, le créateur même des espèces vivantes. Mais ce n'était pas par son côté sensible que le mystère le touchait le plus ; c'était par le côté spirituel, dont le côté sensible n'est que l'image. Il sentait que Cora était son âme éternelle, jadis habitante du ciel, puis entraînée dans les régions terrestres par son imprudence, et plongée dans la caverne du corps et les ténèbres de la chair. Dans ces ténèbres, le Verbe ne l'avait pas abandonnée ; il avait daigné, lui aussi, s'incarner, éclairer de sa lumière idéale cette prison de chair. Il avait dit à son âme de se tourner vers le haut, 'de rentrer en possession de sa partie immortelle et d'entrer en combat avec le périssable ; ou plutôt il avait combattu en elle et pour elle, et bientôt il devait la conduire de nouveau aux pieds de Jupiter. Aussi, quand Julien entendit les dieux décider qu'après un long séjour dans la cité immuable, Cora devait retourner dans la cité terrestre, oubliant un instant que la sagesse des dieux est plus grande que celle de l'homme, il s'écria : Ô dieux ! jamais, jamais ! Comme la peau est attachée à la chair et y reste fixée tant que le corps vit, que je reste éternellement attaché à la chair céleste, au corps qui ne périt point. Tandis que Julien voyait le Christ hellénique dans toute sa splendeur, et que son âme, quittant la terre, s'envolait avec Cora vers l'assemblée des dieux et désapprenait la vie active, Eusébie poursuivait ses menées auprès de Constance. Décidée à faire de son ami un héros guerrier, elle obtenait pour lui le commandement des Gaules et le titre de César. Athènes vit donc arriver un jour les eunuques de l'impératrice, qui, allant à la cellule de Julien, le traitèrent de maître et de roi, et bientôt l'emmenèrent en grand cortège par la route d'Italie. Julien fut d'abord fort touché des attentions d'Eusébie ; mais quand il vit qu'on le destinait à la pourpre, il sentit combien pouvaient être lourdes les prévenances de la plus aimable des femmes. Il comprit tout aussitôt qu'il n'était pour Constance qu'une poupée chargée de promener en Gaule les insignes impériaux ; qu'il n'aurait aucune puissance réelle, que tous les revers, toutes les fausses mesures lui seraient attribués, et que tous ses succès administratifs et guerriers ne serviraient qu'à pousser les créatures des chambellans, dont on allait l'entourer. Le soir même du jour 'où il arriva à Milan, il écrivait à l'impératrice une lettre où il la suppliait de lui obtenir la permission de retourner à Athènes, d'éloigner de lui ces dignités qui lui étaient odieuses. Mais il avait beau s'ingénier, il ne trouvait pas de termes convenables ; il craignait toujours qu'ils fussent mal interprétés. En même temps, dans la solitude et le silence de cette nuit, il se rappela le métal brillant où il s'était vu officiant dans le temple de Diane éphésienne, en costume de grand pontife. Il ne pouvait croire cette promesse vaine : l'ambition s'éveilla en lui. Il pensa que les dieux, qui voulaient par lui rétablir leur culte, avaient choisi la main de ses ennemis pour préparer leurs voies ; il les consulta par opération théurgique, et il sut en effet que les dieux lui ordonnaient d'accepter le titre de César. Décidé à obéir, Julien n'en gardait pas moins un air triste et mécontent ; le sort de Gallus était malgré lui devant ses yeux. Il avait conservé l'habit des philosophés athéniens et laissé croître sa barbe. Des courtisans ayant trouvé sa tenue inconvenante à la cour l'entraînèrent dans la boutique d'un barbier, le rasèrent et le revêtirent de l'habit militaire. Il faisait, dit-il, un plaisant soldat, marchant les yeux à terre comme un écolier. Pendant qu'il improvisait son éducation militaire, et qu'il s'exerçait à marquer le pas sur l'air de la pyrrhique, on l'entendit s'appliquer un proverbe alors populaire : Mettre une selle à un bœuf ! est-ce le harnais qui lui convient ? puis soupirer : Ô Platon ! Le 6 novembre (355), l'empereur le présenta aux soldats avec les cérémonies d'investiture et les discours d'usage. Les soldats saluèrent le nouveau César avec enthousiasme, en frappant leurs boucliers sur leurs genoux, ce qui est chez eux le signe de la plus grande satisfaction. Julien ne fut pas sensible à ces démonstrations ; l'armée avait accueilli son frère avec ce même enthousiasme ; Constance avait dit à Gallus ces mêmes paroles flatteuses qu'il lui adressait aujourd'hui. Pour que rien ne manquât de rappeler à Julien le souvenir sinistre du dernier César, Constance lui fit épouser Hélène, la plus jeune de ses sœurs. Eusébie essaya en vain de dissuader l'empereur de ce mariage, Julien l'accepta comme une conséquence fatale des honneurs qu'il subissait, et il fit les préparatifs de son départ pour le mois suivant. La surveillance et la défiance de Constance dépassaient tout ce que Julien avait pu imaginer. Il ne lui laissa emmener en Gaule que deux hommes de sa connaissance, le médecin Oribaze, et Évémère qui, comme Julien, professait alors en secret la religion hellénique ; tout le reste de ses officiers domestiques était autant d'étrangers et d'espions, tous les chefs militaires qu'il allait trouver en Gaule devaient recevoir les ordres de l'empereur par le préfet. La sollicitude d'Auguste allait jusqu'à régler l'ordre et le nombre des plats qui devaient paraître à la table de César. La seule consolation de Julien, en acceptant cette royauté esclave, fut une bibliothèque considérable dont Eusébie lui fit présent au moment de son départ. Elle contenait, outre les poètes et les philosophes grecs, un grand nombre d'ouvrages sur l'art militaire dont il allait avoir grand besoin, ne s'étant jamais occupé de guerre. H devait prouver bientôt qu'il était de ces esprits qui savent tirer de leurs lectures des données pratiques. H réunit à la bibliothèque d'Eusébie les livres de théurgie dont il ne se séparait plus, et chargea Évémère d'en prendre soin. Il fut très-sensible à cette attention de l'impératrice qui, a-t-il écrit plus tard, lui fit ainsi retrouver la Grèce au milieu des Gaules. Pour en finir avec Eusébie, que Julien ne devait plus revoir, disons dès maintenant ce que devinrent leurs relations. Eusébie lia un commerce de lettres avec sa belle-sœur Hélène, par laquelle elle put suivre son protégé dans ses expéditions et son administration. L'année qui suivit le départ de Julien, quand déjà la renommée de ses succès s'était répandue dans tout l'empire, Hélène étant devenue grosse, son amie Eusébie lui envoya une sage-femme qui opéra trop près la section de l'ombilic, et fit ainsi à dessein périr l'enfant. L'année suivante, Eusébie invita Hélène à venir la voir à Milan, et lui fit prendre par surprise un breuvage destiné à la faire avorter toutes les fois qu'elle deviendrait grosse. Eusébie ne devait pas recueillir le fruit de ses intrigues. Elle mourut en 360, quand Julien était encore en Gaule, et avant Constance, qui se remaria. Julien la regretta vivement ; au milieu de ses occupations, il trouva le temps d'écrire le panégyrique de son amie. Pour lui, il ne devait pas se remarier : depuis la mort de sa femme, arrivée peu de temps après celle d'Eusébie, il resta étranger à tout commerce des sens... Cette continence était grandement favorisée par les privations de nourriture et de sommeil qu'il s'imposait, et qu'il observait dans son palais avec la même rigueur que dans les camps[10]. Il parait cependant que ce n'est pas sans de dures souffrances qu'il parvint à vaincre sa chair au fort de sa virilité, car plus tard il aimait à rappeler le mot de Sophocle, se félicitant d'avoir échappé au plus enragé et au plus cruel des maîtres. |