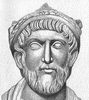JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
II. — CHRÉTIEN ET PAÏEN.
|
Éducation mi-païenne, mi-chrétienne de Julien, de saint Basile, de saint Grégoire. — L'indifférence en matière de religion, caractère de la haute classe au quatrième siècle. — Séjour de Julien et de Gallus à Marcelle, contraste entre les deux frères. Rêverie de Julien devant la nature. — Mariage de Gallus ; retour de Julien â Constantinople ; il fréquente les écoles. — Force respective des galiléens et des hellènes au moment où Julien parait sur la scène. Constance ne pouvait prendre le parti ni de laisser vivre ses jeunes cousins ni de les faire périr. Quand il considérait qu'il avait confisqué leurs biens, qu'ils étaient jeunes et seuls, que lui n'avait pas d'enfants, il s'intéressait à eux et aux progrès de leurs études, il voulait les approcher de sa personne, leur servir de précepteur et corriger leurs exercices. Comme il se croyait un grand orateur et un grand poète, bien qu'il n'y entendît rien[1], il leur envoyait des sujets de discours. Mais si les eunuques inventaient quelque conspiration, quelque menée dans les provinces, il envoyait brusquement des contre-ordres, les faisait transporter d'une ville à l'autre et les trouvait dangereux partout. Julien avait environ six ans et Gallus douze ans lors du massacre des Flaviens. Constance sépara les deux frères, il envoya Gallus en Ionie, Julien à Nicomédie. L'évêque de Nicomédie était alors Eusèbe, un des chefs de l'arianisme ; il était parent de Julien par les femmes ; il s'occupa avec amour de l'éducation de l'enfant. Il voulut en faire le modèle de l'Église, le défenseur de ce qu'il regardait comme les saines doctrines, et il résolut de l'initier à tous les secrets de la foi et à toutes les intimes délices de la vie mystique[2]. L'enfant passa successivement entre les mains du diacre qui purifie et du prêtre qui illumine, afin de devenir digne d'arriver par degrés aux pieds de l'évêque qui perfectionne, qui lave l'esprit du chrétien des dernières souillures, et l'admet dans la cohorte des initiés, de ceux qui suivent avec les prêtres tous les exercices de la haute piété et partagent avec eux la plénitude des faveurs spirituelles. Le diacre l'engendra spirituellement ; il le prépara à la vie par la lecture des saints livres. Il lui apprit comment l'homme avait violé le précepte d'Éden, et, cédant aux frauduleuses suggestions du serpent, avait échangé la mort contre l'immortalité ; comment le monde alors, privé des grâces célestes, avait été livré aux esprits des ténèbres que l'homme avait adorés comme des dieux et auxquels il avait élevé des autels. Mais Dieu, par un conseil de sa miséricorde infinie, tira de sa pure substance un être qui, prenant toutes nos misères, sauf le péché, s'unit à notre bassesse, et qui, conservant toutefois sans altération aucune tous les attributs de Dieu, combattit la troupe rebelle des- esprits immondes, et la renversa ; il inonda de lumière notre obscurité, il orna de ses grâces notre difformité, il affranchit la maison de notre âme des souillures hideuses, et nous apprit à monter vers le ciel et à mener la vie divine en l'imitant. Le diacre montra à Julien comment les livres saints sont pleins de Dieu, et qu'ils sont sa forme ; comment chaque mot contient pour celui qui sait le lire les promesses encore secrètes des grâces infinies que le prêtre doit donner un jour à l'initié. Puis le diacre présenta Julien à l'évêque qui l'interrogea et, satisfait de ses réponses lui imposa les mains. Le diacre délia la ceinture du catéchumène, et l'évêque le plaça en face de l'Occident pour qu'il prononçât les paroles d'abjuration, puis, l'ayant fait descendre dans la piscine, il le baptisa par la triple immersion de l'eau. Le prêtre alors, remplaçant le diacre, apprit à Julien les secrets de la hiérarchie céleste, dont l'Église est l'image visible sur la terre et le symbole : institution sacrée qui célèbre suivant des règles fixés les mystères de l'illumination, échelle de Jacob, qui va de la créature à Dieu, où chacun est purifié et purifie à son tour, de telle sorte que chacun a son mode d'imiter Dieu, et que chaque être renvoie au degré inférieur la clarté qu'il a reçue d'en haut. Cette hiérarchie est séparée comme l'Église en trois ordres. Immédiatement auprès de Dieu, reproduisant par leurs splendeurs originelles les choses qui sont en Dieu, sont les séraphins ; dans le second, les puissances et les vertus ; dans le troisième, les anges et les archanges. Ces trois degrés qui mènent à Dieu, l'homme peut les monter par les sacrements, symboles de l'invisible appropriés à notre faiblesse. Le premier, le baptême, nous donne la science des choses sacrées et la justesse d'esprit qui nous fait discerner les dons de Dieu de ceux du diable. Le second, la sainte cène, nous fait entrer en communication directe et continue avec le Verbe de Dieu. Le troisième, la perfection hiérarchique, nous rend semblables aux séraphins qui, dans l'éternel repos, contemplent Dieu, font partie de Dieu, ne sont qu'un avec lui. Le mouvement même des divines pensées, que le Verbe avait sollicité en nous, s'arrête[3] et nous jouissons de toute la plénitude d'une immobile et béate contemplation. Dans les riches basiliques de Nicomédie, Julien chantait des hymnes sacrées dont la musique était empruntée au culte païen, ou bien il entonnait ces longues psalmodies en prose, horreur des païens, auxquelles se mariaient les sons de l'orgue. Cet instrument égyptien faisait alors fureur dans la société romaine. Il n'était pas employé seulement dans les cérémonies du culte ; ce timbre, qui nous parait aujourd'hui si sévère, résonnait aussi dans les festins et accompagnait les danses. Les dévots païens n'en aimaient pas le profane usage dans leurs temples et leurs mystères. Ils n'y voulaient que des chants à l'unisson ou des récitatifs en vers pour une seule voix, accentuant savamment suivant d'antiques préceptes, autour de laquelle les accords prolongés des lyres faisaient comme un grand silence. Mais tandis que Julien était dressé aux visions célestes et aux pratiques minutieuses du christianisme oriental, il recevait ailleurs une éducation toute différente qui, en se combinant à la première, devait créer cette singulière individualité. Constance s'était bientôt décidé à faire jouir Julien de l'héritage de sa mère Basiline ; un esclave gouverneur, l'eunuque Mardonius, faisait partie de cet héritage. Mardonius était déjà avancé en âge, c'était lui qui avait fait l'éducation de Basiline ; il devait dresser Julien suivant la vieille méthode, sans sacrifier à l'esprit nouveau, ni en morale, ni en rhétorique, ni en musique. Il lui apprit à jouer non de l'orgue, mais de la lyre ; il lui dit que les maîtres classiques avaient établi les règles de l'art dans leur perfection depuis huit cents ans, qu'il ne fallait point de mélange dans les chants lyriques. Il s'emportait contre quiconque en altérait les modulations, en troublait la mesure et voulait y substituer des ornements désavoués par les préceptes anciens. Il lui faisait prononcer le grec à bouche ouverte, sans iotacisme, sans langueur, sans bredouillement et en scandant. Le maitre savait par cœur Homère et Hésiode d'après les meilleures versions ; l'élève les sut bientôt. Quand Mardonius conduisait Julien, à travers les rues de Nicomédie, aux leçons du diacre chrétien, ils récitaient tous les morceaux de leurs poètes favoris, et les commentaient d'une façon qui eût fort étonné ces poètes. Le maitre disait à l'élève qu'Hésiode et Homère étaient des hommes animés du Saint-Esprit, comme Moise et les prophètes, qu'ils étaient même plus clairs, plus explicites, plus conformes à la vraie nature des choses, et qu'on trouvait en eux toute science et toute sagesse sous des formes allégoriques. Julien sut que la création et la lutte primitive des éléments, qui ne sont qu'esquissés à grands traits dans la Genèse, se trouvent avec tous leurs détails dans Hésiode ; que le Dieu Éros, qui féconde le chaos et en fait sortir l'éther et le jour, est la parole de Dieu, disant que la lumière soit ; que le règne d'Uranus est la période édénique ; que le règne de Cronos et l'invasion des maux par l'imprudence de Pandore correspondent à la chute de l'homme et à l'imprudence d'Ève ; que la mutilation d'Uranus et la naissance d'Aphrodite sont les détails du déluge ; que Jupiter est la loi inexorable de la nature qui confond dans la même protection le juste et le pervers, et leur distribue indifféremment les biens et les maux, et que Prométhée est la vertu qui résiste à la nature. Jupiter la persécute ici-bas, mais il la recevra dans son sein au jour de la réconciliation, quand son fils Hercule la lui amènera. Mardonius lui dit que les dieux sont les forces de la nature, qui luttent entre elles pour produire l'harmonie. Il lui apprit ce que sont la balance, où Jupiter pèse la destinée d'Hector, la chaîne d'or qui joint la terre au ciel et les filets de Vulcain, et quels enseignements cosmogoniques se cachent sous les adultères d'Aphrodite. Tandis que les diacres chrétiens disaient à l'enfant que l'homme souillé et déchu, abandonné aux démons, ne peut de lui-même, sans l'intermédiaire de Jésus-Christ, ni connaître le bien ni tendre vers lui, Mardonius lui disait que les lois de la justice et de la beauté sont écrites au fond de la conscience des dieux et des hommes ; que le mal n'est qu'une apparence, sans existence réelle ; que l'homme n'a qu'à vaincre ses passions pour contempler le bien face à face dans toute sa pureté abstraite. Tandis que les prêtres chrétiens plaçaient au-dessus de la vertu la béatitude immobile de celui qui contemple l'essence divine, l'eunuque lui présentait la vie comme un rude sentier, où il faut remplir des devoirs multiples, fatigants envers soi-même, envers sa famille, envers ses amis et envers la république, sans attendre aucune récompense extérieure. L'éducation mi-païenne, mi-chrétienne, que recevait Julien n'était pas une exception. Au quatrième siècle et jusqu'à la fin du cinquième, les fils de famille étaient le plus souvent élevés ainsi, dans un égal respect pour les mythologies juive et grecque. Au même temps où Julien grandissait à Nicomédie, saint Basile et saint Grégoire de Nazianze recevaient une éducation très-analogue. Les enfants ainsi élevés, une fois devenus hommes, prenaient parti pour ou contre le christianisme, si un goût irrésistible les entraînait vers les spéculations théologiques ; mais la plupart de ces jeunes gens de la haute classe, une fois sortis des écoles, se mêlaient franchement à la vie active, n'attachant qu'une médiocre importance à tout ce qu'ils avaient appris dans l'adolescence. Ceux-ci restaient toute leur vie indifférents entre le paganisme et le christianisme ; également prêts, suivant qu'ils le jugeaient utile à leur influence dans la province et à leur crédit à la cour, à briguer les fonctions de pontife païen ou chrétien. On n'a pas assez insisté sur cette indifférence religieuse dont Constantin est l'exemple le plus célèbre, et qui était le caractère général de la haute classe au quatrième et au cinquième siècle, et par conséquent des évêques. Le bruit des discussions théologiques nous a empêché de comprendre combien était petit le nombre de ceux qu'elles intéressaient en elles-mêmes ; combien était grand en ce temps-là, comme de nos jours et comme de tout temps, le nombre de ceux que les soucis de la vie journalière absorbaient entièrement, et qui étaient disposés à adopter toute secte triomphante par raison politique intéressée ou désintéressée. Il y avait certainement la moitié des évêques présents au concile de Nicée, anciens généraux, anciens préfets, anciens préteurs et consuls qui se préoccupaient peu de savoir si le Fils était égal ou inférieur au Père, et qui eussent été incapables d'expliquer ce que voulait dire cette infériorité ou cette égalité. Julien allait avoir quinze ans quand Constance, repris d'une terreur subite, relégua ses deux neveux en Cappadoce, à nacelle, château royal qui devait leur servir de prison. On ne sait quel motif détermina l'empereur et les eunuques à cette mesure. Les deux frères, qui n'ignoraient pas les malheurs de leur famille et la part que Constance avait prise à la mort de leur père, purent craindre un instant pour leurs jours. Depuis près de dix années ils ne s'étaient pas vus, et la prudence les avait empêchés de correspondre ; la persécution les rapprochait ; ils conçurent l'un pour l'autre une amitié qui ne se démentit jamais, et à laquelle Julien resta fidèle jusqu'à l'injustice, après la mort de Gallus. Il était difficile cependant de trouver deux frères plus différents de caractère, avec une grande ressemblance de visage. Tous deux, sauf le front, rappelaient leur grand-père Constance Chlore : ils étaient engoncés avec ces grands yeux vifs, ce fort nez droit proéminent et cette bouche bien dessinée mais lippue qui, chez Constance Chlore, exprimait la bonté, chez Gallus la sensualité, chez Julien un dédain suprême, non sans pédantisme pour les femmes et les ignorants. Gallus, peu soucieux de toute science profane, chrétien fervent, mêlait au christianisme, non la superstition savante des théurges et des astrologues, mais, comme dit Ammien au sujet de Constance, la superstition des vieilles femmes. Il avait, du reste, avec son oncle plus d'une analogie : c'était la même sympathie pour ses domestiques et pour tous les inférieurs disposés à flatter sa beauté et ses vertus, à écouter ses vanteries. Bon par nature, cruel par faiblesse et par peur, sa superstition devait le livrer aux prêtres, et sa sensualité aux femmes. Il passait sa vie à Macelle fort agréablement au milieu du luxe princier dont Constance avait entouré ses neveux dans leur prison. Il ne s'apercevait pas que ses domestiques étaient une troupe d'espions ; il ne leur communiquait que des colères enfantines et des pensées niaises, peu de nature à inquiéter le souverain. Il fréquentait le tombeau de saint Marnas, martyr de Césarée ; il donnait de l'argent aux chrétiens pour élever ou décorer des églises ; il jeûnait et veillait aux vigiles, chantait aux fêtes, s'enivrait ensuite, et, sous prétexte d'aumône, donnait des repas à la canaille, avec jeux de cirque, ballets, pantomimes et farces licencieuses. Le reste du temps il mettait et ôtait des habits précieux et des robes d'or, et se faisait admirer de ses valets et de ses femmes. Il en voulait toutefois à son oncle de ce qu'il ne mourait pas, lui, Gallus, étant l'héritier le plus proche du trône, et tout à fait digne de briller sur un plus grand théâtre. Quoique Julien fût de six ans plus jeune que son frère, il était en réalité plus vieux que lui. Il avait eu dès l'enfance l'esprit très-ouvert et très-avide, et on l'avait surmené. Il semble n'avoir vécu que par le cerveau. Il voulut et sut toujours dompter ses sens, il ne connut jamais d'autre passion que l'amour, ou plutôt la folie, de la science et de la sagesse, des hautes discussions. Il fuyait le cirque et le théâtre comme une grossièreté. Il avait la tête pleine d'une foule d'auteurs, de vers, de prose, de dissertations morales ; il commençait à s'occuper des anges. Il aimait à parler parce qu'il parlait facilement et suivant les règles. S'il écrivait, ses lettres intimes comme ses discours publics ou philosophiques n'étaient que des enchaînements de périodes faits moins pour convaincre l'esprit que pour charmer les oreilles et l'imagination par des antithèses, des comparaisons, des rapprochements singuliers. C'était le goût du temps, la leçon des maîtres. Un écrivain qui voulait passer pour habile ne devait laisser échapper aucune occasion de raconter une anecdote édifiante ou merveilleuse sur un personnage de l'antiquité, de faire des citations d'œuvres anciennes sur la mort, la sagesse et la vertu. On aimait à s'appuyer en tout sur des autorités. L'art suprême était celui des digressions. Heureux qui pouvait introduire dans ses discours, sans trop de disparate, la description d'une éclipse de lune ou de soleil, ou celle d'un tremblement de terre, ou une virulente peinture de la corruption des mœurs ! Julien ne devait trouver le naturel et l'éloquence que dans la polémique : Pendant les six années que nous passâmes dans une terre qui ne nous appartenait pas, dit-il plus tard en parlant de son séjour à Macelle, on nous gardait comme si nous eussions été prisonniers des Perses. Aucun de nos amis n'avait permission de nous aborder. Nous ne pouvions nous livrer à aucun entretien libre ni à aucun genre d'étude. Au milieu d'un domestique nombreux et magnifique, nous étions réduits à n'avoir pour camarades que nos esclaves et à faire nos exercices avec eux. Les jeunes gens de condition libre ne pouvaient nous approcher... Si mon frère a eu dans l'humeur quelque chose de brutal et d'inculte, il le tenait en partie de cette éducation rustique. — Ce qui l'avait le plus indigné, ce dont il se souvient ici ; avec le plus de colère, c'est qu'il n'avait auprès de lui personne avec qui causer et philosopher, car pour Mardonius, depuis longtemps il n'avait plus rien à lui apprendre. On lui refusait tout autre livre que les livres sacrés des chrétiens. Il prenait en haine la religion qui lui était imposée par ses persécuteurs ; il faisait venir en secret des livres païens. Il commençait à prendre quelque notion des théories alexandrines, et il devinait ce qu'il n'en connaissait pas. Il avait saisi l'idée mère des spéculations de cette époque, cette opinion que l'ordre physique et astronomique est la représentation et le symbole de l'ordre logique. Macelle était incliné sur le versant est du mont Agée, Julien trouvait en face de lui les derniers plis du mont Taurus. Ces contrées, autrefois si fertiles, avaient déjà quelque chose de cet aspect grandiose et désolé qu'elles présentent de nos jours. La dépopulation, et avec elle l'aridité, envahissait tout. Quand il portait son regard sur la campagne, dans de longues journées de solitude et de rêveries forcées, il y voyait des aqueducs interrompus, des colonnes solitaires, restes de temples païens pillés par les eunuques et enlevés par morceaux pour servir à l'ornement des palais et des églises. A quelques lieues de Césarée, les champs cultivés cessaient, le sable avait recouvert la terre végétale par larges bandes qu'interrompaient des bouquets de palmiers, de dattiers et d'oliviers sauvages. Quand il voyait la lumière du soleil se jouant sur la vaste étendue, quand il étudiait ses effets bienfaisants et terribles, il y trouvait le symbole du Verbe, du soleil intellectuel qui nous donne la conscience de nos pensées, comme le soleil réel donne à chaque objet sa forme et sa couleur. Alors il se levait et il adorait le Dieu, les bras étendus : Je n'avais pas encore de barbe au menton, nous dit-il dans son épître sur le Soleil-roi, que déjà je désirais passionnément les rayons de l'astre divin. Ravi de l'éclat de sa lumière, je ne pouvais en détacher mes yeux ; puis la nuit, quand le ciel était serein, je quittais tout pour aller contempler au dehors la beauté des astres qui lui font cortège, au point de ne plus entendre ce qu'on me disait et d'ignorer ce que je faisais moi-même. Et cependant, par les dieux ! aucun livre d'astrologie ne m'était tombé entre les mains, et j'ignorais toute cette science. Cependant le caractère enfantin de Gallus avait paru aux eunuques digne de leur protection et favorable à leur fortune. Il s'agissait pour eux de conserver jusqu'à la fin de leurs jours les richesses qu'ils avaient amassées. Constance n'avait pas encore épousé Eusébie ; il n'avait pas d'enfants de son premier mariage, et les eunuques le détournaient d'en contracter un second ; une femme nouvelle était pour eux un inconnu dangereux. Sans doute Constance était robuste et bien portant, mais il fallait prévoir l'éventualité de sa mort. Lui mort, la félicité des eunuques était à la merci de son successeur. Si l'empereur futur était un homme vieilli dans les camps, curieux de voir tout par lui-même, inaccessible aux charmes des eunuques et de leur douce voix, arrivé sans eux à la souveraineté, il était probable qu'ils paieraient leur passé. Si, au contraire, c'était un second Constance, inappliqué et vaniteux, et de plus leur créature, surveillé depuis longtemps et entouré de domestiques et de prêtres choisis, ils pouvaient espérer qu'il n'y aurait de changé dans l'empire que le nom de l'empereur. Les chambellans résolurent donc de faire de Gallus un César ; on représenta à Constance que la révolte de Magnence, qui s'était emparé des Gaules, le forçait de conduire la cour à Milan, qu'il lui fallait un associé en Orient pour maintenir les Perses pendant la guerre d'Occident, et qu'il n'en pouvait choisir un plus convenable que son neveu. Constance adopta le projet des domestiques, mais il y fit une addition qui devait déjouer leur prudence. II décida que Gallus en devenant César épouserait Constantine. Constantine, sœur de Constance, avait épousé en premières noces l'Annibalien, neveu chéri de Constantin, que celui-ci avait fait de son vivant roi de Pont, et auquel il destinait après sa mort un royaume indépendant. Constantine s'était vue reine, puissante à la cour ; son père l'avait décorée du titre d'Auguste ; elle avait espéré faire un Auguste de son mari, avoir non-seulement le titre, mais la puissance, puis tout à coup la mort violente de l'Annibalien l'avait réduite au veuvage et à une vie mesquine et privée. Constance croyait, en la donnant au nouveau César, auquel il destinait plus tard le trône d'Orient, réparer les torts qu'il avait envers elle. Mais celle-ci ne devait apporter dans sa nouvelle dignité que ses rancunes et une ambition insatiable. C'était une grande et belle femme, brune, déjà mûre et fort libertine ; elle s'entendait à mener les hommes, et était elle-même menée par les femmes. Dès qu'elle fut arrivée à Antioche, d'où le César devait gouverner l'Orient, elle charma et subjugua entièrement son jeune époux, qui jusqu'à sa mort ne vécut plus et surtout ne pensa plus que par elle, et elle ne cessa de chercher une occasion favorable pour faire proclamer Gallus Auguste et détruire Constance. Julien, qui connaissait la légèreté de son frère, n'avait pas vu sans inquiétude son élévation ; il ne le laissa pas partir de Macelle sans lui avoir tenu les discours les plus étendus sur les devoirs des rois, sur la honte qu'il y avait pour un honnête homme à se laisser mener par les femmes, et sans lui avoir mis sous les yeux les exemples de tous les grands princes de Rome. Il lui recommanda surtout une extrême prudence dans ses propos les plus intimes et dans ses rapports avec Constance : il se doutait que la bonne intelligence de César et d'Auguste ne devait pas être de longue durée. Gallus lui fit des promesses qu'il ne devait pas tenir, mais en revanche il profita des épanchements plus ou moins sincères de la réconciliation et des fêtes de son élévation et de son mariage pour obtenir de Constance que Julien quitterait sa prison de Macelle et viendrait à Constantinople achever ses études. Il y avait alors six ans que Julien était en Cappadoce et que sa pensée s'y dévorait elle-même faute d'aliments, six ans que sa science ne faisait pas de progrès. Il partit pour Constantinople avec une joie extrême, décidé à regagner le temps perdu et à devenir un savant universel. Il arriva dans la ville avec Mardonius, vêtu d'un grossier manteau, et il alla voir le célèbre Libanius, qui tenait alors école à Constantinople. Sans doute Julien avait déjà lu en secret quelque écrit de ce rhéteur, avec lequel il a une grande analogie de style. Ils conçurent l'un pour l'autre une amitié ou plutôt un amour platonique, enthousiaste et respectueux de la part de Julien, plein de dignité de la part de Libanius, lequel ne fit que s'augmenter jusqu'à la mort de Julien, et auquel Libanius resta fidèle après la mort de son jeune ami, qu'il considéra toujours comme un saint. C'est à Libanius que Julien écrivait plus tard la lettre suivante, qui dans ses quelques lignes contient toute la manière d'écrire de l'auteur et montre en même temps les grâces affectées qui étaient alors à la mode : Puisque tu es oublieux de ta promesse (car voici
le troisième jour et le philosophe Priscus n'est pas venu, il me mande même
qu'il tardera encore longtemps), je te remets ta dette en mémoire avec instance. Elle est de
celles, tu le sais, qu'il t'est aussi facile d'acquitter qu'il m'est agréable
de les recevoir. Envoie donc ce discours avec ce symbole sacré, et
promptement, par Hermès et la muse !
— Sache bien
que je suis brisé de ces trois jours passés loin de toi ; le poète sicilien
dit vrai : un seul jour d'absence vieillit deux amants. S'il en est ainsi,
illustrissime, et cela est certain, tu as triplé notre vieillesse. J'ai dicté
pour toi ceci, plein d'inquiétude. Je ne pouvais écrire moi-même, je trouvais
ma main plus lente que ma langue, ma langue elle-même devient plus lente, parce que depuis longtemps déjà je ne l'exerce
plus. Adieu, frère très-charmant et très-aimé. Mais à peine Julien avait-il pris quelques leçons de son nouveau maître que les évêques représentèrent à Constance qu'il était dangereux de livrer un prince du sang à un ennemi du christianisme. Libanius était en effet un païen, ou, comme on disait alors, un hellène fervent et pratiquant. On défendit donc à Julien d'écouter ses leçons, et on lui fit suivre celles d'un rhéteur qui faisait profession de christianisme, Écébole. Les craintes des évêques étaient chimériques. En ce qui concernait l'éducation, les païens pouvaient différer des chrétiens ; mais en tout ce qui concernait l'enseignement public, maîtres païens et chrétiens donnaient exactement le même. Grégoire de Nazianze et Basile, qui suivaient alors les leçons de Libanius, n'en furent pas moins des chrétiens et des saints, et le christianisme d'Écébole ne devait pas empêcher l'abjuration de Julien. Il est même probable que Julien, ne pouvant aller à l'école de Libanius, dont l'enseignement public n'eût eu rien de commun avec les questions religieuses, entretint dès lors avec lui un commerce secret, et qu'il l'interrogea sur les cérémonies et les mystères du paganisme. Écébole était du reste un esprit fort accommodant sur, les matières religieuses ; quand il avait vu le christianisme devenir religion officielle, il s'était fait chrétien ; il retourna au paganisme quand pillés et brûlés par le peuple et les eunuques, sous Constantin et surtout sous Constance ; mais ces faits eurent toujours le caractère de la violence et de l'exception, et non celui d'une mesure légale et universelle. Les principaux oracles fonctionnaient encore, les chrétiens venaient les consulter comme les hellènes[4]. Les fêtes en l'honneur du soleil, d'Adonis et de Bacchus, attiraient partout le même concours de peuple que sous les Antonins, et les populations chrétiennes les célébraient avec autant d'ardeur que les helléniques. Les prêtres galiléens s'efforçaient d'en déshabituer le peuple en enrichissant le type du Christ de tous les attributs des anciens dieux, mais ils n'y étaient pas encore parvenus. Les galiléens étaient donc encore au temps de Julien en très-faible minorité dans l'empire ; car je ne compte pas pour galiléens sérieux les soldats et les fonctionnaires civils, qui croyaient de leur devoir, de leur intérêt ou de leur sûreté, d'être de la religion du maître. Ils s'étaient convertis en masse au galiléisme pour complaire aux fils de Constantin, et pendant les deux années du règne de Julien ils retournèrent en masse à l'hellénisme. Mais si les galiléens étaient inférieurs en nombre, ils étaient bien supérieurs par l'esprit d'association, ou plutôt de franc-maçonnerie. Le galiléisme avait été d'abord une secte juive, il lui en était resté quelque chose. Or, la race sémitique, juifs ou Phéniciens, a toujours été la plus entendue dans le commerce et les opérations de banque et de bourse. Chez les juifs, dispersés dès le temps de Cyrus parmi les nations étrangères, le plus souvent en butte à la violence, cet esprit commerçant avait produit une vaste association de secours mutuels et de soutien des juifs entre eux, qui dure encore. Les galiléens des premiers siècles avaient hérité et de l'esprit de banque et de l'esprit de franc-maçonnerie des juifs. Sous Dioclétien, les galiléens, qui étaient pour la plupart des familles de curiales, de la classe qui correspondait à notre bourgeoisie aisée, avaient déjà lié des intérêts d'un bout à l'autre de l'empire. Capables de réunir de gros capitaux sur un point, ils agissaient de concert sur les denrées et particulièrement sur les grains, dont ils parvenaient à élever et à baisser brusquement les prix. Tout galiléen en voyage allait loger chez ses coreligionnaires ; où il était défrayé de tout ; aussi une population toujours croissante de fainéants et d'esclaves échappés faisaient métier de voyager de ville en ville, où sous couleur de galiléisme ils se faisaient accueillir et secourir. Dioclétien, effrayé de cet État dans l'État, voulut briser l'association galiléenne ; mais il ne fit que la resserrer. Constantin, plus habile, la mit dans ses intérêts : ses fils la rendirent maîtresse de l'empire. C'est cet esprit de franc-maçonnerie que Julien va tenter d'inspirer aux hellènes, afin d'opposer ligue contre ligue. Le moment était bien choisi. Depuis que les galiléens étaient soutenus par les empereurs, les liens de leur association s'étaient fort relâchés. Tous les habiles avaient voulu en âtre. Depuis qu'avec un peu de violence et d'énergie on pouvait mettre la main sur les biens de l'Église hellénique, aussi riche alors que devait l'être un jour l'Église catholique, être évêque ou membre de la fabrique devenait une excellente spéculation. Les galiléens de la veille avaient refusé de reconnaître ceux du lendemain ; des querelles et des batailles entre les sectes galiléennes avaient succédé aux anciennes luttes entre galiléens et hellènes. De leur côté les hellènes, opprimés à leur tour, voyant leurs biens sacrés passer chaque jour à l'ennemi, avaient compris combien ils avaient besoin de se réunir autour d'un chef, et d'établir des liens entre leurs différentes Églises. |