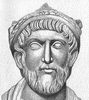JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
I. — L'AMOUR PLATONIQUE, LA GRANDE DAME, L'EUNUQUE.
|
Mort de Constantin. — Massacre des Flaviens. — Civilisation gréco-orientale ou byzantine. — L'art, les costumes, les mœurs au temps de Julien. — Digression sur l'amour platonique, différence capitale entre l'homme de la cité antique et l'homme moderne. L'eunuque précepteur, l'eunuque favori, l'eunuque pourvoyeur. — Constance, son caractère ; influence des eunuques sous son règne. — Mariage de Constance avec Eusébie. Constantin le Grand aimait ses neveux et il avait dessein de les admettre avec ses fils au partage de l'empire. Il semble qu'il ait compris que l'empire romain était trop grand et trop hétérogène pour conserver l'unité de son administration comme de son gouvernement, et qu'il fallait le partager, d'après la diversité des nationalités et des langues, en un grand nombre de royautés distinctes, unies seulement par une religion commune, ainsi que cela eut lieu au moyen âge. Mais, par une inconséquence bien naturelle, en même temps qu'il désirait pour l'avenir cette division, il crut que de son vivant la civilisation romaine pouvait prospérer et se conserver dans son unité, et il n'accorda à ses héritiers futurs que des titres et des honneurs sans puissance réelle. Aussi, dès que la nouvelle de sa mort se répandit dans Constantinople, Constance, le seul de ses trois fils qui se trouvât alors dans la ville ; excita sourdement les fureurs des soldats qui, pour prévenir les guerres civiles et pour assurer aux enfants du grand empereur la succession paternelle, envahirent les maisons des Flaviens et les massacrèrent au nombre de neuf, tant neveux que frères de Constantin. Deux membres de la maison impériale, deux frères, Gallus et Julien, furent seuls exceptés ; leur jeunesse les sauva. Tous les deux devaient un jour faire repentir Constance de sa générosité, et lui montrer qu'il avait agi avec imprudence en ne les comprenant pas dans le massacre général de sa famille. De tels massacres, en effet, étaient devenus une nécessité à l'avènement des empereurs, Pour laisser vivre à côté de lui, sans danger pour l'État, des princes de son sang, il eût fallu au souverain une grandeur et en même temps une habileté surhumaines. Leur emprisonnement, la confiscation de leurs biens, les persécutions qu'ils subissaient, en faisaient les chefs naturels de tous les mécontents ; et si, au contraire, le monarque leur donnait un gouvernement et des honneurs dignes de leur rang, il fallait qu'il eût un passé de gloire derrière lui et une franchise continue de procédés qui leur ôtassent toute idée de rébellion, en leur ôtant toute crainte pour leur sûreté personnelle et toute espérance de succès. Telle était la position qu'avaient faite aux empereurs les réformes de Dioclétien et de Constantin. Ils avaient tué les formes républicaines ; ils avaient augmenté le prestige du trône en l'environnant de domestiques hiérarchisés ; ce prestige devait tourner au profit des princes du sang. En faisant de la cour des Romains une cour d'Orient, ils avaient soumis l'empire aux exigences des monarchies d'Orient. Ces réformes et la fondation de Constantinople n'avaient fait du reste que constater la révolution accomplie depuis longtemps dans les mœurs. A la civilisation gréco-romaine des Antonins succède la civilisation gréco-orientale. L'idéal des princes s'est déplacé. Tandis que les Antonins agissaient avec le sénat comme les dictateurs de l'ancienne république, chargés d'un despotisme temporaire pour le salut de l'État, tandis qu'ils s'efforçaient de faire revivre les Scipions et les Fabricius, l'idéal.des monarques byzantins sera le même que celui des Ptolémées et des Antiochus : la magnificence dans les divertissements, les habits, les domestiques et la protection des lettres inoffensives. Les mœurs publiques ont achevé de disparaître ; tous ceux qui se mêlent de gouvernement et d'administration ne sont plus que des employés, des gens en place. Le pouvoir, moitié civil, moitié religieux, des pontifes païens et chrétiens, conserve seul quelque chose de l'ancienne dignité municipale. En même temps les mœurs privées sont devenues, non plus chastes et plus dignes, mais plus douces et plus tendres. La vieille dureté romaine n'est plus nulle part dans la famille ; exceptionnellement les haines et les crimes se rencontrent chez les grands ; mais en général les rapports du mari avec sa femme et du père avec ses enfants ont acquis ce charme et cette intimité que les anciens Romains eussent trouvés honteux. Marc-Aurèle seul avait su unir l'héroïsme ancien au sentiment de la famille moderne. Après lui on ne trouve plus que des apologistes prétentieux du passé, ou des hommes de mœurs nouvelles auxquels l'ancien esprit est complètement étranger. L'esprit nouveau emporte tout et se traduit dans les arts et les coutumes avec une force irrésistible. C'est d'abord l'architecture énorme, surchargée, disparate. Les maisons étagées sur les collines de Constantinople, l'immense palais des empereurs présentent, sans nécessité pour la construction, des façades de colonnes pillées à tous les temps et à tous les pays. Ici, la grâce simple de l'attique ; là, les ciselures admirables de Palmyre ; à côté, des blocs à peine dégrossis, des monolithes de granit et de porphyre, des marbres veinés, rouges, jaunes et verts, surmontés de chapiteaux d'or mat, des dômes bariolés, des frises et des plafonds surchargés de lourdes rosaces, des lits et des sièges à colonnes en spirale, lourds comme des monuments. Et, partout rappelée, à l'intérieur, à l'extérieur, la sphère bleue étoilée, symbole de puissance et de perfection. En sculpture, en peinture, les figures apocalyptiques, les griffons, les taureaux à tête d'homme, les oiseaux fantastiques, les personnages disproportionnés remplacent le type humain, qu'on méprise et que bientôt on ignore. Le buste et la médaille, rendus jadis avec un modelé si sûr, interprétés avec tant de largeur, deviennent des portraits exacts, d'une ressemblance désobligeante, puis des ébauches informes et des profils enfantins. Les monstres et les ornements géométriques envahissent
aussi les habits. Les princes portent des tiares assyriennes où sont fixés
des nimbes d'or ; aux étoffes de lin et de laine, teintes d'une seule
couleur, succèdent des étoffes de soie légères comme le crêpe de Chine,
couvertes de grosses perles rondes, et brodées du haut en bas avec une
richesse et une invention bizarres. A. Marcellin dit des grands seigneurs de
son temps : Ils
mettent leur honneur dans la hauteur insolite de leurs carrosses et dans la
richesse de leurs habits. Ils succombent sous le poids d'un manteau qu'une
seule agrafe retient au cou, si léger cependant que le souffle le ferait
voltiger. A tout moment ils le relèvent, surtout du côté gauche, pour faire voir les larges bordures de leur tunique et les formes variées
des animaux qui y sont brodés. On essaye en tout de ressembler aux
femmes, on se met des perruques poudrées d'or, on a horreur de la barbe, on
s'épile des pieds à la tête. De vieux sénateurs, fardés et les yeux peints,
dans des poses nonchalantes, roulent à toute bride par les rues, entourés
d'eunuques, de musiciens et de marmitons, poursuivis par la canaille qui
célèbre leur bonne mine et leur munificence, et qui implore une invitation
pour le prochain festin, ou au moins des reliefs à dévorer dans les cours et
sous les portiques. Cette imitation des parures et des allures de la femme indique l'admiration croissante pour le type féminin. Les anciens ne l'avaient admiré et adoré qu'autant que par sa force musculaire et ses aptitudes logiques il se rapprochait du type masculin ; les modernes lui trouvent d'autant plus de charme qu'il s'en éloigne davantage. En même temps que la femme avait acquis dans la famille un charme plus intime, une influence plus continue et plus pénétrante, elle avait perdu son ancienne dignité de matrone. Sa mauvaise influence croissait avec la bonne. La séparation, si tranchée au temps de Démosthène, entre la femme légitime qui donne des enfants à l'État et garde la maison, et la courtisane qui satisfait les sens, n'existe plus. L'adultère, presque inconnu chez les républicains de l'Italie et de la Grèce, ou présenté avec un caractère fatal, va devenir le sujet favori des légendes amoureuses. La femme a pour l'homme un prestige autrefois inconnu, elle devient l'idéal de ses sens, de son esprit et de son cœur. La grande dame sait confondre et combiner avec art ces trois genres de séduction ; la conscience de l'homme se trouble et il ne sait auquel il s'est laissé prendre. A ce mélange hétérogène entre le sens du beau et le sens de la volupté, la volupté seule gagné et l'homme devient inhabile à jouir des beautés simples et franches. Dans l'ordre des beautés intellectuelles comme dans l'ordre des beautés physiques il lui faut du vague, de l'indéfini, du demi-voilé, il se défie de la vigueur de son imagination, il a peur que son idéal ne lui échappe en se précisant. A mesure que son imagination se dérègle, il acquiert le sentiment de l'indécent, et il trouve plaisir à ce qui est indécent. Quand Phryné, à la tète de Neptune, entrait dans la mer à la vue de tout le peuple, et en sortait tordant ses cheveux, les Athéniens éprouvaient à la voir un plaisir tout artistique, plus vif, mais du même ordre que celui qu'on éprouve à voir manœuvrer un beau cheval ou voguer un cygne. Quand Théodora, quittant ses riches vêtements et ses tissus de perles, représentait devant le peuple de Constantinople la fable de Léda ou du jugement de Pâris, il n'y avait plus qu'une satisfaction puérile donnée au libertinage d'une race énervée. Ce type de grande dame intrigante, libertine, pleine de séduction de tout genre, dirigeant tout dans l'État et embrouillant tout, régnant sur des peuples entiers, prenant au piège les rois barbares et les menant comme des enfants, pleine de sang-froid dans sa puissance, ne meurt en Orient qu'avec la venue des Turcs ; en Occident, on le retrouve encore vivace au dixième siècle. Les mêmes causes qui avaient amené l'empire l'avaient fait naître, et il date d'Auguste, comme le remarque Montesquieu ; toutefois, dans le haut empire, l'influence de la grande dame est encore en lutte avec un vieux reste d'héroïsme et d'orgueil patricien, ou, quand elle domine, c'est avec un caractère brutal et simple qui est encore antique par un certain côté ; mais depuis la fondation de Constantinople, elle règne en souveraine ; l'eunuque seul peut quelquefois lutter contre elle. Les races héroïques, les Grecs du beau temps, qui étaient Grecs non-seulement de langage et de nom, mais de sang, ne connaissaient pas ce type ; il ne pouvait naître chez eux, ils l'auraient eu en haine et en mépris profond. Il diffère entièrement du type de ces femmes dont Aspasie est la personnification la plus célèbre et que les Grecs appelaient des amies. Démosthène dit expressément qu'elles donnent les voluptés de l'esprit, et il l'oppose aux courtisanes, qui donnent celles des sens. Quand Socrate les fréquentait, il ne cherchait auprès d'elles aucun libertinage, niais un charme pareil à celui qu'il trouvait auprès des jeunes gens. Leur éducation' était calquée sur celle de l'éphèbe, expertes comme lui dans la gymnastique, dans les danses guerrières et sacrées, et dans ce que les Grecs appelaient la musique, c'est-à-dire dans la musique proprement dite, la poésie, la morale, la politique, l'éloquence ; elles savaient comme les jeunes Grecs discuter sur l'origine des choses et leur nature intime. Ce type était une anomalie dans la société grecque, d'une rareté extrême. Platon, dans sa naïveté sublime, nous montre que de son temps l'idéal était généralement ailleurs que dans les amies. On le cherchait dans l'éphèbe, dont celles-ci n'étaient le plus souvent qu'une copie incomplète. De nos jours on a abusé ridiculement du mot amour platonique. La passion moderne pour la femme, quelque spiritualisée qu'on la veuille, n'a rien de commun avec lui. L'amour platonique, dans le sens moderne de cette expression, suppose je ne sais quoi de vague et d'incertain, c'est une exception sans importance. Celui-là, au contraire, éclate au grand jour, en plein soleil, avec une précision et une sûreté de but qui en font la force sociale la plus utile à la cité, le plus grand excitant au bien et au beau. Le rêve de toute cité antique avait été de soumettre les cités voisines et d'étendre peu à peu sa domination sur l'univers. La profession des armes avec tout le développement poétique qu'elle comporte fut donc d'abord le seul idéal de l'homme libre. Mais cette conquête universelle qu'il fut donné aux Romains de réaliser, aucune cité grecque ne pouvait l'accomplir, à cause de la foule de petites peuplades analogues resserrées dans un étroit espace, qui, par des alliances, contrebalançaient l'influence d'une cité prépondérante. Aussi, tandis que l'accroissement des richesses par la conquête et les querelles de leur partage furent, jusqu'à l'époque de l'influence grecque, la seule occupation et le seul idéal du citoyen romain, le citoyen grec, ne trouvant plus dans la guerre une occupation et surtout un idéal suffisant, fut contraint de s'en créer un autre. Les Grecs commencèrent donc à aimer et admirer, d'un amour désintéressé, les vertus propres au guerrier et au citoyen : l'énergie, qui fait supporter le froid, le chaud et les longues fatigues, et qui fait dompter les passions ; l'héroïsme qui fait sacrifier la vie avec joie ; le bon agencement des muscles qui unit la souplesse à la force ; l'éloquence qui rend maître des esprits, — comme belles et bonnes en elles-mêmes indépendamment de toute utilité immédiate. Ils conçurent alors pour l'homme possédant ou faisant espérer qu'il posséderait toutes ces vertus, pour l'éphèbe habile aux arts du gymnase et à ceux des muses, une adoration qui acquit tous les caractères de l'amour et qu'ils nommèrent de ce nom. On voit déjà des traces de cet amour aux temps homériques, dans l'amitié de Patrocle pour Achille, dans l'annihilation volontaire de sa personnalité devant celle d'un être plus beau et plus grand ; mais cet amour ne put devenir un sentiment général qu'au temps de Périclès, lorsqu'il devint une nécessité. L'amour pour les vertus héroïques se complète alors par l'adoration du jeune homme pour celui qui lui a ouvert le monde des idées, le monde des formes invisibles dont les beautés visibles ne sont que l'image grossière. Alcibiade raconte ainsi pourquoi il est amoureux de Socrate : En l'écoutant, je sens palpiter mon cœur plus fortement que si j'étais agité de la manie dansante des corybantes, ses paroles font couler mes larmes Je me suis souvent trouvé ému an point de penser qu'à vivre comme je fais ce n'est pas la peine de vivre.... C'est un homme qui me force de reconnaître que, manquant moi-même des biens essentiels, je néglige mes propres affaires pour me charger de celles des Athéniens. Il me faut donc malgré moi m'enfuir bien vite en me bouchant les oreilles pour échapper aux sirènes, si je ne veux pas rester jusqu'à la fin de mes jours assis à la même place auprès de lui. Pour lui seul dans le monde, j'ai éprouvé ce dont on ne me croirait guère capable, de la honte en présence d'un autre homme : or il est le seul devant qui je rougisse. J'ai la conscience de ne pouvoir rien opposer à ses conseils, et pourtant, de n'avoir pas la force quand je l'ai quitté de résister à l'entraînement de la popularité. Je le fuis donc ; mais quand je le revois j'ai honte d'avoir si mal tenu ma promesse ; et souvent j'aimerais mieux qu'il ne fût pas au monde, et cependant si cela arrivait, je suis bien convaincu que je serais plus malheureux encore, de sorte que je ne sais comment faire avec cet homme-là. ... Nous nous trouvâmes ensemble à l'expédition de Potidée, et nous y fûmes dans la même chambrée. Dans les fatigues, il l'emportait non-seulement sur moi en fermeté et en constance, mais sur tous nos camarades. S'il nous arrivait d'avoir nos provisions interceptées et d'être forcés de souffrir de la faim, comme c'est assez l'ordinaire en campagne, les autres n'étaient rien auprès de lui pour supporter cette privation. Nous trouvions-nous dans l'abondance, il était également unique par son talent pour en user : lui qui d'ordinaire n'aime pas à boire, s'il y était forcé, il laissait en arrière tous les autres buveurs ; et ce qu'il y a de plus surprenant, nul homme au monde n'a jamais vu Socrate ivre... Fallait-il endurer la rigueur des hivers qui sont très-durs dans ces contrées-là, ce qu'il faisait quelquefois est inouï. Par exemple, dans le temps de la plus forte gelée, quand personne n'osait sortir du quartier, ou du moins ne sortait que bien vêtu, bien chaussé, les pieds enveloppés de feutre et de peau d'agneau, lui ne laissait pas d'aller et de venir avec le même manteau qu'il avait coutume de porter, et il marchait pieds-nus sur la glace plus aisément que nous qui étions bien chaussés ; au point que les soldats le voyaient de mauvais œil, croyant qu'il les voulait braver. Alcibiade parle ensuite d'une qualité fort estimée des anciens, celle de rester parfaitement immobile pendant vingt-quatre heures, occupé à résoudre quelque problème philosophique ou scientifique ; puis du courage avec lequel Socrate lui a sauvé la vie, et du sang-froid qu'il montra dans la déroute de Délium. L'enthousiasme, la tendresse que ressentait un jeune Grec pour celui qu'il voyait doué d'éloquence, de philosophie et d'héroïsme, était si grand, que son affection avait toutes les délicatesses et toute la vivacité de celle que la femme seule nous inspire aujourd'hui ; elle en avait donc aussi la jalousie, l'égoïsme et les folies. On voit dans le Phèdre que les amants aimaient à isoler celui qu'ils chérissaient pour en jouir davantage, à le détacher de ses parents et de ses amis, qu'ils trouvaient un plaisir dans l'embarras de ses affaires et dans ses infortunes, car c'était alors qu'il avait besoin de leur dévouement et qu'il s'attachait à eux davantage. L'amour que le jeune homme ressentait pour l'homme fait doué de grandes qualités se changeait avec l'âge, quand lui-même était arrivé à la complète virilité, en amour pour les jeunes gens, soit que l'homme fait fût porté par un attrait irrésistible, comme l'était Socrate, à communiquer aux autres le feu sacré dont il brûlait, à dresser ces corps et ces âmes vierges aux grandes choses et aux grandes idées, soit que les formes grêles et veloutées des adolescents, leur esprit et leur sourire indécis éveillassent en l'homme fait des espérances illimitées, qu'il voulût par eux jouir d'une seconde fleur de jeunesse, qu'il désirât voir arriver ces jeunes êtres à la beauté physique et intellectuelle qu'il n'avait pu atteindre, et qu'il refit en eux le rêve d'idéal qu'il avait cru autrefois pouvoir réaliser lui-même. On voyait alors des hommes de mérite, déjà comptés dans l'État, faire pour un jeune homme des folies ruineuses, dépenser leur patrimoine en chiens, en chevaux, en festins et en fêtes de toute sorte pour s'attirer la reconnaissance de l'aimé. de dis l'aimé, car les Grecs avaient établi en principe dans ces sortes d'amour la distinction entre l'aimé et l'aimant qui existe toujours plus ou moins dans toutes les affections : une des deux personnes aimant raisonnablement sans exclusion d'autres intérêts, par bienveillance et reconnaissance, et l'autre par passion irréfléchie. Platon loue Achille de son extrême douleur, à la mort de Patrocle, parce qu'il était l'aimé, et qu'il n'y a qu'une âme parfaitement belle qui puisse être touchée à ce point de l'affection qu'on lui témoigne. A l'admiration du type masculin succéda l'admiration du type féminin, c'est la différence capitale entre l'homme de la cité antique et l'homme du Bas-Empire, parce que cette différence résume toutes les autres et les suppose, et il importait d'y insister. Pour Platon, la femme est un homme manqué ; plus laide que l'homme, moins bien proportionnée que lui pour la course et la lutte, elle lui est également inférieure dans les excursions et les luttes idéales. Pour l'homme du Bas-Empire, la femme l'emporte sur l'homme en beauté, en grâce, en esprit ; elle complète encore plus son âme que sa famille. En vain il ira s'ensevelir aux déserts pour échapper à ses séductions infernales ; absente, il la verra, malgré les prières et les macérations. Le disciple de Platon, lui, reste à la ville, la voit familièrement sans qu'elle trouble sa sérénité, aussi peu ému de ses mines et de son babil que de ceux d'un enfant. L'amour platonique, qui est tombé avec les mœurs publiques, devient ridicule et infâme, alors l'antiquité est bien morte. Avec l'importance que prend la femme au quatrième siècle, et la chute de l'amour platonique, coïncide l'importance que prennent les eunuques. Comme on voit l'ouïe et le toucher se développer chez les aveugles d'une façon merveilleuse, comme on voit les sourds-muets saisir sur les physionomies les nuances les plus fugitives et acquérir une pantomime expressive, il semble que la disgrâce de ces êtres malheureux leur accorde certains privilèges ; leur voix acquiert une pureté séraphique ; leur esprit, dans tout ce qui est abstrait, acquiert une limpidité plus grande. Ils se distinguèrent bientôt dans tous les genres. Ils étaient entrés par trois côtés dans la société romaine. Une charmante et odieuse anecdote du Satiricon nous montre quel danger un enfant courait auprès de son précepteur ; aussi, dès le milieu du troisième siècle, les jeunes gens de la haute classe ont polir précepteurs des eunuques esclaves. Ces eunuques ne les quittent point, ils leur font apprendre par cœur les classiques, ils les conduisent aux cours des rhéteurs, ils leur font répéter les différents chapitres de l'enseignement. Beaucoup de ces eunuques étaient des gens instruits et spirituels qui s'entendaient fort bien à orner la mémoire d'un adolescent, à l'ouvrir aux choses de l'esprit, à le morigéner, à le contenir et à guider ses premiers pas dans la vie. Une fois leur élève devenu homme, ils conservaient sur lui un grand empire, et dirigeaient sa maison par une influence analogue à celle qu'avait conservée sur Louis XV le cardinal Fleury. Vers la même époque, les eunuques étaient entrés dans l'empire comme favoris des grands seigneurs et des princes. A mesure qu'on appréciait moins les qualités héroïques, politiques et philosophiques, ces sortes de passions avaient remplacé l'amour platonique. Le plus souvent elles étaient innocentes et non infâmes comme les amours d'Héliogabale, mais elles n'en sont pas moins honteuses pour la société où elles se produisaient, parce qu'elles indiquent l'appauvrissement du sang. A des jeunes gens musclés et pleins d'espérance, dont l'affection, le commerce, les questions élevées eussent été pour eux un stimulant aux grandes luttes de la vie, les sénateurs et les Césars énervés préféraient des flatteurs, donneurs d'humbles conseils, des confidents toujours attentifs dans le sein desquels ils épanchaient des cancans de femme, les soucis mesquins, les terreurs continuelles d'une vie sans gloire. Une fois devenus indispensables, ces amants pitoyables s'entendaient mieux que des femmes à exploiter à leur profit les terreurs, les haines, les faiblesses d'un maitre, et leur vanité gonflée par l'impuissance jouissait avec délices des flatteries de toute sorte dont leur pouvoir les rendait l'objet. Enfin Constantin avait introduit les eunuques à Byzance pour un troisième office qui souvent se confondait avec les deux premiers : pour diriger, servir et recruter son sérail. Les sérails en effet ne datent pas à Constantinople de la venue des Turcs, car l'usage de Constantin fut suivi par la plupart des empereurs chrétiens. Le goût de Constantin pour les femmes n'avait fait que s'accroître avec l'âge, il le soumit aux eunuques ; ce fut eux qu'il chargea de l'éducation de ses fils. Constance, élevé par les eunuques, n'avait pas hérité de la beauté ni des grandes qualités de son père, mais il n'avait pas hérité non plus de son libertinage ; il chérissait les eunuques, mais seulement comme conseillers et comme ministres. Leur influence n'en était pas moins grande, il ne sut jamais résister à leur voix pointue. Vaniteux et glorieux à la façon des enfants, cruel quand il avait peur et facile à terrifier, paresseux et inappliqué, il aimait à se reposer sur des domestiques du soin des affaires. Il était surtout dirigé par son ancien précepteur, l'eunuque Eusèbe. Les eunuques acquirent sous son règne des richesses immenses, soit par le pillage des temples païens, soit par les pots-de-vin qu'ils recevaient de leurs créatures auxquelles ils donnaient les provinces à pressurer, soit par les confiscations qui suivaient les procès pour crime de lèse-majesté. Ils n'avaient en effet qu'à accuser quelqu'un auprès de Constance d'aspirer au trône, pour que celui-ci perdît la raison, et, oubliant sa modération habituelle, poursuivit les prétendus coupables avec une atrocité qui surpassait, dit A. Marcellin, celle de Caligula, de Domitien et de Commode, inventant des tortures inconnues avant lui et rendant la mort aussi lente que le permet la nature. Toutefois, Constance était un chrétien et un arien fervent, fort scrupuleux sur les mœurs et un époux fidèle et amoureux ; aussi l'influence d'Eusèbe n'était pas la seule à laquelle il obéît. Sa femme, l'impératrice Eusébie, l'emportait souvent sur le parti des chambellans. C'était une femme belle et distinguée. Fille d'un personnage consulaire, élevée à Thessalonique par sa mère, elle avait reçu une instruction de rhéteur ; savante en astronomie et en géométrie, collectionneuse de livres, elle se plaisait aux doctes entretiens, mais sans pédantisme, et elle n'en était pas moins femme ni moins habile dans les intrigues de palais. Eusébie était la seconde femme de Constance, il l'avait épousée étant déjà maître de tout l'empire, seul auguste : C'est après ses nombreux triomphes, dit Julien dans son éloge d'Eusébie, qu'il célébra cet hymen dans des fêtes où il convia des cités, des nations entières, et les muses. Est-on curieux de savoir avec quelle pompe la nouvelle épouse, accompagnée de sa mère, fut amenée de la Macédoine, quel fut le cortège, et quel le nombre des carrosses et des équipages enrichis d'or, d'argent et de bronze précieusement travaillés ? Et après s'être excusé d'en faire la description : Nous encourrions le même blâme en nous engageant à décrire les habits somptueux, les présents variés, et à donner la longue liste des colliers et des couronnes envoyés de la part de l'empereur, à peindre la joie et les acclamations des peuples qui se portèrent en foule à la rencontre d'Eusébie, et les réceptions brillantes qui lui furent faites sur toute la route. L'impératrice, ainsi accueillie et aimées avait cru pouvoir soumettre les eunuques, puis s'en débarrasser entièrement et diriger seule son mari, mais elle fut stérile. Elle devait attendre en vain toute sa vie la naissance d'un enfant qui eût affermi définitivement sa puissance, et elle était contrainte de disputer à Eusèbe et à son parti l'autorité qu'elle avait espéré exercer seule. Telles étaient les mœurs des Romains, tel était l'état de la cour quand Julien arriva à l'âge d'homme. Disons maintenant quelle éducation il avait reçue. |