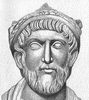JULIEN L'APOSTAT
PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA FORMATION DU CHRISTIANISME
INTRODUCTION.
|
VI. — L'HELLÉNISME. Après avoir exposé la formation du christianisme, il me reste peu de chose à ajouter dans cette introduction sur l'hellénisme, qui fait le sujet de ce livre. Je dirai seulement ici que cette religion ne différait ni par le dogme de l'incarnation, ni par celui de la rédemption, ni par la morale, ni par la théologie du christianisme athanasien, qui depuis est devenu le seul christianisme orthodoxe. C'était ce christianisme moins le nom du Christ, ce christianisme où le Verbe incarné s'appelait Iacchus et Attis, et cela sans que l'hellénisme ait eu besoin de copier le christianisme, mais parce qu'il était sorti du même ensemble de circonstances linguistiques et politiques. Pour le dogme de l'Incarnation et de la Rédemption, je renvoie à la citation de Salluste qui est à la fin du volume et aux dernières paroles de Julien, tirées de son discours sur la Mère des dieux. Pour la morale, ce qui nous empêche d'Ordinaire de voir l'identité de la morale galiléenne du quatrième siècle avec la morale hellénique de ce même siècle, c'est que nous disons : La morale apportée au monde par le christianisme. On n'apporte pas de morale au monde dans un livre, on n'accomplit pas de révolution en morale par le triomphe d'une doctrine ; la morale d'un temps n'est pas susceptible d'une création idéale, c'est une résultante de l'ensemble des mœurs. La morale qui éclate dans les tragédies d'Eschyle est la justice héroïque, parce qu'au temps d'Eschyle Athènes était une cité libre et une cité héroïque. La morale qui éclate dans l'Exode et le Livre de Job est la simplicité sublime, parce que la vie des nomades ou des peuples qui, déjà sédentaires, ont conservé toutes les habitudes des nomades, est simple et sublime. La morale qui éclate dans tous les livres des premiers siècles, sans distinction de sectes, est touchante et mesquine, parce que tous les cœurs étaient attendris et brisés par la dureté des temps, les cerveaux malades, les langues et les idées confuses, et qu'au lieu de l'héroïsme antique qui évite le martyre en triomphant des faits qu'il sait juger, on ne savait plus comprendre que la vertu qui se résigne à les subir sans les juger. Enfin pour l'identité de la trinité de l'hellénisme avec celle du galiléisme, je parle bien entendu de l'identité du dogme de la trinité tel que le concevait Julien l'Apostat et tel que le concevait saint Athanase, tel que celui-ci l'a fait triompher et rendu orthodoxe au concile de Nicée, tout cosmographique et frais encore du syncrétisme de Platon et d'Aristote[1]. Car depuis, la trinité catholique a changé deux fois, une fois avec saint Thomas d'Aquin et une fois avec Malebranche, cette seconde transformation n'ayant eu d'importance qu'en France, puisque la plus grande partie du clergé italien, et entre autres notre Saint-Père actuel, est restée thomiste. L'ignorance monstrueuse du moyen âge en cosmographie, l'éclipse totale de l'arithmétique et de la géométrie anciennes, ne lardèrent pas à rendre incompréhensible le dogme de la trinité. Le christianisme s'était réduit à l'adoration de Jésus-Christ, de Notre-Dame et des saints, tous dieux de chair ; aucune idée pure à adorer. Thomas d'Aquin ayant eu entre les mains les ouvrages quelque peu défigurés et incomplets d'Aristote y trouva les racines facilement saisissables de la trinité chrétienne. Dieu, l'essence ou substantif suprême, est composé comme toutes les autres essences d'une matière et d'une forme ou espèce ; sa matière, son essence en possibilité, en virtualité, est le Père ; son espèce, son essence en activité, en manifestation continue, est le Fils ; enfin le lien mystérieux et toujours présent qui unit cette matière à cette espèce, cette virtualité à cette activité, pour en faire le corps surnaturel, est l'Esprit. Quand Galilée eut supprimé la physique et la logique scolastiques, la trinité chrétienne se trouva entraînée dans le naufrage. Descartes, par la forte réaction monothéiste qu'il fit en philosophie comme en physique, vint à son secours. Pour Descartes il n'existe au monde qu'une force, c'est la volonté de Dieu, faculté tellement omnipotente qu'elle précède tout en Dieu, même la raison : Si les angles d'un triangle sont égaux à deux droits, dit-il, et si deux et deux font quatre, c'est que Dieu l'a voulu. Malebranche, élève chrétien de Descartes, adoucit la doctrine de son maître pour en reconstituer la trinité. La volonté de Dieu fut le Père, la raison ou loi universelle fut le Fils, l'amour divin qui avait réalisé cette loi dans l'univers fut l'Esprit. C'est donc à la trinité d'Athanase seule qu'est identique la trinité hellénique. Mais si l'hellénisme n'était inférieur, ni par la morale, ni par le culte, ni par la théologie au christianisme, d'où vient qu'il n'a pu lutter avec lui ? Cela tient à deux causes secondaires en apparence, capitales en réalité : 1° La religion hellénique était la religion officielle de l'empire, attachée à l'empire et comprise par tous ses membres comme. telle, n'ayant d'autre souverain pontife que l'empereur ; elle devait vivre et périr avec l'empire, et l'empire romain devait périr. Cet hellénisme du quatrième siècle qu'on appelle si improprement paganisme, fut au contraire tué par les pagus qui voulaient réagir contre l'unité factice de l'empire, reconquérir leur individualité propre, et qui trouvèrent dans le culte des saints chrétiens un moyen facile d'adorer de nouveau leurs anciennes idoles locales, à la place des dieux aristocratiques de Virgile et des dieux parfaits d'Homère. 2° Les chefs du néo-hellénisme, qui interprétaient Homère et Hésiode avec la même subtilité que les Pères de l'Église mettaient à l'interprétation de la Bible[2], initiés au vrai sens de l'hellénisme par le recueil des hymnes orphiques, qui, depuis les beaux temps de la Grèce, n'avait jamais été interrompu, et qui était comme un miroir des transformations de la mythologie grecque, surent bien y trouver le monothéisme mais non l'évhémérisme : ils se refusèrent toujours à adorer le Verbe incarné dans la nature, comme un personnage historique. Or l'évhémérisme est une conséquence fatale de la corruption des langues. Pour les hommes primitifs, pour notre père Japhet, comme pour Sem et pour Cham, qui savent qu'il n'y a au fond de la parole humaine qu'une douzaine de radicaux qui, en se développant et se mariant, arrivent à exprimer toutes les nuances possibles de l'âme humaine, il n'y a dans l'univers d'autres réalités que les idées-mères ; au contraire les corps visibles, celui d'un homme, d'un chien, d'un arbre, ne sont qu'une réalité accidentelle et sans intérêt, due au mouvement et à la virtualité des idées-mères. Les hommes du moyen âge, au contraire, c'est-à-dire les peuples qui, comme nous, ne savent plus parler, s'imaginent que les corps visibles sont les seules réalités et qu'au contraire les idées génératrices et destructrices des existences sont des abstractions, ils ne peuvent donc plus adorer les idées. Mais comme l'idolâtrie est le fond du cœur humain, leur cerveau malade se tire du dilemme en adorant des corps humains dans lesquels ils rêvent que les idées sont incarnées. Leur dieu s'évanouit s'ils ne sont sûrs, qu'il a vécu sur la terre à un certain moment, dans un certain pays. Cette tendance évhémériste, cette transformation des types en prophètes et en saints, est universelle, on en note le progrès chez chaque peuple à mesure que son langage se désorganise, et lui fait croire qu'il y a d'autres parties du discours que les verbes. C'est elle qui du brahmanisme a fait sortir le bouddhisme, du judaïsme, le galiléisme et plus tard l'islamisme. En ne voulant pas se soumettre à cette loi, les chefs de l'hellénisme se sont condamnés à l'insuccès ; mais c'est ce parti pris qui les élève au-dessus de leurs rivaux. |