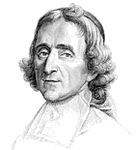FÉNELON
DEUXIÈME PARTIE.
|
I. Les récits mystiques de Mme Guyon, tout en ravissant Mme de Maintenon et Fénelon, leur paraissaient des parfums secrets de piété exceptionnels qu'il fallait respirer dans leur sanctuaire intérieur, mais qu'il ne fallait pas laisser évaporer ou transpirer au dehors, dans la crainte d'enivrer le vulgaire. Le roi, simple de foi comme d'imagination, pensait plus sévèrement. J'ai lu des morceaux de ces
écrits de notre amie au roi, écrit Mme de Maintenon ; il m'a dit que c'étaient des rêveries ; il n'est pas
encore assez avancé dans la piété pour goûter ces perfections. Ne répandez
point, ajoute-t-elle ailleurs, les maximes de l'abbé de Fénelon devant des
gens qui ne le goûtent pas. Quant à Mme Guyon, il faut nous contenter de la
garder pour nous. L'abbé de Fénelon a raison de ne pas vouloir que ces écrits
soient montrés ; tout le monde n'a pas l'esprit droit et solide. On prêche la
liberté des enfants de Dieu à des personnes qui ne sont pas encore ses
enfants. On voit que Fénelon se défiait lui-même de cet entraînement vers une perfection idéale qui pourrait scandaliser les faibles ; que sa complicité spirituelle avec Mme Guyon était moins entière que celle de Mme de Maintenon et de la cour, et que son admiration, pleine de prudence jusque dans l'entraînement, n'alla jamais jusqu'au fanatisme. Cet entraînement venait de sa nature même, et de cette disposition à l'amour mystique de Dieu, où la tendresse se mère à la subtilité. Écoutons-le parler de sainte Thérèse, et nous reconnaîtrons à son admiration quel est le goût intime, le courant natif de sa piété, et nous retrouverons en même temps la réserve, la discrétion, la mesure qui n'abandonnèrent pas cette belle âme : De l'oraison simple où était déjà
sainte Thérèse, Dieu l'enleva jusque dans la plus haute contemplation ; elle
entre dans l'union où se commence le mariage virginal de l'époux avec
l'épouse ; elle, est toute à lui, il est tout à elle. Révélations, esprit de
prophétie, visions sans aucune image sensible ; ravissements, tourments
délicieux, comme elle le dit elle-même, où l'esprit est enivré, et où le
corps succombe, où Dieu lui-même est si présent, que l'âme, épuisée et
dévorée, tombe en défaillance, ne pouvant sentir tant de majesté ; en un mot,
tous les dons surnaturels découlent sur elle. Ses directeurs d'abord se trompent. Voulant juger de ses forces pour la pratique des vertus par le degré de son oraison, et par le reste de faiblesse et d'imperfection que Dieu laissait en elle pour l'humilier, ils concluent qu'elle est dans une illusion dangereuse, et ils veulent l'exorciser. Hélas ! quel trouble pour une âme appelée à la plus simple obéissance, et menée, comme sainte Thérèse, par la voie de la crainte, lorsqu'elle sent son intérieur bouleversé par ses guides ! J'étais, dit-elle, comme au milieu d'une rivière, prête à me noyer, sans espérance de secours. Elle ne sait plus ce qu'elle est, ni ce qu'elle fait quand elle prie. Ce qui faisait sa consolation depuis tant d'années fait sa peine la plus amère. Pour obéir, elle s'arrache à son attrait ; mais elle y retombe, sans pouvoir ni en sortir ni se rassurer. Dans ce doute, elle sent les horreurs du désespoir ; tout disparaît, tout l'effraye, tout lui est enlevé. Son Dieu même, en qui elle se reposait' si doucement, est devenu un songe pour elle. Dans sa douleur elle s'écrie, comme Madeleine : Ils me l'ont enlevé, je ne sais où ils l'ont mis. Ô vous, oints du Seigneur, ne
cessez donc jamais d'apprendre, par la pratique de l'oraison, les plus
profondes et les plus mystérieuses opérations de la grâce, puisque vous en
êtes les dispensateurs. Que n'en coûte-t-il point aux âmes que vous
conduisez, lorsque la sécheresse de vos études curieuses et votre éloignement
des voies intérieures vous font condamner tout ce qui n'entre point dans
votre expérience ! Heureuses les âmes qui trouvent l'homme de Dieu, comme
sainte Thérèse trouva enfin les saint François de Borgia et Pierre
d'Alcantara, qui lui aplanirent la voie par où elle marchait ! Jusqu'alors,
dit-elle, j'avais plus de honte de déclarer mes révélations que je n'en
aurais eu de confesser les plus grands péchés. Et nous aussi, aurons-nous
honte de parler de ces révélations dans un siècle où l'incrédulité prend le
nom de sagesse ? Rougirons-nous de dire à la louange de la grâce ce qu'elle a
fait dans le cœur de Thérèse ? Non, non, tais-toi, ô siècle ! où ceux même
qui croient toutes les vérités de la religion se piquent de rejeter sans
examen, comme fables, toutes les merveilles que Dieu opère dans ses saints. Je sais qu'il faut éprouver les
esprits pour voir s'ils sont de Dieu. A Dieu ne plaise que j'autorise une
vaine crédulité pour de creuses visions ! mais à Dieu ne plaise que j'hésite
dans la foi, quand Dieu se veut faire sentir ! Celui qui répandait d'en haut,
comme par torrents, les dons miraculeux sur les premiers fidèles, n'a-t-il
pas promis de répandre son esprit sur toute chair ? N'a-t-il pas dit : Sur
mes serviteurs et sur mes servantes ? Quoique les derniers temps ne
soient pas aussi dignes que les premiers de ces célestes communications,
faudra-t-il les croire impossibles ? La source en est-elle tarie ? Le ciel
est-il fermé pour nous ? N'est-ce pas même l'indignité de ces derniers temps
qui rend ces grâces plus nécessaires pour allumer la foi et la charité
presque éteinte ?... Ah ! plutôt m'oublier moi-même que d'oublier jamais ces livres (de sainte Thérèse), si simples, si vifs, si naturels, qu'en les lisant on oublie qu'on lit, et qu'on imagine entendre Thérèse elle-même ! Oh ! qu'ils sont doux ces tendres et sages écrits, où mon âme a goûté la manne cachée ! Quelle naïveté quand elle raconte les faits ! Ce n'est pas une histoire, c'est un tableau. Quelle force pour exprimer ces divers états ! Je suis ravi de voir que les paroles lui manquent, comme a dit saint Paul, pour dire tout ce qu'elle sent. Quelle foi vive ! Les cieux lui sont ouverts, rien ne l'étonne, et elle parle aussi familièrement des plus hautes révélations que des choses les plus communes. Assujettie par l'obéissance, elle parle sans cesse d'elle et des sublimes dons qu'elle a reçus, sans affectation, sans complaisance, sans réflexion sur elle-même. Grande âme qui se compte pour rien, et qui, ne voyant plus que Dieu seul en tout, se livre sans crainte elle-même à l'instruction d'autrui. Ô livres si chers à tous ceux qui servent Dieu dans l'oraison, et si magnifiquement loués par la bouche de toute l'Église, que ne puis-je vous dérober à tant d'yeux profanes ! Loin, loin, esprit superbe et curieux qui ne lisez ces livres que pour tenter Dieu et pour vous scandaliser de ses grâces ! Où êtes-vous, âmes simples et recueillies à qui ils appartiennent ?... Oh ! si vous compreniez combien il est doux de goûter Dieu, quand. on ne veut plus goûter que lui seul, vous jouiriez du centuple promis dès cette vie ; votre paix coulerait comme un fleuve, et votre justice serait profonde comme les abîmes de la mer. II. Cependant le bruit des nouveautés qui couvaient, à Saint-Cyr et à Versailles, entre Mme Guyon et l'abbé de Fénelon, et qui ravissaient les âmes ardentes, était parvenu à l'archevêque de Paris, à Bossuet et à l'évêque de Chartres, directeur de Mme de Maintenon. Ces trois oracles de l'Église se réunirent, et lui dénoncèrent Fénelon comme fauteur dangereux d'idées inexpérimentées ou téméraires, qu'il fallait, pour la paix de la religion à peine reconquise, éloigner du roi et de son petit-fils. Bourdaloue, orateur célèbre et vénéré de la chaire, consulté par elle sur ces doctrines, répondit avec la même austérité : Le silence sur ces matières, dit-il. dans sa lettre, est le meilleur gardien de la paix. Il m'en faut parler que dans le secret de la confidence sacrée avec ses directeurs spirituels. La sourde conspiration des esprits, sévères couva ainsi contre Fénelon longtemps avant d'éclater. Rien n'indique encore, à cette époque, un plan arrêté de Bossuet pour perdre dans l'esprit du roi un disciple qu'il avait chéri ; on n'y voit que quelques soupçons inquiets d'un homme des traditions qui répugne de foi et d'orgueil aux nouveautés, et la douleur vive d'un maitre de la doctrine qui voit son enfant près de chanceler dans la foi. Ces deux sentiments naturels dans Bossuet n'avaient pas besoin d'une basse envie pour éclater en sainte colère. L'envie n'est pas la passion de l'orgueil. Bossuet était superbe de son génie et de son audace ; il n'enviait pas, il écrasait. Quand on a la foudre en main, on ne dresse pas d'embûches. Aussi, au commencement de cette querelle, Bossuet chercha plutôt à l'étouffer qu'à l'envenimer. Il traita les visions de Mme Guyon comme les erreurs d'un esprit malade. Il consentit à voir cette femme célèbre, il reçut avec indulgence ses explications et ses regrets des troubles qu'elle excitait involontairement dans les âmes. Il la fit, de sa propre main, participer aux mystères dans sa chapelle particulière ; il lui conseilla le silence, l'ombre, l'éloignement de Paris et de la cour pendant quelques mois. Il se chargea d'examiner lui-même à loisir ses écrits, et de porter un arrêt suprême auquel elle se soumettrait avec une déférence volontaire. Il fit ce qu'il avait promis de faire, il lut et censura les livres de sa pénitente. Il lui écrivit pour lui indiquer, avec une bonté divine, les passages scandaleux pour la raison ou dangereux pour la morale. Il s'entretint confidentiellement avec Fénelon des aberrations de son amie spirituelle, et le conjura de les condamner avec lui. Fénelon, sûr de l'orthodoxie de Mme Guyon, et touché des persécutions qui la menaçaient, la justifia devant Bossuet avec plus de magnanimité que de politique. Il se refusa à condamner comme théologien ce qu'il admirait comme homme, comme poète et comme ami. Il répondit que Dieu se servait des plus faibles sentiments pour manifester sa gloire ; que l'esprit soufflait où il voulait ; que la langue exaltée des prophètes ou des sibylles n'avait ni la précision ni la timidité de la langue des écoles, et qu'avant de réprouver ces inspirées de Dieu ou de leur propre délire, il fallait les éprouver par le temps. Bossuet fut contristé. III. Le roi, qui se mêlait de théologie sans rien comprendre que la discipline et l'autorité infaillible, témoigna son mécontentement. Mine de Maintenon, par qui ce scandale naissant s'était introduit à Saint-Cyr, à la cour, dans l'Église, trembla de paraître aux yeux du roi complice et fauteur de ceux qui alarmaient la conscience du prince. Elle se hâta de désavouer ses amis et de leur retirer sa faveur. Elle n'alla pas cependant, dans le commencement, jusqu'à s'unir à leurs persécuteurs. Elle rendait en secret témoignage de leur innocence et de leur intention, mais elle pressait la nomination d'un tribunal de doctrines pour juger la question, et pour décharger une responsabilité qui lui pesait dans cette affaire. Encore une lettre de Mme Guyon !
écrit-elle. Cette femme est bien importune. Il est
vrai qu'elle est bien malheureuse ! Elle me prie aujourd'hui de faire
adjoindre M. Tronson, l'ami de Fénelon, aux juges. Je ne sais si le roi
voudra donner cette mortification à l'archevêque de Paris.... M. l'abbé de Fénelon a trop de piété pour ne pas croire
qu'on peut aimer Dieu pour lui-même, et il a trop d'esprit pour croire qu'on
puisse associer cet amour aux vices les plus honteux. Il n'est point l'avocat
de Mme Guyon, quoiqu'il en soit l'ami ; il est le défenseur de la piété et de
la perfection chrétienne. Je me repose sur sa parole, parce que j'ai connu
peu d'hommes aussi francs que lui, et vous pouvez le dire ! IV. Les conférences s'ouvrirent. Bossuet les dominait ; étranger à ces subtilités, il priait encore Fénelon lui-même de l'initier à ces exaltations des mystiques français et espagnols ou italiens que l'Église avait tolérés, et qu'il appelait dans son rude bon sens d'amoureuses extravagances. Fénelon analysait pour Bossuet ces livres, sources où Mme Guyon avait puisé ses propres enthousiasmes. Il était ferme alors dans sa déférence au génie de Bossuet. Ne soyez point en peine de moi,
lui écrivait-il en lui adressant ces documents, je
suis dans vos mains comme un enfant. Ces doctrines passent par moi sans être
de moi. J'aime autant croire d'une façon que d'une autre. Dès que vous aurez
parlé, tout sera effacé en moi. Quand même ce que je crois avoir lu me
paraîtrait aussi clair que deux et deux font quatre, je le croirais encore
moins clair que mon obligation de me défier de mes lumières et de leur
préférer celles d'un pontife tel que vous !... Je tiens trop à la tradition pour chercher à en détacher celui qui, de
nos jours, doit en être la colonne principale. V. Cependant l'archevêque de Paris, impatient de la lenteur des conférences, fulminait séparément contre Mme Guyon et ses doctrines. Mine de Maintenon, tremblant que Fénelon ne se trouvât compris dans ces réprobations de l'Église de Paris et arraché aussi à la cour où elle voulait le retenir, employa, pour le détacher de Mme Guyon, la séduction de la faveur royale. Le roi le nomma archevêque de Cambrai. A ce titre, Mme de Maintenon espérait le faire associer lui-même aux évêques qui jugeaient Mme Guyon, et le contraindre à réprouver ainsi comme pontife ce qu'il avait admiré comme ami. Le roi entra dans ce complot de bienveillance. On y retrouve toute l'habileté d'un courtisan sous l'affection d'une amie. Elle voulait du même coup tranquilliser le roi sur les doctrines de Fénelon, et reconquérir Fénelon sur Mme Guyon, qu'elle abandonnait aux évêques. Fénelon s'alarma au premier moment d'une dignité qui devait l'enlever à son élève. Il représenta au roi que la première dignité à ses yeux était la tendresse qui l'attachait à son petit-fils, et qu'il ne changerait volontairement contre aucune autre. Non, lui répondit avec bonté Louis XIV, j'entends que vous restiez en même temps précepteur de mon petit-fils. La discipline de l'Église ne vous impose que neuf mois de résidence dans votre diocèse : vous donnerez les trois autres mois à vos élèves ici, et vous surveillerez de Cambrai leur éducation pendant le reste de l'année, comme si vous étiez à la cour. Fénelon, enchaîné par de telles faveurs, se dépouilla, contre l'usage, d'une abbaye qu'il possédait, et résista avec un désintéressement exemplaire aux instances et aux exemples qui l'encourageaient à garder ces richesses de l'Église. Il ne voulut rien emporter dans son évêché des trésors d'aumônes appartenant, selon lui, à d'autres pauvres. Le monde l'admira sans l'imiter. Le roi, d'après les inspirations de Mme de Maintenon, l'adjoignit aux évêques qui scrutaient les doctrines de Mme Guyon. Mais déjà la conférence était dissoute, et Bossuet, seul rapporteur et seul oracle, rédigeait à part le jugement. Fénelon, après en avoir discuté et fait modifier les termes dans un sens qui excluait toute application de la censure à la personne de Mme Guyon, signa l'exposé des principes purement théologiques de cette déclaration. La paix semblait tellement cimentée entre ces deux oracles de la foi en France, que Bossuet voulut présider lui-même, comme pontife consécrateur, à l'élévation ecclésiastique de son disciple et de son ami. Le roi, son fils, son petit-fils, sa cour entière assistèrent, dans la chapelle de Mme de Maintenon, à Saint-Cyr, à la cérémonie où le génie de l'éloquence consacrait le génie de la poésie. VI. Mais à peine cette paix était-elle rétablie par l'intervention de Mme de Maintenon, par la longanimité de Bossuet, par l'humilité de Fénelon et par le silence de Mme Guyon, que de nouvelles causes de discussion s'élevèrent à son occasion entre les pontifes. Mine Guyon s'évada secrètement du couvent où Bossuet lui avait offert un asile sûr et affectueux à Meaux, capitale de son diocèse. Elle lui écrivait qu'elle se retirait dans la solitude, loin du monde et de ses orages ; mais elle se cacha, au contraire, dans Paris, au milieu du cénacle de plus en plus fervent de ses disciples, au nombre desquels on comptait avec inquiétude Fénelon et ses amis, le duc de Beauvilliers et le duc de Chevreuse. Au même moment l'archevêque de Paris mourut. C'était un homme de mœurs mondaines, qui avait blessé la conscience du roi. On cherchait un homme de haute vertu pour purifier le siège. L'Église nommait Bossuet, le inonde Fénelon. Mme de Maintenon hésitait entre les deux, l'un plus redouté, l'autre plus aimé. Les soupçons de nouveauté éloignèrent de Fénelon, les craintes de la domination éloignèrent de Bossuet. Mme de Maintenon appela au siège de Paris M. de Noailles, pontife exemplaire et agréable à la cour. Bossuet ressentit avec majesté l'injure ; il ne s'abaissa ni à solliciter ni à refuser. Il y a toute apparence, écrit-il à ses amis de Paris, que Dieu, par sa miséricorde autant que par sa justice, me laissera dans ma place. Quand vous souhaitez qu'on m'offre et que je refuse, vous voulez contenter ma vanité. Il vaut mieux contenter l'humilité ! Il n'y a pas à douter, malgré tout vain discours des hommes, que, selon tous mes désirs, je ne sois enterré ici aux pieds de mes saints prédécesseurs en travaillant au salut du troupeau qui m'a été confié. La grandeur de cette ambition était dans sa franchise. Bossuet ressentait l'indignité de la préférence de M. de Noailles envers son génie ; mais il ne s'abaissait ni au murmure, ni au regret, ni même au désir : il sentait lui-même sa vengeance dans sa supériorité. Cependant, soit qu'il fût à son insu humilié d'avoir été balancé avec la jeunesse de Fénelon, avec la médiocrité de M. de Noailles, soit que l'évasion peu loyale de Mine Guyon et sa résidence suspecte à Paris lui parussent avoir été incitées par Fénelon, et avoir trompé ainsi la 'confiance qu'il avait mise dans son disciple, le ressentiment couva dans son âme et ne tarda pas à éclater. Il sollicita du roi l'arrestation de Mme Guyon. Le roi la fit découvrir dans Paris et enfermer dans une maison de fous. Que voulez-vous qu'on fasse, écrivit Mme de Maintenon à l'archevêque de Paris, d'elle, de ses amis, de ses papiers ? Le roi sera encore ici tout le jour, écrivez-lui directement. Je suis ravi de cette arrestation, écrivit aussi Bossuet à Mme de Maintenon ; ce mystère cachait bien des maux à l'Église. Fénelon, alors à Cambrai, apprit avec douleur que son amie venait d'être transférée à Vincennes. Le duc de Beauvilliers trembla de voir Fénelon enlevé à l'éducation du duc de Bourgogne. Il est évident, écrit-il, qu'il y a une cabale très-puissante et très-animée contre
l'archevêque de Cambrai. Mme de Maintenon obéit à ce qu'on lui suggère ; elle
est prête à se porter aux dernières extrémités contre lui. Je le vois à la
veille d'être ravi aux princes comme un homme suspect de leur inspirer des
doctrines dangereuses. Si on y réussit, j'aurai mon tour ; mais, au scandale
près, je vous dirai que j'en serais consolé.... Quant à M. de Fénelon, je ne lui conseillerai pas, quand
il le voudrait, de faire une condamnation formelle des livres de Mme Guyon.
Il donnerait trop de joie aux libertins de la cour, et ce serait confirmer
tout ce qui se débite au préjudice de la piété.... Ne serait-ce pas donner lieu de croire qu'il est complice
de tout ce qu'on impute à cette pauvre femme, et que, par politique et par
crainte d'être disgracié, il se presse d'abjurer ? Je me croirais en
conscience obligé, dans tous les cas, de dire ouvertement ce qui pourrait
justifier M. de Fénelon ; et, quand il serait disgracié, je le dirais plus
hautement, parce qu'on verrait mieux alors que la justice et la vérité seules
m'obligent à rendre témoignage.... On transféra, après plusieurs interrogatoires, Mme Guyon dans une maison cloîtrée de Vaugirard, sous la surveillance du curé de Saint-Sulpice. Nous n'aurons pas pour cet adoucissement, écrit Mme de Maintenon, l'approbation de Bossuet ; mais, pour moi, je crois qu'il est de mon devoir de détourner des violences autant qu'il m'est possible. VII. On veut que je condamne la
personne de Mme Guyon, écrit au même moment Fénelon. Quand l'Église portera sur ses doctrines un arrêt, je suis
prêt à le signer de mon sang. Hors de là je ne puis ni ne dois rien faire de
semblable. J'ai vu de près une vie qui m'a infiniment édifié : pourquoi
veut-on que je la condamne sur d'autres faits que je n'ai point vus ? Me
convient-il d'aller accabler une pauvre personne que tant d'autres ont déjà
foudroyée et dont j'ai été l'ami ? Quant à Bossuet, je serais ravi d'adhérer à son livre, s'il le souhaite, quant aux doctrines ; mais je ne le puis honnêtement ni en conscience, s'il attaque une femme qui me parait innocente, et des écrits que j'ai laissé condamner sans y attacher inutilement ma propre censure.... Bossuet est un saint pontife, c'est un ami tendre et solide : mais il veut, par un excès de zèle pour l'Église et d'amitié pour moi, me mener au delà des bornes.... Je crois Mme de Maintenon sur la même pente.... Elle s'afflige et s'irrite tour à tour contre moi à chaque nouvelle impression qu'on lui donne.... Tout se réduit donc de ma part à ne pas vouloir parler contre ma conscience, à ne pas consentir à insulter une femme que j'ai révérée comme une sainte sur tout ce que j'ai vu d'elle par moi-même.... Si j'étais capable, ajoute-t-il
ailleurs dans une lettre de tendre reproche à Mme de Maintenon, sa persécutrice par amitié, si j'étais capable d'approuver
une femme qui prêcherait un nouvel Évangile, il faudrait me déposer et me
brûler, bien loin de me supporter comme vous le faites ; mais je puis fort
innocemment me tromper sur une personne que je crois sainte. Je n'ai jamais
eu aucun goût naturel pour elle, je n'ai jamais éprouvé rien d'extraordinaire
en elle qui ait pu me prévenir en sa faveur ; elle est confiante à l'excès,
la preuve en est bien claire, puisqu'il (Bossuet) vous a redit, comme des impiétés, des choses qu'elle lui
avait confiées.... Je ne compte pour rien ni ses prétendues prophéties, ni ses prétendues révélations... je n'ai jamais entendu parler des images scandaleuses qu'on attribue à son mysticisme pour exprimer l'amour divin ; je parierais ma tête que tout cela ne veut rien dire de précis, et que Bossuet est inexcusable de vous avoir donné comme une doctrine de Mme Guyon ce qui n'était que songe, ou expression figurée, ou quelque chose d'équivalent. On n'a rien trouvé contre ses mœurs que des calomnies. Je suis si persuadé qu'elle n'a rien enseigné de mauvais, que je répondrais encore de lui faire donner ou les explications ou les rétractations satisfaisantes.... Peut-être croirez-vous que je parle ainsi pour la faire mettre en liberté ? Non, je m'engage à lui faire donner ces explications sans qu'elle sorte même de prison, je ne la verrai point ; je ne lui écrirai que des lettres ouvertes, lues par vous et par ses accusateurs. Après tout cela, laissez-la
mourir en prison. Je suis content qu'elle y meure, que nous ne la voyions
jamais, que nous n'entendions jamais parler d'elle ! Pourquoi donc vous resserrez-vous le cœur à notre égard, madame, comme si nous étions d'une autre religion que vous ?... Ne craignez pas même que je contredise Bossuet, je n'en parlerai jamais que comme de mon maitre ; je consens qu'il soit vainqueur, et qu'il passe pour m'avoir ramené de toutes sortes d'égarements : sincèrement, je ne veux avoir que déférence et docilité pour lui... VIII. Fénelon, ainsi placé par son imprudence et par la rigidité de ses adversaires entre le crime de condamner ce qu'il croyait innocent, l'humiliation de se condamner lui-même, et le danger de susciter sur sa propre tête les foudres de Bossuet, maure de l'Église de France, se retira triste et pressentant la ruine de sa vie dans la solitude de Cambrai. Là pour manifester son innocence de foi et pour enlever tout prétexte aux incriminations de Bossuet, il écrivit son livre des Maximes des saints. C'était la justification, par les textes tirés des livres et des opinions des oracles mêmes de l'Église, de l'amour désintéressé de Dieu ; doctrine transcendante des mystiques de tous les âges. soumit humblement page par page son manuscrit à la censure de Monseigneur de Noailles, qui rengagea à ne le communiquer qu'à ses théologiens, sans en parler à Bossuet. Il corrigea sur leurs notes tout ce qui fit pour eux l'objet de la plus légère observation. Il chargea le duc de Chevreuse, son ami, de faire imprimer le livre. Bossuet s'indigna au bruit de la prochaine publication d'un livre dont on. lui avait dérobé le secret. Je suis certain, écrivit-il, que cet écrit ne peut causer qu'un grand scandale.... Je ne puis, en conscience, le supporter !... Dieu m'oblige à faire voir qu'on veut soutenir par là fies livres téméraires qui sont le renversement de la piété.... Voilà la vérité à laquelle il faudra que je sacrifie ma vie !... On ne m'évite, en cette occasion, après m'avoir témoigné tant de soumission en paroles, que parce qu'on sent que Dieu, en qui je me fie, me donnera la force pour éventer la mine !.... IX. La colère de Bossuet fut contagieuse à l'apparition du givre. La justification de Fénelon parut mn crime contre l'autorité de l'oracle de l'Église de France. Le roi prit parti pour le, chef de l'épiscopat. Un historien impartial et contemporain, d'Aguesseau, attribue l'éclat de la colère de Louis XIV à l'aversion sourde qu'il nourrissait contre la supériorité d'esprit de Fénelon. Soit que ce prince craignit, dit d'Aguesseau, les esprits d'un ordre supérieur, soit qu'une certaine étrangeté et une certaine recherche dans le caractère et dans les formes de Fénelon déplussent à ce prince, qui était porté par son goût au simple et à l'uni ; soit que Fénelon, par une politique profonde, voulant paraitre se renfermer dans ses fonctions, évitai de s'insinuer dans la familiarité du roi, il est bien certain que Louis XIV n'avait jamais paru le goûter et qu'il n'eut aucune peine à le sacrifier. Bossuet accrut encore cette disposition par les alarmes qu'il jeta dans la conscience du roi. Il s'accusa comme d'une condescendance criminelle de n'avoir pas révélé plus tôt au roi le fanatisme de son disciple ! La cour, informée des secrètes antipathies du roi, s'ameuta tout entière contre le prétendu hérésiarque. Un naturel si heureux, dit
encore d'Aguesseau, fut perverti, comme celui du
premier homme, par la voix d'une femme. Ses talents, son ambition, sa
fortune, sa réputation même, furent sacrifiés par lui, non à l'illusion des
sens, mais à celle de l'esprit. On vit ce génie si sublime se borner à
devenir le prophète et l'oracle d'une secte, fertile en images spécieuses et
séduisantes, voulant être philosophe et n'étant jamais qu'orateur, caractère
qu'il a conservé dans tous les ouvrages sortis de sa plume jusqu'à la fin de
sa vie. On alla jusqu'à l'accuser d'avoir voulu flatter la dévotion du roi pour en faire l'instrument de sa fortune, en ayant la pensée de joindre la politique à la mysticité, de former, par les liens secrets d'un langage mystérieux, une puissante cabale à la tête de laquelle il serait, toujours par l'élévation et l'insinuation de son génie. Ces imputations tombaient d'elles-mêmes devant le courage qu'avait en ce moment Fénelon de mécontenter le roi et d'offenser Bossuet, pour soutenir une femme persécutée et une doctrine calomniée. Tout le monde s'éloignait de lui. La contagion de la disgrâce dans laquelle il s'était volontairement précipité faisait redouter et éviter non-seulement de le justifier, mais même de le plaindre. Il était à Versailles aussi isolé qu'à Cambrai, attendant chaque jour l'ordre de s'exiler dé la cour. Ce fut dans cette angoisse de son âme qu'un incendie dévora, avec son palais épiscopal de Cambrai, les meubles, les livres, les manuscrits qu'il contenait, sa seule richesse, qu'il y avait transportée. Il reçut ce coup avec sa sérénité habituelle. J'aime mieux, dit-il à l'abbé de Langeron qui accourut pour lui apprendre ce malheur domestique, que le feu ait pris à ma maison qu'à la chaumière d'une pauvre famille. X. Cependant Bossuet fulminait des censures sévères contre le livre de Fénelon, tout en ménageant l'ancien ami. Il nous est dur, disait-il, de parler ainsi d'un ami si accoutumé à entendre ma voix, comme j'étais moi-même si accoutumé à entendre la sienne. Dieu, sous les yeux de qui j'écris, sait avec quel gémissement j'ai porté ma triste plainte sin- ce qu'un ami de tant d'années me juge indigne de traiter avec lui, moi qui n'ai jamais élevé ma voix contre lui d'un demi-ton seulement !... Un ami de toute la vie ! un cher adversaire, Dieu le sait, que je porte dans mes entrailles !... Xl. Au moment où Bossuet écrivait ces lignes, le roi envoyait l'ordre à Fénelon de quitter Versailles, de se rendre à Cambrai, sans s'arrêter à Paris. Il lui défendait d'aller à Rome solliciter un jugement du pape sur ses doctrines, redoutant sans doute la séduction que son génie et sa vertu exerceraient à Rome comme partout. Le roi en même temps écrivait à Rome pour demander au souverain pontife une condamnation de l'archevêque de Cambrai, s'engageant à la faire exécuter par toute son autorité royale. La séparation de Fénelon et du duc de Bourgogne, son élève, déchira ces deux cœurs. Les larmes du duc de Beauvilliers, du duc de Chevreuse, se mêlèrent à celles du jeune prince et de son ami. Le duc de Bourgogne se jeta en vain aux pieds du roi, son, aïeul, pour arracher un contre-ordre ; un sursis, un pardon : Non, mon fils, répondit le roi ; je ne suis pas maître de faire de ceci une affaire de faveur. Il s'agit de la sûreté de la foi ; Bossuet en sait plus dans cette matière que vous et moi ! Mme de Maintenon affligée, mais d'autant plus inexorable qu'elle avait été plus complice, refusa de recevoir Fénelon. Le duc de Beauvilliers, fidèle à ta vertu comme à l'amitié, parla en cœur libre au maître des grâces : Sire, dit-il au roi, je suis l'ouvrage de Votre Majesté. Vous m'avez élevé, vous pouvez m'abattre ; dans la volonté de mon prince je reconnaîtrai la volonté de Dieu ; je me retirerai de la cour, sire, avec le regret de vous avoir déplu, mais avec l'espérance d'une vie plus tranquille. Fénelon conjurait, au contraire, le duc de Beauvilliers et ses amis de ne pas se perdre pour sa cause. Je suis ici accablé des opprobres dont on m'a couvert, écrit-il à ces amis, mais sacrifiez-moi ! Encore un peu de temps, et le songe trompeur de cette vie va s'évanouir, et nous serons tous réunis à jamais dans le royaume de vérité, où il n'y a plus ni erreur, ni division, ni scandale, où la paix de Dieu sera la nôtre ! En attendant, souffrons, taisons-nous, laissons-nous fouler aux pieds, trop heureux si notre ignominie sert à sa gloire ! XII. Arrivé dans son diocèse, Fénelon se livra tout entier à la charité et à l'étude. De cette solitude sortirent des milliers de pages où respirent le génie littéraire de la plus pure antiquité et le génie moderne du christianisme, qui parlent de la divinité avec une admirable puissance d'esprit et de langage, souvent avec le plus tendre enthousiasme. On y sent une prière, une adoration perpétuelle sous. chaque parole, comme la chaleur sous la vie. On peut dire que Fénelon ne pouvait parler de Dieu. sans prier. Voici quelques-unes de ces pages prises au hasard dans cette multitude de traités et de lettres où s'épanouissait son âme. Elles le peindront mieux que tout ce que nous pouvons en dire : Tout porte la marque divine dans
l'univers : les cieux, la terre, les plantes, les animaux, et les hommes plus
que tout le reste. Tout nous montre un dessein suivi, un enchaînement de
causes subalternes conduites avec ordre par une cause supérieure. Il n'est point question de critiquer ce grand ouvrage. Les défauts qu'on y trouve viennent de la volonté libre et déréglée de l'homme, qui les produit par son dérèglement ; ou de celle de Dieu, toujours sainte et toujours juste, qui veut tantôt punir les hommes infidèles, et tantôt exercer par les méchants les bons qu'il veut perfectionner. Souvent même ce qui parait défaut à notre esprit borné, dans un endroit séparé de l'ouvrage, est un ornement par rapport au dessein général, que nous ne sommes pas capables de regarder avec des vues assez étendues et assez simples pour connaître la perfection du tout. N'arrive-t-il pas tous les jours qu'on blâme témérairement certains morceaux des ouvrages des hommes, faute d'avoir assez pénétré toute l'étendue de leurs desseins ? C'est ce qu'on éprouve tous les jours pour les ouvrages des peintres et des architectes. Si des caractères d'écriture étaient d'une grandeur immense, chaque caractère regardé de près occuperait toute la vue d'un homme ; il ne pourrait lire, c'est-à-dire assembler les lettres, et découvrir le sens de tous ces caractères rassemblés. ll en est de même des grands traits que la Providence forme dans la conduite du monde entier pendant la longue suite des siècles. Il n'y a que le tout qui soit intelligible, et le tout est trop vaste pour être vu de près. Chaque événement est comme un caractère particulier qui est trop grand pour la petitesse de nos organes, et qui ne signifie rien s'il est séparé des autres. Quand nous verrons en Dieu à la fin des siècles, dans son vrai point de vue, le total des événements du genre humain, depuis h, premier jusqu'au dernier jour de l'univers, et leurs proportions par rapport aux desseins de Dieu, nous nous écrierons : Seigneur, il n'y a que vous de juste et de sage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . Mais, après tout, les vrais défauts mêmes de cet ouvrage ne sont que des imperfections que Dieu y a laissées pour nous avertir qu'il l'avait tiré du néant. Il n'y a rien dans l'univers qui ne porte et qui ne doive porter également ces deux caractères si opposés : d'un côté, le sceau de l'ouvrier sur son ouvrage ; d'un autre côté, la marque du néant d'où il est tiré et où il peut retomber à toute heure. C'est un mélange incompréhensible de bassesse et de grandeur, de fragilité dans la matière et d'art dans la façon. La main de Dieu éclate partout, jusque dans un ver de terre. Le néant se fait sentir partout, jusque dans les plus vastes et les plus sublimes génies. Tout ce qui n'est point Dieu ne peut avoir qu'une perfection bornée ; et qui n'a qu'une perfection bornée demeure toujours imparfait par l'endroit où la borne se fait sentir, et avertit que l'on y pourrait encore beaucoup ajouter. La créature serait le créateur même, s'il ne lui manquait rien ; car elle aurait la plénitude de lit perfection, qui. est la divinité même : dès qu'elle ne peut être infinie, il faut qu'elle soit bornée en perfection, c'est-à-dire imparfaite par quelque côté. Elle peut avoir plus ou moins d'imperfection ; mais enfin il faut toujours qu'elle soit imparfaite ; il faut qu'on puisse toujours marquer l'endroit précis où elle manque, et que la critique puisse dire : Voilà ce qu'elle pourrait encore avoir, et ce qu'elle n'a pas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu'on étudie le monde tant qu'on
voudra ; qu'on descende au dernier détail ; qu'on fasse l'anatomie du plus
vil animal ; qu'on regarde de près le moindre grain de blé. semé dans la
terre, et la manière dont ce germe se multiplie ; qu'on observe attentivement
les précautions avec lesquelles un bouton de rose s'épanouit au soleil et se
referme vers la nuit : on y trouvera plus rie, dessein, de conduite et
d'industrie que dans tous les ouvrages de l'art. Ce que l'on appelle même
l'art des hommes n'est qu'une faible imitation du grand art qu'on nomme les
lois de la nature, et que les impies n'ont pas eu honte d'appeler le hasard
aveugle. Faut-il donc s'étonner si les pontes ont animé tout l'univers, s'ils ont donné des ailes aux vents et des flèches au soleil ; s'ils ont peint les fleuves qui se hâtent de se précipiter dans la mer, et les arbres qui montent vers le ciel pour vaincre les rayons du soleil par l'épaisseur de leurs ombrages ? Ces figures ont passé même dans le langage vulgaire, tant il est naturel aux hommes de sentir l'art dont toute la nature est pleine. La poésie n'a fait qu'attribuer aux créatures inanimées le dessein du Créateur, qui fait tout en elles. Du langage figuré des pontes, ces idées ont passé dans la théologie des païens, dont les théologiens furent les pontes. Ils ont supposé un art, une puissance, une sagesse qu'ils ont nommée numen, dans les créatures même les plus privées d'intelligence. Chez eux, les fleuves ont été des dieux, et les fontaines des naïades. Les bois, les montagnes ont eu leurs divinités particulières. Les fleurs ont eu Flore, et les fruits Pomone. Plus on contemple sans prévention toute la nature, plus on y découvre partout un fonds inépuisable de sagesse, qui est comme l'âme de l'univers. Que s'ensuit-il de là ? La
conclusion vient d'elle-même. S'il faut tant de sagesse et de pénétration, dit
Minutius Félix, même pour remarquer l'ordre et le dessein merveilleux de la
structure du monde, combien, à plus forte raison, en a-t-il fallu pour le
former ! Si on admire tant les philosophes parce qu'ils découvrent une petite
partie des secrets de cette sagesse qui a tout fait, il faut être bien
aveugle pour ne pas l'admirer elle-même. Voilà le grand objet du monde entier, où Dieu, comme dans un miroir, se présente au genre humain. Mais les uns (je parle des philosophes) se sont évanouis dans leurs pensées ; tout s'est tourné pour eux en vanité. A force de raisonner subtilement, plusieurs d'entre eux ont perdu même une vérité qu'on trouve naturellement et simplement en soi, sans avoir besoin de philosophie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . Un voyageur entrant dans le Saïde,
qui est le pays de l'ancienne Thèbes à cent portes, et qui est maintenant
désert, y trouverait des colonnes, des pyramides, des obélisques, des
inscriptions en caractères inconnus. Dirait-il aussitôt : Les hommes n'ont jamais habité ces lieux ; aucune main d'homme
n'a travaillé ici ; c'est le hasard qui a formé ces colonnes, qui les a
posées sur leurs piédestaux et qui les a couronnées de leurs chapiteaux avec
des proportions si justes ; c'est le hasard qui a lié si solidement les
morceaux dont ces pyramides sont composées ; c'est le hasard qui a taillé ces
obélisques d'une seule pierre et qui a gravé tous ces caractères ? Ne
dirait-il pas, au contraire, avec toute la certitude dont l'esprit de l'homme
est capable : Ces magnifiques débris sont les restes d'une majestueuse
architecture qui florissait dans l'ancienne Égypte ? Voilà ce que la simple raison
fait dire au premier coup d'œil, et sans avoir besoin de raisonner. Il en est
de même du premier coup d'œil jeté sur l'univers. On peut s'embrouiller
soi-même par de vains raisonnements pour obscurcir ce qu'il y a de plus clair
; mais le simple coup d'œil est décisif. Un ouvrage tel que le monde ne se
fait jamais de lui-même ; les os, les tendons, les veines, les artères, les
nerfs, les muscles qui composent le corps de l'homme, ont plus d'art et de
proportion que toute l'architecture des anciens Grecs et Égyptiens. L'œil du
moindre animal surpasse la mécanique de tous les artisans ensemble. Si on
trouvait une montre dans les sables d'Afrique, on n'oserait dire sérieusement
que le hasard l'aurait formée dans ces lieux déserts ; et on n'a point honte
de dire que les corps des animaux, à l'art desquels nulle montre ne peut
jamais être comparée, sont des caprices du hasard ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô mon Dieu ! si tant d'hommes ne
vous découvrent point dans ce beau spectacle que vous leur donnez de la
nature entière, ce n'est pas que vous soyez loin de chacun de nous. Chacun de
nous vous touche comme avec la main ; mais les sens et les passions qu'ils
excitent emportent toute l'application de l'esprit. Ainsi, Seigneur, votre
lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres sont si épaisses qu'elles ne
la comprennent pas : vous vous montrez partout, et partout les hommes
distraits négligent de vous apercevoir. Toute la nature parle de vous et
retentit de votre saint nom ; mais elle parle à des sourds, dont la surdité
vient de ce qu'ils s'étourdissent toujours eux-mêmes. Vous êtes auprès d'eux
et au dedans d'eux ; mais ils sont fugitifs et errants hors d'eux-mêmes. Ils
vous trouveraient, ô douce lumière ! ô éternelle beauté ! toujours ancienne
et toujours nouvelle ! ô fontaine de chastes délices ! ô vie pure et bienheureuse
de tous ceux qui vivent véritablement, s'ils vous cherchaient au dedans
d'eux-mêmes ! mais les impies ne vous perdent qu'en se perdant. Hélas ! vos
dons que leur montre la main d'où ils viennent les amusent jusqu'à les
empêcher de la voir ; ils vivent de vous, et ils vivent sans penser à vous,
ou plutôt ils meurent auprès de la vie, faute de s'en nourrir ; car quelle mort
n'est-ce point de vous ignorer ! J'ai reconnu qu'il y a dans la
nature nécessairement un Être qui est par lui-même, et par conséquent
parfait. J'ai reconnu que je ne suis pas cet Être, parce que je suis
infiniment au-dessous de l'infinie perfection. J'ai reconnu qu'il est hors de
moi, et que je suis par lui. Maintenant je découvre qu'il m'a donné l'idée de
lui, en me faisant concevoir une perfection infinie sur laquelle je ne puis
me méprendre ; car, quelque perfection bornée qui se présente à moi, je
n'hésite point ; sa borne fait aussitôt que je la rejette, et je lui dis dans
mon cœur : Vous n'êtes point mon Dieu ; vous n'êtes point mou infiniment
parfait ; vous n'êtes point par vous-même. Quelque perfection que vous ayez, il
y a un point et une mesure au delà de laquelle vous n'avez plus rien et vous
n'êtes plus rien. Il n'en est pas de même de mon Dieu, qui est tout ; il est, et il ne cesse point d'être ; il est, et il n'y a pour lui ni degré ni mesure ; il est, et rien n'est que par lui. Tel est ce que je conçois ; or, puisque je le conçois, il est ; car il n'est pas étonnant qu'il soit, puisque rien, comme je l'ai vu, ne peut être que par lui. Mais ce qui est étonnant et incompréhensible, c'est que moi, faible, borné, défectueux, je puis le concevoir. Il faut qu'il soit non- seulement l'objet immédiat de ma pensée, mais encore la cause qui me fait penser, comme il est la cause qui me fait être, et qu'il élève ce qui est fini à penser l'infini. Voilà le prodige que je porte toujours au dedans de moi. Je suis un prodige moi-même. N'étant rien, du moins n'étant qu'un être emprunté, borné, passager, je tiens de l'infini et de l'immuable que je conçois ; par-delà je ne puis me comprendre moi-même ; j'embrasse tout, et je ne suis rien ; je suis un rien qui connaît l'infini : les paroles me manquent pour m'admirer et me mépriser tout ensemble. Ô Dieu ! ô le plus être de tous les êtres ! ô Être devant qui je suis comme si je n'étais pas ! vous vous montrez à moi, et rien de ce qui n'est pas vous ne peut vous ressembler. Je vous vois ; c'est vous-même : et ce rayon qui part de votre face rassasie mon cœur en attendant le plein jour de la vérité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je demande pourquoi Dieu nous a
donné cette capacité de le connaître et de l'aimer. Il est manifeste que
c'est le plus précieux de tous ses dons. Nous l'a-t-il accordé d'une manière
aveugle et sans raison, par pur hasard, sans vouloir que nous en fissions
usage ? Il nous a donné des yeux corporels pour voir la lumière du jour.
Croirons-nous qu'il nous a donné les yeux de l'esprit, qui sont capables de
connaître son éternelle vérité, sans vouloir qu'elle soit connue de nous ?
J'avoue que nous ne pouvons ni connaître ni aimer infiniment l'infinie
perfection. Notre plus haute connaissance demeurera toujours infiniment imparfaite,
en comparaison de l'Être infiniment parfait. En un mot, quoique nous connaissions Dieu, nous ne pouvons jamais le comprendre ; mais nous le connaissons tellement, que nous disons tout ce qu'il n'est point, et que nous lui : attribuons les perfections qui lui conviennent, sans aucune crainte de nous tromper. Il n'y a aucun être dans la nature que nous confondions avec Dieu ; et nous savons le représenter avec son caractère d'infini, qui est unique et incommunicable. Il faut que nous le connaissions bien distinctement, puisque la clarté de son idée nous force à le préférer à nous-mêmes. Une idée qui va jusqu'à détrôner le moi doit être bien puissante sur l'homme aveugle et idolâtre de lui-même. Jamais idée ne fut si combattue ; jamais idée ne fut si victorieuse. Jugeons de sa force par l'aveu qu'elle arrache de nous contre nous-mêmes. Nous produisons le livre qui
porte toutes les marques de divinité, puisque c'est lui qui nous a appris à
connaître et à aimer souverainement le vrai Dieu. C'est dans ce livre que
Dieu parle si bien en Dieu, quand il dit : Je suis celui qui est. Nul
autre livre n'a peint Dieu d'une manière digne de lui. Les dieux d'Homère
sont l'opprobre et la dérision de la divinité. Le livre que nous avons en main,
après avoir montré Dieu tel qu'il est, nous enseigne le seul culte digne de
lui. Il ne s'agit point de l'apaiser par le sang des victimes ; il faut
l'aimer plus que soi ; il faut ne s'aimer plus que pour lui et de son amour ;
il faut se renoncer pour lui, et préférer sa volonté à la nôtre ; il faut que
son amour opère en nous toutes les vertus, et n'y souffre aucun vice. C'est
ce renversement total du cœur de l'homme, que l'homme n'aurait jamais pu
imaginer : il n'aurait jamais inventé une telle religion, qui ne lui laisse
pas même sa pensée et son vouloir, et qui le fait être tout à autrui. Lors
même qu'on lui propose cette religion avec la plus suprême autorité, son
esprit ne peut la concevoir, sa volonté se révolte, et tout son fond est
irrité. Il ne faut pas s'en étonner, puisqu'il s'agit de démontrer tout
l'homme, de dégrader le moi, de briser cette idole, de former un homme
nouveau, et de mettre Dieu en la place du moi, pour en faire la source et le
centre de tout notre amour. Dieu a mis les hommes ensemble
dans une société où ils doivent s'aimer et s'entre-secourir comme les enfants
d'une même famille qui ont un père commun. Chaque nation n'est qu'une branche
de cette famille nombreuse qui est répandue sur la face de toute la terre.
L'amour de ce père commun doit être sensible, manifeste, et inviolablement
régnant dans toute cette société de ses enfants bien-aimés. Chacun d'eux ne
doit jamais manquer de dire à ceux qui naissent de lui : Connaissez le
Seigneur qui est votre père. .... Ces enfants de Dieu ne sont sur la terre que pour connaître sa perfection et accomplir sa volonté ; que pour se communiquer les uns les autres cette science et cet amour céleste. .... Il faut donc qu'il y ait entre eux une société de culte de Dieu ; c'est ce qu'on nomme religion : c'est-à-dire que tous ces hommes doivent s'instruire, s'édifier, s'aimer tes uns les autres, pour aimer et servir le père commun. Le fond de cette religion ne consiste dans aucune cérémonie extérieure ; car elle consiste tout entière dans l'intelligence du vrai et dans l'amour du bien souverain. .... Mais il ne suffit pas de connaître Dieu ; il faut montrer qu'on le connaît, et faire en sorte qu'aucun de nos frères n'ait le malheur de l'ignorer, de l'oublier. Ces signes sensibles (du culte) ne sont que des marques par lesquelles les hommes sont convenus de s'édifier mutuellement, et de réveiller les uns les autres le souvenir de ce culte qui est au-dedans. De plus, les hommes, faibles et légers, ont souvent besoin de ces signes sensibles pour se rappeler eux-mêmes la présence de ce Dieu invisible qu'ils doivent aimer.... Voilà donc ce qu'on nomme religion, cérémonies sacrées, culte public du Dieu qui nous a créés. Le genre humain ne saurait reconnaître et aimer son Créateur sans montrer qu'il l'aime, sans vouloir le faire, sans exprimer cet amour avec une munificence proportionnée à celui qu'il aime, enfin sans s'exciter à l'amour par les signes de l'amour même. XIII. L'affaire du livre des Maximes traînait en longueur à Rome. Fénelon y envoya l'abbé de Chantérac, un de ses plus fervents disciples, pour le défendre contre les accusations de Paris. Pendant que la cour pontificale délibérait avec la lenteur prudente qui la caractérise, une controverse irritée se continuait en France entre Bossuet et Fénelon : Que peut-on penser de vos intentions ? disait Fénelon à Bossuet. Je suis ce cher disciple que vous portez dans vos entrailles ; vous allez me pleurant partout, et vous me déchirez en me pleurant. Que peut-on penser de ces larmes, qui ne servent qu'à donner plus d'autorité à vos accusations ?... Vous me pleurez, et vous intervertissez le sens et le texte de mes paroles !... Qui est-ce qui a commencé le
scandale ? Qui est-ce qui écrit avec un zèle amer ? Vous vous indignez de ce
que je ne garde pas le silence, quand vous intentez contre moi les
accusations les plus atroces ? Oui, je le dis avec douleur, répondait Bossuet, vous avez voulu raffiner sur la sainteté. Vous n'avez trouvé digne de vous que la beauté de Dieu par elle-même. Vous vous plaignez de la force de mes expressions, et il s'agit de dogmes nouveaux qu'on veut introduire dans l'Église !... Voilà pourtant ce que le monde appelle mon langage excessif, aigre, rigoureux, emporté ! Il faudrait qu'on laissât passer un dogme naissant doucement, sans éveiller l'horreur ? Le laisser glisser sous l'herbe, et relâcher par cette faiblesse les saintes rigueurs du langage théologique ?... Si j'ai fait autre chose que cela, qu'on me le montre ; si c'est cela que j'ai fait, Dieu sera mon protecteur contre les mollesses du monde et les vaines complaisances. Composez des lettres tant qu'il
vous plaira ; divertissez la cour, la ville ; faites admirer votre esprit et
votre éloquence ; ramenez le temps des Lettres provinciales. Je ne
veux plus de part au spectacle que vous donnez au public ! Nous sommes, vous et moi,
répliquait Fénelon, l'objet de la dérision des
impies ; nous faisons gémir les gens de bien ! Que tous les autres hommes
soient hommes, c'est ce qui ne doit pas surprendre ; mais que des ministres
de Jésus-Christ, ces anges des Églises, donnent au inonde profane et incrédule
de tels spectacles, c'est ce qui demande des larmes de sang ! Trop heureux,
si, au lieu de ces guerres de doctrines, nous avions toujours fait nos
catéchismes dans nos diocèses pour apprendre aux pauvres villageois à
connaître et à aimer notre Dieu ! XIV. Bossuet cependant avait envoyé, de son côté, à Rome un de ses neveux, l'abbé Bossuet, qui n'avait du génie de son onde que la domination et l'invective, pour solliciter les foudres de l'Église contre Fénelon. Ce jeune prêtre ne cessait de répandre à Rome, sur les doctrines et le caractère de Fénelon, les ombres de la calomnie. Pressez-vous, écrivait-il à son oncle ; qu'attendez-vous pour enlever à Fénelon le titre de précepteur du prince ? N'hésitez pas à envoyer ici tout ce qui peut faire connaître l'attachement de M. de Cambrai pour Mme Guyon et pour le P. Lacombe, et leur doctrine sur les mœurs ; cela est de la dernière conséquence !... J'ai été ravi du petit livre (odieuse calomnie imprimée en Hollande) ; il y est nommé et bien nommé : cela fera ici un effet terrible contre lui. Ce futur janséniste poussait le zèle de secte et de famille jusqu'à appeler dans sa correspondance Fénelon cette bête féroce ! Pendant ces négociations, la calomnie à Rome et à Paris, poursuivait par les mêmes moyens, la flétrissure des mœurs de Mme Guyon, afin de faire rejaillir cette flétrissure, non-seulement sur la doctrine, mais sur la vertu de l'archevêque de Cambrai. La tête du religieux Lacombe, enfermé dans les cachots du château de Lourdes, dans les Pyrénées, s'était affaiblie et égarée par la torture de l'isolement. Il avait fini par écrire à l'évêque de Tarbes des lettres dans lesquelles il semblait confesser des relations coupables avec Mme Guyon. Aussitôt qu'on eut connaissance à Paris de ces aveux du délire, on fit transférer le religieux au château de Vincennes. Là il écrivit, sous l'insinuation ou sous la contrainte, à Mme Guyon une lettre où il l'exhortait, comme sa complice, à confesser leurs égarements et à se repentir. Le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, lut cette lettre à Mme Guyon, et la somma d'avouer les désordres confessés par le religieux. Elle se souleva contre une telle horreur. Elle soupçonna que le religieux était tombé en démence, et qu'on abusait contre elle et contre Fénelon de la folie d'un prisonnier. Son désaveu et son indignation lui furent imputés à crime. Transférée pour subir une plus étroite captivité à la Bastille, elle persista dans son innocence et dans son supplice. On s'empressa néanmoins d'envoyer ces lettres infamantes à Rome, pour y ternir celui qu'on voulait perdre. Le cardinal de Noailles, Bossuet, Mme de Maintenon elle-même, sur la foi de ces rêves d'un insensé, ne doutèrent plus du crime du religieux et de Mme Guyon. Ces lettres, écrivait l'abbé Bossuet à son oncle, feront plus d'impression que vingt démonstrations théologiques. Voilà les arguments dont nous avons besoin ! La démence du religieux ne tarda pas à éclater. On le jeta dans une loge d'aliénés, où il mourut dans le délire. On fut forcé de reconnaître que Fénelon n'avait jamais vu ce religieux, et n'avait entretenu aucune correspondance avec lui. XV. On se vengea de cette déception de l'animosité par l'expulsion de tous les amis de Fénelon de la cour du duc de Bourgogne. Bossuet publia une relation du quiétisme, où toutes les colères et toutes les insinuations contre la doctrine prenaient la gravité de son accent contre les sectaires eux-mêmes. Fénelon voulait se taire, de peur d'entraîner dans sa ruine le duc de Beauvilliers, son dernier ami auprès de son élève ; les instances de son représentant à Rome le contraignirent à répondre. Sa réponse retourna et attendrit les cœurs. Le contraste entre la dureté de Bossuet et la patiente réserve de l'accusé éclata aux yeux de l'opinion. Pouvez-vous comparer, s'écrie Fénelon à la fin de sa réponse, votre procédé au mien ? Quand voue publiez mes lettres, c'est pour me diffamer ; quand je publie les vôtres, c'est pour montrer que vous êtes mon consécrateur. Vous violez le secret de mes lettres intimes, et c'est pour me perdre ! Je me sers des vôtres, mais après vous, et c'est, non pour vous accuser, mais pour justifier mon innocence opprimée ! Les lettres que vous produisez de moi sont ce qu'il y a de plus secret dans ma vie après ma confession, qui une fait, selon vous, le Montanus d'une nouvelle Priscille. Ah ! pourquoi mettez-vous votre gloire à me diffamer ? Qui ne sera étonné qu'on abuse du génie et de l'éloquence jusqu'à comparer une défense si innocente, si légitime, si nécessaire, à une si odieuse révélation des secrets d'un ami ? On vit avec douleur, dit le contemporain d'Aguesseau, que l'un des deux grands adversaires disait faux, et il est certain que Fénelon, du moins, sut se donner dans l'esprit du public l'avantage de la vraisemblance. Qui lui conteste de l'esprit ? s'écria Bossuet en lisant cette défense ; il en a jusqu'à faire peur ! Son malheur est de s'être chargé d'une cause où il en faut tant. Il montra bientôt, dans cette crise de sa vie, que son âme était supérieure encore à son esprit. |