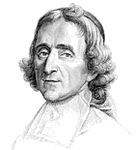FÉNELON
PREMIÈRE PARTIE.
|
I. De tous les hommes modernes, celui qui ressemble le plus à un sage de l'antiquité, c'est Fénelon. Il est beau de visage comme un de ces jeunes disciples du Christ, que le pinceau de Raphaël nous représente dans saint Jean endormi sur le sein de son divin maître. Il converse, en se promenant dans les jardins de Versailles, comme Platon dans les jardins d'Académus. Il tient une lyre, comme Homère ; il chante, comme un rhapsode, des fables sacrées du monde ancien. Il habite la demeure d'un grand roi qui rappelle Cyrus ou Sésostris ; il donne des leçons de sagesse, d'héroïsme, du culte divin, aux petits-fils de ce roi ; il vit, revêtu de la robe du sacerdoce, entre le vestibule du temple et le vestibule du palais ; il passe de la cour à l'autel, de la solitude au commerce d'esprit avec les politiques, les lettrés, les courtisans, les favorites du maitre de l'empire ; il est législateur aussi bien que poète, homme d'État autant que pontife. Il veut introduire la charité et l'égalité chrétienne dans le gouvernement ; il veut, comme dans l'antique Égypte, que la loi religieuse et la loi civile ne se contredisent pas dans la politique de l'empire. Il médite, dans l'antichambre du pouvoir absolu, les institutions de la liberté. Il entrevoit, du haut de sa piété sublime, des perfections et même des chimères de sociétés politiques, qui sont le germe et quelquefois le piège des philosophes législateurs pères de la révolution française. Ses larmes sur le sort des peuples et ses leçons à l'héritier du trône inquiétaient le maitre du trône ; il craint que l'esprit de la royauté ne soit corrompu dans son héritier par quelque excès de vertu qui jette l'empire dans les utopies, ces précipices de la bonne intention ; il le relègue à distance de son gouvernement. Le philosophe se retire en pleurant sur le sort du peuple et des princes. Il se réfugie en Dieu ; il donne les leçons et les exemples de cette vertu plus difficile aux hommes de génie qu'aux autres hommes, l'humilité. N'ayant pas pu améliorer l'empire, il améliore et il sanctifie en lui l'homme et le chrétien ; il meurt de langueur et de sainte tristesse dans l'obscurité. Ses œuvres et ses vertus se répandent et se multiplient après lui, de sa tombe, comme la liqueur d'un vase enfoui et brisé sous les pieds de ses profanateurs, et son nom devient le nom de toute poésie, de toute politique et de toute piété pendant deux siècles. Tel est Fénelon. Encore une fois, ne dirait-on pas d'un Pythagore ou d'un Platon de la France ? Nous allons retracer cette vie, une des plus belles des temps où nous sommes. II. Fénelon était né d'une famille noble et militaire du Périgord, vivant tantôt dans les camps, tantôt dans le fond de cette province, parmi le peuple des campagnes, et non encore corrompue par l'air des cours. Son père, Pons de Salignac, comte de Fénelon, retiré du service, avait eu plusieurs enfants d'un premier mariage avec Isabelle d'Esparbès. Veuf et déjà avancé en âge, il avait épousé Louise de Saint-Abre, fille d'une noble maison de la même province. Les enfants du premier lit s'affligèrent et murmurèrent de ce second mariage de leur père. Ils craignaient que les enfants qui en surviendraient ne réduisissent jusqu'à l'exiguïté la part de l'héritage paternel qui reviendrait à chacun d'eux, et ne fissent ainsi déchoir la famille de son rang dans le pays. Un oncle de cette jeune famille, Antoine de Fénelon, informé de ces murmures, écrivit à ses neveux pour leur reprocher leurs plaintes. Sachez, leur dit-il dans cette lettre, retrouvée dans les archives de la maison, sachez déférer avec confiance et respect aux désirs de votre père : la Providence a ses vues secrètes qu'il n'est pas donné aux familles de percer. Souvent l'illustration et la fortune des maisons viennent des choses qui semblent le plus contraires à nos courtes sagesses. On eût dit que cet oncle, doué du don des présages, entrevoyait de loin, dans l'enfant qui devait naître, l'éternel honneur de son nom. Peu de temps après naquit de ce mariage François de Fénelon, archevêque de Cambrai. Fils d'un vieillard et d'une jeune épouse, il reçut de la nature la maturité de l'un et les grâces de l'autre. Cultivé dans la maison paternelle, comme un fruit tardif et délicat, il y fut élevé jusqu'à l'âge de douze ans par cette raison de père et cette tendresse de mère qui se retrouvèrent tout entiers plus tard dans son âme, dans son caractère et. dans ses œuvres. La littérature sacrée et la littérature grecque et latine furent, sous un précepteur domestique, les premiers aliments de son imagination. Son intelligence et son cœur, modelés dès son berceau sur ces modèles classiques du bon et du beau dans l'antiquité, en prenaient naturellement l'esprit et les formes. On peut dire que l'enfant était né en France au XVIIe siècle, mais que son génie était né à Athènes, au siècle de Périclès. L'université de Cahors acheva son éducation. Le bruit de ses heureuses dispositions franchit les limites de cette école de sa province, et parvint jusqu'à son oncle, Antoine de Fénelon, le même qui avait si bien auguré de lui avant sa naissance. Cet oncle, parvenu aux premiers grades de l'armée, appela son neveu auprès de lui à Paris. On destinait l'enfant à l'Église, comme un fardeau de famille dont on se déchargeait alors sur le sacerdoce. On lui fit poursuivre ses études philosophiques et théologiques, plus fortes dans les hautes écoles de Paris. Son génie, naturel, facile et précoce, y éclata comme il avait éclaté à Cahors, mais de plus haut, et ses succès ainsi que ses grâces lui attachèrent de plus illustres amis. Cette gloire anticipée et cette faveur générale qui entouraient le jeune Fénelon firent craindre quelque enivrement du monde au vieil oncle son tuteur ; il se hâta de soustraire son neveu aux séductions de l'amitié et de l'admiration en le jetant dans le séminaire de Saint-Sulpice, pour l'attacher au sacerdoce par des vœux. Pendant que Fénelon y poursuivait ses études en' leur imprimant une direction moins profane, l'oncle, qui voulait donner lui-même à son propre fils les premières leçons de la guerre, le conduisait au siège de Candie, contre les Turcs. Ce fils unique, frappé, dès les premiers assauts, d'un boulet, y périt dans les bras de son père. Le vieux guerrier revint en rapportant le corps de son enfant à Paris. Il ne lui restait qu'une fille ; il la donna en mariage au marquis de Montmorency-Laval, de l'illustre maison de ce nom. La perte de son fils unique l'attacha davantage à son neveu. Vertueux et pieux lui-même, il s'étudia à ne faire des honneurs ecclésiastiques, pour le jeune néophyte, que le prix de la piété et de la vertu. L'ardente imagination du lévite devait naturellement le
porter à l'héroïsme de sa profession. Il forma la résolution de passer les
mers, de s'enrôler parmi les missionnaires qui allaient convertir le Canada
au christianisme, et de se consacrer, comme les premiers apôtres de
l'Évangile, à la poursuite des aines parmi les idolâtres, dans les forêts du
nouveau monde. L'image de ces Thébaïdes modernes l'attirait par ses
ressemblances avec les austérités et les apostolats antiques. Sa belle
imagination devait avoir, dès sa jeunesse et pendant toute sa vie, sa part
dans ses rêves et même dans sa vertu. Ainsi celui qui était destiné à
civiliser des cours et à élever des rois n'aspirait qu'à civiliser des
sauvages dans la solitude du désert. Le directeur du séminaire de
Saint-Sulpice, homme sage et prudent, avertit ce M. Antoine de Fénelon de la résolution
de son élève. L'oncle gourmanda tendrement son neveu sur une fausse vocation
qui éteindrait, dans les forêts de l'Amérique, un flambeau allumé par Dieu
pour éclairer un grand siècle. Fénelon résista ; sa famille persista. On
l'envoya chez un autre de ses oncles, évêque à Sarlat, qui lui défendit, au
nom du ciel, de poursuivre ce dessein téméraire, et qui le fit rentrer au
séminaire de Saint-Sulpice pour y consommer son sacrifice et pour y revêtir
le caractère sacerdotal. Le jeune homme obéit, devint prêtre, resta à Paris,
et fut employé, pendant trois ans, à expliquer les mystères aux enfants du
peuple, les jours de fêtes et les dimanches, dans la sacristie de l'église de
Saint-Sulpice. L'évêque de Sarlat, son oncle, l'appela de ces humbles
fonctions dans son diocèse, pour le faire nommer représentant du clergé de la
province ' à l'assemblée générale du clergé. La jeunesse de Fénelon fit
échouer l'ambition de son oncle : un autre ecclésiastique de haute naissance
obtint les suffrages. Fénelon reprit à Sarlat sa passion d'apostolat lointain
et poétique pour la conversion. des peuples. Je
médite, écrit-il alors, un grand voyage. La Grèce
s'ouvre devant mes pas ; l'islamisme recule ; le Péloponnèse redevient libre
; l'Église de Corinthe refleurit, la voix de l'apôtre s'y fait encore
entendre. Je me vois transporté dans ces belles contrées et parmi ces ruines
sacrées pour y recueillir, avec les plus curieux monuments, l'esprit même de
l'antiquité. Je visite cet Aréopage où saint Paul annonça aux sages du monde
le Dieu inconnu ; mais le profane vient après le sacré, et je ne dédaigne pas
de descendre au Pirée, où Socrate fit le plan de sa république. Je ne
t'oublierai pas, ô île consacrée par les visions du disciple bien-aimé !
Heureuse Pathmos ! j'irai baiser ta terre sur les pas de saint Jean, et je
croirai, comme lui, voir les cieux ouverts ! Je vois déjà le schisme qui
tombe, l'Orient et l'Occident qui se réunissent, et l'Asie qui voit renaître
le jour, après une si longue nuit ! Cette lettre écrite à Bossuet, jeune aussi alors, son ami à ce commencement de la vie, son antagoniste à la fin, ne fut qu'une confidence sans réalisation. L'évêque de Sarlat, qui avait consenti par lassitude, inclina l'esprit de son neveu d'un autre côté par des sollicitations indirectes. Fénelon, rappelé à Paris par l'archevêque, M. de Harlay, fut nominé, malgré sa jeunesse, supérieur des nouvelles converties au catholicisme, dont les persécutions de Louis XIV avaient multiplié le nombre à Paris. Il n'avait que vingt-sept ans. La sévérité de ses mœurs, l'ardeur de sa foi, la splendeur de sa parole, le sens droit et mûr de son esprit, suppléaient déjà en lui l'autorité de l'âge. Logé dans l'abbaye de Saint-Germain des Prés, chez son oncle, le marquis Antoine de Fénelon, qui s'y était retiré à l'ombre du cloître ; dirigé par l'expérience du supérieur de Saint-Sulpice, M. Tronson ; encouragé par Bossuet, son émule et son ami ; vivant dans la société austère du duc de Beauvilliers et des familiers les plus rigides de Louis XIV ; recherché par l'archevêque de Paris, M. de Harlay, qui voyait dans ce jeune prêtre un ornement de son diocèse, Fénelon gouverna cet ordre de femmes de son administration et de sa parole avec une sagesse prématurée. Il pouvait aspirer, sous les auspices de M. de Harlay, aux plus hautes et aux plus soudaines dignités de l'Église ; il leur préféra J'amitié, stérile alors, de Bossuet, évêque de Meaux, la plus haute science et la plus haute éloquence de l'Église. Il se fit le disciple de Bossuet, au lieu de se faire le favori de M. de Harlay, renonçant à la faveur pour s'attacher à la gloire. M. de Harlay, jaloux de Bossuet, ressentit cette négligence du jeune prêtre. Monsieur l'abbé, lui dit-il un jour, en se plaignant de son peu d'empressement à lui complaire, vous voulez être oublié, vous le serez ! Il fut oublié, en effet, dans la distribution des faveurs de l'Église. Son oncle, l'évêque de Sarlat, fut obligé, pour soutenir son neveu à Paris, de lui résigner le petit prieuré de Carénac, dépendant de son évêché. Ce revenu de trois mille francs, suffisant à peine aux nécessités d'une vie ascétique, fut la seule fortune de Fénelon jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il passa quelques semaines dans ce prieuré champêtre ; il distribua aux indigents de la contrée tout ce qu'il put retrancher de ce modique revenu à ses besoins les plus restreints. Il y composa des vers où le sentiment de la solitude qui porte à Dieu se mêle au sentiment de Dieu qui remplit la solitude. Comme la plupart des grands esprits de tous les siècles, Solon, César, Cicéron, Montesquieu, J. J. Rousseau, Chateaubriand, il commença par chanter avant de penser. La musique des vers précède, dans l'homme, l'éloquence, parce que l'émotion de l'âme précède en lui la vigueur du raisonnement. Les vers de Fénelon avaient la mollesse et la grâce de la jeunesse ; ils n'avaient pas la virilité de l'âme véritablement poétique, qui surmonte du premier coup les difficultés du rythme, et qui crée du même jet le sentiment, le mot et le vers. Il le sentit lui-même ; il laissa, après quelques essais, les vers à Racine, ce Virgile français ; il se résigna à la prose, instrument moins laborieux, moins parfait, mais plus complaisant de la pensée, et il ne cessa pas d'être le plus poétique génie de son temps. III. Il reprit et poursuivit pendant dix ans, à Paris, la direction de l'établissement qui lui était confié, mûrissant dans l'ombre un talent et une vertu qui devaient éclater bientôt. Il s'exerçait à parler et à écrire sur des choses saintes. Il composait, pour la duchesse de Beauvilliers, mère d'une jeune et nombreuse famille, un traité de l'éducation des filles. Ce livre, bien supérieur à l'Émile de J. J. Rousseau, n'est point l'utopie, mais la pratique raisonnée d'une éducation domestique pour l'époque où Fénelon écrivait. On y sent le tact parfait d'un homme qui n'écrit pas pour être lu, mais pour profiter aux familles. Il entremêlait à ces travaux et à ces devoirs de sa profession des correspondances intimes pleines d'onction sainte et d'enjouement chaste avec ses amis. Il en avait déjà un grand nombre ; le plus cher et le plus assidu de tous était le jeune abbé de Langeron, digne d'avoir associé sa mémoire à celle de Fénelon. Bossuet était pour lui plus qu'un ami, c'était un maitre, mais un maitre chéri autant qu'admiré. Ce grand homme, alors dans toute sa force et dans toute son autorité, qui croissaient avec ses années, possédait nom loin de Paris, à Germigny, une maison de campagne, délassement et délices de ses travaux. Fénelon, l'abbé Fleury, l'abbé Langeron, l'élite de l'Église et de la littérature sacrée, suivaient Bossuet dans cette retraite ; ils partageaient ses loisirs sévères ; ils recevaient les confidences de ses sermons, de ses oraisons funèbres, de ses traités de polémique ; ils lui soumettaient leurs essais ; ils s'enrichissaient de ses entretiens familiers, dans lesquels cet homme de premier mouvement était plus sublime encore que dans sa chaire, parce qu'il était plus naturel. Une telle société d'intelligences mûrissait les pensées, agrandissait les vues, polissait le style, cimentait les cœurs. Germigny était un Tibur français, de génie, de philosophie et de sainteté, supérieur par les hommes et par les choses au Tibur de Rome. Ce furent les plus heureuses années de Fénelon ; il jouissait de ses amis et de lui-même. Son éclat, renfermé dans cette retraite, ne lui attirait encore ni la renommée ni l'envie du monde. Il avait placé sa gloire dans la gloire de Bossuet, son ambition dans l'amitié de ces hommes supérieurs. Son propre génie lui était d'autant plus doux qu'il était encore une confidence. Il était loin de soupçonner que les foudres sortiraient bientôt pour lui de ce cénacle où il ne respirait que la paix, la modestie et le bonheur. IV. Les guerres de religion étaient à peine amorties en France. La révocation de l'édit de Nantes venait de frapper la liberté de conscience en rompant le traité de paix entre les religions, promulgué par Henri IV. Trois cent mille familles étaient expulsées, dépouillées, privées de leurs enfants ; des milliers d'autres familles dans les provinces protestantes étaient contraintes, moitié par la persuasion commandée, moitié par la violence imposée, à désavouer la religion de leurs pères et à professer la religion du roi. Bossuet approuvait ces croisades intérieures contre la Réforme. Le but légitimait à ses yeux et sanctifiait même les moyens. Des missionnaires, appuyés de troupes et de geôliers, parcouraient les provinces, imposant la foi, convertissant les faibles, fortifiant les douteux, sévissant contre les obstinés. Lés parties du royaume où le protestantisme avait laissé le plus de racines n'étaient qu'un vaste champ de bataille après la victoire, où des commissions ecclésiastiques ambulantes, armées à la fois de la parole et du glaive, ramenaient tout par le zèle, par la séduction ou par la terreur à l'unité de la foi. C'était l'œuvre que Louis XIV vieilli et fanatisé de lui-même s'était imposée pour s'assurer le ciel en offrant à l'Église une immense dépouille d'âmes contraintes ou persuadées par son autorité. Bossuet était le ministre intime de cet empire absolu sur les consciences. Réunissant en lui le double caractère de prêtre controversiste et d'homme d'État, il servait avec l'ardeur de son caractère et de sa foi l'Église par le roi, le roi par l'Église. Son ambition élevée, qu'il se dissimulait à lui-même sous la sainteté du zèle, lui faisait tenir une balance égale entre les exigences de la cour de Rome et l'orgueil de Louis XIV. Ménageant habilement la faveur alternative des deux puissances qui se servaient en se redoutant, il conquérait par la main du roi la France protestante au catholicisme, mais il revendiquait pour le roi, dans ce catholicisme français, des attributions temporelles et des libertés voisines de la révolte et qui touchaient au schisme. Serviteur ardent mais superbe, Bossuet s'imposait ainsi à Rome par ses services à l'Église, à Versailles par son ascendant à Rome, au monde par la sublimité de son génie. Sans avoir le titre, il avait l'omnipotence de patriarche en France. La cour le craignait et le vénérait. Mme de Maintenon, sans satisfaire l'ambition de Bossuet, qui aspirait à l'archevêché de Paris et au cardinalat, mais qui, du haut de cette position, serait devenu trop absolu et peut-être indocile, ménageait en lui l'oracle de l'Église et le conseil de conscience du roi. Bien qu'elle eût été arrachée elle-même de son berceau par la persécution à la foi réformée de sa famille, elle trempait dans cette persécution de toute son influence sur l'esprit de Louis XIV. L'autorité de Dieu et l'autorité du roi, confondues dans un seul et même pouvoir, lui paraissaient, ainsi qu'à la cour, sanctifier toutes les rigueurs de cette conversion en masse. Une persécution, dont deux siècles n'ont pu effacer l'effroi dans la mémoire de ces provinces, consternait une partie du Languedoc et le Vivarais. L'excès des sévices criait vengeance. Ce cri des victimes commençait à importuner la cour ; on voulait l'apaiser, non par des libertés rendues à la conscience des peuples, mais par des ministres plus insinuants et plus humains. Bossuet jeta les yeux sur Fénelon. Nul homme n'était plus propre à relever des âmes abattues sous la crainte, à faire paraître léger et volontaire le joug imposé, à porter pour ainsi dire l'amnistie des consciences dans les provinces où la persécution et la prédication s'étaient jusque-là décréditées l'une par l'autre. Fénelon, présenté pour la première fois par Bossuet à Louis XIV, ne demanda pour toute grâce au roi que de désarmer la religion de toute force coercitive, de laisser respirer les protestants de la terreur qui glaçait les âmes, d'éloigner les troupes des provinces qu'il allait visiter, et de laisser la parole, la charité et la grâce opérer seules sur les convictions qu'il voulait éclairer, et non dompter. Louis XIV, qui touchait au but, ne disputa pas sur les moyens. Il fut charmé de l'extérieur, de la modestie, de l'éloquence naturelle du jeune prêtre ; il lui confia les missions du Poitou. Fénelon s'adjoignit pour cette œuvre ses amis l'abbé de Langeron et l'abbé Fleury, animés de son propre esprit. Sa présence, sa mansuétude, sa prédication dans ces contrées, pacifièrent les esprits. Il obtint des abjurations libres. Il ne trompa ni le roi ni Bossuet sur la sincérité des abjurations contraintes, qui avaient, avant lui, imposé une foi politique à ces provinces. Il revendiqua avec courage les droits et la dignité des convictions, dans sa correspondance avec la cour. Accusé, par les agents de la persécution, d'une indulgence qui laissait couver la liberté des croyances sous ses pas. Si l'on veut, écrivit-il à Bossuet, leur faire abjurer le christianisme et leur faire adopter le Coran, il n'y a qu'à leur renvoyer les dragons. Un tel langage, tenu à Bossuet lui-même par un jeune ministre du clergé qui aspirait aux dignités de son ordre, devançait de deux siècles son temps. Continuez à faire venir des blés, écrit-il ailleurs aux ministres du roi ; c'est la controverse la plus persuasive pour eux.... Les peuples ne se gagnent que par la parole.... Il faut leur faire trouver autant de douceurs à rester dans le royaume que de périls à en sortir. Cependant on retrouve avec douleur, dans d'autres lettres de Fénelon à Bossuet sur ces abjurations, quelques traces de timides concessions au zèle impitoyable de ce pontife, et quelques complaisances pour la réduction des peuples à Dieu par l'autorité du prince. Nul homme n'échappe complètement aux idées dominantes, surtout quand cet homme est enrôlé dans un des corps qui entraînent ceux qui leur appartiennent dans les opinions ou dans les passions d'une époque. V. A son retour du Poitou, Fénelon fut désigné au roi par le duc de Beauvilliers et par Mme de Maintenon pour précepteur du duc de Bourgogne, son petit-fils. Le duc de Beauvilliers était gouverneur du jeune prince héritier du trône. Ce choix honorait le gouverneur, Mme de Maintenon et le roi. Fénelon semblait avoir été prédestiné par la nature à ces fonctions : son âme était royale, il n'avait qu'à la faire passer par les leçons dans l'enfant destiné au trône pour en faire un roi accompli, pasteur des peuples, dans l'antique acception de ce titre. Il n'avait point brigué cette élévation. La fortune l'avait découvert d'elle-même dans le demi-jour où il s'enfermait. Ses amis se réjouirent pour lui, s'affligèrent pour eux. La cour allait leur dérober son intimité. Bossuet, en apprenant cette nomination, sur laquelle il avait été certainement consulté, répandit sa joie dans une lettre de quelques lignes à Mme de Montmorency-Laval, cousine et amie de Fénelon. Hier, madame, écrit-il, j'étais tout occupé du bonheur de l'Église et de l'État.
Aujourd'hui, j'ai le loisir de réfléchir avec plus d'attention à votre
bonheur, il m'en a causé un très-sensible. Votre père (le marquis Antoine de Fénelon), un ami de si grande vertu et si cordial, m'est revenu
dans l'esprit. Je me suis représenté comme il serait à cette occasion, et à
un si grand éclat d'un mérite qui se cachait avec tant de soin. Enfin,
madame, nous ne perdons pas notre ami, vous pourrez en jouir ; et moi,
quoique éloigné de Paris par mes fonctions, je m'échapperai quelquefois pour
aller l'embrasser. On sent dans ce billet tout un homme. La joie sans envie d'un maitre qui se sent grandir dans son disciple ; le souvenir d'une antique amitié avec le chef de la race qui remonte au cœur, et qui voudrait rouvrir le tombeau pour féliciter les morts ; enfin la tendresse virile du père qui aura besoin dans sa vieillesse de. revoir quelquefois son fils. Bossuet avait le cœur quelquefois endurci par la polémique et enflé par l'autorité du pontife ; mais il avait le cœur pathétique. Sans cette sensibilité, il aurait été rhéteur ; comment aurait-il été éloquent ? D'où lui seraient venus ces accents qui fendent l'âme et qui arrachent des cris et des pleurs ? L'autre ami de Fénelon, l'abbé Tronson, le directeur de Saint-Sulpice et le confident de son âme, lui écrivit une lettre de félicitation inquiète et tendre, où la crainte se mêlait à la joie : On vous ouvre la porte des grandeurs terrestres, lui dit ce saint homme, mais vous devez craindre qu'on ne vous la ferme aux solides grandeurs du ciel.... Vos amis vous rassureront, sans doute, sur ce que vous n'avez pas recherché votre emploi, et c'est assurément un grand sujet de consolation ; mais il ne faut pas trop vous y appuyer. On a souvent plus de part à son élévation qu'on ne pense. A son insu, on ne manque guère de lever les obstacles ; on ne sollicite pas les personnes qui peuvent nous servir, mais on n'est pas fâché de se montrer à elles par les beaux côtés ; et c'est justement à ces petites découvertes humaines, par lesquelles on trahit son mérite, qu'on peut attribuer les commencements de son élévation. Ainsi nul ne peut être certain de ne pas s'être appelé lui-même. On voit que le scrupuleux directeur de la conscience connaissait les secrets de l'âme de son disciple, et le prémunissait contre cette ambition par le don et la volonté de plaire qui était à la fois le charme et le danger de Fénelon. L'amitié eut la première pensée de Fénelon après son élévation. Il fit nommer l'abbé Fleury sous-précepteur et l'abbé de Langeron lecteur du jeune prince. Un autre de ses amis, qui était en même temps son neveu, l'abbé de Beaumont, fut associé comme sous-précepteur à l'abbé Fleury. Fénelon renferma ainsi tout son cœur dans son emploi. Il entoura son élève d'une même âme sous des noms divers., Le duc de Beauvilliers, qu'il avait séduit le premier, et de qui tout dépendait, lui livra l'éducation entière, et ne se réserva que la dignité de ses fonctions. Elles étaient aussi délicates par les ménagements qu'exigeait l'état de la cour qu'importantes par la destinée de l'enfant, dans lequel on confiait à Fénelon la destinée future d'un peuple. Il est difficile aujourd'hui, à la distance où nous sommes, et après tant de révolutions de trônes et de mœurs qui ont agrandi pour nous la distance, de bien comprendre la cour de Louis XIV. C'était une espèce d'Olympe monarchique et chrétien, dont Louis XIV était le Jupiter ; des dieux et des déesses inférieurs, divinisés par l'adulation des grands et par la superstition des peuples, s'y mouvaient sous lui. Leurs vertus étaient exaltées, leurs vices même étalés avec une audace de supériorité qui semblait mettre entre le peuple et le trône la différence d'une morale des dieux à la morale des hommes. Louis XIV s'était fait accepter comme une exception à tout, même à l'humanité. On ne jugeait pas le roi comme on jugeait le reste des créatures : il semblait avoir sa conscience, sa vertu, son Dieu, à part des autres mortels. Ce fut un moment unique dans l'histoire de la grandeur des cours, et de l'enivrement des courtisans, et de la prosternation des peuples. Cette majesté du trône venait moins encore de celui qui régnait que des événements qui avaient amené son règne. La royauté complète et absolue était mûre pour cette époque ; Louis XIV en cueillait le fruit. Deux grands ministres, Richelieu et Mazarin, venaient, l'un, de préparer la tyrannie en abattant la noblesse libre ; l'autre, de préparer la paix et l'obéissance en adoucissant le joug sur le peuple esclave, en captant les parlements, en amnistiant les factions, en séduisant la cour, en corrompant les princes, et en remettant, à force de machiavélisme doux, la France vaincue, achetée, pardonnée et lasse, entre les mains d'un enfant. L'énergique et dure volonté du Gaulois dans Richelieu, le génie grec et italien dans Mazarin, semblaient s'être ainsi succédé et concertés pour façonner le royaume à la servitude et à la paix. Tout le règne de Louis XIV est dans ces deux hommes, l'un la terreur, l'autre l'attrait de la royauté. On a apprécié et peut-être flatté Richelieu ; on n'a pas encore mis Mazarin à sa hauteur dans l'histoire, Machiavel sans crime de la monarchie française. Louis XIV, après sa mort, n'eut rien à conquérir en autorité et en respect, il n'eut qu'à régner. VI. Grâce à ces deux précurseurs, il n'eut pas besoin d'être un grand homme pour être un grand roi. Il lui suffisait d'avoir un cœur élevé et un esprit juste, il eut l'un et l'autre. Ce qui éclairait son esprit, ce n'était pas le génie, c'était le bon sens. Ce qui élevait son cœur, ce n'était pas la grandeur d'âme, c'était l'orgueil. Mazarin lui avait appris à mépriser les hommes et à croire au caractère divin de son pouvoir : il y croyait ; c'était sa force. Son idolâtrie envers lui-même servait d'exemple à l'idolâtrie qu'il commandait et qu'il respirait dans sa cour. Il avait appris, de plus, de ce premier ministre, le plus pénétrant des hommes d'État, à bien discerner la valeur des hommes. Bien régner, pour Louis XIV, ce n'était qu'être bien servi. Il se trompait rarement sur le mérite de ses serviteurs. Son royaume n'était que sa maison, ses ministres n'étaient que ses domestiques, l'État que sa famille, son gouvernement n'était que son caractère. Ce caractère de Louis XIV, orné seulement à l'extérieur d'un reste de chevalerie des Valois, qui décorait en lui l'égoïsme, et dans sa cour la servitude, n'avait de grand que la personnalité. Il pensait à lui, il était né maitre, il commandait bien, il était poli dans la forme, sûr dans les relations politiques, fidèle à ses serviteurs, sensible au mérite, aimant à absorber dans ce qu'il appelait sa gloire les grandes renommées, les grandes vertus et les grands talents. Les longs troubles apaisés, les guerres civiles éteintes, la paix renaissante, la langue formée, la nature plus féconde après les orages, faisaient de la date de son règne la date du génie de la France dans les lettres, dans les arts ; il profitait, en homme heureux et digne de son bonheur, de ce bénéfice des temps, il l'accroissait en l'encourageant par ses munificences et par sa familiarité, il accueillait bien tout homme de génie comme un sujet de plus. Quant à la religion, il en avait deux : une toute politique, qui consistait à remplir littéralement, et au besoin par la violence, son rôle de roi très-chrétien, fils et licteur couronné de l'Église. L'autre, toute privée, héritée de sa mère, imitée de l'Espagne, scrupuleuse de conscience, littérale de pratiques, superstitieuse de foi. Cette piété-là n'avait eu, jusqu'à son âge mûr, que peu d'influence sur sa vie. Elle n'avait ni véritable élévation, ni indépendance d'âme, ni grande vue de Dieu. C'était plutôt la piété d'un esclave qui tremble que celle d'un roi qui prie. Il l'accommodait à toutes ses passions, il la profanait par toutes ses faiblesses. Porté à l'amour par ses sens plus que par son âme, il avait multiplié les scandales. Ses attachements cependant n'avaient jamais été des libertinages ; une certaine sincérité d'entraînement et une certaine constance d'attachement les relevaient un peu. Ce n'était pas le vice, c'était la passion. Mais cette passion, tout orientale, était celle d'un sultan pour sa favorite plutôt que celle d'un amant pour son idole. Il l'encensait, il l'adorait, il la faisait adorer à sa cour, à son armée, à son peuple, puis il la 'brisait pour en élever une autre. Il avait promené ainsi sa femme entourée de ses maîtresses, ne se croyant jamais assez adoré si l'on n'adorait pas ses faiblesses. La maturité venue, et les remords prévalant enfin sur les passions, il avait cherché à concilier son besoin de favorite avec sa dévotion. Une femme créée exprès pour ce rôle par la nature et par l'art s'était offerte à ses yeux. Il l'avait attendue et cultivée longtemps sans pouvoir la conquérir autrement qu'en l'épousant. Cette femme était Mme de Maintenon. Mme de Maintenon régnait depuis plusieurs années au moment où Fénelon fut appelé à la cour. Sa destinée était moins un jeu du hasard qu'un chef-d'œuvre du calcul. A ce titre, les femmes vertueuses mais insinuantes, qui se font de la considération même un moyen d'intrigue, en ont fait la sainte et la patronne de l'ambition. Les hommes n'ont pas de sympathie pour elle, car la passion ne fut pour rien dans sa capitulation avec le roi ; et si elle négocia si longtemps, ce fut pour se rendre à plus haut prix aux désirs de celui qu'elle n'aima jamais. Née d'une race persécutée et dépouillée pour son attachement au protestantisme ; ramenée enfant des colonies par une parente sans asile, s'embellissant avec les années de tous les charmes qui exposent une jeune fille à des séductions précoces, inspirant à ceux qui la voyaient une admiration redoublée par le malheur, élevée dans des relations de société équivoques, vivant dans une sorte de familiarité domestique avec la plus célèbre courtisane du temps, Ninon de Lenclos, épousée ensuite par un vieillard infirme et burlesque, le poète Scarron, sa beauté chaste et mélancolique, en contraste avec l'âge et l'humeur de son mari, son indigence noblement soufferte, sa conduite mesurée et irréprochable au milieu de la licence et de la séduction qui l'entouraient, les grâces sévères de son esprit, cultivées dans l'ombre, une piété enjouée mais sincère, servant à la fois de sauvegarde à sa jeunesse et de base à sa considération, avaient attiré sur elle l'attention du monde qui venait se délasser de la cour chez le Diogène du temps. Bientôt veuve de Scarron, elle avait dérobé son veuvage aux mauvaises interprétations du monde dans un couvent. Obligée de mendier la modique pension de survivance de son mari, elle s'était rapprochée de la cour et y avait formé des liaisons. Une occasion s'était offerte. On cherchait une confidente sûre et dévouée à qui l'on pût confier le duc du Maine, enfant valétudinaire de Mme de Montespan. La jeune veuve, présentée à cette favorite, l'avait fascinée. Elle avait reçu du roi et de sa maîtresse le jeune prince, et l'avait conduit aux eaux des Pyrénées pour rétablir sa santé et pour commencer son éducation. La correspondance obligée qu'elle entretenait de là avec Mme de Montespan et le roi avait dissipé une certaine prévention de Louis XIV contre elle, puis lui avait conquis sa confiance et son intérêt. Nulle femme de son temps, et peut-être d'aucun temps, n'écrivit d'un style plus simple, plus flexible et plus viril à la fois- Sa plume avait la solidité de sa raison et l'habileté de son âme. Le bon sens, la clarté et la force étaient ses muses. C'étaient les qualités qui convenaient le plus à l'esprit sévère, mais précis, de Louis XIV ; c'étaient celles aussi que la favorite craignait le moins dans une confidente. La supériorité de son imagination, l'éclair, la saillie, la passion, l'éblouissement continu de sa conversation, l'assuraient contre toute rivalité. Elle avait le génie de la séduction, elle ne redoutait rien d'une simple estime. VII. Ce fut à l'abri de cette modestie d'esprit et de cette humilité du rôle de confidente, que la veuve s'insinua de plus en plus dans l'amitié de la favorite, dans la familiarité du roi. Ce rôle, dans une liaison qui scandalisait l'Europe, demandait' à la vertu de la confidente des accommodements suspects avec le rigorisme de sa piété ; mais nous avons déjà dit que le roi faisait alors exception à la morale. La nouvelle amie de Mme de Montespan et du roi satisfaisait à ses scrupules en blâmant avec douceur, en paroles, un commerce coupable qu'elle acceptait en action. Sa complaisance n'allait jamais jusqu'à l'approbation ou à la complicité, et dans les entretiens que sa charge et sa résidence chez la favorite lui donnaient occasion d'avoir sans cesse avec le roi, elle lui reprochait ses faiblesses et l'encourageait au repentir. Sa beauté mûrie, mais conservée dans tout son attrait par la froideur de son âme, convertissait le roi au moins autant que ses sévérités de langage. Il se demandait, libre alors par la mort de la reine, si un attachement calme, consacré et vertueux avec une femme à la fois si séduisante et si solide ne serait pas un bonheur de l'âme et des sens, supérieur en félicité comme en vertu aux voluptés amères de ses désordres. L'attrait s'accroissait à chaque entretien. La jalousie de Mme de Montespan le redoublait par ses reproches impatiemment supportés. Elle commençait à accuser d'ingratitude et de trahison domestique une amie qu'elle avait tirée, disait-elle, de l'abjection, et qui ne s'était introduite dans son intimité que pour suborner le cœur du roi par des séductions pieuses, et pour prendre dans la couche du monarque la place d'Esther, d'où elle la précipitait dans l'opprobre. Ces désespoirs de l'amour rassasié et ces reproches d'ingratitude étaient trop motivés. Avant peu d'années, Mme de Montespan disgraciée tramait ses regrets dans l'exil, et la veuve de Scarron était reine. Cependant la dignité du trône et l'orgueil du roi, supérieur encore à sa dévotion, l'avaient empêché de proclamer son asservissement à cette nouvelle épouse ; il s'était contenté de satisfaire à l'Église, en faisant bénir la nuit son mariage par l'archevêque de Paris, en présence de quelques courtisans affidés. L'union était secrète, la cohabitation était publique. Mme de Maintenon occupait aux yeux des peuples le rôle équivoque de favorite vénérée du roi. La famille royale, la cour, les ministres, l'Église, le roi lui-même, lui étaient asservis. Favorite, épouse, arbitre de l'Église, oracle du conseil, elle était à la fois le Richelieu et le Mazarin de la vieillesse du roi. Son habile humilité assurait son empire en enlevant au roi toute jalousie d'autorité ; il ne redoutait point dans sa femme une rivale. Elle se faisait arracher par lui ses conseils, qui devenaient bientôt la volonté de Louis XIV. C'était une royauté qui avait épousé son premier ministre. La dévotion, qui, en succédant à l'amour, avait été le nœud de cette union, la perpétuait. La cour, inspirée par une femme pieuse, gouvernée par un roi inquiet de son salut, dominée par des évêques sévères comme Bossuet, gourmandée par des confesseurs tantôt terribles comme Letellier, tantôt doux comme Lachaise, travaillée par des factions contraires, où l'ambition se mêlait au mysticisme, ressemblait à un synode plus qu'à un gouvernement. Versailles rappelait parfois alors ce palais des Blakernes, à Byzance, sous les empereurs grecs du Bas-Empire, où les querelles métaphysiques déchiraient la cour et le peuple, et laissaient approcher de Constantinople la décadence et les légions des conquérants. Le roi avait un fils, Monseigneur, prince élevé par Bossuet et par Montausier, doué d'intelligence et de bravoure par la nature, mais que la jalousie orientale du roi avait écarté des camps aussitôt qu'il y avait montré de l'aptitude ; il vivait relégué à Meudon avec une favorite, et presque indigent. Ce fils avait fini par accepter cette situation subalterne et obscure, pour ne pas porter à Louis XIV l'ombrage impardonnable d'un héritier du trône. Le roi tremblait moins devant la mort que devant l'idée de ne plus régner un jour. Le duc de Bourgogne, que Fénelon était appelé à élever, était le fils de Monseigneur, petit-fils ainsi du roi. Mais le roi, selon l'habitude des aïeux, préférait ce petit-fils à son propre fils, parce que ses années n'étaient point encore une menace, et qu'il y avait plus de distance entre son propre règne et le règne éloigné d'un enfant. Les courtisans se groupaient autour de ces différentes branches de la famille royale, mais le plus grand nombre autour du roi, et tous autour de Mme de Maintenon. Telle était la cour de Louis XIV à l'avènement de Fénelon aux fonctions de précepteur du duc de Bourgogne. VIII. Cet enfant, par son caractère, donnait autant à redouter
qu'à espérer de sa nature. Il était né terrible,
dit Saint-Simon, le Tacite inculte mais expressif de
cette fin de règne ; ses premières années faisaient trembler : dur, colère
jusqu'aux emportements contre les choses inanimées, incapable de souffrir la
moindre contradiction, même des heures et des éléments, sans entrer dans des
fougues à faire craindre que tout ne se rompit dans son corps, c'est de quoi
j'ai été souvent témoin ; opiniâtre à l'excès, passionné pour tous les
plaisirs, la bonne chère, la chasse avec fureur, la musique avec une sorte de
délire, le jeu encore, où il ne pouvait supporter d'être vaincu, et où le
danger avec lui était extrême ; enfin, livré à toutes les passions et
transporté à tous les plaisirs. Souvent farouche, naturellement porté à la
cruauté, barbare en raillerie, saisissant le ridicule avec une justesse qui
écrasait. De la hauteur des cieux il ne regardait les hommes que comme des
atomes avec qui il n'avait aucune ressemblance, quels qu'ils fussent.
L'esprit, la pénétration brillaient en lui de toute part, jusque dans ses
violences ; ses reparties étonnaient, ses réponses tendaient toujours au
juste et au profond ; 'il se jouait des connaissances les plus abstraites ;
l'étendue et la vivacité de son esprit étaient prodigieuses. et l'empêchaient
de se fixer sur une seule chose à la fois, jusqu'à le rendre incapable
d'études. De cet abîme sortit un prince.... Ce prince était l'enfant
qu'on donnait à transformer à Fénelon. Le roi, Mme de Maintenon et le duc de Beauvilliers avaient été admirablement servis par le hasard ou par le discernement, en rencontrant et en choisissant un tel maitre pour un tel disciple. Fénelon avait reçu de la nature les deux dons les plus nécessaires à ceux qui enseignent : le don d'imposer et le don de plaire. Le respect et l'attrait sortaient de toute sa personne ; la nature lui avait donné dans les traits la beauté de l'âme : son visage exprimait son génie, et le manifestait même dans son silence. Le pinceau, le ciseau et la plume de ses Contemporains, même de ses ennemis, s'accordent dans l'image qu'ils ont retracée de Fénelon. D'Aguesseau et Saint-Simon ont été ses Van Dyck et ses Rubens. Il vit, il parle et il enchante sous leurs mains. Sa taille était élevée, mince et flexible comme celle de Cicéron ; la noblesse et la modestie composaient gon attitude et réglaient sa démarche. La maigreur et la pâleur de ses traits en accusaient mieux la perfection. Il ne devait rien de sa beauté à la carnation, rien à la couleur ; elle était tout entière dans la pureté et dans la suavité des contours. Beauté toute morale et tout intellectuelle, la nature, pour l'exprimer, n'avait employé que le moins de matière possible ; on sentait, en le contemplant, que les éléments rares et délicats qui composaient cette figure ne donnaient presque point de prise aux brutales passions des sens, mais qu'ils n'avaient été pétris et moulés que pour rendre une intelligence active et une âme visible. Son front, était élevé, ovale, rebondi vers le milieu, déprimé et palpitant vers les tempes ; il était surmonté de cheveux fins d'une couleur indécise, que le souffle involontaire de l'inspiration soulevait, comme un vent léger, en boucles autour de la coiffure qui couvrait le sommet de la tète. Ses yeux, d'une limpidité liquide, empruntaient, comme l'eau, des reflets divers au jour, à l'ombre, à la pensée, à l'impression ; ils étaient, disait-on, de la couleur de ses pensées. Des sourcils élevés, arrondis et minces les relevaient ; des paupières longues, veinées et transparentes les recouvraient ou les dévoilaient tour à tour, en se déployant ou en se reployant avec une extrême mobilité. Son nez était aquilin ; mais la proéminence légère qui accentuait seulement ce trait de son visage ne servait qu'à donner une certaine énergie d'expression à la ligne plus grecque que romaine de son profil. Sa bouche aux lèvres presque toujours entr'ouvertes, comme un homme qui respire à cœur ouvert, avait une empreinte indécise de mélancolie et d'enjouement qui révèle la liberté d'esprit sous la gravité des pensées ; elle semblait aussi prête à la prière qu'au sourire ; elle aspirait à la fois le ciel et la terre ; l'éloquence ou la familiarité en coulaient d'avance par tous les plis. Ses joues étaient déprimées, mais sans rides, excepté aux deux coins des lèvres, où la bienveillance avait creusé l'empreinte d'un accueil habituellement gracieux. Son menton ferme et un peu proéminent donnait de la solidité virile à ce visage presque féminin. Sa voix répondait par sa sonorité douce, grave et caressante, à tous ces traits harmonieux de la figure ; le son y parlait autant que le mot. On était ému avant d'avoir compris. Cet extérieur, ajoute
d'Aguesseau, était rendu plus imposant par une noble
distinction répandue sur toute sa personne, et par je ne sais quoi de sublime
dans le simple, imprimant au caractère de ses traits un certain air de
prophète. Le tour nouveau, sans être recherché, qu'il donnait à ses
expressions, faisait croire à ceux qui l'entendaient qu'il possédait toutes
les sciences comme par inspiration ; on eût dit qu'il les avait inventées
plutôt qu'il ne les avait apprises : toujours neuf, toujours créateur,
n'imitant personne et paraissant lui-même inimitable. Un si grand théâtre
n'était pas trop pour un si grand acteur ; il n'y eut aucune place que le
public ne lui eût destinée, et qui ne parût au-dessous de son mérite. A ces dons des privilégiés de la nature, Fénelon ajoutait tous ceux que donne la volonté naturelle de plaire, sans penser ni à séduire ni à flatter. Le besoin d'être aimé, parce qu'il aimait lui-même, était sa seule flatterie et sa seule séduction ; mais c'était aussi sa puissance. Cette puissance, disent ses amis, allait jusqu'à la fascination, d'autant plus irrésistible qu'elle était moins voulue en lui ; cette passion de plaire n'était pas l'effort de son âme, c'était, son bonheur. Attiré vers tous, il attirait, par cet aimant même, tous à lui. La bienveillance était tellement son essence, qu'en la ressentant il la répandait. L'attrait général qu'il inspirait aux autres n'était que la répercussion de l'attrait qu'il éprouvait lui-même pour eux. Cette inclination à plaire n'était point artifice ; elle était épanchement. Il ne la bornait pas, comme les ambitieux, à ceux auxquels il avait intérêt à complaire, et qui pouvaient servir par leur amitié son élévation ou ses desseins ; elle s'étendait à tous, sans autre distinction que la déférence en haut et la familiarité en bas ; aussi soigneux, dit Saint-Simon, d'enchanter les supérieurs et les égaux que les subalternes : car il n'y avait pour lui, dans ce besoin d'attraction réciproque, ni grands ni petits, ni supérieurs ni subalternes ; il n'y avait que des cœurs pénétrés par le sien. Il n'en négligeait aucun, et il les enlevait tous, jusqu'à ceux des serviteurs les plus inaperçus de la domesticité du palais. Et cependant cette prodigalité d'âme n'avait rien de banal et d'uniforme dans l'expression qui en aurait vulgarisé la valeur ; elle était mesurée, distinguée et proportionnée, non en tendresse, mais en convenance, selon les rangs, les personnes, les Mérites, les degrés, dans la familiarité et dans le cœur. Aux uns le respect affectueux, aux autres l'intimité pénétrante ; à ceux-ci le mot, le sourire, le simple coup d'œil. Tout était instinctivement gouverné en lui par la bienséance naturelle des sentiments, non des formules. Un tact infaillible, ce toucher de l'âme, l'empêchait, sans qu'il y pensât, de témoigner rien de trop à l'un, rien de trop peu à l'autre. Chacun était comblé, mais à sa mesure. Une grâce merveilleuse ajoutait quelque chose encore à tout le reste ; cette grâce était un présent de la nature : la naissance y surajoutait le bon goût. Né de la noblesse, élevé dans l'élite, habitué dès l'enfance à marcher sur un plan plus haut que la foule, ses manières avaient ce prix inestimable de la supériorité qui s'incline, qui élève à soi et qui flatte en aimant. Sa politesse même ne paraissait pas une attention à tous, mais une inspiration pour chacun ; elle s'étendait jusqu'à son génie. Il évitait d'en éblouir ceux que son trop d'éclat aurait pu offusquer ou humilier. Il le proportionnait, dans la conversation, à la mesure d'esprit de ses interlocuteurs, les égalant toujours, ne les dépassant jamais. Cette conversation, qui est l'éloquence de l'amitié, était surtout la sienne ; elle était, selon les hommes, les heures, les sujets, grave, souple, lumineuse, sublime, enjouée, mais toujours noble, même dans la détente. Il y avait dans ses élans les plus involontaires quelque chose de doux, tendre et de familier, destiné à se faire comprendre des plus humbles et à se faire pardonner son génie. On ne pouvait, dit encore Saint-Simon qui le redoutait, ni le quitter ni s'en défendre, ni ne pas chercher à le retrouver. Son entretien laissait dans les âmes ce que sa voix laissait dans l'oreille, ce que son visage laissait dans les yeux, une empreinte neuve, pénétrante, indélébile, qui ne s'effaçait plus de l'esprit, des sens et du cœur. Quelques hommes furent plus grands, aucun ne fut plus proportionné à l'humanité, aucun aussi ne domina plus par l'amour. Tel était Fénelon, à quarante-deux ans, quand il parut à la cour. Il ne tarda pas à la conquérir tout entière, à l'exception des envieux, qu'aucune grâce dans la supériorité ne fléchit, et du roi, qui avait contre le génie les préventions du simple bon sens, et qui n'aimait pas qu'on regardât trop un autre homme que lui dans sa cour. Mme de Maintenon, femme véritablement supérieure en discernement toutes les fois que son goût naturel n'était pas refoulé par son ambition, ne tarda pas à reconnaître dans Fénelon l'esprit dominant de cette cour secondaire de l'héritier du trône. La piété pure, sincère et tendre de Fénelon la rassura contre son entraînement. Elle l'attira dans sa familiarité secrète ; elle songea même à en faire le confident de sa conscience en le choisissant pour son directeur spirituel. Une telle confiance aurait fait régner l'âme de Fénelon sur l'âme de Mine de Maintenon, qui régnait elle-même sur le roi ; l'oratoire d'une femme serait devenu l'oracle d'un siècle. On croit que la jeunesse de Fénelon, et la répugnance instinctive du roi contre une supériorité trop alarmante, la détournèrent de ce désir. Elle confia sa conscience à un autre, mais elle conserva à Fénelon toute sa faveur. Nul esprit dans cette cour n'était plus apte à comprendre, à admirer et à aimer Fénelon. A l'exception de Bossuet, tout était médiocre dans cette familiarité pieuse de Louis XIV et de Mme de Maintenon. Fénelon n'y convenait que par sa vertu ; son esprit dépassait cet entourage. Mais nous avons dit que nul ne savait se proportionner davantage à ce qui ne s'élevait pas à sa hauteur ; son plus sublime génie était de faire oublier son génie. Il se renferma, sous le patronage du duc de Beauvilliers et dans l'intimité du duc de Chevreuse, ses amis plus que ses supérieurs, dans la délicate fonction de sa charge. Le récit des efforts et du succès par lesquels le maître parvint à transformer le disciple appartient à la philosophie plus qu'à l'histoire. Le premier des procédés de Fénelon fut son caractère. Il parvint à persuader, parce qu'il parvint à se faire aimer ; il fut aimé, parce qu'il aima lui-même. En peu d'années, il façonna une rude nature, d'abord ingrate et laborieuse, puis facile et reconnaissante, en Germanicus de la France. Ce Germanicus, comme celui de Rome, devait être seulement montré au monde. Nous le retrouverons au bord du cercueil. Ce fut dans les studieux loisirs de cette éducation royale, qui portait forcément l'esprit de Fénelon sur la philosophie des sociétés, qu'il composa secrètement en poème le code moral et politique des gouvernements. Nous parlons du Télémaque ; le Télémaque, c'est Fénelon tout entier pour la postérité. S'il n'eût été que le courtisan lettré et élégant de la cour secrète de Mme de Maintenon, le pontife exemplaire et éloquent de Cambrai, ou l'instituteur d'un prince enlevé avant l'âge du trône, son nom serait déjà oublié. Mais il moula son âme et son génie dans un poème impérissable. Il est immortel, son monument, c'est sa pensée ; elle vit dans ce livre. On a disserté sur l'époque précise de la composition du Télémaque par le poète, et sur le mode de sa composition. On a prétendu que ce livre n'était point destiné à être un livre dans la pensée de l'écrivain ; on a dit qu'il tut écrit par lui au hasard, et page par page, pour donner des sujets de traduction grecque ou latine à son élève ; l'immensité, la régularité, la continuité et la sublimité de l'œuvre, évidemment écrite d'un seul trait et soufflée par une inspiration continue, démentent ces puériles suppositions. Elles ne sont pas moins démenties par la nature des sujets que Fénelon traite dans Télémaque. Comment un instituteur sensé et gardien scrupuleux de l'imagination de son élève lui aurait-il donné pour sujet d'étude l'examen des plus hautes théories de gouvernement, les fables équivoques de la mythologie ou les molles images des amours d'Eucharis ? C'est calomnier le bon sens et la pudeur du poète. Le livre, destiné en effet au jeune prince, fut évidemment écrit dans l'intention de prémunir son intelligence toute formée à l'âge d'homme contre les doctrines de la tyrannie et contre les pièges de la volupté, dont le maitre lui présentait les images, pour l'armer d'avance contre les séductions du trône ou de son propre cœur. Ce qu'il y a de vrai dans ces hypothèses, c'est que l'instituteur détachait de temps en temps une page de son manuscrit, proportionnée à l'âge et aux défauts de l'enfant, et la lui faisait traduire, afin de lui présenter dans sa composition ou les maximes qu'il voulait lui inculquer, ou le portrait des vices dont il voulait le corriger par des leçons indirectes. Mais le poème tout entier était le délassement, le trésor et le secret du poète. IX. Le monde entier connaît ce poème. Chrétien d'inspiration, il est païen de forme. Il correspond parfaitement par ce défaut d'originalité au temps et à l'homme. Fénelon, comme son livre, avait le génie païen et l'âme chrétienne. Malgré ce vice de composition, qui lui enlève ce caractère de contemporanéité et de nationalité que tout livre véritablement monumental doit porter en lui pour être le monument vivant et éternel d'une pensée non feinte, mais réelle, c'est le plus beau traité d'éducation et de politique qui existe dans les temps modernes, et ce traité a le mérite de plus d'être en même temps un poème, c'est-à-dire d'être tout à la fois une moralité, un récit et un chant ! Il vit ainsi d'une triple vie : il enseigne, il intéresse et il charme. La mélodie des vers lui manque, il est vrai. Fénelon n'avait pas assez d'énergie dans l'imagination pour exercer sur ses pensées cette pression du style qui les incruste dans le rythme, et qui solidifie, pour ainsi dire, la parole et l'image en les jetant dans le moule des vers ; mais sa prose, aussi poétique que la poésie, si elle n'a pas la perfection, toute la cadence et toute l'harmonie de la strophe, en a cependant le charme. C'est de la musique encore, mais une musique indécise, qui coule mollement et librement dans l'oreille. Cette poésie dure moins, mais lasse moins que celle d'Homère ou de Virgile. Si elle n'a pas l'éternité du métal, elle n'en a pas non plus le poids ; l'esprit et les sens du vulgaire la supportent avec moins d'efforts. Fénelon et Chateaubriand sont aussi poètes par le sentiment et par l'image, c'est-à-dire par ce qui est l'essence de la poésie, que les plus grands poètes ; seulement, ils ont parlé au lieu de chanter leur poésie. La véritable imperfection de ce beau livre, ce n'est pas d'être écrit en prose, c'est d'être une copie de l'antiquité, au lieu d'être une création moderne. On croit lire une traduction d'Homère, ou une continuation de l'Odyssée par un disciple égal au maitre. Les lieux, les noms, les mœurs, les personnages, les événements, les images, les fables, les dieux, les hommes, la terre, la mer et le ciel, tout est grec et païen, rien n'est français ou chrétien. C'est un jeu de l'esprit, un déguisement de l'imagination moderne sous des fictions et sous des vêtements mythologiques. On y sent l'imitation sublime, mais l'imitation à toutes les lignes ; Fénelon n'y est qu'un Homère dépaysé-dans un autre peuple et dans un autre âge, chantant les fables à des générations qui n'y croient plus. Là est le vice du peule. C'était celui du temps, qui, n'ayant pas encore poétisé ses propres croyances ni créé ses propres images, et retrouvant partout sous sa main, à la renaissance des lettres, les monuments poétiques de la Grèce, n'imaginait rien de plus beau que de calquer ces vestiges, et restait impuissant à force d'admiration. Mais, ce défaut expliqué ou excusé, l'œuvre de Fénelon n'est pas moins sublime. C'est le même de la piété filiale ; on pourrait presque dire que c'est le poème de toutes les vertus et de toutes les saintetés de l'homme. Le poète suppose que le jeune Télémaque, fils d'Ulysse et de Pénélope, conduit par la Sagesse sous la forme d'un vieillard nommé Mentor, navigue sur toutes les mers d'Orient à la recherche d'Ulysse, son père, que la colère des dieux repousse pendant dix ans de la petite Ile d'Ithaque, son royaume. Télémaque, pendant ce long ; voyage, tantôt heureux, tantôt traversé par le destin, aborde ou échoue sur mille rivages, assiste à des civilisations diverses, expliquées par son maitre Mentor, court des dangers, éprouve des passions, est exposé à des pièges d'orgueil, de gloire, de volupté, en triomphe avec l'aide de cette Sagesse invisible qui le conseille et le protège, se mûrit par les années, se corrige par l'expérience, devient un prince accompli, et, voyant régner dans les contrées qu'il parcourt, tantôt de bons rois, tantôt des républiques, tantôt des tyrannies, reçoit, par l'exemple, des leçons de gouvernement qu'il appliquera ensuite à ses peuples. X. Comme l'Émile, ce Télémaque plébéien de J. J. Rousseau, ce poème est surtout social et politique. c'est la critique et la théorie des sociétés et des gouvernements ; c'est le programme d'un règne futur dont le duc de Bourgogne était le Télémaque et dont Fénelon était le Mentor. C'est sous cet aspect principalement que ce livre a eu une immense influence sur le genre humain, que Fénelon a été, non pas seulement un poète, mais un législateur politique, un Solon moderne, une date vivante dans cette transformation des sociétés qui travaille le monde depuis l'apparition de son poème ; en sorte qu'on peut dire, sans fiction et sans exagération, que tout le bien et tout le mal, tout le vrai et tout le faux, tout le réel et tout le chimérique dans la grande révolution européenne d'idées et d'institutions dont nous sommes les instruments, les spectateurs et les victimes depuis, un siècle, a coulé de ce livre, comme de l'urne des biens et des maux. Le Télémaque est à la fois la grande révélation et la grande utopie des sociétés. Quand on remonte avec attention, chaînon par chaînon, des tribuns les plus fanatisés de la Convention aux girondins, des girondins à Mirabeau, de Mirabeau à Bernardin de Saint-Pierre, de Bernardin de Saint-Pierre à J. J. Rousseau, de J. J. Rousseau à Turgot, de Turgot à Vauban, de Vauban au précepteur du duc de Bourgogne, on trouve pour premier des révolutionnaires, pour premier tribun des peuples, pour premier réformateur des rois, pour premier apôtre de liberté, Fénelon ; on trouve pour évangile des vérités et des erreurs de la révolution moderne, Télémaque. Or, Fénelon, en politique, était à la fois vertueux et chimérique. De là les sommets et les précipices sur lesquels cette révolution s'élève, ou dans lesquels elle trébuche tour à tour dans l'application ; tout ce qui est principe est admirable dans le Télémaque, tout ce qui est gouvernement est absurde. La transformation politique du inonde avait, dans Fénelon, son prophète, elle devait attendre pendant un siècle son homme d'État. Le bon sens de Louis XIV, aiguisé par la pratique du gouvernement, lui arrachait ce mot vrai sur le livre et sur l'homme : Fénelon est l'homme le plus chimérique de mon royaume. Toutes ces maximes générales, saines en spéculation, ont été converties en institutions depuis, et bien souvent ruinées dans la pratique par la défectuosité des choses humaines. Les peuples régis par leur propre sagesse, les républiques patriciennes et plébéiennes, les royautés tempérées par le pouvoir sacerdotal ou par le pouvoir populaire, le gouvernement représentatif, les états généraux de la nation rassemblés périodiquement tous les trois ans, les administrations et les assemblées provinciales, l'élection et la déposition des princes, la souveraineté du peuple en action, la suppression de l'hérédité du trône et des magistratures, la liberté de conscience, la paix perpétuelle entre les peuples, la fraternité et l'égalité entre les citoyens, la suppression de la richesse de quelques-uns au profit prétendu de l'aisance de tous, l'arbitraire de l'État dans la fortune des sujets, la répartition des terres et des professions par le gouvernement, l'éducation publique égale et forcée pour tous les enfants de la patrie, la communauté des biens, la condamnation du luxe, les lois somptuaires sur les maisons, les logements, les aliments ; les métiers élémentaires, tels que l'agriculture ou le soin des troupeaux, favorisés violemment par l'interdiction du luxe et des arts ; le maximum de prix ou de consommation sur les denrées ; l'économie politique tour à tour la plus juste et la plus fausse ; vérité, erreur, utopies, inconséquences, contradictions, illusions, possible, impossible, grandes vues, courtes vues, rêve vague, aspirations sans point de départ, sans but et sans moyen d'exécution : tout fait de la politique, du Télémaque une sorte de pastorale des gouvernements. Tout s'y mêle ; on croit nager dans l'océan des imaginations humaines, sans boussole pour se diriger, sans pôle pour y tendre, sans rivage pour aborder. C'est, après le Contrat social de J. J. Rousseau et, l'Utopie de Platon ou celle de Thomas Morus, le pandémonium des spéculations vaines. Tout y est ombre, rien n'y a un corps. C'est en présence de ces quatre livres, la République de Platon, l'Utopie de Morus, le Télémaque de Fénelon et le Contrat social de J. J. Rousseau, qu'on a pu dire avec vérité le mot du grand Frédéric : Si j'avais un empire à punir, je le donnerais à gouverner à des philosophes. C'est que ces philosophes, malgré la magnificence de leur génie, l'élévation de leurs vues et la vertu de leurs tendances, faisaient, dans leurs plans pour l'humanité, abstraction de l'humanité elle-même. Esprits sans expérience et sans réalité, ils construisaient leurs institutions imaginaires sur des nuées. Dès que ces nuées touchaient terre, les institutions fondaient en vapeurs ou en ruines. Fénelon, dans le Télémaque, est un des philosophes qui ont créé, pour le siècle qu'ils formaient, les plus belles et les plus trompeuses perspectives, qui ont mêlé le plus d'idées fausses à plus d'idées justes, et qui ont le plus confondu la passion d'amélioration du sort des hommes en société avec la passion de l'impossible. C'est contre ces impossibilités d'application que la révolution inexpérimentée dont il est le père est venue se heurter, s'irriter et échouer toujours ; et c'est de la colère contre la résistance des réalités aux chimères que sont nés les déceptions, les fureurs, les tyrannies et les crimes de cette révolution. Les utopistes de l'anéantissement du pouvoir et du gouvernement purement métaphysique ont produit les anarchies et les crimes de la Révolution en 1793 ; les utopies du nivellement des propriétés et du communisme social ont amené la panique et le désaveu de la révolution de 1848. Ces deux utopies sont des rêves de Fénelon pris au sérieux par des esprits mal éveillés. Le saint poêle a été, à son insu, le premier radical et le premier communiste de son siècle. Quant à l'influence de ce livre en matière d'économie politique, elle n'a été ni moins grande ni moins funeste. Mais on s'explique plus facilement ces erreurs. Les déclamations contre les arts, contre le luxe ; les lois somptuaires contre la consommation des produits chers du travail, qui n'ont aucun sens de nos jours, avaient un sens dans l'antiquité primitive où Fénelon puisait malheureusement ses exemples et ses idées. On conçoit, en effet, qu'au commencement des choses, dans des sociétés toutes pastorales ou toutes agricoles, où la terre, à peine cultivée, ne fournissait que le strict nécessaire à l'alimentation de l'homme, le législateur fit au citoyen une vertu et une prescription de dépenser et de consommer le moins possible. La sobriété et l'épargne des citoyens laissaient ainsi une part plus grande aux besoins de leurs frères. Ces lois avaient pour but de prévenir la disette, fléau de ces empires naissants, où la vie alimentaire était tout. Dans cet esprit, la tempérance, qui n'est qu'une vertu envers nous-mêmes, était une vertu envers la société. L'abstinence était un dévouement, le luxe un crime. On comprend donc les lois somptuaires de l'antiquité. Mais quand la société, sûre de sa vie et ayant multiplié ses forces productives par les défrichements, les troupeaux, les machines, ne craint plus la disette et ne nourrit des masses immenses de population que par le salaire attribué au travail intellectuel, artistique, industriel ; quand la consommation de l'un est toute la richesse de l'autre, quand chaque jouissance, chaque vanité, chaque caprice satisfait du riche qui consomme est volontairement ou involontairement un salaire, une charité envers le travailleur qui produit, le système de Fénelon, de Platon et de J. J. Rousseau devient non-seulement une absurdité, mais un meurtre contre le peuple. C'est la consommation qui devient vertu, c'est le luxe, proportionné à la fortune, qui devient le père nourricier du genre humain. Cette erreur du Télémaque est une de celles qui ont fait le plus de mal à la Révolution, et qu'on a le plus de peine aujourd'hui à extirper de l'esprit du peuple lui-même, qu'elle séduit et qu'elle fait souffrir. Tel est le Télémaque : vertueuses maximes, déplorables applications. Mais comme ce poème répondait par anticipation aux plus nobles et aux plus légitimes instincts de justice, d'égalité et de vertu dans le gouvernement des empires, comme il était inspiré par une âme sainte et écrit par un poète de génie, on conçoit l'explosion d'un tel livre dans le monde. Mais le Télémaque était encore le secret de Fénelon. Il l'écrivait dans le palais de Louis XIV. Il devait le dérober aux yeux du roi et des courtisans jusqu'à la fin de ce règne. Dans ce livre était une terrible accusation : il la réservait pour l'époque où le duc de Bourgogne, son élève, atteindrait à la maturité des années et s'approcherait des degrés du trône. C'était la confidence scellée, qui resterait ignorée à jamais jusque-là entre le maître et le disciple. Peut-être aussi ce livre était-il destiné à être, au moment de l'avènement du jeune prince à la couronne, la proclamation d'une politique nouvelle, le programme d'un gouvernement fénelonien ; c'était aussi une sorte de candidature indirecte au rôle de premier ministre, dont Fénelon pouvait avoir le pressentiment sans s'en avouer à lui-même l'ambition. Son ami l'abbé Tronson l'avait prémuni, comme on l'a vu, d'avance contre cette ambition lui ne sollicite pas, mais qui révèle à propos des aptitudes involontaires : telle était celle de Fénelon. Il y a, chez certains hommes privilégiés de la nature, des ambitions qui ne sont pas des vices, mais des forces. Elles n'aspirent pas, mais elles montent d'elles-mêmes, comme le globe aérostatique dans un élément plus lourd que lui, et par la seule supériorité de leur ascendance spécifique. La vertu même de Fénelon devait lui faire désirer une élévation future, croit son âme pleine de bien se répandrait de plus haut et plus loin sur ses semblables. Mais l'envie commençait à percer l'ombre dans laquelle il
se renfermait. On s'inquiétait de l'influence qu'il exerçait, non plus comme
maitre, mais comme ami, sur son élève. Celle qu'il conquérait tous les jours
davantage sur Mme de Maintenon, par l'attrait de son entretien, ne portait
pas moins ombrage à la cour. La correspondance entre Mme de Maintenon et lui
était aussi fréquente que l'intimité. Ces lettres ne déguisaient pas la hardiesse
des conseils que Fénelon donnait à la femme qui conseillait à son tour le roi
; il l'encourageait à régner : Vous êtes plus
capable d'affermir que vous ne le pensez vous-même, lui écrivait- il, pour obéir à la prière qu'elle lui avait faite de lui dire
des vérités même sévères. Vous vous défiez trop de vous-même, ou bien vous
craignez trop d'entrer dans des discussions contraires au goût que vous avez
pour une vie tranquille et recueillie... Comme
le roi se conduit bien moins par des maximes suivies que par l'impulsion des
personnes qui l'entourent, et auxquelles il donne son autorité, l'essentiel
est de ne perdre aucune occasion pour l'obséder de gens vertueux, qui
agissent de concert avec vous pour lui faire accomplir dans toute leur
étendue les devoirs dont il n'a aucune idée. Le grand point est de
l'assiéger, puisqu'il veut l'être ; de le dominer, puisqu'il veut être dominé.
Son salut consiste à être assiégé par des gens droits et sans intérêt. Vous
devez donc mettre votre application à lui donner des vues de paix, et surtout
de soulagement des peuples, de modération, d'équité, de défiance des conseils
durs et violents, d'horreur pour les actes d'autorité arbitraire.... Vous avez à la cour des personnes bien intentionnées ;
elles méritent que vous les traitiez bien, que vous les encouragiez : mais il
y faut beaucoup de précaution, car mille gens se feraient dévots pour vous
plaire. On voit que Fénelon parlait des vices du roi en homme qui se livrait tout entier à la merci de Mme de Maintenon, maitresse désormais de ses confidences ; on voit aussi que, fidèle à l'amitié, il cherchait à attirer sur le parti de la vertu à la cour, les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers, toute la faveur du maître. Il ne faut pas oublier cependant que ce parti de la vertu était en même temps le parti de ses patrons et de ses amis. Cette correspondance et cette intimité pieuse entre Mme de Maintenon et Fénelon conquérait de plus en plus au futur auteur du Télémaque l'attrait et le cœur de celle qui régnait à la cour ; elle revient avec complaisance, dans ses vieux jours, sur les sentiments qu'elle éprouvait alors. J'ai souvent pensé depuis,
écrit-elle, pourquoi je ne livrai pas ma conscience
à l'abbé de Fénelon, dont toutes les manières me plaisaient, dont l'esprit et
la vertu m'avaient tant prévenue en sa faveur. Elle avait besoin plus
qu'aucune femme, dans sa situation, de la société d'un homme aussi attrayant
que supérieur, au milieu de la froideur, du vide et de la médiocrité des esprits
dont elle était entourée. Ah ! que ne puis-je,
écrit-elle en ce temps-là à sa nièce chérie, que ne
puis-je vous donner mon expérience ? Que ne puis-je vous faire voir l'ennui
qui dévore les grands, et la peine qu'ils ont à remplir leurs journées ? Ne
voyez-vous pas que l'on meurt de tristesse dans une fortune qu'on aurait de
la peine à imaginer ? J'ai été jeune et jolie ; j'ai goûté des plaisirs ;
j'ai été aimée partout ; dans un âge plus avancé, j'ai passé des années dans
les commerces de l'esprit ; je suis venue à la fortune, et je vous proteste
que tous les états laissent un vide affreux. Cette amitié de Mme de Maintenon pour l'homme le plus séduisant du royaume inspira au roi l'idée de récompenser Fénelon de ses succès dans l'éducation de son petit-fils par le don de l'abbaye de Saint-Valéry. Le roi lui annonça lui-même cette faveur, et s'excusa gracieusement de ce qu'elle était si tardive et si disproportionnée à ses services. Tout commençait à sourire à Fénelon : le cœur de Mme de Maintenon semblait lui ouvrir celui de la cour. XI. Mais un piège était sur la route de Fénelon. Ce piège, il le portait en lui-même : c'était sa belle âme et sa poétique imagination. Il se laissa séduire non par sa fortune, mais par sa piété. Nous avons dit, au commencement de ce récit, que la cour de Louis XIV vieilli était un synode plutôt qu'un gouvernement, et que les questions de dogme, d'orthodoxie, de théologie les plus subtiles, y tenaient autant de place que la guerre on la politique. Il convient de le rappeler au ment où nous allons voir la faveur de ce beau génie, et peut-être la fortune de la France, renversée par les hallucinations d'une femme et par la colère de Bossuet. Il y avait alors à Paris une jeune, belle et riche veuve, Jeanne-Marie de Lamothe, mariée à M. Guyon, fils du créateur du canal de Briare, qu'elle avait perdu à vingt-huit ans. Mme Guyon était douée par la nature d'une beauté rêveuse et mélancolique, d'une âme passionnée et d'une imagination à qui la terre ne suffisait pas, et qui cherchait l'amour jusque dans le ciel. Elle avait connu à Paris, avant son mariage, un jeune religieux barnabite, nommé Lacombe. La piété tendre et l'exaltation mystique de ce religieux avaient fait sur l'âme et le cœur de la jeune néophyte une de ces impressions entraînantes où la grâce et la nature semblent tellement se confondre, comme dans l'amitié de saint François de Sales et de Mme de Chantal, qu'on ne peut discerner si l'on cède, en y cédant, à une vertu d'en haut ou à un attrait humain. A peine veuve, Mme Guyon, qui avait entretenu toujours une correspondance avec son maitre dans la piété, avait volé à Gex, petite ville du Bugey, sur le versant du Jura, où le P. Lacombe l'attendait. L'évêque de Genève, de qui relevait la petite ville de Gex, connaissait le nom, la grâce, l'esprit, la fortune, la piété célèbre déjà de la jeune veuve. Il avait regardé comme une illustration pour son Église qu'une femme douée de tant de dons naturels et surnaturels vînt les ensevelir ou les consacrer au service de Dieu dans cette solitude. Il s'était empressé de donner à Mme Guyon la direction d'un couvent de jeunes filles converties par ses soins du schisme de Calvin. Mme Guyon avait demandé le P. Lacombe pour supérieur de son monastère. L'intimité de la veuve et du religieux, ainsi consacrée par la communauté de séjour et de piété, s'était exaltée jusqu'à l'extase. L'imagination enflammée de la femme avait bientôt dépassé celle du religieux. Le maître était devenu le disciple ; il recevait les inspirations et les révélations des yeux et de la bouche de sa pénitente comme les manifestations du ciel. Ce commerce mystique avait paru suspect aux âmes simples. L'évêque de Genève, après l'avoir involontairement favorisé, s'en était ému ; il avait relégué le religieux disgracié à Thonon, autre petite ville de son diocèse, sur les bords du lac de Genève. Mme Guyon n'avait pas tardé d'y suivre son ami spirituel. Retirée à Thonon dans un couvent d'ursulines, elle y recevait librement le P. Lacombe ; elle entretenait avec lui ces relations extatiques qui maintenaient son empire sur son esprit faible, asservi et charmé. De là elle alla répandre ses effusions d'amour pour Dieu à Grenoble, dans des conférences avec un petit nombre de sectaires. Les forêts et les rochers dé la Grande-Chartreuse l'attirèrent par leur majestueuse sainteté ; elle y apparut comme la Sibylle de ces déserts. Enfin, espérant trouver de l'autre côté des Alpes l'imagination italienne plus inflammable au feu de ses nouvelles doctrines, elle envoya son disciple Lacombe prêcher sa foi à Verceil, en Piémont, et l'y suivit encore. Elle erra ainsi avec lui pendant plusieurs années, de Gex à Thonon, de Thonon à Grenoble, de Verceil à Turin, de Turin à Lyon, laissant partout le monde indécis entre l'admiration et le scandale. Mais l'admiration prévalait sur tous ceux qui contemplaient de plus près la sincérité de ses extases, l'austérité de sa vie, la pureté de ses mœurs. Au retour de ce long pèlerinage, elle fit imprimer à Lyon une explication du Cantique des cantiques de Salomon, et quelques autres écrits sur la contemplation. Ces doctrines, renouvelées de Platon et des premiers contemplateurs chrétiens, surtout en Espagne, pays de l'extase, consistaient à recommander aux âmes pieuses, comme type de perfection, un amour de Dieu pour lui-même, désintéressé de toute récompense comme de toute crainte. Elles recommandaient également une contemplation si pénétrante et si absorbée en Dieu, que l'âme, noyée pour ainsi dire dans l'océan de l'essence divine, y contractât l'impeccabilité du pur esprit, ne fût plus capable ni de monter ni de descendre, et laissât le corps comme un vêtement dépouillé, libre de ses actes simplement matériels, sans que l'âme, exaltée en Dieu, fût responsable de sa dépouille. C'était en un mot, la vertu de Dieu passée dans l'homme par l'union absolue et indissoluble de l'homme à Dieu, le rêve de toute âme sur la terre, l'état anticipé du ciel. Il y avait de la grandeur et de la sainteté pour les saints. dans ces maximes ; il y avait des pièges pour le vulgaire. L'Église s'émut à ces rumeurs ; le cardinal Lecamus, évêque de Grenoble, les dénonça à l'archevêque de Paris, M. de Harlay à la cour. Mme Guyon et le P. Lacombe venaient de rentrer à Paris. L'apôtre et le disciple furent arrêtés. Le religieux, interrogé, jeté à la Bastille, confiné à l'île d'Oléron, fut enfermé au château de Lourdes, dans le plus âpre rayon des Pyrénées, pour y languir pendant de longues années d'expiation. Mme Guyon, enfermée de son côté dans un monastère de la rue Saint-Antoine, subit les interrogatoires sévères de l'Église et se lava victorieusement de toutes les accusations de scandale et d'impiété qui l'avaient assaillie à son retour à Paris. Elle devint l'édification, l'amour et les délices du couvent qui lui servait de prison. Une femme célèbre alors par ses lumières et son zèle dans la piété, Mme de Miramion, entendit parler de la femme captive ; elle la vit, elle fut séduite. Elle intercéda auprès de Mme de Maintenon pour en obtenir la liberté d'une femme injustement persécutée. Mme de la Maisonfort, parente aussi de Mme de Maintenon, la duchesse de Béthune, fille de l'infortuné Fouquet, Mme de Beauvilliers elle-même, fille de Colbert, s'unirent à Mme de Miramion dans ce même intérêt. Mme de Maintenon fit rendre la liberté à la protégée de tant de femmes irréprochables. Mme Guyon, libre, courut rendre grâce à sa libératrice. Mme de Maintenon subit la fascination générale ; elle rapprocha d'elle Mme Guyon comme un foyer de piété, d'éloquence et de grâces, qui n'avait été obscurci que par les fumées d'une sublime imagination. Elle l'introduisit à Saint-Cyr, maison où elle avait rassemblé sous ses auspices l'élite des jeunes filles nobles du royaume ; elle l'engagea à y révéler les dons de Dieu dans des conférences où éclaterait son génie contemplatif et pieux. Elle y assistait elle-même ; elle devint complice innocente de toutes les subtilités de l'esprit mystique sur l'amour' divin ; elle entraîna dans cette admiration les hommes les plus sévères de la cour, tels que le duc de Beauvilliers et le duc de Chevreuse ; elle admit Mine Guyon dans son intimité la plus inaccessible au vulgaire. Ce fut là et sous de si respectables auspices, que Fénelon rencontra Mme Guyon. La conformité de tendresse et d'exaltation de ces deux âmes également religieuses, séduites par deux imaginations également colorées, ne tarda pas à établir entre Fénelon et Mme Guyon un commerce spirituel où il n'y eut de séduction que la piété et de séduit que l'enthousiasme. |