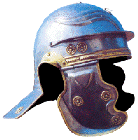DE LA MILICE ROMAINE
QUATRIÈME PARTIE. — ADMINISTRATION DE L'ARMÉE
CHAPITRE VII. — DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS MILITAIRES ; DES HOMMES ATTACHÉS AU SERVICE DE L'ARMÉE.
|
Des corporations de fonctionnaires et d'employés. — Des ministres de la religion. — Des médecins : origine de la médecine à Rome ; son introduction dans l'armée ; différentes aortes de medici ; organisation du service médical. — Des ouvriers ; des vivandiers et des valets d'armée. Outre les frumentarii, chargés de la manutention dei vivres, et les librarii, chargés de la comptabilité, il y avait au service de l'armée d'autres employés, formant, comme ceux-là, des corporations très-importantes. Tels étaient les ministres de la religion, les médecins et les chirurgiens, et, dans un ordre moins relevé, les ouvriers, les vivandiers et les valets d'armée. En décrivant les précautions qu'un général avait l'habitude de prendre avant de se mettre en campagne, avant de combattre, avant d'entreprendre un transport de troupes par mer, nous avons dit qu'il avait soin de faire des sacrifices et d'immoler des victimes aux dieux, afin de donner à ses soldats une certaine confiance dans l'entreprise qu'il allait tenter. Les généraux, dans ces prières publiques, dans ces sacrifices solennels, avaient auprès d'eux des prêtres qui leur servaient d'aides et de ministres, et l'armée traînait après elle tout l'attirail des superstitions païennes. Mais les grands prêtres, ceux dont la dignité était la plus honorée à Rome, ne pouvant pas sortir de la ville, les légions n'avaient à leur suite que des ministres d'un ordre subalterne, dont l'autorité ne pouvait nuire en rien à celle du général en chef. Tels étaient ces sacrificateurs nommés victimarii, ces aruspices que les inscriptions nous disent avoir été attachés aux cohortes indépendantes[1], et ces augures légionnaires qui prenaient le titre d'augur pullarius, parce qu'ils avaient pour fonction de nourrir des poulets sacrés, et d'indiquer, d'après leur appétit, quelle devait être la volonté des dieux. Ils avaient dans le campement, près de la tente du général, un petit temple nommé augurale ou auguratorium ; là ils pouvaient parfaitement s'entendre avec les chefs supérieurs pour tirer parti de la superstition des troupes et les animer au combat par des présages heureux. Un chef habile pouvait se servir de ce moyen, dans des circonstances difficiles, pour ramener à lui la confiance de ses soldats, et la corporation des prêtres légionnaires avait ainsi son utilité dans l'administration générale de l'armée. Après eux, nous avons cité les médecins et les chirurgiens. Y eut-il, dès l'origine, des medici dans les légions ? a quelle époque y en eut-il, et quand furent-ils regardés comme fonctionnaires de l'État ? Quelle fut alors leur condition ? quels furent leurs privilèges ? Comment fut établi le service médical ? Ceux qui, jusqu'ici, ont écrit sur l'art militaire des Romains, ne se sont pas arrêtés sur toutes ces questions. Végèce, en effet, dans son chapitre, Comment se gouverne la santé d'une armée, ne donne que des conseils généraux sur les précautions sanitaires qui doivent être prises en campagne, mais il ne dit rien du corps des médecins. Lebeau, dans ses nombreux mémoires à l'Académie, cite bien quelques inscriptions où il est question de différentes sortes de medici, mais il n'entre pas dans de grandes explications à ce sujet. M. Dezobry, enfin, dans son savant ouvrage sur Rome au siècle d'Auguste, en consacrant aux médecins romains une lettre tout entière, n'a pu parler de ceux de l'armée, dont la condition, sous Auguste, n'était pas encore bien établie. Nous nous trouverions donc aujourd'hui dans une grande pénurie de documents sans le travail consciencieux qu'a publié, l'an dernier, M. Aubertin, dans le Journal de l'Instruction publique. M. Aubertin, après avoir démontré que les principaux éléments du service médical existaient dans les armées grecques, après avoir comparé certaines opinions de Xénophon aux sages et doctes conseils de l'illustre chirurgien en chef de l'armée d'Orient, M. Baudens, se demande si cette médecine militaire existait aussi chez les Romains, et donne pour la solution de cette question de précieux renseignements, dont nous avons pu nous-même constater l'exactitude par les nombreuses recherches que nous a rendues nécessaires tout l'ensemble de notre travail. Durant les six premiers siècles, Rome, n'ayant pas de médecins,
ne put en donner à ses armées. Chaque citoyen opulent avait alors, comme
Caton, un manuel de conseils et de remèdes pour soigner sa famille ; sur le
champ de bataille, le soldat blessé se faisait soigner par ses camarades,
quand il n'avait plus la force de le faire lui-même, ou quelquefois, après un
combat meurtrier, on portait les malades les plus pauvres dans les maisons
des riches, qui en prenaient soin. C. Fabius, consul, dit Tite-Live[2], saucios milites
curandos dividit patribus. Et Tacite, dans le IVe livre des Annales[3], confirme ces paroles
de Tite-Live : Fuitque urbs per illos dies veterum institutis similis qui, magna
post prælia, saucios largitione et cura sustentabant. Mais bientôt
on comprit les nombreux inconvénients d'une telle méthode : il se forma dans
les légions un corps médical, composé de volontaires, et le traitement des malades et des blessés fut confié aux
soins de quelques camarades qu'un goût particulier disposait à s'occuper de
chirurgie[4].
Nous avons vu la même chose dans notre armée, pendant la guerre de Crimée, où
la plupart des volontaires, dit M. Baudens, montrèrent un zèle et une aptitude dignes des plus grands
éloges. Ce ne fut qu'en l'an 535 de Rome, qu'un Péloponnésien, du nom d'Archagatas ; vint y fonder la première école de chirurgie. Sa réputation s'établit facilement : il eut de nombreux disciples, et les gens riches eurent bientôt un esclave chirurgien. Alors les généraux purent en emmener à leur suite dans les camps, et les médecins s'introduisirent ainsi dans l'armée ; ce n'étaient toutefois que des esclaves attachés au service de leurs maîtres, et qui soignaient les soldats d'une façon peu régulière. Mais, lorsque J. César eut fait citoyens romains tous les médecins et chirurgiens qui venaient à Rome ; lorsqu'Auguste eut ajouté à ce bienfait l'exemption des impôts[5], tant de faveurs en attirèrent un grand nombre de la Grèce et des pays étrangers. Les légions se ressentirent de cette affluence, et, comme ils étaient citoyens, rien ne pouvait plus s'opposer à ce qu'ils fussent attachés, en qualité de fonctionnaires de l'État, aux différents corps de l'armée. Comme les frumentarii, comme les librarii, les medici formèrent une corporation ayant son bureau, ses règlements, ses privilèges particuliers. Tous les médecins légionnaires prirent le titre de medicus legionis, ceux des cohortes indépendantes celui de medium cohortis. La cavalerie eut les siens, comme l'infanterie, car on a retrouvé l'inscription de M. Vulpius Sporus, médecin des Asturiens à cheval ; et il y eut même des médecins vétérinaires, puisqu'une inscription d'Orelli mentionne un medicus jumentarius[6]. La marine n'en fut pas non plus dépourvue : une inscription découverte à Baïes nomme Satrius Longinus, médecin à double solde, medium duplicarius, du vaisseau le Cupidon. Ce titre de duplicarius montre assez que tous les medici devaient être soldés par l'État, puisqu'on accordait à quelques-uns d'entre eux une double solde pour récompense. Nous savons d'ailleurs, par Vopiscus, biographe d'Aurélien, que ce prince leur défendit expressément d'exiger aucun salaire des soldats : A medicis milites gratis curentur[7]. Or, s'ils n'étaient pas payés par leurs clients, ils devaient l'être nécessairement par la caisse militaire. Ce même titre de duplicarius prouve, de plus, qu'il y avait parmi les medici, comme parmi les autres employés de la légion, certaines distinctions accordées en récompense des services rendus. Nous avons dit, en effet, qu'on appelait bénéficiaires tous les soldats exemptés de travaux ou recevant plus que la solde ordinaire, et nous lisons, sur une des six inscriptions de médecins de cohortes qu'on a retrouvées à Rome, le nom de Julius Ingenuus, medicus beneficiarius. On peut même penser, d'après l'inscription d'Anicius Ingenuus, médecin de la cohorte tongrienne, qui est intitulé medicus ordinarius, qu'il n'y avait pas seulement des distinctions honorifiques, mais qu'il y avait encore différents grades entre tous les médecins d'une armée. D'après Végèce, dit M. Aubertin, on appelait ordinarius le premier tribun d'une légion et le premier centurion d'une cohorte qui prenait la tête de la compagnie, qui ordines ducebat. Par analogie, le medicus cohortis ordinarius devait être le médecin en chef d'une légion, ce que nous appelons en français chirurgien-major. Ainsi donc, il y eut un service médical organisé dans les armées de terre et de mer ; on ne peut en douter. Mais quelle fut cette organisation ? Les agents de la médecine militaire furent-ils obligés de parcourir toute l'armée pour porter secours aux malades et aux blessés ? Ceux-ci restèrent-ils dans leurs tentes, ou furent-ils transportés dans un lieu commun ? En un mot, y eut-il des ambulances et des hôpitaux ? Il est certain qu'en temps ordinaire une armée romaine n'avait besoin ni d'hôpital ni d'ambulance. La nourriture saine et frugale des troupes, les exercices hygiéniques qu'on leur imposait, l'habitude du travail, la régularité de la vie, le climat tempéré des lieux qu'elles parcouraient, le nombre généralement restreint des hommes qui les composaient, tout contribuait à leur donner une excellente santé et à les préserver de ces terribles maladies qui font souvent à nos armées modernes plus de mal que l'ennemi. Ce n'était donc qu'après les combats qu'il aurait été utile de réserver dans les camps un emplacement spécial au service médical ; mais les historiens latins ne nous en parlent pas, et, quoique nous lisions, dans les Commentaires, que César établit momentanément, pour ses malades, un camp fortifié d'où ils revenaient à l'armée par bandes de deux à trois cents hommes, nous ne pouvons voir dans cet établissement temporaire qu'un fait tout à fait exceptionnel. En général, lorsqu'après un combat il y avait un grand nombre de blessés à soigner, on plaçait sur des chariots, à la suite de l'armée, ceux qui étaient le plus légèrement atteints, et l'on confiait les autres aux alliés, en les répartissant chez les particuliers. Ægrotantes ipse visitavit, dit Lampride en parlant d'Alexandre Sévère[8], per tentoria milites, etiam ultimos, et carpentis vexit, et omnibus necessariis adju vit. Et si forte gravius laborassent, per civitates et agros patribus familias honestioribus divisit. Cependant les généraux se préoccupèrent de plus en plus ds l'état sanitaire de leurs troupes, et l'on finit par réserver dans les camps un lieu de traitement pour les hommes, valetudinarium, et même un lieu de traitement pour les chevaux, veterinarium. Les médecins eurent à leur suite, pour les aider dans leurs fonctions, des infirmiers dont Léon le Philosophe parle très-longuement, et qu'il appelle optiones valetudinarii[9]. Derrière ces grandes corporations de fonctionnaires attachés aux légions venaient les différentes compagnies d'ouvriers travaillant au service de l'armée. Servius Tullius en avait attaché, dès le principe, deux centuries à chaque légion, et, sans leur donner d'autres armes que leurs instruments de travail, il les avait enrégimentés comme de véritables soldats. Avec les progrès de l'art militaire, et à mesure qu'on fit de nouvelles inventions, le nombre de ces employés s'accrut insensiblement : il y eut des maçons, des charpentiers, des forgerons, chargés de faire des logements dans les campements d'hiver, de construire des tours pour l'attaque des places, de fabriquer et de réparer les machines de guerre ; des mineurs, des pionniers, etc., etc., et même des lecticarii, chargés de porter les morts à la sépulture. Toutes ces compagnies, qui avaient leurs contremaîtres particuliers, étaient sous les ordres d'un seul chef général, nommé præfectus fabrum. Cet officier, quoique inférieur en dignité aux autres préfets militaires, avait cependant un grade très-honorable. Nous le voyons souvent signalé dans les auteurs et les inscriptions, et nous savons que L. Cornélius Balbus, pour qui Cicéron fit le plaidoyer qui nous reste, était præfectus fabrum sous le consulat de César. Enfin, au-dessous des ouvriers, et en dernier lieu, venaient les vivandiers, lixæ, et les valets, calones. Les vivandiers étaient des hommes libres qui suivaient l'armée pour s'enrichir en trafiquant ; les calones étaient des esclaves qui servaient les soldats et les déchargeaient de ce qu'il y avait de plus pénible dans les travaux militaires. Leur nombre, sous la république, avait toujours été très-restreint, et, dans l'origine, les officiers seuls et les chevaliers avaient pu s'en servir ; mais plus tard, dans les temps de relâchement, il devint excessif ; des armées en eurent quarante mille à leur suite[10]. Les grands généraux en avaient toujours limité l'usage le plus possible : César, par exemple, lorsqu'il était parti de Sicile pour porter la guerre en Afrique, avait défendu à ses soldats d'embarquer un seul valet avec eux. Dans la décadence, ce fut tout le contraire : Léon voulut que ses officiers en eussent d'enrôlés pour garder les bagages pendant le combat, et que ses soldats se missent quatre ou cinq ensemble pour en entretenir un[11]. Les empereurs, par de telles ordonnances, semblaient avoir pris à tâche de désorganiser eux-mêmes l'ancienne discipline de l'armée romaine. |