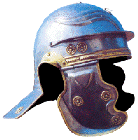DE LA MILICE ROMAINE
QUATRIÈME PARTIE. — ADMINISTRATION DE L'ARMÉE
CHAPITRE IV. — DISCIPLINE : PEINES ET RÉCOMPENSES.
|
Lois rigoureuses de la discipline romaine. — Peines : castigatis, pecuniaria mulcta, numerum indictio, militiæ mutatio, gradus dejectio, ignominiosa missio ; peines corporelles, bastonnade, verges, mort. — Récompenses : armes d'honneur, avantages honorifiques, couronna ; récompenses des s'épissas, triomphe. Les exercices militaires par lesquels les Romains apprenaient à leurs soldats l'art de combattre et de vaincre seraient restés complètement inutiles, s'il n'y avait eu dans l'armée des règlements établis, une police régulière capable d'en conserver tous les avantages. Des peines sévères infligées aux délits, des récompenses glorieuses accordées au courage, entretenaient parmi tous une crainte salutaire avec une noble émulation, et c'est avec raison que Valère-Maxime appelle cette discipline exacte et rigoureuse des légions la garde la plus fidèle de l'empire romain : sanctissima romani imperii custos severa castrorum disciplina[1]. Celui qui recevait le commandement d'une armée était en même temps revêtu du pouvoir de juger et de punir. Les consuls, comme généraux, hors des murs de Rome, avaient une puissance absolue, avaient le droit de vie et de mort sur tous leurs soldats, sans qu'il y eût aucun moyen d'appel[2]. Mais, quelque grande que fût leur autorité, ces généraux eux-mêmes étaient soumis à la discipline, étaient obligés d'en observer les lois : Officium regentis exercitum non tantum in danda, sed etiam in observanda disciplina consistit, dit le jurisconsulte Macer[3]. Ils n'avaient plus d'amis, plus de parents, plus de fils : Disciplina castrorum antiquior fuit parentibus romanis, quam caritas liberorum ; et nous voyons qu'un général fit trancher la tête à son fils vainqueur parce qu'il avait combattu contre ses ordres[4]. Devant une telle autorité l'officier supérieur aussi bien que le simple soldat devait s'incliner sans résistance : l'obéissance passive était la première règle de la discipline, règle absolue à laquelle personne ne pouvait se soustraire. Lorsque Q. Fabius, malgré la défense qu'il avait de combattre, eut remporté sur les Samnites une victoire éclatante, le dictateur Papirius Cursor ordonna qu'il eût la tête tranchée, et, pour que la sentence ne fût pas exécutée, il fallut que le sénat et le peuple romain tout entier vinssent en suppliant demander au général irrité la grâce du vainqueur coupable[5]. Fabius cependant était maître de la cavalerie ; après le dictateur il était l'officier le plus puissant, le second personnage de toute l'armée ! Quelle obéissance, quelle soumission de tels exemples n'inspiraient-ils pas aux soldats ! Et devons-nous nous étonner encore de cette parole de Scipion qui, prêt à passer en Afrique, disait, en montrant avec confiance les troupes qui allaient affronter avec lui toute la puissance des Carthaginois : De tous ces soldats qui font l'exercice, il n'y en a pas un qui, à mon premier ordre, ne monte sur cette tour et ne se jette en bas la tête la première ![6] Cette confiance du général dans la soumission de ses soldats, cette obéissance aveugle des soldats et des officiers à leur général était une des forces de l'armée. Car, comme le dit très-bien le maréchal de Saxe dans ses Rêveries[7], si la police militaire n'est établie avec sagesse et exécutée avec une fermeté inébranlable, on ne saurait compter avoir des troupes : celles-ci ne sont plus qu'une vile populace, plus dangereuse à l'État que l'ennemi même. Il ne faut pas croire que, dans le soldat, la subordination et l'obéissance servile avilisse le courage : on a toujours vu que plus la discipline a été sévère, plus on a exécuté de grandes choses avec les armées où elle était établie. Un grand nombre de punitions étaient donc employées pour les fautes où tombaient les soldats romains. Nous commencerons par celles qui ne portaient que la honte pour passer ensuite aux peines corporelles et au dernier supplice. Voici d'abord, telle que l'indique le Digeste[8], la gradation des peines militaires appliquées aux délits qui ne rendaient pas passible d'une punition corporelle : castigatio, pecuniaria muleta, munerum indictio, militiæ mutatio, gradus dejectio, ignominiosa missio. La punition nommée castigatio était, avec la réprimande, une peine passagère, n'emportant ni amende ni surcroît de travail. Nous avons vu par exemple que les soldats qui ne profitaient pas suffisamment des leçons que leur donnaient, dans les exercices, les doctores armorum, recevaient de l'orge au lieu de blé pendant un certain temps. Quand ils montraient trop de paresse ou de poltronnerie, on leur ouvrait la veine pour leur tirer du sang. Montesquieu donne pour raison de cette punition singulière que, la force étant la principale qualité du soldat, c'était le dégrader que de l'affaiblir. D'autres fois, quand ils s'étaient mal comportés, on les notait comme lâches à la face de toute l'armée, et on les faisait camper hors des retranchements : ils restaient ainsi exposés aux attaques des ennemis et ils n'étaient délivrés de cette position honteuse qu'après avoir réparé leur faute[9]. On leur infligeait l'amende, pecuniaria mulcta, soit en les privant de leur part de butin, soit en ne leur donnant pas leur paye. C'est ainsi que Q. Cincinnatus priva de butin les soldats du consul Minutius qui s'étaient laissé envelopper par les ennemis, et qu'une légion qui avait laissé tuer en Ligurie le consul Pétilius fut privée de paye pendant six mois[10]. Cette punition se notait sur le rôle par ces mots resignatum æs, et le soldat qui la supportait s'appelait ære dirutus. L'amende par elle-même pouvait être considérée comme peu de chose, mais trois amendes méritées par le même homme entraînaient la peine capitale[11]. Une aggravation de travaux, munerurn indictio, était ordinairement infligée aux fuyards. On leur faisait remplir les corvées les plus lourdes, on leur faisait creuser des fossés profonds tout autour du camp, et, dans ces circonstances, on leur ordonnait de déposer leurs armes, comme s'ils n'étaient plus dignes de les porter[12]. Le changement de service, militiæ mutatio, était une punition plus grave que les précédentes, en ce sens qu'elle était permanente. Elle consistait à faire descendre le soldat à un service inférieur, les cavaliers au rang de fantassins, les fantassins légionnaires parmi les troupes légères. C'est ainsi que furent traités tous les prisonniers que Pyrrhus renvoya sans rançon au sénat[13]. On ne leur tenait plus compte de leurs services passés, et quelquefois même on ajoutait encore à cette punition en les privant de leurs enseignes ou en retenant leur paye. La dégradation, gradus dejectio, était pour les officiers ce qu'était le changement de service pour les soldats : de même qu'on faisait descendre le soldat à un service inférieur, on réduisait l'officier, par la dégradation, à un grade subalterne ou même au rang de simple soldat. Le plus grand exemple de dégradation que nous fournisse l'histoire est celle du consul Minutius, que son collègue Cincinnatus réduisit au grade de lieutenant : Minutius, lui dit-il, en attendant que vous ayez l'âme d'un consul, vous resterez à la tête de ces légions avec la qualité de lieutenant, donec consularem animum incipias habere, legatus his legionibus præeris[14]. Mais la dégradation la plus complète était le congé infamant, ignominiosa missio. Le général réunissait toute l'armée, et, en présence de tous, il prononçait la dégradation du coupable par cette simple formule : Tua opera jam non utar ; celui-ci sortait immédiatement des rangs, il quittait ses armes, son habit militaire et jusqu'à sa chaussure : il ne devait plus rien avoir du soldat. Plus tard, les généraux ajoutèrent à la formule primitive les motifs de la punition en reprochant au coupable toutes ses fautes. César nous raconte, dans ses Commentaires sur la guerre d'Afrique[15], comment il dégrada C. Aviénus, tribun militaire de la dixième légion, qui avait, à son départ de Sicile, rempli un vaisseau de ses provisions, de ses chevaux et de tout son train, sans y mettre un seul soldat. Étant monté sur son tribunal, après avoir assemblé les tribuns et les centurions de toutes les légions : J'aurais voulu, dit-il, que certains hommes missent fin à leurs désordres et à leur insolence, au lieu d'abuser de ma patience, de ma modération et de ma douceur. Mais puisqu'ils ne savent s'imposer aucun frein, je vais agir contre eux selon les lois militaires, afin que d'autres se gardent d'imiter leur conduite. C. Aviénus, tu as soulevé en Italie les soldats romains contre la République, et tu as exercé des rapines dans les villes municipales ; tu as été nuisible à l'État et à moi ; tu as rempli les vaisseaux de tes équipages, au lieu d'y mettre des soldats, et, grâce à toi, la République manque de soldats au moment nécessaire. Par ces motifs, je te chasse ignominieusement de mon armée, et t'ordonne de quitter aujourd'hui l'Afrique et de t'en éloigner au plus tôt. Après ces peines ignominieuses venaient les châtiments corporels, la bastonnade, fustuarium, les verges, la mort. Être battu de verges était regardé comme le traitement le plus humiliant et le plus indigne d'un citoyen romain : aussi le coupable qui l'avait mérité était-il quelquefois privé de la liberté et vendu publiquement comme esclave. Pour la bastonnade même, nous remarquons un fait singulier, c'est que le soldat se serait cru déshonoré s'il avait été battu avec un autre bois qu'un bois de vigne ; jamais on ne lui faisait cet affront. Le bâton n'était employé qu'avec les auxiliaires[16]. Quand un coupable allait subir le fustuarium, le tribun le frappait d'abord légèrement ; à ce signal, tous les soldats de sa légion s'élançaient sur lui pour le frapper, et le plus souvent, dit Polybe[17], il succombait au milieu du camp rassemblé. S'il parvenait à s'échapper (car il pouvait fuir), il ne se représentait plus dans son pays natal : aucun individu, pas même ses parents, n'aurait osé le recevoir. C'en était donc fait de ceux qui avaient eu le malheur d'être ainsi punis. Tel était cependant le supplice réservé aux officiers subalternes qui avaient montré quelque négligence dans le service des rondes, et, grâce à la rigueur de ce châtiment impitoyablement infligé, la surveillance nocturne était irréprochable. La bastonnade était encore réservée à quiconque volait dans le camp, ainsi qu'aux faux témoins, à ceux qui abusaient de leur corps, ou qui avaient été punis trois fois pour la même faute. Les Romains regardaient également comme une lâcheté et comme une honte pour un soldat de se vanter faussement auprès des tribuns d'un acte de courage pour obtenir quelque récompense, d'abandonner par peur le poste qu'on avait reçu, ou bien de jeter dans la mêlée une de ses armes. Aussi, par crainte du châtiment qui les attendait, la plupart des légionnaires s'exposaient à une mort certaine et ne craignaient pas de tenir tête à beaucoup d'ennemis plutôt que de quitter leur place. Quelques-uns, lorsqu'ils avaient lâché leur bouclier, leur épée ou quelque autre de leurs armes, s'élançaient au milieu des ennemis, soit pour recouvrer ce qu'ils avaient perdu, soit pour échapper par la mort à une inévitable honte et au mépris de leurs concitoyens. Les supplices capitaux s'infligeaient pour les manquements les plus notables à la discipline, pour tous les actes d'insubordination. Que ce fût une résistance violente d'un subordonné à son supérieur, ou une désobéissance inspirée par les motifs les plus louables, la punition était la même. Abandonner son général, déserter, vendre ses armes, entrer dans le camp pardessus les murailles étaient autant de crimes dignes de mort[18]. La mort se donnait de différentes manières. Les condamnés étaient accablés de pierres, lapidibus cooperiri, percés de coups d'épée[19], décapités, securi percuti[20], quelquefois crucifiés[21] et laissés sans sépulture[22], quelquefois même noyés ; c'était le supplice capital le plus terrible : on précipitait le condamné dans les eaux, et, afin de l'empêcher d'en sortir, on lui jetait sur le corps une claie chargée de pierres : c'est ce qu'on appelait sub crate necari[23]. Quand un certain nombre d'hommes s'étaient rendus
coupables d'un crime capital, soit en fuyant lâchement devant l'ennemi, soit
en résistant par une émeute à l'autorité des supérieurs, pour ne pas faire
mourir tous les coupables, les Romains avaient recours à un moyen également
efficace et terrible. Le général rassemblait l'armée et faisait comparaître
devant lui les lâches ou les révoltés qu'il accablait de reproches amers ;
puis, suivant la gravité de la faute, il les vigésimait ou les décimait,
c'est-à-dire les faisait tirer au sort, et chaque vingtième ou dixième, après
avoir été battu de la façon la plus cruelle, était décapité en présence de la
légion entière. Ceux que le sort n'avait pas désignés recevaient de l'orge au
lieu de froment et campaient en dehors des retranchements. Comme le danger et la crainte, dit Polybe[24], sont suspendus sur tous, les chances du sort étant
incertaines, et que tous subissent également l'affront de ne manger que de
l'orge, il résulte de cette coutume la punition la plus capable d'effrayer
les soldats et de les exciter à réparer leur faute. Quelquefois les
généraux ne croyaient pas nécessaire d'exécuter tous ceux que le sort avait
désignés, et se contentaient de faire un choix parmi eux, en n'en condamnant
qu'un sur cent, sur quatre cents et même cinq cents[25]. Car ce terrible tirage, dit Cicéron, n'avait été établi que pour ménager le sang des citoyens
sans laisser les crimes impunis : Statuerunt majores nostri, ut, si a multis
esset flagitium rei militaris admissum, sortitione in quosdam
animadverteretur, ut metus videlicet ad omnes, pœna ad paucos pertineret[26]. Telles étaient les punitions en usage dans l'armée pour maintenir la discipline. Le citoyen romain, si libre, si protégé dans ses foyers, se trouvait soumis, dès qu'il était enrôlé, à l'autorité la plus absolue ; quand il s'était rendu coupable d'une faute, sa vie et sa liberté étaient à la discrétion de ses officiers, qui pouvaient choisir et appliquer les peines comme ils voulaient. Mais si, par un tel régime, Rome savait inspirer la crainte aux lâches et aux méchants, elle avait pour les bons et les braves plus d'une récompense capable de leur faire affronter tous les périls : sa libéralité à récompenser la valeur couvrait la rigueur avec laquelle elle punissait la lâcheté. Lorsqu'un combat avait été livré et que quelques soldats s'y étaient signalés : le général assemblait la légion, et, appelant devant lui ceux qui s'étaient particulièrement distingués, il commençait par les féliciter de leur valeur, et rappelait, s'il y avait lieu, les belles actions qu'ils avaient précédemment accomplies. Ensuite, dit Polybe[27], il donnait une lance à celui qui avait blessé un ennemi ; à celui qui en avait renversé un et qui l'avait dépouillé, s'il était fantassin, une coupe, s'il était cavalier, un harnais. Autrefois la lance était la seule récompense, et on ne la méritait pas en tuant ou en blessant un ennemi dans une bataille ou dans un assaut, mais dans une escarmouche ou dans quelque action pareille, lorsqu'il n'y avait aucune nécessité de combattre corps à corps, et que l'on s'exposait volontairement pour montrer son courage. Plus tard, ces dons honorifiques furent plus variés : ce furent des colliers, des phalères, des hastes pures, des drapeaux, des bracelets, des cornicules. Les colliers étaient des ornements d'argent pour les Romains et d'or pour les auxiliaires : on les portait autour du cou. Rien n'est plus commun que de voir dans les inscriptions donatus torquibus, phaleris, etc., et, d'après ces monuments, il paraît qu'il y avait des colliers plus grands et plus honorables que les autres, torques major[28]. La phalère était une chatte d'or qui passait derrière le cou et tombait sur la poitrine : Phaleris hic pectora fulget, dit Silius Italicus[29]. La haste pure, hasta pura[30], était une lance sans fer, ressemblant au sceptre des dieux, et servait à récompenser une première action d'éclat. Les bracelets, armillæ, dans l'origine simple ornement militaire, avaient fini par devenir une distinction accordée aux braves : ils étaient d'argent et n'étaient donnés qu'aux légionnaires. Les drapeaux, vexilla, ne pouvaient être obtenus que par les officiers et les chevaliers : pour empêcher qu'ils ne fussent confondus avec ceux de la cohorte, ils étaient de couleurs différentes : écarlate et pourpre pour les hauts faits d'un combat sur terre, bleu de mer pour une action remarquable dans un combat naval. Les cornicules, cornicula, qu'on ne donnait aussi qu'aux cavaliers, étaient de longues aigrettes qu'ils attachaient sur le côté de leur casque. Ces récompenses, de même que la médaille militaire qu'on donne aujourd'hui à nos soldats, étaient souvent accompagnées de certains avantages pécuniaires, quelquefois de l'exemption des fonctions onéreuses. Les soldats qui en jouissaient se nommaient bénéficiaires, beneficiarii, et il y avait parmi eux plusieurs degrés, car nous lisons dans les inscriptions principalis beneficiarius tribuni[31]. Végèce, qui en parle, sépare tous ceux qui étaient exemptés des fonctions onéreuses en deux classes bien distinctes, les duplares et les simplares : duplares, ceux qui recevaient double ration de vivres et double paye ; simplares, ceux qui recevaient la ration ou la paye simple. Il parle même d'une classe intermédiaire de bénéficiaires, qu'on appelait sesquiplares, et qui recevaient une demi-ration, une demi-paye au-dessus de l'ordinaire. Une récompense qui n'était pas moins enviée était la promotion à un service ou à un grade supérieur. Car de même que le général pouvait punir un officier, en le dégradant, ou un soldat, en le faisant passer à un service inférieur, il pouvait aussi les récompenser en leur donnant de l'avancement dans la hiérarchie militaire. Nous avons vu que les centurions, les optiones, les signiferi, étaient choisis parmi les soldats les plus courageux de la légion. Mais de toutes les récompenses que pouvait mériter le courage, les plus grandes, les plus honorables étaient les couronnes. La corona castrensis ou vallaris était une couronne d'or donnée au soldat qui avait escaladé le premier les retranchements d'un camp ennemi et qui avait frayé un chemin pour y pénétrer. La corona muralis, couronne murale, ainsi appelée parce qu'elle était décorée des tourelles d'un rempart, était d'or également, et servait de récompense à celui qui escaladait le premier les murs d'une ville assiégée[32]. Une troisième espèce de couronne d'or, nommée corona classica, navalis ou rostrata, faite pour imiter les éperons des vaisseaux, était offerte à l'officier qui avait détruit une flotte, ou au matelot qui avait été le premier à l'abordage d'un navire[33]. Le soldat qui avait sauvé un citoyen romain, en tuant l'ennemi qui le pressait et en demeurant maître du champ de bataille, recevait la couronne civique, corona civica, composée seulement de quelques rameaux de chêne, mais la plus honorable de toutes. Elle portait pour inscription ces mots : Ob civem servatum, et celui dont la vie avait été sauvée la présentait lui-même à son libérateur, qu'il devait regarder dès lors comme un père[34]. Sous l'empire, ce fut le prince qui la décerna[35]. Le sauveur d'un citoyen recevait l'exemption de toutes les charges publiques, et ce privilège remontait à son père, qui était ainsi récompensé d'avoir produit un tel fils. Il portait sa couronne au théâtre, prenait place parmi les sénateurs, et ceux-ci se levaient par respect à son arrivée, ineunti etiam ab senatu assurgebatur[36]. Aussi le sénat, pour flatter Auguste, ordonna de suspendre, dans son vestibule, une couronne civique entre deux branches de laurier, avec cette inscription : Ob cives servatos, pour signifier qu'il était le libérateur de ses concitoyens et le vainqueur des ennemis de la République[37]. Cette couronne civique pouvait être méritée également par les généraux et par les soldats. Quelques autres récompenses n'étaient et ne pouvaient être accordées qu'aux généraux. Quand le général romain, par exemple, avait tué le général ennemi en combat singulier, les dépouilles du vaincu s'appelaient spolia opina ; on les suspendait dans le temple de Jupiter Férétrius, avec le nom du vainqueur. Pendant toute la durée de la république, ces sortes de dépouilles ne furent remportées que trois fois : par Romulus sur Acron, roi des Cæninenses[38] ; par Cornélius Cossus sur Tolumnius, roi de Véies[39], et par Claudius Marcellus sur Viridomarus, roi des Gaulois[40]. La couronne obsidionale était tout aussi rare, car pour la mériter il ne fallait rien moins qu'avoir sauvé une armée entière assiégée dans son camp et menacée d'une complète destruction. C'était une couronne faite d'une simple tresse d'un gazon vert arraché du lieu où les assiégés avaient été sauvés, et ceux-ci la décernaient eux-mêmes à leur libérateur[41]. Enfin, de tous les honneurs militaires qui pouvaient être rendus à un général vainqueur, le plus grand, le plus magnifique sans contredit, était celui du triomphe, triumphus. On l'accordait au général qui, dans une guerre légitime contre l'étranger, justo et hostili bello, et dans une seule action, avait tué cinq mille ennemis et reculé par cette victoire les limites de l'empire[42]. Le sénat tout entier allait recevoir les troupes à la porte de Rome et les conduisait dans la ville. Le cortège traversait le Velabrum, montait la Via Sacra et le Forum jusqu'au temple de Jupiter Capitolin. En tête étaient portés les dépouilles de l'ennemi, les noms des peuples vaincus et des villes soumises ; les captifs les plus distingués suivaient, enchaînés, avec leurs enfants et leurs serviteurs. Puis venaient les licteurs, dont les faisceaux étaient entourés de lauriers, des musiciens et des danseurs ornés de couronnes d'or, et des porteurs de parfums. Sur un char à quatre chevaux paraissait le triomphateur, le front ceint d'une couronne de laurier, accompagné de ses plus jeunes enfants ; et derrière lui tous les officiers supérieurs, à cheval, et le corps tout entier des légionnaires, portant des branches de laurier dans les mains et des guirlandes du même feuillage autour de la tête. Les rues étaient jonchées de fleurs, et dans une de ces rues était élevé un arc de triomphe, sous lequel défilait le cortège. Dans les premiers temps, on abattait cet arc aussitôt après la fête, mais plus tard on le remplaça par un monument permanent, en marbre ou en pierre, qui pût perpétuer dans l'avenir la gloire des siècles passés. |