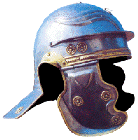DE LA MILICE ROMAINE
DEUXIÈME PARTIE. — DE L'ARMÉE MANŒUVRANT SUR TERRE
CHAPITRE V. — DE L'ARMÉE ATTAQUANT UNE VILLE.
|
Attaque d'emblée par escalade. — Siège régulier : lignes de circonvallation ; tranchées conduisant du camp au fossé de la place ; comblement du fossé ; machines d'approche ; machines de sape ; mines ; assaut, disposition et précautions des assiégeants. Si les Romains étaient presque invincibles dans les combats, ils ne se montraient pas inférieurs à eux-mêmes dans l'attaque des villes. Lorsqu'ils ne pouvaient s'emparer d'une place par surprise, ils essayaient quelquefois de la prendre par escalade. L'armée se divisait en trois lignes concentriques, à la portée du trait : la première se composait des troupes légères, la seconde des fantassins légionnaires, et la troisième de la cavalerie. Les trois lignes ainsi formées s'avançaient : les troupes légères nettoyaient le rempart à coups de traits ; les fantassins pesamment armés descendaient dans le fossé de la ville pour battre les murailles en brèche et poser les échelles ; la cavalerie attendait la fin du combat pour arrêter la fuite des vaincus. C'était là l'ordre le plus ordinaire ; quelques généraux cependant en employaient d'autres. Scipion, par exemple, escalada Oringe, en Espagne, d'une façon singulière qui mérite d'être rapportée. Il forma deux lignes autour des remparts, et divisa son armée en trois corps, dont l'un fut destiné à l'escalade, tandis que les deux autres se reposeraient. Lorsque le premier corps attaqua, le combat fut long et douteux, et l'on eut beaucoup de peine à porter les échelles auprès des murailles, à cause de la grande quantité de traits qui étaient lancés de tous côtés : ceux qui avaient planté leurs échelles et qui pensaient y monter en étaient aussitôt renversés avec des fourches que l'on avait faites exprès. Mais, lorsque Scipion eut remarqué que le petit nombre des siens permettait à l'ennemi une longue résistance, il fit revenir de l'assaut cette partie de l'armée qui avait attaqué la première, et y envoya les deux autres ensemble. Cela donna tant d'épouvante aux assiégés, qui étaient déjà las d'avoir combattu contre le premier corps, qu'ils abandonnèrent la muraille par une fuite inopinée. Il fallait, pour qu'une telle entreprise réussît, que le fossé de la ville fût sec et que les assiégés eussent été presque pris au dépourvu, sans avoir eu le temps de préparer toutes les machines nécessaires à leur défense. Aussi la prise d'une ville par escalade était-elle rare, et fallait-il presque toujours faire un siège régulier avant de tenter l'assaut. On commençait par enfermer la ville, que l'on voulait prendre, dans des lignes de circonvallation. Celles-ci étaient composées ordinairement d'un fossé et d'un parapet garni de tours de distance en distance ; et ces tours n'étaient point en bois : c'étaient des ouvrages en terre, plus élevés que le parapet, et qui lui servaient de protection. Les circonvallations avaient parfois une très-grande étendue, et exigeaient des travaux gigantesques. Pour montrer jusqu'à quel point les Romains en portèrent l'art, il nous suffira de rappeler celles de Scipion autour de Numance, et celles de César autour d'Alésia. Le circuit de Numance était de vingt-quatre stades : les deux lignes que Scipion fit élever devaient donc avoir plus de cinquante stades. Pour construire la première, il partagea d'abord le terrain à ses soldats, et les plaça sous la surveillance des principaux officiers, qui durent faire opérer les travaux de tous les côtés en même temps ; puis il établit des signaux de jour et de nuit pour être averti immédiatement des attaques et des sorties que pouvaient tenter les assiégés. Cette première ligne eut un rempart de huit pieds d'épaisseur sur dix de hauteur, garni d'une palissade et flanqué de tours de cent pas en cent pas. La seconde fut ensuite tracée de la même façon, et avec les mêmes précautions, à une certaine distance de la première. Mais, toutes deux se trouvant coupées par une espèce de marais, on fit une jetée sur laquelle on construisit un parapet d'une hauteur égale à celle du rempart ; puis, le Douro, qui coulait près de la ville, pouvant amener des secours ou des messages aux assiégés, au moyen de barques et de plongeurs, et étant trop large pour permettre d'y établir des ponts, on construisit quatre forts à l'endroit où la circonvallation aboutissait au fleuve, et l'on tira de l'un à l'autre bord une estacade de poutres flottantes, liées les unes aux autres, et garnies de longs pieux armés de pointes de fer. Quand les deux lignes furent ainsi tracées sans interruption, et que la ville eut perdu tout moyen de recevoir des secours, on dressa dans les tours et dans les forts des batteries de machines de guerre; les archers et les frondeurs s'y logèrent, et l'on établit des corps de garde et des sentinelles en très-grand nombre tout le long des lignes. Malgré l'étendue de ces dernières, Scipion prenait soin de les parcourir lui-même chaque jour et chaque nuit. Ces précautions prises, il partagea son armée : trente mille hommes furent destinés à la garde des retranchements, et vingt mille au siège ; dix mille furent mis en réserve. Nous comprenons facilement combien de telles dispositions demandaient de soins, de travail et d'habileté. Cependant les lignes de Numance ne sont pas comparables à celles d'Alésia. La position de César était bien plus difficile que celle de Scipion. Pour s'en rendre compte, il faut songer que la ville était perchée sur la crête d'une montagne ; qu'elle renfermait une garnison plus forte que l'armée romaine, et qu'elle attendait des secours considérables : de sorte qu'il s'agissait pour César de faire le siège d'une ville presque imprenable par sa position, étant lui-même exposé aux sorties des assiégés et aux agressions des ennemis du dehors. Voici comment, dans ces circonstances, il fit élever ses retranchements. Il fit d'abord creuser un fossé large de vingt pieds, dont les côtés furent à pic et la profondeur égale à la largeur. A quatre cents pieds en arrière de ce fossé, il établit le reste de ses travaux. Il laissait cette distance afin que les ennemis ne pussent point, pendant la nuit, attaquer à l'improviste ses ouvrages, ni lancer tous les jours une grêle de traits sur ses travailleurs; car on avait été obligé d'embrasser une si grande circonférence que les troupes romaines n'auraient pu aisément en garnir tous les pointa. Dans cet espace, César fit ouvrir deux fossés de quinze pieds de largeur sur autant de profondeur. Celui qui était intérieur, creusé dans la plaine et dans un terrain bas, fut rempli d'eau au moyen de rigoles faites à la rivière. Derrière ces fossés, il éleva une terrasse et un rempart de douze pieds de haut ; il y ajouta un parapet et des créneaux, et, à la jonction du parapet et du rempart, une palissade de longues pièces de bois fourchues pour en rendre l'abord difficile. Le tout était flanqué de tours distantes entre elles de quatre-vingts pieds. Il fallait à la fois aller chercher du bois, pourvoir aux vivres, travailler aux fortifications: ce qui diminuait les forces en les éloignant du camp. Souvent encore les Gaulois essayaient d'attaquer les ouvrages et faisaient de vives sorties par plusieurs portes. César jugea nécessaire d'ajouter quelque chose aux fortifications pour qu'une force moindre suffit à les défendre. On prit des troncs d'arbre dont on retrancha les branches ; on les dépouilla de leur écorce et on les aiguisa par le sommet. On creusa une longue tranchée de cinq pieds de profondeur où ces pieux furent plantés, les pointes en haut ; ils étaient attachés par le pied, de manière à ne pouvoir être arrachés. Il y en avait cinq rangs liés ensemble et entrelacés : quiconque s'y était engagé s'embarrassait dans leurs pointes aiguës. Les soldats leur donnèrent le nom de ceps. Au-devant étaient des puits de trois pieds de profondeur, disposés obliquement en quinconce, et qui se rétrécissaient peu à peu. On y faisait entrer des pieux ronds, de la grosseur de la cuisse, durcis au feu et aiguisés à l'extrémité ; ils ne sortaient de terre que de quatre doigts ; on les affermissait au pied en foulant fortement la terre ; le reste était recouvert de ronces et de broussailles, afin de cacher le piège. Il y avait huit rangs de cette espèce, séparés seulement par un intervalle de trois pieds : on les nommait des lis, à cause de leur ressemblance avec cette fleur. En avant encore étaient fichées des chausse-trapes d'un pied de long, armées de pointes de fer : on en mit partout et à de faibles distances : on les appelait des aiguillons. Ce travail fini, César fit tracer dans le terrain le plus uni qu'il put trouver, et dans un circuit de quatorze milles, une contrevallation du même genre, mais du côté opposé, contre les attaques du dehors, afin que, si la cavalerie envoyée par Vercingétorix ramenait avec elle de nombreux secours, la foule même des ennemis ne pût envelopper les retranchements. Puis, voulant épargner à ses soldats le danger de sortir du camp, il ordonna que chacun se pourvût de vivres et de fourrages pour trente jours. Une fois les lignes de circonvallation établies comme nous
venons de le voir, les Romains, pour passer de là au corps de la place
assiégée, faisaient usage des tranchées. Leurs galeries d'approche étaient
construites hors de terre par des blindages de fascines et de claies, formant
une espèce de muraille de cinq à six pieds d'élévation, à travers laquelle on
pratiquait des créneaux pour les archers : on les construisait plus solides
et plus élevées à mesure qu'on approchait des murailles et de la portée des
machines. Quelquefois même ces galeries étaient couvertes pour garantir les
soldats des traits lancés du haut des tours. Josèphe en parle dans la
description du siège de Jotapata : Les Juifs,
dit-il, ne laissaient pas de faire des sorties ;
après avoir arraché ce qui couvrait les travailleurs et les avoir contraints
de quitter la place, ils ruinaient les ouvrages et mettaient le feu aux
claies. Vespasien, ayant reconnu que ce qui restait de vide entre les
ouvertures de ces ouvrages donnait le moyen aux assiégés de les traverser, les
fit fermer de telle sorte qu'il n'y restait aucun intervalle. Polybe
en parle aussi clairement dans son neuvième livre, où il est question du siège
d'Égine : Depuis la galerie, dit-il, qui
était entre les deux tours, jusqu'au mur qui joignait celle de la ville, on
creusa deux tranchées où furent dressées trois batteries de balistes, dont
une jetait des pierres du poids de trente mines (90
kg.). Et, pour mettre à l'abri des traits des assiégés tant
ceux qui venaient de l'armée aux travaux que ceux qui retournaient des
travaux à l'armée, on conduisit des tranchées blindées depuis le camp
jusqu'aux tortues. Je crois que ces deux citations ne peuvent nous
laisser aucun doute sur la manière dont les Romains se servaient des
tranchées pour passer des lignes de circonvallation au fossé de la ville. Quand ils étaient arrivés à ce fossé, s'il était sec, ils faisaient une descente à travers les terres, parvenaient ainsi au pied de la contre-escarpe, l'ouvraient et construisaient une galerie couverte pour aller frapper le mur de la ville. Mais si le fossé n'était pas sec, il fallait le combler, afin de pouvoir ensuite poser sur le comblement les machines d'approche et de sape. Ils se servaient pour cela d'un appareil particulier nommé tortue de comblement. Vitruve nous en a donné la description. C'était une machine de douze pieds de haut ; la base en était carrée, et chaque face avait vingt-cinq pieds ; les côtés qui regardaient la ville étaient couverts d'une espèce de matelas piqué et composé de peaux crues entre lesquelles on mettait de l'herbe marine ou de la paille trempée dans du vinaigre. On avait soin de joindre plusieurs de ces appareils, très-près et sur une même ligne, pour donner plus de largeur au comblement et aussi pour donner un plus grand front à couvert aux troupes destinées à l'attaque ; car, à mesure que le comblement se faisait, on poussait les tortues vers la ville, et, quand elles étaient arrivées au pied des murs, on s'en servait pour les saper. Ainsi la tortue de comblement était en même temps un moyen d'approche. Outre cette machine, les Romains en employaient d'autres pour ménager la vie de leurs soldats : on les nommait vinea, pluteus, musculus. La vinea était un abri d'osier, en forme de voûte ou de berceau de vigne, long de seize pieds, large de huit et haut de sept[1]. Le pluteus était un appareil du même genre, mais mobile, et monté sur trois roues ; et le musculus se composait d'une longue et solide galerie en fortes charpentes. Tout cela était couvert, autant que possible, à l'épreuve des pierres et des traits lancés du haut de la ville[2]. Mais, de tous les moyens d'approche, le plus important et
le plus ingénieux était celui de la tour mobile. Végèce nous en donne la
description suivante : Les tours mobiles,
dit-il, sont faites d'un assemblage de poutres et de
forts madriers ; pour les garantir contre les dangers des feux lancés de la
ville, on les couvre de peaux crues. Leur hauteur se proportionne à leur
base, elles ont quelquefois trente pieds carrés et quelquefois quarante et
cinquante : elles sont si hautes qu'elles surpassent les murailles et même
les tours de pierres. Elles sont appuyées sur plusieurs roues selon les
règles de la mécanique, par le moyen desquelles on fait mouvoir la machine,
quelque grande qu'elle puisse être. La ville est en extrême danger si l'on
peut approcher la tour jusqu'à la muraille, car elle a plusieurs escaliers
pour monter d'un étage à l'autre, et chaque étage fournit différentes façons
d'attaquer. Au bas, il y a un bélier pour battre en brèche ; sur l'étage du
milieu un pont-levis composé de deux poutres qu'on abat sur le mur de la
ville, lorsqu'on en est à portée ; et sur les étages supérieurs il y a des
soldats armés de traits qui tirent continuellement sur les assiégés. Quand
les choses en sont là, la ville ne tient pas longtemps. Car quel espoir
reste-t-il à ceux qui avaient mis toute leur confiance dans la hauteur de
leur rempart, quand ils en voient tout à coup paraître un autre qui le domine
? Ainsi ces tours étaient de véritables forteresses et renfermaient
tout un système complet d'attaque : au moyen des machines qu'elles
renfermaient, on combattait de loin ou l'on sapait les murailles ; au moyen
du pont-levis on faisait irruption dans la place ; et cette irruption était
protégée par les soldats des étages supérieurs. Mais on comprend que de
pareilles machines devaient être construites hors de la portée de l'ennemi,
et qu'il fallait, pour les tramer jusqu'à la ville, beaucoup de précautions
et beaucoup de temps. C'était pendant ce temps qu'on faisait jouer toutes les machines de jet et de sape. Nous ne reviendrons pas sur les premières dont nous avons parlé précédemment, sur ces balistes et ces catapultes dont la puissance était souvent telle qu'elles pouvaient lancer à plus d'un mille des quartiers de pierre pesant depuis cent jusqu'à deux cent cinquante livres. Mais nous devons nous arrêter un moment à la description des béliers et des tortues, dont l'action ruinait les murailles pour y pratiquer une brèche. Là plus simple et la plus usitée de toutes ces machines de sape était le bélier suspendu. C'était une poutre d'une longueur et d'une grosseur prodigieuses, suspendue par de fortes chaînes au centre d'une charpente qui se composait de quatre poutres verticales assemblées entre elles par huit traverses, quatre en haut et quatre en bas. Cette poutre, ainsi suspendue horizontalement, était armée à l'extrémité d'une tête de bélier en fer fondu, et une cinquantaine de soldats, au moyen de cordages, la dirigeaient contre la muraille. Comme les vides de la charpente étaient remplis par des cuirs à l'abri du feu et des traits, les soldats qui manœuvraient à l'intérieur se trouvaient en sûreté : souvent même, pour les défendre encore mieux, on les environnait d'un parapet en terre. Le bélier suspendu, demandant une charpente d'une certaine hauteur, ne pouvait être facilement employé dans les tours, et de plus son mouvement oblique diminuait la force de ses coups. On en avait donc inventé un autre qui, au lieu d'être soutenu par des chaînes, glissait sur un système de roulettes : il frappait en ligne droite, et son effet, plus direct, était plus fort. De plus, il pouvait agir par un simple trou percé dans la machine, tandis que, pour donner un espace libre aux vibrations du bélier suspendu, il fallait laisser ouverts en grande partie le devant et le derrière de la charpente qui le soutenait. La tortue, qui ressemblait au bélier extérieurement, avait un mécanisme tout différent. Au lieu de frapper, elle tirait à elle et arrachait. C'était une poutre terminée par un énorme crampon de fer ; on l'élevait et on l'abaissait tour à tour, et la griffe de fer, en s'attachant aux pierres qu'avait déjà remuées le bélier, les enlevait complètement. Outre ces appareils de destruction qu'employaient les Romains pour ruiner les murailles de la ville assiégée, ils savaient aussi faire usage des mines. Nous voyons en effet cet usage établi dès le commencement de leur histoire militaire, et Tite-Live nous raconte comment Camille, après dix ans d'un siège qui avait épuisé tous les moyens connus, s'avisa de ce nouveau genre d'attaque contre la ville de Véies. De tous les ouvrages, dit Tite-Live, le plus long et le plus pénible était un souterrain que Camille faisait construire sous la citadelle des ennemis. Ne voulant pas d'interruption dans cet ouvrage, et craignant qu'un travail continuel sous terre n'épuisât les mêmes soldats, il partagea les travailleurs en six troupes qui se relevaient tour à tour de six heures en six heures, et qui ne s'arrêtèrent ni jour ni nuit avant de s'être ouvert un chemin vers la citadelle... Puis il attaqua la ville sur tous les points, afin de détourner l'attention des Véïens du danger dont le souterrain les menaçait... Ceux-ci, du haut de leurs remparts, s'étonnaient que les assiégeants qui, depuis si longtemps n'avaient pas bougé de leurs postes, se ruassent sans précaution, comme des insensés, vers les murailles... Mais le souterrain, plein de soldats, les vomit tout à coup tout armés dans le temple de Junon qui se trouvait dans la citadelle : une partie attaque par derrière les ennemis sur les murailles ; d'autres forcent les portes ; d'autres enfin mettent le feu aux maisons d'où les femmes et les enfants lançaient des tuiles et des pierres. Une clameur immense remplit toute la ville. En un moment les défenseurs sont précipités du haut des murs, les Romains s'élancent par les portes ouvertes, la ville est prise. Mais à cette méthode de surprendre les villes par des souterrains conduits jusqu'au milieu de la citadelle en succéda une autre, beaucoup moins pénible et beaucoup plus courte. On ouvrait la galerie, on la poussait sous le fossé jusqu'au pied des murs ; sous la muraille, on perçait une mine à droite et à gauche sur une étendue d'une centaine de pieds ; on soutenait avec de forts étançons la partie de murs minée, on enduisait les étançons de poix ou autre matière combustible, et l'on remplissait la mine de bois sec ou de fascines goudronnées ; on y mettait le feu, et, quand les étançons étaient brûlés, la muraille tombait nécessairement. César, dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, nous dit que les Gaulois s'entendaient parfaitement à ces sortes d'ouvrages : Ils les font, dit-il, avec d'autant plus d'adresse et d'industrie, qu'il y a beaucoup de mines de fer dans leur pays, et qu'ils sont fort experts dans cet art. Aussi pouvons-nous remarquer que César, dans cette guerre, se servit très-peu d'un moyen que ses ennemis connaissaient mieux que lui. Quand les Romains, par leurs béliers et leurs mines, avaient pratiqué une brèche dans les murs de la ville assiégée, ils essayaient de la prendre par assaut. La brèche devait toujours être assez large, car nous avons vu qu'ils avaient l'habitude de placer plusieurs béliers côte à côte. Ils pouvaient donc présenter dans l'assaut un nombre raisonnable de soldats sur la même ligne. Cela ne les empêchait pas de donner à leurs colonnes une grande profondeur, afin que les soldats blessés ou tués sur les premiers rangs fussent toujours et immédiatement remplacés par ceux qui venaient après eux. Cet ordre en colonnes profondes donnait à leurs soldats une vive impulsion, en les mettant dans l'absolue nécessité de combattre ou de mourir : car les derniers, ne craignant pas les coups, et étant animés par le bruit d'un combat où ils ne voyaient nul danger pour eux, poussaient ceux qui les précédaient, et, par l'effort de tous ces serre-files, il fallait que la tète enfonçât ce qui lui était opposé. Quant aux autres précautions dont usaient les assiégeants pour prendre une ville d'assaut, nous les trouvons dans le récit que fait Josèphe du siège de Jotapata : Le lendemain matin, dit-il, après que l'armée romaine se fut un peu délassée du travail d'une si horrible nuit, Vespasien donna ses ordres pour l'assaut ; il fit mettre pied à terre aux plus braves de sa cavalerie, pour donner en même temps par trois endroits et entrer les premiers lorsque les ponta seraient posés ; ils étaient suivis de la meilleure infanterie, et le reste de la cavalerie eut ordre d'occuper le tour des murailles pour ne laisser fuir aucun des assiégés après la prise de la place. Il disposa aussi tous ses archers, tous ses frondeurs et toutes ses machines pour tirer en même temps, et commanda de donner l'escalade aux endroits où les murs étaient encore en leur entier : il voulait affaiblir par cette diversion le nombre de ceux qui défendaient la brèche, et obliger, par cette grêle de flèches, de traits et de pierres, ceux qui y restaient à l'abandonner.... Aussitôt que les trompettes des légions eurent sonné la charge, toute cette grande armée jeta des cris militaires, et, le signal étant donné, on vit l'air s'obscurcir et retentir par un nombre incroyable de dards et de flèches.... Les Juifs montrèrent un courage remarquable.... mais ils avaient le désavantage de ne pouvoir être rafraîchis, tandis que le plus grand nombre des Romains faisait que de nouvelles troupes prenaient la place de celles qui étaient repoussées. Ainsi, s'exhortant les uns les autres, se pressant et se couvrant de leurs boucliers, ils formèrent comme un mur impénétrable, et, donnant tous ensemble, de même que si tout ce grand corps n'eût eu qu'une seule âme, ils repoussèrent les Juifs, qui mettaient déjà le pied sur la brèche. Nous voyons, d'après ce récit, que les généraux romains faisaient quelquefois mettre pied à terre à leurs cavaliers, qui servaient alors en qualité de fantassins d'élite. Nous pouvons aussi remarquer la précaution qu'ils prenaient souvent de présenter l'escalade en plusieurs endroits durant l'assaut, afin d'opérer une diversion parmi les assiégés. Pour l'escalade, les soldats s'avançaient ordinairement en formant la tortue. Ils se serraient les uns contre les autres en se couvrant de leurs boucliers : ceux du premier rang les portaient devant eux, ceux des flancs sur le côté exposé, et ceux du second rang joignaient les leurs à ceux du premier par-dessus leurs têtes, de sorte que tous ces boucliers, rangés les uns sur les autres, couvraient cette multitude d'hommes de la même manière que les écailles couvrent un poisson. Les troupes, ainsi rangées, s'approchaient des murs à l'abri des traits, et, quand il n'y avait pas de brèche et que le mur n'était pas trop élevé, cette première tortue servait de rampe à une seconde. Les derniers rangs mettaient genou en terre pour permettre à la seconde tortue de monter sur leurs boucliers : les soldats, dans le même ordre et couverts de la même manière, montaient sur les boucliers de la première tortue, qui, se relevant tout entière au commandement, élevait la seconde colonne jusqu'au mur : elle s'y élançait, et aidait ensuite à monter ceux qui l'avaient élevée[3]. Mais, quand le mur était trop haut et ne permettait pas ce moyen d'escalade, on établissait tout le long des espèces de grues, nommées tellenon[4]. Rien de plus simple que cette machine. On implantait non loin du mur un mat, au haut duquel était sur pivot une longue poutre transversale, pouvant s'élever et s'abaisser de tous côtés à volonté ; à l'une des extrémités de cette poutre on accrochait une grande caisse quadrangulaire et découverte, dans laquelle montaient quelques soldats : en pesant sur l'autre extrémité, et en faisant pivoter la poutre, on les transportait immédiatement au milieu même des assiégés. Quelquefois aussi on construisait un agger tout en charpente, qu'on élevait devant les murailles sur une longueur de plusieurs centaines de pieds et sur une largeur proportionnée : c'était une montagne factice, que les soldats pouvaient alors franchir en formant la tortue[5]. Tels étaient les différents moyens dont se servaient les Romains pour assiéger une ville et s'en emparer. Nous avons énuméré le plus brièvement possible tous les travaux qu'ils savaient opérer dans un siège régulier ; nous devons maintenant montrer quels étaient les moyens de défense que les assiégés avaient en leur pouvoir contre une attaque si puissante. |