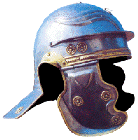DE LA MILICE ROMAINE
DEUXIÈME PARTIE. — DE L'ARMÉE MANŒUVRANT SUR TERRE
CHAPITRE II. — DE L'ARMÉE EN MARCHE.
|
Manière de décamper ; marche ordinaire ; marche en pays ennemi ; marche dans les montagnes ; passage des rivières. Quand le général avait résolu de décamper, castra movere, il faisait donner un premier signal pour faire détacher les tentes, réunir tous les bagages, colligere vasa, et, dès que les soldats avaient vu enlever les tentes de leurs tribuns, ils s'empressaient de plier les leurs : car il n'est permis, dit Polybe[1], de dresser ni d'enlever aucune tente avant celles des tribuns et du consul. Au second signal, on mettait les bagages sur les bêtes de somme, et l'on brûlait tout ce qu'on ne pouvait emporter ; au troisième, l'avant-garde partait et donnait le mouvement à toutes les troupes. Le transport du gros bagage, comme les tentes, les moulins, etc., ne se faisait pas au moyen de chariots, que les Romains trouvaient trop embarrassants[2], mais simplement par les bêtes de somme, jumenta sarcinaria[3] ; tout le reste était porté par les soldats eux-mêmes. Ils avaient avec eux des vivres, cibaria, pour quinze jours[4] et même pour plus de temps[5], des ustensiles, une scie, une corbeille, une bêche, une hache, un crochet avec une courroie de cuir, falx et lorum ad pabulandum, une chaîne, un pot[6], ordinairement trois et quatre pieux, quelquefois douze[7]. La totalité de cette charge montait à soixante livres, sans compter leurs armes, qu'ils ne regardaient pas comme un fardeau, mais comme une partie d'eux-mêmes, arma membra milites ducebant[8]. Avec ce poids, ils parcouraient vingt milles en un jour, quelquefois davantage[9], et ils ne trouvaient pas de telles marches trop pénibles, par suite des exercices nombreux qui leur en avaient fait prendre l'habitude. Même lorsque l'armée était en marche dans un pays où elle n'avait aucun ennemi à craindre, elle gardait un ordre parfait, et les soldats ne pouvaient s'éloigner de leur drapeau sans être punis de la façon la plus sévère. Le plus souvent c'étaient les extraordinaires qui formaient l'avant-garde ; puis venait l'aile droite des alliés, suivie des bagages de ces deux corps ; après l'aile droite marchait la première légion, ayant derrière elle ses bagages aussi ; puis la seconde légion, également suivie des siens et de ceux de l'aile gauche des alliés ; celle-ci formait l'arrière-garde. Mais chaque jour l'ordre des légions et des ailes était renouvelé, afin que, se succédant tour à tour au premier rang, tous les soldats fussent appelés à user les premiers de l'eau et des vivres qui se trouvaient sur le chemin. Quant à la cavalerie, tantôt elle suivait les différents corps auxquels elle était attachée, tantôt elle escortait les bêtes de somme pour les contenir. C'était là l'ordre de marche en temps ordinaire dans un pays où l'on n'avait rien à craindre ; mais quand on était dans le voisinage de l'ennemi, et qu'on pouvait à tout moment être attaqué, on apportait à cet ordre quelques changements rendus nécessaires par les circonstances. Lorsqu'on s'attendait, par exemple, à une affaire d'arrière-garde, les extraordinaires, au lieu d'être placés à la tête de l'armée, devant l'aile droite des alliés, passaient derrière l'aile gauche et fermaient la marche. Lorsqu'on était en danger dans un pays découvert, on suivait encore une autre ordonnance. Les chefs formaient, des hastats, des princes et des triaires, trois colonnes parallèles, et les faisaient marcher à une distance égale ; les manipules qui avaient les têtes de colonnes avaient devant eux leurs bagages ; ceux des princes suivaient les hastats ; ceux des triaires, les princes ; de sorte que les équipages et les manipules étaient rangés alternativement. Grâce à cet ordre, si quelque péril survenait, se tournant aussitôt soit à droite, soit à gauche, ils sortaient des équipages du côté où se présentait l'ennemi. Ainsi, en un moment, et par un seul mouvement, si ce n'est qu'il fallait quelquefois développer les hastats, l'armée se trouvait en position de combattre, et la multitude des bêtes de somme et de ceux qui les suivaient, à l'abri derrière le front de l'armée, n'avait rien à redouter[10]. C'était surtout dans les pays de montagnes qu'on prenait de grandes précautions lorsqu'on se sentait exposé à une attaque soudaine. Alors le général devait avoir un plan détaillé du pays, afin de connaître exactement la distance des lieux, la nature des chemins, les routes les plus courtes ou les plus détournées. D'habiles généraux, dit Végèce[11], ont poussé cette recherche au point d'avoir un plan figuré partie par partie, ce qui les mettait en état non-seulement de raisonner avec l'officier qu'ils détachaient sur la route qui devait être tenue, mais de la lui faire sentir au doigt et à l'œil. Le général interrogeait les principaux habitants du pays, et prenait soin de questionner chacun d'eux séparément, afin qu'en conciliant leurs rapports il pût s'assurer de la vérité. Il choisissait des guides qu'il faisait garder à vue, et qui devaient attendre une bonne récompense de leur fidélité ou un châtiment exemplaire de leur perfidie. Il envoyait en avant et de différents côtés des éclaireurs (speculatores) pris ordinairement parmi les cavaliers les plus expérimentés et les plus habiles ; puis il donnait le plus grand soin au bon ordre de ses troupes. Il se saisissait des hauteurs par des détachements d'élite, et, entre ces détachements, il faisait marcher serré tout le corps d'armée, en plaçant de distance en distance des officiers qui sussent contenir les uns et presser les autres. Cela est d'autant plus important, dit encore Végèce, qu'à la première attaque qui se fait en queue, ceux qui se sont portés trop en avant pensent ordinairement moins à rejoindre qu'à fuir, pendant que les traînards, se trouvant trop loin de la troupe pour en être secourus, perdent courage et se laissent tailler en pièces. C'est pour avoir oublié toutes ces précautions que le consul Flaminius se fit battre au lac Trasimène par l'habileté d'Annibal. Annibal, après plusieurs fausses marches et autres mouvements concertés, avait feint tout à coup de marcher du côté de Cortone et de Rome. Flaminius, malgré les ordres positifs du sénat qui lui défendaient de rien engager avant la jonction de son collègue, sans attendre les cinq mille chevaux que Servilius lui avait détachés pour renforcer sa cavalerie, et sans écouter d'autres conseils que celui d'un courage aveugle, s'élance plein de confiance à la poursuite de l'ennemi. Il arrive au lac Trasimène ; il voit un défilé, bordé d'un côté par les hauteurs et de l'autre par le lac : il s'y engage. Mais Annibal, informé que le consul le suit, revient sur ses pas ; depuis l'entrée jusqu'à la sortie du passage, il fait occuper les hauteurs par l'infanterie espagnole et africaine, et, dans cet ordre, il attend que l'imprudent Romain s'avance assez pour être accablé. Flaminius oublie toute prudence : il a commis une première faute en n'envoyant pas devant lui des cavaliers qui l'eussent averti des mouvements de l'ennemi ; il en commet une seconde en s'engageant dans le passage sans s'occuper des hauteurs qui le dominent. S'il avait envoyé des détachements sur le haut de la montagne, en leur ordonnant de marcher de front avec la colonne d'en bas, ils auraient pu l'avertir de l'embuscade, et même attaquer avec avantage les troupes embusquées, qui, se voyant découvertes et surprises, se seraient trouvées dans un grand danger, ou du moins dans un grand embarras. Au lieu de cela, il ne s'inquiète de rien, il marche droit devant lui : il croit poursuivre Annibal. Tout à coup, le flanc de la hauteur se couvre d'ennemis ; la sortie du défilé est fermée ; les soldats surpris sont à peine en état de se défendre ; il se voit vaincu et tué avant que d'avoir su à quoi se résoudre. Une grave imprudence dans la marche avait causé la ruine d'une armée ! Le passage des rivières et des fleuves dans le voisinage de l'ennemi n'étant pas moins dangereux que celui des montagnes, le général devait encore, dans ces circonstances, user de nouvelles précautions[12]. Si le courant était trop rapide ou le lit trop large, le bagage, les valets et les soldats faibles courant risque d'être submergés, on avait coutume, après avoir sondé le gué, de séparer la cavalerie en deux troupes, et de les porter, l'une en haut, l'autre en bas du courant, en laissant entre les deux un espace servant de passage à l'infanterie et au bagage ; la première rompait l'impétuosité du courant, pendant que l'autre arrêtait ou relevait ceux que les eaux emportaient ou renversaient. Les cavaliers les plus adroits faisaient des faisceaux de joncs et d'herbes sèches, sur lesquels ils attachaient les armes des fantassins, et les leur poussaient ainsi d'un bout à l'autre sans qu'elles fussent mouillées. On facilitait aussi le passage des rivières navigables en enfonçant dans l'eau des pieux sur lesquels on clouait des planches, ou, si l'on était pressé, en liant ensemble des tonneaux vides, couverts de soliveaux, sur lesquels marchait l'infanterie ; la cavalerie passait à la nage. Mais, lorsque la rivière était trop profonde, et que ni les fantassins ni les cavaliers ne pouvaient la passer à gué, pour peu qu'elle coulât sur un terrain aisé à couper, on la détournait par des fossés et des ruisseaux, et, en la diminuant dans son lit, on la rendait guéable. Plus tard, on trouva plus commode de transporter à la suite de l'armée de petites chaloupes faites d'un seul tronc d'arbre creusé et d'un bois fort léger, des planches, des cordes, des chevilles de fer, en un mot, dit Végèce, de quoi construire sur-le-champ une espèce de pont de bateaux, aussi solide qu'un pont de pierres. On y faisait d'abord passer quelques troupes d'élite qui, arrivées sur l'autre bord, élevaient une palissade capable d'arrêter l'ennemi en cas d'attaque. Puis, quand le passage était terminé, si le pont était jugé nécessaire soit pour revenir, soit pour faciliter les convois, on formait des deux côtés un retranchement et de larges fossés, où l'on postait une garde qui devait y rester tout le temps voulu. Nous trouvons, dans différents auteurs, la description des ponts de bateaux qui servaient au passage des rivières. Tacite en parle dans la guerre d'Othon contre Vitellius : Cæcina et Valens, dit-il, pour bannir l'oisiveté du camp, occupèrent leurs soldats à dresser un pont sur le Pô, feignant de le vouloir passer pour s'opposer aux gladiateurs. Ils rangèrent donc des bateaux à égale distance, joints ensemble par de grosses poutres, et arrêtés avec des ancres dont les cordages n'étaient pas trop tendus, pour n'être point rompus par l'effort de l'eau, si elle venait à grossir. Sur le dernier vaisseau, il y avait une tour pour repousser, à coups de traits et de machines, l'ennemi qui en avait une vis-à-vis pour les incommoder. Arrien donne plus de détails sur cette construction : On laisse aller, dit-il, un bateau dans le courant, non pas de droit fil, mais de travers, comme s'il était arrêté par la poupe ; et, de peur que l'eau ne l'emporte, ou le fait soutenir par une nacelle à force de rames, jusqu'à ce qu'il soit au lieu où l'on veut faire le pont ; alors, on jette en bas de la proue de grandes cages d'osier en forme de pyramides, pleines de grosses pierres qui l'arrêtent par leur pesanteur ; on tourne vis-à-vis de la proue celle d'un autre vaisseau, qu'on arrête de la même manière ; puis on jette d'une proue à l'autre deux pièces de bois s'attachant ensemble avec des ais au travers, en ne laissant entre les deux vaisseaux qu'autant de distance qu'il en faut pour faire que les pièces de bois n'aient pas trop de portée et ne soient pas rompues par ce qui doit passer dessus. On observe la même chose dans tous les vaisseaux que l'on joint à ceux-là pour achever l'ouvrage, à la tête duquel on attache, de part et d'autre, des degrés de bois : cela permet aux chariots et aux chevaux de descendre plus commodément, et rend en même temps plus ferme toute la structure du pont. Comme on conduit tous les vaisseaux en même temps à l'endroit où l'on veut faire l'ouvrage, il est achevé en peu d'heures, sans que le bruit et les cris des soldats empêchent de recevoir et d'exécuter les ordres très-promptement. Si les rivières par elles-mêmes sont déjà difficiles à passer, et si la crainte du voisinage de l'ennemi exige beaucoup de précautions, on comprend combien l'opération présente de difficulté quand l'ennemi est là, sur l'autre bord, en position de s'y opposer par la force. Aussi, voyons-nous que, dans de pareilles circonstances, les généraux romains les plus habiles joignirent souvent la ruse au courage. César nous fournit dans ses Commentaires deux fameux exemples qu'il n'est pas inopportun de rapporter ici. César mène une partie de son armée le long de l'Allier, cherchant à le passer. Vercingétorix, averti de sa marche, le côtoie à l'autre bord, ne perd pas de vue les ennemis, fait rompre tous les ponts et disperse sa cavalerie de tous côtés pour empêcher d'en construire d'autres. De cette façon, les deux armées marchent ensemble et campent tous les jours assez près l'une de l'autre. César voit bien qu'il ne peut forcer le passage, et cependant le temps presse ; l'Allier n'est guéable qu'en automne ; une campagne est perdue, s'il ne trouve un moyen de se transporter sur l'autre bord. Ce moyen, la ruse le lui fournira. Il va camper dans un endroit couvert de bois, vis-à-vis d'un des ponts rompus par Vercingétorix ; il choisit vingt cohortes parmi toutes ses légions indifféremment, afin que le nombre de ces dernières ne paraisse pas diminué, et s'embusque dans le bois avec ce corps. Il ordonne alors aux légions de continuer leur marche, avec tout le bagage, comme si elles étaient au complet, et de suivre ainsi la rivière le plus loin possible. Vercingétorix, qui croit toujours avoir toute l'armée en sa présence, côtoie les légions et marche aussi vite qu'elles. Pendant ce temps, César fait rétablir, sur les pieux qui restent encore, le pont récemment rompu, passe avec ses vingt cohortes, et se retranche immédiatement. Il fait revenir ensuite les légions et l'ennemi ne peut plus s'opposer à leur marche. Tandis que César opère ainsi le passage de l'Allier, son lieutenant, Labienus, d'un autre côté, opère celui de la Seine plus glorieusement encore. Labienus est dans la position la plus critique. Sur une rive, les Bellovaques approchent, l'autre est occupée par Camulogène et l'armée des Gaulois prêts à combattre ; de plus, un grand fleuve tient les légions séparées de leur refuge et de leurs bagages. Namque altera ex parte Bellovaci... instabant ; alteram Camulogenus parato atque instructo exercitu tenebat ; tum legiones a præsidio atque impedimentis interclusas maximum flumen distinebat. Des deux côtés, la bataille est imminente : seulement, s'il reste sur la rive droite, il va être attaqué, tandis que s'il passe sur la rive gauche, il prend l'offensive et se rapproche de ses campements. Il saisit donc ce dernier parti, et, comprenant qu'il n'a pas de temps à perdre, il l'exécute immédiatement. Le soir du même jour, il assemble les officiers et leur recommande de donner tous leurs soins à l'accomplissement de ses ordres. Il confie aux chevaliers romains le commandement des cinquante bateaux qu'il a amenés de Melodunum pour en former une flottille, leur dit de se mettre en route à la fin de la première veille, et de descendre le fleuve en silence jusqu'à une distance de quatre mille pas. Il laisse à la garde du camp cinq cohortes composées des soldats les moins solides, commande aux cinq antres cohortes de la même légion de partir à minuit, avec tous les bagages, pour marcher en amont du fleuve avec le plus grand bruit possible, et les fait accompagner d'un certain nombre de barques qui doivent être également dirigées avec bruit. Puis, dans le plus grand silence, il sort lui-même de son camp avec les trois autres légions, il va retrouver les cinquante bateaux qui l'attendent. Un violent orage, qui éclate tout à coup, favorise son dessein et empêche les éclaireurs gaulois de l'apercevoir : il les surprend avant qu'ils puissent donner l'alarme. Les chevaliers se mettent à l'œuvre et font passer les légions. Au point du jour, les Gaulois apprennent que l'armée romaine est en mouvement sur trois points : ils supposent aussitôt que leurs ennemis, démoralisés par la défection des Éduens, tentent le passage de la Seine par trois endroits différents pour fuir plus promptement, et ils divisent eux-mêmes toutes leurs troupes en trois corps. Ce n'est que plus tard qu'ils sont mieux informés, et alors ils se rangent en bataille pour s'avancer à la rencontre de Labienus. Mais celui-ci a atteint son but, il n'a plus à craindre les Bellovaques qu'il a laissés de l'autre côté du fleuve, il n'a plus devant lui qu'un seul ennemi qu'il saura vaincre. Nous nous arrêtons à ce dernier exemple, qui nous a paru d'autant plus intéressant qu'il se rapporte à cette première bataille de Paris, si étudiée de nos jours et commentée avec tant de science par M. de Saulcy et par M. Quicherat. Nous avons essayé de montrer les précautions, les moyens et les ruses qu'employaient les généraux romains dans les marches de leurs armées, en plaine, au milieu des montagnes, à travers les fleuves. Nous avons montré par différents exemples que ces marches, bien ou mal conduites, avaient pu produire le même résultat que de grandes batailles gagnées ou perdues. Nous passerons maintenant aux véritables combats, et, après avoir dit quelques mots sur les machines de jet dont on s'y servait quelquefois, nous indiquerons, d'après le récit des auteurs, l'ordre de bataille ordinairement suivi par les armées romaines. |