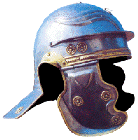DE LA MILICE ROMAINE
DU RÔLE HISTORIQUE DE LA MILICE ROMAINE.
|
I. Rome, fondée par la guerre, formée d'un peuple de soldats, doit combattre dès l'origine pour se soutenir et s'agrandir. Romulus, en créant la ville, crée la légion. Ce corps redoutable, composé de citoyens tous animés du même amour de la patrie, assez nombreux pour se soutenir seul sans être surchargé d'une multitude confuse et inutile, divisé en autant de parties qu'il lui en faut pour se prêter à toutes les circonstances, accoutumé à une prompte obéissance, endurci par les fatigues, dressé par les exercices à tous les travaux de la guerre, sera l'âme véritable des armées, l'âme de Rome même[1]. La légion et l'État, nés ensemble, auront même puissance, mêmes révolutions, même vieillesse. Durant cinq siècles les règles primitives sont maintenues : point de changement, point de réforme dans la discipline. Les villes voisines sont vaincues et soumises, la République étend sa main puissante autour d'elle et montre aux peuples étonnés, dans ses légionnaires et ses généraux, les plus beaux exemples de courage, de désintéressement et de vertus. Siècles heureux, où les soldats, dit Tite-Live, ne versent pas le sang de leurs frères et ne savent encore faire la guerre qu'aux étrangers : nondum erant tam fortes ad sanguinem civilem, nec præter externa noverant bella[2]. Le nom de soldat n'est pas alors un titre de rebut, abandonné aux dernières classes du peuple[3]. Pour mériter cette qualité honorable, il ne suffit pas d'être citoyen romain de naissance, il faut encore posséder une certaine fortune. L'usage des armes est réservé à cette classe d'hommes qui ont un patrimoine à défendre, et qui, participant à l'établissement des lois, trouvent leur intérêt comme leur devoir à les faire respecter. Citoyens dans le camp comme dans la ville, embrasés d'amour pour leur patrie et leur liberté, aussi soumis aux lois de l'État qu'aux ordres des généraux, aussi sobres, aussi laborieux dans le champ qu'ils labourent de leurs propres mains que dans les expéditions militaires, les Romains passent avec joie des travaux de l'agriculture à ceux de la guerre. Ils sont convaincus que leur intérêt est intimement lié à la conservation et à la prospérité du gouvernement libre auquel ils participent, et cette persuasion, qui est la source du patriotisme, rend leurs légions redoutables. Rome cependant rencontre des ennemis dignes d'elle. Les Véïens l'arrêtent longtemps sous leurs murs, les Gaulois viennent l'attaquer jusqu'au pied du Capitole, les Samnites et Pyrrhus remportent plus d'une victoire. Mais rien ne l'abat ; elle a dans son sénat un gardien fidèle de son honneur et de son indépendance ; elle refuse de racheter les captifs ; elle ne traite qu'avec un peuple vaincu. Pour observer pendant l'hiver les mouvements de ses puissants ennemis, pour les tenir en échec, garder ses places, conserver ses conquêtes, il lui faut bientôt des légions permanentes. Dans les commencements, comme on combattait presque à la vue de ses remparts, ses expéditions militaires n'étaient que des excursions de quatre ou cinq mois au plus, et tous les ans, au printemps, elle levait de nouvelles troupes qu'elle licenciait en automne. Dès que ses guerres s'étendent au loin, elle ne peut plus permettre à ses soldats de revenir à la fin de chaque campagne : elle laisse les citoyens sous les drapeaux des années entières, et ceux-ci ne pouvant plus cultiver leurs champs ni subvenir à leurs dépenses, elle est obligée de les entretenir elle-même. Elle les nourrit, elle les habille, elle les paye ; mais elle ne leur donne si généreusement tous les moyens de vivre que pour les mettre dans la nécessité de vaincre ou de mourir en combattant. L'Italie ne lui suffit plus. Non loin est une île, puissante en ressources, qui peut lui servir de grenier pour tout son peuple. L'empire des terres d'ailleurs ne peut être assuré que par celui des mers ; Carthage a toute la mer, et Rome, en passant dans la Sicile, y trouvera Carthage, luttera contre elle corps à corps. Ses légions, qui n'ont encore combattu que sur terre, sont donc obligées d'attaquer sur un élément inconnu un ennemi plus habile et plus expérimenté. Elle construit à la hâte des flottes immenses, elle invente de nouvelles armes : son premier combat naval est une victoire. Alors parait à la tête de l'armée carthaginoise le plus grand homme de guerre que Rome ait jamais combattu. Certain que sa patrie ne peut subsister que par la ruine des Romains, Annibal s'élance sur l'Espagne, s'empare de Sagonte, franchit les Pyrénées et les Alpes, soumet les peuples sur son passage ou les entraîne à sa suite. Trois fois les Romains s'opposent à sa marche, trois fois ils sont vaincus. Cinquante mille hommes périssent dans la seule bataille de Cannes, et les deux Scipions peu après sont défaits et tués en Espagne. Le sénat reste inébranlable. La République ne perd ni le courage ni la confiance : le jeune Scipion saura la venger en vengeant son père. Par lui les revers en Espagne sont promptement réparés, et les Carthaginois, attaqués à leur tour sur leur territoire, rappellent en Afrique cet Annibal, tant de fois vainqueur, qui, malgré son habileté, son courage et ses victoires, doit abandonner l'Italie. Rome est délivrée du plus redoutable de ses ennemis, et ses légions victorieuses lui donnent à Zama la domination de l'Afrique et l'empire des mers. N'ayant plus rien à craindre pour elle-même, elle entreprend sans péril d'autres conquêtes ; la victoire la suit partout : son peuple est le peuple-roi. C'est l'apogée de la gloire militaire des Romains. II. Mais du sein de leur prospérité même naissent tous leurs maux ; Rome donne des lois aux peuples, elle ne pourra bientôt plus maintenir les siennes. Avec les dépouilles des vaincus s'introduisent dans la ville le luxe, les passions et les vices, le désir insatiable des richesses, l'amour criminel d'un pouvoir sans frein et sans bornes. De grands hommes de guerre dirigent toujours les armées Marius bat Jugurtha, les Teutons et les Cimbres ; Sylla fait trembler la Grèce et l'Asie ; mais Marius et Sylla, violant toutes les lois par ambition, partagent les Romains en deux camps. Marius, savant général, introduit d'utiles changements dans la milice : l'ordre primitif des Hastats, des Princes, des Triaires est abandonné ; la cohorte devient la division importante de la légion. Mais, non moins ambitieux qu'habile, il prend pour soldats les derniers du peuple, ceux dont il est l'idole, à qui il doit son élévation, et qu'il croit propres à seconder ses vues : homini potentiam quærenti egentissimus quisque opportunissimus[4]. Sylla, patricien, mais aussi ambitieux que Marius, se met à la tête du parti contraire. Pour gagner ses soldats, il détruit leur discipline, les laisse s'enrichir dans la guerre contre Mithridate. Les légions n'appartiennent plus à la République, mais à leurs généraux : elles oublient le respect des lois et l'amour de la patrie. Alors éclate la guerre civile. Sylla, sous prétexte de défendre le sénat, Marius, au nom du peuple, portent les armes jusque dans Rome. Sylla triomphe : il remplit la ville de meurtres et de carnage, et pour récompenser ses troupes il leur distribue les terres des citoyens. Les colonies que Rome fondait auparavant, en déchargeant la ville d'un grand nombre de citoyens, servaient à garder les places principales, à accoutumer peu à peu les peuples étrangers à ses mesura. Sylla forme des colonies de ses partisans : il établit quarante-sept légions dans divers endroits de l'Italie qu'il occupe ainsi tout entière, et dès lors, dit Appien, ces gens-là, regardant leur fortune comme attachée à sa vie, veillent à sa sûreté, sont toujours prêts à le secourir ou à le venger[5]. Il se fait dictateur, et la République n'est plus. La liberté est perdue pour jamais ; car les généraux sauront désormais que le peuple romain peut souffrir un maître, et rien n'arrachera de leur cœur l'ambition de régner. C'est en vain que Sylla délaissé un pouvoir usurpé : d'autres, qui l'usurperont comme lui, voudront et sauront le garder. Les mauvais exemples ne manquent pas d'imitateurs. César, Antoine, Octave déchirent leur patrie, la noient dans le sang des citoyens. De ces guerres fratricides Octave sort vainqueur, avec le titre d'empereur et sous le nom d'Auguste. Ainsi, de Marius à Auguste, la milice romaine n'est plus ce qu'elle était aux premiers siècles. L'art militaire, il est vrai, a fait de grands progrès, et les campagnes de Gaule sont admirables : mais l'esprit de l'armée n'est plus celui de la République. Les soldats sont soumis à leurs généraux, mais ils ne sont plus attachés à la patrie, et la discipline intérieure des camps a déjà reçu quelque atteinte, les chefs s'attachant eux-mêmes à la ruiner pour corrompre et gagner leurs troupes. Les richesses des nations vaincues, en s'introduisant peu à peu dans la ville, ont préparé cette triste révolution. Si Marius et Sylla étaient nés au temps de Manlius, ils eussent été, comme Manlius, accablés dans les premiers mouvements qu'ils auraient faits[6] ; car alors tout le peuple se laissait conduire par l'intérêt et le bien de l'État, et point du tout par des considérations particulières. Mais à l'époque où tous ces ambitieux paraissent, les citoyens, corrompus déjà par l'excès ou le désir des richesses, sont plus attachés à leur propre fortune qu'à celle de la République : dès lors il est facile à un seul d'opprimer la liberté de tous, car un peuple qui n'est plus vertueux ne défend pas longtemps sa liberté. III. Auguste est à la tête de quarante légions composées de vétérans, passionnément dévouées à la maison de César dont elles ont déjà reçu et dont elles attendent encore des récompenses excessives. Les vrais républicains ont péri pour la plupart dans les proscriptions ou les armes à la main. Un grand nombre des plus nobles familles sont éteintes. Le sénat, humilié pendant les guerres civiles, n'a plus qu'une ombre de son ancienne dignité ; et le peuple, triomphant en secret de la chute de l'aristocratie, ne demande que du pain et des jeux. Auguste, d'une libéralité prudente et adroite, satisfait aux désirs du peuple ; puis, comme il doit beau coup aux soldats, il fait beaucoup pour eux. Il distribue des terres à ses partisans[7] ; il attache les légionnaires pour toujours au métier de la guerre en leur accordant des pensions de retraite qui assurent leur vieillesse ; il établit une caisse militaire et lève de nombreux impôts sur les citoyens pour entretenir cette caisse. Dès lors on est soldat par profession, par état. Le citoyen et le légionnaire étaient autrefois réunis dans le même homme, désormais la vie civile et la vie militaire sont deux choses tout à fait différentes. Ce grand changement opéré dans la milice romaine est
habilement expliqué par Dion dans les conseils qu'il fait donner à Auguste
par son ministre : Il me semble à propos, dit
Mécène à son maitre, d'entretenir dans chaque
province, selon le besoin des affaires, tantôt plus, tantôt moins de troupes,
composées de citoyens, de sujets et d'alliés ; que ces troupes ne quittent
pas les armes ; que les soldats soient attachés par état au métier de la
guerre ; qu'ils établissent leurs quartiers d'hiver dans les lieux les plus
commodes, et que le terme de leur service soit marqué à un âge qui leur
laisse encore quelque temps en-deçà de la vieillesse. Éloignés comme nous le
sommes des extrémités de l'Empire, et environnés de toutes parts de nations
ennemies, il ne serait plus temps de courir au secours quand la frontière
serait attaquée ; et si nous permettions de manier les armes à tous ceux qui
sont en âge de les porter, ce serait une source perpétuelle de divisions et
de guerres civiles. D'un autre côté, leur ôter les armes pour ne les leur
donner que dans le besoin, ce serait nous exposer à n'employer que des
soldats sans expérience et mal exercés. Mon avis est donc de ne laisser aux
citoyens en général ni armes, ni places fortes, mais de choisir les plus
robustes et ceux qui sont moins en état de subsister par eux-mêmes pour les
enrôler et les former aux exercices. Ceux-ci feront de meilleures troupes,
n'ayant d'autre métier que celui de la guerre, et les autres, vivant à
couvert sous cette garde perpétuelle, vaqueront plus tranquillement à
l'agriculture, au commerce et aux autres occupations de la paix, sans être
jamais obligés de quitter leurs professions pour courir à la frontière. La
partie vigoureuse, qui ne peut vivre qu'aux dépens des autres, subsistera
sans incommoder personne et servira de défense à tout le reste. Auguste, porté à la paix autant par sa situation que par son caractère, suit volontiers la politique de Mécène. Il croit qu'à l'excès de grandeur où Rome est parvenue, elle a désormais, en risquant le sort des combats, beaucoup plus à craindre qu'à espérer. Sans prétendre à l'honneur de nouvelles conquêtes, il vent défendre les anciennes et contenir la puissance romaine dans les bornes que la nature semble lui avoir tracées : à l'Occident, l'océan Atlantique ; le Rhin et le Danube au nord ; l'Euphrate à l'Orient ; et, vers le midi, les sables brûlants de l'Arabie et de l'Afrique. Un tel système de défense n'est pas inutile ; car les conquêtes de Pompée et de César, en reculant les limites de l'empire romain, l'ont mis en contact immédiat avec le puissant royaume des Parthes et les nations libres et guerrières de la Germanie. Pour tenir sous le joug tant de nations vaincues et prévenir les invasions de voisins redoutables, il faut multiplier le nombre des légions) accroître les forces de l'armée permanente. Mais cette armée ne peut se recruter que parmi les citoyens libres de dix-sept à soixante ans : le dernier cens, exécuté sous la République, en 683, n'en a donné que 450.000 ; et un autre dénombrement, opéré par César en 708, a constaté que le nombre des citoyens à accourir au premier signal pour étouffer les premiers mouvements d'une rébellion. Il se les attache tout à fait en leur accordant une double paye et des prérogatives supérieures à celles des autres troupes ; puis il leur donne deux chefs, pour que l'un serve à l'autre de surveillant, et il les prend dans l'ordre des chevaliers plutôt que dans le sénat, pour ne pas confier un commandement de cette importance à des personnes déjà puissantes par elles-mêmes. Mais ce qu'il semble prévoir et ce qu'il veut prévenir ne tardera pas à arriver. Les préfets du prétoire, peu considérés dans l'origine, deviendront bientôt les premiers officiers de l'empire, et se rendront redoutables aux empereurs. IV. Mécène, en conseillant à son maître de ne prendre pour soldats que les prolétaires incapables de subsister par eux-mêmes[8], a affaibli la légion en la déshonorant ; une multitude sans éducation comme sans moyens de subsistance ne vaut pas des hommes élevés dans un esprit d'obéissance aux lois et de patriotisme. On n'est pas longtemps à s'en apercevoir, et Tibère se plaint, dans Tacite, que les légionnaires n'ont plus le même-courage et n'observent plus la même discipline qu'autrefois, parce que ce ne sont plus que les misérables et les vagabonds qui s'enrôlent volontairement. Le soldat une fois enrôlé devant passer sa vie dans le métier de la guerre, l'armée, séparée du reste du peuple, forme une classe à part, dont l'humeur indocile et hautaine méprise tous ceux qui ne portent pas les armes. Les légions qu'on attache aux provinces frontières n'en sont plus retirées que très-rarement : c'est de sa province que chacune d'elles reçoit son nom, et ces diverses dénominations les accoutument à se regarder comme des corps tout à fait étrangers les uns aux autres. Les généraux enfin, soumis directement à l'autorité de l'empereur, ne peuvent plus montrer leurs talents et leur valeur sans s'attirer la jalousie ou la haine du maître. Leur devoir et leur intérêt les empêchent également d'aspirer à des victoires qui ne leur seraient peut-être pas moins fatales qu'aux nations vaincues. Germanicus, Suetonius Paulinus, Agricola sont arrêtés dans le cours de leurs succès ; Corbulon est mis à mort ; le mérite militaire, comme le dit très-bien Tacite dans son langage expressif, est désormais, dans toute la rigueur du terme, imperatoria virtus. Mais si les empereurs seuls ont le droit de vaincre les ennemis, les premiers Césars, tout occupés de l'exercice de la tyrannie, se montrent rarement à la tête des armées. Ils restent à Rome, flattant le peuple par des jeux, le sénat par des mensonges, leur garde par des largesses. Cette garde comprend bientôt sa puissance, et se rend maîtresse de l'empire. Dès le règne de Tibère, successeur d'Auguste, un ministre ambitieux obtient pour lui seul le commandement des dix cohortes prétoriennes. Il représente alors que la dispersion de ces troupes entraîne des désordres ; que leur réunion maintiendra mieux la discipline et permettra d'en tirer des secours plus efficaces dans les besoins pressants ; qu'elles recevront ses ordres toutes à la fois, et que la vue habituelle de leur force et de leur nombre, en leur inspirant à elles-mêmes plus de confiance, imprimera aux autres plus de terreur. Séjan, dont l'ambition ne craint pas d'aspirer à l'empire, voit ses projets démasqués et déjoués ; mais Tibère n'en garde pas moins les dix mille prétoriens réunis à Rome. A la mort de Caligula, successeur de Tibère, la division éclate entre le sénat et les soldats. La puissance des empereurs romains étant militaire dans son origine, les soldats veulent que l'État n'ait qu'un seul chef et que ce chef ne soit autre que le leur. Claude donne aux prétoriens cinq mille sesterces par tête, ils le proclament, et le sénat doit céder. Claude est ainsi le premier qui achète en quelque façon l'empire : exemple contagieux, qui sera porté plus tard aux excès les plus scandaleux et les plus funestes ! C'est au camp des prétoriens en effet que Néron se présente tout d'abord : il leur promet une gratification semblable à celle qu'ils ont obtenue de son père, et reçoit en échange le titre suprême qu'il demande. Après la conjuration de Subrius Flavius, de Sulpicius Asper et de Pison, c'est encore auprès d'eux qu'il se rend : il les loue de leur attachement, leur distribue vingt millions de sesterces. Il se montre toujours attentif à se concilier leur amitié : il leur accorde même une gratification perpétuelle, et veut qu'à l'avenir ils reçoivent leur blé de sa libéralité[9]. Cependant toutes ces largesses ne suffisent pas à lui assurer leur fidélité. Nymphidius, préfet du prétoire, leur promet au nom de Galba, s'ils abandonnent Néron, une récompense qui passe toute mesure : trente mille sesterces par tête pour les prétoriens, cinq mille pour les légionnaires répandus dans l'empire. A de telles paroles les prétoriens sont persuadés, ils abandonnent la garde du palais, se retirent dans leur camp et proclament Galba. Ainsi finit la famille des Césars. Jusque-là, quoique les armes fussent l'origine, la force et l'appui du gouvernement impérial, cependant une sorte de droit de succession a tempéré et limité le pouvoir des gens de guerre, en les empêchant de disposer de l'empire pleinement à leur gré. A la mort de Néron, se divulgue, dit Tacite, un mystère d'État : evulgato imperii arcano, ponte alibi principem quam Romæ fieri ; on sait que l'on peut faire un empereur ailleurs qu'à Rome, que la force décide seule de ce choix, et que les troupes en sont maîtresses absolues[10]. L'énorme largesse promise par Nymphidius achève de porter le mal à son comble. Les soldats ne donnent plus l'empire, ils apprennent à le vendre. Galba ne peut ni ne veut acquitter sa dette, et l'avidité des prétoriens frustrés se tourne vers Othon. Les légions des provinces prétendent n'avoir pas moins de droit qu'eux à donner un maître au monde : elles veulent toutes porter leurs chefs à la souveraine puissance. De là une suite de révolutions, de guerres intestines et d'événements tragiques qui font passer les empereurs sur la scène aussi rapidement que des rois de théâtre. Vitellius, vainqueur par ses légions, casse les dix cohortes de Rome qui lui sont hostiles : il les remplace par seize mille prétoriens nouveaux et tandis que les dix cohortes anciennes ont toujours été composées de soldats d'élite choisis dans les villes voisines de Rome, il forme les siennes d'un mélange confus de soldats des légions germaniques. Pendant ce temps les troupes d'Orient proclament Vespasien, qui ne manque pas d'appeler à son service les prétoriens cassés par Vitellius. Rome est prise, et tandis que les cohortes sont assiégées jusque dans, leur camp, les habitants de la ville, comme s'il ne s'agissait pour eux que de combats destinés à les divertir, favorisent par leurs cris et leurs applaudissements tantôt les légions d'Orient, tantôt celles de Germanie ! Les règnes de Vespasien, de Titus, de Trajan, d'Adrien, d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurèle rappellent pour un temps l'ordre si souvent troublé. Mais le vice radical subsiste. Les princes les mieux affermis sont toujours obligés de ménager leurs troupes. Celles-ci ont trop bien connu leur ascendant sur la puissance civile pour l'oublier jamais. Enfin elles prennent absolument le dessus, et, après Commode, les prétoriens disposent de l'empire en faveur de Pertinax. Pour eux Pertinax est trop vertueux. Après trois mois de règne ils le tuent ; et, ne mettant plus de bornes à leur criminelle avidité, insultant au malheur public, ils font monter sur les murs du prétoire ceux d'entré eux qui ont la voix la plus forte pour proclamer l'empire à vendre au plus offrant. Didius Julianus, après avoir marchandé longtemps, offre trente mille sesterces par tète : il l'emporte. C'est en vain que le peuple indigné s'oppose à sa marche, lorsqu'il sort du sénat : le fer lui ouvre un passage à travers la foule, il garde l'empire. Mais Sévère, commandant des légions d'Illyrie, en se déclarant le vengeur de Pertinax, se fait proclamer par ses troupes, marche aussitôt vers Rome et détruit sans peine la fortune encore chancelante de Didius. Une nouvelle fois les légions entrent victorieuses dans la ville. Sévère fait occuper le camp des prétoriens par ses troupes d'élite ; il leur reproche tous leurs crimes, le meurtre de Pertinax, la vente de l'empire, la lâcheté même avec laquelle ils ont abandonné leur empereur : il conclut qu'il n'est point de châtiment dont ils ne se soient rendus dignes par ces forfaits et les casse ignominieusement. Puis il choisit parmi ses troupes d'Illyrie les plus braves soldats dont il forme une nouvelle garde, quatre fois plus nombreuse que l'ancienne ; et, le camp de Rome ne suffisant plus, il en fait construire un second dans le voisinage. Aussi Caracalla, l'assassin de son propre frère, est-il obligé, pour s'attacher tant de gardes, de dissiper en un jour les richesses immenses amassées pendant un règne de dix-huit ans par les voies tyranniques de son père. Les soldats, munis d'un ordre, vont au trésor public se payer de leurs propres mains ; puis ils reviennent armés, proclament leur empereur, l'introduisent dans le sénat, et, pendant qu'il parle, se rangent sur deux files le long des bancs des sénateurs. Pauvre sénat ! Assemblée jadis honorée des princes et des peuples, devant laquelle s'inclinait le monde comme devant une assemblée de rois, qu'est devenue maintenant ton ancienne puissance, ta dignité d'autrefois ? Oubliant les vieilles maximes de la république, tu as apposé le sceau légal à l'ambition de tes premiers empereurs ; tu leur as permis d'introduire dans la ville une garde de soldats armés ; et maintenant tes maîtres sont devenus les esclaves d'une soldatesque effrénée : ce ne sont même plus leurs ordres, ce sont les piques prétoriennes qui dirigent tes conseils ! Triste résultat de la corruption des mœurs, des guerres civiles de Marius et de Sylla, de l'ambition de César, du pouvoir militaire constitué par Auguste, affermi par Tibère et ses successeurs ! V. Auguste, en garnissant les frontières de nombreuses légions, avait défendu l'empire contre les attaques du dehors ; mais, par la création de la garde prétorienne, il avait laissé le désordre dans l'intérieur. L'empire romain était comme un grand corps dont les pieds et les mains seraient armés, dont le cœur serait sans défense. Dès que ses ennemis occuperont ses frontières, Rome leur sera donc ouverte. Et cela doit arriver ; car, au milieu de tant de guerres intestines, la crainte et la majesté de son nom diminue de jour en jour ; les barbares ne la redoutent plus : ils l'attaquent de toutes parts. Déjà Caracalla, par un édit devenu nécessaire, a donné le droit de cité à tous les sujets de l'empire ; mais dans un nombre d'hommes si considérable on ne trouve plus assez de soldats. Claude Il ouvre aux barbares eux-mêmes l'entrée dans les légions : il y incorpore une foule de Goths. Probus, dix ans après, tire de la Germanie seize mille soldats qu'il distribue dans son armée. Ce mélange détruit toute discipline ; il n'y a plus d'ordre dans les camps ; on ne tient même plus le rôle des soldats. On n'a pas soin, dit Végèce, de mettre de nouveaux soldats à la place de ceux qui sont en congé, après le temps de leur service. On néglige de remplacer les morts, les déserteurs ; tout cela fait un si- grand vide dans les troupes, que, si l'on n'est pas attentif à les recruter tous les ans, ou même tous les mois, l'armée la plus nombreuse est bientôt épuisée... Si l'on veut encore, ajoute-t-il, remporter des victoires, il faut faire des vœux au ciel qu'il inspire à l'empereur de recruter les légions selon l'ancien usage. Vain souhait ! Vœux inutiles ! Les anciens usages sont perdus pour toujours : le nom de légion lui-même disparaîtra bientôt ; on ne pourra plus distinguer dans les camps les Romains des barbares. Le terme fatal de la puissance romaine est proche. C'est en vain que pour défendre les frontières les empereurs distribuent aux officiers et aux soldats les terres limitrophes des barbares[11] : les barbares obtiennent des terres. C'est en vain que, pour diminuer les luttes intestines, Dioclétien partage l'empire et divise les prétoriens en quatre grandes armées qui doivent s'intimider les unes les autres[12] ; par cette multitude d'empereurs et de césars[13], le corps de l'État est désuni, les guerres civiles se multiplient[14]. La puissance de Constantin qui, vainqueur de. Maxence, casse définitivement cette garde prétorienne si souvent souillée du sang de ses princes, n'arrête en rien la décadence rapide de l'empire. Constantin, comme les autres, reçoit les barbares dans ses troupes. L'unité de l'armée est détruite. Rome, qui n'a plus de milice, succombe sous le nombre de ses ennemis, laissant avec un grand nom un grand enseignement aux peuples futurs. |