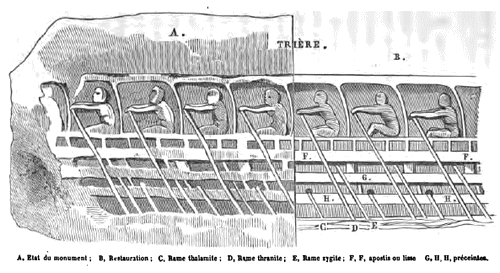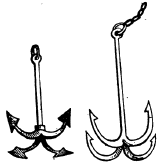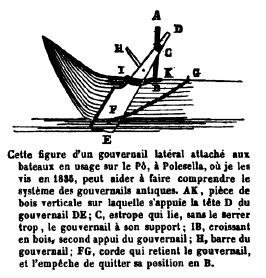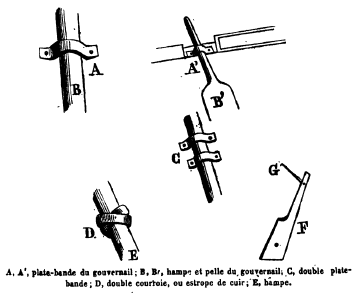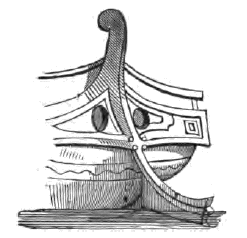ÉTUDES SUR LA MARINE ANTIQUE
PREMIÈRE ÉTUDE. — LA FLOTTE DE CÉSAR.
LA FLOTTE DE CÉSAR – HISTOIRE – LES NAVIRES – TACTIQUE – POST-SCRIPTUMPRÉFACE. L’Étude qu’on va lire est due au plus singulier, au plus propice des hasards. Je m’explique. Pendant les rares et courts loisirs que lui font la politique de l’Europe et le gouvernement de la France, l’Empereur recueille tous les éléments d’une histoire sérieuse de Jules César. Les détails nautiques, assez nombreux dans les Commentaires, ont naturellement attiré l’attention de Sa Majesté, et d’autant plus qu’ils ont été négligés par les historiens, comme par les traducteurs des Mémoires de César. L’Empereur a cherché à connaître les navires employés au sixième et au septième siècle de Rome, pour le transport des hommes, des chevaux, des machines et des vivres, et les vaisseaux armés pour la guerre. La construction de ceux-ci, qu’emportaient des rames nombreuses, rangées par groupes ou par étages, est restée jusqu’ici un problème, malgré tous les efforts de la critique. L’organisation des rames dans les navires antiques présente des difficultés assez mal comprises par les érudits et les gens du métier pour que, dans les traités nombreux où elles sont exposées, aucune solution n’y soit proposée qui puisse satisfaire un esprit raisonnable et pratique. L’Empereur résolut donc de reprendre une question toujours entière, et d’interroger lui-même les textes et les monuments dont l’érudition la plus sagace, la plus autorisée n’a su tirer que des hypothèses, ingénieuses peut-être, mais assurément inadmissibles, et, de fait, rejetées par tous les hommes qui ne sont point restés étrangers aux choses de l’art naval. Le 2 mai 1860, Sa Majesté fit au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale l’honneur de le visiter. Ce qu’elle y allait chercher surtout c’était ce que ce cabinet possède de pièces portant à leur revers des figures de vaisseaux. Le savant conservateur des médailles montra à l’Empereur les plus beaux morceaux de cette catégorie, ceux où les navires ont la meilleure apparence, et dont le bon état laisse le mieux lire dans le travail du graveur, avec les formes générales des bâtiments, le nombre et l’arrangement des rames. Sa Majesté fit un choix parmi ces pièces, puis demanda si quelque traits moderne pourrait lui offrir l’image de navires, empruntés aux marbres ou aux peintures antiques, et gaz-dés dans les musées de l’Italie. De fortune, M. Chabouillet avait auprès de lui mon Archéologie navale ; il en ouvrit le premier volume à l’auguste visiteur, qui y vit trois bâtiments à rames, — deux unirèmes et une trirème — gravés d’après une peinture de Pompéi, une mosaïque existant à Pouzzoles, et un bas-relief en marbre, classé parmi les monuments précieux que montre avec orgueil le musée Bourbon de Naples. L’Empereur daigna parcourir le livre que M. Chabouillet lui faisait connaître, et, recourant au titre de l’ouvrage où il lut un nom qui, certainement, n’avait jamais été prononcé devant Sa Majesté, s’informa de la qualité de l’écrivain qui portait ce nom. Sire, M. Jal a l’honneur d’être l’Historiographe de la marine impériale. — Ah ! et fermant le livre : Faites porter, je vous prie, ces deux volumes aux Tuileries ; je veux les lire. Je fus bien vite instruit de ce qui venait de se passer au Cabinet des médailles. Je pensai entrer dans les vues de Sa Majesté en lui offrant un livre où la marine antique occupe une plus grande place que dans l’Archéologie navale ; je me hâtai d’adresser à l’Empereur mon Glossaire nautique, en le suppliant d’en agréer l’hommage. Le 5 mai, je reçus la lettre que voici : Monsieur, L’Empereur a apprécié le mérite et l’utilité du Glossaire nautique dont vous êtes l’auteur, et que vous avez offert à Sa Majesté. Elle a accepté avec beaucoup de plaisir cet ouvrage, et elle me charge d’avoir l’honneur de vous adresser tous ses remerciements. Agréez, etc., Le secrétaire de l’Empereur, Chef du cabinet, MOCQUARD. Ce billet si gracieux me comblait. Je ne formais plus qu’un vœu : c’était que l’Empereur trouvât dans mes travaux quelques notions qui pussent lui être utiles. Il me semblait que cet incident heureux qui avait mis sous les yeux de Sa Majesté le résultat de mes longues études ne devait pas avoir d’autre suite ; il n’en fut cependant point ainsi. Le 6 mai, je reçus de M. le chambellan de service une lettre qui m’annonçait que Sa Majesté me recevrait le lendemain i, à trois heures. Je me rendis aux ordres de l’Empereur, ému, troublé, comme on peut le croire, mais bientôt rassuré par la grâce noble et charmante, par la bonté digne et familière avec laquelle Sa Majesté daignait m’accueillir. Après quelques mots trop indulgents sur des travaux dont elle voulut bien féliciter le patient auteur, Sa Majesté me dit en souriant : A mes moments perdus, je m’occupe de l’histoire de César. La marine romaine a sa part dans mes études préliminaires et je vous ai prié de venir pour me dire comment vous entendez la construction des galères antiques et les ordres différents des rames, agents de ces navires. — Je ne les entends pas du tout, Sire, répondis-je tout naturellement à l’Empereur, et j’ai presque honte de l’avouer à Votre Majesté ; mais c’est la vérité. Je me suis occupé beaucoup moins des marines antiques que de la marine du moyen âge, et je suis bien loin d’être fixé sur une question longtemps controversée et singulièrement obscure. Tout ce que j’en sais, c’est qu’aucun des systèmes proposés pour sa solution, depuis trois siècles, ne me paraît admissible. — Mais vous croyez à la superposition des rames en deux étages, et voici un texte cité dans ce volume, qui vous paraît ne pas laisser de doutes à cet égard. Et l’Empereur me montra un passage des Tactiques de Léon le Philosophe, qu’il avait marqué d’un signet de papier, dans le premier tome de mon Archéologie. J’entrai alors dans quelques détails techniques sur les navires à rames du moyen âge et des âges plus voisins du nôtre, insistant sur le fait de la tradition, que tout me démontre avoir été constante depuis les Phéniciens et les Grecs jusqu’au dix-huitième siècle, dans la construction des galères, au moins de celles qu’animait un seul rang de rames, de celles aussi qui, des temps antérieurs à la fondation de Rome jusqu’au dixième siècle de notre ère environ, obéissaient à l’impulsion de rames rangées en files sur deux étages. Sa Majesté me fit l’honneur de m’écouter avec une
attention que je craignis à la fin de lasser. Je m’inclinais respectueusement
pour prendre congé de l’Empereur, le remerciant de l’honneur inespéré qu’il
m’avait daigné faire de m’admettre en sa présence, lorsque Sa Majesté me dit
: J’ai envie de faire construire une trirème à
l’antique pour nous bien rendre compte du système mis en pratique par les
constructeurs grecs et romains. — C’est une
idée excellente, Sire ; le résultat peut être très utile, et, dans tous les
cas, l’essai ne peut manquer d’être intéressant. Au seizième siècle, à
Venise, Vittore Fausto fit une quinquérème qui brilla sur la lagune et fut
chantée par tous les poètes. C’était un navire à cinq rames par bancs et non
un vaisseau à l’antique, comme le Fausto l’avait pensé, comme le dirent le Bembo
et Venise tout entière. Mais Fausto avait bien fait de tenter son essai, qui
ne fut pas heureux et ne doit point décourager Votre Majesté[1]. Je quittai l’audience de l’Empereur, désolé et presque humilié de n’avoir pas eu une solution pratique à proposer à Sa Majesté, pour aider à la satisfaction du désir qu’elle m’avait fait l’honneur de manifester devant moi, de voir flotter bientôt un vaisseau long ayant trois rangées de rames actives. Je sentis que j’avais un devoir à remplir, et, convalescent à peine d’une longue maladie, fruit de pénibles labeurs, j’entrepris une tâche que je finis, le 6 juillet, à la campagne, pendant le temps d’un congé où rien ne put être donné au repos. Cette tâche était, difficile. Elle fut vraiment rude ; mais j’allai jusqu’au bout, sans découragement et assez vite pour que ma solution, si elle était admissible, pût trouver immédiatement une application pratique. Je savais, en effet, que Sa Majesté avait chargé M. Dupuy de Lôme, ingénieur dont la réputation est grande dans les marines européennes, et qui a construit d’excellents et de magnifiques navires[2], de lui proposer le plan d’une trirème faite à la manière antique. Je ne doutais point que l’habile constructeur ne trouvât un système à l’aide duquel un vaisseau long marcherait et évoluerait à merveille, tant à la voile qu’à la rame ; mais il pouvait se faire que l’archéologue eût connu des monuments écrits ou gravés qui auraient échappé aux recherches de l’ingénieur, et que, sous ce rapport-, son travail, qui s’était proposé pour résultat de donner tous les éléments constitutifs d’un vaisseau véritablement antique, c’est-à-dire d’un vaisseau fondé, si j’ose parler ainsi, sur les textes anciens, sur les médailles et les bas-reliefs grecs et latins, qu’une saine critique peut considérer comme véritablement historiques, que son travail, dis-je, ne fût point inutile à l’architecte naval chargé par l’Empereur de faire revivre les trirèmes contemporaines de César. J’eus l’honneur d’adresser mon manuscrit à Sa Majesté le 29 juillet 1860, et, le 2 août suivant, je reçus de M. Mocquard une lettre contenant un ordre de l’Empereur que Monsieur le chef du cabinet de Sa Majesté me signifiait en ces termes : L’Empereur, à qui je me suis empressé de remettre votre Mémoire sur les trirèmes des anciens, désire que vous communiquiez vos idées à M. Dupuy de Lôme, et que vous en confériez avec lui. Je lui en donne avis. Sa Majesté fut obéie tout de suite. Nous eûmes, le 4 août, M. Dupuy de Lôme et moi, une longue conférence sur la construction des navires à rames de l’antiquité. M. Dupuy de Lôme ne connaissait encore de mon système que ce que lui en avait dit un ingénieur de mes amis à qui j’avais demandé des conseils pour la réalisation pratique de mes idées, et qui avait bien voulu m’aider à les formuler ; car il y avait là un travail d’ingénieur qui n’était pas de ma compétence et que je n’avais abordé qu’avec une juste défiance de mes forces. L’Empereur avait communiqué, la veille, à M. Dupuy mon travail, que celui-ci n’avait pu lire encore, mais qu’il me promit de lire bientôt. Je vis deux projets étudiés ; M. Dupuy de Lôme poursuivait l’exécution de l’un d’eux, Sa Majesté l’ayant approuvé. Dans ce projet, l’ingénieur plaçait sur un pont, et à ciel ouvert, ses trois rangs, de rameurs. L’autre, enfermant les rameurs de l’étage inférieur dans un entrepont, établissait sur le pont de la trirème les deux rangs supérieurs de rames. Celui-ci, inspiré par mon système, dont les principales données, ainsi que je viens de le rapporter, avaient été connues de M. Dupuy de Lôme, qui me le dit lui-même comme pour me l’apprendre si je l’avais ignoré ; celui-ci se trouvait ainsi tout naturellement écarté, le constructeur de la future trirème n’ayant pour l’appuyer aucun des testes sur lesquels j’avais édifié mon hypothèse, et qui étaient pour moi d’un prix inestimable. Il n’eus pas de peine à lui faire comprendre que son projet, qui promettait d’ailleurs un navire riche de bonnes qualités, élégant dans sa forme et propre à une marche rapide, aurait contre lui la critique des archéologues, qui n’y trouveraient point appliquées certaines règles ressortant de quelques textes dont il fallait absolument tenir compte. En homme supérieur, M. Dupuy de Lôme fit bien vite -le sacrifice de ses vues, et me demanda d’ailleurs le temps de se convaincre en étudiant les preuves que j’apportais, dans mon Mémoire, à l’appui de ma solution ; puis le 10 août il m’écrivit un billet que l’on me permettra de citer ici : Monsieur, J’ai achevé hier soir la lecture attentive de votre Mémoire sur les navires à rames des anciens. Déjà, à la suite de notre première conversation sur ce sujet, j’étais décidé à adopter, pour la trirème que l’Empereur veut faire construire, la solution d’un pont couvrant le rang inférieur des avirons. J’ai donc donné tout de suite — des ordres pour l’adoption de celui des deux plans que je vous ai montrés, qui était conforme à cette solution que vous préconisez comme la plus justifiée par les- textes. Ce que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, depuis, sur la rentrée me paraît aussi fort bien établi. Je n’ai donc plus aucun doute sur la convenance d’adopter, comme plus conforme aux textes, la trirème avec un pont couvert et saris rentrée sensible. Je suis heureux, Monsieur, de cette circonstance qui m’a procuré le plaisir véritable de vous entendre discuter ces questions avec l’autorité que vous avez si justement acquise. Recevez, Monsieur, etc. DUPUY DE LÔME. Cette lettre si loyale et si courtoise me fit un grand plaisir, moins parce qu’implicitement elle reconnaissait ce que je pouvais avoir de légitime prétention à la propriété d’une idée déclarée applicable — et appliquée en effet aujourd’hui, que parce qu’elle me confirmait dans la persuasion où j’étais, que j’avais eu le bonheur de trouver une solution pratique à une difficulté depuis bien longtemps envisagée par un grand nombre de savants critiques et de constructeurs habiles, et jamais résolue. Je demande pardon au lecteur de me montrer moins modeste qu’il ne me conviendrait sans doute de le paraître ; mais qu’il veuille bien se mettre un moment à la place d’un homme de lettres sans renommée, à qui arrive l’heur si grand de trouver le mot d’une énigme que tant d’érudits, justement honorés pour leur savoir, la hauteur de leur intelligence, la finesse de leur esprit, cherchèrent en vain depuis la renaissance, et peut-être sera-t-il indulgent pour la faiblesse vaniteuse dont je viens de me rendre coupable. Je revis bientôt M. Dupuy de Lôme ; je le remerciai de ce qu’il m’avait fait la grâce de m’écrire, et me mis complètement à sa disposition pour l’avenir. Je lui parlai d’une foule de détails qui pouvaient contribuer à donner à sa trirème la, physionomie antique dont il était si essentiel de la décorer, la critique des antiquaires devant, sans doute, quand cette trirème flotterait, s’exercer sur la poupe, sur la proue, sur le côté, sur tout enfin. Il fallait, à mon avis, ne rien négliger pour faire revivre complètement les navires des anciens, dans l’échantillon que l’Empereur voulait en donner aux savants de l’Europe. M. Dupuy de Lôme fut tout à fait de cet avis et me pria de communiquer à M. Mangin, ingénieur chargé de suivre la construction de la galère qui allait s’édifier au chantier d’Asnières, tout ce que je pourrais réunir d’informations pour l’œuvre principale, aussi bien que pour la décoration extérieure et intérieure du navire, dont le plan définitif allait être arrêté. Je ne manquai pas de me conformer aux intentions de M. Dupuy de Lôme. J’eus avec M. Mangin une conversation- à l’issue de laquelle je rédigeai un petit mémoire où je réunis toutes les notions dont je supposais que l’acquisition pouvait n’être pas indifférente à cet ingénieur. Le 15 septembre 1860, je reçus de lui le billet suivant : Monsieur ; La lettre que vous avez bien voulu prendre la peine de m’écrire contient des renseignements pleins d’intérêt et qui me seront d’une grande utilité. Je les considère comme mon vade mecum pour les détails de la construction dont je suis chargé, et je vous prie de vouloir bien agréer mes sincères remercîments. Monsieur votre fils a eu l’extrême obligeance de m’apporter un spécimen de décoration pour la maîtresse partie du navire ; il s’y révèle un goût parfait et une grande habileté de dessinateur. Mais il est encore bien- tôt pour songer à ces détails ; d’ailleurs j’ai besoin de prendre à ce sujet les ordres de M. le directeur du matériel (M. Dupuy de Lôme). Les formes générales sont arrêtées, et c’est déjà un grand point, car nous allons maintenant fais e marcher la construction rapidement. Agréez, etc. AM. MANGIN. Le point de départ que je crois vrai une fois admis, le système adopté dans ce qu’il a d’essentiel, à savoir l’emplacement des rameurs du rang inférieur, on peut faire dix plans de trirèmes se ressemblant beaucoup, et ne différant l’une de l’autre que par les détails de longueur, de largeur et de creux. M. Dupuy de Lômé a eu d’excellentes raisons pour construire une galère à trois rangs de rames d’une petit6taille : d’abord, le navire qu’il avait à faire étant exécuté à titre d’essai, il importait d’en réduire les dimensions ; la trirème devant d’ailleurs naviguer sur les eaux de Paris, il fallait n’en pas exagérer la longueur pour qu’elle pût évoluer sans difficulté ; enfin, au risque d’avoir une couverte un peu étroite pour l’emplacement des rames supérieures et le passage nécessaire au service du navire, entre les deux rangs des rameurs maniant les plus longs avirons, il fallait rétrécir la galère, afin qu’elle pût aisément passer sous tous les ponts, d’Asnières à l’Institut. M. Dupuy s’est donc décidé à donner à son bâtiment :
Il a muni sa trirème de 130, rames et a taillé aux rameurs thranites des avirons longs de 7 mètres 20 centimètres environ. Désireux de créer un navire bon marcheur, — on verra dans mon projet, que cette pensée ne m’a point préoccupé, et que je me suis contenté de supposer ma trirème ne marchant pas mieux que les galères unirèmes du moyen âge et du dix-septième siècle, — M. Dupuy de Lôme a voulu que son bâtiment eût des façons fines ; il n’en est que plus élégant. Ma trirème serait un peu plus largement assise sur l’eau, moins gracieuse, par conséquent ; mais je n’ai connu aucun monument qui m’autorisât à prêter aux vaisseaux longs antiques les façons étroites qu’avaient à l’arrière les galères contemporaines de Louis XIV, dont M. Dupuy de Lôme s’est rapproché. Au moment où j’écris, la construction de la trirème commandée par l’Empereur n’est pas encore bien avancée ; mais ce qui de sa membrure est déjà monté fait connaître que ce vaisseau long sera d’tine belle apparence. Tout porte à croire que ce sera un bon navire, et que M. Dupuy de Lôme aura réussi à produire un curieux, noble et complet modèle des vaisseaux antiques faits pour la guerre. Voilà connus du lecteur l’histoire du petit ouvrage que je-place sous ses yeux, et le premier chapitre de celle de la trirème faite par M. Dupuy de Lôme, deux œuvres qui ont d’intimes rapports. Lorsque, pour rendre compte à Sa Majesté de ce que j’avais fait, en exécution de ses ordres, qu’elle m’avait fait connaître le 2 août, j’eus l’honneur de lui écrire le 29 septembre 1860, je disais : Je suis heureux, Sire, de voir le
système que m’a suggéré une étude laborieuse, patiente et faite avec l’ardeur
que j’ai toujours apportée à mes travaux sérieux, approuvé par un des maîtres
de son art, et mis en pratiqué dans la construction de la trirème qui
s’édifie pour Votre Majesté. C’est une bonne fortuné bien grande pour un humble
archéologue d’assister à la réalisation matérielle de ses idées ; cette bonne
fortune, ce sera ma gloire de la devoir à l’Empereur, dont un désir m’à fait
surmonter des obstacles qu’on pouvait croire invincibles. Je tremblais
d’échouer dans ma tentative ; aujourd’hui je crois avoir réussi à faire faire
un pas à la question de la restitution des navires antiques, sinon à avoir
résolu tous les problèmes qui s’y rattachent. Sans Votre Majesté, je n’aurais
pas osé entreprendre une tâche qui longtemps avait effrayé ma faiblesse ;
l’Empereur a paru souhaiter que je fisse un effort, je le remercie très humblement
de m’avoir laissé deviner une pensée qui m’a soutenu et inspiré dans
l’exécution d’un travail, le dernier sans doute de son espèce que mon âge et
surtout ma santé me permettront de faire. Sa Majesté a pensé que la publication de mon Étude sur, la marine contemporaine de Jules César ne serait pas sans utilité pour les marins, les érudits, les traducteurs des historiens et des poètes anciens, les professeurs des lycées et leurs élèves. Elle a trouvé juste qu’au moment où, la trirème de M. Dupuy de Lôme étant mise à l’eau, une discussion naîtra probablement entre les antiquaires français et étrangers sur le système qui a prévalu dans sa construction, je ne perdisse pas mes droits à la priorité de l’idée, et que j’acceptasse en conséquence la plus grande part dans les critiques qu’il pourra soulever. Elle a donc bien voulu permettre qu’un Mémoire, fait seulement pour elle, fût imprimé et livré au public. L’Empereur a daigné faire plus encore : il a ordonné que l’édition en fût donnée à ses frais. Je ne saurais dire combien je suis profondément reconnaissant et touché de cette marque de haute protection, accordée par Sa Majesté à des essais, bien peu dignes assurément d’une telle faveur, et dont le sujet qu’ils ont pour but de faire connaître constitue seul l’intérêt. Paris, 30 octobre 1860. LA FLOTTE DE CÉSAR. De quels éléments était composée la flotte de César ? Quelle importance, quelle forme, quelle organisation avaient les navires dont se servit ce grand homme pour le transport de ses troupes ; pour ses voyages et pour ses luttes sur mer contre les Armoricains, puis contre son antagoniste Pompée ? A la première de ces questions, la réponse est facile ; elle l’est moins à la seconde. Longtemps, pour ma part, j’ai cru sans solution possible le problème qui a occupé sérieusement, depuis le seizième siècle, des savants très distingués, mais par malheur ignorants des choses de la marine ; des marins très habiles, mais qui n’ont pu donner à l’érudition aucun moment de leur vie, remplie par les obligations de leur métier. Je n’avais guère eu le temps de m’appliquer à une étude, très intéressante sans doute, mais hérissée de difficultés. Mère de la marine moderne, la mariné du moyen âge avait réclamé mes premiers soins ; et, bien malgré moi assurément, j’avais dû ajourner, sans terme prévu, l’époque où je pourrais m’occuper de la marine antique, aïeule de la marine actuelle, qui, plus qu’on ne le croit, ressemble à sa grand’ mère, et à ce point même qu’il est impossible de méconnaître leur étroite parenté, quand on regarde attentivement l’une et l’autre. D’autres travaux m’avaient éloigné de la voie où ma destinée semblait être de n’entrer jamais, tant les obstacles s’étaient multipliés autour de mon désir : une circonstance bien heureuse pour moi, un hasard singulier qui m’a valu le plus grand honneur que pût ambitionner un homme de lettres obscur, une bonne fortune inespérée, enfin, m’y ramène et m’impose, — douce, contrainte, — le devoir de chercher à deviner l’énigme posée devant la science depuis plus de mille ans, par quelques mots incompris jusqu’ici. Sans préambule, marchons droit au but, que j’entrevois. Qui, mieux que César lui-même, pourrait nous parler de la flotte de César ? Suivons donc pas à pas l’auteur des Commentaires ; écoutons ses récits ; rendons-nous compte des faits qu’il rappelle, sans se préoccuper des détails qu’il connaissait parfaitement, et que connaissaient aussi ses contemporains, pour qui il écrivait ; expliquons certaines choses qui ont besoin d’être analysées pour être suffisamment entendues ; corrigeons les versions inexactes des traducteurs qui mentent au texte de César dans le plus grand nombre des passages où il est question de la navigation et des vaisseaux ; et notons en passant les noms des navires que mentionne l’historien. Ce premier travail rapidement fait, venons à un autre plus ardu. Celui-ci veut une marche lente pour être sûre ; il appelle une critique clairvoyante, minutieuse, sévère des textes et des images qu’ont allégués les savants ; il me conduit à un essai de restitution des navires romains propres à la guerre, restitution que je tâcherai d’élever au-dessus de la condition douteuse de l’hypothèse, en la faisant pratique autant qu’il sera en moi d’y parvenir. Ainsi, deux parties dans cette Etude : L’HISTOIRE et LES NAVIRES. L’HISTOIRE. § I.César est en Illyrie ; un message de Crassus lui arrive : les Vénètes retiennent Silius et Vélanius qui sont allés demander des vivres pour l’armée romaine à ce peuple, fier de sa position derrière une mer dangereuse, fier de ses vaisseaux, les meilleurs de cet océan, fort de ses alliances avec les petites nations voisines qui le défendent du côté de la terre. César conçoit le dessein de punir l’audace des gens de la Vénétie ; il veut les attaquer sur cette mer par laquelle ils se croient bien protégés. Ii envoie l’ordre au jeune P. Crassus de faire construire sur le rivage de la Loire un certain nombre de vaisseaux longs (naves longas), de lever, dans le pays, des rameurs qu’on exercera promptement, de réunir un corps de matelots pour le service des voiles, des timoniers faits à la manœuvre du gouvernail, enfin des pilotes que des navigations fréquentes le long de la côte occidentale de la Gaule ont familiarisés avec le Mor Bihan[3] et les écueils qui en rendent l’abord redoutable, à ceux qui le tentent pour la première fois et sans guides sûrs. Caïus, est obéi. Sans doute, en même temps qu’il écrivait à Crassus, il expédiait à Rome un officier chargé d’enrôler quelques bons charpentiers de navires pour diriger l’édification des vaisseaux longs, dont la, forme devait être inconnue aux riverains de la Basse-Loire. Quoi qu’il en soit, l’œuvre de la construction marcha vite ; la levée des équipages ne souffrit pas de grandes difficultés, et tout était prêt dans l’escadre romaine, lorsqu’au printemps César arriva aux lieux où était réuni cet appareil naval. De leur côté, les Vénètes s’étaient préparés à la guerre ; ils avaient muni leurs navires de tout ce qui pouvait leur être nécessaire, et les avaient réunis en une seule flotte, dans les eaux de Vannés. Le commandement des vaisseaux romains, auxquels étaient venus se joindre des navires qu’avaient pu fournir les Poitevins et les autres petites nations maritimes qui vivaient en paix alors avec, les conquérants, fut confié à D. Brutus, malgré son jeune âge, ou peut être à cause de sa jeunesse qui le rendait propre aux entreprises aventureuses. Brutus monta le vaisseau qui portait l’enseigne, marque de son commandement, pendant que César allait aux Vénètes avec les gens de pied qu’il menait par terre. Contrarié par les vents d’ouest et de nord-ouest, par une mer agitée et dure qui venait du large, par des marées fortes qui le portaient tantôt dans l’Océan, tantôt sur un rivage dénué de ports où se .réfugier au besoin, Brutus lutta durant quelques mois d’été contre la nature, plus terrible que ne pouvaient Patte les hommes qu’il cherchait sans les pouvoir rejoindre. A la fin, cependant, la flotte armoricaine fut aperçue par les bâtiments légers que le préteur avait lancés à la découverte. Cette vue produisit une surprise indicible aux Romains, qui ne connaissaient encore que par ouï-dire les navires vénétiens. On leur avait bien appris que ces navires, très élevés au-dessus de l’eau, étaient entièrement construits en bois de chêne et fiés par des baux[4], d’un pied d’équarrissage, tenus aux membres latéraux par des clous eu fer gros d’un pouce ; mais ce qu’ils voyaient était bien au-dessus de l’idée qu’ils s’étaient faite de ces masses flottantes. Que pourrait, sur les flancs épais de ces bâtiments, l’éperon d’airain dont était armée la proue du vaisseau long, relativement si faible, si fragile, si peu hors de l’eau, et dont la tour, dressée à l’avant, sur le pont antérieur au premier banc des rameurs ; n’arrivait pas au niveau du plat bord du vénète, si étrangement enhuché[5] ? Si les navires élevés avaient l’avantage de la hauteur et de la solidité, les vaisseaux romains avaient ceux de la légèreté, de la vitesse ; et puis, quand les armoricains ne pouvaient aller qu’à la faveur du vent, les navires de Brutus pouvaient se servir, suivant l’occurrence, de la voile ou de la rame : de la voile, pour aller à l’ennemi si le vent ne leur était pas contraire ; de la rame, pendant l’action, pour manœuvrer entre les vénètes, qui ne marchaient, eux, qu’au moyen de peaux de bœufs amincies par un instrument de silex ou de fer[6], surfaces lourdes et solides, tenant lieu aux Gaulois de la toile de lin (carbasus)[7] que, les navigateurs de la Méditerranée ouvraient au souffle de Favonius ou d’Auster. L’adresse, la ruse, les stratagèmes, et, plus que tout cela, le courage personnel, étaient ce que les Romains avaient à opposer aux marins de Vannes, qui devaient les accabler de pierres tombant du haut de leurs remparts. D’aussi loin que Brutus eut aperçu les Vénètes, qui se rangeaient pour le combat, il fit préparer les faux qu’on avait embarquées à bord de chacun des navires. Au lieu de les emmancher à un bois court et facilement, maniable, on les lia à des perches, à des antennes de rechange, à tout ce qu’on ‘eut de long, de fort et de capable d’être utilement attaché aux mâts pour être porté au dehors, à la hauteur du gréement des navires vénétiens. Ce qu’on se proposait dans l’emploi de la faux, ainsi disposée, c’était de trancher les appuis latéraux des mats, faits de chanvre, et non de chaînes de fer comme les câbles des ancres[8], et surtout de couper les drisses des voiles, parce que, celles-ci une fois abaissées, les bâtiments devaient être condamnés à l’immobilité. Les faux promptement disposées et solidement amarrées au, mât de chacun des vaisseaux longs, Brutus donne le signal de marcher en avant. César est sur une colline dominant la mer, et Rome va combattre sous ses yeux ! Rien de ce qui se fera de beau ne restera ignoré ; on est en présence de celui dont un regard encourage, dont une parole récompense. Favorable aux Vénètes, le vent du nord-est est d’abord contraire aux Romains ; mais la brise est molle, l’Océan est faiblement agité, et la range a beau jeu, Brutus marche au centre de son escadre, dont la ligne, légèrement courbée en croissant, s’étend à droite et à gauche, de telle sorte que les deux ailes débordent la ligne ennemie et l’enserrent comme dans un demi-cercle[9]. Chacun des capitaines des vaisseaux longs a reçu les instructions de son général. Les Vénètes ne peuvent pas marcher sur une ligne de front bien serrée, ils risqueraient trop de s’aborder ; on s’introduira dans les intervalles qui resteront ouverts, et chacun, forçant de rames, passera près d’un ennemi pour obtenir de la faux l’office qu’on attend d’elle. La manœuvre n’est pas sans difficulté. Lorsque le navire romain entrera dans le créneau laissé entre deux vénètes, les rames seront supprimées du côté où la faux devra opérer la chute de la voile ennemie ; celles du bord opposé continueront leur effort pendant que des rameurs du côté de la faux pousseront avec leurs avirons, dont ils se serviront comme de simples perches, pour faciliter le mouvement en avant, et que les timoniers redresseront la marche du bâtiment ait moyen du gouvernail[10]. Quand la voile sera tombée ; deux ou plusieurs vaisseaux longs vireront de bord et viendront, à la rame, investir le navire inerte. Alors commencera l’escalade des morailles de bois, et les bâtiments vénètes ne seront plus pour les soldats de Rome que des forteresses à prendre d’assaut. Tout se passé comme le préteur et ses capitaines l’ont entendu. La brise, petite au commencement de l’action, meurt et rend presque inutile le secours des faux. Cependant tant que le vent a duré la manœuvre convenue a eu son effet. Les antennes sont abattues et les voiles deviennent un embarras dont on ne, peut se dégager. L’assaut réussit partout. Dans ces abordages multipliés, la valeur romaine se signale par des actions que le courage des Gaulois rend plus belles. Les vaisseaux ces Vénètes sont capturés-presque tous ; peu d’entre eux parviennent à se sauver, la nuit étant arrivée pour les cacher. Les vaisseaux à rames, remorquant leurs lourdes prises sur lesquelles l’aigle romaine a remplacé les enseignes armoricaines, se rapprochent triomphants du port où les attend César victorieux. Le combat a duré, rude et bien rendu de part et d’autre, depuis la quatrième heure du jour jusqu’au soleil couché. Vannes se reconnaît vaincue, et paye d’un sang cruellement versé parle vainqueur l’outrage fait au droit des gens. § II.Quittons Venetia soumise, et assistons aux préparatifs, que fait César pour son passage, du pays des Morins qui vient de se donner à lui, à la côte d’Angleterre, qu’il a envoyé reconnaître par C. Volusenus, monté sur un vaisseau long. César veut faire une expédition en règle. Il faut qu’il transporte avec lui un corps de troupes assez considérable pour parer à tous les événements. Il doit embarquer des fantassins, de la cavalerie, des vivres, des machines de guerre, enfin tout ce qui appartient à une armée qu’attend une résistance probable. Il a les vaisseaux longs construits l’année précédente aux bords de la Loire, et ce qui, des nations alliées, lui est resté de navires propres à faire campagne. Il lui faut encore de grands navires, des bâtiments plus petits, et des vaisseaux longs, armés pour le combat. Il requiert environ quatre-vingts bâtiments de charge que lui donne la peur inspirée aux Morins et à leurs voisins maritimes, et les réunit au port d’où il entend partir. Ces bâtiments (naves onerariæ, coactæ contractœque) ont paru suffisants pour le transport de deux légions. En moyenne, chacun d’eux ne doit porter qu’une soixantaine d’hommes, si chaque légion est de cinq mille guerriers. Mais avec les soldats doivent être transportés les armes, les vivres, les outils de toutes sortes, les tentes, tout le matériel de campement, toutes les machines pour l’attaque et poux la défense. Ce que César a de vaisseaux longs est distribué par lui au questeur, aux lieutenants dit général eu chef et à ses préfets, chefs d’escadre et capitaines. Non loin du port où se prépare le gros de l’expédition (à Boulogne, peut-être, si l’on admet que César lui-même était à Wissant), dix-huit navires de charge sont retenus par le vent (d’ouest ou de nord-ouest) ; ils ne peuvent triompher de cet obstacle, qui empêche leur jonction avec le reste de la flotte. Ils porteront la cavalerie. L’embarquement des chevaux s’opère lentement ; César est en vue de la côte d’Angleterre avec la partie de la flotte qu’il a emmenée et qu’a poussée un bon vent d’est, et le convoi de la cavalerie n’est pas encore signalé ! Mal arrivera de ce retard aux dix-huit navires porte-chevaux. Quatre jours après celui du départ de la flotte, ils sortiront aidés par un vent propice et doux, approcheront du rivage breton, et alors le nord-ouest soufflant avec violence les accueillera, les dispersera, permettant à quelques-uns de revenir à leurs ports de départ ; puis, variant comme il arrive souvent dans les tempêtes, chassera les autres jusqu’à un mouillage à l’ouest du lieu où s’est arrêté César, et les empêchera d’y rester à l’ancre, leur perte y étant imminente. Contraints de reprendre le large, ils lutteront à la voile contre le vent irrité et la mer soulevée, et, après avoir péniblement tenu une route oblique à la direction du vent pour ne pas s’éloigner trop des parages morins, ils reverront enfin le continent gaulois, mais blessés, meurtris et à bout de forces. Pendant les quatre jouis dont nous venons de parler, qu’avait fait César ? Arrivé devant une plage unie et ouverte, et la serrant d’aussi près que le permettait le tirant d’eau des vaisseaux ronds qui portaient ses troupes, il tenta de débarquer. Mais le terrain lui fut disputé par les Barbares. Ceux-ci, contre les soldats romains qui se jetaient à la mer cuirassés, portant leurs armes à la main, et ayant de l’eau jusqu’aux aisselles, lancèrent leurs chars de guerre et leur cavalerie. Pour protéger ses troupes, César fit avancer les vaisseaux longs à droite et à gauche de la ligne des transports, et les chargea d’inquiéter les flancs découverts de l’ennemi. Les pierres lamées par les frondes, les traits jetés à la main, les flèches parties des ares, mirent le désordre parmi les Bretons qu’avaient étonnés et troublés déjà le bruit des rames et la vue de navires de guerre dont l’espèce leur était inconnue. C’était peu que ce secours envoyé par le général à ses gens. L’ennemi ne lâchait pas pied. Ses sol-dits le trouvaient encore ferme et fortement opposé au mouvement qui se produisait de la mer à terre César fit préparer les esquifs des vaisseaux longs — chacun avait le sien pour les communications avec la terre et pour le service du bord — ainsi que les bâtiments légers qui servaient pour aller à la découverte et pour porter les ordres (scaphas longarum navium, item speculatoria navigia), et les remplit, de soldats envoyés pour balayer la plage et faciliter le débarquement. Ces hommes, quand ils eurent touché le sol, firent une attaque d’ensemble, pendant laquelle les légionnaires purent descendre au rivage, se grouper, combattre, battre, chasser les Barbares et rester maîtres d’un champ de bataille vivement disputé. La paix fut le prix de cette journée difficile. (Bell. Gall., l. IV.) César ne put se rembarquer immédiatement. Pour mettre à l’abri des accidents ses vaisseaux longs, il les avait fait tirer à terre (in aridum subduxerat) ; mais on ne les avait pas montés assez haut. La grande marée de la pleine lune qu’on n’avait point soupçonnée, et dont Bretons et Gaulois, toujours secrètement hostiles, n’avaient point averti Brutus, apparemment, remplit d’eau ces navires. Le vent qui poussait cette marée était très fort et plusieurs des bâtiments de charge fixés par l’ancre au rivage eurent beaucoup à souffrir de sa violence inattendue. Quelques-uns furent portés sur la grève et brisés par le choc ; d’autres perdirent leurs ancres, leurs agrès, et furent réduits à un tel état de délabrement qu’an les jugea désormais impropres au service qu’ils avaient rendu pour le passage du détroit. Cependant on n’en avait pas d’autres, et ce n’était ni le temps ni le lieu d’entreprendre des constructions nouvelles. On manquait même de moyens de radoub. On manquait aussi de blé pour un hivernage dans file Britannique. César envoya des navires, en assez bon état, dans les ports de la Gaule, avec mission de rapporter des vivres et tout ce qu’il fallait pour réparer les bâtiments avariés, à la reconstruction desquels on appliqua d’abord le bois et l’airain des vaisseaux défoncés qu’on ne pouvait relever. Tout le monde se mit à l’œuvre, charpentiers, matelots, soldats, et bientôt la flotte rétablie fut en état de repasser la mer. Douze navires seulement étaient perdus. Après un certain temps rempli par des combats qui ne sont pas de notre sujet, l’équinoxe d’hiver approchant, César jugea prudent de profiter du premier beau temps pour ramener son armée sur le continent. Le voyage fut heureux et court ; seulement deux bâtiments de charge ne purent suivre les autres et allèrent chercher un port au pays des Morins. Ces navires portaient environ trois cents — soldats (milites circiter ccc, dit l’historien de la campagne), ce qui ; en moyenne, fait cent cinquante hommes par navire, nombre supérieur à celui que plus haut j’ai supposé être celui des combattants embarqués sur les onéraires. § III.César va passer l’hiver en Italie, suivant sa coutume. Avant de partir, il pourvoit au rétablissement de son matériel naval dont il aura besoin pour reprendre sa guerre contre les Bretons. Ses lieutenants ont ordre de faine réparer les navires que deux passages ont fatigués, et d’en construire d’autres dont il détermine la forme et les proportions. Il veut, disent les Commentaires, qu’on les fasse — c’est de navires de chargé et de transport qu’il s’agit seulement — un peu moins hauts sur l’eau qu’on ne les fait danse la Méditerranée, afin qu’on les puisse plus aisément charger et tirer à sec sur le rivage. Il veut qu’on les fasse un peu plus larges que ne le sont ceux de la même espèce dont on se sert sur l’océan romain, afin d’y pouvoir loger plus commodément les chevaux. Il entend surtout que tous soient navires actuaires, c’est-à-dire pouvant se servir de la rame aussi bien que de la voile, ce que leur peu de hauteur doit rendre facile. Ces prescriptions de César sont fort sages, et l’on en comprend très bien l’importance ; mais il est, parmi les motifs qui déterminèrent le réformateur des navires actuaires usités dans la Méditerranée, une raison que j’avoue en toute humilité ne pas comprendre. Les Commentaires disent Paulo facit humiliores (les navires qu’il prescrit de construire) ideo quod, propter crebras commutationes æstuum minus magnos ibi (dans l’Océan) fluctus fieri cognoverat ; parce qu’il avait reconnu que les fréquents changements des marées faisaient les vagues moins grandes dans la mer des Gaules qu’elles ne le sont dans la Méditerranée. Il semble que le contraire serait plus vrai. D’ailleurs, comment accorder cette observation, en vertu de laquelle César prétend qu’on fasse les actuaires relativement peu élevés, parce que les lames d’un océan soumis à l’action du flux et du reflux sont moins hautes, moins dangereuses par conséquent pour lm petit navire qu’elles battent ; que celles d’un océan sans marée ; comment accorder, dis-je, cette observation, avec cette remarque inspirée à César par la vue des gigantesques vaisseaux vénétiens : Leurs navires, un peu plus plats que les nôtres, et par là devant naviguer plus aisément sur une nier peur profonde et souffrir moins quand le jusant venu les laissait à sec, avaient des proues très élevées et des poupes très-hautes aussi pour supporter, l’effort des grandes lames et. des tempêtes (prorœ admodum erectæ, atque item puppes ad magnitudinem fluctuum tempestatumque accommodatæ) ? Les commentateurs n’ont pas été frappés de cette contradiction qui m’arrête et que je ne saurais expliquer. Mais passons. § IV.César est de retour au port Itius. L’auteur des Commentaires dit que César, revenu d’Illyrie, a trouvé vingt-huit vaisseaux longs et-environ six cents actuaires faits, sur les données qu’il a laissées à ses lieutenants. Ses vaisseaux sont rassemblés, sa flotte est prête ; il lui manque seulement quarante navires construits sur la Marne et venus de Meaux (?) par la Seine jusqu’à la mer, où une tempête les a contraints de chercher un refuge dans les petits ports voisins de l’embouchure du fleuve. On ne les attendra point. On embarque cinq légions et deux mille cavaliers ; on se hâte, mais ce n’est point l’affaire d’un jour. Les hommes entrent assez vite dans les navires qui doivent les transporter ; les chevaux s’introduisent plus difficilement dans les actuaires dont les entreponts sont transformés en écuries où chaque animal doit avoir sa place justement mesurée. Il faut à l’infanterie deux cents navires de transport, aux chevaux deux cents actuaires, en admettant qu’en moyenne chaque actuaire recevra dix chevaux et chaque onéraire cent vingt-cinq hommes. Les actuaires porteront sur le pont les rations de deux jours au moins pour les chevaux, et dix cavaliers qui aideront les rameurs pendant la traversée[11]. Le reste des approvisionnements, vivres, fourrages, armes, machines de guerre, est réparti sur les deux cents actuaires, dont le nombre considérable prouve la petitesse. Le préteur avertit César que le dernier homme et le dernier cheval sont aux postes qui leur ont été assignés et le chef de l’entreprise donne le signal du départ. Au coucher du soleil, l’ancre levée, on ouvre la voile oblique à un petit vent du sud-ouest (leni Africo) qui tombe pendant la nuit et livre sans défense, au courant de la marée montante, les navires écartés de la côte où ils tendaient. Au, point du jour, la flotte, à mi-canal, voit à sa gauche et loin d’elle la terre de Bretagne dont le jusant va la rapprocher. La mer est calme et la marée étale. Le reflux se dessine bientôt ; ordre est donné aux équipages de prendre les rames et de nager vigoureusement. Tout le monde se met aux avirons, et les vaisseaux de transport ne le cèdent guère en vitesse aux vaisseaux longs, bien plus légers et mieux faits pour la marche. On arrive sans trop de retard et l’on s’établit sur la plage connue. César marche tout de suite à l’ennemi et laisse à Q. Atrius le commandement des navires mouillés près du rivage. Il était écrit au livre des destins que les vaisseaux de César ne pourraient trouver le repos sur une mer tranquille. La tempête s’élève comme au premier voyage ; la mer s’enfle, se soulève, rompt les câbles, brise les ancres et jette la flotte sur les roches et le sable de la côte. Les Romains sont, une fais encore, sans moyen de retraite immédiat, si les chances de la guerre les contraignent à la fuite. Averti du désastre qui vient d’anéantir une grande partie de ses vaisseaux, César arrête l’élan de ses troupes et vient juger par ses yeux de l’état des choses sur la plage. Il prend tout de suite son parti. S’il a perdu quarante navires, le reste, bien que fortement avarié, peut servir encore, après un intelligent radoub. D’abord il fait tirer à terre, établir sur des béquilles les vaisseaux qu’on devra réparer, et, tout autour de la place où sont montés ces survivants du naufrage, il fait creuser un large fossé, dresser des palissades, organiser enfin un camp retranché qui servira à garder tout à la fois contre les surprises de l’ennemi le chantier de réparations et les troupes préposées à la garde de ce castrum navale[12]. (Bell. Gall., l. V.) § V.Laissons César revenir de la Bretagne avec quelques prisonniers, seul fruit, pour le présent et l’avenir, de deux expéditions coûteuses ; laissons-le continuer son œuvre, et, d’un pas, allons l’attendre devant Marseille, où Domitius est entré avec sept actuaires (les traducteurs disent sept galères et se trompent) qu’il a prises de force à leurs propriétaires habitants d’Igilium et de Cosanum. Marseille s’est déclarée pour Pompée. Elle a appelé à son aide les Albices, montagnards grossiers, ses voisins et dès longtemps ses alliés. Elle munit es remparts, et se hâte d’armer ses navires. César, qui ne petit convaincre les Marseillais de l’intérêt qu’ils ont à servir sa cause, se dispose de son côté à la guerre. Il s’établit devant la ville ; mais il lui faut une marine pour fermer le port et isoler la cité, investie de tous côtés, excepté de celui de la’ mer. Il envoie à Arles et demande qu’on lui fasse promptement des vaisseaux longs au nombre de vingt-deux. Les charpentiers se mettent à l’œuvre, et, trente jour, après celui où le premier bois a été coupé pour la construction de ces navires, Marseille voit arriver, rostrés, munis de leurs rames et de leurs mâtures, et armés de l’éperon pour la lutte qui va commencer, les vingt-deux bâtiments, que César met sous le commandement de Brutus. Vingt-deux navires faits et gréés en trente jours ? Ce résultat, qui dut satisfaire César et l’étonner peut-être un peu, nous semble témoigner d’abord de l’excellente organisation des chantiers qui avaient réuni dans la : ville d’Arles un nombre immense d’ouvriers ; ensuite, des dimensions médiocres de ces navires si promptement achevés. L’événement prouva que c’était aux dépens de la perfection qu’on achetait cette promptitude qui avait pu frapper les Marseillais. Les conditions de vitesse et de légèreté, avaient été négligées d’une manière bien fâcheuse, dans ces constructions si hâtées. D. Brutus put s’en convaincre le jour où, sortant d’Hypæa (If), port de la flotte romaine, il marcha contre Marseille dont l’armée navale s’était accrue, depuis quelques semaines, de dix-sept vaisseaux longs, onze desquels étaient pontés (naves tectæ)[13], et d’une multitude de petits navires, essaim plus incommode que dangereux, que Domitius, avait imaginé de lancer en avant, autant pour embarrasser les Césariens que pour les effrayer. Brutus avait contre lui le nombre, et il apprit bien vite que Domitius avait sur lui un autre avantage. Les navires de Marseille étaient d’une rapidité qui, secondant l’habileté de leurs capitaines et de leurs timoniers, leur assurait, dans les évolutions, une action supérieure. Ils pouvaient éviter le choc des éperons romains, contourner les vaisseaux de Brutus en les accablant de traits et de projectiles, et, chose non moins importante, passer assez près de leurs rames pour les briser. Les bâtiments qui combattaient pour César, montés par des rameurs et des timoniers qui n’avaient point l’éducation des timoniers et des rameurs élevés sur des navires de guerre, et qui, tirés à la hâte des vaisseaux ronds, ne connaissaient même pas le vocabulaire de la marine à rames, ces bâtiments n’avaient pour eux que les chances de l’abordage. Les Albices et les pâtres féroces que Domitius avait jetés sur ses navires étaient redoutables sans doute ; mais Brutus avait-mis sur les siens des soldats choisis dans les premiers rangs des légions de César, soldats forts, habitués aux combats, bien armés d’ailleurs, et qui rendaient égale une partie que Domitius ne croyait pas douteuse. Les Marseillais., jugeant, après le premier quart d’heure du mouvement en avant de l’une et de l’autre flotte, que les vaisseaux de Brutus étaient inférieurs aux leurs à cause de leur poids et de leur mauvaise marche (gravitate et tarditate impediebantur), prirent le parti que les Romains avaient pris dans leur conflit avec les Vénètes ; mais cette tactique leur réussit beaucoup moins bien qu’aux adversaires des Gaulois. Plusieurs navires marseillais se réunirent contre un seul vaisseau de. Brutus, et ainsi se forma un certain nombre de groupes qui ne se désunirent plus qu’après la victoire. Aussitôt qu’un des Phocéens accostait un Césarien, celui-ci lui jetait ses grappins tenus par des chaînes de fer et se l’attachait si bien que la retraite devenait impossible[14]. Alors un champ de bataille flottant était constitué, et la lutte devenait ce qu’elle aurait été à terre. Les légionnaires de César eurent partout l’avantage dans ces terribles mêlées ; un grand nombre d’Albices et de pasteurs fut tiré ; plusieurs des navires de Domitius furent coulés ou pris, et Marseille perdit neuf vaisseaux, le reste ayant pu échapper par la fuite et étant rentré dans le port. (Bell. civil., l. Ier.) Arrêtons-nous ici un moment. Si l’auteur des Commentaires parle du poids et de la marche lente des navires de Brutus, s’il dit que leur défaut de légèreté et de vitesse tenait à ce qu’ils étaient faits de bois vert (factæ enim subito ex humida materia), il ne dit point que leur infériorité dans la manœuvre tint à leur grande dimension, à beur élévation sur l’eau. Comme, ailleurs, et nous le verrons bientôt, il cite des trirèmes, des quadrirèmes, des quinquérèmes ; et, plus humbles, des birèmes, il est bien évident qu’il n’y avait, au combat de Marseille, ni birèmes, ni vaisseaux longs plus importants ; tout se passa avec de simples navires unirèmes, les uns découverts et d’une longueur médiocre, les autres pontés et bastingués, et d’une grandeur qui était probablement à peu près celle des galères du seizième et du dix-septième siècle, que tiraient vingt-cinq ou vingt-six rames de chaque côté. Il faut donc rejeter, en ce qui touche au combat de Brutus contre Domitius, le texte de Lucain au troisième livre de la Pharsale. L’auteur, abusant du droit qu’Horace reconnaît aux poètes de tout oser, suppose que la flotte césarienne était composée de navires à deux, trois, quatre et cinq combinaisons de rames, et, comme si ce n’était pas assez, il monte Brutus sur un navire qui avait une combinaison sextuple de rames, celsior cunctis prætoria puppis verberibus senis (acta). Ici j’aurais pu me servir du mot rang pour me conformer au langage reçu ; on verra plus loin ce qu’il faut entendre par les validæ triremes, quasque quatuor surgens exstructi remigis ordo commovet de Lucain, mal instruit certainement des faits et peu soucieux d’une vérité prosaïque ; de Lucain, marchant appuyé sur une tradition qui lui grandissait singulièrement les objets et plaisait au ponte coloriste. Entre cet écrivain, qui recueille des souvenirs altérés déjà par le temps, et César, qui raconte sa propre histoire et dont la mémoire doit être fidèle, qui pourrait hésiter ? Mais revenons à Marseille, où L. Nasidius, qui y arrive envoyé par Cn. Pompée ; amène dix-sept navires, dont un petit nombre seulement étaient armés-du rostre d’airain, pointe de cette flèche flottante qu’on appelait le vaisseau long. Pourquoi tous ne sont-ils pas munis de cette arme d’attaque ? C’est qu’apparemment ceux qu’on n’en a pas pourvus sont navires de transport. Les Marseillais, les Grecs, comme les appelle l’auteur de la Pharsale (Graii), ont réparé autant qu’ils l’ont pu les pertes faites dans le combat que nous avons raconté. Ils ont radoubé de vieux navires relégués au fond de leur arsenal maritime, et les ont armés avec le plus grand soin. Ils ont requis, tout le long de la côte, les barques des pécheurs, et les ont couvertes, autant pour en mettre les rameurs à l’abri des, coups, que pour fournir un plancher aux archers et aux machines à lancer des traits. L’escadre marseillaise sort par un bon vent et va rejoindre à Taurœnta (?), où elle attend Nasidius, qui a persuadé aux gens de Marseille de tirer vengeance de leur défaite. Brutus quitte son mouillage avec sa flotte arlésienne augmentée de six navires pris sur les Marseillais et récemment réparés ; il va à l’ennemi qui le reçoit bravement. Les vaisseaux de Brutus manœuvrent moins bien que ceux de Marseille : au lieu de se tenir sur une ligne serrée et de s’avancer de front sans se désunir, ils s’écartent, par l’inhabileté des timoniers qui font de fausses routes ; ils ouvrent aux Domitiens des créneaux où les navires légers se précipitent, criblant de traits les Romains qui ripostent de leur mieux. Quand un vaisseau marseillais est accroché par les mains de fer d’un romain, aussitôt plusieurs vaisseaux de Marseille accourent pour lui prêter aide et réduira l’abordeur. Un seul incident remarquable signale cette journée : Deux navires trirèmes, — c’était sans doute deux vieux bâtiments qui n’avaient point figuré dans la première affaire et que Marseille avait ressuscités par un radoub, — deux navires trirèmes, ayant reconnu à son enseigne le vaisseau de Brutus, vont à lui, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, espérant le broyer entre leurs masses fortement lancées par leurs avirons. Ils courent sur la mer, présentant leurs rostres aux-flancs sans défense de Brutus, qui, devinant leur intention, les laisse approcher jusqu’à une certaine distance, puis, excitant, tout d’un coup ses rameurs obéissants, leur échappe par un mouvement forcé des rames et les voit bientôt se heurter l’un l’autre, et briser, celui-ci son éperon, celui-là l’œuvre morte de sa proue. Perdant qu’ils tachent de se dégager, des navires césariens accourent et les ont bientôt coulés bas. Remarquons-le : dans son récit, César, qui nomme les trirèmes pour la première fois[15], dit que les naves triremes duo qui ont remarqué le vaisseau de D. Brutus, l’ont reconnu, non à sa grandeur, à sa taille, à sa forme particulière, mais à son enseigne (ex insigni facile agnosci poterat), ce qui démontre bien que le préteur de la flotte romaine montait un vaisseau ordinaire, sans doute une unirème éperonnée. Nasidius, qui commandait l’aile gauche de la flotte marseillaise, ne donna que faiblement et se retira promptement du champ de bataille sans y laisser même blessé un de ses bâtiments. Marseille perdit dix vaisseaux : cinq coulés, quatre pris, et un qui, avec Nasidius, alla chercher la côte d’Espagne. Ainsi finit la seconde bataille des Césariens contre les partisans de Pompée, qui ne furent plus tentés de courir la chance des combats sur mer, et se décidèrent à se donner à César. Domitius, honteux, et ne voulant pas entrer dans la capitulation qu’on préparait, choisit un jour de gros temps, sortit de Marseille suivi de deux navires chargés de quelques amis, et se fit chasser par les vaisseaux romains qui gardaient à l’ancre l’entrée du port. Un de ces gardiens s’attacha au petit navire qui portait Domitius, mais ne put l’atteindre. Les familiers du général pompéien, pressés par les autres ; revinrent au port et firent leur soumission avec la ville qui, livra ses trésors, ses armes et ses vaisseaux. (Bell. civil., l. II.) § VIII.César a quitté Marseille,-que le courage de ses habitants n’a pu sauver du malheur d’une défaite. Il a franchi le Rubicon, et devant lui s’enfuit Rome à la suite de Pompée, qui s’arrête un moment à Brindes. César l’y aura bientôt rejoint ; bientôt aussi il aura traversé l’Adriatique pour chercher son rival qui, avec une flotte immense, aux ordres de Marcus Bibulus, a porté sur le rivage macédonien ce qui reste de la République romaine. César n’a qu’un petit nombre de navires de charge, à peine ce qu’il en faut-pour embarquer sept légions. De navires faits pour la guerre, il n’a que douze vaisseaux longs, dont quatre seulement sont munis de remparts et couverts d’un pont (duodecim naves longas in quibus erant constratæ quatuor). Il n’hésite cependant point, au risque de se voir la route interceptée par Bibulus ; il compte sur sa fortune, et, le 4 janvier, lève l’ancre. Le surlendemain, sans avoir perdu un navire, il touche la côte de l’Épire, près des monts Cérauniens. Il renvoie ses vaisseaux à Brindes pour y prendre la partie de l’armée qu’il attendra avant d’entrer en campagne. Mais Fusius Calenus, qu’il a commis au soin de ce passage, part trop tard, ne met point à profit une brise de nuit qui, soufflant de l’est, devait le pousser rapidement à la côte d’Italie, et rencontre une division navale conduite par Bibulus. Celui-ci lui enlève quarante onéraires qu’il croyait chargées : elles étaient vides. Cette déception jette le préfet de la flotte de Pompée dans un accès de colère puéril et barbare. Au lieu d’emmener ces bâtiments à Corcyre, il les brille en pleine mer, et, avec eux, les matelots et les capitaines qui les montent, espérant par cet acte violent inspirer aux Césariens une terreur salutaire. Ce n’est. pas la seule action de ce genre qu’on doit reprocher à Bibulus. Un vaisseau parti de Brindes avec Fusius, qui, lui, était rentré au port, ayant reçu de César l’avis que les navires Pompéiens couraient les eaux de la mer Adriatique ; un vaisseau qui, ne portant point de troupes, et, appartenant à un particulier, devait être traité comme un bâtiment neutre et maître de sa navigation, fut pris par Bibulus et brûlé sans pitié aussi bien que les hommes libres, les esclaves et-les enfants qu’il partait ; voyageurs malheureux qui avaient d’abord recherché l’escorte de Calenus et s’étaient fiés, malgré ses ordres, au privilège qui les devait protéger. Maître de la mer, Bibulus était pourtant dans une position difficile César lui fermait la terre. Bien gardés, tous les points de la côte étaient interdits aux navires, dont les équipages souffraient par le manque de bois et d’eau potable. Aucun vaisseau ne pouvait approcher des rivages et s’y ancrer. Les choses en vinrent à ce .point, pour les marins pressés par la soif, qu’on fat obligé de recueillir la rosée des nuits dans les peaux qui couvraient les navires ex pellibus quibus erant textæ naves[16].» Bibulus mourut de l’excès de la fatigue et du froid. Un de ses lieutenants partit d’Orique avec cinquante vaisseaux, et fit voile pour Brindes où il s’empara d’une fie voisine de ce port — l’île du Lazaret et du Fort de mer, dont le nom antique nous est inconnu — ; il voulait se trouver sur la route que devaient prendre nécessairement les navires de César et leur couper le chemin. Ceci valait mieux que le blocus de la côte d’Épire et de Thessalie. Arrivé à l’improviste, il surprit et brûla quelques transports, et prit un bâtiment chargé de blé : bonne aubaine pour lui, perte sensible pour César. Antoine était à Brindes. A soixante esquifs appartenant aux plus grands navires, il fit adapter des parapets et des claies pour les fortifier, puis leur donna de petites garnisons d’hommes d’élite et les envoya faire le guet près de la côte. Ensuite, sous le prétexte apparent d’un exercice pour les rameurs, il fit sortir de Brindes deux trirèmes (naves triremes duos), auxquelles Libon opposa tout de suite cinq quadrirèmes. Les trirèmes se retirèrent, se firent suivre en nageant modérément, et attirèrent près de l’entrée du port les quadrirèmes imprudemment emportées par la fougue de leurs rameurs. A ce moment, les esquifs armés arrivèrent au signai fait par Antoine, attaquèrent une des quadrirèmes, l’enlevèrent à l’abordage et l’emmenèrent à Brindes pendant que les autres prenaient honteusement la fuite. Brindes fut débloquée par cette, victoire de quelques barques sur des navires beaucoup plus forts qu’elles. Libon se retira humilié de l’échec qu’il venait d’éprouver, et plein, de mépris sans doute pour les équipages de ses vaisseaux, dont avait si aisément triomphé iule poignée d’héroïques vétérans. Voilà les Quadrirèmes nommées pour la première fois par César ; nous les retrouverons bientôt et les examinerons de plus près pour les faire connaître mieux que par quelques phrases des Commentaires qui n’ont pas la prétention de les décrire. César attendait depuis plusieurs mois le corps que devaient lui ramener les vaisseaux de Fusius Calenus. Il l’appelait par de fréquentes lettres. L’hiver avançait et les légions désirées restaient toujours à Brindes. Un message impératif arriva enfin à Calenus, qui en tint compte au risque de ce qui pourrait arriver d’une rencontre entre ses vaisseaux et les escadres de Pompée. Il partit, Auster (le vent du sud) le favorisant et le poussant grand largue. Les voiles, qui recevaient le vent parla droite, emportèrent ses navires assez vite pour que le lendemain ils se trouvassent dans les eaux de Dyrrachium et d’Apollenia. Aussitôt qu’ils furent en vue de terre, un-des préteurs de la flotte de Pompée, C. Coponius, qui, à Dyrrachium, commandait l’escadre des vaisseaux rhodiens, sortit du port, et, les rames aidant les voiles, donna la chasse au convoi césarien composé en grande partie de navires de charge et de bâtiments-écuries ; pour cette raison, d’une marche plus lente que l’escadre des vaisseaux longs de Rhodes. Coponius gagnait visiblement Calenus. Le vent tombait et la voile se dégonflait. Si la brise mollit encore, un combat, que Calenus serait heureux d’éviter, va s’engager et peint-être coûter cher à César. La brise se refait ; les voiles s’enflent de, nouveau ; le sillage des navires romains s’augmente : les légions sont sauvées. Le port de Nymphée, à trois milles au nord-ouest de Lissus ; s’ouvre pour les recevoir. La rade est exposée au vent du sud qui souffle avec violence. On affronte la tempête sur des ancres solides, et, par un bonheur inespéré, une saute de vent a lieu ; Africus (vent d’ouest) succède subitement à Auster. Mais Africus, qui sauve les Césariens, rend la manœuvre de Coponius difficile. Comment revenir à Dyrrachium avec le vent debout ? L’état de la mer est tel que louvoyer est impossible ; il faut donc céder et aller à la mort qui attend sur le rivage. Seize navires rhodiens pontés sont jetés au-plain et brisés ; la plus grande partie des hommes de leurs équipages est écrasée sur les roches ; le reste est recueilli par les soldats de César et renvoyé généreusement dans ses, foyers. § IX.Antoine était à Lissus (Alessio, en Albanie) où il avait amené quatre légions et huit cents chevaux. Il renvoya presque toute sa flotte en Italie, pour y prendre d’autres troupes, et garda seulement les pontons, espèce de navire gaulois, comme le dit César. C’étaient des bâtiments de charge, gros et lourds, qui, sans doute, dans leur forme extérieure, avaient gardé quelque chose de leur origine, et ne s’étaient point romanisés, si je puis parler ainsi. Ils n’étaient pas, apparemment, dépourvus de bonnes qualités, puisqu’on les destinait à porter César lui-même, qui devait suivre de près Pompée, si celui-ci comme le bruit en courait, rentrait, en Italie. César avait laissé à Oricum trois cohortes, troupe suffisante, pensait-il, pour défendre la ville et les vaisseaux longs qu’il avait emmenés de Brindes. Atilius, son lieutenant, resta pour garder ce poste. Il retira au fond du port ses bâtiments désarmés et dégréés ; et, pour obstruer l’entrée de la ville du côté de la mer, coula dans la passe un navire de charge, écueil contre lequel devait venir se briser tout vaisseau qui tenterait la voie, du port. En arrière de celui-là, il établit un autre navire grand et fort, sur lequel fut édifiée une tour qui devait être toujours remplie de soldats. Le file de Pompée, commandant l’escadre égyptienne, averti du départ de César, vint à Oricum, attacha de nombreuses cordes au vaisseau coulé, et, tous ses vaisseaux à rames attelés à ces remorques faisant effort ensemble, déplaça le navire submergé qu’on avait assurément négligé de remplir de pierres. Quant au second navire, il le fit attaquer avec des bâtiments munis de fours, aussi hautes que celle du vaisseau qu’ils allaient combattre — turres ad libram, au niveau de l’autre, et non à contrepoids comme le veut un traducteur, qui a omis de dire ce qu’il entendait par des toues à contrepoids —. L’action fut favorable aux soldats de Pompée. Les Césariens furent contraints de fuir dans les embarcations du navire vaincu. Pendant que Pompée s’ouvrait ainsi le port, il préparait une attaque contre les vaisseaux longs attachés à terre dans l’arrière-port. Derrière la ville, était, en forme d’île, une éminence naturelle qu’il fallait franchir pour arriver au refuge où s’abritaient les navires d’Atilius. A l’aide de rouleaux de bois (scutulæ) et de leviers, on fit marcher quatre birèmes jusqu’à la partie intérieure du port[17]. Ces bâtiments — César ne les avait pas-encore nommés — attaquèrent les vaisseaux longs qu’ils prirent ou brillèrent aisément. Cependant Pompée était entré dans le port de Lissus, y avait combattu les trente vaisseaux de charge, les pontons de tout à l’heure que Marc-Antoine y avait mis en réserve, et les avait incendiés tous (Bell. civil., l. III). § X.Faisons un grand pas. La bataille de Pharsale est gagnée et César est à Larisse. D. Lælius, commandant une partie de l’escadre d’Asie, qui appartenait à Pompée, ignorait encore les événements accomplis dans la Thessalie, et avait repris le dessein que Libon n’avait pu faire réussir. Il s’était emparé de l’île qui garde l’entrée de Brindes, et surveillait Vatinius, détaché dans cette ville pour tenir libres, au moyen d’une escadre, les communications entre l’Italie et César. Vatinius suivit l’exemple donné par Marc-Antoine ; il fit ponter et blinder toutes les grandes embarcations, les arma de parapets et y mit garnison. Il fit avancer alors ces petits navires vers l’île où stationnait la marine de Lælius ; celle-ci-courut aux esquifs, qui prirent chasse, feignant une fuite qui devait tromper l’ennemi. Un vaisseau quinquérème et d’autres moindres se laissèrent abuser par cette manœuvre ; ils donnèrent dans l’entrée étroite du port de Brindes, et les esquifs, changeant de rôle, virèrent de bord, firent front aux vaisseaux longs qu’ils eurent bientôt rejoints, entourés, combattus et pris, en grande partie. Lælius perdit là une quinquérème et deux bâtiments moins grands, que les Commentaires ne désignent pas autrement que par ces mots : minores duas naves. Malgré cette perte et toute la gêne que lui causait Vatinius, Lælius n’abandonna point son poste. Un événement maritime plus important que celui dont vous venons de parler eut lieu, vers le même temps, sur la côte de-Sicile. Cassius — celui-là même qui devait être au nombre des meurtriers de César — Cassius commandait, pour-Pompée, une escadre fournie par la Cilicie, la Syrie et la Phénicie. Il fit voile pour le Phare où se tenait, partagée en deux escadres, la flotte de César. L’une d’elles était sur la côte de Calabre, près de Vibo (Bivona ?) ; Publius Sulpicius, préteur, la régissait ; l’autre, mouillée à Messine, obéissait à M. Pomponius. Cassius donna d’abord contre celle-ci. Il ne chercha point le combat, bien qu’elle ne fût pas en bon ordre ; mais, profitant d’un vent qui partait sur elle, il lança des navires de charge remplis de matières incendiaires .qui répandirent autour d’eux la flamme et la destruction. Pomponius perdit son escadre tout entière, c’est-à-dire trente-cinq navires, dont vingt étaient pontés (constratœ). Sulpicius ne fut pas aussi malheureux. Le vent, toujours propice à Cassius, passa de l’est à l’ouest, et quarante brûlots donnèrent sur les côtes de l’escadre de Vibo que son commandant avait rangée tout près du rivage et presque à terre. Ils ne brûlèrent que cinq vaisseaux, les vétérans commis à la garde des bâtiments ayant pris, bien que malades ou convalescents pour la plupart, la généreuse résolution de chasser un insolent agresseur. Ces braves hommes poussèrent les vaisseaux de Sulpicius au large, y montèrent, mirent à la voile, se jetèrent sur les rames, et, manœuvrant avec habileté, gagnèrent le vent à Cassius, laissèrent arriver sur la flotte Pompéienne, et firent si bien le devoir auquel là fureur les portait ; que la victoire leur resta. Deux trirèmes furent prises et, de plus, deux quinquérèmes, sur l’une desquelles Cassius avait son enseigne de commandement. Cassius, au moment où l’abordage devenait imminent, jugeant qu’il allait être fait prisonnier, s’embarqua furtivement dans l’esquif (scapha) de son navire prétorien, et gagna comme il put un de ses vaisseaux fugitifs. § XI.La nouvelle de la défaite de Pompée à Pharsale arrivant sur ces entrefaites, Cassius se hâta de quitter les parages de la Sicile. Pompée s’était éloigné de la Thessalie, et, après avoir traversé la Macédoine, après avoir passé deux jours à Mitylène, touché en Cilicie et en Chypre, renonçant au projet qui l’avait tenté d’abord d’aller en Syrie avec quelques vaisseaux, affrétés à des particuliers, et environ deux mille hommes levés un peu au hasard et un peu par force, se dirigea vers la ville de Péluse. On sait qu’il trouva la mort où il espérait trouver le salut. Achillas et Septimus le tuèrent traîtreusement dans une petite embarcation (naviculam parvulam) qui le transportait de son vaisseau à Alexandrie, où il devait avoir une entrevue avec le jeune roi Ptolémée, alors armé contre sa sœur Cléopâtre. César ne pouvait manquer de suivre Pompée à la trace. Ayant appris que son gendre avait été vu en Chypre, et soupçonnant qu’il se dirigerait vers l’Égypte où il avait des partisans, il embarqua deux légions décimées par la fatigue, et qui formaient un corps de trois mille deux cents hommes environ ; il mit sur des navires-écuries huit cents chevaux, et partit pour Alexandrie avec une flotte militaire composée de dix vaisseaux longs de Rhodes et d’un petit nombre de bâtiments armés en Asie. Il s’établit dans une partie de la ville et dans le port où étaient cinquante vaisseaux longs, secours envoyé à Pompée qui n’était pas sans importance, car il se composait de quinquérèmes et de trirèmes fort bien armées et équipées. Outre cela, étaient mouillés dans le port vingt-deux navires pontés, commis à la garde d’Alexandrie, et y demeurent d’ordinaire en station. L’arrivée de César causa une émotion qui se traduisit bientôt en rixes et en un véritable combat où il resta triomphant. Pendant la lutte, le peuple fit tous ses efforts afin de s’emparer de la flotte qui aurait rendu-la mer libre pour lui. César n’attendit pas que la victoire se fût décidée. Jugeant que cette grande quantité de vaisseaux lui serait une gêne plus qu’un avantage, parce qu’il avait trop peu de troupes — quelques légions étaient venues grossir le faible noyau de son armée — pour défendre le port, l’arsenal et le quartier qui les environnait, il fit mettre le feu aux escadres de Pompée et d’Alexandrie, aux vaisseaux qui étaient retirés dans l’arsenal de mer (in navalibus), et embarqua sur ses propres vaisseaux une partie de son monde. Ce fut au Phare qu’il alla s’établir, assuré que là rien ne lui manquerait, la mer lui appartenant désormais, et des approvisionnements de tous genres pouvant lui arriver des lieux où il les enverrait chercher. L’escadre que César avait avec lui était trop peu considérable pour être une arme suffisante, d’attaque au de défense, dans toutes les occasions où il allait se trouver engagé. Il fit donc venir pour l’augmenter ce qu’il avait de vaisseaux à Rhodes, en Cilicie et en Syrie. C’est dans la rade appelée le Port neuf, qu’il réunit sa flotte. Elle y était, attendant la 37e légion qu’amenait Domitius Calvinus, retenu par le vent d’est sur un point de la côte à l’ouest d’Alexandrie. Eurus persistant à souffler et Calvinus commençant à manquer d’eau, cet officier-dépêcha un petit actuaire (navigium actuarium) pour avertir qu’il était au mouillage sous le vent du port d’Alexandrie, et dans l’impossibilité de sortir de la baie où il était mouillé. César, pour bien juger de ce qu’il convenait de faire dans cette circonstance, monta sur un vaisseau et se fit suivre de toute sa flotte, laissant les soldats à la garde des retranchements dont il avait entouré la partie de la ville où il tenait contre les Alexandrins. Ceux-ci ayant été avertis par quelques rameurs, pris, comme ils allaient faire de l’eau, à Chersonèse, que César avait mis à la mer sans avoir embarqué de soldats, Ganymède, commandant les troupes de Ptolémée depuis la mort d’Achillas, conçut la pensée de combattre des navires sans défenseurs. Il arma tout ce qui de l’incendie avait échappé et qu’on avait pu réparer à la hâte, et ordonna qu’on allât au-devant de César revenant d’une reconnaissance qu’il avait poussée jusqu’au lieu où était D. Calvinus. César n’accepta point le combat qu’on lui offrait. Ii était trop tard, et la nuit venant laissait trop de chances à un ennemi qui connaissait très bien les parages où les pilotes romains pouvaient être embarrassés ; et puis, César n’avait pas les légionnaires pour soutenir vaillamment le choc, qui devait être furieux. Il rangea la côte le plus qu’il put, résolu, l’obscurité devant le protéger plus tard, à gagner la haute mer, et ensuite son mouillage du Phare. La fortune en décida autrement. Un Rhodien s’était éloigné des autres vaisseaux Césariens ; les Alexandrins, l’ayant remarqué, ne purent résister au désir de l’aller capturer. Ils envoyèrent à lui quatre navires pontés et des bâtiments légers non pontés (apertæ). La partie était trop inégale ; César accourut au secours du capitaine imprudent et désobéissant, et le combat s’engagea malgré lui. Les Rhodiens, braves gens, familiers avec, les luttes navales, et désireux d’obtenir le pardon, d’une faute qui leur faisait encourir une grave responsabilité, se battirent en héros. Partout on fit de même ; la journée fut bonne. On prit aux Alexandrins une quadrirème, une autre fut coulée à fond, enfin deux autres perdirent tous leurs soldats embarqués (duæ omnibus epibatis nudatœ). Sans la nuit, César aurait pris la flotte entière. Le vent s’étant calmé, il entra dans le port d’Alexandrie, ses vaisseaux victorieux traînant à la remorque les bâtiments de charge qu’amenait Domitius Calvinus. § XII.Ganymède ne perdit pas le temps en de vaines plaintes. Battu, il aspirait à se venger. Alexandrie avait perdu par le feu plus de cent dix vaisseaux longs, et quelques-uns par le combat ; il résolut de refaire une flotte. Il fit radouber d’abord quelques vieux navires qui pourrissaient au-fond de l’arsenal, ensuite il se donna à des constructions nouvelles, et cela, avec tant d’ardeur, qu’en peu de jours et contre l’opinion de tous (paucis diebus, contra omnium opinionem), on vit achevées vingt-deux quadrirèmes, cinq quinquérèmes et certain nombre de petits navires (parvula navigia), dont on espérait tirer un bon parti. Remarquons cette affirmation de l’auteur, Hirtius ou tout autre, qui continua les Mémoires de César : Vingt quinquérèmes ou quadrirèmes furent faites en peu de jours, et demandons-nous si les quadrirèmes étaient bien de ces vaisseaux énormes que l’imagination des commentateurs a créés. C’étaient sans doute dés navires assez grands, mais bien m’oins assurément que les petits vaisseaux de ligne des temps modernes. Nous dirons plus loin ce que nous croyons de leur taille, en dehors de toutes les poétiques suppositions des savants. Paucis diebus est bien vague, et il est fâcheux qu’Hirtius n’ait pas été plus rigoureusement exact. Ces bâtiments construits si vite et un peu à la légère, car ainsi que le dit l’historien, ils n’étaient point faits pour une longue navigation, mais pour une nécessité du moment et pour combattre dans le port ; ces bâtiments furent couverts de soldats et de toutes les munitions nécessaires, après qu’on les eut essayés à la ramé. On les essaya parce qu’il fallait bien s’assurer qu’ils pouvaient marcher et évoluer passablement. César s’apprêtait de son côté. Sa flotte n’était pas considérable : trente-quatre navires, dont cinq quinquérèmes et dix quadrirèmes ; le reste, vaisseaux plus petits et, pour la plupart, non pontés (reliquœ infra hanc magnitudinem et plerœque apertæ). La valeur des soldats compensait le petit nombre des navires, et César entrait en campagne, sûr des hommes qui le suivaient. Il avait levé l’ancre, porté à l’est pour contourner le Phare ; et, faisant l’ouest, il allait, chacun de ses vaisseaux prenant dans l’ordre de marche qui devait bientôt passer à l’ordre de bataille, le rang qui lui avait été assigné avant de quitter le mouillage : Les Rhodiens faisaient l’avant-garde ; les vaisseaux longs armés au royaume de Pont les .suivaient ; mais leur escadre, future aile gauche de l’armée, était séparée de l’autre, désignée pour former l’aile droite, par un intervalle de quatre cents pas, espace assez grand pour que, au moment voulu, les vaisseaux se déployassent aisément et formassent la ligne en croissant ouvert, sur laquelle on devait se présenter à l’ennemi. Une escadre de réserve marchait au nord du corps principal ; elle était destinée à composer, pendant l’action, une seconde ligne, chacun de ses capitaines sachant quel navire de la première ligne il soutiendrait ou remplacerait au besoin. Lorsque César se présenta au large des passes, marchant au sud-est environ, après avoir tenu la ligne de l’ouest, les Alexandrins, en arrière des bancs qui rendent difficile l’accès de leur ville, avaient formé leur front où l’on voyait, sur une ligne, vingt-deux navires de guerre[18]. Une seconde ligne, entre la terre et le front, était composée de bâtiments auxiliaires. Sur les ailes et dans les intervalles laissés entre les vaisseaux, se tenaient, en grand nombre, de petits navires remplis de joncs, de menu bois et de soufre. Les hommes qui montaient ces brûlots portaient, des torches ardentes ; ils avaient un double rôle, promener l’incendie dans les rangs des Césariens et chercher à les effrayer par des cris sauvages. Les deux flottes restèrent longtemps en présence, chacune d’elles attendant que l’autre fît un mouvement en avant. Les pilotes de César connaissaient mal les passes et les sondes de la mer où sont les bancs que les Alexandrins désignaient sous le nom d’Africains ; les marins d’Alexandrie restaient tranquilles derrière ces bas-fonds, comme abrités par une muraille. César hésitait à se hasarder dans des passages étroits dont les détours pouvaient être dangereux pour lui ; il n’osait se jeter à l’aventure sur une mer dont la profondeur variable mettait en péril d’échouement les plus grands de ses vaisseaux[19]. Euphanor triomphe de ses résolutions prudentes. Euphanor est un Rhodien, par son courage et la grandeur de son intelligence, plus digne d’être Romain que Grec. — C’est l’éloge que fait de lui l’auteur que nous étudions. — Il commande l’escadre de Rhodes, choisi pour ce poste par, ses compatriotes. Il offre à César de marcher le premier, de franchir la passe et de porter le défi, aux Alexandrins immobiles. César le loué de cette détermination et donne le signal du départ à quatre Rhodiens qui s’élancent en forçant de rames, s’engagent dans le canal étroit ; arrivent sur le banc, le franchissent, et bientôt sont entourés de navires ennemis. Les Grecs sont adroits ; investis, ils manœuvrent si bien qu’ils présentent toujours leurs proues armées d’airain, et ne perdent ni leurs rames ni leurs gouvernails. La flotte Césarienne a suivi les vaisseaux d’Euphanor. Il ne peut plus s’agir alors de constituer une ligne régulière ; on se battra par groupes ou seul à seul ; ce sera une mêlée, une succession d’abordages ; on combattra sur des îles flottantes, et la victoire restera au courage individuel. La lutte fut longue, acharnée ; la fortune se déclara enfin pour les Romains, inférieurs en nombre, mais supérieurs par l’énergie et la persévérance dans l’action. Dans cette, affaire une quinquérème et une birème avec leurs équipages furent prises aux Alexandrins, dont trois vaisseaux furent coulés à fond sans que César eût perdu un navire. Alexandrie se mit en retraite et s’abrita sous ses tours et ses remparts ; où on ne put l’atteindre. César fût moins heureux quelques jours après, à l’attaque d’un pont dont la possession lui importait. Il éprouva là un échec douloureux ; obligé de fuir pour ne pas tomber au pouvoir des Alexandrins, il se jeta dans son embarcation[20]. Le petit navire fut envahi bientôt par une multitude de soldats, et César se vit obligé de gagner à la nage des b9timents qui étaient à quelque distance. C’était un incident fâcheux ; mais le général conjura par sa détermination un sort plus mauvais peut-être qui l’attendait : l’embarcation trop chargée coula, et l’on dut envoyer des esquifs (scaphas) pour secourir les naufragés. On en sauva quelques-uns seulement. Les Alexandrins ayant entendu dire que de grands renforts devaient arriver à César, par terre, de la Syrie et de la Cilicie, et pensant avec raison que des convois lui viendraient par nier, pour alimenter son armée grossie, se mirent en devoir de barrer le chemin que devaient suivre les navires de charge. Ils allèrent établir leurs croisières aux atterrages d’Alexandrie, à la hauteur de Canope[21]. César ne voulut pas souffrir que ses mouvements fussent gens du côté de la mer. Il confia une flotte à Tibérius Néron. Euphanor, acteur dans tous les combats livrés sur mer, et jusque-là toujours heureux, y commandait ses Rhodiens. Quand, devant Canope, les deux armées navales s’abordèrent, il s’engagea le premier, perça de l’éperon de sa quadrirème une trirème ennemie, et en poursuivit trop loin une autre qui fuyait. Seul alors, abandonné des Césariens dont l’historien cherche à atténuer les torts, il fut entouré par les Alexandrins qui l’accablèrent, et périt dans une lutte inégale et désespérée, avec son glorieux navire à qui les dieux devaient la victoire. La flotte de César revint à son mouillage au Phare, où elle fut probablement assez mal reçue par celui dont elle avait trompé toutes les espérances (Bell. Alexand.). § XIII.Allons maintenant des parages de l’Égypte à ceux d’Épidaure. Vatinius malade, mais plein de cœur, nous y attend avec une escadre qu’il a formée à la hâte au port de Brindes, appelé par Cornificius, qui veut arrêter les progrès d’Octavius en Illyrie. Vatinius n’avait que peu de navires de guerre, et ceux qu’il avait fait demander à Calenus en Achaïe s’étaient fait longtemps attendre sans arriver à la fin. Impatient de résoudre les difficultés, il n’a tenu compte ni de la saison, ni de l’état de sa santé, ni du manque de ressources qui l’a réduit à des moyens extrêmes. Il n’avait au port, avec lui, que des navires actuaires, en assez grand nombre à la vérité, mais bien petits pour une rencontre avec des vaisseaux faits pour le combat ; n’importe, il les avait armés de l’éperon guerrier, les avait adjoints à ses vaisseaux longs, et avait fait voile avec cette réunion de bâtiments montés par des rameurs vigoureux et de braves soldats[22]. Octavius fuyait devant lui ; mais, ayant appris que les navires de Vatinius étaient, en majeure partie, actuaires et petits, il attendit devant l’île de Tauris. Vatinius, qui n’avait pas de ses nouvelles certaines et ne s’était pas assez bien fait éclairer par ses vedettes (speculatoriœ naves), arriva près de Tauris, sans se douter que l’ennemi était là. $on escadre naviguait moins comme une flotte militaire que comme un convoi de marchands, en temps de paix. Ses navires n’étaient point ralliés près de leur général ; ils faisaient route, séparés les uns des autres, quelques-uns par le vent, la plupart trop peu soucieux de l’ordre que Vatinius n’avait pu oublier de leur donner de ne point perdre de vue l’enseigne prétorienne. Aussi furent-ils surpris par la flotte d’Octavius au moment où ils se croyaient tranquilles possesseurs de la mer. Un navire ennemi venait à eux, vent largue, les voiles à mi-mât (antennis ad medium malum demissis) ; il était chargé de combattants en armes ; Vatinius fit aussitôt amener et serrer ses voiles, décrocher les antennes et déplanter les m9ts, gênants pour le combat[23]. Ses navires, poussés alors par les seules rames, marchèrent fièrement au-devant de ceux qui les venaient menacer. Vatinius, monté sur sa quinquérème, après qu’il eut fait arborer l’étendard, signal de la bataille[24], alla droit à la quadrirème qui portait l’enseigne d’Octavius ; ce navire, emporté par la vigueur, de ses avirons, donna si fortement de son éperon contre le rostre de celui de Vatinius, que sa quadrirème perdit son arme d’attaque et n’aborda la quinquérème qu’avec le bois de sa proue[25]. Partout, dans un espace étroit, le combat fut sanglant, héroïque. La faiblesse des actuaires disparut dans cette mêlée, leurs soldats étant montés à l’abordage des Octaviens. Par leur valeur, ils avaient rétabli l’équilibre qui semblait manquer au commencement de l’action entre des navires petits et de grands vaisseaux. La quadrirème d’Octave fut coulée à fond ; plusieurs autres eurent le même sort ; d’autres tombèrent au pouvoir de Vatinius. Octavius s’étant jeté dans un esquif où cherchèrent aussi leur salut plusieurs soldats effrayés ; l’embarcation fut submergée, et le général Pompéien, blessé, alla gagner à la nage son Myoparon, où il fut recueilli. La nuit étant venue mettre fin à la bataille ; il put se sauver à la voile, suivi de quelques-uns de ses vaisseaux, préservés par le gros temps d’un naufrage sur le champ de la lutte, ou du malheur, plus grand encore peut-être, d’être la proie du vainqueur. Vatinius ayant rallié ses navires, les valides et les mutilés, et ayant reconnu que les profits de la journée étaient une quinquérème, deux trirèmes, huit birèmes (dicrotas) et un grand nombre d’hommes de rames, entra au port d’où était sorti Octavius pour le détruire. En trois jours il se répara, et partit le quatrième pour Issa (Lissa), espérant y trouver le lieutenant rie Pompée. Il apprit là qu’Octavius, avec quelques petits navires, avait pris le chemin de la Grèce, pour se rendre en Sicile et en Afrique. Vatinius, ayant purgé le détroit de la flotte ennemie, et, rendu l’Illyrie à Cornificius, reprit la route de Brindes, où il ramena victorieux ses vaisseaux et ses soldats. § XIV.Nous retrouvons César en Sicile. Il est arrivé à Lilybée (Marsala ?) le 14 des calendes de janvier, l’an de Rome 707. Il veut aller en Afrique et prépare tout ce qu’il faut pour le passage d’une armée. Le temps est peu propre à la navigation ; les vents et la mer semblent irrités : César prétend que de pareils obstacles ne l’arrêtent point ; il sera prêt du moins à profiter du premier calme. Sa flotte est peu considérable, mais chaque jour l’.accroit par l’arrivée de vaisseaux longs et ronds qui se rendent à ses ordres. Il embarque six légions sur les vaisseaux longs, à-mesure qu’ils arrivent, deux mille cavaliers sur les onéraires, et envoie une partie de cette armée à l’île Aponiana (une des Égades peut-être), voisine de Lilybée. Lui-même appareille, le sixième jour des calendes de janvier, et se fait suivre des navires qu’il n’a pas expédiés à Aponiapia. Le petit navire (navigium) qui l’emporte avec un bon vent a une marche assez rapide ; aussi, après le quatrième jour, il arrive en compagnie de quelques vaisseaux longs en vue de la côte d’Afrique[26]. Quelques onéraires ont fait bonne route, mais le vent a dispersé tout le reste. Chacun des transports a suivi la route qu’il a pu tenir, et abordé la terre que le hasard lui a présentée. Lorsque César arriva devant Adrumète, après avoir doublé le promontoire de Mercure[27], il vit sur le rivage un gros de cavalerie aux ordres de Cn. Pison, et environ trois mille Maures. Il fit petites voiles et louvoya près de la terre pour attendre ses vaisseaux attardés. Enfin, il débarqua ce qu’il avait de troupes, c’est-à-dire trois mille hommes de pied et cent cinquante cavaliers gaulois. Le retard des bâtiments qu’il attendait contrariait César, qui ne l’imputait point cependant à faute aux capitaines. Ceux-ci avaient agi selon leur libre arbitre. Le général en chef, avant de lever l’ancre, en Sicile, n’avait point assigné aux navires, en cas de séparation, un de ces rendez-vous que la coutume était de donner à tous vaisseaux naviguant en flottes, en escadres ou en divisions. Ni le préteur, ni aucun des officiers qui avaient la responsabilité de la route n’avait pu apprendre vers quelle partie de la côte d’Afrique on devait se retrouver ni vers quelles eaux on allait se diriger. Hirtius, qui excuse en cela César, donne un détail par lequel nous apprenons que les rendez-vous s’assignaient au moyen de tablettes cachetées, distribuées aux commandants de la flotte : neque tabulas signatas dederat. Aujourd’hui les chefs d’escadres ou de divisions navales, les capitaines de navires qui naviguent isolément, emportent des plis cachetés qu’ils ne doivent ouvrir qu’à de certains jours-et par de certaines latitudes. On le voit, la tradition est constante, et ce n’est pas sur ce seul point qu’elle l’est, en marine. César ne savait pas, dit Hirtius, s’il y avait un port qui pût mettre sa flotte à couvert des tentatives de l’ennemi, chose difficile à croire. Si César ne connaissait pas la côte d’Afrique, n’y avait-il aucun capitaine, aucun pilote dans la flotte romaine, qui l’est assez fréquentée pour lever ses doutes et ne pas exposer son armée à naviguer à l’aventure ? Il faut admettre que, surpris par le temps, veillant à tous les-détails de l’embarquement et de l’armement des soldats, César avait attendu le dernier moment pour envoyer au préteur les tabellas signatas, et qu’il partit, oubliant tout à fait de les écrire. De là cette liberté de manœuvre laissée aux capitaines qui ne surent s’ils devaient aborder à l’ouest ou au sud-est de Carthage. Les navires dispersés s’étaient ralliés en partie à, Utique, et quelques vaisseaux longs et, navires de charge étaient venus rejoindre César à Ruspina, d’où il fit porter de l’eau à sa cavalerie, qu’il avait rembarquée et aux gens de sa flotte qu’il gardait au mouillage pour le besoin. Une partie des bâtiments attendus et bien désirés, parut à la fin, au moment où César venait de monter sur un navire de guerre pour aller à leur rencontre et les défendre contre un ennemi qui pouvait tenir la mer et les, attaquer près de l’atterrage. Le reste errait encore, cherchant à deviner où César avait établi son camp. Attaqués par des esquifs armés, plusieurs de ceux-ci furent pris ou brûlés. Aussitôt que César fut averti de ce qui se passait au large et hors de sa vue, il envoya des escadrilles sur tous les points où l’on devait supposer que Scipion avait établi ses croiseurs ; précaution longtemps inutile ! Les convois ne pouvant aborder sains et saufs les rivages voisins de Ruspina, la disette se fit sentir au camp de César. Heureusement cette situation dura peu. Salluste, envoyé avec une escadre pour prendre du blé à Cercine où de grands approvisionnements avaient été faits, disait-on, avait mouillé devant cette île dont les habitants l’avaient bien reçu. Il avait chargé de froment les onéraires, qu’en toute hâte il avait adressés à Ruspina. En même temps qu’on y reçut ce convoi, l’on vit arriver d’autres navires de charge expédiés de Lilybée par le proconsul Alliénus. Ces bâtiments portaient des hommes, et des chevaux, renfort précieux assurément. La flotte, en quatre jours, était venue de la pointe nord-ouest de la Sicile, en Afrique ; César n’était pas venu plus vite, comme on l’a vu. Tout ce que César avait espéré de troupes n’était pas arrivé par le dernier convoi qu’Alliénus avait envoyé ; il fit partir six onéraires pour Lilybée, avec ordre de lui ramener ce qui y était resté de monde. Alliénus obéit promptement ; les vaisseaux partirent, mais la traversée ne fut pas heureuse pour tous. Un navire (nervis, sans épithète) que montaient Quintus Cominius et un chevalier romain nommé L. Ticida, séparé de l’escadre par un gros temps, fut porté à Thapsus où Virgilius le fit attaquer par des esquifs et de petits actuaires (scaphis naviculisque octuariis) qui le prirent et le conduisirent à Scipion. Un autre navire, trirème celui-là (altera navis, trieris), poussé par la tempête à Ægimur, fut capturé par les vaisseaux d’Octave et de Varus, et conduit aussi à Scipion, qui fit égorger les vétérans, équipage militaire de la trière. La garde avait été faite sans vigilance par les vaisseaux longs chargés de protéger l’arrivée à Thapsus des navires de guerre et de charge ; César en cassa les capitaines, les chassant de l’armée et les frappant d’ignominie par un édit sévère. A quelque temps de là, Varus, ayant appris que la 7e légion et la 8e étaient arrivées de Sicile au camp de César, fit mettre à l’eau (deduxit) tous ses navires qu’il avait tirés au sec (subduxerat) sur le rivage d’Utique, et les arma de rameurs et de soldats gétules[28]. Ainsi équipés, ces navires sortirent sous la conduite die Varus ; qui les mena en croisière dans les eaux d’Adrumète[29]. Ils étaient au nombre de cinquante-cinq. César, qui ne savait ni la résolution de Varus, ni l’arrivée de ses vaisseaux au large d’Adrumète dépêcha à Thapsus L. Cispius avec vingt-sept bâtiments, chargés de veiller sur les convois qui pouvaient arriver ; à Adrumète, Q. Aquila, avec treize vaisseaux longs ayant une mission pareille. Cispius fut bientôt arrivé au lieu de sa station ; il n’en fut pas-ainsi d’Aquila, qu’un vent contraire retint dans une baie où il s’était jeté hors de la portée des ennemis. Le reste de la flotte Césarienne était à Leptis. Les équipages l’avaient quitté, en grande partie, pour aller faire des provisions de vivres. Varus en fut averti par un transfuge ; il partit tout de suite d’Adrumète, et ; le jour naissant, arriva à Leptis ; où il brilla les vaisseaux de charge qui étaient ancrés sur la rade, et s’empara, sans combat de, deux quinquérèmes (penteres duas) dont les défenseurs étaient à terre, César apprend ce succès de Varus, monte à cheval, accourt à Leptis d’où l’avait éloigné l’inspection de travaux qu’il faisait exécuter à six milles de ce port ; il réunit les chefs de sa flotte, les remplit du désir de la vengeance, monte le premier sur un très petit navire (navigiolum parvulum conscendit), prend en passant Acilla, que le grand nombre des navires de Varus avait intimidé, et se met à la poursuite de son ennemi. Varus, qui le voit venir, frappé, de crainte par cette active audace de César, vire de bord et court se réfugier dans Adrumète. César le poursuit l’espace de quatre milles environ, atteint son arrière-garde à laquelle il prend une quinquérème avec ses soldats embarqués extraordinairement (cum omnibus epibatis) et cent trente soldats de sa garnison ordinaire (custodibus). Une trirème, qui s’est défendue, est prise avec ses rameurs et ses épibates ; le reste de la flotte de Varus parvient à doubler : le cap[30] et rentre au port. Le vent ayant changé, César ne peut doubler le cap, et, sans louvoyer inutilement, sans fatiguer ses rameurs, convaincu que Varus sera à l’abri, avant que lui ait pu contourner le promontoire, mouille sous le vent du cap, y passe la nuit, et, le lendemain, fait successivement l’est, le nord, l’ouest, dans le parage d’Adrumète où il arrive à force de rames, brûle tout ce qui, de navires de transport, ayant l’enseigne de Varus, est mouillé hors du port intérieur (extra Cothonem)[31]. Il attend ensuite Varus, inutilement défié, et retourne à son camp. César, s’embarque, peu de temps après, à Utique, emmène sa flotte en Sardaigne, et, le troisième jour, jette l’ancre à Carales (Cagliari), c’est-à-dire qu’en trois jours, ou un peu moins peut-être, il fait cent cinquante-neuf milles marins ! Et l’historien ne dit pas qu’il fut contrarié par de grands vents ! Les naves onerariæ devaient être de bien pauvres marcheurs, et les vaisseaux longs, moins tardifs, devaient bien souffrir de la nécessité d’aller en convois avec eux ! Après un séjour assez court à Carales, César appareille de nouveau, côtoie la Sardaigne ; mais, les vents le retenant fréquemment dans les rades ouvertes au nord, au nord-est et à l’est, il n’arrive au port d’Ostie que le vingt-huitième jour. Ici finit la guerre d’Afrique ; ici finit aussi l’histoire des armées navales de Jules César. Arrêtons-nous. L’a première partie de mon travail est achevée. J’espérais être plus bref. Des navigations à suivre, dés combats à raconter, des manœuvres à expliquer, des évolutions à faire comprendre, c’était une tâche, même en résumé, qui voulait de l’espace et du temps. Ce que j’avais en vue ; dans cette analyse interprétative des passages des Commentaires qui mettent en action la marine de César, c’était, en racontant les faits, moins de faire connaître les vaisseaux qui composèrent la flotte du conquérant, que de recueillir les noms des diverses espèces de ces navires, réservant pour une seconde partie ce que je puis dire sur la forme et l’armement en rames de ceux que l’historien nomme : naves longæ. Venons à cette seconde partie. LES NAVIRES. La marine contemporaine de César, comme celle qui, depuis les temps les plus reculés, avait hanté timidement les mers, comme celle qui lui succéda, plus hardie pendant le moyen âge, plus savante jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, je pourrai ajouter, comme la marine de nos jours ; car, à le bien prendre, le navire entraîné par les roues ou poussé par l’hélice n’est, sous une forme nouvelle et avec un nouveau moteur, qu’une restitution de la galère ancienne, la marine du septième siècle de Rome eut deux grandes familles der vaisseaux. Dans l’une se rangeaient tous les bâtiments faits pour porter les lourdes charges, hauts, vastes, lents, n’obéissant qu’à l’impulsion de la voile grande et large ; dans l’autre étaient comptés tous ceux qui, faits pour une marche plus rapide, pour des évolutions faciles, et, par cette raison, destinés au combat qui veut de vives attaques et parfois de promptes retraites, étaient peu élevés sur l’eau, comparativement aux premiers, armés de rames, leur unique moyen d’action à de certains moments, et munis de voiles, quelquefois seulement auxiliaires, quelquefois leur seul propulseur. Les deux familles navales dont nous parlons se distinguaient par les dénominations de vaisseaux ronds et de vaisseaux longs. VAISSEAUX RONDS.Destiné au transport des marchandises, des vivres ; de tout ce qui était pesant et encombrant ; destiné aussi à porter les approvisionnements de guerre, les machines et les soldats en grand nombre, le navire nommé par les Grecs : φορταγωγός OU άπόστολος πλοίον, et par les Romains : navis oneraria, navis frumentaria, était court, plat, large, très haut de la-quille au pont supérieur. Il était pesant et médiocre marcheur. Ses dimensions étaient généralement dans le rapport suivant : pour un de largeur, trois ou quatre de longueur. Ainsi, le navire qui avait, par exemple, vingt coudées de longueur (9m 74c) avait de largeur six coudées et deux tiers (3m 24c) ou cinq coudées seulement (2m 43c)[32]. Bien assis sur l’eau, arrondi par devant, et un peu moins peut-être par l’arrière, sa coupe, à la flottaison, était un ovale peu marqué ; aussi était-il appelé par les Grecs : στρογγύλον πλοίον, par les Romains : navis rotunda. ACTUAIRES.Une variété du vaisseau rond, propre à porter de certaines charges et surtout à transporter en peu de temps des hommes de guerre et des chevaux, était, à l’ovale plus allongé, au bord moins haut que la navis rotunda. Intermédiaire entre l’onéraire rond et le vaisseau long, procédant plus du premier que de l’autre, ce navire obéissait à l’impulsion de la voile, et, dans les calmes, il allait à l’aviron. Il pouvait être cinq fois plus long que large. Il était nommé par les Romains : actuaria navis (du grec άγω, emporter, conduire), et par les Grecs ίστιοκώπους (à mât et à rames). Actuariæ navis sunt quæ velis simul aguntur et remis, dit Isidore au livre XIX de ses Origines[33]. Les dictionnaires latins les définissent fort mal quand ils les appellent des bâtiments, légers à la course. Dans la flotte de César, les actuaires jouèrent un certain rôle, comme transports portant des hommes, et comme passe-chevaux. On a vu que le général, pour sa descente en Angleterre, en fit construire un très grand nombre, sur un plan qui modifiait celui qu’on suivait généralement pour leur construction dans la Méditerranée. Comme il y avait de grands, de moyens, de petits vaisseaux de charge, il y avait de petits, de moyens et de grands actuaires. Cicéron, dans une lettre à Atticus (liv. XVI), parle de trois petits actuaires : tribus actuariolis decem scalmis dit-il ; ces actuaires, à dix scalmes ou avirons, devaient être, en effet, d’un bien petit modèle[34]. Je n’ai pas besoin de dire comment étaient organisés à l’intérieur les actuaires qui portaient des troupes. Couverts d’un pont sur lequel était établi l’appareil des rames (en un seul rang) dont le nombre était proportionné à la grandeur du navire, ils offraient au ; soldats passagers — les épibates — un abri contre les intempéries. Un plancher construit au-dessus de la sentine ou cale formait, avec la couverte, un entrepont sur le sol duquel chaque soldat avait une place, large d’environ 0m 64c longue de 1m 94c à peu près. Les navires porte-chevaux, ceux qu’en France on nomme navires-écuries, et que les anciens désignaient par le nom d’Hippagogœ, qu’ils fussent ou, non actuaires, avaient un entrepont, ménagé au-dessus de la sentine, et partagé en stalles pratiquées contre la muraille, de chaque côté. Entre ces deux rangées de stalles régnait un corridor pour le service de cette écurie, dont la hauteur était de 2m 20c, nécessaire au développement libre du cou du cheval. La stalle de chaque animal était de 0m 72c. Un navire de 25 mètres de longueur et de 8m 75c de largeur pouvait porter quarante-six ou quarante-huit chevaux. J’ai donné dans mon Glossaire nautique, page 646, le plan d’un navire passe-chevaux du moyen âge ; je crois que cette organisation ne diffère pas beaucoup de celle qui avait été adoptée pour les actuaires hippagogues de l’antiquité. Au moyen âge, une porte était ouverte à l’arrière du navire, pour l’embarquement des chevaux. Quand le chargement était achevé, cette porte, qui devait se trouver au-dessous de la flottaison du bâtiment, était fermée et calfatée. J’ignore si les anciens embarquaient leurs chevaux au moyen de ce grand sabord ; je pense qu’ils n’en usaient pas. Je ne vois, en effet, cet huis nommé dans aucun texte ancien. Probablement les chevaux montaient à bord à l’aide de planches (scalæ) poussées de terre. Avec des palans (trocleœ) ils étaient descendus par les écoutilles[35]. VAISSEAUX LONGS.Dans la seconde famille des vaisseaux, celle que les
Latins désignaient par le nom générique : naves longæ,
les grandeurs ne, variaient pas moins que dans celle des vaisseaux ronds. On
a vu César citer les birèmes ou dicrotes, les trirèmes
ou trières, les quadrirèmes et les pentères
ou quinquérèmes ; ces deux dernières
variétés, nommées plus souvent que les trirèmes, étaient probablement les
plus usitées pour la guerre, alors que César fit ses expéditions dans
l’Adriatique, en Afrique et en Espagne. Il y avait déjà longtemps que la
quinquérème était essentiellement le navire de guerre ; elle avait une
importance — je ne dirai pas une grandeur — qu’on pourrait comparer à celle
que, dans les flottes modernes, ale vaisseau de premier rang ou au moins le
grand vaisseau à deux ponts. Polybe raconte que les Romains, quand ils eurent résolu de chasser les Carthaginois de la Sicile, comme ils n’avaient aucune marine, firent cent quinquérèmes et vingt trirèmes, œuvre difficile, assurément, pour leurs charpentiers tout à fait novices dans l’art de construire les quinquérèmes, cette espèce de navire étant jusqu’à ce moment restée inconnue aux Latins. Polybe dit ailleurs (Hist., liv. Ier, § 63) : Dans une des deux guerres, il y eut à la fois sur le même champ de bataille plus de cinq cents quinquérèmes, et, dans l’autre, environ sept cents. Les Romains en perdirent sept cents, en comptant celles qui périrent dans les naufrages, et les Carthaginois cinq cents. Si l’on compare, ajoute l’historien, ces quinquérèmes aux trirèmes dont se servirent les Perses, les Athéniens et les Lacédémoniens, on conviendra qu’il n’y eut jamais d’armée navale aussi puissante que celle dont il vient d’être question. Au liv. XVI, § 7 des Excerpta, Polybe dit que Philippe, dans son combat contre Attale, perdit, de ses vaisseaux, une décère, une ennére, une heptère, une hexère, dix cataphractès, trois triémiolies et vingt lembes. Il ajoute qu’Attale regretta son propre navire, le vaisseau qu’il montait et qui portait son insigne royal (βασιλέως σκάφος), une triémiolie et deux quinquérèmes coulés à fond. Les Rhodiens eurent à déplorer la perte de deux pentérèmes et d’une trière. Qu’étaient tous ces navires mentionnés par Polybe ? Notons d’abord que César ne nomme ni la triémiolie, ni l’hexère, ni l’heptère, ni l’ennère, ni la décère ; et, de ce qu’il n’en parle point, concluons qu’apparemment il n’avait aucun bâtiment de cette importance dans ses nombreuses escadres. Les vaisseaux qui portaient les noms qu’on vient de lire ne sont point une fantaisie de Polybe et des autres historiens ; ils existèrent sans aucun doute, et les critiques n’ont point hésité à les classer parmi ceux dont se composait la liste très-longue des navires en usage chez les anciens, depuis la scapha modeste, à deux ou trois avirons (scapha biremis, scapha triremis), jusqu’au gigantesque et incompréhensible vaisseau de Ptolémée Philopator, qui, au rapport d’Athénée, était mû par des rames dans un ordre de quarante, dont les plus grandes étaient longues de trente-huit coudées ou environ (20m 34c) ?[36] Au reste, tout ce que les érudits les plus habiles, les plus ingénieux ont pu faire dans cette grande question de l’organisation des rames nombreuses agissant sur les vaisseaux longs, n’a eu qu’un seul résultat, résultat utile, à la vérité : c’est de nous fournir une collection de textes grecs et latins, tirés des meilleurs auteurs, et de réunir en un faisceau, — un véritable fagot d’épines, malheureusement, et dont il est difficile de tirer quelques enseignements certains, quelques mots de claires définitions, quelques explications précises, — de réunir, dis-je, en un faisceau tous les éléments écrits du problème que l’érudition, de son côté, et la science des constructeurs, du sien, n’ont pu résoudre. Ce n’est pas que les solutions hypothétiques aient manqué ; chacun a offert la sienne, et toutes ont été rejetées par les hommes pratiques et par les érudits : les unes, pour n’avoir pas tenu compte de certaine textes que je nommerais essentiels ; les autres, pour être en désaccord flagrant avec les exigences de l’art des constructions navales. Isidore de Séville, Suidas, Scaliger, Lazare Baïf, Godescal Stewechius, J. Scheffer, Marc Meibom, Paulmier de Grantemesuil, Vossius, le père Montfaucon, le père Languedoc, Fabretti, Bourreau-Deslandes, Charnock, Maizeroy, Le Roy, J. Rondelet, John Howel, Auguste Bœck, et le dernier venu (1860), M. Achille Laforetière, n’ont pu se trouver d’accord sur l’emplacement, la disposition, la longueur et le poids des rames ; sur la forme extérieure des navires, enfin sur les proportions des vaisseaux. C’est ce dernier côté de la question qu’ils ont le plus négligé, parce qu’ils ignoraient tous quels rapports existèrent, de tout temps, entre les dimensions principales des vaisseaux : longueur, largeur et creux. Quand le discernement de ces hommes savants a été mis en défaut par les difficultés que présente l’interprétation des textes et des monuments figurés (peints, sculptés ou gravés), peut-on espérer d’être plus heureux qu’eux ? Pour moi, qui, jusqu’ici, m’étais récusé et avais franchement déclaré que mon intelligence ne s’élevait pas jusqu’à la compréhension de l’organisation des rames en trois rangées, superposées comme les trois étages des canons d’un vaisseau de 74 ou de 90 ; appelé longtemps, d’ailleurs, par d’autres travaux qui avaient une importance pratique plus grande, une application plus immédiate que ceux sup lesquels la critique s’est savamment, longuement et vainement exercée, je viens de reprendre l’étude de la question avec une ardeur très grande, je pourrais dire avec une véritable passion, et je crois être arrivé à un résultat digne de quelque attention. Non que j’aie imaginé un système d’après lequel on pourrait faire un navire comme celui de Ptolémée Philopator, comme le vaisseau du tyran de Syracuse Hiéron, auquel Athénée prête des rames en vingt ordres, comme les bâtiments à quinze et à seize ordres de rames de Démétrios Poliorcètes, ou même comme l’octère citée par Memnon ; mais je propose une solution qui rend possible la construction de navires, de trois à sept combinaisons — je ne dis pas : à sept rangs — de rames. Que l’on me permette, pour arriver sûrement à une restitution du navire à ramendes anciens, de ne pas marcher trop vite, de rechercher la clarté dans la discussion, d’examiner avec attention les monuments que j’ai pu connaître, de critiquer avec soin les textes que je puis tenir pour acceptables, et surtout de remonter des temps modernes aux temps antiques, en mettant à profit quelques acquisitions que je fis dans le domaine de l’inconnu, lorsque autrefois j’étudiais les marines du moyen âge et de la Renaissance. Commençons par dire que, dans deux voyages faits en Italie et en Grèce[37] à la recherche des bas-reliefs, peintures et médailles, éléments du travail d’archéologie navale que j’avais entrepris, aucune figure de quadrirème ou de navire désigné par les noms quinquérème, hexère, etc., n’a pu m’être montrée. Je ne vois pas qu’aucun des archéologues sérieux dont j’ai lu les dissertations ait allégué un monument offrant l’image d’un vaisseau ayant plus de trois files de rames, l’une au-dessus de l’autre. Le parti qu’avaient pris quelques graveurs de médailles, quelques sculpteurs, quelques peintres pour rendre sensible la superposition des avirons, leur permettait d’indiquer aisément un quatrième, un cinquième et même un sixième rang de rames. Ainsi, qui aurait empêché l’auteur du navire trirème, appartenant au musée Bourbon, de Naples[38], de multiplier les étages des extrémités inférieures des rames, qu’il montra par-dessous et de côté pour les faire bien comprendre ? Il pouvait mettre quatre épaisseurs de rames sous la carène de sa galère aussi aisément qu’il en mit trois. Le peintre décorateur qui peignit, dans une maison de Pompéi, un navire dont les rames superposées sont indiquées par trois lignes de points marquant le bout des rames allant à l’eau, pouvait fort bien ajouter une quatrième ligne aux trois qu’il dessinait d’un pinceau vif et spirituel (Museo Borbonico, n° MCLXXI). Qui empêchait les graveurs de deux médailles d’Adrien, d’un médaillon de bronze de Gordien III (Trajectus Aug...)[39], et d’un moyen bronze du même Gordien, de donner quatre rangs de rames à des navires qui en ont trois bien visibles, lorsque ce quatrième rang aurait pu être rendu facilement en marquant par une quatrième ligne de points, inférieure à la troisième, les extrémités des quatrièmes avirons ? J’insiste sur cette observation, que les monuments font voir des unirèmes, des birèmes, des trirèmes, bien clairement dessinées, bien évidentes, mais qu’aucun ne montre de navire à quatre ou cinq étages de rames l’un au-dessus de l’autre. On verra bientôt la raison de cette insistance.
Les représentations de navires longs unirèmes sont nombreuses sur les médailles et sur les bas-reliefs. M. Chabouillet, conservateur du cabinet des médailles à la Bibliothèque impériale, a bien voulu me communiquer toutes les pièces de cette riche collection où sont figurés des vaisseaux, et j’ai pu voir beaucoup de ces unirèmes, remarquables par des détails intéressants : emplacement des gouvernails (ou timons), emplacement des rames et du rostre, voilure, etc. Une monnaie de bronze, à l’effigie de Marc-Antoine et de sa femme Octavie, porte au revers une unirème marchant à droite, ayant neuf rames seulement, ce qu’explique le peu de champ de la pièce sur laquelle est figuré ce navire, le timon à bâbord, le rostre d’une seule pointe au bas de la rode ou étrave, un mât debout, planté à peu près au milieu de la longueur du bâtiment, et ce mât portant une voile carrée, orientée au plus près du vent qui souffle de tribord. Cette voile est amurée à tribord, en avant du premier banc des rameurs, et bordée, à bâbord, en avant du poste du timonier. Ce détail, qui atteste l’intelligente attention du graveur, — trop peu d’artistes de l’antiquité ont eu un tel soin pour que je ne le signale pas chez l’auteur de la monnaie qui m’occupe, — ce détail vient à l’appui de ce que j’ai démontré dans mon Virgilius nauticus, touchant la navigation au plus près du vent, connue et pratiquée par les anciens, quoi qu’en aient pensé des humanistes qui, n’étant pas un peu marins, n’avaient pas bien compris le sens de ces vers du cinquième livre de l’Énéide : Una
omnes fecere pedem : pariterque sinistros, Nunc
dextros, solvere sinus : una ardua torquent Cornua detorquentque. (v. 828.) Ni celui du suivant : Cornua velatarum obvertimus antennarum. (Liv. III, v. 548)[40]. Une trirème, représentée sur un des grands bronzes d’Adrien (tête laurée à droite ; Felicitati Augus.) marche à droite, à l’aviron et à la voile. Son velum (ou carbasus) n’a point la forme quadrangulaire de la voile qu’on voit si bien orientée sur l’unirème de Marc-Antoine. Il a celle d’un guidon et ne peut servir que pour la marche, vent grand largue ou vent arrière. Son échancrure est très grande et laisse au capitaine la possibilité de bien apercevoir ce qui se passe à la proue de son navire et loin devant lui. Dans mon Gloss. nautiq., p. 1553, j’ai donné, d’après une peinture de Pompéi, une unirème allant vent arrière sous une voile taillée en guidon. Je la reproduirai plus loin, à propos du rostrum. Une trirème (moyen bronze d’Adrien)[41] marche à gauche à la voile et à la rame. Sa voile est orientée de telle sorte qu’on peut dire que le navire va grand largue, le vent lui venant de gauche. Elle est moins échancrée que celles des navires d’Adrien et de Pompéi que je citais à l’instant. Les anciens avaient, ce qui était fort naturel d’ailleurs, plusieurs espèces de voiles : voiles de plusieurs grandeurs pour les temps différents, voiles pour le plus près et voiles pour le vent arrière. Ils savaient naviguer contre le vent, en louvoyant, comme on a navigué depuis eux. Ils usaient de cette allure, toutes les fois qu’elle leur était possible. Comme nous, ils subissaient le malheur de certaines situations. Quand le vent refusait, c’est-à-dire quand l’angle formé par la direction du vent et par la ligne de la quille du navire se rétrécissait ; quand le vent était trop fort, ils étaient obligés de changer leur route, de mouiller l’ancre, ou, s’ils étaient au large, de fuir devant la tempête. Lorsqu’on voit, parti de Leptis, et poursuivant Varus qui a pu doubler le cap derrière lequel est le golfe d’Adrumète, César contraint de mouiller au sud de ce cap, et d’abandonner la chasse jusqu’au lendemain, il ne faut accuser ni la conformation de ses vaisseaux longs, ni l’ignorance de ses marins. Il obéit à une nécessité à laquelle cèdent souvent les meilleurs navires et les marins les plus hardis.
BIRÈMES.
Les
monuments anciens qui montrent des vaisseaux à deux rangs de rames ne sont
pas très rares. Sans parler de la colonne Trajane[42], le musée du Vatican
possède un bas-relief en marbre[43] représentant un
navire à deux rangs de rames superposées et alternées, sortant de sacs de
cuir, qui semblent attachés au navire par des clous. Les deux rangs
paraissent très rapprochés l’un de l’autre. Un bas-relief de la villa Albani,
cité par M. Anthony Rich, dans son Dictionnaire des Antiquités r Le plus bel exemple que j’aie vu d’une birème antique, et le plus ancien qui existe peut-être, m’est fourni par un peintre d’Étrurie qui exécuta — on croit que ce fut antérieurement à la fondation de Rome — la décoration d’un vase Tyrrhénien. Cette coupe fort curieuse appartient à la belle collection de M. le duc de Blacas, qui m’a gracieusement permis de voir, d’étudier et de dessiner en croquis quatre navires qui en sont le précieux ornement[45]. De ces quatre bâtiments, deux sont navires de charge ; les deux autres sont vaisseaux longs. Les deux onéraires marchent à droite ; les birèmes vont à gauche. Une des onéraires porte, gonflée par le vent, une voile large et peu haute ; la seconde navigue sous une voile à demi repliée par des cargues nombreuses. Quant aux vaisseaux longs, ils vont à la rame et aussi à la voile, sous l’allure du largue, les ailes ouvertes au vent qui leur vient de tribord. Leurs voiles sont de l’espèce de celles dont je parlais il n’y a qu’un moment. Échancrées par le bas, mais non point par une échancrure angulaire, — la leur est largement arrondie, — leurs écoutes (pedes) sont attachées aux extrémités des deux points ou cornes longuement pendantes. Les rames sont en action en même temps que la voile. Ces rames sont ainsi disposées : dans la première birème il y a douze rames au rang supérieur et six au rang de dessous. Les rames ne sont point immédiatement les unes au-dessus des autres. La première du second rang est plus voisine de l’étrave que celle du premier. Au milieu de l’interscalme (l’espace qui sépare les chevilles auxquelles à sont liées les rames), au milieu de l’interscalme des avirons du second rang est placé le scalme de l’aviron supérieur ; ainsi, les trous où se meuvent les rames, sont alternés, de la proue à la poupe, comme dans un vaisseau de ligne moderne les sabords des canons. La seconde birème a douze rames en haut et neuf en bas. Notons, pour ne rien oublier, qu’elle remorque une petite galère non armée.
Pourquoi les ramés inférieures sont-elles moins nombreuses que leurs supérieures ? Probablement, parce que le dernier tiers du navire, du côté de la poupe, très allongé, plus étroit de beaucoup que la partie de la proue, et tout à fait hors de l’eau, eût été trop chargé et trop embarrassé par un double appareil de rames, par un double rang d’hommes maniant les avirons. Pour expliquer le système de ces birèmes étrusques, il y a deux hypothèses également admissibles. D’abord, supposer que les rames du second rang sont appuyées sur le bordage qui fait la jonction de la muraille et du pont de la birème ; imaginer ensuite qu’au-dessus de ce bordage — la gouttière moderne — est élevé un mur d’un mètre environ, sur lequel on a établi les rames du premier rang. Dans cette hypothèse, tous les rameurs sont sur le pont ; ceux qui manient les avirons inférieurs, assis sur des bancs peu élevés, les autres sur des bancs beaucoup plus hauts ; tous assis près de la muraille du navire, pour que le maniement de la rame soit facile et que l’anglé fait par l’aviron et la verticale abaissée du sommet de la muraille ne soit pas trop ouvert. La seconde hypothèse supposera les rames d’en haut appuyées sur la gouttière et manœuvrées par des rameurs assis sur des bancs fixés au pont ; elle fera sortir les rames d’en bas, de sabords percés dans la muraille, au-dessous du pont, celles-ci maniées par des rameurs logés dans un entrepont bas, mais assez haut pourtant pour qu’ils puissent respirer à l’aise et agir un peu librement. Je ne crois pas que de sérieuses objections puissent s’élever contre cette double explication du système des birèmes Tyrrhéniennes. La première peut servir à la restitution de l’ordre des rames des navires birèmes qu’on voit sur plusieurs médailles et sur la colonne Trajane, où l’on remarque des bâtiments ayant un double rang de rameurs, les uns assis assez bas pour que leur tête ne paraisse point, les autres nageant debout ou assis sur des bancs élevés. Quant à la seconde, elle se présenté avec des avantages incontestables ; elle se base sur un fait historique dont je suis, pour moi, très décidé à ne pas méconnaître l’importance. Ces deux explications, disons-le avant d’aller plus loin, me serviront dans un instant, quand je voudrai fonder le système en vertu duquel j’essayerai de restaurer, de faire revivre l’antique navire à trois rangs de rames. Je dis que la seconde hypothèse exposée plus haut a pour elle l’autorité de l’histoire ; je le démontre. Les Grecs du bas empire eurent une marine dans laquelle, se conservèrent certainement plus d’une tradition des marines antérieures Pour la guerre, ils avaient des vaisseaux long$, chez lesquels la rapidité — ce mot ne doit pas être pris dans le sens où il peut et doit être entendu, aujourd’hui que les moyens d’acquérir la vitesse sont tout autres que ceux dont disposait l’homme réduit à son action personnelle, produite à l’aide d’une rame, — des vaisseaux longs, dis-je, chez lesquels la rapidité était la condition essentielle, et que, pour cette raison, l’on nommait Dromons. Ces navires avaient remplacé les antiques vaisseaux de guerre dont les derniers qui eurent une grande importance avaient trois rangs de rames. Continuateurs des trirèmes, seulement parleur destination, les dromons, appelés encore trières par quelques auteurs, leurs contemporains, n’avaient pas trois étages de rameurs. L’écrivain qui nous a laissé le plus de détails sur les dromons, l’empereur Léon VI, nommé : le philosophe et le savant, à qui nous devons un très curieux traité des Tactiques militaires, nous apprend que de son temps (au neuvième siècle de l’ère chrétienne, 900 ans environ après la mort de Jules César) les plus grands dromons, ceux qui étaient le type des vaisseaux de guerre, comme l’avait été plusieurs siècles auparavant la galère trière[46], étaient des navires à deux rangs de rames superposées de bout en bout, ainsi que nous venons de voir que, dans une portion de la longueur de la birème Tyrrhénienne, l’étaient les rames des deux étages. Que tout dromon, dit l’empereur Léon dont nous traduisons le texte de notre mieux, soit long, large en proportion de sa longueur, et porte deux rangs de rames, l’un supérieur, l’autre inférieur. Que chaque rangée ait au moins vingt-cinq bancs pour asseoir les rameurs, l’une de ces rangées à droite, l’autre à gauche. Que le nombre des soldats et des rameurs, rameurs et soldats tout à la fois, soit de cent en comprenant les deux rangs. Voilà qui est formel : deux rangs, l’un supérieur, l’autre inférieur. Pour qu’il ne reste pas de doute sur la nature de cette superposition, l’auteur des Tactiques dit, art. XIX de son chap. Περί ναυμαχίας : Autant que tu le pourras, — il écrit pour son fils Constantin Porphyrogénète — mets les soldats les plus braves, les plus robustes, les plus actifs dans la partie supérieure du dromon (sur le pont assurément) ; car ce sont ceux-là qui doivent en venir aux mains avec les ennemis. Si, parmi tes soldats, tu découvres quelques hommes sans force et sans courage, rejette-les dans le rang inférieur des rameurs. Si tes soldats d’en haut sont mis hors de combat par des blessures, remplace-les par des rameurs du rang d’en bas. Quoi de plus clair et de plus positif ? Comment hésiter à reconnaître que les deux rangs de rameurs se recouvraient dans toute leur longueur ? Comment ne pas admettre que ces deux rangs étaient séparés par un pont ou plancher, et que l’inférieur était dans un entrepont, lorsque le supérieur était à ciel ouvert ? Quant à moi, je ne doute pas plus aujourd’hui de la réalité de la birème à deux étages, le second couvert par l’autre, que je n’en doutais en 1840 et en 1850, quand je publiai mon Archéologie navale, et mon Glossaire nautique où je traitai longuement des dromons et de leur armement en guerre[47]. Ce qui laissait alors dans mon esprit un doute sérieux, c’était la possibilité de la superposition des rames au-dessus de deux étages, ainsi que l’entendirent Scaliger, Scheffer, Paulmier, Fabretti et d’autres critiques. Je ne pouvais admettre que le nombre des étages : j’hésitais, quant à la trirème, et n’osais pas me prononcer-pût grandir de trois à quarante, eu accordant qu’ils se couvrissent les uns les autres comme les deux du dromon-dicrote, si bien établis par Léon VI. Je n’admettais pas davantage que le côté d’un vaisseau long fût comme un escalier sur chacune des marches duquel était assis un ou plusieurs rameurs. Aucun des autres systèmes proposés par l’érudition ne me semblait plus acceptable, tous contredits par quelques textes dont il faut absolument accepter l’autorité, tous en opposition avec les lois de la construction navale. Un des textes sur lesquels se sont appuyés les partisans
de la superposition des rangs de rames se couvrant par étages d’un bout à
l’autre du navire, est cette phrase de Végèce : Quod
ad magnitudinem pertinet, minimæ liburnæ remorum habent sinqulos ordines ;
paulo majores binos, idoneæ mensuræ ternos vel quaternos, interdum quinos
sortiuntur remiqum gradus. J. Rondelet conclut de cette phrase que
les Liburnes[48],
vaisseaux faits par les Romains sur le modèle de ceux des Liburniens, habiles
constructeurs de navires propres à la course, avaient, les moindres, un, seul
rang de rames et ceux qui étaient plus grands, depuis-trois jusqu’à quatre
et-cinq rangs de rames (ou de gradins),
en raison de leur grandeur. Cette manière de traduire me semble un peu
hardie. Pour bien faire comprendre la façon dont il entendait Végèce,
Rondelet donna la coupe d’une quinquérème où les manches des avirons
correspondent à un degré d’un, gradin établi dans l’intérieur du navire[49]. Je ne crois pas
qu’il faille interpréter ainsi un texte que Stewechius né comprit pas mieux
quand il dit : Ces ordres de rames (ordines) ne doivent pas être considérés comme établis en hauteur,
mais bien en largeur. S’ils étaient doubles, triples, quadruples,
etc., les navires étaient nommés birèmes, trirèmes, quadrirèmes, etc. Végèce dit seulement : Quant à ce qui touche à leur grandeur, les moindres liburnes
ont des ordres uniques de rames ; celles qui sont un peu plus grandes, des ordres
doubles ; pour celles d’une grandeur convenable (idoneæ est
bien vague !) les places des rameurs sont
tirées au sort[50] dans des ordres triples quadruples et quelquefois
quintuples. L’ordo est, chez
Végèce comme chez Léon VI, un rang établi dans la longueur du navire ayant
vingt-cinq ou un plus grand nombre d’avirons. Gradus,
que je traduis par : places, étaient, selon moi, les bancs où l’on asseyait
les rameurs, les transtra de Virgile.
Peu élevés, généralement, ils pouvaient être comparés aux marches d’un
escalier.
Mais ne nous arrêtons pas plus longtemps à discuter les termes d’un texte qui a, peu de valeur, car Végèce, qui écrivait au quatrième siècle, n’avait pas sous les yeux de navires plus grands que les birèmes. Les trirèmes, les quadrirèmes et les pentères n’étaient alors qu’une tradition lointaine, et Végèce la faisait revivre, par une hypothèse, pour relier le passé au présent. Il ne savait probablement pas plus ce qu’étaient les trirèmes antiques, que les historiens de notre temps ne savent ce qu’étaient à Lépante (1591) les frégates, les galiotes, les galères subtiles, les galères plus grandes que celles-ci et les galéasses, géants de la famille des navires à rames. Venons au fait de la restitution d’une trirème antique. TRIRÈMES.Je pose d’abord en principe que je n’ai pas la prétention de faire un navire d’une marche supérieure, un navire qui puisse, pour sa vitesse, être comparé à ceux qui reçoivent l’impulsion des roues ou, de l’hélice, mues par la vapeur. Les vaisseaux longs vantés pour leur rapidité par les poètes et les historiens, étaient lents, si nous les comparons aux moins rapides de nos steamers ; véloces, si on les met en parallèle avec les navires de charge (onerariæ), dont la marche pesante et grave les exposait aux coups des galères et des pirates, montés sur des myoparons légers. Ne cherchons donc point la solution du problème que se proposerait de résoudre un ingénieur qui, voulant construire abstraction faite de certains textes, à la lettre desquels il me faut satisfaire, moi — un bâtiment traîné par des rames dans un triple ordre, travaillerait à lui donner la plus grande vitesse possible. L’ingénieur qui ne serait pas tenu à vaincre les difficultés entrevues par l’archéologue marin serait fort à son aise ; il disposerait ses rames, ou comme, les a disposées Rondelet, dans sa coupe de la quinquérème de Végèce, où de toute autre façon qui lui paraîtrait meilleure. J’ai, quant à moi, des obligations auxquelles je ne puis me soustraire ; je ne suis pas libre ; quelques textes me lient, et je dois subir leur étreinte. Ces textes, les voici : Agrippa autem navem Papiæ
petebat maxime, illamque circa proram[51] et concussam perfregit usque ad carinam : qui in ejus
turribus ad propugnandum consisterant, excussi sunt ; MARE IN NAVEM ADMISSUS OBRUIT THALAMITAS
OMNES, reliqui perfracto tabulato natantes
evaserunt. (Appien, De bell.
civil. Rom., liv. V, § 107.) Intrat
diffusos pestis vulcania passim Atque
implet dispersa foros : trepidatur omisso Summis remigio ; sed etiam tam
rebus in arctis Fama mali nondsm tanti penetrarat
ad imos. Silius Italicus, Punic., l. XIV, v. 423. Dans ces vers, Silius Italicus peint l’effet de l’incendie sur le navire que monte l’Africain Himilcon. La flamme jetée par Corbulon du haut d’une tour construite sur des trirèmes liées ensemble (v. 392), embrase le pin, le sapin, le cyprès dont sont faites les œuvres mortes du vaisseau carthaginois ; elle se propage rapidement à droite, à gauche, partout, sur le pont où nagent les rameurs d’en haut, sur les ponts plus élevés de la poupe et de la proue ; le mal va si vite que, pendant que le feu s’attaque à tout, dévore tout aux étages supérieurs, la nouvelle du désastre n’est pas encore arrivée ad imos foros, au pont d’en bas. — Ce mot foros est incommode ; il semble désigner à la fois les ponts ou planchers et les entreponts. Du récit pittoresque de Silius Italicus je ne prétends tirer qu’une conclusion. Si les rameurs d’en bas ignorent encore que le feu ravage tout l’étage supérieur du navire, il faut admettre nécessairement que ces rameurs, le plus bas logés, sont dans UN ENTREPONT INFÉRIEUR AU PONT que ruine la flamme lancée par Corbulon. La même conclusion est à tirer du passage d’Appien dont j’ai cité la traduction latine. Le navire de Papias qu’a frappé celui d’Agrippa est ouvert par l’éperon d’airain, et la mer, pénétrant, sous la joue, dans la partie du bâtiment inférieure à la flottaison, NOIE TOUS LES THALAMITES. Quand je composai mon Glossaire nautique, je n’osai point me prononcer sur le véritable sens du mot thalamite que les savants ont interprété de deux façons différentes, deux scoliastes d’Aristophane ayant dit, l’un que le thalamite était le rameur du rang inférieur d’un navire à plusieurs rangs, l’autre qu’il était le rameur voisin de la proue. Le passage d’Appien que je viens d’expliquer m’avait échappé ; il ne permet aucun doute : les thalamites ramaient tout à fait en bas, à la hauteur du thalamos, chambre du triérarque ou du préteur, laquelle était sans doute à l’arrière et en bas, comme fut toujours la chambre du capitaine, ce réduit étroit, éclairé par le haut et que Pétrone nomme diæta[52]. Les thranites ramaient en haut, sur le pont, à la hauteur du θράνος, siège du capitaine ou petit-être du timonier. Quant aux rameurs, qui, dans les navires plus grands que les birèmes, nageaient au-dessus des thalamites et au-dessous des thranites, ils avaient le nom de zygites. On ne sait pas bien quelle partie du navire, dans sa hauteur, était appelée ζύγος. Pollux dit seulement Τά δέ μέβα τής νέώς ζύγά. Le joug était peut-être la poutre principale, qui, au maître couple, servait de liaison aux deux côtés du navire, la maîtresse latte de la galère moderne, le maître bau du vaisseau rond. Polybe, racontant la perte du navire décère de Philippe, qui était le vaisseau prétorien (ou commandant), dit que ce bâtiment ayant été frappé par l’éperon d’une triérémiolie[53], au milieu de sa longueur, et au-dessous du rang des thranites, la triérémiolie y resta fixée, ce qui gêna fort les mouvements que le timonier voulait donner à la décère. Il y a là une faute étrange que n’ont remarquée ni les éditeurs, ni les traducteurs, ni les commentateurs de Polybe, et que n’a relevée aucun des critiques qui ont entrepris d’expliquer les textes des auteurs anciens où il est question de la marine. Au lieu de θρανίτι dans le passage qui nous occupe, il faut de toute nécessité lire θαλαμίτιν. En effet, l’éperon de la triérémiolie, comme celui de tous les vaisseaux longs, armés pour le combat, était fixé au bas de l’étrave, quelquefois en partie un peu au-dessus du niveau de la mer, mais le plus ordinairement au-dessous, et à demi immergé[54]. Les blessures qu’il pouvait faire n’étaient dangereuses pu pour mieux dire mortelles qu’à la condition qu’il ouvrait un navire à sa flottaison ou un peu au-dessous. Là triérémiolie qui s’attacha à la décère de Philippe ne put donc frapper le flanc du vaisseau qu’à la ligne d’eau, c’es-à-dire au-dessous des scalmes des thalamites, les rameurs du rang le plus bas. Poux admettre le contraire, il faudrait croire que le navire abordeur se serait dressé sur sa poupe au moment où il touchait le navire abordé ; et comment accepter une opinion si- manifestement contraire à la nature des choses ? Il faut donc réformer le texte de Polybe et restituer à l’historien l’expression réelle de sa pensée qui ne saurait être douteuse pour les marins. Les rames des thalamites étaient courtes. Arrien, parlant des birèmes ; dit que leurs rames inférieures étaient rangées peu au-dessus des ondes ; c’est-à-dire que les trous ou sabords de nage par lesquels elles passaient pour aller à la mer étaient fort rapprochés de la ligne de flottaison du navire[55]. Ce n’est pas sans intention que je cite ce détail donné par l’historien des expéditions d’Alexandre (liv. VI)[56]. Je veux m’en autoriser dans la construction que j’entreprendrai tout à l’heure d’une trirème antique. Les thalamites occupaient, au-dessous de la cale, un espace entre deux ponts, où ils manœuvraient des rames courtes, sortant de trous, voisins du niveau de l’eau, assez éloignés cependant de la met pour que la lame que le vent soulevait n’entrât pas dans le navire par ces ouvertures qu’on avait soin de fermer, d’ailleurs, à tous les étages, par des sacs de cuir cloués autour du petit sabord, entourant la hampe de la rame et la serrant, comme la braie de toile goudronnée serre le mât, le piston d’une pompe ou la tête d’un gouvernail dans le vaisseau moderne. Ceci est hors de doute. Il est probable que pendant le gros temps les rames des thalamites étaient rentrées dans le vaisseau, leur usage devenant très difficile, et que les sabords de nage du rang inférieur étaient bouchés jusqu’au retour du calme. Tous les systèmes imaginés par les hommes qui ont cherché à restaurer les navires à rames de l’antiquité sans avoir égard à ces faits, incontestables selon moi, après l’explication que j’ai donnée des passages de Silius Italicus et d’Appien, peuvent être ingénieux, mais ils pèchent par l’inobservation d’un des points essentiels de la question. Ainsi, la, restitution de la quinquérème par gradins, d’après Végèce, proposée par J. Rondelet est inadmissible, le rang des thalamites étant à ciel ouvert au lieu d’être sous un pont. Il est bien clair, que, si les thalamites de la décère de Philippe avaient été assis ou debout sur le degré inférieur du gradin, à cinq marches que suppose Rondelet, ils n’auraient pas été noyés par l’eau, introduite dans le navire ; car ils auraient franchi bien vite le second degré, le troisième et ainsi de suite. D’ailleurs, Rondelet plaçant la première marche de son gradin sur un pont établi au-dessus de la flottaison du navire, le rang des thalamites n’aurait pu être atteint par l’eau qu’un bon moment après le choc du vaisseau de Papias par l’éperon de celui d’Agrippa. Il faut absolument, pour que le texte d’.Appien ait un sens raisonnable, que le pont sur lequel rament les thalamites, plancher établi un peu au-dessus de la cale, le soit au-dessous du tirant d’eau en charge au vaisseau. Dans le cas du vaisseau d’Himilcon bridé par Corbulon, les thalamites de Rondelet auraient certainement connu l’incendie aussi tôt que les thranites, aucun pont ne les séparant de ceux-ci. Me dira-t-on qu’Appien et Silius Italicus sont des auteurs auxquels n’est pas due une foi aveugle ? Je répondrai qu’en effet ce ne sont point deux écrivains qui se soient occupés particulièrement-de la marine ; mais quels sont les écrivains antiques qui ont été spéciaux sur ce chapitre ? Quels sont, après Virgile, les historiens ou les poètes qui aient laissé des ouvrages qu’on puisse alléguer comme mieux renseignés sur ce qui touche à la construction navale, à la manœuvre des vaisseaux, à la navigation ? Aucun traité spécial d’art nautique n’est venu, des temps antiques à nous, et Léon VI se plaignait, il y a neuf cents ans, de n’avoir trouvé, dans les écrivains de l’antiquité, aucun renseignement précis sur l’art de la marine. Nous en sommes dont réduits à choisir, parmi les auteurs anciens, ceux qui parlent avec intelligence des choses de la marine, — intelligence que reconnaissent aisément les marins, — et je dois dire qu’Appien et Silius Italicus, pour moi, sont de ceux-là. Je les vois en général exacts, et dans le cas présent, comme rien ne me paraît répugner à la raison dans leurs récits, comme il me semble très vraisemblable que les choses purent se passer ainsi qu’ils les racontent, je tiens leurs textes pour fort respectables, et je les invoque, convaincu que je suis qu’ils ne peuvent pas me tromper. Allons donc en avant, sans nous arrêter à une objection qui me parait peu fondée. Il est un préjugé fortement établi parmi les savants, les marins et les gens du monde, à savoir : que les anciens avaient seulement de petits navires ; par des exemples assez nombreux, j’ai démontré dans mon Archéologie navale, que le même préjugé qui existe à propos des navires du moyen âge est sans fondement. Tout ce qu’on lit dans les historiens dignes de foi sur les bâtiments à rames, de quelque manière qu’on entende l’organisation de leurs avirons, prouve assez qu’il y avait de grands vaisseaux longs. La rencontre de la décère de Philippe avec la triérémiolie témoigne de la grandeur de ce navire qui, attaqué par un bâtiment plus petit, resté attaché à ses flancs, écrasa l’équipage de la triérémiolie et ne put être vaincu que par deux quinquérèmes qui, venues l’une d’un côté, l’autre de l’autre, la percèrent de leurs éperons et finirent par la prendre d’assaut et la couler. Il est assez connu qu’à la bataille d’Actium les vaisseaux d’Antoine et de Cléopâtre, qui dépassaient de beaucoup en grandeur ceux d’Octave et par là étaient plus lourds et moins obéissants aux volontés de leurs capitaines, durent surtout à cette exagération de la masse la défaite qui déshonora Marc Antoine. Plutarque dit qu’Antoine mit plus de vingt mille hommes, munis de lourdes armes, sur les meilleurs et les plus grands de ces vaisseaux, de dix à trois ordres de rames[57]. L’historien ajoute que les vaisseaux à Octave-Auguste, non seulement avaient peur d’attaquer par l’avant ces navires qu’armaient de puissants éperons d’airain, mais encore qu’ils ne se hasardaient guère à les attaquer, en flanc ; car, au choc, leurs rostres moins solides se brisaient dans le ventre de bâtiments revêtus de bordages très-épais qui recouvraient des membres d’un bois de fort échantillon, liés ensemble par du fer. Il arriva là à Octave ce qui était arrivé à la flotte de Jules César dans son combat contre les hauts et gros navires des Vénètes. Dans une restitution des vaisseaux longs des Latins, on ne doit pas craindre de paraître exagéré en supposant des bâtiments de dimensions égalés à celles de certains navires du moyen âge et des temps modernes. Les galères ordinaires du dix-septième siècle qui continuaient, à quelques différences près, inutiles à mentionner ici, les galères subtiles du seizième, traditions elles-mêmes de celles qui les avaient précédées, avaient généralement cent pieds (32m,48) de longueur en quille, onze pieds six pouces (3m,73) d’élancement à la poupe, et quatorze pieds et demi (4m,71) de quête à la proue ; ce qui faisait que la longueur totale de la galère, d’un bout à l’autre, sur le pont, était de 40m,92, ou, en chiffres ronds, de 41 mètres. Sa plus grande largeur était de dix-neuf pieds (6m,17) ; le rapport de la longueur à la largeur était donc de 7 à 1 environ. La galère, sur le pont, au point vertical correspondant au talon de la quille, était large de dix pieds environ (3m,24), et au-point vertical, correspondant à l’attache de l’étrave à la quille, de quatorze pieds et demi (4m,71). Le creux, mesuré de la quille au pont, était de sept pieds six pouces. La hauteur du pont à la flottaison était d’environ trois pieds (0m,97). L’appareil des rames, plus haut d’environ deux pieds, était à 1m,62 environ de cette ligne d’eau. Il faut remarquer que les rames étaient établies sur des pièces de bois latérales au navire qu’elles élargissaient, surtout vers la poupe et la proue, en l’encadrant dans un vaste rectangle dont ces apostis, comme on les nommait, étaient les grands côtés, quand les petits côtés étaient formés par les jougs de poupe et de proue, deux pièces de bois qui portaient, sur leurs extrémités extérieures les apostis de gauche et de droite. Les médailles d’Adrien, les deniers d’argent de Marc-Antoine et le médaillon de Gordien III, allégués plus haut, montrent, en général, au-dessus du premier rang des rames ou du rang unique des avirons, une forte pièce de bois d’où semblent sortir les rames. C’était quelque chose d’analogue à l’apostis ; les Romains le nommaient columbarium ; parce que c’était de là que les rames descendaient pour aller plonger leurs pelles dans la mer (κολυμβάω, je plonge). Par extension, les trous ou petits sabords d’où sortaient les rames à tous les étages, recevaient le nom de columbaria[58]. Les rames des galères modernes, à vingt-cinq ou vingt-six avirons de chaque côté, étaient longues de 11m,69. Sûr cette longueur, douze pieds (3m,90) étaient donnés à la partie de la rame comprise entre la poignée où s’appliquait la main du premier rameur, ou vogue-avant, et le tolet où s’attachait l’aviron sûr l’apostis. La partie extérieure de la rame, celle qui, partant du tolet, allait à l’eau, était de vingt-quatre pieds (7m,80). L’intervalle entre chaque tolet ou scalme était de. quatre pieds (1m,30), ou quelquefois un peu moindre. (Description d’une galère, Ms. in-fol. appartenant au Dépôt de la marine.) Sur les données de cette galère, qui diffèrent peu de celles que j’ai, pu recueillir dans les manuscrits des treizième, quatorzième et quinzième siècles, traitant de la construction des navires à rames, on pourrait très bien, selon moi, restituer une galère unirème antique. En diminuant les dimensions de la galère du dix-septième siècle, qui pouvait être des moyennes au temps de César et d’Auguste, on obtiendrait une unirème pontée (lecta), ou non, pontée (navis longa aphracta, non tecta) ; et je pense qu’on serait très voisin de la vérité, si l’on ne tenait pas compte de quelques modifications dans les, façons de la carène et dans celles des œuvres mortes. La galère unirème, cataphractée ou couverte, grandie dans toutes ses parties, serait, à mon sens, la base de la birème à vingt-cinq rames basses et vingt-cinq rames hautes, le dromon-dicrote ordinaire de l’empereur Léon VI. RESTITUTION D’UNE PETITE TRIRÈME.Quant à la galère trirème, après bien des essais, des doutes, des tâtonnements, voici ce que le proposerais si j’étais appelé à donner mon avis sur le parti à prendre pour la construction d’une trirème à l’antique, et sur la restitution de galères plus grandes, celles qui ont porté les noms de quadrirème, quinquérème, hexère, heptère et octère. Je supposerais un navire, large à sa flottaison, de 5m,80 et long de 42 mètres, dans le rapport, par conséquent, de 1 à 8, ou un peu moins, rapport plus favorable à la marche que celui de 1 à 7, et qui n’est pas sans exemple dans ce que je connais du passé des galères. Ainsi Marino Sanuto (liv. II, partie 4, ch. II), indiquant à Jean XXII les proportions des galères de son temps (quatorzième siècle), lui disait qu’elles avaient vingt-trois pas et deux pieds vénitiens (40m,63) de longueur totale, et 5m,27 de largeur in ore (à son ouverture), c’est-à-dire à la hauteur où était établi le pont ou la couverte. Cette hauteur, mesurée au milieu du navire, de la quille au pont sur lequel étaient placés les bancs de la chiourme, était de 2m,49. Dans mon projet, cette hauteur le creux mesuré de planche en planche serait de 2m, 90. On voit flue je n’invente guère et que si-je suis un peu plus grand dans toutes les dimensions que je suppose, je garde, entre ces dimensions, les mêmes rapports que pour des galères, réputées bonnes marcheuses, prescrivaient les charpentiers du moyen âge, continuateurs assurément de leurs devanciers. Tout le système d’apostis, de jougs, de parapets, pour asseoir les rames, mettre à couvert les rameurs et fournir aux soldats des lieux de combats munis de remparts, ajoutait un-assez grand poids à celui de la coque ; je voudrais que les hauts de la trirème Bissent moins lourds. J’élèverais la muraille du navire d’un mètre seulement : cette muraille aurait d’échantillon (épaisseur) 0m,20. Ma trirème aurait 1m,80 de tirant d’eau, en charge. A vingt centimètres au moins au-dessous de la ligne de flottaison, je construirais un plancher où pont, couvrant la sentine, avec laquelle il communiquerait par des écoutilles toujours ouvertes, afin de laisser l’air se renouveler dans cette cale. Là seraient placées deux des pompes destinées à vider les eaux, qui, sans cette précaution, croupiraient sur le lest de pierre et empesteraient les rameurs de l’étage le plus bas. Sur le pont dont je viens de parler, et dans un entrepont que je suppose borné par un second pont, construit à la hauteur de 1m,60, je placerais mes rameurs thalamites. Je pourrais donner à cet entrepont un peu plus d’élévation pour laisser plus de liberté aux rameurs ; mais 1m,60 est la hauteur de l’entrepont dans quelques brigs de guerre, à voiles, et j’ai pensé qu’en asseyant le rameur sur un banc haut de 0m,45, hauteur d’une chaise ordinaire, cet homme ne serait point gêné dans son action, qui consisterait à faire mouvoir une rame longue seulement d’environ 4m,15[59]. Cette rame sortirait d’un petit sabord, rond ou carré, incliné à l’horizon, et dans lequel serait planté le scalme auquel devrait être attaché l’aviron. Arrien, comme on l’a vu plus haut, dit que la rame inférieure d’une birème était très voisine de l’eau ; dans ma supposition, le point où la rame du thalamite reposerait dans le sabord de nage serait au-dessus de la ligne de flottaison de 0m,70. Cette rame assez légère, dont le manche attrait C mètre environ de longueur, serait d’un maniement très-faciles allant chercher son point d’appui dans la mer à 2m,10 du flanc du navire. Logés comme je viens de le dire, les thalamites seraient dans les conditions où les placent les textes d’Appien et de Silius Italicus que j’ai rapportés plus haut, et dont j’ai dit que tout ingénieur, tout archéologue, tout critique, devrait ne pas négliger les termes, sous peine de ne point satisfaire aux données essentielles du problème à résoudre. Mes thalamites seraient d’ailleurs dans cet entrepont que l’empereur Léon VI donnait aux rameurs du rang inférieur de son dromon à deux étages. Mon hypothèse, sous ce dernier point de vue, a donc pour elle trois textes qu’on m’aurait opposés certainement, et avec beaucoup de raison, si je les avais négligés ainsi que l’ont fait tous les savants ingénieurs et aussi tous les érudits qui, étrangers à la construction navale, ont tenté la restitution des vaisseaux longs antiques. Ne sachant qu’en tirer, ils ont pris le parti facile de paraître les ignorer ou de les rejeter sans les discuter, procédés également indignes de la science. Venons aux rameurs du deuxième rang, à ceux que, selon le scoliaste d’Aristophane, on gommait les zygites. Rien n’est mieux établi que l’inégalité des rames dans les navires à deux ou trois rangs d’avirons superposés. La raison est contraire à leur égalité : à quoi servirait, en effet, que la rame du thalamite fût égale à celle du thranite ? Cette longueur, loin d’être un avantage, serait un obstacle pour les rameurs du rang d’en bas. Les médailles ne laissent aucun douté sur l’inégalité des rames. Toutes celles que j’ai alléguées ci-dessus montrent bien la rame la plus haute, plus grande que celle qui lui est immédiatement inférieure, et celle-ci plus longue que la dernière, très voisine de la mer. Les bas-reliefs du musée de Naples, la trirème peinte, empruntée à la décoration d’une maison de Pompéi, confirment le fait attesté par les médailles, fait nécessaire et qui est affirmé d’ailleurs par Galien. Cet auteur dit, au chap. XXIV du livre Ier de son traité De usu partium corporis humani (j’emprunte le texte latin de Kühn) : Quemadmodum, opinor, et in triremibus remorum extremitates ad unam œqualitatem perveniunt, quum tamen insi omnes non sint œquales. Ceci est très juste et fort bien observé : quand elles sont dans l’eau, les rames paraissent égales. Elles s’introduisent, en effet, dans la mer autant l’une que l’autre ; mais, descendant de hauteurs inégales, elles ne sont point également longues. Ce qui me semble moins bon, c’est la comparaison que fait le docte Galien de la main de l’homme avec les rames de la trirème. Quelle analogie put-il remarquer entre nos doigts et les rames placées sur des plans différents, leviers inflexibles qui, plongeant de hauteurs inégales dans l’eau où elles entraient à peu près l’une autant que les deux autres, remplissaient un office qui n’avait aucun rapport avec celui que, remplissent les doigts de la main humaine, dont Galien admirait, avec raison assurément, l’intelligente composition, qui les rend propres à saisir les objets ; grands ou petits, plats ou sphériques, minces ou gros ? J’avoue, pour moi, que ce qu’il peut y avoir de rapports entre le doigt le plus long de la main et la plus longue rame de la galère à trois rangs, entre l’auriculaire et la rame du thalamite, ne me frappe aucunement. Mais enfin, si je passe condamnation sur une comparaison qui m’étonne et que je sais empruntée par le médecin de Bergame au philosophe de Stagire qu’il copie souvent, et que, cette fois, il reproduit sans critique, chose surprenante de la part d’un esprit fin et délicat, d’un observateur ordinairement exact et scrupuleux ; si, dans le texte de Galien, je ne veux voir autre chose que cette affirmation qui m’intéresse : Les rames de la galère à trois rangs étaient inégales, je ne puis cependant pas ne point m’arrêter à une phrase complémentaire de Galien, qu’Aristote écrivit aussi, à en croire toutes les éditions de ses œuvres, phrase étrange qu’il faut citer ici. Voici ce que dit Aristote : Καί ό έσχατος δέ μικρός όρθώς, καί ό μακρός, ώσκερ κώπη μέσον νεώς[60]. Voyons maintenant ce que Galien a fait de cette observation : Καθάπερ, οΐμαι, κάν ταϊς τριήρεσι τά πέρατα τών κοιπών είς ΐσον έξκινεϊται, καίτοιγ'ούκ ΐσων άπασών ούσών, τοιγαροΰν κάκεϊ τάς μέσας μεγίστας άπεράγζονται διά τήν αύτήν αίτίαν[61]. M. Ch. Daremberg, exact et savant traducteur de Galien[62], rend ainsi ce passage : Il en est de même, je pense, sur les trirèmes où les extrémités des rames arrivent sur la même ligne, bien qu’en réalité les rames elles-mêmes ne soient pas égales. C’est pour la même raison qu’on fait les rames DU MILIEU les plus longues. Rapprochant, comme il le devait, la brève affirmation d’Aristote, de la paraphrase de Galien, M. Daremberg a traduit ainsi les quelques mots d’Aristote que j’ai rapportés : C’est avec raison que le dernier doigt est petit, et que le doigt du milieu est grand, de la même manière que la rame DU MILIEU dans un vaisseau. Ainsi-, selon Aristote et Galien, et du consentement de Casaubon, de Kühn et de M. Charles Daremberg, les doigts de la main humaine, faits pour se ployer et saisir, peuvent être-comparés aux rames d’une trirème, parce qu’ils paraissent égaux en longueur quand la main est fermée, comme les leviers qui poussent le navire, inégaux d’ailleurs, sont égaux en arrivant à l’eau ; bien plus, et c’est là ce qu’il y a de tout à fait singulier, la rame du milieu fut faite la plus longue, par analogie avec le plus long doigt ou médius. C’est à n’y pas croire ! Comment Aristote, qui avait dû voir des trirèmes, comment Galien, qui, dans ses nombreux voyages sur mer, put étudier la forme et l’organisation des navires à rames, en vinrent-ils à prétendre que la rame du milieu dans la trirème était la plus grande ? Les monuments, d’accord avec les textes, nous font voir la rame du milieu moins-grande que la rame qui descend de l’étage le plus élevé, plus grande que la rame du rang le plus bas ; et il y a de bonnes raisons pour qu’il en soit ainsi. Quand les auteurs anciens ne nous auraient pas appris que la rame du thranite, partant du rang le plus élevé, était la plus longue, par conséquent la plus lourde et la plus difficile à manier, ce qui valait au thranite une paye plus forte que celle des rameurs des rangs inférieurs[63], le bon sens nous avertirait que la rame du milieu, celle du zygite, devait être moins longue que celle du thranite : car pourquoi aurait-elle été plus longue, quel profit aurait rapporté au navire cet aviron qui aurait été chercher la nier plus loin que l’aviron thranite et la : rame thalamite ? Cette grandeur de l’aviron zygite est contraire à la logique autant qu’au fait, et il est aussi impossible de l’admettre qu’il l’est de comprendre par quelle singulière inadvertance Aristote la supposa. Une faute dans les premiers manuscrits d’Aristote, toujours reproduite pendant trois siècles, aura abusé Galien, qui l’aura acceptée sans la remarquer ou sans oser la signaler : je ne saurais expliquer autrement l’étrangeté des assertions que je reproche à Galien et à son prédécesseur, assertions qui préconisent une chose incroyable et qui n’a jamais été vraie, de quelque combinaison qu’aient fait usage les constructeurs de trirèmes, trois cents ans avant notre ère. . J’en demande bien pardon aux traducteurs d’Aristote et de Galien, mais ils se sont laissé tromper par des paroles qui n’ont pas de sens raisonnable, ou, pour mieux dire, qui présentent le plus fâcheux contre-sens. Quant à la comparaison du système des doigts de l’homme avec l’appareil des rames de la galère trière, si l’on voulait absolument l’établir, on ne pourrait le faire qu’en regardant la main ouverte et non fermée (comme le dit Galien), en voyant complaisamment, dans le doigt médius la rame du thranite, dans l’annulaire la rame du zygite, dans l’auriculaire la rame du thalamite ; en supposant, enfin, que les extrémités de ces doigts correspondent aux sabords d’où sortaient les avirons de la galère, et que la partie de la main où s’attachent les phalanges représente la mer, où arrivaient égales les rames, inégales en longueur. Mais à quoi bon une pareille comparaison, qui n’a rien de frappant ni d’utile ? Laissons à Galien ce qu’il a dit d’excellent sur la conformation de la main ; retranchons de son traité, comme de celui d’Aristote, ce que tous deux ont dit de la rame du milieu, faite à l’image du doigt médial, et comme lui plus longue que les autres avirons[64]. Revenons aux rames du second rang de ma trirème. Je me garderais bien de les faire plus longues que celles du premier ; et je les placerais sur le pont, limite supérieure de l’entrepont des thalamites. Les zygites y seraient assis sur des bancs peu élevés, de 0m,20 par exemple, — c’est bien la moindre hauteur qu’on pourrait donner à ces sièges, — et feraient mouvoir des rames de 6m,40, dont la partie antérieure (garnie de plomb) aurait de longueur 1m,40. La partie extérieure, longue de 5 mètres, irait chercher son point d’appui dans l’eau à 3m,60 du flanc de la trirème. La rame du zygite passerait par un sabord où le tolet serait fixé à un point distant, en hauteur, de 1m,05 de la ligne des scalmes thalamites. Disons que cette rame, balancée sur le seuillet de son sabord, ne serait pas lourde et pourrait être aisément manœuvrée par un seul homme. Ajoutons que notre navire aurait une rentrée de 0m, 45 au plus, à la hauteur du pont supérieur ; cette rentrée serait de 0m,20 à la hauteur du plat-bord. La hauteur totale de la trirème, mesurée sur son côté, de la flottaison au sommet du plat-bord, serait de 2m,55. On remarquera que je veux rester dans des limites étroites pour construire un navire qui, en respectant les textes que je regarde comme sacramentels, serait dans de bonnes conditions d’existence. J’ai d’ailleurs un motif pour me tenir, en construisant cette petite trirème, fort au-dessous des dimensions que j’aurais pu proposer pour la construction d’une trirème aussi grande que le furent les galéasses des quinzième et seizième siècles. Ce motif, le voici : la grandeur des galéasses sera celle à laquelle j’arriverai pour la restitution de l’hexère, comme j’entends qu’elle devait être. Les zygites placés ainsi que je viens de le supposer, je placerais les thranites sur le pont des zygites, et sur des bancs, élevés à la hauteur du siège du capitaine, le thranos. Le banc du thranite serait élevé de 0m,50 environ ; sa rame, dont le manche serait garni de plomb, comme celui de l’aviron du zygite, traverserait un sabord percé dans le plat-bord à 0m,70 au-dessus du pont ; elle aurait de longueur 8m,75 et irait chercher son point d’appui dans l’eau à 5 mètres du flanc de la trirème. La ligne des scalmes des thranites serait à 0m,40 au-dessus de celle des scalmes des zygites, celle-ci étant au-dessus des scalmes des thalamites de 1m,05. Je pourrais assigner un autre emplacement à la rame du thranite. J’ai dit ci-dessus que plusieurs des trirèmes gravées sur les médailles paraissent avoir une pièce de bois d’où semblent sortir les rames des galères unirèmes et les rames thranites des galères trières. Cette pièce est une sorte d’apostis que je pourrais établir en dehors du navire, au moyen de consoles ou corbeaux qui s’éloigneraient de la muraille de cinquante centimètres environ. Un petit plancher la relierait à la muraille ; une balustrade s’élèverait sur son rebord extérieur ; les pieds de ce parapet s’appuyant sur la tête des corbeaux. C’est sur cette pièce extérieure que je placerais les scalmes des rames maniées par les thranites. Ces rames auraient, dans ce cas, de longueur totale 9m,25, au lieu de 8m,75, cette différence étant au bénéfice du manche, qui, en grandissant ainsi, rendrait plus aisée la manœuvre de l’aviron. Ajoutons que le petit balcon dont je viens de parler devrait être attaché à la muraille de la galerie à 50 centimètres au-dessus de la rangée des sabords de nage des zygites.
Les sabords des thranites, ceux des zygites et des thalamites, n’étaient point, chez les anciens, placés immédiatement au-dessous les uns des autres comme sont les fenêtres d’une maison : ils étaient dans un ordre oblique, ainsi que, dans un vaisseau moderne à plusieurs batteries, sont les sabords, ouverts en échiquier aux canons. Les sabords de nage, que j’aurais pu écarter les uns des autres de 1m,13 à 1m,29, — et c’est de ces quantités qu’étaient distants les scalmes des rames sur les galères du moyen âge et des siècles plus rapprochés de nous, — je les écarterais seulement d’un mètre, afin de multiplier les rames et d’augmenter la vitesse de la trirème. Quant à la position respective des tolets, elle serait marquée par des distances de 0m,50 ; ainsi, en admettant que le premier aviron de l’avant fût celui d’un zygite, au-dessus de lui et en arrière serait l’aviron d’un thranite à 0m,50 de distance, et au-dessous, à 0m,50 de la rame de celui-ci, serait l’aviron du thalamite.
Les rames seraient au nombre de cent soixante-seize, maniées chacune par un homme d’une force moyenne, dont le travail équivaudrait au huitième de celui d’un cheval de vapeur[65]. L’ensemble des forces de ces rameurs serait donc représenté, selon là manière actuelle de compter, par vingt-deux chevaux. Ce n’est pas beaucoup sans doute, mais c’est à peu près ce qu’obtenait une galère ordinaire du dix-septième siècle, mue par vingt-cinq rames de chaque bord, chaque rame maniée par cinq hommes, qui tous ne donnaient pas toutes leurs forces dans le labeur pénible de la nage, les uns par paresse, le& autres parce qu’ils se fatiguaient vite, ceux d’ailleurs qui étaient les plus voisins du scalme produisant naturellement moins d’effet que leurs camarades. Mes cent soixante-seize rames seraient ainsi réparties : de chaque côté, vingt-neuf thranites, trente zygites et vingt-neuf thalamites. Ce nombre de rames pourrait être augmenté en grandissant un peu la trirème dans sa longueur. Pour la poupe, où devaient être les timoniers, je suppose deux gouvernails suspendus aux flancs de la trirème, près de l’arrière, un de chaque côté[66], — où devait être aussi le thranos, siège du capitaine, je réserverais une longueur de 5 mètres, qui permettrait de placer des soldats pendant le combat et quelques matelots pour manœuvrer les écoutes de la voile. A la proue serait un espace, plus arrondi que triangulaire, ayant 7 mètres de longueur, élevé au-dessus du pont de 1 mètre environ, théâtre pour les soldats et plate-forme sur laquelle devrait s’ériger une tour de bois, construite avant le combat, et dont les pièces, pendant les navigations ordinaires, et quand aucune apparence de lutte ne nécessiterait la construction de la tour, seraient cachées sous cette teugue de l’avant, à l’extrémité de laquelle on garderait une place pour les ancres, les grappins d’abordage et les machines à lancer des pierres et des flèches. Il est bien entendu que la partie de la poupe laissée au capitaine serait élevée aussi et plus haute que la teugue de l’avant[67], car il faudrait que, de cette dunette[68], le triéarque pût tout voir aisément pour veiller sur toutes choses, stans cella in puppi, comme Virgile le dit d’Anchise. Sur le pont des thranites et des zygites, je tracerais une coursie, allant de l’avant à l’arrière, dans toute la longueur des 30m, occupés par les rameurs. Ce passage (aditus, agea, πάροδος)[69] serait large de 1m,20. Dans, la coursie, je percerais les écoutilles, ouvertes pour la communication de là cale et de l’entrepont avec le pont supérieur, écoutilles pouvant être couvertes par des panneaux à claire-voie (caillebotis). Dans la coursie encore serait pratiquée une ouverture longue pour le mâtage et le démâtage de l’arbre ou mât (ίστός, malus), enlevé quelquefois pendant le combat, et rangé, ainsi que les antennes, le long de la coursie, laquelle serait limitée à droite et à gauche par une petite muraille en bois, comme l’était celle des galères modernes. En avant du modius, conduit demi-circulaire qui descendrait du pont à la quille et recevrait le mât, fixé dans cet étambrai par un cercle de fer, et implanté dans une pièce de bois creusée, fixée à la quille ; je placerais une pompe allant du pont à la sentine (sentina, άντλος). J’ai dit plus haut que deux pompes seraient établies dans l’entrepont ; cette troisième serait un utile auxiliaire pour elles[70]. Entre les bancs des zygites et le plat-bord, serait un espace d’un demi-mètre environ ; j’y mettrais en réserve, à tribord et à bâbord, une douzaine de rames de rechange pour les thranites et les zygites. J’en voudrais autant dans l’entrepont des thalamites. Cet entrepont servirait de dortoir pour les soldats pendant la nuit, et d’entrepôt-pour les voiles, les câbles, les armes et les pièces des machines de guerre, montées seulement alors qu’on croirait ‘à une rencontre hostile. Les parties de l’entrepont, placées sous la poupe et sous la proue, devraient être occupées par les logements du capitaine et des officiers de la trirème. A la poupe, le thalamus, contenant la petite niche recevant les images des dieux protecteurs du navire[71], le lit et la table à manger ; à la proue, quelques petites chambres pour le second triéraque, les centurions des troupes embarquées, et le pilote. Il est inutile de dire que la sentine contiendrait, outre le lest (arena, scaburra, έρμα), les vivres en petite quantité, l’eau et les cordages pour faire des haubans, des drisses de voiles, etc. Je n’ai point encore tout dit ; mais il me reste peu de chose à dire. Je ne veux parler ni de la quille (carina, τρόπις), ni de l’étrave, ni de l’étambot, ni des couples (statumina), — côtés du navire, membres arrondis comme des U, largement ouverts ou un peu plus resserrés, mais non, pas jusqu’à devenir anguleux comme le V, — ni des planches qui serviraient à couvrir la carcasse de la trirème, à faire son bordage : il ‘me suffira de dire que tout ce qui serait pièce principale et fondamentale de l’édifice devrait être en chêne ou rouvre, et tout le reste de la construction, en pin, sapin, cèdre ou aulne[72]. Je mentionnerai, comme importantes et ne devant pas être oubliées, des ceintures ou préceintes, au nombre de deux ou de trois. Peut-être que deux suffiraient à notre petite trirème ; plus grande, elle en aurait voulu certainement trois. Chacune de ces ceintures serait en chêne et aurait une épaisseur peu considérable. Je les placerais sous les sabords des rames des zygites, et sous ceux des rames thalamites. Si j’en supposais une troisième, elle se placerait entre ces deux-là[73]. Les anciens, toujours et partout préoccupés des choses de l’art, ne laissaient pas plus sans ornements les détails de l’architecture navale que ceux de l’architecture civile ; je voudrais donc que ces préceintes fussent décorées d’un ornement léger, mais visible et produisant un certain effet. Ce goût de la décoration, les Grecs et les Romains le portaient loin dans la fabrication de leurs navires ; aussi, au-dessus de la proue et de la poupe, faisaient-ils des constructions légères qui affectaient des formes agréables, embrassant dans leur contour extérieur la poupe et la proue, qu’elles continuaient en s’élevant, se rétrécissant, et se recourbant quelquefois en dehors et le plus souvent en dedans[74], comme nous le montrent les médailles. Ces constructions, dont la forme générale était celle de la moitié postérieure du bonnet phrygien, étaient nommées du nom générique στόλος (ornement). Celle de la poupe recevait pour acrostole, ou décoration placée à son extrémité, une sorte de panache nommé άφλαστον par les Grecs et aplustrum ou amplustrum par les Latins. Ce panache, analogue à la queue d’un coq, et que montrent un grand nombre de médailles, était fait de planches d’un bois mince ; il pouvait s’adapter au stole et s’en retirer à volonté. Dans les combats on défendait l’aplustre, comme on aurait défendu son enseigne. On emportait l’aplustre d’un navire vaincu, et l’on en parait son navire vainqueur ; Juvénal a dit quelque part : Victæque triremis aplustre[75]. L’aplustre était toujours doré ou peint de couleurs éclatantes. L’acrostole de la proue se terminait à sa partie recourbée par un bouclier, une spirale, une boule, une volute, que les Romains, après les Grecs[76], nommèrent corymbe. Quelquefois un casque[77] était mis à l’extrémité de l’acrostole de proue ; quelquefois l’un des deux acrostoles se recourbait en dehors et se façonnait en col d’oie, ornement qui prenait le nom d’anserculus[78]. La petite oie figurait plus souvent à la poupe qu’à l’avant. Je voudrais qu’on ne négligeât aucun de ces détails ; je voudrais aussi qu’on établît à la poupe, dans le stolos, un tabernacle, ou autrement, une tente sous laquelle devrait être placé le siège du patron ou du capitaine. J’en ai dit quelques mots plus haut. Les Grecs nommaient ce tabernacle σκηνή (tente à pavillon, hutte). Arrien dit : Quand le navire qui portait le roi fut près du camp, ce prince ordonna qu’on enlevât la tente de la poupe de son vaisseau, voulant être bien vu de tous[79]. Ce pavillon était donc mobile et facile à démonter. Je n’oublierais pas la figure placée à la proue, l’image du dieu ou des dieux peinte à la poupe, et ; plus indispensable encore, l’arme de la galère, le rostre ou éperon. A la poupe je peindrais[80] Castor et Pollux, Minerve, Apollon, Isis, Neptune ou le père des dieux[81]. Si le navire était consacré à Jupiter et portait son nom au front de la trirème, au-dessus du massif de bois que terminerait l’éperon, et le dos appuyé à l’étrave, je mettrais l’Aigle aux ailes éployées et tenant la foudre dans ses serres. Au-dessus de cette figure ou παράσημον, et au-dessous du στόλος, je ferais écrire le nom du navire Jupiter, Minerve, Apollon, etc., dans un cadre rond ou ovale, le scutulum des Romains. Ce cadre serait noblement orné. Quelques galères portaient à l’avant, à la place où sont les écubiers modernes, une paire d’yeux peints, mais non percés, qui ne servaient point au passage des câbles. Je ne négligerais pas cette décoration, qui me paraît avoir été assez générale pour que j’en tinsse compte[82].
L’arme offensive qui, selon Pline, fut imaginée par Pisée et attachée par lui à l’étrave du vaisseau de guerre[83], l’éperon, nommé rostrum par les Romains et έμβολον par les Grecs, fut d’abord, comme ce dernier nom le dit, une sorte d’épieu greffé sur la pièce de bois courbe dont était formée l’étrave de la galère, que les Italiens appelaient au moyen âge la rota di proa, et les Provençaux, la rode (roue) de proue. Cette pointe eut, à une certaine époque, la forme d’une pyramide ou d’un cône ; faite d’airain, elle s’enfonça dans un massif de bois destiné à fortifier le bas de l’étrave et à recevoir cette pièce de métal, qui devait être assez solidement tenue dans l’espèce d’encastrement où elle entrait, pour ne pas être ébranlée ou démontée par le choc, dans le conflit où elle jouait un grand rôle[84]. L’éperon fut façonné quelquefois en forme de corne,-d’ergot, ou de bec d’oiseau de proie (rostrum) ; certaines médailles et la colonne Trajane montrent des proues de galères munies d’un éperon, dont la pointe relevée devait être d’un médiocre effet, et devait d’ailleurs empêcher le navire abordeur de se détacher aisément du navire abordé, quand il lui avait porté un coup de sa corne. L’éperon droit, fait d’une tête d’animal, — de porc surtout, comme on le voit dans la birème que j’ai donnée ci-dessus, et dans l’unirème qui figure ci-après au commencement de la seconde de ces Études ; comme on le voit encore à l’extrémité d’un rostre de bronze, trouvé dans le port de Gênes, dont parle Misson dans son Nouveau Voyage en Italie (1717), tome III, page 41, et qu’ont gravé le P. Montfaucon et d’après lui, M. Rich ; — l’éperon droit, fait à deux ou à trois dents, le dernier surtout, fut longtemps en usage sur les navires antiques. Un grand nombre de médailles publiées par différents auteurs, un bas-relief reproduit par Scheffer, la trirème du musée Bourbon, que j’ai donnée ici, page 108, la birème publiée par Piranesi[85], la galère unirème de Pompéi, que j’ai gravée dans mon Archéologie navale (t. Ier, p. 24), les médailles de la famille Lollia, représentant les rostres de la tribune aux harangues, les petites médailles de Marc-Antoine, un grand nombre d’as romains, montrent l’éperon à trois dents[86], si d’autres as représentent des proues aux rostres à une et à deux dents, si toutes les médailles d’Adrien, grands et moyens bronzes, portent l’image de la proue armée de l’éperon à une seule pointe conique ou pyramidale, plus ou moins longue. Comme, au temps de Marc-Antoine et de Virgile, l’éperon était à trois dents, c’est l’éperon tridens[87] que j’établirais sous le parasémon, en l’introduisant dans un massif composé : 1° de deux courbes de bois, fortes, tendant à se rejoindre à angle aigu, et s’appliquant à l’étrave, de telle sorte que l’angle fût un peu au-dessous du tirant d’écu du navire ; 2° de deux pièces, fortes aussi, venant, des flancs du bâtiment, à la pointe dont je parle, et composant, avec les deux premières, un corps pyramidal, dont le sommet ouvert recevrait l’éperon[88]. Quant à la construction de ce corps, il n’est pas un maître charpentier qui ne trouvât le moyen d’y parvenir, et de couvrir convenablement ce squelette du προέμβολον d’un bordage se mariant d’une manière agréable à la proue et à la partie du vaisseau inférieure aux joues.
Il était deux armes de guerre, particulières aux vaisseaux longs ; que je ne dois pas oublier : l’une — elle était double, celle-ci — adhérente au navire, ainsi qu’y adhérait le rostrum ; l’autre, que l’on suspendait au mât, quand le combat était imminent, et dont on se servait, comme d’un bélier, au moment de l’abordage. La première avait le nom grec έπωτίς, dont l’équivalent latin n’est mentionné dans aucun document antique ; la seconde, nommée par Homère ξυστόν ναύμαχον ; est désignée par le nom latin asser, dans le traité De re militari de Flave René Végèce. Cette dernière est le sujet d’une courte Étude qu’on trouvera à la suite de celle que le lecteur a maintenant sous les yeux[89] ; quant à l’autre, voici ce que nous en apprennent les textes anciens et les médailles qui nous sont venues de l’antiquité. L’épotide était une pièce de bois, forte, pointue par une de ses extrémités, taillée en biseau par l’autre, laquelle était solidement attachée à la joue (παρειά) du navire, au moyen de longues et solides chevilles d’airain. L’épotide, faite pour défendre le vaisseau long de l’abordage, si son éperon était brisé ou démonté, dans le conflit entre lui et un vaisseau ennemi, dépassait le front du navire ; mais sa saillie était moins grande que celle du rostre. Il y avait, de chaque côté de la trirème, une épotide, dont la pointe était probablement garnie de bandes de fer ou d’airain. Toutes les galères n’avaient pas d’épotides[90], et l’on voit sur les médailles des représentations d’unirèmes, de birèmes et de trirèmes, qui ne montrent point l’épotide ; mais le plus grand nombre en étaient munies. Suidas dit quelque part : De navires de charge, on fit de robustes navires de guerre, en leur attachant des épotides. Nous avons vu, Vatinius transformer en bâtiments de combat des actuaires, en les munissant d’éperons. Thucydide raconte (liv. VI), que les Syracusains, pour rendre plus propres à la guerre les navires de leur flotte, fortifiaient leurs proues avec des pièces de bois enlacées à l’intérieur, et leur attachaient d’épaisses épotides. Dion, parlant (liv. XLIX) de deux armées navales, qu’il compare entre elles, dit que dans l’une étaient des vaisseaux imposants par leur hauteur, par leurs tours et la grosseur de leurs épotides, et dans l’autre des vaisseaux ayant l’avantage de l’agilité. Appien raconte un combat où des navires attaquèrent leurs adversaires, les uns aux flancs, d’autres aux épotides, d’autres encore de front et rostre contre rostre. Scheffer a mal compris Appien, car il a dit : Cirea has epotides impetus plerumque fiebunt a rostris, uti videmus apud Appianum De bello civ. L’éperon ne pouvait point frapper autour des épotides, mais à la flottaison, à l’endroit que dominaient la joue et l’épotide. Appien dit : un coup que reçut ce navire, sous l’épotide le brisa ; un historien de ce temps-ci pourrait dire dans le même sens : un boulet que reçut ce vaisseau à la flottaison, sous la joue, lui fit une grande trouée. Un historien futur pourra dire sans doute, en parlant des navires modernes, comme Appien : un coup d’éperon donné au bâtiment ennemi, sous la joue, lui fit une large blessure. Je voudrais qu’on mît à ma trirème, pour qu’elle fût tout à fait romaine, deux épotides, dût-on trouver étrange cet accessoire, qui se présenterait à l’avant comme deux lances en arrêt, défenses du vaisseau, au cas où le rostre viendrait à lui manquer.
On connaît maintenant tout le système que je proposerais ; on sait comment j’imagine que peut être construite une petite trirème grecque ou latine ; et l’on a vu quel usage j’ai fait de, textes que je tiens pour très sérieux, et sans l’application desquels, si l’on peut créer une trirème marchant peut-être fort bien, on ne-refera pas une galère antique. Mon hypothèse n’est point d’un savant hasardeux, qui, sans connaître la marine et les conditions d’existence d’un vaisseau long, se livre à un travail arbitraire, cherche une solution ingénieuse et, des termes du problème posé, néglige ceux qui l’embarrassent. J’ai abordé de front toutes les difficultés. Me fondant sur le dromon grec du neuvième siècle ; enfermant, avec Appien, Silius Italicus et l’empereur Léon VI, les thalamites dans un entrepont, en partie au-dessous du tirant d’eau de la galère ; plaçant avec Arrien, la rame du thalamite à très peu de distance. de la mer et la faisant courte, par conséquent ; donnant à mon navire justement les proportions et la grandeur de la galère commune du moyen âge, recommandée au pape Jean XXII, je couronne mon édifice par un arrangement de rames en deux rangs, l’un plus élevé que l’autre, arrangement qui, selon moi, explique très convenablement l’ordre, indiqué par le sculpteur de la colonne Trajane, et par les graveurs de quelques médailles qui font voir, au-dessus du plat-bord des trirèmes, deux rangées d’hommes, dont les uns ne montrent que leurs têtes et les autres leurs bustes entiers ; combinaison que j’ai indiquée d’ailleurs, en décrivant la birème de la belle coupe tyrrhénienne qui appartient à M. le duc de Blacas. Toute raisonnable que me parut la solution proposée ici pour le problème de la restitution des trirèmes antiques, elle ne pouvait me satisfaire qu’à la condition, de recevoir la sanction de la science. Il me fallait savoir si mes données étaient bonnes, si la trirème que j’entrevoyais, au travers des textes grecs et latins et des documents du moyen âge, marcherait un peu, évoluerait sans trop de peine, serait enfin un vaisseau long réalisable dans la phatique : dans le doute où j’étais, j’ai invoqué le secours d’un homme spécial qu’une curiosité intelligente a poussé à connaître, des marines anciennes, bien des choses que ne savent pas tous les constructeurs, et que plusieurs même regardent en pitié, comme des vieilleries sans utilité, persuadés qu’ils sont qu’hier ne peut rien pour demain. Cet ami dévoué[91] a bien voulu relire avec moi les textes et entendre mon interprétation des passages difficiles qu’ils contiennent ; il a critiqué ensuite mes chiffres, et en a substitué quelquefois d’autres aux miens pour arriver à un résultat acceptable par les marins et les constructeurs de navires. Je dois beaucoup à son obligeance. Sans lui, mon travail serait resté fort imparfait et je n’aurais pas osé le produire. Je le donne avec quelque confiance, en insistant toutefois sur ce point capital, qu’un ingénieur aurait certainement projeté un navire à trois rangs de rames, dans des conditions meilleures, au point de vue de la marche ; que celui dont on vient de lire la description ; mais que je n’étais pas libre de faire mieux, renfermé, comme on m’a vu, dans un cercle de documents édits ou figurés ; dont je ne pouvais pas me dégager. Je ne prévois pas, au reste, quelles puissantes objections on pourrait opposer à mon système ; car, pour la rapidité, nous obtenons celle que recherchaient les meilleurs maîtres de hache (constructeurs des galères, maestri d’axia) dans la fabrication des navires à rames. Selon nos calculs, ma petite trirème, qui aurait cent soixante-seize rames, maniées chacune par un-homme, cent vingt-quatre hommes d’état-major, de timoniers, de soldats, et dont par conséquent l’équipage complet serait de trois cents hommes, aurait un déplacement total de 220 tonneaux, construite qu’elle devrait être, partie en bois de chêne, et partie en bois de sapin, et ses rames étant de sapin et non de hêtre, comme le furent, dans les derniers siècles de l’existence des galères, les avirons des bâtiments de cette famille navale. Voici le détail de ce déplacement de 220 tonneaux : Poids de la coque (Σκάφος, corpus navis), 110 tonneaux ; œuvres mortes de la poupe et de la proue, tour, machines de guerre, etc., 24 tonneaux ; matériel d’armement, mâture, rames, gréement, ancres, voiles, rechanges, etc., 40 tonneaux ; équipage, effets d’habillements, 3 tonneaux ; vivres et eau pour quinze jours, 25 tonneaux ; enfin, armes, ustensiles, objets divers, 18 tonneaux. Nous estimons que la trirème, construite suivant les proportions et dimensions que j’ai dites, et ayant un déplacement de 220 tonneaux, aurait une vitesse approximative, en calme, de 4 milles marins et demi, c’est-à-dire qu’elle ferait, à la rame, 8.133m par heure, ou une lieue marine (5.555m) et 2.578m (un peu moins d’une demi lieue)[92]. Eh bien, c’était à peu près là ce que faisait une galère du seizième ou du dix-septième siècle. Armée de bons rameurs, une galère bien construite parcourait dans une heure l’espace de 5.520 toises, dit l’auteur d’un ancien Traité des galères. Or, 5,520 toises sont représentées par 10.758m, qui font 6 milles marins, moins 384m. Le résultat auquel nous sommes parvenus, dans cette restauration d’une petite’ trirème antique, n’a donc rien qui doive, étonner ; les galères modernes ne marchaient pas mieux que ma trirème hypothétique[93]. Quatre nœuds cinq dixièmes de vitesse à l’heure ! qu’est-ce que cela aujourd’hui ? C’est de quoi faire sourire de pitié un ingénieur et un marin, que l’application de la vapeur aux navires a dit habituer à l’idée des longues courses, promptement accomplies ; mais la marine des Romains, contemporaine de César, est antérieure de plus de dix-neuf cents ans à la mariné à feu. Quand nous nous occupons des trirèmes césariennes, ne nous souvenons pas des pyroscaphes ; admirons le navire à hélice, sangs mépriser son père ; le navire à rames, dont la longue histoire, depuis le siège de Troie, jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, est pleine de hauts faits, et qui, ne servît-il que de remorqueur au vaisseau de guerre, dans des combats où sa part fut moins belle, mérita encore que l’on reconnût sa puissante utilité. (Voyez Mémoires de Villette, sur l’année 1704.) TRIRÈMES MOYENNES ET GRANDES.Au-dessus de la petite galère à trois rangs de ramés, dont j’ai essayé une restitution que je crois pratique, étaient des trirèmes moyennes et de grandes trirèmes ; cela n’est pas douteux. Il ne serait pas difficile, en grandissant ma petite trirème, de faire une trirème, des moyennes, ayant 50m de longueur à la flottaison, 6m,25 de largeur, 3m, 33 de creux, trente rames de zygites, trente-cinq de thranites et autant de thalamites, tribord et bâbord, c’est-à-dire, en tout, deux cent quatorze rames, au lieu des cent soixante-seize que, dans mon projet, aurait.la petite trirème. Les rames supérieures, étant plus grandes que leurs correspondantes dans celle-ci, recevraient à leur manche, près de la poignée, une plus grande masse de plomb, qui en faciliterait l’évolution. Les anciens usaient de ce procédé ; il n’est rien de moins ignoré. Athénée le dit positivement (liv. V). La tradition du plombement des rames s’était conservée dans les marines de la Méditerranée, jusqu’à la fin de l’existence des galères. On emplombait le manche de la rame, au moyen d’une plaque de plomb, nommée Platine, qu’on fixait sous cette partie intérieure de l’aviron[94]. Aujourd’hui encore quelques avirons sont plombés au manche. Quels seraient le déplacement et la marche de la trirème moyenne, construite comme je la conçois ? C’est un calcul à faire, mais qui importe assez peu ici, ce semble. Quant à la grande, à la plus grande des trirèmes que je puisse imaginer dans ma pensée, elle pourrait atteindre la taille et les dimensions de la galéasse des seizième et dix-septième siècle, dont j’ai assez longuement parlé dans mon Archéologie navale (t. I, p. 386-410), et dans mon Glossaire nautique (p. 738-39). La galéasse était le plus grand des bâtiments de la famille des galères. Selon Bartolomeo Crescentio et le capitaine Pantero-Pantera, qui résuma plus d’un passage de la Nautica mediterranea du Bartolomeo, la galéasse du seizième siècle était longue en quille de 46m,31, et, d’un bout à l’autre, sur le pont, de 56m. Elle était large, à la maîtresse latte, de 6m,65, ce qui, à la flottaison, la faisait large de 7m au moins. Crescentio ne dit pas quel était le creux de ce bâtiment ; il pouvait être d’environ 3m. Une galéasse vénitienne du dix-septième siècle, dont, en 1835, je vis dans l’arsenal de Venise, un très beau modèle, était un peu plus grande que celle de Crescentio ; voici ses dimensions : longueur totale, 59m,10 ; longueur, en quille, 46m, 30 ; largeur, 9m,01 ; creux, à la maîtresse latte, 3m,35 ; hauteur, de la quille au rebord supérieur du parapet, 6m,32. Le tirant d’eau, en charge, de ce navire pouvait être de 3m et un peu plus, car la galéasse portait une lourde artillerie, un équipage de rameurs considérable, des rames très longues et par conséquent très lourdes ; et puis les bois de chêne et de rouvre entraient pour beaucoup dans sa construction. La galéasse avait 3m,33 de hauteur au-dessus de l’eau. Pourquoi la grande trirème n’aurait-elle pas cette hauteur au-dessus, de la mer ? Pourquoi rabaisser toujours par la pensée, les bâtiments à rames de l’antiquité ? Comment ceux qui ne veulent reconnaître que des navires peu élevés sur l’eau, peu allongés et peu larges, pour les vaisseaux longs des anciens, expliqueraient-ils ce passage, où Cicéron, parlant de la quadrirème faite à Centorbe (Catane), pour Cléomène, dit : Erat ita magna, ut si in prœdonum pugna versaretur, urbis instar habere, inter illos piraticos myoparones videretur. Sans doute urbis instar est une façon de parler fort exagérée. Cette hyperbole était assez ordinaire, et nous voyons que Virgile ne dédaigna pas de l’employer pour faire entendre quelle était la grandeur du navire nommé la Chimère[95] ; mais, si éloignée que fût de la vérité cette comparaison, il reste toujours que la quadrirème centuripinienne était gigantesque, si on la comparait au myoparon, navire à rames dont les pirates faisaient un grand usage, et qui, pour remplir son office d’écumeur de mer, devait pouvoir porter des vivres, des armes, deux voiles au moins, et un assez grand nombre de bandits résolus. Le myoparon devait être léger pour que les vaisseaux longs, unirèmes, agiles et lestement emportés par leurs avirons, ne pussent pas l’atteindre. Assurément, je reste au-dessous de la vérité, en prêtant à la grande trirème antique des dimensions très voisines de celles qu’avait la galéasse, navire dont l’existence ne dépassa guère la longueur : de deux siècles. Une avant-garde de galéasses rendit de bons services à l’armée chrétienne au combat de Lépante, en 1574 ; indépendamment des grandes galères, quelques galéasses figurèrent dans cette Invincible armada dont, en 1588, les destins furent si malheureux. Les constructions navales se perfectionnant, les vaisseaux de ligne grandissant, l’artillerie prenant une plus grande importance dans l’armement des bâtiments de guerre, les galères n’eurent plus qu’un rôle secondaire et la galéasse, très coûteuse d’ailleurs, disparut. Pour des raisons analogues et des causes différentes, les très grands vaisseaux à rames disparurent des flottes de l’antiquité. Ils coûtaient fort cher ; les longs pins, nécessaires à la confection de leurs rames (on sait qu’une rame doit être faite d’un seul brin de bois) devenaient de jour en jour plus rares, et se payaient davantage : à l’abordage, les petits navires avaient raison de ces éléphants de la mer, quand les Romains de César montaient ces navires petits ; enfin, ils avaient une marche lente et lourde, inconvénient inhérent à leur masse et que les galéasses gardèrent aussi, ce qui les perdit dans l’esprit des peuplés. marins modernes. Pantero-Pantera dit dans son Armata navale : La galéasse, étant pesante et d’une grande masse, évolue lentement. Qui sait si ce qui arriva aux bâtiments à rames superposées, des plus grandes dimensions, et, plus tard, aux galéasses, n’arrivera pas, dans un temps-prochain, aux colosses des armées navales actuelles ? Qui peut assurer que, d’ici à dix ans, on n’aura pas renoncé à construire des vaisseaux portant trois ou quatre rangées de canons ?... Si ce n’est pas la grande galère des Grecs et des Romains que nous sommes appelés, à voir restaurer, peut-être est-ce quelque chose d’analogue à celle du moyen âge, que nous reverrons. La grande frégate moderne, portant une seule batterie sur le côté, armée d’une batterie puissante à l’avant, front perpendiculaire au plan de la quille ; munie, à l’arrière, d’une batterie de retraite parallèle à celle de la proue ; la frégate portant au1as de son étrave l’éperon antique à demi noyé, et fendant la mer the sa corne unique, ou de son trident redoutable ; la frégate allant droit à l’ennemi, la poitrine cuirassée, et ne présentant le flanc que le moins possible[96], ce qui lui serait plus facile avec l’hélice, qu’à la galère avec ses rames longues et embarrassantes ; cette frégate, dis-je, propre au combat, rapide, évoluant avec facilité, sera bientôt, je le crois fermement, l’arme unique, le seul vaisseau long d’un usage commun. Mais, ce n’est pas de l’avenir que nous avons à nous préoccuper ici ; revenons au passé, dont, au reste, selon mon opinion, l’avenir ne nous a guère écarté. Ma grande trirème aurait à peu près les dimensions de la galéasse vénitienne aux 59m de longueur. Les thalamites y seraient logés dans un entrepont qui pourrait avoir 1m,94 de hauteur, au lieu de 1m,80. Sur le pont, les zygites et les thranites seraient installés, ainsi qu’on les a vus dans mon projet d’une petite trirème. Les thalamites conserveraient la rame de 4m,15 ; les zygites et les thranites manieraient des rames emplombées, celles des zygites longues de 8m,45 environ, celles des thranites, longues de 4m,75 ou à peu près. Que la longueur de cette rame supérieure n’étonne pas trop ; il s’en faut de 1m,19 qu’elle soit aussi grande qu’était celle de la rame de la galère ordinaire, laquelle avait, nous l’avons dit plus haut, 11m,69, dont 7m,80 hors du navire. La rame de la galéasse avait 13m,77 de longueur ; il est vrai qu’elle était manœuvrée par six et quelquefois par sept hommes. Rien ne nous empêche de mettre deux ou trois rameurs à la rame thranite et deux à la rame zygite, car aucun texte ne dit formellement que, dans les grands navires à rames, les avirons étaient maniés par un seul rameur[97]. Bartolomeo Créscentio dit que, dans les galéasses, lesquelles avaient seulement vingt-cinq, vingt-six ou vingt-sept rames de chaque bord, l’intervalle entre chaque rame était plus grand que dans les galères communes ; or, l’interscalme des galères ordinaires était de 1m,13 ou 1m,29, ainsi que je l’ai déjà dit. Les rames des galéasses devaient être écartées l’une de l’autre de 4m,75 ou environ. Ce que les anciens eurent principalement en vue, et, en ceci, les modernes les imitèrent, quand ils grandirent les vaisseaux de guerre jusqu’à faire le vaisseau à QUATRE batteries, qu’on nomme le vaisseau à TROIS ponts, bien qu’en effet, il ait CINQ planchers ou ponts, ce que, dis-je, les anciens eurent principalement en vue, lorsqu’ils grandirent leurs trirèmes, ce ne fût point assurément d’augmenter la vitesse de ces navires ; ils voulurent surtout élever le polit supérieur, pour que les remparts, qui se superposaient à cette couverte, tout autour du bâtiment, et les tours que l’on montait au moment du combat, dominassent les ponts et les tours des vaisseaux moins hauts sur l’eau que les grandes trirèmes. Faisant application de cette observation que je crois vraie, et qui a pour elle le fait de 1a construction, depuis l’antiquité, de bâtiments pour la guerre plus grands que la, galère ordinaire, je ne donnerais à ma grande trirème que les cent soixante-seize rames dont j’ai pourvu la petite, et j’écarterais ces avirons de 1m,50 ; ce qui supposerait le navire long en quille de 45m. Il était de règle, en effet, au moins durant le moyen âge, que tout le système des rames fût établi sur les membrés du navire qui s’ajustaient dans les entailles faites à la quille. Mais en voilà assez, je pense, sur les trirèmes ; venons aux vaisseaux longs, qu’on appelait quadrirèmes et quinquérèmes, et dont César cite plusieurs fois les noms. QUADRIRÈMES.Rappelons ce que j’ai dit plus haut : aucun monument parmi ceux que j’ai pu connaître, parmi ceux que je vois cités par les savants qui ont écrit sur la marine antique, ne montre la figure d’un navire à plus de trois étages superposés de rameurs. Les bas-reliefs, les peintures, les médailles, ne sauraient donc être allégués en faveur de l’opinion très généralement établie que,- dans la quadrirème, les rames se rangeaient comme, dans les batteries d’un vaisseau à trois ponts, les canons sont rangés aux sabords en quatre étages : première batterie, deuxième batterie, troisième batterie, batterie des gaillards — celle-ci à ciel ouvert, quand les autres sont dans des étages formés par des ponts successifs. Les textes ne sont d’aucun secours pour la solution du
problème posé devant la critique par le nom quadriremis.
De tous les auteurs anciens, Cicéron est celui qui donne le plus de détails
sur la quadrirème et voici tout ce qu’il en dit (je
traduis) : Cléomène ordonna qu’on dressât le
mât de sa quadrirème de Centorbe, qu’on levât les ancres et qu’ont mit à la
voile. En même temps, il fit le signal à tous les autres navires de le
suivre. Ce navire de Centorbe était d’une incroyable vitesse à la voile (erat incredibili
celeritate velis) ; car personne
ne pouvait savoir ce que chacun des autres navires eût pu faire à la rame
contre ce vaisseau, commandant de la flotte. La quadrirème était couverte (constrata) et si grande que, comparée aux autres bâtiments, elle
ressemblait à une forteresse ; et si elle avait dû combattre des pirates,
elle aurait paru comme une ville à côté des myoparons corsaires. Ainsi, la quadrirème de Catane marchait très bien à la voile ; Cicéron ne dit pas quelle était sa rapidité à l’aviron. Il parle de sa taille, qui lui donnait l’air d’une forteresse, à côté des autres vaisseaux longs de la flotte, et l’apparence d’une ville, à côté des myoparons, petits bâtiments des pirates ; de sa longueur exacte, de sa hauteur, mesurée froidement à la coudée du charpentier, et non au compas hyperbolique du poète, du nombre de ses étages, du nombre de ses rameurs, de la quantité et de l’arrangement de ses rames, pas un mot. Cicéron, comme Tite-Live, Polybe, Thucydide, César, Florus et les autres historiens, parlent des navires de leur temps, sans en dire autre chose que leurs noms qui les faisaient très bien reconnaître de leurs contemporains. Quelquefois ils ajoutent que tel navire était grand, rapide ou tardif, bon voilier ou lourd à la rame ; mais c’est tout. Des navires antérieurs à eux, ils disent seulement les noms, ou parce que ces bâtiments sont encore traditionnellement connus des marins ; où plutôt parce qu’ils n’en savent rien de plus. Nos modernes historiens n’en font pas d’autres ; ils disent : Un vaisseau de ligne, un soixante-quatorze, un vaisseau à trois ponts ou simplement un trois-ponts, et, s’ils se comprennent bien eux-mêmes, s’ils sont compris des marins, ils ne le sont pas des gens du monde, qui ne connaissent guère la marine. Ils seront complètement inintelligibles pour tous dans cent ans d’ici, comme le sont pour eux-mêmes, je n’en excepterai pas les historiens de la marine qui se croient le plus autorisés, comme le sont, dis-je, les écrivains qui ont raconté les campagnes navales du moyen âgé, les combats rendus au quinzième siècle et au seizième, les grandes luttes des vaisseaux de Louis XIV contre ceux de la Hollande et de l’Espagne. Lucain (liv. III, v. 528-31) ; parlant de la flotte Césarienne ; dit : Cornua
romanæ classis, validæque triremes, Quasque
quater surgens exstructi remigis ordo Commovet,
et plures quæ merguntæquore pinus Multiplices cinxere rates. et les érudits, les traducteurs, les commentateurs se sont entendue pour reconnaître, dans ces vaisseaux, des galères que mettaient en mouvement quatre rangées de rameurs, s’élevant, les unes au-dessus des autres. Est-ce bien ainsi qu’il faut entendre le texte de Lucain ? Faut-il voir aussi une galère à six rangs de rames montant l’un au-dessus de l’autre, dans ce vaisseau prétorien (le vaisseau amiral, comme on dit en Europe depuis les croisades)[98] que montait D. Brutus au combat de Marseille et que Lucain décrit dans ces trois vers, très bien tournés d’ailleurs : Celsior
ac cunctis Bruti prætoria puppis Verberibus
senis agitur, molemque profundo Invehit, et summis longe petit æquora remis. Un des traducteurs de la Pharsale, un excellent humaniste, M. Philarète Chasles, a rendu ainsi ce passage et le précédent : Aux deux extrémités (de la flotte romaine), les galères aux triples avirons, celles dont les rameurs sont étagés sur quatre rangs..... mais au-dessus de tous les autres, le vaisseau de Brutus élève sa poupe prétorienne ; dirigé par une chiourme à six rangs, il s’avance comme une tour sur la mer profonde, et ses plus hautes rames s’étendent au loin sur les eaux. Au lieu de cela, voyons ce qu’il y a réellement dans les lignes sonores du poète, qui voulut frapper le lecteur par la recherche curieuse de la précision dans le détail : Les deux cornes (ailes) de la flotte romaine et les solides trirèmes, enveloppèrent et les navires, que met en mouvement l’arrangement quadruple des rameurs, placés dans la hauteur (du bâtiment) et plusieurs (autres vaisseaux) qui plongent dans l’eau des rames plus nombreuses. — Multiplices signifie tout à la fois, ce me semble, qui croissent en nombre et qui sont rangées en plusieurs et diverses combinaisons. Ce mot est intraduisible, si on veut le rendre par un mot français unique —.... Mais plus haut que tous les autres, le navire prétorien, sur la poupe duquel se montre Brutus, est entraîné par les six coups simultanés des rames ; il meut sa masse (énorme) dans la mer, où elle s’enfonce profondément, et, de ses rames les plus hautes, va chercher, loin de ses flancs, les eaux (où sera leur point d’appui). Il n’est point question de tour dans les vers de Lucain. L’auteur de la Pharsale, qui, en peignant la poupe prétorienne de Brutus plus haute que celle des autres vaisseaux longs : birèmes, trirèmes, quadrirèmes et quinquérèmes, a donné une suffisante idée de l’élévation de l’hexère montée par le préteur de la flotte romaine, veut faire comprendre qu’elle causait un grand déplacement d’eau et que sa masse pesante s’enfonçait beaucoup dans la mer. Cela est très bien. Au reste, tout est bon dans ce morceau[99], auquel il n’était pas sans intérêt peut-être de rendre sa signification véritable ; car torts ceux qui ont traité de la marine antique, l’ont cité et l’ont traduit avec une liberté qui en a singulièrement altéré le sens. Puppis pour navis est, dans ces vers, une chose de détail que je loue très fort. Le préteur se tenait à la poupe, où était son siège et son enseigne ; Lucain prit soin de le dire ; imitant en cela Virgile, toujours rigoureusement exact sans cesser d’être élégamment poète. Je crois très sincèrement avoir rendu à la lettre, en le commentant, le passage mal interprété de la Pharsale, et avoir fait dire à tous les mots importants ce qu’ils doivent dire et rien autre chose. Si je me suis trompé, il ne me coûtera pas de l’avouer ; car, ici comme toujours, je suis de bonne foi. Après y avoir mûrement réfléchi, après avoir regardé de très près les termes sur lesquels les commentateurs ne se sont pas trouvés d’accord, je n’ai pu reconnaître dans le navire au quater ordo surgens remigis une galère à quatre rangs de rames élevés en étages, pas plus que je n’ai reconnu un vaisseau long à six étages de rameurs, dans la prætoria puppis aux verberibus senis. Mais comment étaient ordonnées les rames de la quadrirème et de l’hexère ? Je puis le dire, ou du moins, avec toute la réserve que commande un sujet si longtemps controversé, je vais exposer mes idées sur cette organisation, qui a donné matière à tant de discussions vaines, à tant d’ingénieux systèmes, sans applications possibles, à tant de volumes savants et pax malheur inutiles. Écartons d’abord toute idée de navires, trop hauts sur l’eau, trop longs, trop larges, et pour cette raison si difficiles à manœuvrer qu’ils devenaient inutiles[100]. Cherchons à faire des navires utiles, de ceux dont parle Polybe, des quadrirèmes, des quinquérèmes, et puisque. Lucain nous a amené à nous occuper de navires à ordre de six, des hexères moyennes, vaisseaux maniables et propres au service. La quadrirème dont l’auteur de la Pharsale décrit en cinq mots l’appareil de propulsion, n’était point un vaisseau à quatre rangs de rames superposés les uns aux autres, c’est-à-dire qu’elle n’avait point d’avirons placés plus haut sur le plat-bord que les rames thranites de ma grande trirème : c’est ma conviction, et je la crois très fondée. Le quater ordo surgem remigis du poète, n’implique pas en lui l’idée d’un quartus ordo surgem au-dessus du tertius ordo qui s’élevait lui-même au-dessus du secundus et du primas ordo ; comme je l’ai dit, il indique l’arrangement quadruple des rameurs placés dans la hauteur du bâtiment. A ma façon d’interpréter les vers de Lucain, opposera-t-on
que je parais ne point tenir compte du mot surgem,
qui semble se rapporter à quater ? Je
répondrai que j’en tiens un grand compte, et qu’il suffit pour moi que le triplex ordo de la trirème soit surgens, pour que le quater ordo le soit lui-même : Il est bien évident que la
quadrirème, trirème pourvue d’un quatrième ordre de rames est surgens, puisque la trirème l’est elle-même. Pour
moi, la trirème que j’ai imaginée grande comme la galéasse du seizième
siècle, grandissant en longueur, en largeur et en creux, sans s’élever à
proportion, pouvait devenir quadrirème par l’adjonction d’un quatrième ordre
de rames doublant le rang des thalamites ; et voici comment. Le sabord de
nage du thalamite, doublé, ou à peu près, dans sa largeur, pourrait recevoir
un second aviron un peu plus long que son parallèle, et manié par un rameur
assis à côté du premier thalamite, sur le banc de celui-ci. Ce siège, dans
cette combinaison des rames à deux par banc, au lieu d’être perpendiculaire
au plan vertical passant par la quille, lui serait incliné d’une Certaine
quantité. J’ai dit que, dans.la grande trirème, les sabords de nage seraient
éloignés les uns des autres de 1m,50 ; dans la quadrirème, l’interscalme
pourrait être de 2m. Je pense que l’ouverture du sabord pour une rame, étant
de 0m,60, serait de 1m,20 pour le sabord de deux avirons. J’incline du côté
de la poupe le banc des deux rameurs, de telle sorte que si, de son extrémité
éloignée de la muraille du navire, — celle où devait s’asseoir le deuxième
rameur, — on abaissait une perpendiculaire sur la muraille, l’intervalle
compris entre le pied de cette perpendiculaire et l’extrémité du banc des
thalamites supposé prolongé jusqu’au bordage intérieur, serait de 0m,80. Le
banc ainsi incliné vers l’arrière de la quadrirème, porterait, nageant l’un à
côté de l’autre, à la distance d’un mètre ; les deux thalamites, le premier,
le plus voisin de la muraille, manœuvrant une rame de 4m,15 environ, l’autre
maniant un aviron de 5m,85 ou à peu près. Éclaircissons tout ceci par une
figure :
Tous les chiffres que je viens de donner ne sont qu’approximatifs et mis là seulement pour formuler ma pensée. Une étude plus longue les ‘rendrait seule définitifs. L’arrangement que je viens d’indiquer en peu de mots, je ne l’invente pas aujourd’hui pour la circonstance. Les galères à 2, 3, 4 et rames par banc, ont existé pendant environ trois siècles, du treizième au seizième. J’ai développé le système des galères à plusieurs rames par banc dans le Mémoire n° 4 de mon Archéologie navale et dans mon Glossaire nautique, p. 33. Quelques savants, quelques marins crurent que cet ordre de choses, qui leur était resté inconnu et que je venais de leur révéler, contenait la solution du problème de l’organisation des raines dans les vaisseaux longs antiques ; je ne le pensai point, quant à moi ; je n’y vis alors qu’un des éléments probables de cette solution l’autre, le plus essentiel, la superposition des rames en trois étages étant resté encore, à cette époque, à l’état de doute dans mon esprit. L’antiquité connut-elle l’ordre des rames à deux, trois ou quatre par banc ? Aucun texte, à ma connaissance, ne le fait supposer ; mais, comment croire qu’une chose si simple en elle-même ait échappé à l’esprit des Grecs et des Romains ? D’ailleurs, une birème que Lazare Baïf publia, d’après un marbre antique (p.23, De re navali, 1549), a ses avirons groupés par deux et se prête parfaitement à cette croyance, qu’antérieurement au moyen âge, le système si bien expliqué par Marino-Sanuto Torsello au pape Jean XXII, était mis en pratique à bord de certains navires. QUINQUÉRÈMES ET HEXÈRES.Les quinquérèmes ou pentères étaient, à ce qu’il semble,
ainsi que les hexères, parmi les grands vaisseaux longs armés pour la guerre,
de ceux qu’on employait le plus. Polybe, que j’ai déjà-cité à ce propos,
nombre par centaines les quinquérèmes qui servaient dans les flottes
carthaginoises.et dans les armées romaines ; Tite-Live dit (liv. XXI, ch. XVII),
qu’on mit à l’eau deux cent vingt quinquérèmes, — qu’un peu plus loin il
nomme naves longæ. — Au liv. XXVIII,
ch. XXIII de son Histoire, nous
lisons : Regia classis septem et trigenta majoris
formæ navium fuit, in quibus tres hepteres et quatuor hexeres habebat ;
præter has, decem triremes erant. Au chap. XXXI du même livre : Hostium
classis undenonoginta navium fuit, et maximæ formæ naves, tres hexeres
habebat et duas hepteres. Aucun texte.ne nous fait connaître la
forme de la quinquérème, de l’hexère et de l’heptère ; aucun ne nous dit quel
était leur armement en rames et dans quel ordre étaient disposés leurs
avirons. Nia supposition, en ce qui touche ces bâtiments, est, quant à la
quinquérème, qu’à chacune des rames du rang des zygites de la quadrirème, on
ajoutait une rame
Je doute que mon système de la trirème devenant quadrirème, quinquérème et hexère, sans cesser d’être en réalité trirème, fut convenablement appliqué à la fabrication des navires qu’on nommait heptères, octères, nonères, décères, etc. Sous ces noms, se cache certainement un mystère, — quelque chose de fort simple peut-être[101] — qui a mis en défaut la perspicacité de tous les critiques, la sérieuse application de tous les hommes de l’art qui ont pour eux la science et la pratique ; je m’humilie profondément quant à moi devant sa ténébreuse apparence. J’ai cherché à percer du regard le voile dont il est couvert depuis près de deux mille ans ; mais mon œil s’est fatigué sans avoir pu pénétrer son épais tissu, trop lourd pour que ma faible main en ait pu soulever un coin. Si ce que j’ai donné sur les antiques navires à rames trouvait grâce devant les juges compétents ; si mes efforts agréaient au lecteur auguste, qu’il me serait glorieux de satisfaire, je m’estimerais heureux d’avoir entrepris l’œuvre que j’ai menée à fin, non sans trembler pour une témérité dont je me serais défendu, si le devoir ne m’avait imposé sa loi, si le désir d’être utile ne m’avait soutenu pendant la marche difficile et longue que j’ai faite dans le rude sentier où je m’étais engagé. TACTIQUE. Autant qu’ils le pouvaient, les commandants d’escadres et de flottes allégeaient leurs navires avant d’en venir aux mains avec l’ennemi. S’ils étaient dans un port ou seulement assez près d’une terre qui ne leur fût pas hostile, ils déposaient leurs approvisionnements de bouche et tout ce qui pouvait alourdir leurs navires. S’ils étaient à là mer, ils transbordaient, des vaisseaux longs sur les navires de charge dont ils étaient toujours suivis, les choses qui pouvaient les gêner et-contribuer à rendre plus lente leur marche, moins vives et moins faciles leurs évolutions. Ils trouvaient d’ailleurs à cela-un autre avantage ; blessés par l’éperon de leurs adversaires, leurs bâtiments coulaient bas moins facilement, et l’on avait plus de temps pour aveugler les voies d’eau, comme on, dit aujourd’hui : (Polybe, I, ch. LX ; Tite-Live, liv. XXII et XXXIV). Les circonstances de lieu et de temps étaient tenues pour beaucoup parles marins de l’antiquité. On ne se battait jamais ou presque jamais quand il ventait un peu fort, quand la met agitée pouvait contrarier l’action des rames, belles des thalamites surtout. On ne se battait près de la côte que lorsqu’on y était forcé ; la crainte des naufrages commandait cet éloignement de la terre. Quand l’ennemi serrait de si près que l’on se voyait contraint d’accepter le combat à quelques pas d’un rivage, on s’appuyait tout à fait à la terre, mettant les poupes sur le sable de la rive et tournant les proues au large (Appien, liv. V). Choisir son champ de bataille lorsqu’il le pouvait, était une habileté que ne négligeait point un général d’armée navale. Qu’aurait pu Thémistocle avec la flotte grecque, relativement petite, contre l’immense flotte des. Perses, s’il n’avait attiré dans le détroit de Salamine les vaisseaux de Xerxès, qui, trop nombreux, furent en grande partie écartés du combat par l’étroitesse du terrain sur lequel Athènes s’était placée ! (Diodore de Sicile, liv. XI). L’empereur Léon VI recommandait à son fils de ne se battre jamais très près de ses propres rivages, de peur d’être abandonné par ses soldats ; à qui la fuite eût été facile. En général, les anciens, avant le combat, amenaient et serraient les voiles, démâtaient, leurs navires[102], laissant le pied des mats[103] au-dessus de l’orifice du trou[104] (étambrai) où s’implantaient ces arbres qu’on pouvait redresser et raffermir tout de suite, si de mauvaises chances forçaient à s’éloigner au moyen des voiles. On gardait ces voiles tant que l’action ne s’engageait pas ; afin de ménager les rameurs à qui un rôle très important était fait pendant la lutte, et qu’il fallait fatiguer le moins possible dans les marches et contremarches préliminaires. (Polybe, liv. III.) Les vaisseaux éperonnés cherchaient d’ordinaire à s’attaquer par l’avant, rostre à rostre, comme je l’ai dit plus haut, à propos du combat de Vatinius contre Octave[105]. Quand ils ne pouvaient s’aborder de front, ils tendaient à se blesser le plus possible à l’avant, l’éperon allant chercher les parties de la carène qui avoisinaient le rostre ennemi. Ainsi, on frappait sous l’épotide (à la flottaison, bien entendu), ou sous le, dernier aviron des thranites quand la série des rames était établie de telle façon que la dernière rangée de la proue était des thranites. C’est.en ce sens, ce me semble, que doit cure comprise cette phrase de Polyen, mal expliquée par son éditeur et par J. Scheffer : Le choc eut lieu près des premiers thranites (τάς πρώτας θρανίτιδας). Quand on désespérait de frapper de son éperon le navire ennemi, près du massif qui tenait le rostre de celui-ci, on s’efforçait de passer assez près de lui pour briser ses rames. Voici comment on s’y prenait : on faisait nager l’équipage le plus vigoureusement possible ; on se dirigeait obliquement vers l’ennemi, soit en venant du côté de sa proue, soit en venant du côté de sa poupe ; on rentrait vivement ses propres rames du côté où l’on voulait tenter cet abordage, ou bien, ces rames, restées attachées à leurs scalmes, on les étendait le long du bord, et, d’un coup de gouvernail donné à temps, on prolongeait le flanc du vaisseau qu’on voulait aborder, brisant les avirons dont il se servait pour fuir l’abordeur. Manœuvrer pour éviter cette destruction des rames, qui rendait le navire incapable, d’action, au moins jusqu’à ce qu’on eût mis dehors les rames de rechange, était une habileté à laquelle s’appliquaient tous les triérarques. — Voir, à ce sujet, Silius Italicus, liv. XIV ; Tite-Live, liv. XXXVI, chap. XXXXIV ; liv. XXXVII, chap. XXIV et XXX ; Quinte-Curce, liv. IV, chap. IV ; Diodore, liv. XIII et XLV. Quant à ce que je viens de dire des rames qu’on étendait le long du bord sans les ôter des estropes qui les retenaient aux scalmes, rappelons qu’aujourd’hui, dans les embarcations : chaloupes, grands canots, etc., lorsqu’un obstacle se présente, lorsqu’on veut éviter d’autres rames qui pourraient offenser celles qu’on manie, lorsqu’on aborde un quai, un navire, etc., on laisse aller les avirons, retenus par leurs estropes aux tolets. Ils se rangent alors contre le bord de l’embarcation, permettant, dans leur nouvelle position, l’approche du petit navire avec le quai, le vaisseau, le rocher ou l’autre embarcation, permettant aussi le passage du canot entre deux bâtiments ou dans un canal étroit. Ovide, liv. XI des Métamorphoses, dit, vers 475 : Obvertit lateri pendentes navita remos. Il est facile de se figurer comment, dans des navires un peu grands où la rame, le sabord de nage n’étant pas trop large, ne pouvait s’appliquer contre le bordage extérieur du vaisseau aussi aisément qu’elle le fait dans une chaloupe, comment, dis-je, l’aviron pouvait être dit : pendens lateri. On portait à l’avant, le plus possible, la rame dont la poignée était retenue à la muraille intérieure du bâtiment par un lien de corde ; alors la rame ne touchait plus l’eau, elle n’était pas tout à fait tangente au flanc du navire ; mais, dans sa situation, elle restait, comme suspendue, faisant avec la muraille un angle assez aigu, pour que l’écartement de la pelle ne fût pas grand. Les galères du moyen âge et des temps plus rapprochés de nous, n’ayant qu’un rang de rames, lesquelles ne fonctionnaient point dans des sabords, mais étaient attachées par des estropes à des escaumes, plantés sur des apostis, rentraient très aisément les avirons que les rameurs mettaient dans la position horizontale, puis qu’ils tiraient de dehors en dedans, les rameurs de dextre passant la poignée de leurs rames à ceux de senestre, qui, à leur tour, passaient la poignée des leurs aux rameurs de la droite. Cette manœuvre né devait pas être impossible dans les trirèmes antiques, mais je ne connais aucun texte qui me fasse connaître qu’elle y était pratiquée ; et, sur ce fait, comme sur tous les autres, je ne voudrais point avancer une chose que je ne pourrais prouver[106]. J’agis en tout prudemment et réservéement, comme disait Montaigne (Essais, liv. II, chapitre XII). Plusieurs ordres de bataille furent adoptés par les anciens. Quelquefois, les flottes allaient l’une à l’autre, sur un front horizontal, les navires plus ou moins rapprochés et généralement assez près pour qu’aucun intervalle offrant un passage facile à un vaisseau ennemi ne restât ouvert entre deux navires voisins. Cette tactique n’a guère changé depuis l’antiquité. Quelquefois, la flotte était divisée en deux, trois ou quatre escadres, marchant à une petite distance l’une de l’autre, comme marchent à terre, en colonne, les compagnies d’un bataillon. Le combat s’engageait entre la première escadre et l’ennemi, et quand elle était affaiblie, la seconde se présentait toute fraîche, pendant que la première se retirait du champ de bataille. Ainsi agissaient les autres escadres, si le préteur n’avait pas jugé bon qu’elles se portassent à droite et à gauche de l’escadre engagée pour attaquer l’ennemi en flanc et l’envelopper dans un demi-cercle d’éperons. L’ordre demi-circulaire (ordo lunatus) était le plus souvent employé. Au centre se plaçait le préteur, veillant à tout, ayant auprès de lui des petits navires porte-avis, pour communiquer celles de ses volontés qu’il ne pouvait ou ne voulait pas faire connaître par des signaux. Aux extrémités des cornes ou. ailes recourbées étaient mis les vaisseaux longs les plus forts destinés à recevoir le premier choc, et dont la fermeté dans l’action était bien nécessaire. Entre ces navires et le vaisseau prétorien était le commun de la flotte, marchant droit à l’ennemi, non pas chaque bâtiment suivant celui qui le précédait, le rostre dans le sillage de son matelot d’avant, comme nous disons ; mais allant, en ordre d’échiquier, sur une ligne parallèle à celle que traçait avec sa quille le vaisseau qu’il avait à sa droite et un peu devant lui, s’ils étaient l’un et l’autre à l’aile droite, un peu devant lui et à sa gauche, s’ils faisaient partie de la corne gauche. Parfois, l’ordre en croissant était renversé. Ce second ordre se formait lorsque, l’ennemi étant en très grande force, on avait besoin de se serrer beaucoup pour résister à son attaque. Les vaisseaux tournaient tous leurs éperons en dehors du demi-cercle et présentaient ainsi un front d’airain demi-circulaire (incurvus ordo), les rames touchant presque les rames. En arrière du demi-cercle des vaisseaux combattants, se tenaient les navires de charge, les petits bâtiments et quelques vaisseaux de secours ou de réserve destinés à remplacer, dans l’ordre de bataille, ceux qui étaient contraints de se retirer de la mêlée. Je dis la mêlée, car toute bataille navale finissait et a toujours fini par là. A un certain moment, la tactique était oubliée ; ses règles, auxquelles on avait obéi d’abord et qu’on avait respectées tant qu’on l’avait pu, étaient forcément négligées. Le conflit en venait à ce point que chaque capitaine, laissé maître de sa manœuvre, ne prenait plus conseil pour sa défense que ale son génie et de sa valeur. Dans l’ordo lunatus, chacune des cornes avait un
commandant, ainsi qu’aujourd’hui, dans une escadre ou une flotte, il y a,
sous l’amiral, un commandant de l’avant-garde et un commandant de
l’arrière-garde. Le corps de bataille et les deux cornes composaient la
flotte. (Diodore de Sicile, liv. XIII et XX ;
Thucydide, liv. Ier.) Xénophon, liv. Ier, parlant d’une bataille livrée
par les Athéniens, dit : Les Athéniens allèrent à
l’ennemi dans l’ordre que voici : Aristocrate, avec quinze vaisseaux, tenait
la corne gauche ; Diomédon le suivait avec a le même nombre de navires. (C’est-à-dire que Diomédon était à la droite
d’Aristocrate.) Périclès allait derrière
Aristocrate et Erasinide derrière Diomédon. Après eux, venaient, sous la conduite
d’Hipée de Samos, dix navires samiens, marchant à une certaine distance l’un
de l’autre. Près de ceux-ci étaient les vaisseaux des trois navarques et
quelques navires de réserve. A l’aile droite était Protomaque, avec quinze
vaisseaux, suivis de quinze navires de Thrasyle, derrière lesquels marchaient
ceux d’Aristogène ; Lysias venait après Protomaque. Diodore de Sicile
dit que cet ordre de marche pour le combat était nommé phalange (liv.
XIII). Dans la phalange, il y avait, nomme on voit, deux ailes ou cornes
très fortes, et ii ri corps du batailla plus faible, formé cette fois des
Sauriens, des trois vaisseaux navarques et de quelques navires de renfort. Deux ordres qu’on voit rarement employés par les anciens, sont l’ordre en forceps, dont la figure était celle d’un U, et l’ordre en coin (cuneus), dont le V renversé (A) donne une idée suffisante. Polybe (liv. Ier) parle de l’ordre en forceps en décrivant la flotte carthaginoise ; Végèce détaille l’ordre en coin, qui avait ordinairement la figure d’un triangle ; à l’extrémité inférieure des deux côtés du coin, dont l’éperon du vaisseau prétorien était le sommet, se soudaient, pour ainsi dire, les navires les plus forts qui formaient une base en ligne horizontale. J’ai fini. Cette étude me semble tout à la fois, trop longue et trop courte. Je n’ai pu la faire autrement. Le sujet était vaste, et il s’en faut de beaucoup que je l’aie épuisé. Il m’aurait fallu écrire un gros volume pour être complet. Je crains fort d’avoir été moins intéressant que je n’aurais dû l’être, parlant de choses d’un intérêt si grand. J’ai négligé à dessein tous les agréments dont il m’eût été possible d’enrichir cette dissertation ; avant tout, j’ai cherché à être vrai. Si j’ai approché de la vérité que je cherchais, on me pardonnera, j’espère, la sécheresse à laquelle je me suis condamné. Le courage ne m’a pas manqué, si la sagacité m’a fait défaut. J’aurais souhaité faire plus et mieux ; peut-être mes efforts n’ont-ils pas été tout à fait impuissants. Si j’avais pu autant que j’ai voulu ; si la pénétration de mon esprit avait égalé l’ardeur de mon désir, il ne resterait plus rien à dire après moi sur une des questions les plus curieuses et les moins éclaircies de l’histoire ancienne ; mais, je le sens, l’instrument a trahi l’ouvrier. Je ne me rends qu’un témoignage : c’est que j’ai fait tout ce qu’il était en moi de faire ; je me flatte donc de trouver un peu d’indulgence. J’ai une conviction, — qu’on me pardonne de l’exprimer en finissant : — Mes solutions sont plus pratiques qu’aucune de celles qu’ont proposées les hommes qui, depuis trois siècles, ont écrit sur la marine antique. Je les sais imparfaites ; il n’a pas tenu à moi qu’elles le fussent moins. Du château de Vauban (Nièvre), 6 juillet 1860. POST-SCRIPTUM. Cette étude était achevée depuis trois semaines ; depuis trois jours j’avais eu l’honneur de la soumettre à Sa Majesté l’Empereur, quand le savant M. Léon Rénier, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, eut l’extrême obligeance de me communiquer une épreuve de la reproduction photographique faite à Athènes d’un fragment de bas-relief antique, représentant en élévation une petite partie d’une trière. Ce fragment, très intéressant pour les artistes et les archéologues, parce qu’il parait être du beau temps de l’art grec, est pour moi sans prix. Dans ce morceau d’un navire à trois rangs de rames, je trouve, en effet, la confirmation du système que j’ai proposé et jusqu’aux détails principaux de la trirème dont j’ai essayé la restitution. C’est ce dont sont convenus sans difficulté MM. Du Puy de Lôme, Pastoureau et Mangin, ingénieurs de la marine, à qui, aussitôt que je l’ai eu en ma possession, j’ai montré le dessin si gracieusement prêté par M. Rénier.
Le monument que le hasard m’a fait connaître fut découvert à l’acropole d’Athènes, vers 1852. C’est, de son histoire, tout ce qu’a pu m’apprendre M. François Lenormant, jeune et savant antiquaire, digne du nom qu’il porte. M. Lenormant a rapporté d’Athènes un moulage du fragment dont on voit, p. 228, la représentation faite d’après la photographie ; il a bien voulu me le montrer, et j’ai pu comparer l’épreuve de plâtre avec celle que la lumière a produite sur le papier. Elles diffèrent en ce point que, dans le marbre tel qu’il était quand on l’a moulé pour M. Lenormant, manquait le premier rameur (mutilé) de gauche que donne la photographie, et presque tout le dernier rameur de droite. Le monument a subi quelques dégradations, on le voit, entre l’époque où il fut photographié par M. D. Constantinos et celle où M. François Lenormant l’a fait mouler. Le fragment de marbre a de longueur quarante centimètres ; la copie photographique, n’en a que treize environ. Les huit rameurs thranites qui manœuvrent les rames supérieures de la trirème sont d’un bon ciseau ; c’est ce que démontre l’examen attentif, fait à la loupe, de leurs corps, dont les mouvements sont d’un naturel parfait ; et les détails, bien qu’altérés par le temps, excellents de dessin et de modelé. Ces rameurs sont assis, le dos tourné vers la proue, sur des bancs qu’on n’aperçoit point. Les bras étendus, le dos courbé, les jambes allongées, ils tiennent la position d’hommes qui vont tirer fortement à eux la poupe de la galère. Leurs rames, longues et lourdes, sont descendues à l’eau, et ils commencent l’action dont le résultat doit être de faire avancer le navire d’un nombre de pas proportionné à la grandeur de leur effort. Ils ont intenta brachia remis, bientôt ils seront adductis lacertis, comme le dit si bien Virgile[107]. Au-dessus des têtes de ces hommes, complètement nus, est déployée une tente, établie sur des arceaux de bois, au nombre de huit. Cette tente, dont les bords extérieurs ont disparu sous les outrages du temps, qui a rendu le marbre fruste et l’a ébréché en bien des endroits, est, ou d’une grosse étoffe, ou de cuirs amincis, graissés et cousus ensemble. Sur la tente, au-dessus du septième arceau, à l’endroit même ou est placée la lettre B, est un torse humain, vu de dos ; il est difficile d’expliquer la présence d’un homme assis à cette place. A la droite de cet esclave nu et tout près de lui se voit, dans le marbre, une sorte d’enroulement que l’on pourrait prendre pour le lit d’un coquillage à hélice conique, et qui est peut-être l’extrémité d’une voile tournée autour de l’antenne. Ces détails sont si peu visibles dans la photographie que j’ai du les supprimer dans la restitution que j’ai tentée d’une partie du monument. Si l’on mesure l’espace compris entre les bancs des rameurs, indiqués par les pieds des arceaux qui portent latente, à la grandeur moyenne des esclaves qui peinent aux avirons, on trouvera que cet espace est d’un mètre environ ; l’interscalme était donc dans la trière d’Athènes aussi grand que dans la trirème que j’ai restituée ; dans le marbre, il n’est en effet que de cinquante-cinq millimètres. Les rames des thranites ne passent point au travers de la muraille du vaisseau long et ne fonctionnent pas dans des sabords ; elles ont leurs scalmes sur une sorte d’apostis ou forte lisse adhérente à la muraille, assez saillante, et supportée par des consoles ou corbeaux, dont quelques-uns sont très visibles. Les leviers qui, pour aller à leurs scalmes où les retient une estrope de corde ou de cuir (τρόπωτήρ) que le temps a rongée aussi bien que la cheville elle-même, passent dans le croisillon d’un parapet élevé sur la lisse, sont maniés par leurs nageurs comme nos matelots manient aujourd’hui les avirons d’une chaloupe, les ongles des deux mains en dessous, à la différence des rameurs de la colonne Trajane, représentés les ongles de la main qui tient la poignée tournés vers le ciel et ceux de l’autre main tournés dans le sens opposé. Les rames du second rang partent de la muraille de la trière ; mais leurs sabords sont cachés par l’apostis dont l’ombre se projette sur le bordage et fait saillir la lisse d’un nombre de centimètres difficile à préciser. Ces rames, — celles des zygites, — sont, dans l’élévation qui nous occupe, si rapprochées des rames les plus hautes, qu’il est impossible de ne pas supposer que les esclaves qui les manœuvrent sont assis sur le pont où sont les bancs .des rameurs que le statuaire nous fait voir. Leurs sièges sont seulement moins hauts que les bancs des thranites. Le sculpteur aurait pu montrer leurs têtes, mais il était homme de trop de goût pour se hasarder à présenter un détail d’un effet désagréable, que son talent n’aurait pu sauver. Il ne prétendait évidemment pas à une vérité absolue, et se gardait de tout ce qui aurait pu alourdir cette belle file d’êtres humains si forts et si élégants qui, de ce qu’il avait à représenter, était évidemment ce qui l’intéressait le plus, sinon la seule chose qui l’intéressât. L’espace qui sépare la naissance des rames zygites du rang très clairement rendu des avirons thalamites, ne me laisse aucun doute sur l’intention qu’eut l’artiste de faire comprendre que les thalamites étaient renfermés dans un entrepont. Si l’on prend le compas et qu’on cherche à placer un des esclaves du rang d’en haut dans cet entrepont, on reconnaîtra bien vite que le sculpteur n’a pas plus tenu compte, ici, de la vérité matérielle que dans le cas dont je viens de parler. Son entrepont est beaucoup trop bas de plafond ; mais qu’importe ? Que lui importe, à lui surtout ? Il indique à merveille les sabords ronds de ses rames thalamites, au-dessus d’une préceinte et très près de l’eau ; pourquoi lui demander plus ? Il ne fait pas œuvre de géomètre ou de ναυπηγός ; pourvu qu’il soit à peu près vrai, pourvu que, sur le long côté de sa galère, la lumière joue agréablement dans le marbre, par les saillies des préceintes, des rames et des consoles, parles creux des sabords des thalamites, par les ornements de la proue et de la poupe, par les ondulations de la mer, il sera content. Il sait bien qu’aucun Athénien délicat qui aura pu admirer ses rameurs, ne lui cherchera querelle pour des choses qu’un cordonnier vulgaire ou un grossier matelot, étranger aux choses de l’art, pourra seul vouloir plus exactes. Ce qui le touche, lui, c’est la figure humaine. Si elle sort de sa main belle, grande, simple, forte, souple ; si les rameurs qu’il doit montrer dans la même pose ne se ressemblent que par un trait principal, la nécessité de paraître en profil ; s’ils sont divers, par leurs natures différentes, par l’étude variée de toutes les parties de leurs corps, qu’aucune draperie ne doit cacher, l’artiste a réussi ; son œuvre est faite. Le navire qui porte ces beaux esclaves sera ce qu’il pourra être, plus grand ou plus petit qu’il ne faut, dans de justes proportions, ou, au contraire, tel que la critique minutieuse d’un constructeur de trirèmes pourra l’atteindre impitoyablement ; cela lui est assez indifférent. Le vaisseau ne le préoccupe pas plus que ne l’occuperait le piédestal de la statue rêvée qui s’élancera par son ordre du bloc de marbre où elle est captive ; il est sculpteur[108], il n’est point charpentier. Il ne place peut-être pas très bien les préceintes de sa trière ; mais il enferme les thalamites dans un pont dont le plancher est au-dessous du niveau de l’eau ; il met leurs rames courtes sur une ligne horizontale très rapprochée de la mer ; il dispose en lignes diagonales, du haut en bas, les rames des trois étages ; il satisfait par là à une vérité essentielle et donne à son navire une apparence qui fait dire à l’ignorant qui n’y regarde pas de trop près : ceci est une trirème. Il n’en veut pas plus. Pour moi, je ne lui en demande pas davantage. Si je rapproche l’image imparfaite qu’il me présente de sa trière marchant à l’aviron, des textes qui doivent me servir à la critiquer, je reconnais l’intention qu’il a eue de faire ce que les auteurs ont dit que faisaient : les constructeurs quand ils édifiaient des navires à trois rangs de rames, et je le loue de sa fidélité. — Je le compare à l’auteur des médailles d’Adrien qui, dans ses deux trirèmes, fit ses trois rangs de raines équidistants, et plaça le rang des thalamites trop haut-au-dessus de l’eau, source d’erreurs pour bien des gens qui ont cherché la solution du problème de l’emplacement des rames sur les vaisseaux longs ; et je reconnais la supériorité de l’artiste grec, à cet égard, sur le graveur romain. Je termine par un mot. Curieux comme spécimen de la sculpture à une des belles époques de l’art, le fragment dont je joins ici un croquis qui le représente fruste dans une de ses moitiés et restauré dans l’autre[109], est précieux pour l’archéologue marin. Ce monument est, de beaucoup, le plus important que je connaisse, au point de vue tout spécial qui m’occupe. Je suis heureux d’avoir pu l’étudier ; je suis heureux du témoignage inattendu qu’il m’apporte en faveur des idées que j’ai développées plus haut sur la construction dés trirèmes. Je regrette vivement que les parties qui doivent le compléter aient disparu ; probablement elles m’auraient montré une poupe élégante, et une proue recourbée, armée de l’embolon. La poupe qui précédait presque immédiatement le premier rameur de gauche, — j’en juge à une certaine inclinaison qui va de gauche à droite et me montre le pont de la galère montant un peu du côté du premier rameur de gauche, — cette poupe devait être un morceau bien intéressant, et je fais des vœux ardents pour qu’aux environs du lieu où l’on a trouvé ce qui nous est connu de la trière, on cherche et l’on trouve les parties qu’il nous reste à connaître. M. François Lenormant croit que toutes recherches nouvelles seraient inutiles, l’acropole et surtout les environs de l’Erechtéon où le monument fut découvert ayant été fouillés avec un très grand soin ; il pense que l’on a aujourd’hui tout ce qu’on peut jamais avoir d’un bas-relief qui fut peut-être un monument votif, peut-être aussi l’image du navire sacré qui portait la Théorie à Delphes et à Délos. Pour moi, j’espère encore. Paris, 31 janvier 1861. FIN DE LA PREMIÈRE ÉTUDE |

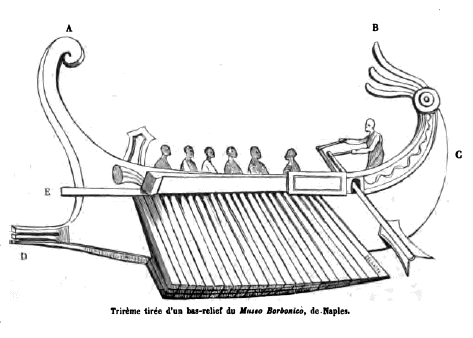
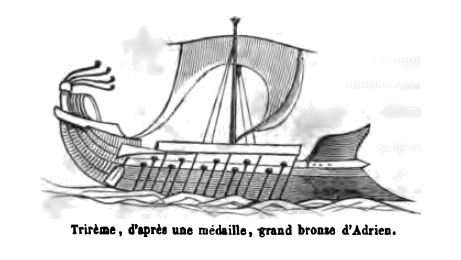
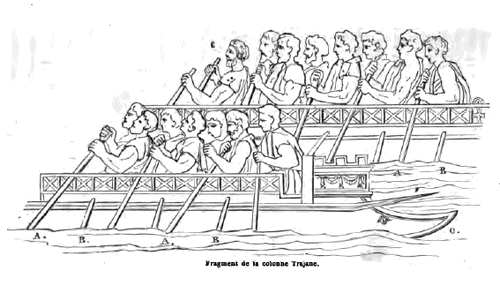
 omaines et
grecques, page 82, porte la figure d’une birème dans les mêmes conditions
omaines et
grecques, page 82, porte la figure d’une birème dans les mêmes conditions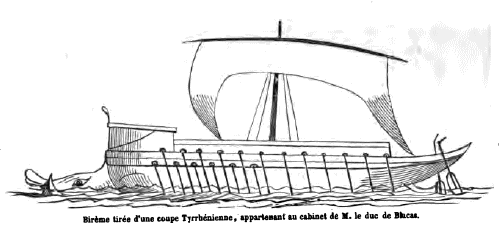
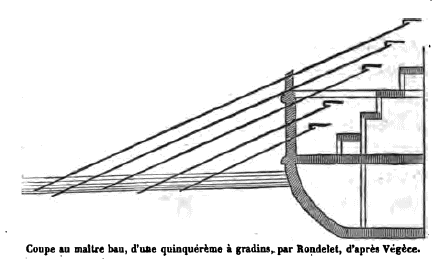
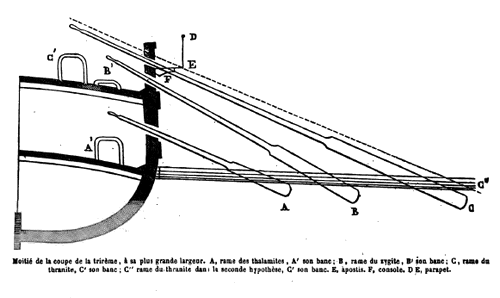
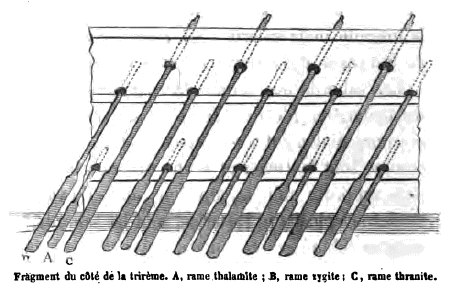
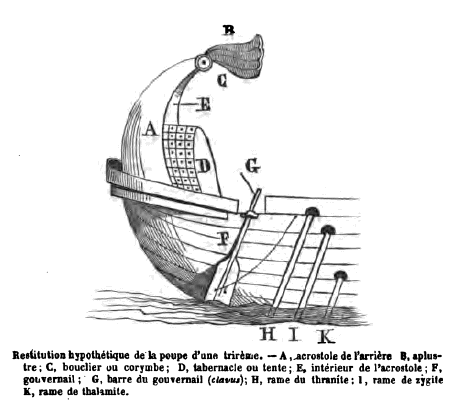
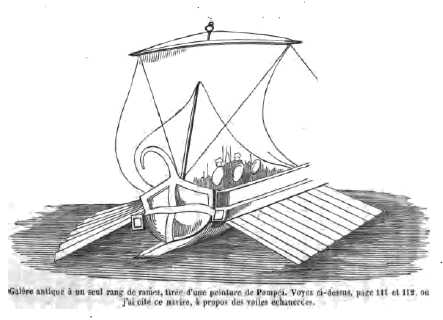
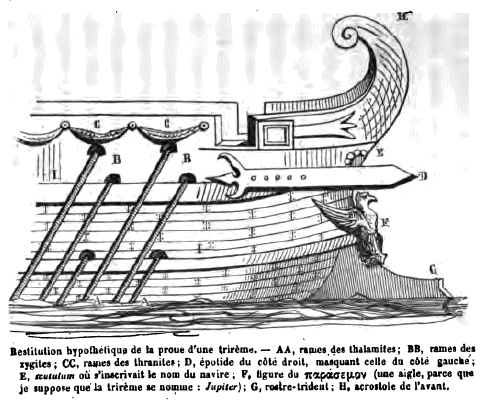
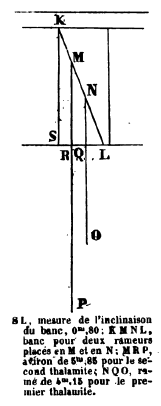 La
quadrirème aurait dans mon hypothèse, avec 2m d’interscalme, 600 de
développement en longueur, pour l’emplacement de 60 rames groupées par deux.
Elle aurait donc, de chaque côté : 58 rames de thalamites, 30 rames de
zygites, 29 rames de thranites, c’est-à-dire, en- tout, tribord et bâbord,
234 rames ; et, en mettant trois hommes aux rames d’en haut, deux hommes aux
rames des zygites et un homme aux rames du rang inférieur, un équipage de 292
rameurs.
La
quadrirème aurait dans mon hypothèse, avec 2m d’interscalme, 600 de
développement en longueur, pour l’emplacement de 60 rames groupées par deux.
Elle aurait donc, de chaque côté : 58 rames de thalamites, 30 rames de
zygites, 29 rames de thranites, c’est-à-dire, en- tout, tribord et bâbord,
234 rames ; et, en mettant trois hommes aux rames d’en haut, deux hommes aux
rames des zygites et un homme aux rames du rang inférieur, un équipage de 292
rameurs.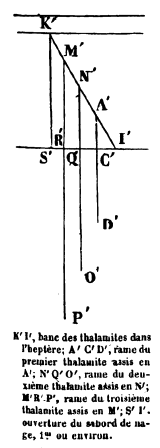 de zygite, comme pour faire la quadrirème, j’ai avancé
qu’on pourrait donner une sœur jumelle à la rame des thalamites. De la quinquérème,
plus grande que la quadrirème dans ses trois dimensions, le creux, la largeur
et la longueur, si l’on voulait faire une hexère, on pourrait grandir la
pentère, et placer sur le banc des thranites, très inclinée en arrière, une
seconde rame maniée par trois hommes, ce qui ferait six thranites sur le même
banc pour manœuvrer les deux rames. Une rame ajoutée au rang des thalamites
de l’hexère pourrait en faire une heptère ; une rame ajoutée à chacune des
rames des zygites de l’heptère, pourrait en faire une octère.... ; mais ces
additions de rames supposent des agrandissements considérables dans le corps de
la trirème, et je ne sais pas s’il est sage d’aller plus loin dans la
création de ces monstres nautiques.
de zygite, comme pour faire la quadrirème, j’ai avancé
qu’on pourrait donner une sœur jumelle à la rame des thalamites. De la quinquérème,
plus grande que la quadrirème dans ses trois dimensions, le creux, la largeur
et la longueur, si l’on voulait faire une hexère, on pourrait grandir la
pentère, et placer sur le banc des thranites, très inclinée en arrière, une
seconde rame maniée par trois hommes, ce qui ferait six thranites sur le même
banc pour manœuvrer les deux rames. Une rame ajoutée au rang des thalamites
de l’hexère pourrait en faire une heptère ; une rame ajoutée à chacune des
rames des zygites de l’heptère, pourrait en faire une octère.... ; mais ces
additions de rames supposent des agrandissements considérables dans le corps de
la trirème, et je ne sais pas s’il est sage d’aller plus loin dans la
création de ces monstres nautiques.