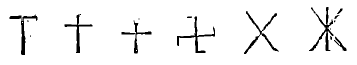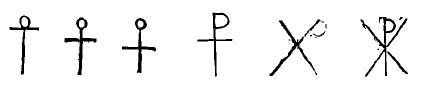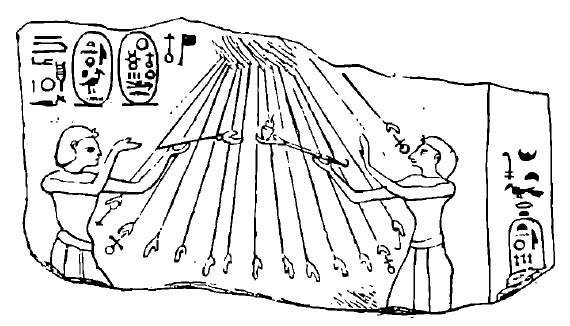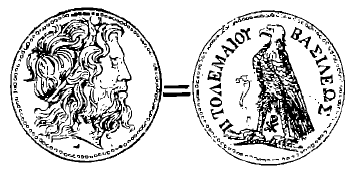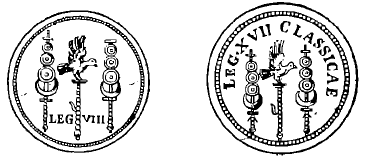LA RELIGION SOLAIRE DANS L’EMPIRE ROMAIN
Polydore HOCHART
La Doctrine. - Les Cultes païens. - Le Culte chrétien. - Les Empereurs étaient devenus les parèdres du Soleil - La Légende de la conversion de Constantin.LA DOCTRINEConnaissant aujourd’hui les véritables lois de la nature qui nous sont enseignées dès l’enfance, il nous semble que croire à la divinité du Soleil ne peut avoir été qu’une grossière superstition ; il nous parait inadmissible qu’un astre ait été l’objet de l’adoration de gens instruits. Cependant, si nous nous reportons moins de trois siècles en arrière, si même nous jetons un regard attentif autour de nous, que de croyances complètement erronées ne trouvons-nous pas admises pour des vérités incontestables, non seulement par le vulgaire, mais par des esprits éminemment cultivés et droits[1]. Il en fut de même pour le culte du Soleil qui, aux siècles de l’empire romain, devint le culte presque universel du monde civilisé. Le sentiment des premiers humains en présence de la nature parait avoir été comme chez les enfants, la crainte. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, les inondations des fleuves et les envahissements de la mer, les pluies diluviennes et les ouragans, les éclairs et le bruit de la foudre, ne pouvaient être pour eus que des objets de terreur. Inhabiles encore à se défendre eux-mêmes, ils ne songèrent qu’à se soumettre, à reconnaître la supériorité des éléments, c’est-à-dire à les diviniser et implorer leur clémence : Primus in orbe deos fecit timor[2]. Le soleil, la lune, les étoiles, les nuages, l’air, la mer, la terre devinrent des dieux pour eux. Quelques-uns cependant, plus hardis, réussirent à se préserver des fléaux destructeurs ; le succès encouragea ; les progrès succédèrent aux progrès. Vint enfin un moment où la race humaine crut se sentir non plus l’esclave, mais le maître de la nature ; elle s’estima de puissance égale sinon supérieure à celle des éléments dont elle avait d’abord fait des Dieux. Elle s’enorgueillissait dans Prométhée d’avoir trompé Jupiter-Soleil par une ruse grossière et de lui avoir dérobé le feu. Le sentiment de la divinité ne s’effaçait cependant pas du cœur de l’homme. Il lui fallait reconnaître que sa victoire contre les éléments n’était que passagère, qu’il finissait toujours par succomber dans la lutte. On admit alors que Prométhée fut enchaîné par Jupiter sur le Caucase et condamné à un éternel supplice pour servir d’exemple aux téméraires[3]. L’homme avait toutefois constaté en lui une force active, l’intelligence, qui lui paraissait distincte des éléments eux-mêmes. Il en vint ainsi à penser que les Dieux, ses maîtres et ceux du monde, devaient avoir comme lui sensibilité et intelligence. Il leur attribua toutes les passions, tous les calculs, tous les motifs d’action qui se manifestaient en lui. D’autre part, on remarquait que la sensibilité et l’intelligence ne se voyaient que dans les corps organisés, vivants. Puisque donc les dieux étaient sensibles et intelligents, c’était évidemment, pensa-t-on, une de ces formes qu’ils devaient revêtir. Or parmi les êtres vivants, l’homme était incontestablement le mieux doué. On fut ainsi conduit à attribuer aux Dieux la forme humaine[4]. On leur supposait un corps réel, mais très subtil et indestructible. Celte conception avait sa base dans la confiance que l’on accordait aux songes[5]. Qui n’était certain d’avoir vu apparaître à ses yeux des êtres marchant, parlant, agissant, témoignant la vie et l’intelligence, et en même temps franchissant l’espace avec la rapidité de l’éclair, passant à travers les murs et les portes. Les impressions que laissent les songes sont parfois si profondes qu’on ne saurait s’étonner que les hommes aient longtemps refusé de croire qu’ils n’étaient que des chimères et ne répondaient à aucune réalité. On pensa donc que chacune des manifestations des forces de la nature était produite par la volonté et l’action d’une divinité qui y présidait. Les phénomènes continuèrent à paraître aussi redoutables, mais au lieu d’implorer le nuage, le vent, l’eau eux-mêmes, on implorait l’être qui les mettait en mouvement. Tandis que le naturalisme demeurait la religion des peuples asiatiques, l’anthropomorphisme devint la base du culte de la race grecque, de cette race qui eut à un si haut degré le fier sentiment de la valeur propre et de l’indépendance de l’homme[6]. De grandes écoles philosophiques sorties de son sein déclarèrent que c’était par l’étude de l’âme humaine et non point par celle des phénomènes physiques qu’on devait chercher à connaître la nature et les attributs des êtres qui animaient et gouvernaient le monde. Mais d’autres philosophes pourtant mirent en doute la raison sur laquelle on fondait la prétention de donner aux Dieux la forme humaine. Considérer le type humain comme le plus parfait est une pure hypothèse, disait-on ; en fût-il ainsi, il varie beaucoup selon les individus, et l’appréciation des conditions qui en constituent l’excellence est fort variable ; on ne saurait donc donner aux Dieux une forme constante ; ne voyait-on pas des Jupiter, des Junon, des Apollon de tous genres[7]. Tous ces dieux à figure humaine, qu’ils fussent représentés dans les esprits sous les formes grossières qui leur furent attribuées aux premiers essais de l’art ou sous la merveilleuse beauté que leur donnèrent les grands artistes de la Grèce, finirent par perdre créance. Les gens sensés ne pouvaient se résoudre à croire à la nature et à la puissance divine d’êtres créés par l’imagination de l’homme. Les politiques déclaraient qu’il fallait laisser au peuple ses superstitions. Mais on en riait généralement[8]. Quelle était alors, se demandait-on, le Dieu ou les Dieux qui gouvernaient l’univers. Ne fallait-il pas revenir au culte du soleil et des astres[9] ? C’est à ce parti que se rangèrent généralement les stoïciens ; ils ne furent pas les seuls ; mais ils furent les plus influents propagateurs du retour au naturalisme dans le monde gréco-romain. Aux premiers siècles de notre ère, en dehors des divergences théoriques des écoles de philosophie, l’opinion générale pensait que l’univers était formé de quatre éléments : la Terre, l’Eau, l’Air, le Feu. Les trois premiers correspondaient à ce que nous appelons corps solides, liquides et gazeux[10] ; le dernier pourrait être assimilé à ce qu’était le fluide impondérable de la physique moderne. Superposant les éléments par ordre de densité, on plaçait la Terre au rang inférieur ; l’Eau reposait sur elle ; l’Air était au-dessus ; et au point le plus élevé de l’espace se trouvait le Feu. Il formait la substance du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles. Cette région supérieure était appelée le Ciel ou Éther[11] ; on disait par suite la substance stellaire ignée ou éthérée, céleste, puisque le ciel était le lieu qu’elle occupait. Les stoïciens, dont les doctrines philosophiques étaient les plus répandues, enseignaient que la terre, l’eau, l’air étaient des éléments passifs ; le quatrième, le feu, était l’élément actif. C’est à lui, c’est à son action, qu’étaient dues toutes les transformations des autres éléments[12]. On concevait la nature du Feu comme dans le système de l’émission on définissait le calorique. Selon les anciens, c’était une substance, de nos jours on dirait un fluide, d’une extrême ténuité qui pénétrait toutes les parties de l’univers[13]. On attribuait au feu les phénomènes que nous nommons lumineux, calorifiques, électriques. C’est ce qu’exprimaient les écoles orientales, où avaient puisé les Grecs et les Romains, en disant qu’il était formé par la triade, φώς, πϋρ, φλόξ, lumière, chaleur, foudre[14]. Le feu, de plus, se confondait, on n’en doutait pas, avec le mouvement[15]. Les stoïciens eurent donc non pas la connaissance précise, mais l’intuition de l’unité du principe de la chaleur, de la lumière, de l’électricité et du mouvement, qui après avoir été naguère considérées comme des forces distinctes sont actuellement ramenées à une seule. Le feu produisait encore, pensaient-ils, la vie dans la nature. Sans lui tout être vivant ne périssait-il pas ? Il paraissait ainsi constituer ce que nous nommons le principe vital ou la force vitale[16]. On ne pouvait d’autre part concevoir la vie dans son développement complet sans activité propre et sans intelligence ; c’est ce qui la caractérisait. Posant en principe que nul ne pouvait donner ce qu’il ne possède pas, on en concluait que l’activité et l’intelligence étaient inhérentes à la substance ignée[17]. C’était, en conséquence, le feu ou l’éther, comme on l’appelait aussi, qui formait, pensait-on, toutes choses et donnait la vie à tous les êtres. Or cette puissance active et souverainement intelligente qui avait établi cet ordre parfait dans l’ensemble et dans les détails qu’on admire dans l’univers, que pourrait-elle être sinon la divinité ? La divinité était ainsi répandue partout, animait tout, et faisait partie intégrante du monde[18]. Mais le feu n’était pas également réparti dans l’espace. Sur la terre et dans les couches atmosphériques les plus proches d’elle, il se trouvait allié à d’autres éléments, et par conséquent il y était moins pur, moins actif ; c’était seulement dans les plus grandes hauteurs au-dessus de nos tètes qu’il était dans toute son excellence ; il y formait des globes tels que le soleil, la lune, les étoiles. Les astres passaient ainsi pour des êtres essentiellement vivants, intelligents[19]. La principale masse du feu était, on n’en doutait pas, le Soleil ; c’était de lui que la terre recevait la chaleur et la vie. On reconnaissait bien aux autres astres une influence active, mais ce n’était qu’une influence secondaire[20]. La vie sur la terre résultait de l’intime union de l’élément igné et des éléments passifs ; et la mort était causée par leur désassociation. Orles astres n’étant formés que du premier élément ne pouvaient, pensait-on, périr. On en croyait trouver la preuve dans les annales de l’humanité qui ne constataient aucun changement survenu dans la constitution du ciel. Vie, intelligence, immortalité, constituaient la divinité ; les astres étaient donc des dieux ; et leur puissance se faisait sentir sur la terre et dans le monde entier. De la conception que l’on avait de la nature du principe vital, on demeurait convaincu que l’âme de l’homme, ce qui constituait en lui la capacité de sentir, de penser et d’agir était d’essence ignée[21]. C’était d’une étincelle dérobée au ciel que Prométhée, croyait-on, avait animé l’argile dont il avait façonné l’homme[22]. D’autre part tous les astres étant sphériques, cette forme passait pour divine[23] ; et l’âme participant de la nature stellaire devait aussi, pensait-on, la posséder. On s’imaginait que c’était un petit globe de substance ignée qui tombé du ciel, se déformait en traversant les couches de l’atmosphère et s’introduisait dans le corps qu’elle animait[24]. En conséquence, devenue libre par la mort, l’âme laissait le cadavre froid ; elle remontait vers sa véritable patrie, et elle s’élevait d’autant plus haut dans les sphères célestes qu’elle était plus pure, plus dégagée d’attaches terrestres[25] : ce qu’on appelait la mort était donc, au contraire, la vie. Les stoïciens avaient en cette matière quelques points communs avec les péripatéticiens[26] ; ils étaient à peu près d’accord avec les pythagoriciens[27] ; mais leurs doctrines étaient, combattues par les épicuriens et les platoniciens. Les épicuriens faisaient valoir deux sortes d’arguments : les uns généraux contre l’existence des dieux, les autres particuliers à la nature que leur attribuait récole du Portique. Rejette, disaient-ils[28], l’erreur dont la religion aurait pu t’imposer le frein honteux ; ne crois pas que le soleil et les astres soient d’une essence divine et qu’ils jouissent de l’immortalité. Ne voyons-nous pas les corps terrestres, l’eau, le souffle aérien, le fluide igné, naître, se former et périr ? Le tout doit partager le sort des parties qui le composent. Quand on ignorerait la puissance des atomes créateurs, l’imperfection des cieux permet d’affirmer qu’ils ne sont pas d’une nature divine. S’il en était ainsi, pourquoi, lorsque les rudes et patients travaux de l’homme ont couronné la terre de verdure et de fleurs, les froids tardifs ou les chaleurs dévorantes viennent-ils détruire ses légitimes espérances ? Pourquoi chaque saison amène-t-elle une foule de maux homicides ? Ils donnaient fort souvent à leurs critiques la forme de la raillerie et de l’invective[29]. Un dieu, disaient-ils, doit être heureux ; a-t-on jamais su quels pouvaient être les plaisirs du soleil ?.... Et encore : Pense-t-on qu’il puisse tourner avec tant de vitesse sans perdre le sentiment ? Tandis que les épicuriens niaient, en même temps que la divinité du soleil, toutes les autres, les académiciens étaient d’accord avec les stoïciens sur l’existence des dieux ; ils ne se séparaient d’eux que sur leur nature. Ils se bornaient à soutenir que la substance ignée et son principal foyer ne réunissaient pas les qualités de bonté, de sagesse, d’intelligence répondant à l’idéal que concevaient les esprits distingués. Ils employaient à peu près les mêmes arguments que les épicuriens. Les stoïciens, disaient-ils[30], prétendent que le principe universel, c’est le feu ; qu’ainsi tous les corps vivants sont animés par la chaleur, et que l’extinction de la chaleur leur ôte la vie. Mais l’on ne conçoit pas ce qui leur fait dire qu’ils meurent faute de chaleur plutôt que faute d’humidité ou d’air, et cela d’autant moins qu’ils meurent même par excès de chaleur. La vie des animaux ne dépend donc pas plutôt du feu que des autres éléments. Ou encore[31] : Les stoïciens sont obligés de convenir que tout feu a besoin d’aliment et que s’il en manquait il ne pourrait subsister ; que le soleil, la lune, tous les astres, se nourrissent les uns des vapeurs d’eaux douces, les autres des vapeurs d’eaux salées qui s’élèvent de la terre... Or ce qui peut cesser d’être n’est pas éternel de sa nature ; le feu ne l’est donc pas. Les stoïciens et les naturalistes répondaient qu’il fallait distinguer deux sortes de feu ; le feu mauvais ou destructeur, le feu bon ou générateur ; celui qui dévore et consume tout ce qu’il rencontre et celui qui donne la vie aux plantes, aux animaux et aux hommes, les fait croître, les conserve, les rend sensibles et intelligents ; or le feu du soleil, disaient-ils, est de cette dernière sorte, puisqu’il en a toutes les propriétés[32]. Dans les Temples, sur l’autel domestique, le feu sacré qui brûlait était considéré comme étant sans conteste d’une nature différente de celui de la cuisine. Les mazdéens et, avec eux, les sectes empreintes de la religion de Zoroastre admettaient également deux natures de feu[33]. Refusant de voir dans le feu la source de la vie dans l’univers, les académiciens l’attribuaient à l’intelligence, principe qui réunissait, selon eux, toutes les qualités que les stoïciens attribuaient à tort au feu ; c’était en lui qu’ils plaçaient la puissance créatrice et conservatrice du monde ; c’est lui qui en était l’âme : L’intelligence n’était pas, pour les académiciens, une simple abstraction et encore moins une négation. Quoique invisible et impalpable, elle n’en constituait pas moins, affirmaient-ils, une substance réelle ; et ils en avaient fait, par suite un cinquième élément[34]. Les académiciens, toutefois, et après eux les néoplatoniciens, ne pouvaient méconnaître le rôle actif et vivifiant du feu dans l’univers, et surtout celui du soleil[35]. Ils refusaient seulement d’admettre que l’intelligence et l’activité libres fussent des propriétés inhérentes à la substance ignée. Le soleil, disaient-ils, possède au suprême degré l’intelligence ; mais son action calorifique n’en est que la manifestation et non la cause. C’est ce que pensait à peu près Macrobe, et c’est également cette opinion qu’il attribuait à Cicéron[36]. En écrivant : Aux grands hommes, il a donné une âme, partie de ces feux éternels que nous nommons constellations, étoiles[37], Cicéron, dit-il, n’a pas déclaré que nous sommes animés par les feux éternels et célestes ; car bien que divine cette flamme n’est pas moins un corps, et un corps, quelque divin qu’il puisse être, ne saurait animer un autre corps. Il a entendu exprimer simplement que nous avons reçu en partage une parcelle de cette âme du monde ou intelligence pure qui anime ces corps célestes, divins en apparence et en réalité. Il ajoute, en effet : et qui sont animés par des esprits divins. N’est-il pas évident que les feux éternels sont les corps, que les esprits divins sont les âmes des astres, et que la force intelligente qui pénètre nos âmes est une émanation de ces esprits divins. Ainsi tout en prétendant distinguer leur cinquième élément des autres, les platoniciens plaçaient dans les couches supérieures de l’espace céleste le principal foyer de l’intelligence, là même où les stoïciens mettaient la pure substance ignée. Aussi quelle que fût l’idée que l’on eût sur la nature intrinsèque des âmes, leur descente des sphères éthérées et leur ascension faisaient partie des doctrines de presque toutes les écoles philosophiques et des divers cultes[38]. Cette croyance était devenue générale dans l’empire romain au IIIe et au IVe siècle. C’est ainsi que le disciple des néoplatoniciens, le césar Julien, voyait les âmes arriver du ciel sur la terre portées par un rayon de soleil. Il écrivait : De la partie la plus active et la plus divine de sa clarté, il fait une sorte de char qui conduit sans obstacle les âmes vers une génération nouvelle. Et il exprime l’espoir de retourner après sa mort dans le sein du soleil : Puisse le soleil, quand l’heure fatale sera venue, m’accorder un essor facile auprès de lui, et s’il se peut, un séjour éternel avec lui[39]. Dans ses commentaires sur le Songe de Scipion[40], Macrobe nous fait connaître les croyances qui régnaient de son temps et qu’il partageait. Les âmes, dit-il, descendent du ciel sur la terre et remontent de la terre au ciel par deux portes : l’une, celle du Cancer, est appelée la porte des hommes, parce que c’est par elle qu’on descend sur la terre ; l’autre, celle du Capricorne, est appelée la porte des dieux, parce que c’est par là que rentrent les âmes qui viennent reprendre place parmi les dieux. Quand on demandait aux platoniciens de justifier l’existent ; de leur cinquième élément, d’en déterminer la nature, ils déclaraient qu’il était invisible, inappréciable aux sens et qu’on ne pouvait le connaître que par la raison. Les hommes qui recherchaient la clarté dans la pensée ne trouvaient pas satisfaction dans une telle conception ; elle leur paraissait purement hypothétique. Cicéron convenait lui-même qu’il était aussi difficile de donner un nom convenable à ce cinquième élément que d’expliquer quelle était sa nature[41]. On n’était pas plus avancé sur ce point au temps de Julien. Il écrivait[42] : Il est mal aisé, je le sais, de s’en faire une idée. C’est pourquoi Zénon, écrit Cicéron[43], n’était point d’avis d’ajouter aux principes ou éléments des choses, cette cinquième nature, de laquelle étaient composés les sens supérieurs et l’âme, selon les autres philosophes. Il assurait que le feu était cette même nature que l’on cherchait, et qu’il suffisait pour engendrer les sens et l’âme elle-même. De son côté Pline avait dit[44] : Au milieu des astres roule le Soleil, dont la grandeur et la puissance l’emportent sur tous, et qui gouverne non seulement nos saisons et nos climats, mais encore les autres astres et le ciel lui-même. II est la vie ou plutôt l’âme du monde entier ; il est le principal régulateur, la principale divinité de la nature ; c’est du moins ce qu’il faut croire si nous jugeons par les faits... Je pense qu’il faut laisser à la sottise humaine de chercher quelle est la figure et la forme de Dieu, si tant est qu’il ne soit pas le Soleil. Aussi peut-on constater la tendance générale des esprits à quitter les abstractions pour en venir dans la pratique au culte du Soleil et à déclarer avec Julien[45] : Je crois, sur la foi des sages, que le père commun des hommes, c’est le Soleil. La barrière qui séparait les stoïciens des platoniciens n’était pas infranchissable. Tandis que les épicuriens étaient les mécanistes de l’antiquité, les philosophes issus des écoles de Socrate et de Pythagore étaient des animistes. Tout aussi bien que Platon, Zénon enseignait que tout mouvement supposait nécessairement une âme qui l’opérait[46]. Ils ne différaient entre eux qu’au sujet de la substance dont était formée l’âme ou l’intelligence de l’Univers. Pour les stoïciens, cette substance était le feu. D’une nature aériforme, elle pénétrait tous les corps, disaient-ils ; et alors même qu’elle était invisible on en pouvait toujours constater la présence, en frappant, par exemple, deux cailloux ou en frottant deux morceaux de bois. Ils la définissaient[47] : un fluide intelligent et calorifique n’ayant aucune forme propre, mais les pouvant prendre toutes à son gré. Πνεΰμα[48] νοερόν καί πυρώδες, ούκ έχον μέν μορφήν, μετάβαλλον δ' είς ά βούλεται. Pour les platoniciens, la substance de l’intelligence constituait, il est vrai, un cinquième élément, mais quand ils voulaient la définir, la dépeindre, ils étaient contraints d’user de comparaisons[49], et ils l’assimilaient souvent au feu ou à l’air des stoïciens ; comme eus ils en plaçaient le foyer dans les sphères célestes. En dehors des écoles philosophiques la confusion des deus substances ne pouvait donc manquer de se produire dans la grande masse des esprits[50]. C’est ce que montre dans le langage usuel des Grecs et des Romains la synonymie des termes qui les désignaient[51]. On peut donc dire que pour les stoïciens la vie, et avec elle l’intelligence et la sensibilité qui la constituaient, n’était que la chaleur transformée[52]. La religion solaire avait ainsi pour base un système philosophique plus ou moins logiquement établi sur la nature ignée du principe constitutif de la force vitale et de l’intelligence, c’est-à-dire de Dieu[53]. Cette doctrine n’était pas si évidemment fausse que des hommes éclairés n’aient pu l’adopter[54]. Ce sont des croyances similaires sur l’essence divine qui formaient le fond du panthéisme naturaliste qui séduisit, au XVe et au XVIe siècle, tant d’esprits au-dessus de l’ordinaire, et les attira dans la Nouvelle Philosophie[55], malgré les nombreuses chimères de la secte. Selon Paracelse[56], le système général des astres, réalisé dans le firmament par l’élément du feu, est la source de la sagesse, de la sensibilité, des pensées ; c’est donc au feu que l’homme doit le développement de son intelligence. Or qui ne reconnaît ici la doctrine d’Héraclite qui disait que le monde est et sera toujours un feu vivant, s’embrasant et s’éteignant avec mesure. Héraclite d’ailleurs attribuait au feu les propriétés universelles, spirituelles et matérielles tout ensemble ; c’est assez dire que, comme Paracelse après lui, il ne désignait point par le mot πΰρ le phénomène extérieur du feu, mais le principe premier, générateur de ces phénomènes[57]. Cette idée est-elle donc si éloignée des opinions des savants modernes qui ont pensé que tous les phénomènes vitaux, physiologiques et psychologiques, étaient dus à l’action des forces naturelles, c’est-à-dire la chaleur, la lumière, l’électricité, le magnétisme, forces qui se transforment les unes dans les autres et en mouvement ? L’erreur de la doctrine et les conséquences qu’elle entraînait venaient de ce que tout système religieux ou philosophique se proposait de faire connaître l’essence de la cause qui produit la vie et fait régner l’ordre dans l’univers ; tandis qu’il ne nous est donné que de constater ses manifestations. Aussi est-ce à bon droit que Cicéron[58] fait dire à Cotta : Que n’est-il aussi aisé de trouver les raisons qui établissent le vrai que celles qui dévoilent le faux ! Les esprits qui veulent ou peuvent tenter de se débarrasser des préjugés et des erreurs qui règnent autour d’eux sont rares en tous les temps ; grand, au contraire, est toujours le nombre de ceux qui préfèrent les partager et éviter ainsi tout ennui, taule fatigue d’esprit. Dans l’empire au nie et au ive siècle dominait le mysticisme. Par son but et sa méthode, la philosophie n’était à vrai dire que la théologie. Les philosophes se confondaient avec les hiérophantes[59]. Aussi leur ultima ratio était comme celle des temples : le maître l’a dit ou c’est un mystère. Peut-être, déclare Julien[60], ces idées sont-elles trop subtiles ; mais je tiens moins à les démontrer qu’à y croire. Impuissants dans la discussion contre le bon sens et la raison, ils étaient toujours prêts à employer la violence pour étouffer la parole de leurs adversaires, pour l’empêcher de parvenir aux oreilles de leurs adeptes. Les principes d’Épicure surtout les irritaient. Toute voie, déclaraient-ils[61], ne convient pas aux prêtres puisqu’ils doivent suivre celle qui leur est tracée ; de même toute lecture ne leur convient pas. Fermons tout accès chez eux aux enseignements d’Épicure et de Pyrrhon ; c’est un des bienfaits des dieux de la perte de leurs livres, dont la plus grande partie a disparu. La grande majorité de ceux qui, parmi les populations de l’empire romain, avaient reçu une culture intellectuelle moyenne, concevait la divinité comme quelque chose de semblable à l’air, mais d’une essence beaucoup plus subtile, comme un fluide impondérable, dirions-nous, s’il était permis d’appliquer une telle expression à des idées anciennes. Embrassant et pénétrant tout dans l’univers, elle n’avait aucune forme particulière et pouvait les prendre toutes : elle réunissait en elle les principes de la chaleur, de la lumière, du mouvement et, par suite de la vie et de l’intelligence. Elle façonnait et animait tout ce qui existe, quoiqu’à des degrés divers. Elle se concentrait surtout dans les hautes sphères, dans les astres qui étaient constitués de sa propre substance et exerçaient une action providentielle dans le monde. Le soleil était reconnu pour être incontestablement de tous les corps célestes le plus grand, le plus puissant, celui qui avait la plus considérable et la plus directe influence sur la terre. Mais s’il lui était donné d’y apporter et d’y entretenir la vie, il n’était toutefois que l’émanation, ou en quelque sorte le fils de la divinité universelle et suprême, de la Nature. A un autre point de vue un le considérait comme en étant un des organes d’action, sa voix ou sa main ; il était ainsi l’artisan ou démiurge, l’intermédiaire ou médiateur du monde. LES CULTES PAÏENSLa doctrine panthéistique et naturaliste des stoïciens leur permettait de ne se mettre en antagonisme ni avec la religion gréco-romaine, ni avec les autres cultes répandus dans les diverses provinces de l’empire. L’école du Portique les adoptait tous en leur donnant toutefois des interprétations allégoriques. Elle se flattait de transformer par d’habiles transactions la théologie mythique et la théologie civile en théologie physique[62]. Qu’est-ce que la Nature, disaient-ils[63], si ce n’est Dieu, si ce n’est cette intelligence céleste répandue dans l’ensemble et dans toutes les parties de l’univers ? Pour peu que vous le vouliez, il y a bien d’autres noms à donner à ce grand auteur de tout ce qui est à notre usage. Vous pouvez l’appeler Jupiter stator parce qu’il donne la stabilité à toutes choses ; nommez-le Destin, car le destin est l’enchaînement compliqué de toutes les causes et lui-même la première cause, celle de qui toutes les autres dérivent. Tout nom que vous lui donnerez lui conviendra à merveille, dès que ce nom caractérisera quelque attribut, quelque effet de la puissance céleste ; Dieu peut avoir autant de noms qu’il est de bienfaits émanant de lui. C’est pour cela que ceux de notre secte le confondent avec Bacchus, Hercule, Mercure. Les prêtres orientaux avaient, d’autre part, avant les barbares du Nord, envahi l’empire romain. Par leurs connaissances médicales, physiques, astronomiques, ils avaient acquis une influence considérable et supplanté les ministres d’Esculape, les aruspices et les augures, les druides et autres pontifes provinciaux. Ils avaient répandu avec eux le naturalisme religieux qui constituait le fond de leurs cultes et qu’ils retrouvaient d’ailleurs presque partout dans les anciennes croyances mal éteintes. La partie élevée de leur théologie et de leur morale ne différait pas essentiellement des doctrines enseignées dans les écoles philosophiques gréco-romaines. Leurs idées sur la nature divine du Soleil, la descente et l’ascension des âmes, et sur d’autres questions, étaient à peu près les mêmes. Si parmi les gens éclairés, il en était beaucoup qui, à l’exemple de Pline, ne pouvaient s’élever à la conception de l’élément invisible, il en était surtout ainsi pour les masses. Elles n’avaient de culte que pour l’astre visible dont la substance et l’action étaient apparentes ; c’est à lui qu’elles adressaient leurs hommages et leurs prières. Le Soleil était ainsi devenu la divinité prépondérante au IIIe et au IVe siècle[64]. Mais bien que l’anthropomorphisme eût perdu un terrain considérable, il était loin d’avoir disparu de la conscience religieuse du monde romain. L’habitude de concevoir les dieux sous la forme humaine hantait encore fortement les esprits. On se plaisait à représenter le Soleil sous la figure d’un homme soit entièrement nu, soit ayant les épaules recouvertes d’un manteau et portant sur la tète une couronne ornée de rayons ; on lui donnait aussi les traits et les attributs sous lesquels avaient été honorés la plupart des dieux. Vainement les philosophes avaient voulu faire de Jupiter le dieu suprême, l’Éther[65]. Jupiter, disait Plutarque[66], n’est pas né en Crète. Principe et cause de son éternelle existence, il a toujours été, il sera toujours. En lui sont le commencement et la fin, la mesure et la destinée de chaque chose. Mais placé à une telle hauteur, s’occupant de l’univers entier, ses regards ne se portant pas spécialement sur la terre et sur les hommes, ses autels eussent reçu moins d’offrandes, on en fit le soleil[67]. Pour conserver la clientèle de leurs temples, tous les autres dieux de l’Olympe, Apollon, Mars, Mercure, furent assimilés au grand astre[68]. Il en fut de même des dieux particuliers de certaines contrées, comme le Belenus de la Gaule[69]. C’est le Soleil qu’adoraient les initiés aux mystères de Bacchus et de Cérès[70], de Cybèle[71], de Vénus[72], d’Isis[73], de Mithra[74]. Hercule et ses, douze travaux était le Soleil parcourant les douze signes du zodiaque. Tous ces dieux et toutes ces déesses avaient par suite à peu près les mêmes attributs ; on les honorait par des cérémonies à peu près semblables. Nous n’avons pas à insister sur ce point. Nous rappellerons seulement que dans les Gaules, Belenus était confondu avec Mercure, et tous deux avec Mithra, ainsi que le montrent diverses sculptures antiques[75]. Mercure était parfois représenté debout sur la croupe d’un taureau ; et à Patras, où Apollon avait un culte spécial, il était, nous dit Pausanias, également sur un taureau. Sur beaucoup de bas-reliefs c’est la déesse Mylitta, la Vénus assyrienne, qui immole un taureau, comme Mithra[76]. Mylitta ne se distinguait pas d’Astarté, la Vénus phénicienne, la Virgo celestis ou numen virginale de Carthage[77]. Saint Ambroise confond Mithra et Mylitta[78]. Isis était prise pour Cérès et pour Vénus[79]. Il est d’usage, dit Macrobe[80], dans la célébration des mystères, que le Soleil, alors qu’il parcourt l’hémisphère supérieur ou diurne, soit invoqué sous le none d Apollon, et sous celui de Dionysos, qui est le même que Bacchus, alors qu’il parcourt l’hémisphère inférieur ou nocturne. D’autre part, le calendrier romain réformé par Auguste et basé sur les révolutions solaires, avait été imposé à toutes les contrées de l’empire dans l’intérêt administratif. Si certaines populations continuaient à désigner les mois par les noms indigènes qu’elles étaient habituées à leur donner, chacun d’eux, néanmoins, correspondait à un mois romain. La division toutefois du mois en ides et kalendes n’avait rien de naturel, rien de logique ; elle ne se généralisa pas : elle frit, au contraire, abandonnée. En dehors du monde officiel, la semaine depuis longtemps adoptée en Égypte et en Asie, suivie dans tous les mystères orientaux, devint vers la fin du IIe siècle, de l’Euphrate à l’Océan, le mode général de compter et de nommer les jours[81]. Chacun d’eux fut ainsi consacré à un astre. Il y eut d’abord le jour du Soleil, puis ceux de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus, de Saturne. Sur ce point comme sur tant d’autres, l’unification s’était faite dans le monde romain. Le premier jour de janvier, époque traditionnelle à Rome pour les mutations des grandes magistratures, fut choisi pour le commencement de l’année civile. Mais elle ne répondait pas à la date astronomique du solstice d’hiver, du retour apparent du soleil vers l’hémisphère nord ; celle-ci était fixée sur le calendrier romain au 25 décembre invariablement. Chaque année, en ce jour, dans toutes les provinces de l’empire les confréries de Bacchus[82], de Mithra[83], de Vénus, d’Isis[84], et d’autres encore célébraient par des manifestations joyeuses ce qu’elles appelaient la Nativité du Soleil[85], du Dieu qui allait amener la belle saison des fleurs et des fruits. La fête était parfois ajournée au 1er janvier. On la faisait ainsi coïncider avec le commencement de l’année civile. Ce n’était d’ailleurs qu’à ce moment que l’on pouvait constater effectivement une légère augmentation dans la durée du jour, s’assurer que l’époque de sa croissance régulière était arrivée. Les processions étaient de rigueur dans toutes les fêtes religieuses[86]. Les mystes de Bacchus parcouraient les rues des villes et les routes de la campagne. Des faunes et des bacchantes portaient triomphalement le Dieu nouveau-né, Λικνίτης[87], couché dans le van ou la corbeille sacrée qui lui servait de berceau ; il avait à la main une grappe de raisins, symbole de l’heureuse récolte qu’il promettait[88]. On le montrait aussi tenu dans les bras de Cérès[89]. Les dignitaires portaient tous des peaux de faon, la nebris[90] ; ils étaient coiffés de mitres, avaient des thyrses à la main. D’autres jouaient de la flûte ou battaient du tambour ; d’autres portaient des branches de sapin. Ceux des rangs inférieurs, par leurs costumes et leurs gestes, cherchaient à représenter quelques-unes des actions attribuées à ce Dieu. Venaient ensuite les porteurs de phallus, le visage enguirlandé, et une partie d’entre eux habillés en femmes ; ils se livraient à des danses extravagantes et obscènes ; d’autres, montés sur des ânes, imitaient Silène, Pan et les Satyres. Tous criaient à tue-tête les mots sacramentels : Evohé Bacchus ! Puis ils se réunissaient dans des banquets où l’ivresse était obligatoire[91]. Pour les initiés aux mystères de Bacchus, de Cybèle, de Sérapis, l’ébriété était un acte religieux par lequel ils rendaient hommage à la Divinité[92], en obtenaient des faveurs, et entraient par l’extase en communication avec elle[93]. On se persuadait qu’on agissait alors sous son impulsion et que tout devenait permis, que rien de ce qu’on faisait ne pouvait être mal, puisqu’un Dieu ne pouvait que bien faire. Les sectateurs de Mithra avaient aussi leurs processions en ce jour[94]. Ils se distinguaient par les insignes de leurs grades. Les uns figuraient des taureaux ; d’autres se faisaient des têtes de lion ; ceux qui avaient les grades supérieurs ou aériens avaient des têtes de vautour, d’aigle, de griffon, d’épervier. Ils criaient en répétant les mots syro-chaldaïques : Annouel ou Noël, c’est-à-dire, un dieu nous est né[95]. Des festins où la joie et l’espérance se manifestaient par l’intempérance complétaient la fête anniversaire de Mithra[96], le Médiateur, le Mesites[97], comme disaient les initiés grecs. Les confrères d’Isis, couverts également de peaux de faon ou revêtus de formes symboliques d’animaux, se livraient à mille extravagances[98]. Les prêtres, ayant leur tète marquée d’une large tonsure, étaient vêtus de tuniques blanches ; les uns étaient armés de thyrses[99], d’autres portaient des lampes allumées[100]. Ils promenaient triomphalement l’image d’Horus[101] ; le jeune dieu qui venait de naître pour le bonheur de la terre, qui allait grandir bientôt et redonner la vie à la nature, était tenu dans les bras de sa mère la vierge Isis[102], ainsi que le montrent de si nombreuses figurines antiques. La vénération des provinces de l’empire pour Isis l’avait, pour ainsi dire, transformée en déesse olympienne. Au lieu de la forme raide dont elle était affublée aux bords du Nil, les artistes grecs et romains la représentaient sous les traits d’une matrone patricienne ; ils la revêtaient d’une tunique aux plis élégants ; son visage respirait la grâce et la dignité[103]. Dans beaucoup d’autres cultes s’accomplissaient des cérémonies analogues. Ainsi aux kalendes de janvier on fêtait encore Jupiter-Soleil naissant, le Vejovis des Latins, l’Axur des Grecs. A Rome la foule se rendait alors dans l’île du Tibre où était son temple[104]. Dans la plupart des contrées et même des villes, les habitants étaient partagés en mystes de Bacchus, de Vénus, d’Isis et autres. Prenons pour exemple les Gaules. Nous n’avons pas à rappeler les nombreuses confréries de Mithra, de Bacchus, de Belenus, qui y étaient répandues. Celles d’Isis ont été contestées. Mais dans la Religion des Gaulois[105], le savant bénédictin de Saint-Maur démontre que les inscriptions recueillies par Gruter, Reinesius, Chorier, Bouche et autres savants attestent que non seulement Isis était connue et honorée dans les Gaules, mais encore qu’elle y avait des temples magnifiques et superbes. A cet effet il cite des inscriptions trouvées en Flandre, à Soissons, à Nîmes. Il établit ensuite que l’église de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés fut un temple d’Isis et que sa statue, selon Jacques Dubreuil, religieux de cette abbaye y était gardée non pour l’adorer mais pour remarque d’antiquité du lieu. Il fait en outre observer que le bourg d’Issy, Issiacum, tire son nom d’un ancien bâtiment qui a toujours passé pour avoir été un temple d’Isis. Enfin il rappelle que Melun, au moyen âge, s’appelait Isia, à cause du sanctuaire en renom que la déesse y avait possédé. Quoique ayant au fond à peu près les mêmes croyances, toutes ces confréries se jalousaient. Quand leurs processions se rencontraient, il était rare qu’elles ne se livrassent point bataille. Les thyrses que portaient les confrères ressemblaient fort aux longues cannes à pomme entourées de rubans des Compagnons du Devoir et servaient comme elles d’armes pour la défense aussi bien que pour l’attaque[106]. Sulpice Sévère, dans la vie de saint Martin[107], raconte comment le saint, entouré de ses partisans, aperçut un grand nombre d’hommes qui semblaient accomplir une marche religieuse. Il s’apprête aussitôt à leur faire un mauvais parti, ou tout au moins à empêcher leur cérémonie de s’accomplir ; cependant, après s’être rapproché d’eux et ayant reconnu que c’était un simple enterrement, il permit au cortège de continuer sa route. C’est cet usage qui s’est si longtemps conservé dans les diverses corporations de métiers. Il est encore de nos contemporains qui ont vu ces affligeants combats à coups de bâtons que se donnaient les Compagnons quand ils venaient il se croiser sur un même chemin. Des fêtes analogues en l’honneur du Soleil se renouvelaient à toutes les saisons[108]. Celles de l’équinoxe du printemps étaient avec celles du solstice d’hiver les plus générales. Dans presque tous les cultes on célébrait le retour du Soleil sous le symbole de la mort et de la résurrection de quelque divinité. Parmi les cérémonies les plus remarquables étaient celles des Mystères de Vénus. Ce qu’on voyait à Antioche[109], à Byblos[110], à Alexandrie[111], à Athènes[112], se répétait partout où était honorée la déesse, c’est-à-dire dans toutes les provinces. Ces solennités duraient plusieurs jours, quelquefois huit jours. Les premiers étaient consacrés au deuil. On pleurait Adonis[113] (le soleil), le bel amant de Vénus (la terre) tué par le sanglier (l’hiver)[114]. Les initiés se livraient alors à toutes les manifestations d’un violent désespoir. Ils formaient des processions qui simulaient des cortèges de convoi funèbre ; les femmes s’arrachaient les cheveux, se frappaient la poitrine ; les hommes se flagellaient ; l’air retentissait de cris de douleur, de chants et de sons de flûte lugubres. On allait voir dans les sanctuaires le jeune Dieu étendu sur son lit, vêtu des tissus les plus délicats, les plus riches et les mieux ouvrés ; il était entouré de branches d’arbres, de fruits, dons précieux de la nature dont il était le dispensateur. La pâleur n’altérait pas la sérénité et la beauté de ses traits. Comme il paraissait beau l’amant trois fois aimé de Vénus, l’amant chéri jusque dans les enfers ! que doux était son visage ombragé d’un duvet naissant ! Auprès de lui d’habiles cantatrices faisaient entendre des chants élégiaques : Sois heureuse, Vénus, qui reçois les hommages des hommes sous tant de noms et dans tant de temples ! Tu vas revoir ton époux, il va revenir à la vie. Toi seul, è cher Adonis, toi seul parmi les dieux, vois tour à tour la terre et l’Achéron ! Sois le bienvenu, sois-nous propice ![115] Le dernier jour était tout à la joie, tout aux festins en l’honneur du dieu ressuscité. Le temps de deuil était quelque chose comme notre semaine sainte. Le malheur attendait inévitablement, croyait-on, celui qui n’y prenait point part ou qui le troublait. Aussi attribua-t-on l’issue fatale de l’expédition athénienne contre Syracuse au départ de la flotte durant les Adonies[116]. En arrivant à Antioche, Julien trouva toute la population poussant des cris de douleur pour la mort d’Adonis[117] ; elle ne se détourna pas de ses lugubres cérémonies ; le César les respecta malgré ce qu’une pareille réception avait d’étrange et de contraire aux manifestations de joie qu’on faisait éclater d’habitude à l’entrée d’un souverain dans une ville. On attribua néanmoins sa mort et la défaite de son armée par les Perses à cette funeste coïncidence qui marqua son arrivée dans la capitale de la Syrie. Le 21 mars de chaque année[118] les sectateurs de Cybèle consacraient deux jours à la douleur de la perte d’Atys, et un troisième jour à la joie de l’avoir retrouvé. Les manifestations de ces fanatiques allaient jusqu’à la frénésie, jusqu’à des actes sanglants[119]. Les mystes de Bacchus pleuraient aussi sa passion et sa mort et fêtaient sa résurrection[120]. Donnant parfois une forme plus euphémique à la même idée du Dieu mourant périodiquement et revenant à la vie avec le printemps, on le faisait descendre aux enfers avec Perséphone ; et le couple divin en remontait triomphant. Dans les confréries d’Isis on se lamentait également de la mort cruelle d’Osiris et l’on se réjouissait de sa résurrection[121]. Des cérémonies analogues se célébraient dans presque tous les autres mystères[122]. Le Soleil était par suite devenu le Dieu universel de l’empire romain. Son culte servait en quelque sorte de lien religieux et politique entre toutes les populations quelles que fussent leur origine, leur langue, leurs croyances particulières. Chacun, disait Lucien[123], voit le soleil luire dans sa patrie, et quoique chacun le déclare sien, le Dieu est commun à tous. Il était le vrai Dieu, DEUS CERTUS[124]. Tous aussi désignaient le Soleil par une même qualification, celle de Maître ou Seigneur. Baal, Adonaï ou Adonis, Κύριος, Dominus avaient la même signification[125]. Ainsi d’un bout à l’autre de l’empire, tout le monde disait du premier jour de la semaine indifféremment le jour du Soleil, ή τοΰ Ήλιου ήμέρα, dies Solis, ou bien le jour du Seigneur, ή τοΰ κύριου ήμέρα, ή κύριακή, Dies Domini, Dies Dominica[126]. Le grand astre était ainsi proclamé le Seigneur et Maître de l’empire romain, SOL DOMINUS IMPERII ROMANI, ainsi que le montrent des médailles frappées sous le règne d’Aurélien[127]. LE CULTE CHRÉTIENDans les premiers siècles de notre ère, la croyance à la fin du monde n’était généralement pas contestée. Quand on voyait périr tour à tour chacune de ses parties, on ne se considérait pas en droit de douter qu’il ne vint à disparaître lui-même[128]. Les diverses sectes philosophiques ou religieuses ne différaient que sur la manière dont cette destruction se ferait et sur l’époque à laquelle elle aurait lieu. Les uns croyaient à un déluge universel dont Sénèque trace un magnifique et émouvant tableau[129]. D’autres attendaient une conflagration générale. D’autres, enfin, faisaient intervenir l’eau et le feu comme éléments destructeurs[130]. Pour les uns, la date de la catastrophe finale demeurait fort éloignée. D’autres, avec Bérose, la fixaient au moment où tous les astres qui faisaient leurs révolutions à des distances plus ou moins grandes seront rassemblés sous le signe du Cancer ou du Capricorne et auront leurs centres placés sur une même ligne[131]. D’autres la croyaient proche[132]. Tous admettaient qu’elle pourrait être produite par quelque cataclysme subit et inattendu[133]. Cette éventualité préoccupait les esprits ; et après chaque phénomène météorologique peu commun ou l’apparition de quelque comète, rares étaient ceux qui ne disaient pas comme Trissotin : Nous l’avons en dormant, madame, échappé belle. On était, d’autre part, unanime à penser qu’à cette destruction ne succéderait pas le néant[134], mais qu’elle serait suivie de l’établissement d’un nouvel et meilleur état de choses. Quand, écrivait Sénèque, l’heure fatale sera venue pour le renouvellement du genre humain[135]..., pluie, irruption de la mer, tremblements de terre se verront. La nature s’aidera de tout pour accomplir son œuvre. Toutes les parties du grand tout seront dissoutes et anéanties pour être régénérées, et reparaître neuves et irréprochables, incorruptibles[136].... Une fois la race humaine détruite avec les bêtes farouches dont l’homme avait adopté les mœurs, la nature forcera la mer à être immobile et à rugir dans ses limites. L’organisation ancienne sera rétablie. Tous les animaux renaîtront. La terre sera repeuplée d’hommes innocents et nés sous des auspices plus heureux[137]. Mais au lieu de croire qu’ils seront dotés d’une vie immortelle et toujours vertueuse, Sénèque ajoutait tristement : Leur innocence ne durera pas plus que l’enfance d’une race nouvelle. Les personnes qui en grand nombre étaient troublées par la perspective de la terrible catastrophe trouvaient dans la plupart des religions, notamment dans les mystères de Mithra et d’Isis, l’assurance qu’elles n’auraient rien à redouter. Les initiés, assurait-on, qui vivraient à ce moment, seraient transformés en êtres immortels et ceux qui seraient déjà morts ressusciteraient pour partager le sort heureux de leurs frères[138]. C’est cette même espérance que donnaient à leurs disciples les Apôtres de Jésus et ceux qui, après eux, se disaient les missionnaires de la Bonne Nouvelle. Cette transformation de la terre se ferait, pensaient les uns, sous l’action du soleil, source de la vie sur la terre ; d’autres croyaient qu’elle aurait lieu avec un soleil nouveau. On admettait l’existence d’un ou plusieurs autres soleils qui demeuraient invisibles, mais dont on ne pouvait douter, puisqu’ils s’étaient parfois montrés, affirmait-on, au-dessus de l’horizon[139]. Ne voyait-on pas, d’ailleurs, les comètes et d’autres astres apparaître et se dérober aux yeux des humains[140] ? Il existe donc, disait-on, des corps célestes hors de notre vue et rien, par conséquent, n’empêche que l’un d’eux vienne à un moment donné, substituer son action à celle du soleil actuel. Mais, dans l’un ou l’autre cas, c’était un foyer de lumière et de chaleur, un soleil qui devait transformer le monde[141] ; on ne connaissait pas, on ne supposait pas d’autre force capable de le faire[142]. La fin du monde et la résurrection dei morts constituaient, sinon l’unique, du moins là principale préoccupation des esprits dans les confréries chrétiennes. Le christianisme ne pouvait ainsi manquer de subir l’influence du milieu où il se développait et se recrutait. Pour les populations qui croyaient que la puissance divine résidait dans les astres et auxquelles on affirmait que le Christ était le Verbe de Dieu et Dieu lui-même, qui devait transformer le monde et ressusciter, rendre immortels ceux qui auraient cru à la parole de ses apôtres, pour de telles populations la confusion du Christ et du soleil était inévitable. En répondant à ses adversaires, Tertullien disait[143] : D’autres, avec plus de raison et de vraisemblance, croient que notre Dieu est le soleil. Il faudrait alors nous ranger parmi les Perses, quoique nous n’adorions pas comme eux l’image du soleil sur nos boucliers. Ce soupçon vient apparemment de ce que noua nous tournons vers l’orient pour prier. Mais ne voit-on pas la plupart de vous tournés vers le même point du monde et affecter d’adorer le ciel en remuant les lèvres ? Si nous donnons à la joie le jour du soleil, c’est pour une raison tout autre que le culte de cet astre. Ce que nous adorons est un seul Dieu qui, par sa parole, sa sagesse et sa toute-puissance, a tiré du néant le monde avec les éléments, les corps et les esprits pour l’ornement de sa grandeur. Observons, tout d’abord, qu’on ne saurait lire sans un sentiment de surprise et de défiance, les ouvrages chrétiens qualifiés d’apologétiques. Quand les enseignements des églises étaient, comme ceux des autres cultes, donnés mystérieusement aux initiés et selon leurs grades[144], est-il vraisemblable que des docteurs ecclésiastiques aient publiquement dévoilé devant les profanes l’objet de leurs croyances[145] ? Il est toutefois admissible que des hommes influents ou ayant autorité dans les églises professaient les doctrines platoniciennes, et admettaient un cinquième élément invisible, incorporel, qui était l’intelligence et qui formait la substance de Dieu et celle de l’âme humaine. Ce sont ces idées qui finirent par triompher. Mais s’il est possible que les églises orthodoxes fussent du IIe au Ve siècle plus puissantes et plus nombreuses qu’aucune autre secte, elles ne constituaient certainement pas moins une minorité par rapport au nombre total des hérésies. Or Basilide, Bardesane, Manès et autres fondateurs de confréries importantes parmi celles qui se disaient chrétiennes, avaient adopté les croyances du naturalisme oriental. L’Abraxas ou Abracadabra des Basilidiens n’était autre chose que le dieu Soleil, figuré par le coq ou d’autres emblèmes ainsi que l’ont montré les savants chanoines L’Heureux et Jean Chifflet[146]. Par manichéen, il faut aussi entendre un chrétien qui ne différait guère d’un disciple de Zoroastre. On n’en saurait douter, quand on voit, dans les Actes de la dispute d’Archélaüs avec Manichée, l’évêque de Cascar apostropher en ces termes l’hérésiarque[147] : Barbare de Persan, grosse barbe, prêtre de Mithra, imposteur, tu adores le soleil, Mithra, qui éclaire, dis-tu, vos cavernes mystérieuses. Point n’est besoin de rappeler l’importance que prit le manichéisme parmi les chrétiens et les hommes supérieurs qu’il compta dans son sein. Les idées sur la subtilité, l’activité intelligente et créatrice du feu étaient d’ailleurs si générales qu’il n’était guère personne dans les églises qui pût s’en affranchir. C’est au feu que la plupart des Pères de l’Église, et surtout saint Augustin[148], comparent ou assimilent l’intelligence divine, le Saint-Esprit, troisième personne de la triade chrétienne et de même nature que les deux autres. C’était en langues de feu qu’il était, disait-on, descendu sur les apôtres. Aussi l’ablution ne constituait-elle pas alors le véritable sacrement d’initiation ; comme dans les mystères isiaques[149], mithriaques, dionysiaques[150], elle n’était qu’un acte préparatoire, ou un premier degré ; l’initiation définitive se conférait non par l’eau mais par le feu ou la lumière. C’est ce qu’expliquent les paroles attribuées à Jean, le prophète du Jourdain[151] : Pour moi, je vous baptise de l’eau ; mais il vient un plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui délier les cordons de ses souliers. C’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. L’initiation en conséquence ne se disait pas l’ablution, βαπτισμός ; c’était l’illumination, φωτισμός ; et le lieu où elle se faisait était appelé par les Grecs φωτιστήριον, et par les Latins locus illuminationis[152]. C’est ce qu’on peut constater dans la Vie de Constantin, par Eusèbe, à propos du sacrement qui lui aurait été conféré. Au sujet des cérémonies pour rendre le vieil empereur participant aux mystères, il est dit qu’il fut transfiguré par la lumière divine et que la robe dont il était revêtu brillait avec autant d’éclat que la clarté du jour[153]. Pour la généralité des chrétiens l’air, πνεϋμα ou spiritus, dont nous avons fait esprit, était synonyme de feu ou lumière. Le πνεϋμα άγιον καί πΰρ des églises était le πνεϋμα νοερόν καί πυρώδες des philosophes. Aussi dans les écrits attribués au légendaire Denys l’Aréopagite et qui faisaient autorité dans les Églises, il était dit : Le feu existe dans tout... Il produit, il est puissant, il est invisible et présent à tout. Voilà pourquoi les théologiens ont déclaré que les substances célestes étaient formées de feu et par cela faites autant que possible à l’image de Dieu[154]. Ce n’était guère que des nuances d’idées qui séparaient les sectes les unes des autres, comme selon qu’on admettait l’homoousion ou l’homoiousion on était athanasien ou arien. Tout en supposant, en effet, l’existence d’une substance intelligente distincte du feu, les orthodoxes, qui suivaient les philosophes platoniciens, pensaient que le soleil et les astres étaient de nature divine. C’est ce que montrent les textes qui leur servaient de règle[155]. Ainsi, pour prouver la possibilité de la vie éternelle sur la terre qu’on promettait au chrétien, lors de l’avènement du Messie, l’apôtre Paul[156] rappelle qu’il y a deux sortes de corps : les corps mortels et corruptibles, les corps immortels et incorruptibles ; il qualifie les premiers de corps terrestres et les seconds de corps célestes ou stellaires, tels que le soleil, la lune, les étoiles. Il est évident qu’il partageait et confirmait l’opinion commune, puisqu’il y faisait appel. D’autre part, l’image du soleil était celle sous laquelle les apôtres représentaient ordinairement Jésus. L’auteur des Actes fait dire à Paul, en parlant du miracle de sa conversion : une grande lumière céleste resplendit autour de moi. Dans l’Apocalypse, il est écrit[157] : Son visage resplendissait comme le soleil dans toute sa force. C’est encore le soleil qu’il faut entendre sous la qualification symbolique d’Agneau qui est si souvent donnée à Jésus dans cette prophétie[158]. Le 4e évangile s’exprime ainsi[159] : Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean fut envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et ailleurs[160] il fait dire à Jésus en parlant de lui-même : Je suis la lumière de l’univers. En parlant des phénomènes avant-coureurs de la venue du Messie et de la transformation du monde, les évangélistes disaient : Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles ;.... les puissances des cieux seront ébranlées ; on verra venir alors le Fils de l’homme sur une nuée avec une grande puissance et un brillant éclat. On pourrait produire encore bien d’autres citations. Ces croyances, au sujet de la nature ignée de Dieu et de son assimilation au soleil, se trouvaient appuyées de l’autorité de prophéties hébraïques. Les juifs, sur ce point comme sur tant d’autres, n’avaient pas manqué de subir l’influence du mazdéisme. Ses doctrines se trouvent, en effet, reproduites dans leur littérature religieuse. Dieu, lit-on dans le Psaume XVIII[161], a établi sa tente dans le soleil ; il est comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale ; il se plait à fournir sa carrière comme un géant ; il va d’une extrémité du ciel à l’autre ; rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite ; elle remplit les âmes. Par les interprétations allégoriques qu’il essaie de donner dans ses commentaires sur ce psaume, saint Augustin met hors de doute que ces passages étaient, comme il est naturel de le penser, communément pris à la lettre par les fidèles[162]. Mais on renouvelait contre la divinité du soleil l’objection si souvent reproduite dans l’antiquité contre l’existence même des dieux. : Pourquoi, parmi les hommes, les bons sont-ils souvent accablés de maux, tandis que les méchants ont les biens en partage ? Pourquoi les bienfaits du soleil, disait-on, se répandent-ils indifféremment sur les croyants et les impies ? C’est pourquoi la plupart des Églises orthodoxes déclaraient que le Christ n’était pas le soleil que l’on voyait actuellement, qu’il serait un soleil nouveau, un soleil de justice dont les rayons ne porteraient la lumière et la vie qu’à ceux qui auraient trouvé grâce devant Dieu. Elles s’appuyaient à cet effet sur les paroles de quelques voyants israélites. L’un d’eux, entre autres, Malachie, avait dit[163] : Voici venir un jour embrasé comme une fournaise ; tous les orgueilleux, tous les méchants seront comme du chaume ; et ce jour qui viendra les brûlera, a dit le Dieu des armées ; il ne leur laissera ni rameau, ni racine. Mais sur vous, qui craignez mon nom, se lèvera LE SOLEIL DE LA JUSTICE et la vie sera dans ses rayons ; vous marcherez et vous croîtrez comme de jeunes taureaux engraissés. C’est donc sans surprise que nous entendons Bosio nous dire[164] : Sous le nom métaphorique de soleil, on désignait Notre-Seigneur le Christ, parce qu’il est le soleil de justice. Saint Cyrille d’Alexandrie l’expliquait par les prophéties juives. Notre-Seigneur Jésus-Christ est appelé Soleil, nous apprend-il, à cause de ces paroles de l’Écriture : Sur ceux qui craindront mon nom se lèvera le soleil de justice. Un peu plus loin il ajoute : Eusèbe nous dit aussi : Celui qui était appelé généralement Seigneur, Dieu, Ange, Roi des Rois, Pontife, Verbe, Sagesse ou Image de Dieu, on le nomme maintenant Soleil de Justice. Celui-ci, toutefois, que Dieu a engendré ne se lèvera pas pour tous les hommes, mais seulement pour ceux qui craindront son nom. La principale différence, en effet, entre les manichéens ou autres et la plupart des orthodoxes, parait avoir consisté en ce que les premiers assimilaient le Christ au soleil qui éclairait et vivifiait actuellement le monde et que les seconds en faisaient le soleil invisible pour le moment, qui devait apparaître au jour de sa transformation. Saint Augustin, qu’on ne saurait se refuser à considérer pour un homme de génie, pendant plus de dix ans professa le manichéisme, prêcha et mit tout son zèle à propager la croyance que le Christ n’était autre que le soleil lui-même. Il devait certainement s’appuyer sur des textes et des raisons qui lui paraissaient probantes. Plus tard il modifia ses idées. Le Christ, dit-il alors[165], est Notre Soleil de justice ; non pas le soleil qu’adorent les païens et les manichéens, celui que voient aussi les méchants ; il est cet autre Soleil dont la vérité éclaire la nature humaine. Mais quand l’évêque d’Hippone entreprit de ramener à sa nouvelle doctrine ceux avec lesquels il avait été si longtemps en intime communion d’idées, il rencontra des obstacles considérables. Les efforts si souvent réitérés qu’il tente à ce sujet, démontrent avec évidence combien la confusion du Christ et du soleil était générale et tenace dans les esprits de ceux qui faisaient partie des confréries chrétiennes. On l’entend s’écrier : Ceux qui croient honorer le Christ dans le Soleil mentent à son sujet ; ceux qui disent que le Christ est le Soleil mentent au sujet du soleil. Le Soleil sait bien que le Christ est son Seigneur et son Créateur ; et s’il pouvait s’indigner, il s’indignerait bien plus fortement contre ceux qui l’honorent si faussement que contre ceux qui l’outragent[166]. Il convient cependant, et ne pouvait se refuser à le faire, que dans les livres saints il fallait assez souvent entendre par Soleil le Christ. Ne croyez pas, mes frères, dit-il[167], que nous devions adorer le Soleil parce que, dans les Écritures, le Soleil signifie parfois le Christ.... Ce sont là des métaphores. Pour les comprendre, il faut être capable de reconnaître que la chose qui se montre à nos yeux est tout autre que celle qui se montre à notre âme. Et dans son commentaire du Psaume CIII, où on lit : le soleil a connu son coucher, il dit : Que signifient ces paroles, sinon que le Christ a connu sa passion ? C’est du coucher dont il s’agit et le coucher dit Christ, c’est sa passion ; de même que le Soleil se couche et se lève, le Christ est mort et ressuscitera. Aussi Augustin se sent-il tenu à des ménagements envers les manichéens ; et tout en les combattant, il s’écrie[168] : Que ceux-là s’irritent contre vous qui ignorent combien il est malaisé de guérir l’œil de l’homme intérieur en sorte qu’il puisse regarder son Soleil ; ce Soleil n’est pas celui que vous adorez avec les yeux de la chair et qui brille également pour les hommes et les animaux ; mais c’est le Soleil dont il est dit dans le prophète : le Soleil de justice s’est levé pour moi. C’est le Soleil dont il est dit dans l’Évangile : C’était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde.... Que ceux-là s’irritent contre vous qui ne sont point tombés dans vos erreurs !... Pour moi, malheureux, qui ai pu à peine mériter d’être délivré de vos imaginations, de vos systèmes, de vos erreurs,... qui ai pleuré si longtemps pour qu’il me soit donné de croire à cette substance immobile et pure dont parlent les livres divins ; moi qui ai recherché avec tant de curiosité, écouté avec tant d’attention, cru avec tant de témérité, prêché avec tant d’ardeur et défendu avec tant d’opiniâtreté toutes ces rêveries qui vous occupent et vous enchaînent, je ne puis m’irriter contre vous. Il en était de même en Orient. C’est, en effet, à des chrétiens que s’adressait saint Jean Chrysostome dans sa XIIe homélie sur l’Épître aux Éphésiens, c’est à ceux de son église qu’il voulait prouver qu’on avait tort de considérer le soleil comme le Dieu de l’univers[169]. Mais il n’était pas facile aux masses de se faire une idée précise de ce soleil invisible dont on leur parlait et d’admettre sa supériorité sur celle de l’astre dont ils constataient chaque jour la puissance et les bienfaits. Si les églises, d’ailleurs, comptaient dans leur sein quelques hommes éminents, la généralité des membres du clergé et des moines ne parait pas avoir possédé alors une grande instruction et s’être affranchis des idées qui régnaient autour d’eux. On peut ainsi affirmer sans témérité que, durant le IIIe et le IVe siècle, les chrétiens, en grande majorité, confondaient dans leur esprit le soleil et le Christ. Comment en aurait-il pu être autrement, quand d’une part on croyait universellement à la divinité du Soleil et que de l’autre on appelait le Christ Soleil, on le représentait sous les traits et avec les attributs auxquels les populations étaient habituées à reconnaître l’astre-Dieu ? C’est, en effet, une figure exactement semblable à celle que les païens donnaient au Soleil qu’on attribuait au Christ sur les sarcophages chrétiens ; on y traçait une tête humaine ornée d’une couronne radiée. Sur les emblèmes mystiques appelés croix, on voyait soit la personne du Christ, soit l’agneau ou tout autre symbole qui en tenait lieu entouré du nimbe lumineux ; on y lisait même l’inscription ΦΩC ou LUX MUNDI[170]. Que la nature du nimbe et de l’auréole, dit le docte abbé Didron[171], que l’élément qui les constitue l’un et l’autre soit le feu ou la flamme qui est comme l’efflorescence du feu, il ne peut y avoir aucun doute sur cette proposition... C’est sous la forme de rayons lumineux et d’aigrettes flamboyantes que l’auréole de la tète et l’auréole du corps environnent les divinités hindoues. Le corps de Zoroastre, cette pure émanation de la divinité des anciens Perses, jetait une telle clarté, lorsqu’il vint au monde, que toute la chambre où il vit le jour en fut illuminée[172]..... Chez les Grecs, les Romains et les Étrusques, toutes les constellations, le soleil, la lune, les planètes, représentés sous la forme humaine, sont environnés de rayons ou de cercles lumineux entièrement semblables à nos nimbes et à nos auréoles. En aurait-il été ainsi s’il y avait eu dans les églises une doctrine fondamentale et unanimement acceptée qui répudiait toute assimilation du Christ et du Soleil ? Pour les fidèles donc comme pour les païens, le Soleil était le Seigneur, le Κύριος ou Dominus ; le jour du Seigneur était le jour du Soleil. Ces croyances étaient tellement enracinées qu’elles étaient encore générales au VIIe siècle ; et saint Éloi eut à défendre aux fidèles de son diocèse de qualifier ainsi le soleil[173]. Pour les chrétiens également, la nativité du Christ n’était autre que celle du soleil. C’est ce que montre un sermon du pape saint Léon à ce sujet. Ne laissez pas, dit-il[174], le tentateur corrompre par des manœuvres perfides les joies de cette fête, en faisant pénétrer dans les âmes simples la croyance pernicieuse de certains esprits qui s’imaginent devoir célébrer dans la solennité de ce jour non pas tant la naissance dit Christ que le lever, comme ils disent, d’un soleil nouveau. Dans un sermon sur la Nativité du Seigneur attribuée à saint Jérôme et qui est reproduit dans ses œuvres, se manifestent encore les efforts de quelques évêques pour faire cesser la confusion qui régnait dans les esprits entre le Christ et le soleil. Aujourd’hui, disait-il, le véritable Soleil s’est levé pour le monde ; aujourd’hui dans les ténèbres du siècle, la lumière est entrée ; Dieu s’est fait homme afin que l’homme devînt Dieu[175]. Dans chaque ville où se trouvaient des confréries chrétiennes, elles célébraient la Nativité du Seigneur à la même époque et par les mêmes manifestations de joie que les païens, c’est-à-dire par des processions et des festins[176]. Saint Jean Chrysostome, dit Dom Bernard de Montfaucon[177], déclame contre les réjouissances qui se faisaient à Antioche, aux calendes de janvier. Toute la nuit se passait à danser, à se dire des mots piquants les uns aux autres. Le marché public était couronné. Ils se revêtaient de leurs habits les plus somptueux ; ils faisaient alors leurs présages ; si nous passons, disaient-ils, cette nouvelle lune en joie, toute l’année sera de même. Les femmes, comme les hommes, buvaient de grandes tasses de vin pur. Comme ceux d’Orient, les évêques les plus éclairés d’Occident déploraient avec raison de tels usages et essayèrent de les réformer. De ce nombre furent, dans les Gaules, saint Maxime et saint Césaire[178]. En ce jour les misérables païens, s’écriait ce dernier, et, ce qui est pis encore, des personnes régénérées dans les eaux du baptême, prennent des figures si monstrueuses que je ne saurais dire s’ils sont plus dignes de risée que de compassion. Car quel est l’homme sage qui peut se figurer que des personnes de bon sens, en se masquant en cerfs, s’avilissent jusqu’à prendre la forme de bêtes P Les uns se couvrent de peaux d’animaux, d’autres se coiffent avec la tète de quelque bête, et tous se piquent de se déguiser si bien qu’ils ne puissent pas être pris pour des hommes. En quoi ils font voir qu’ils ont plus une âme de bête qu’ils n’en ont l’extérieur. Au VIIe siècle, ces usages régnaient encore, et les cérémonies chrétiennes se confondaient avec celles des mystères d’Isis et de Bacchus. C’est, en effet, contre eux que s’élève à son tour saint Éloi[179]. Qu’aux kalendes de janvier, dit-il, personne ne se masque et ne prenne la forme d’une génisse ou d’un faon de biche, ni ne fasse le jongleur, ni ne couvre durant la nuit sa table de toute sorte de mets. Les païens, déclare saint Augustin[180], étaient empêchés de venir au christianisme par le regret des festins joyeux qu’ils faisaient aux jours de fêtes consacrées à leurs idoles ; c’est pourquoi nos ancêtres jugèrent bon de permettre qu’on célébrât par les mêmes profusions les solennités en l’honneur des saints martyrs. Leurs églises ou lieux de réunion étaient pour ainsi dire des salles de repas. Saint Chrysostome[181], saint Grégoire de Nazianze[182] et d’autres docteurs chrétiens conviennent qu’en Orient les agapes se célébraient dans les églises. Théodoret[183] nous apprend qu’on y dansait aussi. Il en était de même en Italie et partout ailleurs. Saint Paulin de Nole[184] décrit une de ces agapes qui eut lieu dans l’Église de Rome aux frais du sénateur Pammachius lors des funérailles de la matrone romaine Paullina. Ces banquets donnaient souvent lieu aux plus grands désordres. C’était inévitable[185]. Les fidèles croyaient comme les païens que l’ivresse était un acte religieux. O stultitiam hominum qui ebrietatem sacrificium putant ! s’écriait saint Ambroise[186] en s’adressant à ceux de son diocèse. Avec lui saint Augustin[187], saint Chrysostome[188] et d’autres sans doute s’élevèrent contre ces grossières erreurs. Il faut savoir gré à ces illustres évêques, qui avaient été élevés dans les écoles philosophiques, d’en avoir voulu faire pénétrer les sages et utiles doctrines[189] dans les églises, en faisant l’éloge de la sobriété, en montrant que loin d’élever vers la divinité, l’ivresse faisait descendra au rang des plus vils animaux. Mais ils constataient avec chagrin que leur voix n’était pas écoutée. D’autre part, Salvien s’écriait : On voit parmi nous consulter le vol des oiseaux et continuer toutes les anciennes coutumes[190]. Et il ajoute : Il n’était en Afrique aucun chrétien qui n’adorât Vénus Céleste et ne portât au pied de l’autel du Christ l’odeur de l’encens qu’il avait offert à la déesse. Ainsi par leurs croyances, leurs rites, leurs fêtes, leurs usages, les confréries chrétiennes des IIIe, IVe et Ve siècles de notre ère avaient de nombreux points de ressemblance avec les païens ; et le christianisme paraissait constituer non une religion nouvelle proprement dite, mais une des sectes de la religion générale de l’empire. LES EMPEREURS ÉTAIENT DEVENUS LES PARÈDRES DU SOLEILLes empereurs romains réunissaient, on le sait, la double puissance de chef politique et de chef religieux ; ils étaient empereurs et souverains pontifes ; c’est en cette dernière qualité que tout ce qui ressortissait des différents cultes relevait de leur autorité. Le souverain pontificat n’était pas un titre purement honorifique ; les princes étaient tenus d’en exercer parfois les fonctions. Chacun d’eux, lors de son avènement, recevait, à cet effet, en hommage du collège des pontifes, une splendide robe sacerdotale[191]. Dans certaines solennités on les voyait présider et officier à des cérémonies religieuses[192]. Julien paraît avoir mis un zèle que n’eurent généralement pas ses prédécesseurs ; mais il ne fit que suivre un usage traditionnel. Il n’est pas, en effet, d’empereur qui ne soit représenté sur les médailles officiant comme pontife, ou muni des instruments sacrés, emblèmes de sa fonction. Ainsi celle d’Aurélien, reproduite ci-dessus, nous montre le prince sacrifiant sur un autel allumé ; sur d’autres, on voit Marc-Aurèle lui-même[193], la tête voilée, debout près d’un autel où brille la flamme et derrière lequel apparaît la victime destinée au sacrifice. Quand Élagabale se déclara le Grand Pontife[194] ou l’invincible pontife du dieu Soleil, Sacerdos Dei Solis et Invictus Sacerdos Augustus, il ne portait, n’essayait pas de porter de révolution dans les idées religieuses. Cette apparente innovation n’était que la consécration d’un état de choses établi. Il ne provoquait aucune surprise quand on le voyait, debout devant l’autel où brillait le feu sacré, faire des libations au Soleil et présider à l’immolation d’un taureau en l’honneur du dieu[195]. Nombreuses, en effet, sont les médailles antérieures à son règne où le Soleil est glorifié. Ainsi, par exemple, on le voit sur les monnaies à l’effigie d’Hadrien[196], d’Antonin[197], de Caracalla[198]. Il en fut surtout de même après lui. Des médailles de Victorin[199] portent la légende : Soli invicto ; elle se lit aussi sur celles de Gallien[200], et l’on voit ce prince et son frère Valérien, revêtus du voile pontifical, sacrifiant au Soleil. Aurélien institue des fêtes solennelles et nationales, sortes de fêtes fédérales romaines, qui se célébraient en l’honneur de l’astre régulateur de l’univers tous les quatre ans[201], aux années bissextiles, alors que l’année civile paraissait correspondre exactement à ses mouvements apparents. Le collège dés pontifes à Rome semble être alors devenu le collège supérieur des prêtres du Soleil dans l’empire. C’est ce que permet de penser la lettre écrite par Aurélien à Cejonius Bassus après le sac de Palmyre. Quant au temple du Soleil, dit-il[202], j’entends qu’il soit remis dans un état primitif. L’or trouvé dans la ville, celui des cassettes de Zénobie, les joyaux de la reine vous suffisent pour le rétablir dans sa magnificence. Vous vous rendrez ainsi agréables à moi et aux dieux. Je vais écrire au sénat d’envoyer un pontife pour en faire la dédicace. D’autre part, les idées orientales et égyptiennes sur la nature du pouvoir royal qui avaient envahi l’empire, assimilaient les princes aux dieux. Il était en conséquence inévitable que parleur titre de souverain pontife, les empereurs se proclamassent les représentants de la divinité sur la terre[203] ; et le soleil étant devenu le Dieu suprême de l’empire, le vrai Dieu, ils se dirent les collègues ou les parèdres du Soleil. L’intérêt politique devait aussi les amener à revêtir cette qualification divine ; il résultait de leur rivalité avec le roi des Perses. Chef comme eux d’un vaste empire, régnant comme eux sur des peuples d’une haute vaillance et d’une grande culture intellectuelle, il se proclamait le frère du Soleil[204]. L’empereur romain n’aurait pu consentir à ne point posséder une semblable dignité, à paraître placé dans un rang inférieur à celui de son orgueilleux et redoutable voisin. Aussi Probus[205], Numérien[206], presque tous les empereurs se qualifient-ils de collègues de l’invincible dieu Soleil ; tous portent une couronne radiée, emblème de leur communauté de puissance et de divinité avec l’astre divin. C’est ce titre, c’est ce diadème symbolique que prennent au commencement du ive siècle les princes qui, tour à tour, s’allient ou se combattent pour la domination de l’empire, Maximin Daïa[207], Licinius[208], Constantin[209]. LA LÉGENDE DE LA CONVERSION DE CONSTANTINQuand le culte du Soleil, quoique sous des rites divers, était pour ainsi dire universel dans toutes les classes de la société et surtout dans l’armée, où les clystères de Mithra étaient en si grand honneur, il semble que ce culte devait être inévitablement celui d’un général tel que Constantin, élevé dans les camps, et que dévorait l’ambition[210]. L’on a cependant longtemps admis et beaucoup de personnes regardent encore comme incontestable que Constantin ait été un empereur chrétien et qu’il ait voulu renouveler l’ordre social et politique du monde romain en lui donnant pour base une religion nouvelle. En examinant sa conduite politique, les historiens reconnaissaient dans le vainqueur de Maxence et de Licinius, dans le meurtrier de son beau-père, de son beau-frère, de son fils, de sa femme, de son neveu, un homme plein d’ambition, ne reculant devant aucune mesure sanguinaire, devant aucune perfidie, devant aucun crime, et ils ne pouvaient supposer que la piété mystique ait pu déterminer chez lui un changement de croyance. On admit alors qu’il agit m habile homme d’État qui avait su apprécier la fonce que donnaient aux chrétiens leur nombre, leur union, leur enthousiasme et l’avenir qui leur était réservé. C’est ce que permettaient de conjecturer les apologistes du christianisme. Mais une étude attentive a montré que, sur cette question comme sur tant d’autres, le zèle ecclésiastique avait fourni à l’histoire des documents erronés. L’hypothèse était sans fondement. Les chrétiens, en effet, ne constituaient alors qu’une faible minorité dans l’empire. Ils ne formaient certainement pas la vingtième partie de la population[211]. Le Sénat, l’armée, les hommes influents des provinces demeuraient attachés aux cultes établis. D’autre part, au lieu de présenter une force compacte, les chrétiens étaient divisés en une foule de sectes : basilidiens, manichéens, ariens, donatistes et d’autres, dont l’énumération serait longue ; toutes ces sectes étaient animées les unes contre les autres d’une haine acharnée ; elles se détestaient plus entre elles qu’elles ne détestaient les païens ; loin d’être un élément d’ordre dans l’empire, elles ne cessaient de troubler la paix publique[212] ; elles ne pouvaient être un appui pour Constantin et, mieux que tout autre, il devait le savoir. Leur influence pouvait-elle être mise en balance avec celle des nombreuses, riches et puissantes confréries de Bacchus, d’Isis, de Cybèle, de Mithra qui couvraient l’empire et possédaient partout des temples magnifiques ? L’intérêt de Constantin était donc évidemment contraire à un changement de religion. Il devait y être d’autant moins porté qu’en tous temps et en tous lieus l’homme parvenu au pouvoir devient essentiellement conservateur. On se trouvait ainsi amené à reconnaître qu’il était invraisemblable que ce prince eût par politique provoqué une révolution religieuse dans le monde romain. Mais ceux qui tenaient arts traditions chrétiennes, ne voulant pas souscrire à une telle conclusion, ont repris l’ancien thème et ont soutenu que la foi de Constantin avait été pure de tout calcul intéressé, qu’il avait été miraculeusement illuminé et touché de la grâce divine. Pour établir cette opinion, on allègue qu’au moment de franchir les Alpes pour attaquer Maxence, Constantin eut une vision dans laquelle le signe mystique des chrétiens lui apparut comme un gage certain de la victoire, qu’il en fit l’emblème de ses étendards, et que la défaite de son rival détermina par suite sa conversion au christianisme. Pour preuve de sa foi, on énumère avec complaisance les édits qu’il aurait promulgués contre le paganisme, les privilèges qu’il aurait accordés aux églises, la fondation qu’il aurait faite de Constantinople pour être la capitale d’un empire chrétien. Examinons ces divers ordres de faits. Dans notre étude sur le symbole de la croix[213], nous avons montré que les signes
avaient la même valeur idéographique, qu’ils étaient des emblèmes solaires usités dans les cultes antiques, que pour les rendre portatifs on les munissait d’un anneau ou anse et que par suite ces dernières formes
étaient devenues aussi sacramentelles que les premières. En outre des considérations que nous avons déjà exposées à ce sujet, le caractère solaire de ces emblèmes est encore établi par les scènes religieuses figurées dans l’antiquité par les Égyptiens et qu’on a retrouvées dans les hypogées d’El Tell, dans les grottes de Dgebel-Tounah, sur les pylônes du temple d’Horus à Karnak[214].
On voit le dieu Soleil représenté par un disque d’où partent de nombreux rayons ; ces rayons sont terminés par des mains tendues aux initiés qui leur présentent la croix ansée, symbole de la vie divine qui leur est apportée. Nous avons rappelé que ces signes figuraient sur des statues, des bas-reliefs, des monnaies qui n’avaient aucun caractère chrétien. On les rencontre, entre autres exemples, sur les médailles des princes macédoniens, de Syrie et d’Égypte[215], sur celles de Jules César, d’Antoine, de Trajan, etc., sur celles des légions romaines[216]. Par une conséquence nécessaire des croyances qui régnaient dans l’empire romain, les emblèmes solaires étaient devenus d’un usage général. Les affiliés aux églises qui avaient, au sujet de la divinité du Soleil, des idées analogues à celles des autres cultes, furent amenés à les adopter également. Ce furent ainsi des symboles en honneur chez les païens que les chrétiens se sont appropriés et qui leur furent ainsi communs. La figuration d’un de ces signes sur une tombe, sur un cachet, sur une médaille, sur un étendard, ne saurait donc suffire à déterminer la religion à laquelle appartenait le personnage qui l’avait fait tracer. Il était inévitable que l’emblème du Soleil, du Dominus romani imperii fut adopté par des
Augustes et des Césars, souverains pontifes de l’empire, vicaires du Dieu
sur la terre. On voit, nous l’avons rappelé, le
Personne n’en a conclu que Dèce, Probus ou Licinius aient été des empereurs chrétiens. On n’a pas eu la même réserve pour Magnence. On voit, dit Tillemont[219], par ses médailles, qu’il faisait profession de christianisme, quoiqu’il y renonçât par ses actions. Mais le rival de Constance avait-il pu faire quelque emprunt au christianisme ? Le savant et consciencieux historien nous apprend lui-même quel était Magnence. Saint Athanase, écrit-il, obligé de dire fortement la vérité, parce que ses calomniateurs l’accusaient d’avoir eu avec lui quelque intelligence, dit qu’il avait été infidèle à ses amis, parjure dans ses serments, impie envers Dieu, que c’était une bête cruelle, qu’il aimait les magiciens et les enchanteurs ; et nous verrons ce qu’on dit qu’il fit à la bataille de Murse. Ce saint, si plein de modestie et de douceur, ne craint pas même de lui donner le nom de diable. Tillemont ajoute : On prétend que sa mère, qui mourut avec lui, se mêlait de deviner, et Philostorge a cru qu’il était lui-même païen de religion. Selon Philostorge[220], en effet, lors de la bataille de Murza, au-dessus du camp de Constance, se montra un iris en forme de couronne ; l’iris signifiait le Christ monté au ciel, la couronne, la victoire du fils de Constantin ; tandis que Magnence et les siens se livraient aux plus horribles pratiques de là magie et à l’invocation des démons. Rien donc certainement n’eut été plus vivement repoussé par les évêques du ive siècle que la prétention de vouloir en faire un chrétien. Pour eux, il ne fut pas un apostat, comme ils qualifièrent Julien ; ils déclarent qu’il ne fut attaché par aucun lien aux Églises, et il ne leur serait certainement pas venu à l’esprit qu’on pût leur opposer le signe d’un usage général qui figurait sur ses monnaies. Elles montrent donc évidemment que les païens plaçaient entre l’emblème les lettres Α et Ω, la première et la dernière de l’alphabet grec, pour désigner que la divinité était le principe et la fin de toutes choses[221]. Nombreuses sont les erreurs commises au sujet de la religion attribuée une foule de personnages connus ou inconnus par la persuasion où l’on était, dans nos temps modernes, que l’emblème solaire représentait les deus premières lettres du mot ΧΡΙΣΤΟΣ et qu’il constituait un symbole spécial au christianisme. Pour les chrétiens, qui l’adoptèrent, il ne représentait pas et ne pouvait représenter le monogramme du Christ ; car ils employaient indifféremment les différents emblèmes avec ou sans l’anneau et ils y attachaient exactement la même idée, la même valeur ; c’est ce qu’on peut constater facilement. Ainsi, sur les médailles de Flacille, épouse de Théodose le Grand, on voit le signe avec l’anneau ; sur celles de son fils, l’empereur Arcadius, il est parfois sans anneau. On peut les comparer avec celles de Valens, de Valentinien et d’Eudoxie. Le nom de Chi-Rhô, que l’on donne généralement aujourd’hui
à ce signe mystique, est donc fort impropre ; il provoque une confusion
fâcheuse dans les idées. Il est d’ailleurs d’une origine fort moderne. Ce fut
très tard qu’on s’avisa d’y voir la réunion des lettres grecques Χ et Ρ,
les deux premières lettres du mot ΧΡΙΣΤΟΣ,
et de penser qu’il constituait le monogramme du Christ. Cette supposition est
née de la nécessité d’expliquer l’origine chrétienne de cet emblème ; elle
date du XVIe siècle ; elle est due à Baronius[222]. On avait jusqu’alors
admis qu’il était formé d’un P latin
mis pour PRO et d’une croix qui
signifiait Christ, de sorte qu’on
appelait les signes
Dans le Misopogon, qui offre en quelques passages des sujets d’étonnement au lecteur attentif, Julien aurait dit des chrétiens d’Antioche[224] : Jamais, prétendez-vous, le Χ n’a fait de tort à votre ville non plus que le Κ. L’énigme inventée par votre finesse n’est pas facile à comprendre. Cependant quelques-uns des vôtres me l’ont expliqué ; nous avons appris quels noms désignent ces initiales. Χ veut dire Χριστός et Κ est Κωνστάντιος. Si Julien s’est réellement exprimé ainsi, il en faut conclure que la signification que les chrétiens d’Antioche donnaient au Χ n’était pas générale, qu’elle était ignorée du public païen, et que Julien lui-même, bien qu’il eût été élevé, dit-on, dans la religion chrétienne, ne l’aurait connue que par indiscrétion. Il faut encore admettre que les officiers de l’armée qui
voyaient chaque jour le signe mystique sur leurs casques et sur leurs
boucliers, pas plus que le César lui-même qui les commandait, n’auraient
point su que c’était un emblème chrétien. Ils y attachaient certainement une
tout autre idée, car sur un médaillon de bronze, Julien lui-même est
représenté[225]
tenant un étendard où figure le monogramme
S’il est d’ailleurs impossible à ceux qui croient à la
vision de Constantin de déterminer, au milieu des contradictions des
écrivains ecclésiastiques qui l’ont rapportée, quand, où et dans quelles
circonstances elle aurait eu lieu, il n’est pas plus facile de savoir quel
était le signe qu’on disait lui être apparu. Constantin n’adopta jamais d’emblème
spécial pour ses étendards. C’est ce qu’avait déjà reconnu Tillemont. Cette figure, dit-il, est
ainsi formée dans diverses médailles rapportées par Baronius
Laissant donc de côté l’examen des différentes légendes chrétiennes relatives à l’apparition miraculeuse de cet emblème à Constantin, qu’on ne saurait ni expliquer ni concilier, nous pouvons constater qu’elles n’ont dû naître qu’assez lard. Elles ne pouvaient, en effet, se produire qu’à une époque où il était possible de croire que ce signe était spécialement celui du Christ ; et tel n’était pas le cas sous le règne de cet empereur, ni même sous ceux de ses fils. Remarquons que la vision de Constantin est rapportée dans sa vie écrite par Eusèbe, non comme un fait publiquement accrédité, mais comme une confidence particulière faite à l’historien. Il convient qu’elle lui parut étrange et qu’il n’y ajouta foi qu’après avoir reçu le serment du prince. Au sujet de cette confidence, qu’il révèle un quart de siècle après la mort de Constantin[227], il faut encore observer que le même Eusèbe, dans son Histoire ecclésiastique, n’en dit pas un mot. Son silence dans un tel ouvrage sur cette question, si importante au point de vue du christianisme, est ainsi fort surprenant. Les partisans de la vision, dit Gibbon[228], ne peuvent point produire en sa faveur un seul témoignage des pères du IVe et du Ve siècles qui ont célébré le triomphe de l’Église et de Constantin dans tous leurs volumineux écrits. Comme ces vénérables personnages n’avaient aucune antipathie pour les miracles, il nous est permis de penser qu’aucun d’eux n’eut connaissance de la vie de Constantin par Eusèbe, et cette opinion est confirmée par l’ignorance de saint Jérôme lui-même sur ce point. Cette légende, on doit le reconnaître, ne circulait donc pas dans le public au ive siècle. Au contraire, du vivant môme de Constantin, le païen Nazaire prétendait que ce prince avait dû sa victoire au concours de guerriers célestes qui combattirent dans les rangs de ses soldats. Il faisait appel au témoignage des Gaulois présents à la bataille, et il déclarait qu’après un prodige si récent et si public, on ne saurait se refuser à croire aux anciennes apparitions[229]. En élevant à Rome un arc de triomphe en l’honneur de Constantin, les notabilités de la ville qui composaient le Sénat tenaient à flatter le prince dans tout ce qui pouvait lui tenir à cœur. Or, dans l’inscription que porte ce monument, il n’est, nullement question du Dieu des chrétiens, ni de vision miraculeuse. Son triomphe sur Maxence et la délivrance de la ville sont simplement attribuées à l’inspiration divine et à son génie, instinctu divinitatis, mentis magnitudine[230]. Si Constantin avait cru devoir faire intervenir en faveur de ses armes quelque divinité spéciale, t’eût été certainement la Victoire romaine ; c’est sa puissante protection qu’il aurait invoquée. Grande était alors la superstitieuse vénération dont elle était entourée et dans la capitale et dans l’armée. On n’en saurait douter quand on voit l’acharnement que mirent les chrétiens à faire disparaître sa statue de la salle des délibérations du Sénat, auxquelles elle semblait présider[231]. C’est d’elle que Symmaque, avec toute sa science et sa sagesse, dira : Respectez les ans où ma piété m’a conduite. Mon culte a rangé le monde sous nies lois ; rues sacrifices ont éloigné Annibal de mes murailles et les Gaulois du Capitole. N’aurais-je donc tant vécu que pour être insultée au bout de ma carrière ? Son culte demeura respecté et son temple resta debout jusqu’aux derniers jours de Rome. Sous les fils de Théodose, malgré l’influence dominante des évêques à leur cour, Claudien, célébrant les honneurs rendus par la capitale à Stilicon, s’écriait[232] : Quæ
vero procerum voces, quam certa fuere Gaudia,
quum totis exsurgens ardua pennis Ipsa
duci sacras Victoria panderet alas ! O palmâ
viridi gaudens et amica trophæis Custos
imperii romani ! C’est, en effet, sous l’égide de la victoire romaine que s’était placé Constantin. Nombreuses sont les monnaies où elle est gravée avec la légende Gloria exercitus. Nombreuses aussi sont celles où on voit le prince couronné par la déesse païenne[233]. Après la défaite de Maxence, Maximin Daïa fit frapper des médailles sur lesquelles d’un côté est son effigie et de l’autre la glorification de son collègue d’Occident : l’on y voit la Victoire tenant une couronne et une palme, et la légende porte VICTORIA CONSTANTINI AUG[234]. Il en est de l’aveu qu’aurait fait Constantin de l’intervention du Dieu des chrétiens en faveur de ses armes, comme de la reconnaissance que lui aurait témoignée Marc-Aurèle pour le salut de son armée en Germanie. Tertullien, Eusèbe, saint Jérôme et bien d’autres avec eux soutenaient que l’armée romaine, enveloppée par Quades, épuisée par les fatigues et la chaleur, avait vu, sur la prière des chrétiens qui combattaient dans ses rangs, éclater un orage qui fit fuir les ennemis et laissa tomber une pluie abondante dont lés Romains purent s’abreuver. On affirmait que Marc-Aurèle avait écrit une lettre devenue publique pour attester le fait. Mais la colonne Antonine qui déroule, sculptée sur le marbre, l’histoire de cette campagne, montre que l’empereur et les siens n’ont attribué leur salut qu’à la protection des dieux du Capitole. On y voit un gigantesque Jupiter Pluvius dont les cheveux et la barbe laissent ruisseler une eau providentielle que les Romains s’empressent de recueillir, tandis que les Barbares sont frappés par la foudre[235]. L’on sait, en effet, qu’une semblable apparition miraculeuse a été aussi attribuée à Constance, dans des conditions à peu près identiques, au moment où, comme son père, il marchait contre un rival pour le chasser de l’Italie et se faire reconnaître par la ville de Rome[236]. Les deux histoires se confondent ainsi, et l’on ne sait quelle est celle qui a donné naissance à l’autre. Il est à présumer toutefois que c’est la vision du fils qui a été plus tard rapportée également au père ; car tandis qu’on ne trouve rien qui y ait rapport dans les médailles de Constantin, les mots célèbres hoc signo victor eris se lisent sur celles de Constance[237]. Or, au lieu du Dieu des chrétiens, c’est la Victoire païenne qui se voit au revers. On n’en saurait douter en la comparant avec sa représentation sur d’autres médailles, sur celle, par exemple, d’Antonin, que nous plaçons à côté. Ses ailes sont repliées ; elle tient une palme de la main gauche ; de la droite elle couronne le prince dont l’étendard est orné de l’emblème mystique ; et c’est elle qui lui prédit son triomphe, lui assure la possession de Rome et de l’empire entier en prononçant ces paroles : HOC SIGNO VICTOR ERIS. Les signes qui figuraient sur le labarum de Constantin ne peuvent donc pas servir à caractériser la foi qu’il professait. Pour la connaître, il faut recourir à d’autres éléments d’information. Ceux qui placent la conversion de Constantin au moment de son triomphe sur Maxence doivent convenir que Gibbon a eu raison de dire[238] : Loin de faire éclater la supériorité de ses vertus chrétiennes sur l’héroïsme imparfait des Trajan et des Antonin, Constantin perdit dans la maturité de son âge la réputation qu’il avait acquise dans sa jeunesse. Plus il s’instruisait dans la connaissance des saintes vérités, moins il pratiquait les vertus qu’elles recommandent. C’est dans cette période, en effet, qu’on le voit, malgré la foi jurée, faire tuer son ancien ami, son ancien collègue, son beau-frère Licinius dont il n’avait plus rien à redouter ; il fait périr son jeune et inoffensif neveu Licinianus, malgré les larmes de sa sœur ; sur un soupçon, il fait décapiter son fils Crispus auquel il devait une bonne part de sa victoire sur Licinius ; il fait étouffer sa femme Fausta dans un bain. La masse de la population ignorait ces drames. Mais bon nombre de ceux qui vivaient à la cour en étaient indignés ; ne pouvant ouvertement manifester leurs sentiments, ils traçaient clandestinement sur les portes du palais des distiques où le monarque était assimilé à Néron[239]. Selon Philostorge[240], aussitôt après sa mort, l’évêque de Nicomédie aurait apporté à Constance un rouleau qui contenait les dernières volontés du vieil empereur. On serait tenté de croire qu’au moment de quitter la vie il allait parler à ses enfants le langage de la sagesse et de la piété. On se tromperait fort. Sa dernière pensée était d’accuser ses frères d’avoir voulu l’empoisonner et de conjurer ses fils de le venger. Il faut donc admettre que les évêques n’ont eu aucune influence sur l’esprit de Constantin, ou qu’ils ont été les complaisants des crimes les plus abominables. Pas un évêque n’a osé, du vivant de Constantin, lui adresser le moindre blâme. Même après sa mort, ils ne se sont point élevés énergiquement contre ses actes sanguinaires. Saint Jean Chrysostome se borne à en conclure qu’il ne faut pas rechercher la puissance sur la terre[241]. Aucun écrivain ecclésiastique cependant n’a donné son approbation, il faut le reconnaître ; il n’est aucun d’eux qui n’ait repoussé toute responsabilité de conseil ou d’encouragement et qui n’ait laissé entendre que, s’ils en avaient eu le pouvoir, ils se seraient opposés aux déterminations de Constantin. N’est-ce donc point convenir qu’ils n’eurent point affaire avec un illuminé de la grâce divine ? Dans les Césars[242], Julien représente son oncle sous les traits d’un efféminé et d’un débauché. Il y a peut-être exagération dans ce portrait peu flatteur. Mais la magnificence asiatique de Dioclétien était devenue afféterie chez Constantin. Il se plaisait à orner sa tête de faux cheveux de différentes couleurs qu’il faisait soigneusement attifer par d’habiles coiffeurs ; il portait un diadème de forme nouvelle enrichi de pierreries ; il se parait de colliers et de bracelets de pierres fines ; il était vêtu d’une robe de soie flottante brodée de fleurs d’or[243]. Sous cette toilette, qu’on ne saurait excuser chez un homme, fût-il jeune et extravagant comme Élagabale, il semble qu’on chercherait en vain l’âme d’un Trajan ou celle d’un Marc-Aurèle. Nous sommes donc convaincus que les évêques et les chrétiens qui se sont approchés de Constantin ou qui ont fait partie de sa cour ont pu être ses flatteurs, mais qu’ils n’ont jamais exercé d’influence marquée sur son esprit. Remarquons, en effet, que pour être déclaré chrétien, il fallait avoir reçu le sacrement d’initiation. Aussi les auteurs ecclésiastiques prétendent bien que Constantin le reçut ; mais ils placent cet acte solennel aux derniers jours de sa vie. On devait attendre toutefois que celui qui se proposait, dit-on, de faire du christianisme une religion d’État, aurait accompli cette cérémonie publiquement dans sa nouvelle capitale et avec une grande pompe. Pas du tout. Elle aurait eu lieu dans un faubourg de Nicomédie, n’aurait constitué qu’un acte absolument privé, celui d’un homme au cerveau affaibli par l’âge, la souffrance et l’approche de la mort. Et quand on examine les circonstances dans lesquelles se serait alors effectuée l’administration du sacrement, les motifs qu’allègue Constantin pour avoir tant différé, on demeure persuadé qu’on se trouve en pleine légende et non point dans l’histoire[244]. On ne saurait, en tout cas, se refuser à convenir que, durant tout son règne, le chef de la seconde dynastie Flavienne demeura hors de l’Église[245]. Demandons-nous maintenant à qui Constantin confia l’éducation de ses enfants. On prétend que Lactance, qui enseigna la rhétorique à Crispus, en aurait fait un chrétien. Or, ce fut ce fils auquel il fit trancher la tète. Quant à Constance et à ses frères, il est douteux que le plus zélé défenseur de l’orthodoxie de Constantin veuille revendiquer pour les évêques l’honneur d’avoir formé leurs âmes, d’avoir été les conseillers de leur jeunesse. Aussitôt après la mort de leur père, ces jeunes gens, dont lainé a vingt et un ans et le plus jeune dix-sept, procèdent aux massacres de leurs deux oncles, de sept de leurs cousins et de plusieurs personnages influents de la cour pour partager l’empire entre eux. Ils font décerner à Constantin les honneurs de l’apothéose, ainsi que le montrent des médailles[246] ; le Sénat, sur leur demande, ou tout au moins sur leur consentement, le met au rang des dieux et établit un collège de prêtres destinés à vaquer au culte de la nouvelle divinité[247]. Constant et Constantin d’ailleurs périssent jeunes sans avoir été initiés ; et Constance, demeuré seul maître de l’empire, s’il reçut le sacrement, ce ne fut qu’à l’heure de la mort[248], suivant en cela comme dans presque toute sa conduite politique l’exemple de son père. On ne saurait donc prétendre, croyons-nous, que Constantin ait songé à faire chrétiens ses fils, ceux à qui il devait laisser le soin de continuer son œuvre. Dans notre étude précitée sur le Symbole de la Croix, nous avons eu l’occasion de rappeler qu’il est un fait qui frappe tous les esprits attentifs, c’est que, sur les médailles à l’effigie de Constantin, qui nous sont parvenues en si grande quantité, on ne reconnaît aucune manifestation de la foi chrétienne de celui que les Églises grecques ont pourtant proclamé l’égal des Apôtres. Eusèbe, il est vrai, dans la Vie de Constantin[249], prétend que ce monarque avait ordonné de le représenter sur les monnaies le visage élevé vers le ciel et les bras étendus dans l’attitude chrétienne de la prière. Ces monnaies, dit-il, furent répandues en nombre considérable dans tout l’empire romain. S’il en avait été réellement ainsi, il serait inexplicable qu’aucune d’elles n’ait été retrouvée. On est donc autorise à conclure que l’assertion d’Eusèbe est dénuée de fondement. Aringhi, toutefois, signale dans sa Roma subterranea[250] une médaille de Constantin qui faisait partie, dit-il, de la collection de Francisco Angeloni et dont un dessin a été donné par Bellorius. Nous la mettons sous les yeux du lecteur. Admettons qu’elle soit réellement authentique, qu’on doive y reconnaître l’empereur Constantin dans la figure debout entre Ies deux branches du signe X ; admettons que ce soit une de celles dont parle Eusèbe ; on n’en pourrait rien conclure. C’est encore, en effet, une erreur qu’il faut dissiper, que de penser que l’attitude dite de l’orante fût spéciale aux chrétiens. La coutume d’étendre les bras et de les relever légèrement en adressant des prières aux dieux était d’un usage général chez les païens ; c’est d’eux que les chrétiens l’ont empruntée ; ceux qui entraient dans les églises conservaient leur même manière de prier. C’est cette attitude qu’a donné à Livie l’habile artiste qui a fait la statue qu’on admire au musée Pio Clementino, à Rome ; c’est celle qu’a la Pietas sur de nombreuses médailles romaines, ainsi qu’on le voit sur celles entre autres de Julia Augusta, d’Hadrien, de Gordien[251]. Elle est aussi donnée à la Providentia. Cette absence de tout témoignage numismatique de la foi chrétienne de Constantin a une grande importance dans la question. D’autant plus qu’au contraire sur toutes les médailles qui ont été frappées sous le contrôle de ses agents, médailles destinées, on le sait, à parler aux yeux des populations, à rendre l’opinion publique favorable aux princes, on voit Constantin avec les attributs de tous les dieux honorés dans l’empire ou protégé par eux. H. est ainsi associé à Mars, Jupiter, Hercule, à Sérapis, à Anubis, à Isis, à Mithra. Aussi est-ce à bon droit qu’on a dit que toute la numismatique de son règne montrait dans Constantin un empereur païen[252]. Si nous nous demandons maintenant quelle a été la conduite de ce prince à l’égard du christianisme comme chef d’État, l’éminent auteur de l’Histoire des Romains nous la fera connaître[253]. Nous verrons que si Constantin a soin de protéger la liberté des cultes, s’il promulgue des mesures favorables aux chrétiens, s’il intervient dans leurs querelles, ce n’est point dans leur intérêt particulier, mais dans celui de l’ordre public. Il ne prend parti pour aucune secte ; il demeure indifférent à l’homoousion et à l’homoiousion ; ce qu’il veut, c’est que la paix ne soit pas troublée dans les provinces ; aussi le voit-on sévir tour à tour contre Athanase et contre Arius. Tout dans les décrets qui émanent de lui dénote un homme qui veut que l’autorité impériale soit obéie partout, même dans les églises. Les privilèges dont jouirent pus tard les chrétiens et leur clergé, les lois injustes, vexatoires, cruelles que ceux-ci appliquèrent impitoyablement aux autres cultes, ne sont pas les œuvres de Constantin. Tous les édits de cette nature lui ont été faussement attribués et rentrent dans la catégorie de la donation qu’il aurait faite, par acte authentique, au pape Sylvestre de la ville de Rome en toute souveraineté[254]. Mais, nous dira-t-on, si Constantin n’a pas eu spécialement foi au Christ, s’il n’a été qu’un prince habite, indifférent en matière religieuse, d’où viendrait l’attachement à sa mémoire qu’ont manifesté les Églises ? C’est que les chrétiens furent pour lui d’utiles auxiliaires de gouvernement et que leurs services furent grassement payés. Les idées abstraites ne passionnent guère les hommes ; elles ne les mettent en mouvement que lorsqu’elles couvrent des intérêts matériels. Les nombreuses corporations de prêtres du paganisme, par une longue succession de dons obtenus de leur clientèle, avaient accaparé la majeure partie des terres de l’empire ; leurs temples étaient remplis d’objets précieux. D’autre part, le commerce et l’agriculture étaient improductifs ; la matière imposable était épuisée ; les mines ne fournissaient plus à l’État que peu d’or ou d’argent ; tandis que ses besoins augmentaient de toutes façons. L’armée n’était plus nationale ; elle se recrutait de mercenaires étrangers ; elle coûtait plus cher que jamais et il fallait lui payer exactement sa solde pour compter sur sa fidélité ; la construction des bâtiments de la nouvelle capitale, les pompes et les fêtes de la Cour exigeaient des ressources énormes et continuelles. En temps de crise ou de gène, les confiscations étaient les mesures financières généralement employées ; elles étaient les plus promptes et les plus efficaces pour alimenter le Trésor public. Les richesses des temples offraient seules des ressources disponibles. On les avait jadis alises parfois à contribution[255]. Mais lancer des décrets pour ordonner la remise d’une partie de leur or aux caisses impériales était facile ; les faire exécuter l’était beaucoup moins. Le monde gréco-romain, par l’union de la philosophie et de la religion, était devenu mystique et dévot ; il s’était attaché aux anciens cultes alors transformés ou réformés. Qui voudrait donc toucher aux offrandes consacrées aux dieux ? Qui oserait se rendre coupable de sacrilège ? Ce furent des chrétiens, les moines surtout, les robes noires, comme on disait, qui se firent les agents des empereurs[256] ; ils constituèrent en quelque sorte un corps de fonctionnaires[257] ; et leur zèle fut encouragé et récompensé par une bonne part des dépouilles sacrées[258]. Cet état de choses se maintint sous les fils de Constantin, et la destinée du christianisme sembla ainsi être désormais liée à celle de la puissance impériale. Aussi le soulèvement de haines dont Julien se vit entouré par les chrétiens ne fut-il pas causé par ses croyances et ses pratiques religieuses, mais par la restitution des biens qu’il tenta de faire effectuer aux temples qui en avaient été dépossédés sous Constantin et sous Constance[259]. La lettre que le Vieux philosophe Libanius écrivit à Théodose en faveur des temples est fort instructive, dit Chateaubriand : Elle offre un tableau presque complet du IVe siècle : usage et influence des temples dans les campagnes ; fin de ces temples ; commencement de la propriété du clergé chrétien par la confiscation de la propriété du clergé païen ; cupidité et fanatisme des nouveaux convertis qui s’autorisent des lois en les dénaturant pour commettre des rapines et troubler l’intérieur des familles ; et de même que Lactance a raconté la mort funeste des persécuteurs du christianisme, Libanius raconte les désastres arrivés aux persécuteurs de l’idolâtrie[260]. La sincérité et la loyauté de l’illustre auteur du Génie du Christianisme, ne pouvaient se refuser à constater un tel état de choses. Ses opinions lui faisaient d’autre part un devoir de chercher à le justifier et à le légitimer à ses yeux et aux yeux des autres ; mais la droiture de son esprit s’y refusant, il en laissa la responsabilité à Dieu. Dieu, dit-il, qui punit l’injustice particulière de l’individu, n’en laisse pas moins s’accomplir les révolutions générales, calculées sur les besoins de l’espèce. Les contributions et les confiscations imposées aux temples ne pouvaient manquer, on le pense bien, de faire crier les clergés païens et avec eux les édiles des villes dépossédées et les philosophes mystiques tels que Libanius. Depuis Néron aucun empereur n’avait osé porter la main sur les biens consacrés aux dieux ; c’était une raison de plus pour lui assimiler Constantin[261]. Un athée, disait-on encore, ou un adorateur de quelque divinité étrangère à l’empire pouvait seul avoir ordonné de pareils sacrilèges. Mais, remarquons-le, on ne nommait pas cette divinité, on ne pouvait pas la nommer, car rien ne permettait de la désigner. Aussi personne, Même parmi ceux qui criaient le plus, tel que Libanius, n’a formellement dit que Constantin devint chrétien[262]. Julien le fait asseoir au banquet des dieux de, l’Olympe[263] ; et s’il lui conteste le mérite de ses victoires, il ne le qualifie point de renégat[264]. Toutefois, les accusations d’impiété adressées à Constantin étaient locales ; elles ne sortaient que de quelques sphères ; elles ne trouvaient aucun écho dans la grande masse des populations de l’empire[265]. Les confiscations furent en effet toujours partielles et successives, et la majorité des temples et des villes, n’en ayant pas eu à souffrir, ne s’en émurent pas[266]. Il serait au contraire possible que la forte quantité de numéraire qui fut alors mise en circulation ait amené dans l’empire un grand développement d’affaires et de luxe, à la satisfaction générale des populations[267]. Les statues des héros et des dieux qui furent transportées à Constantinople étaient loin d’être l’objet d’insultes, comme l’ont prétendu quelques historiens chrétiens. Dans la population cosmopolite, qui s’était agglomérée sur les rives du Bosphore, les païens étaient alors en grande majorité. Ces chefs-d’œuvre de l’art, conformément aux intentions de Constantin, servaient à la gloire de la nouvelle Rome et demeuraient vénérés par les habitants qui étaient fiers de les posséder. On cherche ainsi vainement un motif politique ou religieux qui eût pu déterminer Constantin à embrasser le christianisme ; et d’autre part on ne trouve aucun témoignage certain qu’il ait quitté la religion païenne. Dans tous les cultes, nous l’avons vu, sous les noms divers on adorait le soleil ; il était le dieu national, le Seigneur de l’empire romain, le vrai Dieu. C’est donc du Soleil que Constantin devait inévitablement, comme les rivaux qu’il avait dépossédés, se déclarer le parèdre. C’est aussi ce qu’il fit. Une foule de ses monnaies portent, en effet, en légende Deo soli invicto comiti ou soli invicto comiti. Sur beaucoup d’autres on
voit le soleil sous la figure d’un homme presque entièrement nu, la tète
ceinte d’un diadème radié, élevant la main droite et de la gauche tenant le
globe du monde ; dans le champ on rencontre indifféremment pour emblèmes
équivalents[268]
une couronne, un astre, les signes
Ne vit-on pas, d’ailleurs, l’empereur conserver pendant tout ; sa vie la dignité de souverain pontife du paganisme et en exercer les fonctions[269] ? Sur des médailles qui circulaient partout, Constantin figurait la tète ornée du voile que les sacrificateurs portaient dans les cérémonies publiques. Ses actes le montrent également. Il était dans les attributions du souverain pontife de régler le calendrier civil et de déterminer les jours fériés. Après Auguste, Claude et après Claude Marc Aurèle en fit la réforme. Il établit certaines fêtes, mais il en supprima surtout beaucoup dont la célébration nuisait aux intérêts de la société ; il en réduisit le nombre de façon à ce qu’il y eût dans l’année deux cent trente jours ouvrables. Constantin, à son tour, révisa le calendrier et décréta le chômage officiel du jour consacré au soleil. Il aurait pu le nommer le jour du Seigneur ; personne ne s’y serait trompé. Mais pour éviter toute équivoque, il eut soin de dire le jour du Soleil, Dies solis[270]. La dédicace de la nouvelle capitale donna lieu à des fêtes solennelles où se déploya une pompe magnifique. On vit alors promener dans le char sacré du Soleil la statue de l’empereur représenté assis sur un trône et tenant dans sa main droite la Fortune ou le bon Génie de la ville. Des gardes, vêtus de riches costumes, l’accompagnaient portant des flambeaux de cire blanche. A son passage, tous s’inclinaient et adoraient. Cette cérémonie se renouvelait chaque année ; et après sa mort le même usage demeura en vigueur[271]. Pour symbole de sa puissance souveraine et quasi-divine, quand il sortait, on portait devant lui des luminaires, selon l’usage oriental[272], comme on le faisait en l’honneur des dieux dans les processions religieuses. Chez tous les grands fonctionnaires se voyait le portrait de l’empereur placé sur une table et entouré de flambeaux. Ses édits étaient déclarés divins[273]. Au milieu du forum de la nouvelle Rome avait été élevée une énorme colonne de porphyre, haute de 420 pieds. Au sommet, dominait une colossale statue en bronze qui figurait Constantin sous les attributs du soleil. Il tenait un sceptre de la main droite, le globe du monde clans la gauche ; sur sa tète brillait une couronne de rayons lumineux[274]. C’est évidemment ce caractère divin et solaire officiellement attribué à Constantin dont Eusèbe était imbu, quand il le compare au Soleil levant qui répand la lumière dans le monde[275]. Numini ejus était la formule consacrée dont on se servait en parlant de lui ; c’est elle qui se lisait dans les inscriptions placées en son honneur sur une foule de monuments ; et on peut la voir encore dans la notice qui fut gravée à Rome sur le marbre à l’occasion de la restauration qu’il avait faite de l’aqueduc de l’Aqua Virgo[276]. Si les chrétiens ont eu intérêt à revendiquer Constantin pour un des leurs, ils le purent faire jusqu’à un certain point, mais seulement au même titre que les mystes de Bacchus, d’Isis ou de Mithra. Qu’ils adorassent la Christ dans le soleil visible avec les manichéens ou dans un nouveau soleil invisible et attendu, ils pouvaient prétendre que celui dont le monarque se disait le parèdre était le leur. Par le pouvoir dont il était revêtu, il était, en effet, le surveillant ou l’évêque, έπίσκοπος, de toutes les religions publiquement professées dans l’empire[277] ; et à ce titre il intervenait avec autorité dans les querelles des Églises. Rien, toutefois, n’eut certainement paru plus indigne de créance aux contemporains de Constantin[278], que le bruit de sa conversion au christianisme, c’est-à-dire de sa soumission exclusive aux dogmes et aux rites du culte chrétien et de la répudiation de tous les autres. Il leur eût été impossible d’admettre qu’il fût devenu humble disciple des évêques, cet empereur-pontife qui, de l’Euphrate à l’Atlantique, se faisait honorer, on peut dire adorer, comme le tout-puissant et invincible collègue du Soleil, le vrai Dieu, le seigneur et maître de l’empire romain. Aussi dans l’apothéose officielle et publique qui lui fut décernée sous ses fils, Constantin est-il représenté revêtu du manteau sacerdotal et monté dans le char solaire ; quatre coursiers le portent au ciel où lui est tendue, en signe d’union, la main droite du Dieu[279]. Annales de la Faculté de Lettres de Bordeaux – 1887. |