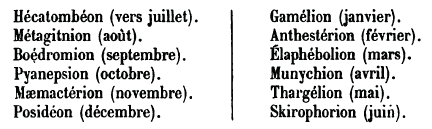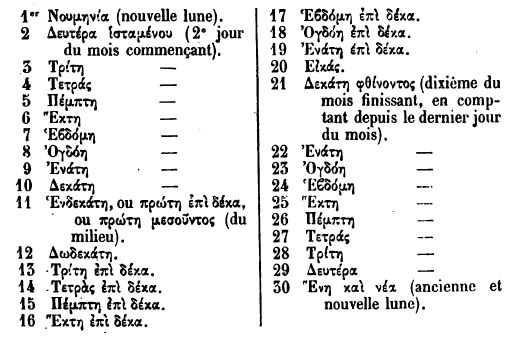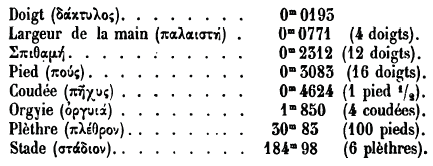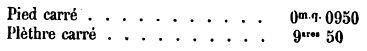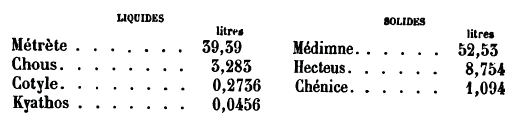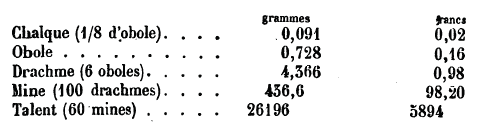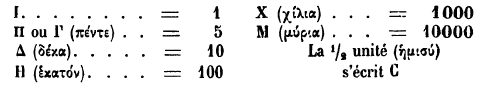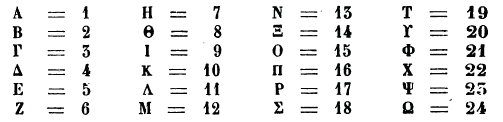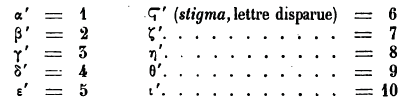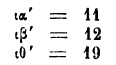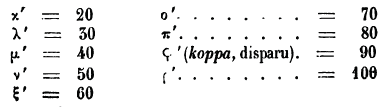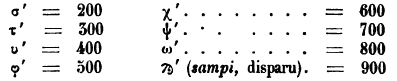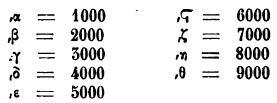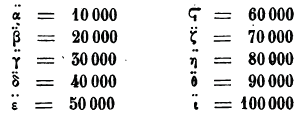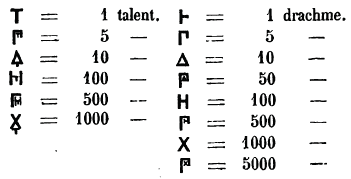LA VIE PRIVÉE ET LA VIE PUBLIQUE DES GRECS
CHAPITRE I. — GÉNÉRALITÉS.
|
SOMMAIRE. — 1. Le
type hellénique. — 2. Le génie grec. — 3. Le bonheur aux yeux d’un Athénien.
— 4. Parallèle entre les Athéniens et les Spartiates. — 5. Esprit des
Lacédémoniens. — 6. Caractère des Thébains. — 7. Simplicité de la vie
grecque. — 8. Divisions du temps. — 9. Mesures, poids et monnaies. —10.
Manière de compter. 1. — LE TYPE HELLÉNIQUE. La race hellénique était fort belle ; elle en était elle-même persuadée, et les étrangers ne contestaient point le bien fondé de l’orgueil qu’elle en éprouvait. Écoutez ce que dit Adamantios, médecin célèbre du début du Ve siècle de notre ère, et impartial en la cause, puisqu’il était de race juive et vivait à Alexandrie : Si la race hellénique s’est conservée pure chez les habitants de quelque pays, ceux-ci sont suffisamment grands, larges d’épaules, droits de stature, solidement membrés ; ils ont le teint clair, le tempérament blond, la carnation ferme et modérément développée, les jambes droites, bien faites, terminées par des extrémités fines, la tête sphérique et de grandeur moyenne, le cou robuste. Leurs cheveux, nuancés de roux, sont souples et frisent aisément ; leur visage est rectangulaire, les lèvres minces, le nez droit. Leurs yeux, tout humides, lancent des regards doux et pénétrants, et ont beaucoup d’éclat ; car, de tous les peuples, les Grecs sont celui qui a les plus beaux yeux. Cette analyse du type parfait de la race hellénique est d’une précision qui impose la confiance. Elle s’applique d’ailleurs parfaitement, aujourd’hui encore, aux habitants de certains cantons reculés de la Grèce, par exemple à ceux de l’ouest de l’Arcadie. Nulle part en Europe le type viril n’est aussi beau que dans ces montagnes où peu d’envahisseurs ont pénétré, où aucun n’a séjourné assez longtemps pour que la pureté du sang hellénique en ait été altérée Il n’est pas à croire cependant que les artistes n’eussent qu’à promener leurs regards autour d’eux pour trouver le modèle des types si parfaits qu’ils ont donnés aux dieux et aux éphèbes. L’estime en laquelle on tenait l’élégance des formes et la pureté des traits montre qu’elles ne se rencontraient pas chez tout le monde. A Athènes particulièrement, où les esclaves et les étrangers domiciliés formaient la plus grande partie de la population, et où les unions illégitimes étaient d’usage courant, la race devait être des plus mélangées, et les types des individus variés à l’extrême. Jamais anthropologiste n’a pu tirer aucune conclusion de la comparaison des crânes découverts dans les tombeaux d’Athènes.... Il suffit d’ailleurs d’ouvrir les poètes comiques pour y trouver la mention de nez crochus ou camards, de bouches fendues jusqu’aux oreilles, d’épaules voûtées, de ventres exubérants, de jambes grêles ou tordues. Parmi les œuvres de la sculpture, les monuments privés, portraits, stèles funéraires et bas-reliefs votifs, nous montrent souvent des physionomies fort éloignées de la correction classique. Ni tous les cosmètes des éphèbes, ni, parmi les grands hommes, Euripide et Démosthène, n’étaient beaux. Socrate était de la laideur la plus triviale. Rayet, Monuments de l’art antique, t. II. 2. — LE GÉNIE GREC. Ce qui frappe tout d’abord dans la race hellénique, c’est la variété de ses aptitudes. Juvénal relevait avec amertume la souplesse des Grecs de la décadence, qui envahissaient Rome et s’y trouvaient bons pour tous les métiers. Cette boutade contient une part de vérité. Ce que le Romain tournait en ridicule, Thucydide l’admirait chez les Athéniens de son temps, et les Athéniens, en cela comme en beaucoup d’autres choses, étaient les plus grecs de tous les Grecs. Aristote, à son tour, remarquait qu’en général les peuples européens, habitant des pays froids, avaient de l’énergie, mais peu de vivacité d’esprit ; les Asiatiques, au contraire, habitant des pays chauds, de la vivacité d’esprit, mais peu d’énergie ; tandis que les Grecs devaient à leur climat tempéré d’allier l’énergie du caractère à l’intelligence. Cet égal développement de facultés diverses a été la cause de l’heureux équilibre et de l’harmonie qu’on remarque dans les grandes œuvres de la littérature comme dans celles de l’art. L’Hellène a toujours eu de la raison dans l’imagination, de l’esprit dans le sentiment, de la réflexion dans la passion. Jamais on ne le voit entraîné totalement d’un seul côté. Il a, pour ainsi dire, plusieurs facultés prêtes pour chaque chose, et c’est en les associant qu’il donne à ses créations leur véritable caractère.... Un autre trait de la race grecque, c’est son inépuisable curiosité. En fait de sciences naturelles ou morales, d’histoire, de géographie, de philosophie, de mathématiques, les Grecs ont été des curieux dans le meilleur sens du mot, et c’est ainsi qu’ils ont posé les premiers presque tous les grands problèmes et inauguré presque toutes les bonnes méthodes. L’énigme, sous quelque forme qu’elle s’offrît à eux, les a toujours tentés, celle du monde particulièrement. Partout ils ont voulu voir et connaître. Ce besoin d’interroger tout ce qui peut répondre éclate chez les premiers philosophes physiciens de l’Ionie ; il s’exprime avec une naïveté et une grandeur merveilleuses dans l’ouvrage d’Hérodote ; et dans l’histoire des sciences, il reste une des gloires de l’école péripatéticienne, qui a ouvert tant de routes à la recherche. Il est vrai que la facilité à tout comprendre et à se prêter à tout est un privilège parfois dangereux. Dans un ancien poème, le héros Amphiaraos disait à son fils Amphiloque, au moment de se séparer de lui : Mon enfant, inspire-toi de l’exemple du poulpe, et sache t’accommoder aux mœurs de ceux vers qui tu iras ; tantôt sous un aspect, tantôt sous un autre, montre-toi semblable aux hommes parmi lesquels tu habiteras. Ce conseil exprimait une des tendances du caractère national ; le souple et astucieux Ulysse est le Grec par excellence. La race hellénique est essentiellement fine d’esprit. De bonne heure, dit Hérodote, l’Hellène s’est distingué du Barbare en ce qu’il est plus avisé et plus dégagé d’une sotte crédulité. Cela se voit en Grèce dans tous Ies temps et dans tous les pays. On oppose souvent, non sans raison, la gravité du génie dorien à la subtilité élégante du génie ionien ; on plaisante sur la niaiserie des gens de Kymê, et on cite la lourdeur des Béotiens. Ce sont là ou des vérités relatives fort grossies, ou de simples boutades propagées par la malignité. Sans alléguer les grands noms littéraires ou politiques de la Béotie, on ne persuadera à personne que les artistes ignorés qui modelaient sans prétention les jolies statuettes de Tanagra aient été des rustres et des lourdauds. Et quant à la gravité dorienne, ce serait une singulière erreur que de la concevoir comme une sorte de pesanteur d’esprit incompatible avec la finesse. Les bons mots des Spartiates étaient fortement renommés dans toute la Grèce. Moins gracieux et moins légèrement ironiques que ceux des Athéniens, ils avaient plus de concision et plus de force. Plusieurs sages, célèbres par leurs sentences, appartenaient à la partie dorienne de la Grèce, et lorsque Cicéron voulait enseigner à aiguiser les mots spirituels qui sont une arme pour l’éloquence, c’était à tous les Grecs sans distinction qu’il demandait des exemples : J’ai rencontré chez les Grecs, dit-il, une foule de bons mots ; les Siciliens excellent dans ce genre, et aussi les Rhodiens et les Byzantins, mais surtout les Athéniens.... La tradition a eu en Grèce une grande force, mais elle n’y a jamais étouffé complètement la liberté individuelle.... Par la hardiesse du jugement, par la fantaisie de l’imagination, par la sincérité naïve ou réfléchie des sentiments, l’Hellène échappe à ce qui pourrait gêner l’essor de la nature. Rien d’artificiel ne vient se superposer en lui à la pure humanité. Les caractères propres qu’elle prend dans ses œuvres sont ceux dont elle ne peut pas se dispenser, parce qu’il les porte réellement en lui. Ils ne tiennent ni à un rôle accepté ni à une discipline quelconque. Sur ses dispositions morales, des divergences notables se sont produites parmi d’éminents critiques. Pour les uns, l’insouciance et la gaieté, voilà le fond du caractère hellénique. Les Grecs, dit M. Renan, en vrais enfants qu’ils étaient, prenaient la vie d’une façon si gaie que jamais ils ne songèrent à maudire les dieux, à trouver la nature injuste et perfide envers l’homme. Et ailleurs le même écrivain nous parle de cette jeunesse éternelle, de cette gaieté qui ont toujours caractérisé le véritable Hellène, et qui, aujourd’hui encore, font que le Grec est comme étranger aux soucis profonds qui nous minent. M. Jules Girard prend le contre-pied de ces affirmations. Il y a eu en réalité chez le Grec, dit-il, un souci de lui-même, de sa condition et de sa destinée, qui s’éveilla en même temps que sa brillante imagination, qui mit dans ses premières œuvres, quelque énergiques qu’elles lussent d’ailleurs, un accent de plainte dont rien, chez les modernes, n’a dépassé la force pathétique. Ce qu’il y a de vérité dans cette opinion, nul ne peut le méconnaître. Mais la première résume à grands traits, avec une exagération sans doute volontaire, une impression juste dans son ensemble. Les Grecs sentaient les misères de la vie et en souffraient. Mais il y a loin de là à une conception foncièrement triste des choses. Toute leur poésie est en définitive la poésie de la vie ; leur idéal est un idéal de jeunesse et de beauté, qu’ils cherchent sans cesse à réaliser et auquel ils aiment à attacher leur pensée. La grande cause de la tristesse habituelle, c’est-à-dire le sentiment profond d’une disproportion constante entre ce que l’on désire et ce que l’on obtient, les Grecs l’ont à peine connue. Quelques penseurs parmi eux ont pu s’en douter ; mais la race grecque a été, plus que toute autre, amie de la vie, jouissant de ses pensées et de ses sentiments, et portée par nature à un optimisme toujours actif. Maurice Croiset, Hist. de la litt. grecque, t. I, pp. 3-20. 3. — LE BONHEUR AUX YEUX D’UN ATHÉNIEN. Le plus heureux homme que j’aie connu, disait Solon à Crésus, c’est Tellus d’Athènes. Citoyen d’une ville prospère, il a eu des enfants beaux et bons, et de tous il a vu naître des enfants qui ont tous vécu ; secondement, il a possédé des biens autant qu’il convient chez nous, et il a eu la fin la plus brillante. En effet, comme les Athéniens livraient bataille à nos voisins d’Éleusis, il combattit dans leurs rangs, décida la victoire et trouva une mort glorieuse. Les Athéniens l’ensevelirent aux frais de l’État, à l’endroit où il était tombé, et ils l’honorèrent grandement. » Au temps de Platon, Hippias, d’accord avec le sentiment populaire, disait : Ce qu’il y a de plus beau en tout temps, pour tout homme, et en tout lieu, c’est d’avoir des richesses, de la santé, de la considération parmi les Grecs, de parvenir ainsi à la vieillesse, et, après avoir rendu honorablement les derniers devoirs à ses parents, d’être conduit soi-même au tombeau par ses descendants avec la même magnificence. » Hérodote, I, 30 ; Platon (?), Premier Hippias, p. 291. 4. — PARALLÈLE ENTRE LES ATHÉNIENS ET LES SPARTIATES. Des envoyés de Corinthe adressèrent ces paroles aux Spartiates : Les Athéniens sont novateurs, prompts à concevoir des desseins et à exécuter ce qu’ils ont résolu ; vous, votre caractère est de conserver ce qui existe, de ne rien changer par vos projets, de reculer même devant les actes les plus nécessaires. Ils sont entreprenants au delà de leurs forces, aventureux au delà de toute attente, et pleins d’espoir dans le danger ; votre habitude est de faire moins que vous ne pouvez, de ne pas vous fier même aux prévisions les plus certaines, et de croire que vous ne vous tirerez jamais d’un péril. Ils sont impatients d’agir, et vous pleins de lenteur. Ils aiment à quitter leur pays, et votre plus grand désir est de rester dans le vôtre. Ils croient en effet qu’une expédition au dehors pourra leur procurer quelque gain, et vous, qu’elle risquera d’amoindrir ce que vous possédez. Vainqueurs de leurs ennemis, ils donnent tout essor à leur ambition ; vaincus, ils la réduisent le moins possible. Tandis qu’ils abandonnent complètement leur corps à leur patrie, comme un bien étranger, ils gardent énergiquement, pour la mieux servir, la pleine possession de leur esprit. Si l’exécution fait défaut à quelqu’un de leurs projets, ils se croient dépouillés de ce qui leur appartient ; et ce qu’ils viennent d’obtenir par les armes leur semble peu de chose auprès de ce que l’avenir leur promet. Voient-ils échouer une tentative, ils se dédommagent par de nouvelles espérances. Pour eux seuls en effet la possession se confond avec l’espérance, parce que les entreprises suivent immédiatement les résolutions. Et c’est ainsi que toute leur existence se consume péniblement au milieu des fatigues et des dangers. Ils ne jouissent nullement des biens acquis, parce qu’ils acquièrent toujours, parce qu’ils ne connaissent d’autre fête que l’exercice utile de leur activité, et qu’à leurs yeux le repos et l’oisiveté sont un plus grand malheur qu’une vie laborieuse et pénible. De sorte que si l’on disait simplement qu’ils sont nés pour ne souffrir la tranquillité ni chez eux ni chez les autres, on donnerait une juste idée de leur caractère. Thucydide, I, 70 ; trad. par Jules Girard. 5. — ESPRIT DES LACÉDÉMONIENS. — À des députés de Samos qui avaient débité une longue harangue, les Lacédémoniens répondirent : Nous en avons oublié le commencement, et nous n’avons pas compris la fin parce que nous avions oublié le commencement. — Les Thébains élevaient certaines prétentions contraires à celles de Sparte : Il vous faut, leur dit un Lacédémonien, avoir moins de fierté ou plus de puissance. — Quelqu’un voyant un tableau qui représentait des Spartiates tués par des Athéniens, disait : Quels vaillants hommes que ces Athéniens ! — Oui, en peinture, ajouta un Spartiate. — On infligeait un châtiment à un homme, et il répétait sans cesse : C’est malgré moi que j’ai failli. — Eh bien ! dit un Spartiate, malgré toi aussi tu es châtié. — Des gens ayant rencontré des Lacédémoniens sur leur route leur dirent : Vous êtes bien heureux : il n’y a qu’un instant, des brigands ont passé par ici. — Ce n’est pas pour nous qu’a été la chance, répondirent-ils, mais pour eux, qui ne sont pas tombés entre nos mains. — Un Spartiate entendant un orateur dérouler de grandes périodes : Voilà, dit-il, un homme qui sait bien tourner sa langue sans avoir rien à dire. — Un autre, interrogé sur quelque chose, répondit : Non. — Tu mens. — Tu vois bien, répliqua le Lacédémonien, que tu parles pour ne rien dire, puisque tu m’interroges sur ce que tu sais. Plutarque, Apophtegmes de Lacédémoniens inconnus, 1, 2, 7, 9, 33, 56, 65 ; trad. Bétolaud. 6. — CARACTÈRE DES THÉBAINS. Un écrivain messénien de la fin du ive siècle trace d’eux ce portrait : Les Thébains ont l’âme grande, et leur optimisme est admirable ; mais ils sont audacieux, insolents, orgueilleux, prompts à frapper un compatriote aussi bien qu’un étranger, et dépourvus de tout sentiment de justice. S’il surgit entre eux quelque différend au sujet d’un contrat, ils en appellent non à la raison, mais à la violence, et ils transportent dans le domaine de la justice les procédés usités par les athlètes dans les luttes de la gymnastique. De là vient que leurs procès traînent pendant trente années. Si l’un d’eux s’en plaint devant le peuple, il n’a qu’à quitter aussitôt le pays ; sinon, il s’expose à périr dans quelque embuscade nocturne de la main de ceux qui ne veulent pas que le procès se juge. Pour un rien, chez eux, un meurtre a lieu. Tels sont les hommes. Cela n’empêche pas d’ailleurs qu’il ne se rencontre à Thèbes des hommes dignes d’estime et d’amitié. Quant aux femmes, leur taille, leur démarche, le rythme de leurs mouvements les placent parmi les plus belles et les plus élégantes de la Grèce. Dicéarque, dans les Fragments des historiens grecs, t. II, p. 258. 7. — SIMPLICITÉ DE LA VIE GRECQUE. La civilisation, en se déplaçant vers le nord, a dû pourvoir à toutes sortes de besoins qu’elle n’était pas obligée de satisfaire dans ses premières stations du sud. Dans un climat humide ou froid, comme la Gaule, la Germanie, l’Angleterre, l’Amérique du Nord, l’homme mange davantage ; il lui faut des maisons plus solides et mieux closes, des habits plus chauds et plus épais, plus de feu et plus de lumière, plus d’abris, de vivres, d’instruments et d’industries. Il devient forcément industriel, et, comme ses exigences croissent avec ses satisfactions, il tourne les trois quarts de ses efforts vers l’acquisition du bien-être. Mais les commodités dont il se munit sont autant d’assujettissements où il s’embarrasse, et l’artifice de son confortable le tient captif.... Dans la Grèce ancienne, une tunique courte et sans manches pour l’homme, pour la femme une longue tunique qui descend jusqu’aux pieds, et, se doublant à la hauteur des épaules, retombe jusqu’à la ceinture, : voilà tout l’essentiel du costume ; ajoutez une grande pièce carrée d’étoffe dont on se drape, pour la femme un voile quand elle sort, assez ordinairement des sandales ; Socrate n’en portait qu’aux jours de festin ; très souvent on va pieds nus et tête nue. Tous ces vêtements peuvent être ôtés en un tour de main ; ils ne serrent point la taille ; ils indiquent les formes ; le nu apparaît par leurs interstices et dans leurs mouvements. On les ôte tout à fait dans les gymnases, dans le stade, dans plusieurs danses solennelles ; c’est le propre des Grecs, dit Pline, de ne rien voiler. L’habillement n’est chez eux qu’un accessoire lâche qui laisse au corps sa liberté, et qu’à volonté, en un instant, on peut jeter bas. Même simplicité pour la seconde enveloppe de l’homme, la maison. Comptez tout ce qui compose aujourd’hui un logis passable, grande bâtisse de pierre de taille, fenêtres, vitrines, papiers, tentures, persiennes, doubles et triples rideaux, calorifères, cheminées, tapis, lits, sièges, meubles de toute espèce, innombrables brimborions et ustensiles de ménage et de luxe, et mettez en regard le ménage hellénique. Des murs qu’un voleur peut percer, blanchis à la chaux, encore dépourvus de peintures au temps de Périclès, un lit avec quelques couvertures, un coffre, quelques beaux vases peints, des armes suspendues, une lampe de structure toute primitive, une toute petite maison qui n’a pas toujours de premier étage : cela suffit à un Athénien noble ; il vit au dehors, en plein air, sous les portiques, dans l’agora, dans les gymnases, et les bâtiments publics qui abritent sa vie publique sont aussi peu garnis que sa vie privée.... En Grèce, un théâtre contient de trente à quarante mille spectateurs, et coûte vingt fois moins que chez nous ; c’est que la nature en fait les frais : un flanc de colline où l’on taille des gradins circulaires, un autel au bas et au centre, un grand mur sculpté pour répercuter la voix de l’acteur, le soleil pour lustre, et, pour décor lointain, tantôt la mer luisante, tantôt des groupes de montagnes veloutées par la lumière. Aujourd’hui un État comprend trente à quarante millions d’hommes répandus sur un territoire large et long de plusieurs centaines de lieues. C’est pourquoi il est plus solide qu’une cité antique ; mais en revanche il est bien plus compliqué, et, pour y remplir un emploi, un homme doit être spécial. Partout les emplois publics sont spéciaux comme les autres. La masse de la population n’intervient dans les affaires générales que de loin en loin, pour des élections. Elle vit, ou vivote en province sans pouvoir se faire d’opinions personnelles ni précises, réduite à des impressions vagues et à des émotions aveugles, obligée de se remettre aux mains de gens plus instruits qu’elle expédie dans la capitale et qui la remplacent quand il faut décider de la guerre, de la paix ou des impôts.... Au contraire, l’Athénien décide lui-même des intérêts généraux ; cinq ou six mille citoyens écoutent les orateurs et votent sur la place publique ; on y vient pour faire des décrets et des lois, comme pour vendre son vin et ses olives ; le territoire n’étant qu’une banlieue, le campagnard n’a pas beaucoup plus de chemin à faire que le citadin. De plus, les affaires dont il s’agit sont à sa portée ; car ce sont des intérêts de clocher, puisque la cité n’est qu’une ville. Il n’a pas de peine à comprendre la conduite qu’il faut tenir avec Mégare ou Corinthe ; il lui suffit pour cela de son expérience personnelle, et de ses impressions journalières ; il n’a pas besoin d’être un politique de profession, versé dans la géographie, l’histoire, la statistique et le reste. Pareillement il est prêtre chez lui, et de temps en temps pontife de sa phratrie ou de sa tribu ; car la religion est un beau conte de nourrice, et la cérémonie qu’il accomplit consiste en une danse ou un chant qu’il sait dès l’enfance, et dans un repas auquel il préside avec un certain habit. De plus, il est juge dans les tribunaux, au civil, au criminel, au religieux, avocat et obligé de plaider dans sa propre cause. Un méridional, un Grec est naturellement vif d’esprit, bon et beau parleur ; il sait les lois en gros ; les plaideurs les lui citent ; d’ailleurs l’usage lui permet d’écouter son instinct, son bon sens, son émotion, ses passions, au moins autant que le droit strict et les arguments légaux. Riche ou pauvre, il est soldat ; comme l’art militaire est encore simple, la garde nationale est l’armée. Pour la former et former le parfait soldat, deux conditions sont requises, et ces deux conditions sont données par l’éducation commune, sans instruction spéciale, sans école de peloton, sans discipline ni exercices de caserne. D’un côté, ils veulent que chaque soldat soit le corps le plus robuste, le plus souple et le plus agile, le plus capable de bien frapper, parer et courir ; cela leurs gymnases pourvoient. De l’autre côté, ils veulent que les soldats sachent marcher, courir, faire toutes les évolutions en bon ordre ; à cela l’orchestrique suffit : toutes leurs fêtes nationales et religieuses enseignent aux enfants et aux jeunes gens l’art de former et de dénouer les groupes. Ainsi préparé par les mœurs, on comprend que le citoyen soit soldat sans effort et du premier coup. Il sera marin sans beaucoup plus d’apprentissage. En ce temps-là, un navire de guerre n’est qu’un bateau de cabotage, contient tout au plus deux cents hommes et ne perd guère de vue les côtes. Dans une cité qui a un port et vit de commerce maritime, il n’est personne qui ne s’entende à manœuvrer un tel navire, personne qui ne connaisse d’avance ou n’apprenne vite les signes du temps, les chances du vent, les positions et les distances, toute la technique et tous les accessoires qu’un matelot ou un officier de mer ne sait chez nous qu’après dix ans d’étude et de pratique. Toutes les particularités de la vie antique dérivent de la même cause, qui est la simplicité d’une civilisation sans précédents, et toutes aboutissent au même effet, qui est la simplicité d’une âme bien équilibrée, en qui nul groupe d’aptitudes et de penchants n’a été développé au détriment des autres, qui n’a pas reçu de tour exclusif, que nulle fonction spéciale n’a déformée. Aujourd’hui nous avons l’homme cultivé et l’homme inculte, le citadin et le paysan, le provincial et le Parisien, en outre, autant d’espèces distinctes qu’il y a de classes, de professions et de métiers, partout l’individu parqué dans le compartiment qu’il s’est fait, et assiégé par la multitude des besoins qu’il s’est donnés. Moins artificiel, moins spécial, moins éloigné de l’état primitif, le Grec agissait dans un cercle politique mieux proportionné aux facultés humaines, parmi des mœurs plus favorables à l’entretien des facultés animales : plus voisin de la vie naturelle, moins assujetti par la civilisation surajoutée, il était plus homme. Taine, Philosophie de l’art, t. II, pp. 159-168. 8. — DIVISIONS DU TEMPS. 1° Ère. — Pendant longtemps, les États grecs n’eurent pas d’ère commune. Chacun datait ses documents publics par le nom d’un magistrat local, dit éponyme. Tels furent les éphores à Sparte, les cosmes en Crète, l’archonte à Athènes, le prytane à Chio. Au IVe siècle, sans rompre avec cet usage, on commença à compter par olympiades. Cette ère commence dans l’été de 776 av. J.-C. Comme une olympiade comprend une période de quatre années, une date grecque se désigne ainsi : Olympiade 100, 1re, 2e, 5e ou 4e année. Pour convertir en années de l’ère chrétienne une date donnée en olympiades, par exemple Ol. 75, 1 (date de la bataille de Salamine), on multiplie 75 - 1 par 4, et on retranche le produit (296) de 776 ; on obtient de la sorte 480 av. J.-C. 2° Mois. — L’année grecque se composait de 12 mois lunaires, comptant 30 et 29 jours alternativement. L’année lunaire avait donc 354 jours, ou 11 jours de moins que l’année solaire. Pour racheter la différence, les Athéniens imaginèrent d’intercaler tous les huit ans trois mois de 30 jours qui se plaçaient dans la 3e, la 5e et la 8e année. Comme cela ne suffisait pas encore, on ajoutait tous les seize ans 3 jours supplémentaires. L’année ne commençait pas partout au même moment. Celle d’Athènes commençait au solstice d’été (21 juin), celle de Délos au solstice d’hiver (21 décembre), celle de Béotie en octobre. Les mois portaient des noms différents suivant les Pays. Voici le calendrier athénien :
Le mois intercalaire venait après Posidéon, et s’appelait le second Posidéon. 3° Jours. — Chaque mois se divisait en trois décades. On désignait les jours comme il suit :
Dans les mois de 29 jours, on supprimait δευτάρα φθίνοντος, et le 29e s’appelait ένη καί νέα. Il est probable que les Grecs ne distinguèrent, à l’origine, que le jour et la nuit. Avec le temps et la diversité croissante des occupations de la vie civile, le nombre des divisions se multiplia. En général, le jour de 24 heures comprend six parties, 3 pour le jour proprement dit (πρωΐ, μεσεμβρία, δείλη), et 3 pour la nuit (έσπέρα, μέση νύξ, έως). On trouve encore des désignations assez vagues comme όρθρος (le lever), περί πλήθουσα άγοράν (quand l’agora est pleine de monde, entre le matin et midi), περί λύχνων άφάς (quand on allume les lampes), περί πρώτον ϋπνον (au premier sommeil). Dans les camps, la nuit est divisée en trois veilles (φυλακαί). Ce n’est qu’après Alexandre qu’on fit commencer le jour au lever du soleil ; auparavant il commençait à son coucher. Les anciens ont divisé le jour et la nuit en 12 heures, comptées à partir du lever du soleil, de sorte que midi coïncidait avec le commencement de la 7e heure du jour, et minuit avec la 7e heure de la nuit. L’emploi du mot ώραι dans le sens d’heures est postérieur au milieu du Ive siècle. La longueur des heures était variable suivant les saisons, puisqu’elle dépendait de celle du jour et de la nuit ; les astronomes seuls comptaient par heures égales comme nous. A l’époque de Démosthène, on avait des horloges à eau ou clepsydres, où le temps se mesurait par le volume d’eau qui s’écoulait régulièrement d’un réservoir. Reinach, Traité d’épigraphie grecque, pp. 473 et suiv. ; Gow, Minerva, pp. 77 et suiv. 9. — MESURES, POIDS ET MONNAIES. Mesures de longueur (attiques).
Mesures de superficie (attiques).
Mesures de capacité (attiques).
Les mesures éginétiques, usitées à Sparte et dans le Péloponnèse, étaient plus grandes d’un tiers environ. Poids et monnaies attiques après Solon.
La valeur des monnaies ne demeura pas immuable. On calcule qu’à l’époque d’Alexandre le talent ne valait plus que 5.812 francs, et qu’il tomba à 5.662 francs après Alexandre. Ces variations dépendaient de la quantité d’argent fin que renfermaient les pièces. Hultsch, Griechische und römische Metrologie, p. 234, 697, 700, 703, 705 ; 2e édit. 10. — MANIÈRE DE COMPTER. Les Grecs ont eu plusieurs systèmes de numération, 1° Le système acronymigue, qui a été presque seul en usage entre 600 et 400 av. J.-C., et qui consiste à prendre pour chiffre la première lettre du mot qui exprime le nombre, l’unité étant représentée par une simple barre verticale :
2° Le système alphabétique, usité à partir de 500, qui consiste à donner aux 24 lettres la valeur de leur numéro d’ordre dans l’alphabet :
3° Le système alphabétique décimal, qui est ainsi conçu : Les 10 premières lettres de l’alphabet, avec un accent à droite et en hait, indiquent les chiffres de 1 à 10 :
Ces mêmes lettres précédées de τ désignent les chiffres de 11 à 19 :
Les dizaines sont représentées par les neuf lettres qui suivent ι :
Les centaines sont représentées par les huit lettres suivantes :
Les milliers sont représentés par les neuf premières lettres de t’alphabet, avec un accent à gauche et en bas :
Pour 10000, 20000, 30000, etc., ces mêmes lettres sont surmontées d’un tréma :
On note ainsi les sommes d’argent :
Bouché-Leclercq, Atlas pour servir à l’hist. gr., pp. 107-109. |