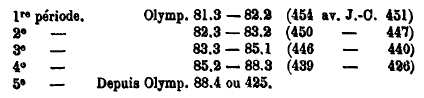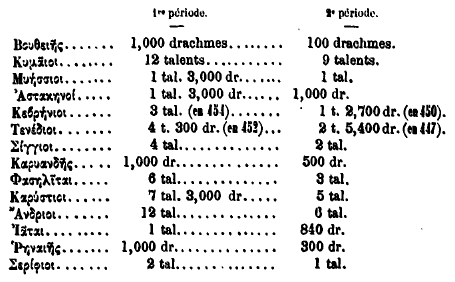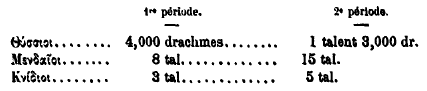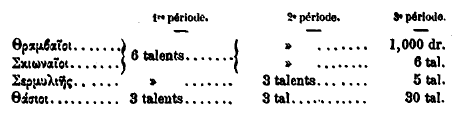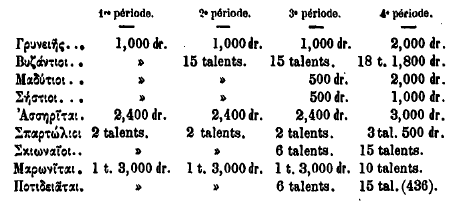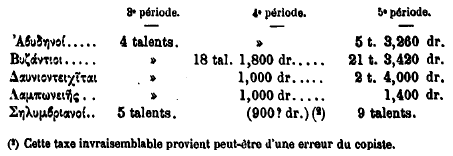DE LA CONDITION DES ALLIÉS PENDANT LA PREMIÈRE CONFÉDÉRATION ATHÉNIENNE
Paul GUIRAUD
I — La confédération de Délos.II — L’Empire athénien.III — Gouvernement intérieur des villes.IV — Justice.V — Service militaire.VI — Tribut.VII — Conclusion.I — La confédération de Délos. L’empire d’Athènes se forma dans les années qui suivirent les batailles de Salamine, de Platées, et de Mycale[1]. Après avoir vaincu sur terre et sur mer les forces persanes, les Grecs, surtout ceux des côtes et des îles, furent animés d’un double sentiment ; ils voulurent prévenir le retour des dangers qu’ils avaient courus, et affranchir les villes helléniques éparses sur tout le littoral de l’archipel. Peut-être l’esprit de vengeance eut-il quelque part dans ce projet ; mais ce fut principalement le souci de leur sécurité qui le leur inspira. Ils n’avaient pas au fond d’autre pensée que d’éloigner d’eux ml ennemi toujours redoutable, et de dresser entre la Grèce et lui une barrière que l’invasion ne franchirait plus[2]. Sparte, qui avait eu jusque-là l’hégémonie, était naturellement désignée pour la direction de l’entreprise ; elle se déroba à cette tâche, et Athènes s’en chargea[3]. Athènes avait alors sur sa rivale plusieurs avantages. Elle possédait un excellent port, le Pirée, et une marine qui récemment avait fait ses preuves ; elle était parente de race avec les cités ioniennes d’Asie-Mineure qui se montraient les plus empressées à secouer le joug persan ; elle était, par sa situation même, intéressée autant que personne au succès de la lutte qu’il s’agissait de continu9r ; elle avait enfin pour elle le prestige du rôle glorieux qu’elle avait joué dans la guerre de l’indépendance. Ces diverses raisons justifiaient assez le choix qui la porta à la tête de la nouvelle ligue ; mais, quoi qu’en disent les orateurs et les écrivains ultérieurs, ce choix ne fut pas entièrement spontané ; il fut, en partie, le fruit des intrigues d’Athènes. Elle n’attendit pas que la confédération se constituât, et qu’on lui en offrit la présidence ; elle travailla elle-même à l’organiser, et à s’y ménager la première place[4]. La ligue n’eut pas tout d’abord l’extension qu’elle reçut plus tard. Depuis l’année 476, qui en marque l’origine, elle ne cessa de s’agrandir, par l’effet des négociations diplomatiques et des opérations militaires d’Athènes, et elle n’arriva que par degrés à son plein développement. M. Kirchhoff a essayé de déterminer les étapes de ses progrès successifs. Il croit que les cinq districts administratifs de la confédération furent créés l’un après l’autre, ceux d’Ionie, d’Hellespont et des lies en premier lieu, celui de Thrace à la suite de la prise d’Eion (470), celui de Carie postérieurement à la bataille de l’Eurymédon (465), et que les cités furent inscrites dans chacun d’eux, moins d’après leur position géographique, que d’après la date de leur adhésion[5]. Si cette hypothèse était fondée, il aurait fallu dix ans environ pour grouper autour d’Athènes la plupart des villes qui reconnurent son autorité. La composition de la ligue subit d’ailleurs, avec le temps, de graves modifications. Nous avons très peu de renseignements sur son organisation primitive. Elle était placée sous le patronage d’Apollon, et elle avait son centre à Délos. Ce n’est pas qu’elle fût, comme on l’a prétendu, une véritable amphictyonie ; jamais les anciens ne la désignent sous ce nom. Elle était, semble-t-il, bien différente de l’assemblée qui jadis appelait dans cette île les Ioniens de l’archipel[6]. Le caractère religieux dominait dans celle-ci ; dans l’autre, c’était le caractère politique. On lui avait donné Délos pour capitale, parce que ce sanctuaire était très vénéré des Ioniens, qui les premiers entrèrent dans l’alliance, et aussi parce qu’on avait voulu, par égard pour les susceptibilités de chacun, fixer le siège fédéral sur une sorte de terrain neutre qui fût voisin d’Athènes sans se confondre avec elle. Le conseil de la ligue se réunissait périodiquement auprès du temple d’Apollon[7]. Toutes les cités y étaient représentées, et toutes y avaient sans doute le même nombre de voix. Il est avéré en effet que l’usage constant chez les Grecs était d’accorder un égal droit de suage à tous les membres d’une confédération. Eschine nous l’atteste pour l’amphictyonie de Delphes[8]. Il en était de même dans la ligue Péloponnésienne. Thucydide applique à ceux qui la composent le mot ίσόψηφοι[9]. Ailleurs, racontant la séance où l’on décide la guerre contre Athènes, il dit : Les Lacédémoniens permirent à toutes les villes alliées, grandes et petites, qui étaient présentes, de voter, et la majorité se prononça pour la guerre[10]. Une pratique analogue fut adoptée dans la seconde confédération athénienne ; chaque cité, quelle que fût son importance, y eut une voix[11]. On peut conclure d’un texte de Thucydide que les choses ne se passaient pas autrement à Délos. L’expression ίσοψήφους lui sert à désigner les alliés, à l’époque où ils étaient encore libres, et il ajoute que la multiplicité des suages rendait l’entente malaisée[12]. Cela favorisait au reste la prépondérance d’Athènes. Officiellement, elle n’avait que la présidence du conseil ; mais il lui était facile de se faire une clientèle docile parmi les états faibles qu’elle tenait sous sa dépendance, et par eux de s’assurer une majorité dévouée. Pour mettre la ligue sur un bon pied, il fallait lui procurer des ressources régulières. Suivant Thucydide, les Athéniens décidèrent quelles villes fourniraient des vaisseaux, et quelles villes paieraient une contribution en argent[13]. Nous n’avons la liste ni des unes ni des autres ; on suppose généralement, sans en avoir de preuve certaine, que les grandes cités furent rangées dans la première catégorie, et les petites dans la seconde[14]. C’est à Aristide que fut confié le soin de répartir les charges communes, et il s’en acquitta à la satisfaction de tous ; on dit même qu’il mérita à cette occasion son surnom de Juste[15]. Il est probable que son travail fut présenté à l’approbation du conseil ; on ne comprendrait guère que le droit de taxer les alliés eût été laissé à la discrétion d’Aristide ou d’Athènes. Le chiffre primitif des tributs s’éleva à une somme annuelle de 460 talents (2.587.500 fr.)[16], mais ici se rencontre une grave difficulté. La ligue de Délos ne s’organisa pas en un jour ; plusieurs années furent nécessaires pour recruter ses adhérents, et nous ne savons pas à quelle date la somme de 460 talents fut atteinte. Thucydide se borne à dire que ce chiffre fut le montant du premier tribut[17], et les autres historiens ne sont pas plus précis. M. Kirchhoff s’est efforcé de démontrer que jamais, avant la bataille de l’Eurymédon, les alliés ne furent soumis à une contribution aussi forte[18]. Le malheur est que son argumentation, si spécieuse qu’elle soit, ne s’appuie sur aucun document ; elle est même en contradiction formelle avec tous les textes anciens. Diodore affirme, d’après Éphore, que le total des tributs établis par Aristide arrivait à 460 talents[19]. Plutarque et Cornelius Nepos sont d’accord avec lui sur ce point[20]. Démosthène, Eschine, l’auteur du discours contre Alcibiade, sans apporter un témoignage aussi net que le leur, attestent au fond la même chose[21]. Quant à Thucydide, il ne parle point d’Aristide dans le passage cité plus haut, mais ailleurs il reproduit le traité qu’on appelle la paix de Nicias, et dans ce texte il est stipulé que plusieurs villes de Thrace paieront désormais le tribut du temps d’Aristide[22]. Ce n’était pas là évidemment une expression vague ; elle désignait, au contraire, un chiffre d’impôt bien déterminé, remontant à une date certaine, à un personnage connu. On avait donc des renseignements positifs sur la taxe imposée par Aristide à chacune des cités alliées, et il suffisait d’additionner toutes ces taxes pour avoir la somme que l’ensemble des confédérés acquittait. Thucydide nous assure que cette somme ; une fois la répartition achevée, fut de 460 talents. Nous n’avons aucun motif de révoquer cette assertion en doute, et il reste vrai que tel fut le chiffre des tributs avant la mort d’Aristide, c’est-à-dire avant 467. On objectera peut-être que la ligue n’était pas encore au complet, puisque, selon l’hypothèse lissez vraisemblable de M. Kirchhoff, l’annexion du district carien et de la Chersonèse de Thrace n’eut lieu qu’après la bataille de l’Eurymédon (465)[23] ; mais rien n’indique que le tribut primitif mentionné par Thucydide soit celui de la ligue poussée à son entier développement ; ce n’était que la somme des taxes prélevées sur les villes qui en faisaient partie à l’époque d’Aristide. Le trésor fédéral fut déposé à Délos, dans le temple d’Apollon, et placé sous la garde des Hellénotames. Nous avons peu de détails sur les attributions de ces magistrats. D’après Thucydide, ils recevaient le tribut[24]. Andocide, cité par Harpocration, dit qu’ils maniaient l’argent de la confédération. Suidas et Hesychius ne sont pas plus explicites[25]. Ils devaient administrer les finances communes, encaisser les recettes et solder les dépenses, sous le contrôle du conseil. Leurs fonctions étaient annuelles ; ils étaient toujours choisis parmi les citoyens d’Athènes et par Athènes elle-même. Cette ville avait encore un autre privilège ; c’est dans son port du Pirée que se réunissaient, en cas de guerre, les navires alliés ; là était le quartier général de la flotte fédérale[26]. La ligue de Délos reposait, comme on voit, sur des bases très équitables. Elle n’asservissait personne, et rapprochait par une simple alliance des états également souverains. Fondée uniquement pour combattre la Perse, elle n’élevait Athènes au-dessus d’eux que dans la mesure où l’intérêt de tous l’exigeait ; elle lui attribuait sans doute plus qu’une primauté d’honneur ; mais elle ne lui donnait que la part d’autorité qui revient de droit au chef d’une confédération. Il n’y avait eu ici ni soumission forcée, ni même abdication volontaire ; tout avait été réglé à l’amiable, et sans qu’il en contât beaucoup aux alliés. Leurs charges s’étaient accrues, mais leur indépendance était demeurée presque intacte. Ils n’avaient aliéné de leur liberté quo ce qu’il leur avait plu d’en sacrifier. Athènes, en réalité, n’était que l’exécutrice des décisions prises par le conseil, et elle ne pouvait devenir quelque chose de plus que si les confédérés eux-mêmes y consentaient. Pour le moment il existait un juste équilibre entre la prépondérance de l’état dirigeant et l’autonomie des états associés. La condition de ces derniers ne tarda pas à se modifier, autant par leur faute que par celle d’Athènes. Le patriotisme hellénique était tellement pénétré de l’esprit local qu’il ne voyait rien en dehors des intérêts de là cité. Ce n’était pas seulement la nature du pays qui morcelait la Grèce à l’infini, c’était encore plus l’idée qu’on se faisait de l’état et de la patrie. On avait de la peine à concevoir qu’une ville coopérât au bien d’une autre ville, et, s’il arrivait parfois qu’une ligue politique se formât, elle tombait vite en dissolution, à moins d’être maintenue par la force. Tel fut le cas de celle de Délos. Quand les alliés s’aperçurent que la Perse n’avait plus de navires dans l’Archipel ni de garnisons sur les côtes, ils furent tentés de croire que leur union était désormais inutile, et le lien fédéral tendit à se relâcher. Ils ne réfléchirent pas que, s’il venait à se rompre, ils allaient se désarmer de leurs propres mains et perdre tous les avantages acquis. L’égoïsme municipal l’emporta, et chacun chercha à s’isoler de nouveau. On eut moins de goût qu’auparavant pour les affaires communes ; on cessa d’envoyer des délégués à Délos ; on mit plus de mollesse à remplir les obligations prescrites ; on se plaignit de leur lourdeur, et on ne désira plus que de s’y soustraire. C’était à la fois le devoir et l’intérêt d’Athènes de réagir contre ces dispositions. Elle ne pouvait guère se résigner à la déchéance qu’eût entraînée pour elle la suppression de la ligue ; elle était tenue, comme présidente, d’en assurer la durée et d’en faire respecter les règlements ; elle comprenait enfin, mieux que toute autre cité, quelle faute ce serait de se condamner, par la division, à la faiblesse. Aussi son action s’exerça-t-elle en sens contraire de celle des alliés Les confédérés étaient de plus en plus enclins à se séparer ; elle voulut leur donner plus de cohésion. Ils désertaient le conseil fédéral ; elle se passa d’eux, d’autant plus volontiers que son autorité s’en trouvait accrue. Ils témoignaient beaucoup de répugnance à payer le tribut annuel ; elle l’exigea avec rigueur. Elle ne céda que sur un point, parce qu’elle eut profit à céder. Un de leurs principaux griefs était la nécessité, au moins pour quelques-uns, de fournir des vaisseaux de guerre et de les monter eux-mêmes. Ces populations des lies et de l’Ionie n’étaient pas belliqueuses[27] ; elles préféraient se livrer au commerce, aux occupations de la paix ; et il leur était pénible d’en être souvent détournées pour une expédition militaire. La plupart d’entre elles demandèrent l’autorisation de remplacer leur prestation en navires par une prestation en argent, qui serait consacrée aux dépenses de la flotte. Athènes y consentit ; elle y gagnait d’être désormais à peu près la seule cité fédérale qui possédât une marine, et d’acquérir par cela même une puissance sans rivale[28]. Cette innovation porta aussitôt ses fruits. D’abord la ligue devint plus forte. A partir de ce moment, presque toutes les villes s’en remirent à Athènes du soin de construire et d’entretenir la flotte. Celle-ci eut dès lors plus d’unité ; elle se composait auparavant d’éléments hétérogènes ; elle ne se composa plus que de trières athéniennes, et l’on sait que ces dernières étaient réputées les meilleures de toute la Grèce. Des chantiers du Pirée sortaient des bâtiments agiles, légers, bons marcheurs, capables d’évoluer avec la plus grande précision, armés en outre d’un éperon redoutable, et montés par des équipages admirablement exercés[29]. Ce fut donc, au point de vue militaire, un avantage réel que ces chantiers fussent en possession d’alimenter seuls la flotte fédérale et qu’aux anciens navires, d’origine diverse et de valeur inégale, se substituât une marine exclusivement athénienne. Mais, d’autre part, les alliés n’ayant plus de vaisseaux de guerre, et perdant chaque jour l’expérience des manœuvres navales se trouvèrent livrés sans défense à l’ambition d’Athènes ; ils n’eurent plus les moyens de résister à ses empiétements, de désobéir à ses volontés, d’échapper à sa tyrannie[30]. Ils l’avaient faite si puissante et ils s’étaient eux-mêmes tellement affaiblis, qu’ils furent à sa discrétion. Le joug s’appesantit sur eux, et ils ne purent rien pour l’empêcher. Du jour où la force fut concentrée tout entière entre les mains d’une ville, celle-ci dut se considérer comme la maîtresse des autres, et élever ses prétentions au niveau de ses ressources matérielles. Un dernier progrès amena ce changement. On se demandait depuis quelque temps s’il ne serait pas bon de transférer le trésor à Athènes. Aristide, consulté à ce sujet, avait dit que la mesure était injuste, mais utile[31]. On ne manquait pas en effet d’excellentes raisons pour la réclamer. On alléguait notamment que Délos était trop peu sûre, et qu’elle ne se défendait pas assez par elle-même, qu’il faudrait, en cas de guerre, immobiliser dans l’île une garnison et une flotte, que, si à la faveur de la paix la surveillance venait à se relâcher, un coup de main sur le temple serait toujours à craindre, et souvent facile à exécuter, qu’il valait mieux, de toute façon, abriter la caisse fédérale derrière les murs d’Athènes et du Pirée[32] Des négociations s’engagèrent à ce propos entre les principaux états de la ligue, et finalement Samos, le plus important après Athènes, souleva la question dans le conseil ; elle n’y rencontra, semble-t-il, aucune opposition[33]. La date de l’événement ne nous est point connue. Nous savons seulement, et de la manière la plus certaine, que la translation fut opérée avant l’année 454[34]. On a émis l’opinion très plausible qu’elle suivit de près la rupture survenue entre Sparte et Athènes vers 460 ; cette circonstance fut sans doute invoquée pour montrer le danger qu’allait courir le trésor dans le temple d’Apollon délien, surtout si les Lacédémoniens se rapprochaient de la Perse[35]. Un texte de Justin confirme d’ailleurs cette hypothèse[36], et il mérite quelque créance, s’il est vrai qu’il émane de l’historien Éphore. En même temps, l’assemblée fédérale disparut. Il n’y a point trace d’un acte formel qui l’ait abolie ; mais, comme les documents n’en font plus mention, il est probable qu’elle cessa de se réunir. Athènes n’eut pas besoin d’un grand effort pour s’en débarrasser. Nous ignorons si le conseil de Délos a jamais eu quelque vitalité ; en tout cas, il n’avait plus qu’un r31e bien effacé vers la fin de son existence, et les alliés n’avaient rien à perdre en le supprimant. Du reste la confédération était maintenant trop vaste et trop dispersée pour être régie par un conseil de ce genre. On ne pouvait, à cause des distances, le convoquer exprès pour chaque affaire nouvelle qui était à résoudre ; et d’un autre côté certaines questions étaient parfois trop urgentes pour être ajournées jusqu’à la :session ordinaire. L’assemblée n’étant pas une garantie pour l’indépendance des villes, et n’étant plus qu’un obstacle à la bonne direction de la ligue[37], on prit, d’un commun accord, le parti de la laisser tomber en désuétude. L’unique autorité de la confédération fut dès lors le peuple d’Athènes, et l’union de Délos fit place à l’empire Athénien. II — L’Empire athénien. On comprendrait mal quel fut le caractère de l’empire d’Athènes, si au préalable on ne se rendait pas compte de l’état politique de cette cité vers le milieu du Ve siècle avant notre ère. Il existe en effet une étroite corrélation entre le régime intérieur de la république et sa conduite à l’égard des alliés. Clisthène avait détruit la prépondérance exclusive de l’aristocratie, mais il n’avait pas établi la démocratie pure. En principe, tous les citoyens étaient égaux devant la loi ; tous aussi étaient admis dans l’assemblée ; mais les pauvres, obligés de compter avec les nécessités de la vie, n’avaient guère le loisir de s’y rendre, et ils étaient en outre exclus des magistratures ; de telle sorte que, dans la pratique, le pouvoir appartenait il une classe dirigeante, composée des riches et des gens aisés. Les écrivains anciens, qui sont en général favorables aux gouvernements tempérés, attribuent en grande partie la prospérité ultérieure d’Athènes à cette constitution[38]. Elle demeura en vigueur pendant prés d’un demi-siècle ; mais, après cet intervalle, elle fut gravement altérée par les réformes d’Aristide et d’Éphialte. Les guerres médiques avaient associé tous les citoyens aux mêmes épreuves et aux mêmes luttes. Ils avaient souffert ensemble, vaincu ensemble, et le patriotisme des pauvres n’avait été ni moins ardent, ni moins efficace que celui des riches. C’est surtout par sa flotte qu’Athènes avait été sauvée, et les équipages de la flotte se recrutaient presque entièrement parmi les thètes. Cette classe, la dernière de toutes, méritait donc, autant que les autres, la reconnaissance de la cité, et il parut difficile de lui refuser la récompense qu’elle sollicitait[39]. On avait encore, à cette époque, des idées saine, sur la politique, et on trouvait équitable de proportionner les droits aux charges et aux services. Or, depuis Thémistocle, la mariste athénienne ne cessait de se développer, et de plus en plus on tendait à fonder la puissance de la république sur la mer[40]. Il résulta de là une extension prodigieuse du commerce, par suite de la richesse mobilière, et l’élévation progressive d’un grand nombre de citoyens vers la fortune, jusque-là réservée aux possesseurs du sol. Il en résulta ainsi un sérient accroissement d’influence pour cette multitude d’individus qui vivaient des choses de la nier ; ces chantiers toujours en activité, ces escadres en perpétuel mouvement, ces expéditions dirigées dans tous les sens, ces victoires navales si fréquentes et si fructueuses, montraient assez la lourde besogne qui incombait aux armateurs, aux ouvriers des arsenaux, aux rameurs, aux matelots, la place énorme qu’ils occupaient sinon dans l’état, du moins dans la société, et la part considérable qu’ils avaient à la prospérité d’Athènes. Aristide, tout aristocrate qu’il fût, céda à ces raisons, et il fit voter une loi qui ouvrait l’accès des plus hautes magistratures à tous les citoyens[41]. Dès lors, l’égalité politique fut complète. Néanmoins il restait encore un obstacle au libre exercice de la souveraineté populaire. Au-dessus des pouvoirs publics planait l’autorité indéfinie d’un corps inamovible, l’aréopage. Ce corps, où entraient, après un examen préalable, et où siégeaient à vie les archontes sortis de charges[42], ne recevait dans son sein que des hommes recommandables par la naissance et les qualités morales. Son indépendance était absolue, et elle venait de ce qu’il n’avait rien à espérer du peuple ni rien à en craindre[43]. Comme toutes les assemblées qui se renouvellent lentement et qui se recrutent elles-mêmes, il avait le tempérament conservateur, il représentait l’esprit de tradition, et le parti de la résistance trouvait en lui son principal appui. Sa compétence judiciaire était très étendue, et il y joignait certains privilèges politiques. Plutarque dit qu’il avait la garde des lois et qu’il exerçait sa surveillance sur toutes choses[44]. Ce n’est pas, semble-t-il, qu’il eût la haute main sur le gouvernement, ni que les décisions populaires fussent nécessairement soumises à sa sanction. Il est probable qu’il avait simplement le droit de juger ce genre de procès que provoquait la γραφή παρανόμων, et de casser, par cette voie détournée, les lois qui lui paraissaient inconstitutionnelles[45]. Vers l’année 460, Éphialte le dépouilla de cette prérogative, qu’il transféra aux héliastes. Ces derniers furent mis en possession de la plupart des jugements, en particulier de ceux qui osaient le moyen de contrôler la puissance législative de l’assemblée[46]. Or c’étaient à peu près les mêmes citoyens qui remplissaient les fonctions d’héliastes et qui votaient les lois dans l’ecclésia. Les mêmes hommes faisaient donc la loi, et déclaraient ensuite si on avait eu raison de la faire. Le peuple n’était plus préservé contre les innovations imprudentes ni contre les violations flagrantes de la légalité par une autorité différente de la sienne. Il était pleinement souverain, et la démocratie régnait sans partage. Il y avait, à ce moment-là, dans Athènes, deux partis qui se disputaient le pouvoir ; l’un groupé autour de Cimon, l’autre conduit par Périclès. Tous deux acceptaient la constitution actuelle, dans ses traits généraux, et les aristocrates, s’ils regrettaient le passé, ne songeaient nullement à revenir en arrière. Mais dans les deux camps les tendances politiques et les principes de gouvernement différaient. A l’extérieur, Cimon voulait que l’on vécut en bons termes avec Sparte ; il pensait qu’il y avait place dans le monde hellénique pour deux villes qui se feraient équilibre, surtout si Sparte bornait son ambition à l’hégémonie du Péloponnèse, et si Athènes se contentait de dominer dans l’Archipel. L’essentiel, à ses yeux, était que la Grèce ne consumât point ses forces dans des querelles intestines dont les ennemis du dehors profiteraient. Athènes, notamment, ne devait jamais perdre de vue le, guerre médique ; ses intérêts lui faisaient une nécessité de la poursuivre, et sa puissance maritime lui en fournissait les moyens. Cimon avait contribué autant qu’Aristide à la formation de la ligue de Délos, et il travaillait à l’agrandir encore, mais le seul but qu’il lui assignât était la lutte contre la Perse[47]. A l’intérieur, il admettait bien la démocratie, mais à condition qu’elle fût mitigée ; il consentait à proclamer l’égalité de tous les citoyens et à n’interdire légalement les fonctions publiques à personne ; mais il souhaitait que dans la pratique le gouvernement restât aux mains des classes élevées. Il ne contestait pas la souveraineté du peuple, pourvu qu’elle ne fût pas sans limites ; il avait combattu avec la dernière énergie la motion d’Éphialte, et elle n’avait été adoptée que pendant son absence[48]. Une démocratie sans frein lui semblait plaine de dangers ; il craignait que la multitude, dégagée de toute entrave et libre de tout oser, n’abusât de sa prépondérance numérique pour accaparer la direction de l’état, et que la politique athénienne n’eut dès lors d’autre objet que de satisfaire les passions et les convoitises de la foule. Périclès ne partageait point ces alarmes. Il ne croyait pas que la démocratie fût incapable de se maîtriser elle-même. Pourquoi le peuple n’obéirait-il pas de plein gré à l’autorité d’un chef qui aurait pour lui la raison et l’éloquence ? Et s’il se rencontrait tut homme pareil à Iliaque génération, son action modératrice n’était-elle pas de beaucoup préférable à celle d’un corps tel que l’Aréopage ? Une cité librement soumise à l’ascendant d’un homme supérieur, voilà quel était l’idéal rêvé par Périclès[49]. Son exemple montra qu’il pouvait être réalisé, mais il fut unique dans l’histoire à Athènes. Il fallait, d’après lui, que ce régime eût souci des intérêts de tous, et que les pauvres comme les riches eussent part à ses bienfaits. Il méditait par suite toute une série de mesures, empreintes de ce que nous appellerions le socialisme d’État, et destinées, sous diverses formes, à nourrir, à distraire le peuple aux frais du trésor. Outre qu’elles lui semblaient commandées par la justice, il y trouvait un double avantage : il comptait éviter par ces libéralités les excès ordinaires des démocraties en Grèce, et il espérait de plus fortifier l’attachement des citoyens aux institutions nationales[50]. Mais, pour suffire aux dépenses qu’entraînerait ce système, il était nécessaire d’accroître les ressources financières d’Athènes. On avait à portée une source considérable de revenus ; c’était les tributs des alliés, il s’agissait simplement de les augmenter et d’en acquérir la libre disposition. De là l’obligation de se soustraire à tout contrôle de la part des confédérés, et de les réduire à la condition de sujets. Il est vrai qu’on risquait ainsi d’alourdir le joug jusqu’au point de le rendre odieux ; mais, pensait Périclès, s’il se produisait des résistances ou des défections, il serait facile de les réprimer par la force. Quant à Sparte, il ne redoutait pas es jalousie, toujours prompte à s’éveiller. Une rupture avec elle n’avait rien qui l’effrayât, et il préférait la guerre ouverte à une paix incertaine qui ne durerait que par le perpétuel sacrifice de l’ambition athénienne[51]. Telles furent, dans la première moitié du Ve siècle, les deux politiques en présence. Celle que défendait Cimon triompha jusque vers l’an 460, et l’on a vu de quelle manière elle organisa la ligue de Délos. Mais un jour arriva où Périclès fut à son tour le plus fort, et sa victoire fut consacrée par la sentence d’ostracisme qui en 459 frappa son adversaire[52]. Elle eut pour conséquence immédiate l’abolition du conseil fédéral et la translation à Athènes du trésor de Délos. Après cinq ans d’exil, Cimon fut rappelé et les deux rivaux se rapprochèrent, en se faisant de mutuelles concessions[53]. Mais Cimon mourut en 449 ; Thucydide, qui le remplaça à la tète du parti aristocratique, fut lui-même banni en 444, et Périclès demeura le chef incontesté du gouvernement[54]. C’est alors que l’union de Délos se transforma en un empire étroitement subordonné à Athènes. Les anciens désignaient par deux termes différents les deux périodes de la domination athénienne : ils appelaient la première ήγεμονία, la seconde άρχή. A l’origine, dit Thucydide, les Athéniens avaient l’hégémonie de leurs alliés ; puis leur puissance s’accrut dans l’intervalle qui sépare la guerre actuelle de la guerre médique, et voici comment se constitua leur empire[55]. Il fait alors le récit très succinct de ce demi siècle, et il conclut ainsi : C’est durant ces cinquante années que l’empire d’Athènes se consolida[56]. Ces textes ne prouvent pas seulement que l’empire fut postérieur à l’hégémonie ; ils montrent aussi qu’il marqua pour les alliés un progrès dans la servitude. Tous les documents s’accordent pour nous le présenter comme étant l’œuvre de la violence. Les orateurs, tels qu’Andocide et Isocrate[57], les historiens, tels que Thucydide, portent à cet égard le même jugement. Hermocrate de Syracuse, parlant aux habitants de Camarine, emploie les termes les plus durs pour caractériser la sujétion des alliés : Les Athéniens, dit-il, après avoir été choisis parles Ioniens et les autres alliés pour les conduire contre la Perse, les ont dans la suite asservis sous divers prétextes, si bien que les Grecs n’ont fait en réalité que changer de maîtres[58]. Ce langage sans doute est très naturel de la part d’un ennemi ; mais l’Athénien Euphémos, dans sa réponse à Hermocrate, loin de repousser ces accusations, semble au contraire s’en glorifier ; il avoue que si sa patrie commande aux Grecs des lies, c’est parce qu’elle en a la force et qu’elle y est intéressée[59]. Dans un discours prononcé à Sparte, les Corinthiens comparent Athènes à un tyran qui aurait surgi en Grèce[60], et Périclès répète la même expression : Le pouvoir que vous détenez, dit-il, est celui d’un tyran ; s’il y a eu injustice à s’en emparer, il serait dangereux d’y renoncer[61]. On voit qu’elle était l’étendue des droits qu’Athènes s’arrogeait. Naguère elle avait des alliés elle n’avait plus aujourd’hui que des sujets. Les tributs qu’ils versaient entre ses mains étaient à ses yeux de véritables impôts ; la caisse fédérale n’était qu’une annexe du trésor de l’État ; les mêmes autorités régissaient la république et la ligue ; et la flotte n’était pas moins destinée à exiger des confédérés l’obéissance qu’à les protéger contre les ennemis extérieurs. S’il nous était possible de pénétrer dans le détail des événements qui signalèrent l’histoire de l’empire athénien, nous constaterions sans doute que beaucoup de villes y furent incorporées contre leur gré. Nous eu connaissons quelques exemples ; mais ils furent probablement bien plus nombreux. Cimon arrive devant Phasélis ; les habitants, quoique hellènes, lui ferment leurs portes, et refusent d’abandonner la cause persane ; il attaque aussitôt leurs murailles, les contraint à lui fournir de l’argent, des navires, et les inscrit parmi les alliés[62]. Carystos, en Eubée, voulait conserver son indépendance ; les Athéniens lui déclarent la guerre, et, après sa défaite, elle accède à la ligue[63]. Il y a apparence que quelques-unes au moins de ces cités cariennes, où la population était à moitié barbare et que Cimon dut successivement assiéger[64], n’y entrèrent qu’avec une extrême répugnance, et qu’elles auraient mieux aimé demeurer à l’écart. Mais c’est surtout à l’occasion de Mélos que les prétentions d’Athènes se manifestèrent sous leur jour le plus odieux[65]. Depuis le début de la guerre du Péloponnèse, cette petite lie était neutre. Sommée par les Athéniens de se joindre à eux, elle osa leur résister, et ils expédièrent une escadre contre elle. Les Méliens eurent beau alléguer que leur cité étant une colonie de Lacédémone, il y aurait impiété de leur part à combattre leur métropole ; les chefs ennemis leur opposèrent des raisons tirées toutes du droit du plus fort. Nous sommes ici, dirent-ils, dans l’intérêt de notre empire. Votre désobéissance est d’un mauvais exemple pour nos alliés ; il faut qu’elle cesse. Ne comptez pas sur les secours de Sparte ; l’utile pour elle est la mesure de la justice, et à quoi lui servirait de vous aider ? Les dieux eux-mêmes sont hostiles à votre cause ; car ils veulent que la fort commande au faible. Nous ne faisons rien de plus que de nous conformer à ce principe, et vous agiriez comme nous, si vous aviez notre puissance. Ces arguments ne convainquirent pas les Méliens ; mais ils furent écrasés par le nombre, et ils expièrent cruellement l’audace qu’ils avaient eue de défendre leur liberté. Quand une cité avait été, d’une façon quelconque, introduite dans la ligue, elle n’avait plus le droit d’en sortir. Aristide, au moment où il la fonda, avait lié entre eux les confédérés par les serments les plus solennels. Pour en marquer la perpétuité, on avait jeté dans la mer des morceaux de fer rougis qui ne devaient plus reparaître à la surface, en accompagnant cet acte d’imprécations terribles contre les violateurs du pacte social. Chaque fois qu’une ville adhérait à l’union, elle prenait un engagement analogue. Nous lisons cette phrase dans le serment qui fut prêté par les sénateurs d’Érythrées : Je ne me séparerai pas du peuple d’Athènes ni de ses alliés, et je refuserai de suivre quiconque le fera[66]. Toute infidélité à l’alliance entraînait pour eux, semble-t-il, la peine de mort et la confiscation[67]. Les sénateurs de Colophon jurèrent aussi de ne se séparer des Athéniens, ni en actes, ni en paroles et déclarèrent maudit avec tous les siens celui d’entre eux qui enfreindrait cette promesse[68]. A Chalcis, ce furent tous les habitants qui contractèrent individuellement une obligation pareille. Je ne me séparerai du peuple des Athéniens par aucune ruse ni manœuvre, ni en paroles ni en action, et je n’obéirai point à quiconque se séparerait d’eux ; si quelqu’un pousse à la défection, je le dénoncerai aux Athéniens[69]. Cette pratique fut en somme d’un usage constant[70], et la religion fut toujours appelée à confirmer l’acte par lequel une cité ne rangeait sous l’autorité d’Athènes. Plais, liés ou non par serment, Athènes considérait tous ses sujets comme astreints à une obéissance perpétuelle, et ses ennemis mêmes avouaient que cette prétention était justifiée. Quand Samos se souleva, plusieurs peuples du Péloponnèse étaient d’avis de la soutenir ; les Corinthiens s’y opposèrent en disant que chacun devait être libre de châtier ses alliés rebelles[71]. Athènes ne manqua pas d’appliquer à la lettre cette doctrine. Dans le cours du Ve siècle, les défections furent fréquentes parmi ses sujets ; elle les réprima sans retard, et souvent avec une extrême dureté. Les seuls cas où elle y renonça furent ceux où elle n’en eut pas la force. Il serait hors de propos de raconter ici tous ces événements. Il suffira de dire que jamais Athènes ne voulut reconnaître aux confédérés le droit à l’insurrection. Quelle que fût la cause de leur mécontentement, ils étaient dans leur tort en se révoltant, et elle n’épargnait aucun sacrifice pour les réduire. Les Thasiens résistèrent trois années de suite sans lasser son obstination[72], et la guerre de Samos l’occupa neuf mois sans la décourager[73]. Quand les hostilités avaient cessé, elle ne déterminait pas d’après une règle uniforme la condition des vaincus ; elle s’inspirait surtout des circonstances, qui tantôt commandaient l’indulgence, tantôt la rigueur. Naxos obligée, après un long siège, de capituler, fut asservie[74]. Lors du soulèvement de l’Eubée, le territoire d’Histiœa fut confisqué et distribué à des colons athéniens[75]. On ne toucha pas à celui des autres villes ; mais, si l’on en juge par Chalcis, elles tombèrent dans une dépendance plus étroite[76]. Thasos dut céder ses mines et ses ports de Thrace, démolir ses murailles, livrer ses navires, et payer une grosse somme d’argent, outre le tribut annuel[77]. Samos imita son exemple et subit un sort pareil[78] ; en revanche, Byzance qui s’était déclarée pour Samos, ne vit point sa situation s’aggraver[79]. La défection des Mityléniens fut suivie de cruelles représailles. Quand le peuple athénien eut à se prononcer sur eux, il décida d’abord de tuer tous les hommes faits et de vendre comme esclaves les enfants et les femmes. Mais à peine eut-on envoyé l’ordre d’exécuter la sentence qu’on se repentit de l’avoir votée. Une nouvelle délibération s’engagea le lendemain. Cléon demanda que l’on fût sans pitié et alla jusqu’à prétendre qu’il fallait frapper de mort tout allié infidèle[80]. Diodote réclama un peu de clémence au moins pour les innocents[81]. Son avis prévalut à une faible majorité et le décret de la veille fut annulé. Le châtiment n’en demeura pas moins très sévère. Les murs de Mitylène furent rasés, ses navires saisis et mille de ses citoyens égorgés ; tout le territoire de l’île, sauf celui de Méthymna, fut consacré aux dieux ou réparti entre des colons athéniens, et les anciens possesseurs furent condamnés à la condition de fermiers[82]. — Ainsi les Athéniens n’avaient pas en cette matière de système bien arrêté. Ils se laissaient guider, soit par l’impression du moment, soit par l’idée qu’ils se faisaient de leur intérêt. On peut dire pourtant, d’une façon générale, qu’avant la guerre du Péloponnèse ils avaient coutume d’infliger à chaque cité rebelle une diminution de sa liberté, et que plus tard, toutes les villes étant également sujettes, ils se contentèrent de punir les défections d’une lourde amende[83], sans compter les précautions militaires qu’ils prenaient pour l’avenir. Dans tous les cas, ils n’admirent jamais qu’une cité se détachât de leur empire ou refusât d’y entrer. Leur conduite fut parfois répréhensible ; mais elle s’explique d’elle-même. Les Athéniens considéraient, à cette époque, la domination de la mer Égée comme le fondement de leur grandeur et la garantie de leur sécurité. Cette mer était pour eux un danger ou une protection, selon qu’elle était ouverte ou fermée aux Perses ; elle avait amené les vaisseaux de Xerxès à Salamine et porté ceux d’Athènes à Mycale. C’était donc une grave question que de savoir laquelle des deux flottes serait maîtresse de l’Archipel. La formation de la ligue de Délos l’avait provisoirement résolue en faveur d’Athènes ; mais il était évident que les navires du Grand Roi reparaîtraient du jour où la ligue cesserait d’exister. A supposer que ce péril ne fût pas à redouter, Athènes avait encore d’excellentes raisons pour tenir à son empire. Par la mer Égée, elle se procurait tous les objets de première nécessité que l’Attique ne produisait pas, notamment les bois de Thrace ou de Macédoine et le blé du Pont-Euxin. Tout ce qu’il y avait de bon en Sicile, en Italie, à Chypre, en Égypte, en Lydie, dans le Pont, dans le Péloponnèse ou ailleurs, lui arrivait par cette voie[84]. Le bien-être de ses habitants en était accru et son commerce y gagnait. Récemment encore elle avait à cet égard de nombreux rivaux, dont quelques-uns même la dépassaient[85] ; aujourd’hui elle n’en voyait plus autour d’elle, et le Pirée était le marché principal de la Grèce. L’auteur de l’écrit intitulé Άθηναίων πολιτεία fait clairement ressortir tous ces avantages. Les Athéniens, dit-il, sont les seuls qui puissent acquérir la richesse. Si une ville est riche en bois de constructions maritimes, il lui sera, impossible de les vendre sans s’être assuré l’amitié de ceux qui commandent la mer ; de même, si elle est riche en fer, en airain, en lin. Mais nous, c’est de ces villes que nous tirons nos navires ; car l’une nous fournit le bois, l’autre le fer ou l’airain, celle-là le lin, celle-ci la cire. Si notre territoire ne nous donne rien de tout cela, la mer nous le donne sans peine, en quoi nous sommes mieux favorisés que les villes étrangères, à qui leur sol ne fournit pas tout ce dont elles ont besoin[86]. Enfin le tribut annuel alimentait le trésor d’Athènes et entretenait sa prospérité financière. C’était là, de l’aveu de ses amis comme de ses ennemis, le plus clair de ses revenus[87]. Or, depuis la suppression du conseil, elle disposait de cet argent à sa guise. Pourvu qu’elle s’acquittât en conscience de l’office pour lequel ces taxes avaient été instituées, elle n’avait à rendre compte de sa gestion à personne. Cette règle, établie par Périclès[88], était fort commode ; elle permettait aux Athéniens de détourner de leur but véritable une partie des recettes fédérales et de les appliquer aux dépenses de leur coûteuse démocratie. Assurément leur puissance avait pour tous les Grecs son utilité, puisque ceux-ci lui devaient de n’être plus inquiétés par la Perse. C’est même là-dessus qu’Athènes se fondait pour dénier aux villes de l’Archipel le droit, non seulement de lui être hostiles, mais encore de s’enfermer dans la neutralité. Elle prétendait, avec quelque raison, que toutes ayant le bénéfice de la sécurité, toutes aussi étaient obligées d’en supporter les frais. Mais avant tout elle s’inspirait du soin de son propre intérêt. La plupart de ses orateurs, Périclès en tête, ne cessent de répéter que la force et la richesse d’Athènes proviennent des tributs qu’on lui paie ; c’en est assez pour qu’ils conseillent au peuple de bien garder en main ses alliés[89]. Tout le discours de Cléon dans l’affaire de Mitylène roule sur cette idée que l’empire athénien est odieux à ceux qui obéissent, mais profitable à la cité qui commande, et qu’il faut, sous peine de décadence, employer la terreur pour le maintenir. Diodote, qui défend contre lui une opinion plus modérée, est au fond d’accord avec son adversaire sur la question de principe[90]. Périclès lui-même, malgré la générosité de son caractère, partage ce sentiment. Il place en première ligne la domination de la mer, il en fait le pivot de la politique athénienne, il concentre vers cet objet la meilleure partie des ressources de la république et il exige que les alliés la secondent de leur mieux. Entre eux et la métropole, il n’aperçoit pas, à vrai dire, d’antagonisme réel d’intérêts, il croit, de bonne foi, que la grandeur de l’une n’exclut pas la prospérité des autres ; mais il n’est nullement disposé à sacrifier jamais Athènes aux confédérés[91]. Par un étrange abus, plus facile à comprendre qu’à justifier, les Athéniens avaient complètement modifié la nature de leurs rapports avec les états de la ligue. Cela ne s’était pas fait d’un seul coup, ni par une altération brusque de l’organisation primitive, mais plutôt par une série d’empiètements consentis, tolérés ou subis. Jadis elle était à peu prés leur égale et elle ne leur demandait que d’associer leurs efforts aux siens pour combattre un ennemi commun. Actuellement, elle exerçait sur eux une véritable souveraineté, elle les gouvernait à sa guise, elle mettait à contribution leur sang et leur argent pour son avantage plus encore que pour le leur, elle les exploitait comme un pays conquis, et leur asservissement était la condition même de la puissance à laquelle elle ne voulait ni ne pouvait renoncer. III — Gouvernement intérieur des villes. Parmi les alliés d’Athènes, on distinguait les villes autonomes, et celles qui l’étaient pas[92]. Dans les idées grecques, l’autonomie ne désignait pas l’indépendance absolue ; elle se conciliait fort bien avec l’obligation de subir l’hégémonie d’autrui, et même de payer tribut ; elle était donc compatible avec un certain degré de sujétion[93]. Ce qui en faisait l’essence, c’était, comme l’indique l’étymologie, le droit de n’obéir qu’à ses propres lois, aux lois que la cité elle-même s’était données, le droit d’établir chez soi le gouvernement qu’on voulait, le droit de ne point reconnaître d’autre autorité locale que celle des magistrats qu’on avait élus. La liberté individuelle, en pareil cas, importait peu ; une ville pouvait être opprimée par un tyran ou par une faction, sans cesser d’être autonome. Mais il fallait que ce tyran ne lui fût pas imposé par l’étranger, que cette faction ne tirât point sa force d’un appui effectif venu du dehors. En un mot, l’autonomie d’un état hellénique prenait fin du jour où se manifestait l’ingérence régulière d’un état voisin dans ses affaires intérieures[94]. A l’origine, la ligue de Délos ne renfermait dans son sein que des cités autonomes. Il n’en fut plus de même au bout de quelque temps. Dès l’année 467, Naxos perdit son indépendance. Ce fut, dit Thucydide, la première ville que les Athéniens asservirent, puis cela arriva à beaucoup d’autres[95]. Un châtiment analogue fut infligé à Thasos en 462, aux cités de l’Eubée, spécialement à Chalcis, en 446, à Samos en 439, si bien qu’au début de la guerre avec Sparte, deux états seulement, Chio et Mitylène, avaient encore leur autonomie[96]. Elle fut même enlevée plus tard à l’île entière de Mitylène, sauf Méthymna[97]. Dans les villes non autonomes, le régime dominant était la démocratie. On sait qu’en Grèce rien ne contribuait autant que la similitude des institutions à unir deux peuples. Dans les luttes que les factions se livraient entre elles, chacune cherchait au dehors une assistance, tout au moins morale, et se montrait favorable à Athènes ou à Sparte, suivant ses préférences politiques. Les Argiens se prononcèrent pour l’alliance d’Athènes, parce que cette ville avait, comme la leur, un régime populaire[98]. Pendant la guerre du Péloponnèse, tout le corps hellénique fut troublé ; partout les chefs de la démocratie appelaient les Athéniens, et ceux de l’oligarchie les Lacédémoniens[99]. Il n’y a point de ville, disait un orateur, où la plèbe ne soit pour Athènes, et c’est malgré la plèbe que les défections se produisent[100]. Alcibiade, sous le coup d’une accusation capitale, est contraint de s’exiler, et se réfugie à Sparte : pour se faire bien accueillir, il déclare qu’il a toujours été hostile à la démocratie[101]. Au moment de l’expédition de Sicile, Syracuse était aux mains du parti populaire ; aussi ne voulait-elle pas croire que les Athéniens approchassent ; la nouvelle ayant été confirmée, une révolution éclate, et les aristocrates s’emparent du pouvoir[102]. En 412, cinq navires péloponnésiens se présentent devant Chio ; la foule est aussitôt dans l’étonnement et l’épouvante ; ses adversaires en profitent pour ouvrir le port à l’ennemi[103]. Il n’est pas rare, remarque Aristote, qu’un régime soit supprimé par une influence extérieure. Cela se vit souvent à l’époque où les Athéniens et les Lacédémoniens avaient la prépondérance en Grèce. Les premiers détruisaient partout les oligarchies, les seconds détruisaient les démocraties[104]. On s’explique de la sorte pourquoi toute confédération hellénique, quand elle n’est pu purement religieuse, a toujours une couleur politique. Parmi les états qui ont jusqu’ici possédé l’hégémonie, dit Aristote, chacun a cru qu’il était de son devoir d’amener toutes les villes qui dépendaient de lui à une constitution analogue à la sienne, et qui pour les uns était démocratique, pour les autres oligarchique ; leur but était leur propre avantage, et non celui des villes[105]. Ce fut là, en particulier, la pratique habituelle d’Athènes. Il est vrai que les cités autonomes purent demeurer fidèles à leur vieille organisation aristocratique ; mais on se rappelle combien le nombre en était réduit. Il est vrai aussi qu’un traité conclu avec Selymbria en 409 laissa aux habitants la liberté de se donner le gouvernement qu’il leur plairait[106] ; mais Athènes n’était plus alors en situation de commander, et sa faiblesse la condamnait à faire des concessions qu’auparavant elle eût refusées. Sauf ces exceptions, trop rares pour entrer sérieusement en ligne de compte, elle favorisa de son mieux la domination des classes inférieures dans toutes les villes de la ligue. Nous avons établi chez les autres, dit Isocrate, le système de gouvernement que nous avions chez nous[107]. Nos pères, écrivait-il quarante ans plus tard[108], persuadèrent aux alliés d’adopter la démocratie, car c’est une marque d’amitié que de communiquer à autrui les bienfaits d’une institution, dont on n’a soi-même qu’à se louer. Il va jusqu’à soutenir que, si les alliés offrirent à Athènes l’empire de la mer, ce fut pour échapper à l’oligarchie[109]. Cette dernière assertion ne doit pas être prise évidemment au pied de la lettre, bien qu’on puisse prétendre que l’empire d’Athènes fut, à certains égards, une coalition générale des démocraties helléniques contre le régime opposé. Quand l’île de Samos était encore aux mains de l’aristocratie, la faction contraire sollicita l’appui des Athéniens. Ils s’empressèrent d’envoyer à son aide une flotte de quarante vaisseaux, et la démocratie l’emporta. Elle fut aussitôt renversée par les oligarques, mais leur succès ne servit qu’à provoquer une seconde expédition de Périclès, et celui-ci ne se retira qu’après avoir restauré le régime populaire[110]. Ce régime ayant succombé dans la suite[111], Athènes encourage une sédition de la plèbe qui réussit ; deux cents riches sont frappés de mort, quatre cents exilés ; leurs terres, leurs maisons sont confisquées, et les Athéniens, sûrs désormais de la fidélité des Samiens, leur accordent l’autonomie[112]. Dans l’opuscule qui traite du Gouvernement d’Athènes, il est vaguement question de quelques troubles survenus à Milet[113]. Ces désordres amenèrent, semble-t-il, l’intervention des Athéniens, comme l’atteste une inscription que M. Kirchhoff date des années 450-446[114]. Le texte est malheureusement trop mutilé pour nous renseigner sur ce qu’ils y firent. Nul doute pourtant que leur ingérence n’ait eu pour effet de modifier la constitution de la république dans le sens de la démocratie[115]. Un changement pareil eut lieu en Eubée vers 446, puisque la classe riche des Hippobotes y fut dépouillée même de ses biens fonciers[116]. Dans la dernière période de la guerre du Péloponnèse, la démocratie se trouvait en possession ‘des villes de l’Archipel, et l’on devine qu’elle se maintenait surtout par la protection d’Athènes ; car, du jour où Athènes, affaiblie par les désastres de Sicile et par ses discordes civiles, n’eut plus la force ni la volonté de l’appuyer, elle disparut presque partout[117]. On se figure volontiers, disait un écrivain du temps, que les Athéniens ont tort de faire cause commune avec les basses classes des cités étrangères. Mais, s’ils recherchaient l’amitié des classes élevées, ils rechercheraient l’amitié de gens qui ne partagent en rien leurs sentiments. Chaque fois qu’ils l’ont essayé, cela ne leur a guère réussi. Ils préfèrent donc se rapprocher de ceux qui leur ressemblent ; car là seulement ils rencontrent quelques sympathies[118]. Un précieux document nous permet de toucher, pour ainsi dire du doigt, l’action d’Athènes sur l’organisation politique des villes sujettes. Érythrées, par son influence peut-être, avait passé de l’oligarchie à la démocratie. Elle signa aussitôt un traité avec Athènes pour renouveler son adhésion à la ligue[119]. Il eût été naturel que ce traité ne renfermât que les conditions mêmes de l’alliance. On y lit en effet le texte du serment qui fut prescrit aux sénateurs d’Érythrées, et qui contient, en particulier, l’engagement quelque peu déplacé ici d’administrer les affaires de la cité avec toute la sagesse et toute la justice possibles[120]. Mais il y a dans ce texte bien d’autres détails, qui paraissent étrangers à l’objet de la convention, il nous atteste en réalité qu’Athènes avait rédigé elle-même la constitution de la ville et qu’elle la prenait sous sa garantie. On y constate qu’elle avait envoyé à Érythrées des agents appelés άπίσκοποι et un officier appelé φρούραρχος, sans doute avec un petit corps de troupes. Ceux-ci avaient formé par la voie du sort un conseil intérimaire, dont le rôle fut probablement de s’entendre avec eux pour la mise en train du régime nouveau. On décida qu’il y aurait à la tête de l’État un sénat annuel, que les membres, au nombre de cent vingt, seraient tirés au sort sous le contrôle du φρούραρχος, qu’ils devraient avoir trente ans au moins et subir l’examen préalable de la δοκιμασία, que tout individu indûment admis dans le Conseil perdrait pendant quatre ans le droit d’y siéger. On menaça de la peine de mort quiconque livrerait la ville aux tyrans, et tout cela fut écrit dans le traité. A vrai dire, Athènes, par cette convention, dicte aux Érythréens, en s’inspirant de ses propres lois, la constitution qui désormais fonctionnera chez eux, et s’oblige à la défendre contre le parti oligarchique. Ce n’est pas là d’ailleurs le seul cas où ce fait se soit produit. Un fragment d’inscription, où quelques mots à peine se laissent déchiffrer, donne à penser que vers la même époque il en advint à Colophon comme à Érythrées[121]. A côté des magistrats indigènes, les textes anciens nous signalent dans les villes alliées la présence de certains magistrats athéniens. Tels sont par exemple les Έπίσκοποι que nous avons vus à Érythrées. Le rôle de ces derniers n’est pas facile à déterminer. Les lexicographes en parlent, mais d’une manière un peu vague. Harpocration[122] cite un passage de Lysias où l’on nous apprend qu’ils se rendaient dans les villes sujettes, pour les inspecter. Suidas et les Anecdota de Bekker répètent la même chose[123]. Il semble, d’après Aristophane, que ces agents fussent désignés par le sort et payés par la ville où ils allaient remplir leurs fonctions[124]. On ignore s’ils y séjournaient longtemps, ou s’ils ne faisaient qu’y passer. La seconde hypothèse est pourtant plus probable, si l’on réfléchit qu’à Érythrées le sénat provisoire fut seul nommé par les έπίσκοποι, et que cette prérogative devait appartenir dans la suite au φρούραρχος. Théophraste[125] les compare aux harmostes spartiates ; mais, tandis que ceux-ci réunissaient dans leurs mains l’autorité civile et militaire, les premiers n’étaient que des commandants de troupes ; l’inscription d’Érythrées les distingue du φρούραρχος, et Théophraste ne les confond pas avec les φύλακες. On leur attribue d’ordinaire un droit de juridiction ; mais la chose n’est pas prouvée. Ils étaient enfin protégés par le privilège de l’inviolabilité[126]. Il faut, en somme, les considérer comme des commissaires extraordinaires, institués à l’effet de rétablir l’ordre dans une cité troublée, de châtier les auteurs d’une révolte, de procéder à une enquête, d’organiser un régime nouveau. Ce n’était pas des magistrats installés à demeure ; ils n’apparaissaient que dans des circonstances exceptionnelles, et, la crise terminée, ils se retiraient. Il était de même probablement de ceux qu’on appelait κρυπτοί, sorte de police secrète chargée d’espionner et de dénoncer les manœuvres des alliés[127]. Un devoir analogue incombait aux proxènes ; c’est par eux qu’Athènes fut informée de la prochaine défection des Mityléniens[128]. Peut-être y avait-il encore d’autres agents ou magistrats athéniens dans les villes sujettes ; mais il n’en est fait mention ni dans les inscriptions, ni dans les auteurs ; car il est à peu près certain que le Ψηρισμαατοπώλης des Oiseaux d’Aristophane[129] est une pure invention du poète ou un personnage dépourvu de tout caractère officiel. On a cru qu’il existait dans les cités de la confédération des fonctionnaires envoyés d’Athènes et désignés par le nom d’Archontes. Mais ce terme s’applique dans les documents ou bien aux archontes athéniens, ou bien à l’ensemble des agents qu’Athènes expédiait dans les différentes parties de son empire. Il a sans doute le premier sens dans une inscription relative à Milet[130], et il a, suivant toute apparence, le second dans deux passages de Thucydide et d’Antiphon[131]. Un texte précis d’Aristophane confirme cette opinion. Pisthetœros vient d’expulser de Néphélococcygie l’Έπίσκοπος, et celui-ci l’a menacé d’une accusation pour violences. Le législateur récite aussitôt la loi qui le condamne : Si quelqu’un chasse les magistrats, et refuse, malgré les traités, de les accueillir dans la ville....[132] Il dit τούς άρχοντας ; l’Έπίσκοπος est donc un de ces derniers, et il ne s’en distingue que dans la mesure où le particulier se distingue du général[133]. Il n’était pas rare qu’une ville alliée eût dans ses murs une garnison athénienne. Mais il ne semble pas que ce fût la règle ordinaire. Si l’on examine les circonstances qui accompagnent habituellement un fait pareil, on s’aperçoit que la précaution avait été rendue nécessaire par quelque défection ou par quelque menace extérieure. En temps normal, Athènes gardait ses trières et ses soldats chez elle, d’autant plus qu’en disséminant ses forces sans motif, elle les eut trop affaiblies. Lorsque Érythrées se constitua en démocratie, un φρούραρχος athénien se transporta dans la ville avec des troupes et y resta, mais ce fut pour protéger le parti qui s’était emparé du pouvoir et pour surveiller une faction amie de la Perse[134]. Une raison analogue maintint à Milet la garnison que les Athéniens avaient été obligés d’y envoyer vers 450[135]. Ils laissèrent un détachement à Samos, mais à la suite d’une révolte de l’île ; encore n’est-il pas sûr qu’il y ait séjourné longtemps[136]. De même, quand l’insurrection de l’Eubée eut été réprimée par Périclès, les stratèges reçurent l’ordre d’y organiser de leur mieux l’occupation athénienne[137] ; on conçoit qu’il y aurait eu imprudence à évacuer trop vite la contrée. Le droit qu’avait Athènes d’imposer ses garnisons aux cités sujettes ne fut jamais contesté ; mais elle n’en usait que si un intérêt pressant l’exigeait. Quand la guerre contre Sparte commença, elle n’avait de soldats presque nulle part, et il lui fallut en diriger immédiatement dans tous les sens[138]. Elle en entretint dés lors, au moins d’une façon intermittente, dans les villes d’une fidélité douteuse, dans celles qui avaient une grande importance stratégique, dans celles surtout que l’ennemi menaçait plus particulièrement[139]. Ces corps de troupes étaient logés, payés et nourris par la ville où ils se trouvaient cantonnés[140], et leurs chefs étaient parfois investis d’une certaine autorité politique[141] ; c’était apparemment dans le cas où le commandant militaire était l’unique représentant d’Athènes dans la cité. En somme, ces garnisons, si elles étaient le signe visible de la domination athénienne, n’en étaient pas la cause véritable. Athènes n’avait recours à la force armée que pour défendre l’intégrité de son empire. Ce qui faisait sa puissance dans la confédération, c’était l’alliance qu’elle avait su nouer avec le parti démocratique dans toutes les villes[142], et la prépondérance que partout elle lui assurait. IV — Justice. Les crimes et délits dont les alliés se rendaient coupables envers la communauté étaient à l’origine jugés par le conseil de la ligue. Quand le conseil n’exista plus, l’autorité suprême de la confédération fut le peuple athénien, et c’est lui qui fut dés lors saisi de tous ces procès. Sa juridiction s’exerçait à cet égard de deux manières. Il pouvait, réuni dans l’ecclésia, décider que tel châtiment serait infligé à une cité entière ; c’est par exemple ce qui eut lieu dans l’affaire de Mitylène, et en ce cas la sentence avait surtout un caractère politique. Il pouvait encore, réparti entre les différentes sections de l’Héliée, frapper des particuliers pour des actes purement individuels ; alors seulement il faisait couvre de juge[143]. Nous connaissons par les documents quelques-uns des crimes d’ordre public qui tombaient sous le coup de la répression des héliastes. On y voit mentionnées expressément la connivence avec l’ennemi[144], la trahison[145], les manœuvres ayant pour objet d’empêcher le paiement du tribut[146]. On doit y rattacher sans doute le refus d’aller à l’armée, la désertion, la lâcheté manifeste, la défection accomplie ou tentée, bref toute violation du pacte fédéral[147]. Comme la plupart des cités étaient liées à Athènes par un traité conclu sous la foi du serment, il suffisait d’en enfreindre une clause pour attirer sur soi la colère des tribunaux athéniens. Or ces sortes de traités étaient nécessairement rédigés en termes assez vagues. Je serai, le plus possible, promirent les Chalcidiens, un très bon et très fidèle allié ; je me porterai au secours et à la défense du peuple athénien, si quelqu’un lui fait tort, et j’obéirai au peuple athénien. Pour que nul n’en ignorât, ce serment fut imposé à tous les habitants en âge de puberté. Si quelqu’un, dit le décret, ne le prête pas, il perdra ses droits de citoyen, et ses biens seront confisqués ; le dixième en sera consacré à Zeus Olympien[148]. Une ambassade athénienne se rendra à Chalcis pour faire prêter le serment avec l’assistance des commissaires de cette ville, et elle dressera la liste des Chalcidiens assermentés[149]. Ainsi, ce n’était pas seulement les pouvoirs publics de Chalcis qui étaient tenus de respecter les intérêts de la confédération et les prérogatives d’Athènes. Chaque citoyen contractait, pour son compte personnel, la même obligation ; et, s’il négligeait de remplir son devoir, il était responsable de sa conduite devant les héliastes. Tout Athénien avait la faculté de lui intenter de ce chef une accusation et la plainte une fois déposée, un huissier le citait à comparaître[150]. Il est probable qu’à moins de stipulations contraires, c’était la législation pénale d’Athènes que les héliastes appliquaient aux coupables, et l’on sait qu’elle était souvent impitoyable, surtout si la sûreté de l’État était en jeu[151]. Quand la ville de Chalcis rentra de force dans la ligue, les héliastes jurèrent le serment suivant, qui montre combien leur droit de juridiction était étendu : Je ne chasserai point les Chalcidiens de Chalcis, et je ne détruirai pas leur ville ; je ne prononcerai contre aucun particulier ni la dégradation, ni l’exil, je ne priverai de la liberté, je ne condamnerai ni à la mort, ni à la confiscation aucun d’eux, sans l’avoir entendu, sauf décision contraire du peuple athénien[152]. Un jugement régulier pouvait donc infliger toutes ces peines. En ce qui touche les procès d’ordre privé, qu’il s’agit d’une affaire civile ou criminelle, les Athéniens jugeaient leurs sujets άπό συμβόλων, c’est-à-dire d’après certaines conventions[153]. Aucune n’est parvenue jusqu’à nous dans son texte intégral. Mais on en devine aisément l’esprit, étant donné qu’Athènes était en situation de faire la loi à ses alliés. On en retrouve même quelques traces, surtout dans les documents épigraphiques, et il est possible, à l’aide de ces indices, si incomplets qu’ils soient, d’en fixer les traits essentiels[154]. Un Athénien venait-il à commettre un crime dans les villes alliées ? Nous ignorons s’il était justiciable des tribunaux locaux ou si sa cause était forcément évoquée à ceux d’Athènes. Le pire qui pût lui arriver était d’être traduit devant les premiers ; mais on verra tout à l’heure combien leur compétence était restreinte, même à l’égard des individus du pays. Elle ne l’était guère moins en matière civile. Les Athéniens, soit domiciliés, soit de passage dans une ville sujette, n’avaient donc qu’un médiocre intérêt à se soustraire à leur juridiction. On serait tenté à priori de penser qu’ils s’y soumettaient dans les procès où le plaideur indigène avait la qualité de défendeur. Mais un texte digne de foi semble démontrer le contraire[155], et il est à peu près certain qu’Athènes se réservait le jugement de toutes les affaires civiles ou criminelles qui concernaient un des siens. Les alliés en résidence habituelle ou momentanée à Athènes étaient évidemment jugés par les tribunaux de la ville. Mais rien n’indique si tous leurs procès étaient introduits devant le polémarque[156] juge ordinaire des étrangers[157], ou bien s’ils suivaient, comme il est plus probable, les règles du droit commun. Quand une affaire mettait aux prises, hors du territoire athénien, deux alliés, voici comment l’on procédait. Au criminel, l’instruction se faisait sur place. On n’a, pour s’en convaincre, qu’à lire le discours d’Antiphon sur le Meurtre d’Hérode ; c’est à Mitylène que l’enquête a lieu, c’est là qu’on interroge les témoins, c’est là qu’on cherche à se procurer, même par la torture, des preuves suffisantes. Mais on remarquera que cette instruction n’a pas de caractère officiel ; elle est l’œuvre exclusive des parents du défunt. C’est par eux que sera intentée et soutenue l’accusation ; c’est donc à eux qu’incombe le soin d’en réunir les éléments[158]. Quant à l’opération appelée άνάκρισις, la seule qui donnât à l’instruction une valeur légale, elle était réservée au magistrat qui devait prononcer la sentence[159]. - La pénalité était déterminée par la nature du délit. La législation athénienne distinguait, même parmi les crimes qui n’avaient rien de politique, ceux qui étaient censés léser la société tout entière et ceux qui ne lésaient que les intérêts des particuliers ; les premiers étaient désignés sous le nom de γραφαί, les seconds sous le nom de δίκαι. A la catégorie des γραφαί se rattachaient l’homicide volontaire ou par imprudence, les coups et blessures, l’incendie, l’atteinte à la liberté individuelle, l’adultère, l’immoralité, l’impiété, l’injure grave, le célibat, l’oisiveté, le bris de scellés, le changement arbitraire de nom, le faux, le refus de témoigner en justice[160]. Les autres délits rentraient, pour la plupart, dans la catégorie des δίκαι, sans qu’il y eût cependant entre ceux-ci et ceux-là une ligne de démarcation bien nette[161]. Dans les deux cas, la répression n’était pas la même. Les δίκαι entraînaient généralement une condamnation à l’amende ; le coupable n’ayant de torts qu’envers le plaignant les réparait par le paiement d’une indemnité pécuniaire[162]. Pour les γραφαί, une amende était souvent infligée au profit de l’État, et elle allait parfois jusqu’à la confiscation des biens ; mais comme il s’agissait surtout de venger la société et de répandre une terreur salutaire, on y joignait volontiers des châtiments plus rigoureux, tels que l’atimie, l’emprisonnement, l’exil, la mort[163]. Ces principes furent appliqués aux alliés comme ils l’étaient déjà aux citoyens d’Athènes. Les 6ixat, c’est-à-dire les crimes et délits passibles d’une simple amende, furent abandonnés à la juridiction des magistrats municipaux, parce que les particuliers étaient seuls intéressés à leur répression, et l’on attribua les γραφαί aux tribunaux athéniens parce qu’il semblait que l’empire entier en eût ressenti les effets. Il n’est pas sûr qu’une distinction de ce genre ait été formulée dans une ligne trop vague de l’inscription de Milet[164]. Elle ressort, en tout cas, avec une entière clarté, de deux passages de l’inscription de Chalcis, dont l’un tout au moins ne laisse place à aucune équivoque[165]. Antiphon affirme que nulle ville alliée n’a le droit de frapper qui que ce soit d’une sentence capitale[166]. Enfin Chamœléon du Pont raconte qu’un auteur célèbre de parodies, Hégémon de Thasos, fut traduit en justice pour un fait qu’il ne spécifie pas, mais qui était peut-être un γραψή ΰόρεως ; le délit en somme était grave, puisque l’accusé ne fut sauvé que par l’intervention d’Alcibiade ; or, le procès se déroula à Athènes, et non pas à Thasos[167]. Lee choses se passaient-elles au civil comme au criminel ? Y avait-il également en cette matière une distinction formelle entre les causes importantes et celles qui l’étaient moins, les premières toujours jugées par les Athéniens, les secondes livrées à la justice indigène ? Dans un texte épigraphique, il est question de certains procès qui de Milet étaient envoyés à Athènes, et l’on voit par diverses allusions à des détails de procédure que c’étaient des procès civils[168]. D’une expression tirée du même document on a conclu que les magistrats des alliés ne jugeaient les affaires civiles que jusqu’à concurrence de cent drachmes, et qu’au-dessus de ce chiffre elles rentraient dans la compétence des héliastes[169]. Mais le texte qu’on allègue est loin de justifier cette assertion. Le plus sage est de dire simplement, et sans préciser davantage, que quelques procès civils, sinon tous, venaient du dehors aboutir à Athènes. Nous avons en effet la preuve que le salaire des jurés était en partie fourni par les prytanies des alliés[170], et l’on appelait prytanies les sommes que chaque plaideur devait consigner au préalable dans tout procès civil[171]. C’est une erreur de croire, comme on l’a quelquefois prétendu, que les causes des alliés fussent évoquées devant des magistrats spéciaux, nommés Έπιμεληταί tout court, et chargés à la fois de l’instruction de l’affaire et de la direction des débats[172]. Il est vrai qu’un décret du sénat et du peuple parle des Έπιμεληταί qui, dans le délai d’un mois, auront à saisir le tribunal compétent de toute plainte déposée contre un allié qui aura mis obstacle à la perception du tribut[173], et l’on sait que, d’après les règles du droit attique, le magistrat qui saisissait le tribunal était le même qui procédait à l’instruction et qui ensuite présidait le jury[174]. Mais ces Έπιμεληταί sont des fonctionnaires financiers, investis, dans les limites de leurs attributions, d’une certaine autorité judiciaire, comme le voulait un usage constant à Athènes[175]. Quant aux Έπιμεληταί mentionnés dans le discours d’Antiphon pour Hélos[176], on voit facilement que ce sont les Έπιμεληταί τών κακούργων, en d’autres termes les Onze. Le même mot se retrouve encore dans l’inscription de Milet, mais absolument isolé[177]. En somme, ces trois textes, les seuls qui on invoque, ne confirment nullement l’hypothèse énoncée plus haut. Est-ce à dire que les arecs incorporés à l’empire fussent traduits devant les juridictions de droit commun ? Dans ce cas, il fauterait faire exception au moins pour le crime d’homicide ; car la Mitylénien accusé du crime d’Hérode ne fut pas jugé par l’Aréopage[178]. S’il était permis en cette matière obscure de remplacer par une conjecture la certitude qui nous échappe, on serait tenté d’admettre que la juridiction habituelle des alliés, au civil et au criminel, était celle des thesmothètes. Mais comme cette opinion ne se fonde que sur des raisons d’une valeur contestable[179], je n’insiste pas. L’essentiel est de nous rappeler que les alliés n’étaient justiciables que des héliastes ; quant au nom des tribunaux et des magistrats qui les présidaient, il est moins utile de le connaître. De tout ce qui précède, il résulte que les alliés étaient rarement jugés par leurs propres tribunaux, et jamais pour leste affaires graves. La justice ordinaire était pour eux celle du jury athénien. Athènes les traitait comme s’ils eussent fait partie de la cité, sauf sur un point d’une importance extrême ; elle leur imposait sa législation civile, sa procédure, sa pénalité ; elle leur imposait aussi ses juges. Quand ils avaient un procès à soutenir, les Athéniens comparaissaient devant leurs égaux ; les alliés comparaissaient devant des étrangers, devant des ma Ires. C’est par là peut-être que se marquait le mieux leur sujétion ; c’est par là qu’Athènes manifestait le plus nettement sa souveraineté. Isocrate, comparant la conduite d’Athènes avec celle de Sparte, s’écriait : Les Lacédémoniens ont tué plus de Grecs sans jugement que nous n’en avons jugés depuis l’origine de notre ville[180]. Le caractère insolite de la domination d’Athènes venait précisément de ce que les condamnations prononcées par eux, au lieu d’être l’œuvre avouée de la violence, étaient reconnues officiellement comme juridiques et légales. Un pareil système ne pouvait évidemment engendrer une justice impartiale. Les héliastes n’avaient pas la sérénité d’esprit qu’on attend et qu’on exige d’un magistrat de profession. Leurs haines, leurs rancunes, leurs préférences, leurs passions en un mot les suivaient sur leurs sièges, parfois au grand dommage de l’équité. Ils y apportaient le mépris ordinaire de l’Athénien pour ses sujets, la jalousie du pauvre ou de l’homme de fortune médiocre contre le riche, l’antipathie du démocrate contre l’aristocrate, enfin l’avidité naturelle à des gens qui vivaient des procès d’autrui. Il y avait bien là de quoi troubler la conscience et fausser le jugement de ces petits bourgeois qui remplissaient les sections de l’héliée. Le mal était déjà visible, quand des Athéniens seuls étaient en cause ; il devait être plus grave encore, quand les plaideurs étaient, soit deux étrangers, soit un Athénien et un étranger. Des considérations qui n’avaient rien de commun avec l’affaire pesaient alors sur l’esprit du juge et lui dictaient sa sentence[181]. Il appréciait les choses autant d’après des raisons extrinsèques que d’après les éléments mêmes du procès. Quiconque n’était pas citoyen, quiconque était soupçonné de sentiments aristocratiques avait chance à priori d’être condamné, et il fallait que son droit fût bien évident pour qu’on le reconnut. Ainsi entendue, la justice n’était plus qu’un moyen de propagande démocratique et un instrument de domination. Parmi les alliés, dit un pamphlet du temps, les riches sont frappés d’atimie, de confiscation, d’exil, de mort, et les pauvres sont épargnés. Si les Athéniens les obligent à se rendre ici pour les jugements, c’est parce qu’ils peuvent de la sorte administrer, sans bouger, les villes sujettes, en favorisant dans les tribunaux les partisans du régime populaire, et en écrasant les autres[182]. Était-ce, comme le croit l’auteur de cet écrit, en vertu d’un dessein prémédité qu’on se montrait si injuste, ou simplement par l’effet d’une passion inconsciente ? C’était sans doute pour les deux motifs à la fois, Dans tous les cas, le résultat pour les alliés était le même. Ils n’avaient de justice à espérer des Athéniens, qu’à condition de leur être dévoués. Le moindre souci des héliastes était de respecter les règles de l’équité. Leur grande préoccupation était de défendre les intérêts de leurs concitoyens, et en second lieu de récompenser ou de punir chez leurs sujets l’empressement ou la répugnance à servir. Cette organisation lésait encore les alliés d’une autre manière. Elle permettait de les exploiter au profit de la république et des particuliers. Par là nous ne faisons pas allusion aux sommes d’argent que les Grecs de l’Archipel consacraient à conjurer le courroux des délateurs, et à se ménager les bonnes grâces des orateurs, des membres du sénat, des personnages influents[183]. Tous ces gains étaient illicites, et l’État, s’il les tolérait, du moins ne les autorisait pas. Nous parlons plutôt des bénéfices légitimes que procuraient aux Athéniens l’affluence et le séjour des plaideurs étrangers[184]. Les recettes de la douane du Pirée s’en trouvaient accrues, et le port en avait plus d’activité. A Athènes, les hôtelleries recevaient plus de voyageurs ; les chars, les esclaves de louage rapportaient davantage à leurs maîtres ; tous ces agents subalternes qu’employaient les tribunaux, les huissiers par exemple, étaient plus nombreux et mieux rétribués ; les prytanies alimentaient la caisse d’où les juges tiraient leur μισθός, et ceux-ci n’avaient pas à craindre que leur salaire manquât. Enfin chaque confiscation ordonnée par les héliastes contribuait à enrichir le trésor ; car la métropole en prenait généralement sa part[185]. Athènes, en un mot, battait monnaie avec les procès des alliés, et son droit de juridiction développait ses ressources matérielles, en même temps qu’il attestait sa souveraineté et qu’il fortifiait son empire. V — Service militaire. Deux charges principales pesaient sur les alliés, le service militaire et le tribut. On se rappelle qu’à l’origine, d’après les arrangements pris par Aristide, certaines villes devaient fournir des navires, tandis que d’autres payaient une contribution pécuniaire. Peu à peu le nombre des premières diminua, à mesure que l’autorité d’Athènes faisait des progrès, et un jour vint où il n’y en eut plus que deux, Lesbos et Chio[186]. Les choses en étaient là dès l’époque de la guerre de Samos, c’est-à-dire dés l’année 440. Après la révolte de butylène, Méthymna, qui était demeurée fidèle, fut la seule cité de l’île à qui on laissa ce privilège[187]. Il est vrai que plus tard Samos le recouvra (vers 412), lorsque par un violent effort elle se fut délivrée du régime oligarchique[188]. Comme le tribut était une marque de servitude et l’autonomie un signe de liberté[189], la faveur de substituer des navires au tribut fut réservée aux villes autonomes. Ce n’est pas que ce mode de prestation eût pour effet d’assurer en quoi que ce fût l’indépendance d’une cité. Il l’exemptait simplement d’une obligation qui passait pour être humiliante. On était de la sorte assimilé, du moins en apparence, aux États qui traitaient avec Athènes sur un pied d’égalité. Nous ignorons de quelle manière était déterminé, pour chaque ville autonome, son contingent de navires. Il est probable que le chiffre maximum en était fixé par les traités, et qu’on ne s’en remettait pas à l’arbitraire de la métropole[190]. D’ailleurs, la proportion des trières alliées au chiffre total de la flotte était très variable. Dans l’expédition de Samos, Athènes arma 160 navires, Lesbos et Chio 52[191]. Une flotte conduite par Périclès sur les côtes du Péloponnèse comprenait 100 navires athéniens, et 50 de Lesbos et Chio[192]. Lors de la révolte de Mitylène, 10 navires de cette cité se trouvaient entre les mains des Athéniens[193]. Dans d’autres circonstances, nous voyons mentionner 10 navires de Chio contre 40d’Athènes, 6 de Chio et 2 de Méthymna contre 30[194]. La flotte équipée au moment de l’expédition de Sicile comptait 134 trières, dont 100 athéniennes ; le reste venait en partie seulement de Chio. Un second armement fut envoyé dans la suite : sur 65 navires, il n’y en avait que 5 de Chio[195]. En somme on ne peut déduire de là aucune règle générale. Tout ce qu’il est permis d’affirmer, c’est que les contingents alliés ne dépassèrent jamais le tiers de la flotte fédérale[196]. Ou sait que chaque trière athénienne réclamait, outre un état-major de cinq officiers supérieurs, cent soixante-quatorze rameurs, une vingtaine de matelots destinés à la manœuvre des voiles, et un très petit nombre de soldats combattants, appelés έπιβάται, que l’on choisissait parmi les hoplites[197]. Il en était sans doute à peu près de même pour les trières des villes autonomes. C’était aux alliés qu’incombait le soin de réunir tous ces hommes, sauf peut-être les épibates qui ne faisaient pas proprement partie de l’équipage. Ils avaient au reste le droit de placer sur leurs navires des esclaves et des mercenaires à côté des hommes libres[198], comme Athènes leur en donnait l’exemple[199]. C’est sur eux également que retombaient les frais de nourriture et de solde[200]. Quant au commandement, je présume qu’il était exercé par des officiers indigènes. Xénophon nous atteste même qu’à la bataille des Arginuses les dix navires de Samos obéissaient à un stratège Samien[201]. Les alliés soumis au tribut n’étaient pas pour cela dispensés du service militaire[202]. Chalcis, après la réduction de l’Eubée, ne fut plus autonome ; elle s’engagea pourtant à envoyer des troupes aux Athéniens, chaque fois qu’il serait nécessaire[203]. Une clause pareille figure dans le traité signé vers 409 avec Selymbria[204] ; et de fait on remarque que dans la plupart de leurs expéditions, les Athéniens emmènent des alliés avec eux. Mais ces hommes ne sont jamais des matelots ni des rameurs ; ce sont toujours des hoplites, ou des peltastes, bref des soldats de l’armée de terre. Thucydide, énumérant au début des hostilités les ressources d’Athènes, distingue les villes qui, comme Chio et Lesbos, fournissent des vaisseaux, et celles qui fournissent de l’infanterie et de l’argent[205]. Avant de partir pour la Sicile, Nicias conseille de demander au dehors le plus d’hoplites qu’on pourra, et lorsque la flotte prend la mer à Corcyre, elle porte, sur un chiffre total de 5.100 hoplites, 2.150 alliés[206]. D’après Thucydide, l’armée de Sicile se composait de trois éléments différents : 1° les Athéniens, 2° les Argiens et ceux qui étaient entrés volontairement dans l’alliance, 3° ce que l’auteur appelle τό ύπήκοον τών ξυμμάχων, c’est-à-dire les soldats recrutés chez les villes sujettes[207]. Ailleurs encore, dans le long paragraphe ou il compare les forces respectives d’Athènes et de Syracuse, l’historien range parmi les auxiliaires de la première les équipages de Chio et de Méthymna, et les hoplites d’Eubée, d’Ionie, ainsi que des petites îles de l’Archipel[208]. Les Athéniens paraissent avoir eu à cet égard un droit illimité de réquisition. Le serment des Chalcidiens est rédigé en des termes qui n’impliquent aucune réserve sur ce point. Il leur prescrit de secourir et de défendre le peuple athénien[209], c’est-à-dire toutes les fois que le peuple athénien le jugera à propos ; et l’on peut conjecturer, d’après certains textes de Thucydide[210], qu’on n’avait pas fixé à l’avance le contingent de chaque cité ; pour toutes les villes l’étendue des sacrifices dépendait de l’étendue de leurs ressources et du chiffre de leur population- Cette charge ne pesait pas d’une manière uniforme sur tous les états de l’empire. Même pendant la guerre de Sicile, lorsqu’Athènes aux abois était obligée de mettre en mouvement toutes ses forces militaires, il y eut des villes sujettes dont les soldats ne participèrent pas à la lutte. On comprend en effet qu’il fût presque impossible d’aller chercher, à chaque nouvelle expédition, les contingents des cités perdues dans des contrées lointaines. On réservait ceux-ci pour le cas où l’on avait quelque ennemi à combattre dans leur voisinage[211] ; et en général on préférait s’adresser aux Grecs des îles ou d’Ionie, parce qu’ils étaient plus prés[212]. Autant qu’il est permis d’en juger, la proportion des alliés aux Athéniens était plus considérable dans l’armée de terre que dans l’armée de mer. Trop souvent, il est vrai, les indications de Thucydide à ce sujet manquent de précision ; mais par endroits il cite aussi des chiffres. Il nous dit par exemple, qu’une fois 2.000 hoplites milésiens, sans parler des autres alliés, se joignirent à 2.000 Athéniens pour attaquer Cythère[213]. Quand Cléon partit pour la Thrace, il avait sous ses ordres 1,200 hoplites d’Athènes, 300 cavaliers, et un plus grand nombre d’alliés[214]. Le corps de troupes qui fit l’expédition de Mélos comptait 1.200 hoplites athéniens, 300 archers à pied, 20 à cheval, et près de 1.600 hoplites[215]. On devine, quoique les renseignements soient ici plus vagues, que le second tout au moins des deux armements expédiés en Sicile était en majorité composé de soldats levés hors de la métropole[216]. Peut-être s’éloignerait-on peu de la vérité en disant que les hoplites des alliés entraient pour la moitié au moins dans l’armée fédérale. Je ne connais aucun texte qui montre si leurs officiers étaient des Athéniens ou des nationaux ; j’inclinerais pourtant vers la dernière hypothèse. Dans tous les cas, l’autorité suprême appartenait aux stratèges d’Athènes. A qui revenait l’obligation de nourrir et de payer tous ces hommes ? Je n’imagine pas que ce fût aux alliés eux-mêmes. La solde ordinaire d’un hoplite, nourriture comprise, était d’une drachme par jour ; à quoi il faut ajouter une drachme pour l’ύπηρέτης, qui accompagnait chaque soldat. Si Athènes avait laissé aux villes le soin d’acquitter ces frais, il en serait résulté pour elles des dépenses exorbitantes. Ainsi la seule expédition de Cythère, dont il est parlé au paragraphe précédent, aurait, pour une simple durée d’un mois, coûté vingt talents à Milet, et l’on remarquera que le tribut annuel de cette cité ne fut jamais supérieur à dix talents. Ce fut donc, suivant toute probabilité, la caisse fédérale qui dut pourvoir à l’entretien et à la solde des troupes de terre[217]. On ne s’expliquerait pas sans cela le silence constamment gardé par les sujets d’Athènes sur les charges qu’eut entraînées pour les finances locales leur service dans l’armée, alors qu’on les voit se plaindre si amèrement de la lourdeur des tributs. VI — Tribut. Pour ce qui concerne le tribut, la première question est de savoir quelle autorité taxait les villes alliées. Athènes ayant la direction exclusive de la confédération, D’est à elle, on le conçoit, que ce soin était réservé. Mais il s’opérait à cet égard un partage d’attributions entre les différents pouvoirs de la république. L’assemblée du peuple avait seule qualité pour soumettre une ville au tribut comme pour l’en exempter[218]. Elle décidait également et le chiffre total des tributs serait élevé, et dans quelle proportion[219]. Quant au travail de répartition, il était l’œuvre du sénat[220]. Enfin, si des contestations venaient à surgir, si certaines cités croyaient avoir été imposées d’une façon injuste, l’affaire était portée devant les héliastes qui prononçaient en dernier ressort[221]. L’année financière commençait à l’époque oit se célébraient les grandes Panathénées, c’est-à-dire en juillet[222]. Mais la révision de la liste des tributs n’avait lieu, comme ces fêtes elles-mêmes, que tous les quatre ans. On y procédait d’ordinaire dans la troisième année de chaque olympiade[223]. Du moins il en fut ainsi jusqu’à une date voisine de la guerre du Péloponnèse. A partir de là, on dérogea à cette règle. Nous voyons en effet qu’il y eut une taxation nouvelle, soit dans la deuxième année de la 85e olympiade (439), comme le pense M. Kirchhoff, soit dans la quatrième (431), comme c’est l’opinion de M. Köhler, et la même irrégularité se produisit quelque temps après, en 425 (Ol. 88, 4)[224]. Pour faire ce travail, on tenait compte de deux éléments principaux, les besoins financiers de l’empire et les ressources des alliés. Des premiers, le peuple et le sénat étaient seuls juges ; à eux seuls incombait le devoir d’assurer l’équilibre des recettes et des dépenses par la diminution des unes on l’augmentation des autres ; eux seuls géraient la caisse commune depuis l’abolition de l’assemblée fédérale, et leur indépendance n’avait aucun contrôle à redouter de la part de leurs sujets. Mais en revanche ceux-ci avaient le droit de défendre devant les pouvoirs publics d’Athènes leurs intérêts lésés. Si une cité trouvait que ses contributions étaient troc lourdes, eu égard à ses revenus, ou bien si, satisfaite de sa condition, elle craignait qu’on ne l’aggravât, il lui était loisible de solliciter une réduction ou le maintien du statu quo. L’occasion la plus propice pour réclamer était le moment où le sénat remaniait la liste des tributs ; et je présume que les délégués chargés de représenter les villes du dehors à la fête des Panathénées se chargeaient aussi de porter à Athènes les doléances et les vœux de leurs concitoyens[225]. Dans certaines circonstances, en 425 par exemple, les agents des alliés avaient recours à des manœuvres illicites. Ils achetaient autour d’eux des consciences qui trop souvent ne demandaient qu’à se vendre ; ils corrompaient les magistrats, les orateurs influents, les sénateurs, et parfois on leur donnait gain de cause[226]. Les Athéniens d’ailleurs ne se refusaient pas à tempérer par des faveurs opportunes la rigueur de leurs exigences. Mais, sauf quelques rares exceptions, que justifiaient des moûts sérieux, ils conservèrent toujours intact le privilège d’imposer à leur gré leurs sujets[227]. Quand la répartition était terminée, on envoyait des commissaires pour informer chaque cité de la somme qu’elle avait à verser[228]. A cet effet, on avait divisé l’empire en cinq districts. Ionie, Carie, Hellespont, Thrace, Iles[229] ; et on nommait deux commissaires par district. Les alliés étaient obligés d’acquitter leur tribut aux grandes Dionysies du printemps[230]. Les Hellénotames notaient avec soin les noms des personnes qui apportaient l’argent des villes et leur délivraient quittance[231]. On faisait ensuite le relevé des états qui n’avaient pas payé, et on désignait parmi les citoyens de la première classe des percepteurs, qui allaient recueillir sur place les sommes encore dues[232]. Il n’était pas rare qu’on mît à la disposition de ces fonctionnaires des forces suffisantes pour contraindre les récalcitrants à s’exécuter ; et dans ce cas, la violence répondant à la mauvaise foi, il arrivait fréquemment, surtout si le trésor était en détresse, qu’on exigeât des villes plus qu’il n’avait été d’abord stipulé[233]. Le chiffre des tributs ne demeura pas toujours fixé à un taux uniforme. Nous savons qu’il ne dépassait pas à l’origine 460 talents, que plus tard, sous l’administration de Périclès, il atteignit 600 talents[234], et que finalement il monta à 1.200 ou 1.300[235]. Mais ces renseignements, si précieux qu’ils soient, ne nous apprennent pas grand’chose sur la condition des alliés. Supposez en effet que dans le cours du Ve siècle l’empire d’Athènes eût doublé d’étendue ; la somme totale des tributs aurait pu doubler aussi, sans qu’il en résultât pour les villes tributaires aucune aggravation de charges. L’essentiel serait par conséquent de connaître ce que chaque ville payait aux différentes époques. Heureusement nous possédons quelques textes d’une importance capitale pour cette question. On a découvert dans les ruines de l’Acropole toute une série de plaques de marbre où sont gravées, année par année et cité par cité, les sommes que l’on prélevait pour le compte de la déesse Poliade sur les contributions des alliés ; ces offrandes étaient calculées à raison d’une mine par talent ; on n’a donc qu’à multiplier par 60 les chiffres inscrits sur ces listes, pour reconstituer les chiffres mêmes des tributs. La suite de ces documents commence avec l’année 454 et se continue presque sans interruption jusqu’en 427 ou 426. De plus, pour l’année 425, nous avons les rôles officiels de l’impôt fédéral, tels qu’ils furent dressés par le sénat[236]. Il va sans dire que ces inscriptions sont très incomplètes, qu’elles présentent des lacunes considérables, et que la lecture en est parfois incertaine ; elles jettent néanmoins une lumière assez vive sur l’objet qui nous occupe[237]. M. Kirchhoff divise ainsi l’histoire financière de l’empire athénien, en se fondant sur les modifications que subirent les taxes des alliés[238] :
Si l’on compare les deus premières périodes, on remarque que de l’une à l’autre les chiffres du tribut ont à peine varié. Sur 79 villes, pour lesquelles ils nous sont connus, 62 paient aux deux époques une somme identique. 14 obtiennent les réductions que voici :
Si on néglige, parmi toutes ces villes, celles dont les réductions, au dixième ou à peu près, ne peuvent s’expliquer que par des circonstances exceptionnelles, on voit que ces taxes sont diminuées : une fois de 2/3 et plus, sept fois de ½, trois fois de 1/3. Trois états cependant paient après 450, plus qu’avant. Ce sont :
Mais il est permis de croire avec M. Köhler[239] que la quote-part de Thyssos fut accrue, parce qu’elle avait recouvré quelques possessions jadis perdues, et que Cnide et Mende furent plus fortement imposées, parce qu’on leur avait rattaché, pour la commodité de la perception, un groupe de cités secondaires[240]. L’abaissement des taxes s’accentue encore davantage, si l’on passe à la troisième période. Sur 128 villes, 95 restèrent au taux de la première ou de la seconde période, même quand il avait été déjà réduit en 450. 29 furent sérieusement allégées. En laissant de côté l’ale de Syros, qui offre quelque chose d’anormal[241], on s’aperçoit qu’une ville vit ses contributions diminuées de 1/7 environ, 1 de 1/6 2 de 1/5 1 de ¼ 8 de 1/3 3 de 2/5 6 de ½ 5 de 2/3 1 de ¾. Quatre seulement eurent leurs charges- alourdies
Pour Thasos, la différence provient, d’après Bœckh, de ce qu’Athènes lui restitua une partie de ses anciens établissements du continent[242]. Pour Sermylia, on peut conjecturer avec M. Köhler, que durant la troisième période elle se trouva placée à la tête d’une syntélie[243] ; et, en effet, la première fois, après 446, qu’elle figure sur nos listes, on lit à la suite de son nom κα(ί) συν(τελεΐς)[244]. Quant à Scione et Thrambé, la cause du léger changement qui les atteint nous échappe. En somme, depuis 454 jusqu’à 440, il y eut une tendance constante à réduire les contributions des alliés ; les rares augmentations que nous avons signalées ne sont en définitive qu’apparentes, et les confédérés, au lieu d’être de plus en plus accablés d’impôts, furent ou bien maintenus au même chiffre, ou bien ramenés à un chiffre inférieur[245]. Est-ce à dire que dans cet intervalle les recettes de l’Union aient baissé, au point de descendre au-dessous de 460 talents ? Nullement. D’abord pas un document ne mentionne, même par voie d’allusion, un fait de cette nature, et un pareil silence aurait de quoi surprendre. Puis il ne faut pas demander à nos plaques de marbre plus qu’elles ne peuvent nous donner ; ces listes sont très incomplètes dans leur état actuel ; elles nous permettent de constater les variations qu’ont subies les tributs d’un certain nombre de villes ; elles ne nous disent pas combien l’empire entier payait à chaque période. Si l’on se résigne à n’y chercher que ce qu’elles sont capables de fournir, on remarque qu’il y a eu diminution d’impôts toutes les fois qu’il y a eu changement, et comme, d’autre part, il est avéré qu’Athènes ne cessa pas de percevoir au moins 460 talents, ta conséquence toute naturelle est que les villes tributaires étaient devenues plus nombreuses. Il y eut en effet des alliés, on l’a vu, qui demandèrent de substituer un versement en argent à lotir prestation en navires, et il est probable que la chose ne se fit pas pour tous dès les premières années de la ligue. D’autres furent annexées à l’empire longtemps après qu’il eut été fondé. Nous en avons la preuve pour ces villes du Pont-Euxin et du Bosphore que d’heureuses expéditions rattachèrent à Athènes[246], et il n’est pas douteux qu’une connaissance plus précise de cette histoire nous montrerait qu’elles ne furent pas les seules. De toute façon, la matière imposable gagna en étendue, et, par suite, le contingent de chacun put être un peu moins lourd. Dans la quatrième période, qui commence en 439, les tributs furent, pour la première fois, relevés, mais ce fut dans une proportion moindre qu’on ne se figure d’ordinaire. Parmi les 117 villes, pour lesquelles la comparaison est possible, 78 ne subirent aucune modification. 9 furent taxées plus légèrement[247] ; mais cela semble s’expliquer par des pertes de territoire ; tel est probablement le cas d’Argilos, d’Ainos, de Galopsos, peut-être aussi d’Épine et de Chalcis[248]. Pour une vingtaine de villes, on revint aux chiffres des deux premières périodes ou à un chiffre voisin. 9 seulement payèrent plus qu’elles n’avaient jamais payé ; encore y a-t-il apparence que pour quelques-unes, Maronée entre autres, l’augmentation se justifiait par une extension de leurs possessions[249] ; quant à Byzance, elle fut punie ainsi d’une défection récente[250].
On voit par là que si les tributs postérieurs à 439 diffèrent de ceux de la période précédente, ils ne s’écartent pas sensiblement des chiffres arrêtés en 454 et 450. Ce qui rendit ce changement nécessaire, ce fut, j’imagine, la guerre de Samos. Elle avait coûté au trésor plus de 1.200 talents, peut-être même 2.000[251] ; il fallut réparer en hâte cette brèche, et c’est pour cela que certaines taxes furent haussées. Au fond, les alliés en souffrirent médiocrement ; car on ne toucha pas à la grande majorité d’entre eux ; et les plus maltraités furent en général frappés de l’ancienne contribution. Mais depuis l’année 454, leur nombre s’était tellement accru que ce retour en arrière suffit pour porter les recettes fédérales jusqu’à 600 talents[252]. On en était encore là quand la guerre du Péloponnèse éclata. Au cours des hostilités, en 425, un dernier remaniement eut lieu sur l’initiative de Cléon. Périclès était mort depuis quatre ans, et avec lui avaient disparu ces idées de modération et de sagesse par lesquelles il avait corrigé ce qu’il y avait de dangereux dans son système de gouvernement, tout imprégné des principes du socialisme d’État. La démocratie athénienne, arrivée à son plein développement, n’était pas un régime à bon marché ; elle pesait, au contraire, d’un poids très lourd sur les finances publiques ; car le peuple avait été habitué à cette idée qu’il devait vivre et s’amuser aux frais du trésor. La guerre d’ailleurs venait aggraver singulièrement les charges de la paix. On a calculé que de 431 à 428 elle coûta en moyenne 2.500 talents par an[253]. Le fonds de réserve se trouvait réduit à 1.000 talents, et tout récemment, pendant le siège de Mitylène, il avait fallu lever sur les citoyens une imposition extraordinaire de 200 talents, qui d’année en année continua d’être perçue dans la suite[254]. Il sembla équitable de demander aux alliés qu’ils imitassent l’exemple d’Athènes, en se résignant, eux aussi, à un surcroît de sacrifices. De là le décret de 425, présenté par l’obscur Thoudippos, mais inspiré en réalité par Cléon, que son succès de Sphactérie avait porté au comble de sa popularité[255]. Ce serait une erreur de croire que toutes les clauses en soient nouvelles ; peut-être sur bien des points se borna-t-il à reproduire des règles déjà anciennes. Il ne rompit sans doute avec la tradition qu’en ce qui touche le chiffre des tributs. Du reste, même à cet égard, il exagéra moins qu’on ne suppose. Si l’on examine la liste des 76 villes, dont les taxes nous sont connues, on constate que 6 furent fixées au taux de la première ou de la seconde période, 8 au taux de la quatrième, et 25 au taux de la troisième, qui fut, on l’a vu, la plus douce. 9 bénéficièrent d’une réduction tantôt insignifiante, tantôt considérable. Il n’y en eut que 27, c’est-à-dire le tiers environ, qui furent plus rudement frappées ; mais on remarquera d’abord que, dans le nombre, 13 appartiennent au seul district des îles. Pour celles-là la progression ne laisse pas que d’être assez forte, puisqu’elle est le plus souvent du double ou des 2/3, et parfois des ¾. On en devine d’ailleurs la cause. Athènes, pressée par le besoin d’argent, se montre exigeante surtout pour les îles de l’Archipel, parce que les îles, étant à sa portée, sont davantage à sa discrétion[256]. Quant aux districts d’Ionie, de Carie, de Thrace et d’Hellespont, comme ils échappent un peu plus à son action, elle semble désireuse de les ménager. Dans l’état actuel des dota mente, on voit que chaque ville insulaire paye en 425 une somme moyenne de 6 talents, tandis que le contingent moyen pour les autres oscille entre 3 et 4. J’ajoute que si l’on excepte Clazomène et Daunioteichos, dont l’énorme augmentation tient peut-être à des causes particulières[257], la progression des tributs est moins prononcée dans les quatre premiers districts que dans celui des îles. Une fois, elle atteint la proportion des 2/3[258] ; mais d’ordinaire elle va de 1/3 à 1/2, et il lui arrive de descendre à 1/6[259]. Tout compte fait, les modifications introduites en 425 dans les chiffres des listes antérieures furent moins graves qu’on ne s’y attendrait. Pourtant la somme totale des tributs s’éleva. Tous les textes s’accordent à dire qu’elle atteignit 1.200 ou 1.300 talents, et nous savons par les inscriptions que l’Hellespont, à lui seul, en paya 296[260]. Comment expliquer cette contradiction apparente ? Il n’y a qu’un moyen, c’est de croire que les tributaires se trouvèrent en 425 plus nombreux qu’auparavant. La chose en elle-même est assez vraisemblable. Il était naturel que pendant la guerre Athènes obligeât les états neutres à prendre nettement position, à se déclarer pour elle ou contre elle, et, comme elle était encore pleine de force, surtout par sa marine, elle put sans peine inscrire parmi ses alliés beaucoup de villes du littoral et des îles[261]. Nous avons d’ailleurs des indices que ce n’est point là une pure hypothèse. La liste de 425 renferme une soixantaine de noms nouveaux ; peut-être plusieurs figuraient-ils déjà sur les précédentes, et dans ce cas les lacunes des documents nous empêcheraient seules de les y rencontrer ; mais la présence de Mélos[262] prouve aussi que quelques-uns de ces états durent alors payer tribut pour la première fois. Une conclusion analogue se dégage de l’étude de l’Έλλησπόντιος φόρος. Dans la troisième période, 36 villes de l’Hellespont versaient ensemble 79 talents, et 81 l’on supplée de la façon la plus probable les chiffres de huit autres cités, on arrive à la somme ils 100 talents environ[263]. En 425, la même région fut taxée à 296 talents ; ce qui fait un accroissement des 213. Or les 19 villes dont on peut comparer les contingents pécuniaires en 446 et en 425 ne furent pas augmentées dans une proportion aussi forte. 10 ne changèrent pas de tribut, 4 furent allégées, et 5 ne furent surchargées que de la manière suivante :
N’est-on pas dès lors fondé à croire que la surélévation de la somme totale fut, en grande partie, amenée par des adhésions nouvelles ? Aristophane en 423/422 comptait 1.000 cités portant leurs tributs à Athènes[264], et, quoi qu’en dise le scholiaste, c’était là pour lui un chiffre précis, comme il est aisé d’en juger d’après le contexte[265]. Ce chiffre est fait pour surprendre, si l’on songe que jusqu’à ce jour nous ne connaissons pas plus de 280 cités tributaires des Athéniens[266]. Les historiens se sont évertués à résoudre la difficulté ; ils n’y ont pas pleinement réussi. Peut-être serait-il possible de tout concilier, si l’on admettait que le poète range parmi les contribuables, non seulement les états qui faisaient régulièrement partie de l’Empire, mais encore ceux qui étaient simplement entrés dans l’alliance athénienne, en s’engageant à fournir un subside de guerre. Ce qui parait autoriser une pareille conjecture, c’est cette assertion d’Aristophane que les villes placées sous l’autorité d’Athènes sont éparses depuis le Pont jusqu’à la Sardaigne[267]. Il n’y a pas le moindre indice que l’empire même ait débordé dans la mer Ionienne. Les Athéniens, dès le début des hostilités, avaient des alliés dans ces parages, par exemple les Messéniens de Naupacte, les Acarnaniens, les habitants de Corcyre, de Zacynthe[268] ; et plus tard ils en acquirent d’autres. Nous savons également que quelques-uns d’entre eux les soutenaient de leur argent[269] ; mais ce n’était pas là, à proprement parler, des confédérés, et leurs noms ne figuraient pas sur les rôles officiels du φόρος. Cela n’empêche pas que leur liste allongeait celle des alliés payants, et que leurs subsides grossissaient les revenus de la république. Aristophane peut donc être dans le vrai, quand il affirme que 1.000 cités envoient leurs contributions à Athènes, et les auteurs qui parlent d’une somme de 12 à 1.300 talents qu’elle aurait annuellement reçue dit dehors ne se trompent pas davantage. Vais pour se rendre un compte exact de la condition de ses sujets, il importe de faire la distinction que ces textes ne font pas. L’année 423 marque le point culminant de la prospérité financière de l’Empire. Immédiatement après, les recettes baissèrent, à mesure que les défections se produisaient. En 413/412, il fallut, pour alimenter le trésor, établir sous le nom de είκοστή ; un impôt du vingtième ou de 5 % sur lis marchandises qui entraient dans les ports des alliés ou qui en sortaient[270]. Thucydide dit formellement que cette taxe était destinée à remplacer l’ancien tribut, et qu’elle lui fut substituée dans l’espoir qu’elle serait plus fructueuse[271]. Nous ignorons si l’innovation dura longtemps. Xénophon, dés 409, mentionne l’obligation pour les Chalcédoniens d’acquitter leur φόρος habituel[272] ; mais en revanche, Aristophane flétrit encore en 406 les mauvais collecteurs du vingtième[273], et il n’est pas sûr que ce soit par pur esprit de récrimination contre le passé. Pour concilier ces deux textes, on a supposé que certaines villes restèrent, jusqu’à la fin de la guerre, astreintes au paiement du vingtième, et que d’autres furent de nouveau soumises au tribut[274]. Il est difficile de se prononcer sur cette question de détail. Elle n’a d’ailleurs qu’une médiocre importance, car l’empire d’Athènes cessa presque aussitôt d’exister, par suite du soulèvement général de tous les alliés. VII — Conclusion. L’Empire athénien fut une tentative pour donner à la Grèce plus de force par l’union. Fondé après un grand péril national où l’indépendance hellénique avait failli succomber, issu du désir de la vengeance et du souci de la sécurité commune, il n’eut d’abord en vue que la défaite des Perses et la défense de l’archipel. Mais peu à peu d’autres idées se mirent à la traverse ; la puissance qui avait la direction de la ligue sentit son ambition croître avec l’importance du rôle qu’elle jouait, et, sans négliger complètement l’intérêt général, elle songea de plus en plus à son intérêt particulier. Insensiblement, les alliés furent réduits à la condition de sujets, Athènes devint maîtresse souveraine, et la confédération ne fut plus guère qu’une extension du territoire de l’Attique. Sous cette forme nouvelle, comme sous l’ancienne, elle continua de rendre à la Grèce les services qu’on attendait d’elle. Elle fut la gardienne vigilante des mers ; elle tint les Perses éloignés de l’Archipel et du littoral qui l’entoure ; elle empêcha toute invasion étrangère, et, à la faveur d’une longue paix, elle assura la prospérité matérielle des villes adhérentes[275]. Mais les alliés s’accoutumèrent si bien et si vite à ces avantages, qu’ils finirent par ne plus s’en apercevoir ; ils ne surent bientôt aucun gré aux institutions qui les leur procuraient ; et avec le temps les inconvénients seuls de leur position les frappèrent. Ils se plaignirent des charges qu’on leur infligeait, du tribut qu’ils payaient, des sacrifices qu’un réclamait d’eux, de l’autorité qu’ils subissaient ; ils se prirent à regretter l’état de choses antérieur, l’époque heureuse qu’un mirage trompeur parait à leurs yeux de tous les bienfaits de la liberté, et la force qui sans cesse les poussait à se détacher les uns des autres agit sur eux avec un redoublement d’énergie. A dire vrai, leurs griefs n’étaient pas tous dépourvus de fondement. Athènes avait abusé de ses pouvoirs, surtout depuis que la démocratie avait succédé chez elle à un régime plus tempéré. Par besoin autant que par orgueil, elle s’était arrogé le droit de disposer à son gré des ressources militaires et financières de la ligue, et, au lieu de les employer pour le bien de tous, elle les avait fait servir de préférence au sien ; c’est ainsi que par un virement singulier, les contributions des alliés avaient été en partie consacrées aux dépenses des fêtes et aux embellissements de la ville. Elle avait violé les principes les plus chers aux états helléniques, en supprimant partout l’autonomie, en exigeant que partout la démocratie gouvernât, en abolissant même toute autre juridiction que celle de ses propres tribunaux. Elle avait enfin asservi à sa politique et traité en pays conquis des cités qui s’étaient volontairement groupées autour d’elle, et qui n’avaient prétendu sacrifier qu’une faible portion de leur liberté. L’excès fut tel, qu’on en vint à détester sa suprématie, et ce fut dès lors une lutte tantôt latente, tantôt déclarée entre les Athéniens et leurs sujets, les premiers désireux de consolider le lien fédéral, les seconds désireux de le rompre. L’empire ne subsistait plus que par la force[276], et il était à prévoir qu’il ne survivrait pas à une épreuve d’où Athènes sortirait affaiblie. Outre les causes de mécontentement général, il y avait dans chaque ville alliée une faction hostile à la métropole, c’était l’oligarchie, dépossédée de son ancien pouvoir, et systématiquement lésée dans ses intérêts matériels. Elle n’attendait qu’une occasion pour se révolter ; la guerre du Péloponnèse la lui fournit. Les Spartiates se donnèrent comme les libérateurs des Grecs et les champions de l’autonomie municipale[277] ; ils eurent aussitôt des amis dans tous les états. Ils les aidèrent de leur mieux à secouer un joug odieux[278] ; et lorsque les désastres de l’expédition de Sicile eurent brisé la force militaire d’Athènes et épuisé son trésor, l’empire tomba en dissolution. Sa chute fut la revanche de l’esprit local contre le principe d’unité et de l’esprit aristocratique contre les violences de la démocratie. Annales
de la Facultés des Lettres de Bordeaux — 1883 |