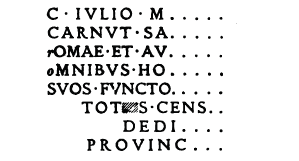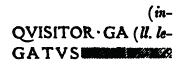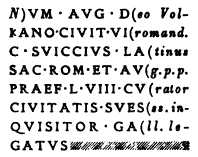LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES DANS L’EMPIRE ROMAIN
LIVRE II.
CHAPITRE III. — DU BUDGET PROVINCIAL.
Texte numérisé par Marc Szwajcer
|
Le budget provincial n’était ni compliqué ni difficile à établir. Il aurait été beaucoup plus simple que nos budgets départementaux, même si l’assemblée avait dû doter avec ses propres ressources tous les services provinciaux, car il est des dépenses dont les anciens ne comprenaient pas la nécessité ; aucun crédit, par exemple, n’aurait été affecté à l’instruction publique ni à l’assistance publique. Mais il y a plus : certaine services, communs aux deux époques, qui chez nous sont à la charge des départements, n’étaient pas payés sur les fonds des concilia ou des κοινά. Gela se conçoit sans peine, pour peu qu’on réfléchisse au caractère religieux et privé plutôt que politique de ces fédérations. On ne remarque pas qu’aucune d’elles ait jamais eu la pensée de construire un pont, une route, un aqueduc. C’est l’État, ce sont les cités que ce soin regardait, et l’assemblée provinciale n’était même pas appelée à fournir une subvention. Il est des cas ou son intervention eût été, du moins à nos yeux, indispensable, et où pourtant on se passait de son concours. Lorsque l’exécution d’un travail intéressait une région plus ou moins étendue, sans intéresser directement l’État, il semble qu’il eût été naturel d’en charger le concilium. On procédait autrement sous l’Empire. Les villes de la région formaient alors entre elles une sorte de syndicat, et elles entreprenaient le travail à leurs frais. Une inscription du temps de Domitien nous montre dix cités de Galice bâtissant un pont à Chaves, sans que la province les aide en rien[1]. Le fameux pont d’Alcantara, sur le Tage, fut élevé par vingt-deux municipes de Lusitanie, stipe conlata[2]. En somme, le budget des dépenses provinciales ne comptait que deux chapitres : 1° frais du culte ; 2° frais causés par la mise en vigueur des décrets de l’assemblée. On peut ranger sous la première rubrique l’érection et l’entretien du temple fédéral et de ses annexes, les dépenses des sacrifices et des jeux, le salaire des agents subalternes. On peut inscrire sous la seconde l’indemnité allouée aux députés que la province envoyait à Rome, les dépenses occasionnées par les procès qu’elle intentait, enfin les frais qui résultaient pour elle des hommages décernés par la diète. Nous allons passer en revue ces divers articles, pour avoir une idée approximative du chiffre annuel des dépenses. 1° Édifices provinciaux. — Il ne faudrait pas croire qu’il existât au chef-lieu fédéral un temple unique, dédié a la double divinité de Rome et de l’empereur. Dans quelques contrées, il pouvait en être ainsi ; dans d’autres, les documents nous signalent plusieurs temples distincts[3]. En Asie même, et probablement en Lycie, les principales villes, celles où se réunissait périodiquement le κοινόν, avaient leurs sanctuaires fédéraux. Souvent, dans l’enceinte consacrée, se dressaient les statues des cités représentées à la diète[4]. Il y avait, en outre, des maisons destinées à loger le personnel, une salle pour les réunions du concilium, des locaux appropriés aux différents services qui fonctionnaient pendant les fêtes. Enfin, il était impossible de célébrer les jeux habituels sans quelque vaste édifice disposé à cet effet, un cirque par exemple, un amphithéâtre, un stade. Peut-être cependant se bornait-on à emprunter les monuments de la cité voisine. 2° Sacrifices et jeux. — Les frais du culte proprement dit se réduisaient à peu de chose, puisqu’il ne réclamait que quelques victimes dans Tannée. Ceux qu’entraînaient les jeux étaient beaucoup plus considérables. Sans doute les fêtes n’étaient pas partout environnées du même éclat, et elles avaient plus de magnificence dans la riche province d’Asie que dans les marches de la frontière du Danube. Il est permis de croire également que, suivant les années, on déployait, au même lieu, un luxe plus ou moins grand. Néanmoins on devine que c’était là pour le budget provincial une assez lourde charge[5]. Dans une ville moyenne d’Italie, un combat de gladiateurs, qui dura trois jours, ne coûta pas moins de quatre-vingt-quatre mille francs[6]. A Pisaure, un spectacle analogue en exigea trente-cinq mille[7]. Les jeux qu’Hérode de Judée institua en l’honneur d’Auguste demandaient la somme énorme de cent talents[8]. Un citoyen de Cibyra légua à sa ville natale un revenu annuel d’une vingtaine de mille francs pour une simple gymnasiarchie[9]. Pour un combat de gladiateurs et pour deux jeux scéniques, un magistrat de Cordoue ne fournit pas moins de quatre cent mille sesterces[10]. A Aphrodise de Carie, un concours de musique réclamait, vers le milieu du IIe siècle, vingt et un mille francs environ[11]. Qu’on se rappelle tous ces faits, puis que l’on réfléchisse à la longueur probable des fêtes provinciales, à la nécessité où l’on se trouvait de divertir pendant tout ce temps une foule oisive et d’autant plus avide de distractions, au besoin qu’éprouvait le concilium d’égaler, sinon d’éclipser, la pompe des jeux particuliers a la ville où il siégeait, et Ton se convaincra que plusieurs centaines de mille francs n’étaient pas de trop pour l’ensemble de ces cérémonies. 3° Salaire des agents. — Sur ce point, nous ne pouvons même pas faire de conjectures ; car tout dépendait du nombre des agents que la province avait à payer. Il y a pourtant des indices que ce personnel était assez considérable. Ainsi un document épigraphique nous signale les chanteurs du temple fédéral d’Éphèse[12]. Nous savons, d’autre part, que les magistrats municipaux avaient sous leurs ordres beaucoup d’auxiliaires. A Genetiva Julia, les seuls duumvirs n’en employaient pas moins de onze, dont le salaire s’élevait à six mille cinq cents sesterces par an[13]. 4° Députations. — Pline nous apprend dans ses lettres qu’une députation envoyée de Byzance à Rome coûtait régulièrement douze mille sesterces (2.520 francs)[14]. Or les provinces étaient très empressées à se mettre en rapports directs avec l’empereur. Il ne se passait presque pas d’année ou elles n’eussent à lui adresser leurs félicitations ou leurs demandes[15], et l’on juge par le chiffre de Pline dans quelle mesure leurs finances étaient grevées de ce chef[16]. On remarquera que, dans le cas dont il s’agit, les Byzantins ne se rendaient pas à Rome en solliciteurs, mais simplement avec mission de porter au prince les hommages de leur cité. L’ambassade devait être plus longue et plue onéreuse quand elle avait pour objet d’obtenir une faveur[17]. 5° Frais de justice. — Si la province poursuivait en justice un de ses gouverneurs, il fallait joindre à l’indemnité ordinaire de ses délégués une certaine quantité de dépenses supplémentaires, telles que frais de l’instruction et honoraires des avocats, sans parler des tentatives de corruption, et il ne paraît pas qu’elle rentrât dans ses fonds, si elle gagnait le procès. 6° Décrets honorifiques. — Il y avait pour elle deux moyens principaux d’honorer un personnage, c’était ou bien d’inscrire son nom dans un décret très élogieux, ou bien de lui élever une statue. Dans le premier cas, la dépense était assez faible, lors même que le décret était tiré à plusieurs exemplaires pour être affiché dans différentes villes. Une statue était bien plus chère. Il est vrai qu’on en faisait de tous les prix, depuis quatre mille sesterces (860 francs) jusqu’à 50.000 (10.500 fr.) et plus[18] ; mais nous savons que les provinces en érigeaient parfois de fort belles, quelques-unes notamment en bronze doré[19]. Toutes ces dépenses n’étaient pas acquittées par le trésor provincial. Il en était que l’empereur ou les particuliers prenaient à leur charge. C’est ainsi que nous voyons Septime Sévère réparer à ses frais un des édifices de la Pannonie Inférieure[20]. Hadrien reconstruisit de même le temple d’Auguste commun à toute la Tarraconaise, et il l’inaugura en personne[21]. Peut-être montra-t-il une générosité pareille à l’égard des Gaules[22]. Ces faveurs se renouvelèrent probablement plus d’une fois sous l’Empire, mais ce qui fut encore plus fréquent, ce furent les libéralités individuelles. Beaucoup de personnages désignés par le concilium pour faire partie d’une ambassade consentaient à en supporter tous les frais, et la province en était quitte avec un remerciement[23]. Il n’était pas rare non plus, lorsqu’elle votait un monument en l’honneur d’un de ses bienfaiteurs, que celui-ci en assumât toute la dépense[24]. Mais ce qui contribuait surtout à alléger le budget, c’était l’habitude qu’on avait de rejeter sur les ordonnateurs des fêtes une bonne part des frais. Dans les municipes, la règle était absolue : tout magistrat était tenu de régaler et d’amuser ses compatriotes[25], d’embellir sa cité, de bâtir quelque édifice d’utilité publique[26], souvent de verser dans la caisse, au début de son administration, une somme dite honoraire,dont le minimum était déterminé[27]. Les hauts fonctionnaires de la province, grand prêtre, agonothète, gymnasiarque, furent astreints à un devoir semblable. Il y a apparence qu’on leur allouait des fonds pour les fêtes[28] ; mais ce crédit, peut-être invariable, était en général insuffisant, et c’était pour eux une obligation stricte de le compléter sur leur fortune personnelle. Ils s’y prêtaient d’ailleurs très volontiers, autant par vanité que par amour du pays natal. Partout les inscriptions sont pleines de louanges à leur adresse, et il est visible que les réunions fédérales tiraient principalement leur éclat des sacrifices qu’ils s’imposaient[29]. Si le budget provincial était soulagé par toutes ces largesses, il avait néanmoins à payer certaines dépenses, restées à son compte. Quels étaient les revenus qui lui permettaient d’y faire face ? On a vu dans un chapitre précédent que tout concilium était un collège, par suite une de ces personnes morales qu’on appelait universitates. Celles-ci, en effet, se reconnaissaient à ce signe qu’elles avaient une caisse commune, des propriétés communes, et un syndic capable d’agir, en cas de besoin, au nom de la communauté[30]. Or les provinces paraissent avoir eu sous l’Empire leur arca[31] ; elles possédaient des immeubles, à commencer par le temple qu’elles avaient édifié ; elles avaient des affranchis, des esclaves[32] ; et les legati qu’elles envoyaient a Rome pour défendre leurs intérêts ressemblaient de tous pointe à un actor publicus, bien qu’ils portassent un titre différent. Elles avaient donc aussi tous les droits civils des universitates. Ces droits étaient très étendus ; ils n’allaient pas pourtant sans quelques restrictions, et il est visible qu’ils n’ont pas été les mêmes dans tous les temps. Les Romains distinguaient deux sortes de biens, les res divini et les res humani juris. Les premiers se subdivisaient à leur tour en res sacræ et res religiosæ. Une chose était dite sacra, lorsqu’elle était consacrée aux dieux du ciel en vertu d’une autorisation donnée par une loi, un sénatus-consulte, ou un édit impérial[33]. Or ces conditions étaient toutes remplies par les temples que nos assemblées élevaient. Les empereurs, en effet, furent toujours assimilés non pas aux dieux Mânes, mais aux dieux d’en haut[34]. En outre, il est constant qu’aucun sanctuaire de Rome et d’Auguste ne fut bâti sans leur assentiment[35] ; et, s’il est vrai que la dédicace en fut faite d’ordinaire par les indigènes, il ne semble pas que le concours d’un magistrat romain fût indispensable pour imprimer le caractère sacré à un monument[36]. Il n’en résulte pas que ces édifices fussent la propriété des concilia ; car, en principe, les choses de droit divin n’étaient le bien de personne[37]. Mais il faut entendre par la que ces choses, étant censées appartenir a la divinité elle-même, se trouvaient extra commercium, et que nul n’avait le droit de les aliéner[38]. Sauf cette réserve, les concilia en usaient comme d’une propriété véritable. Leur faculté d’acquérir s’exerçait dans des limites plus étroites. Pendant tout le cours du Ier siècle, ils ne purent recevoir de libéralités que par fidéicommis, et l’on sait que c’était là un mode d’acquisition fort précaire, puisqu’il n’était protégé par aucune voie légale[39]. Sous Marc-Aurèle les collèges, et par conséquent les assemblées provinciales, obtinrent, avec le droit d’affranchir, celui d’accepter des donations sous forme de legs[40]. Mais il est a peu près sûr que jamais ils ne furent capables d’être institués héritiers. Sans doute certains dieux étaient admis a hériter, et l’héritage dans ce cas revenait, en réalité, soit au collège du dieu, soit, pour employer une expression moderne, au conseil de fabrique. Mais Ulpien, qui nous signale ce fait, a soin d’énumérer les dieux qui seuls jouissent d’un tel privilège, et nous n’apercevons sur sa liste ni Rome, ni l’empereur[41]. L’incapacité qui frappait à cet égard les collèges est encore formulée dans une loi de l’année 290[42]. Il n’était dérogé à cette règle que si le testateur était un affranchi de la corporation. Les collèges étaient aptes, comme tout patron, à recueillir la succession même d’un affranchi qui mourait intestat[43]. On désirerait savoir si ces droits demeurèrent toujours à l’état théorique, ou bien s’ils trouvèrent parfois dans la pratique leur application. Sur ce point, malheureusement, les documents se taisent. Tandis que les textes épigraphiques et juridiques abondent en exemples de donations faites aux cités et même aux collèges, pour les assemblées provinciales rien de pareil n’apparaît. Tacite raconte que l’empereur Othon provinciæ Bœticœ Maurorum civitates dono dedit[44]. Madvig pense que les revenus de ces villes africaines devaient être désormais administrés au nom de la Bétique et affectés à ses besoins, et il voit là une preuve de la personnalité attribuée à une province[45]. L’interprétation est douteuse[46]. Cette conjecture, en tout cas, ne va pas jusqu’à prétendre que les revenus de la Mauritanie Tingitane furent mis à la disposition du concilium de Bétique ; ils allèrent plutôt se perdre dans la caisse où puisait le gouverneur. Du silence presque complet des textes il ne faudrait pas conclure que nos assemblées ne furent jamais gratifiées d’une de ces libéralités dont les hommes se montraient si prodigues à l’égard des villes[47]. Il ne faudrait pas surtout en inférer que ce privilège n’existait pas pour elles. Nous ne pouvons affirmer qu’une chose, c’est que les donations de cette nature étaient fort rares. Il est d’ailleurs assez difficile de pénétrer les raisons de cette anomalie. Les jeux fédéraux n’avaient lieu qu’une fois dans l’année, et une bonne partie des dépenses incombaient aux dignitaires qui les présidaient. Il est donc probable que le budget du concilium en était peu chargé, et qu’on jugeait inutile de le soulager par des fondations particulières. Peut-être aussi obéissait-on à un autre sentiment. La cité était vraiment pour les anciens une famille agrandie, tandis que la province, après les remaniements imposés par les Romains, n’était guère qu’une circonscription administrative. Celle-ci était un être abstrait, qui ne prenait quelque réalité qu’au jour de la fête annuelle, et seulement au chef-lieu fédéral. A quoi bon se mettre en frais, lorsqu’on n’y était pas forcé, soit pour construire en cet endroit un monument qui servirait à embellir une ville étrangère, soit pour y instituer des jeux auxquels les compatriotes du donateur n’assisteraient guère ? N’était-il pas préférable de réserver ces avantages pour la ville où l’on était né, pour celle où l’on résidait, plutôt que d’en faire profiter avant tout les habitants d’une métropole, déjà trop favorisée, et souvent enviée du reste de la province ? En dehors des largesses individuelles, la ressource ordinaire des concilia leur était fournie par les subventions des cités. On aurait tort de considérer ces contributions comme une sorte d’impôt prélevé par la diète. Celle-ci ne possédait aucune autorité sur les municipes ; elle leur était superposée, sans leur être supérieure, et elle n’avait pas plus le droit de les taxer que de leur donner des ordres. Seulement il fallait bien que, dans cette association, comme dans toutes les autres, chaque membre supportât sa part des charges communes. La somme annuelle payée par chaque ville n’était rien de plus qu’une cotisation de ce genre. Nous ignorons de quelle manière elle était désignée ; peut-être était-ce par le mot stips, usité dans les collèges[48]. Il va sans dire que les cités n’étaient point libres de se soustraire à cette obligation, pas plus qu’il ne leur était permis de se retirer du κοινόν, et aucune jamais n’y songea. C’eût été gravement offenser l’empereur que de se refuser à siéger dans une assemblée vouée à son culte[49]. On s’est demandé quelle était l’assiette de cette contribution. On avait d’abord conjecturé que le produit de la Quadragesima Galliarum servait à alimenter la caisse fédérale[50] ; mais on sait aujourd’hui que c’était là un impôt perçu par l’administration des douanes impériales[51]. On a prétendu encore que l’impôt des Trois Gaules était un impôt foncier[52], et l’on s’est fondé pour cela sur une inscription de Lyon qui est ainsi conçue[53] :
Auguste Bernard restitue de la façon suivante les dernières lignes :
et il voit la un prêtre des Trois Gaules chargé du recouvrement de tout le cens[54]. Cette explication bizarre mérite à peine que l’on s’y arrête. Le mot census désigne non pas un impôt, mais le recensement des biens et des personnes. Ce soin était laissé à l’administration municipale. Tous les cinq ans, les premiers magistrats de la cité ajoutaient à leur titre celui de quinquennales et procédaient à cette opération. Le résultat de leur travail, recueilli et probablement contrôlé par des censiteurs en sous-ordre, était transmis par ceux-ci au censiteur de la province. Enfin, un fonctionnaire résidant à Rome... était chargé de centraliser les rapports des censiteurs provinciaux et de dresser le cens général de l’Empire[55]. Que le mot CENS doive se lire plus haut CENS(us) ou CENS(itor), il est manifeste que C. Julius[56] n’a point accompli une opération ordonnée par le concilium, bien qu’il paraisse avoir mérité en cette circonstance les félicitations de la diète. Aux deux hypothèses que nous avons écartées il est aisé d’en substituer une troisième, beaucoup plus simple. La cotisation annuelle était due non par les particuliers, mais par les cités. Les provinciaux qui venaient au concilium y avaient accès, non à titre individuel, mais comme représentants d’une ville. C’étaient les villes qui en se groupant avaient constitué l’union provinciale ; chacune d’elles, par conséquent, était membre de l’association pour son propre compte, et c’est à elles que l’assemblée avait affaire. Il est donc à présumer que la stips annua était acquittée sur les fonds municipaux. Dion Chrysostome parait affirmer qu’en Asie le tarif était uniforme pour toutes les cités[57]. Il était peut-être proportionnel en Lycie[58] et dans la Tarraconaise[59]. La caisse commune s’appelait arca. C’est pour la Gaule que nous connaissons te mieux les fonctionnaires préposés à ce service. Deux d’entre eux, le judex arcæ et l’allector arcæ, figurent dans les documents épigraphiques[60]. Le premier, dit Renier, jugeait les réclamations ou les contestations auxquelles pouvaient donner lieu la répartition et la perception des contributions ; le second était une espèce de receveur général[61]. Ces définitions ne se justifient guère que par l’étymologie ; elles sont néanmoins très acceptables. Il y avait encore un troisième agent, l’inquisitor Galliarum, qui passe d’ordinaire pour être une sorte de contrôleur chargé d’établir l’assiette de la taxe fédérale[62]. Ici pourtant la difficulté est plus grande, et il convient d’insister davantage. Nous avons les noms de cinq de ces inquisitores. Ce sont : L. Lentulus Censorinus[63], L. Cassius Melior[64], Paternus Ursus[65], Q. Julius Severinus[66], Suiccius La(tinus)[67]. Aucun d’eux ne nous apparaît comme ayant eu le rôle d’agent fiscal. Tandis que les deux autres dignitaires sont dits judex arcæ, allector arcæ, jamais on ne nous mentionne un inquisitor arcæ. L’inquisitor était-il un agent extraordinaire de l’empereur ? On a fait observer avec raison qu’une mission de ce genre aurait été, selon l’usage, confiée à un ancien militaire[68]. Or quatre de nos inquisiteurs n’ont pas servi dans l’armée, et le cinquième n’a été préfet de légion qu’afin de s’acheminer par là aux fonctions de procurateur[69]. Tous d’ailleurs ont exercé chez eux les magistratures municipales. M. Hirschfeld a pensé que l’inquisitor était un commissaire choisi par rassemblée des Gaules pour contrôler les opérations du recrutement, pour constater en particulier si les conscrits remplissaient les conditions voulues[70]. On a répondu à cette hypothèse en démontrant que l’inquisitor dilectuum était un fonctionnaire impérial, comme le dilectator, comme le legatus dilectuum, et qu’il agissait dans le cercle restreint d’une cité[71]. S’il faut risquer, à notre tour, une conjecture, nous dirons que l’inquisitor était un agent provincial de l’ordre judiciaire. Son rôle nous est nettement retracé dans une lettre de Pline[72]. Il était élu par l’assemblée pour rechercher les éléments de l’accusation qu’elle projetait d’intenter contre un gouverneur ou ses complices, et parfois il était chargé d’aller la soutenir à Rome. C’est ainsi que, dans l’affaire de Classicus, Norbanus Licinianus fut en même temps legatus et inquisitor de Bétique. Or l’inscription relative à C. Suiccius Latinus porte ces mots :
Ce personnage n’a pu être ni legatus legionis, ni legatus Augusti pro prætore, puisqu’il n’avait pas été préteur auparavant[73]. Il n’a même pas été légat d’un proconsul ; car rien n’indique qu’il ait passé par la questure[74]. Il s’ensuit qu’il a dû être envoyé en mission par une cité, par une province, ou plutôt par le concilium des Gaules, et ceci concorde bien avec le renseignement que nous fournit Pline. Les textes nous font apercevoir encore une arca proviriciæ en Afrique[75] et en Pannonie[76] ; mais ces caisses se rattachent aux finances impériales, puisqu’elles ont pour employés des affranchis du prince régnant. Une inscription de Dacie nous donne le nom d’un certain Artémidore, qui était à la fois prêtre de l’autel central et allector d’un temple[77]. Mais ce temple n’était pas le sanctuaire fédéral ; car il se trouvait à une assez grande distance de Sarmizegethusa, capitale religieuse de la Dacie, et, en outre, il était sûrement consacré a Jupiter Genitor. Nous connaissons un individu qui a été flamine de l’Espagne Citérieure et curateur d’un temple à Tarragone[78]. On l’a rapproché de ces curateurs qui, d’après le Digeste, ad colligendos civitatium publicos reditus exigi solent[79], et l’on a dit que celui-ci avait la double charge de veiller à l’entretien du temple et d’en gérer les revenus[80]. L’hypothèse est assez plausible. Mais rien n’indique que le temple dont on parle soit un édifice provincial. Ces documents douteux étant écartés, il en reste quelques-uns qui nous montrent divers concilia pourvus d’une caisse et d’une administration financière. Le κοινόν de Lycie, par exemple, avait des χρήματα[81] et probablement un magistrat appelé ταμίας[82]. L’assemblée de l’Espagne Citérieure remercia un jour C. Valerius Arabinus, prêtre fédéral, ob curam tabulari censualis fideliter administratam[83]. Il est à présumer que cette cura ne fut ni une charge municipale, ni une fonction impériale ; elle dut être d’ordre provincial. Or, si on la compare aux institutions analogues, on devine que son rôle propre était de conserver les registres censiers qui permettaient de fixer la cotisation des cités[84] ; ce qui attesterait que les villes espagnoles étaient taxées au prorata de leur richesse. On remarquera en outre que dans cette contrée ce soin n’incombait pas à un magistrat spécial ; il rentrait dans les attributions normales du pontife fédéral. Il existait à Lyon pour le concilium des Trois Gaules un service identique. Un document, en effet, nous signale un tabularius Galliarum[85] et il est possible que cet employé subalterne ne dépendît pas de l’État ; il était peut-être placé sous les ordres du judex ou de l’allector arcæ. En Asie, on rencontre un agent provincial d’une nature toute particulière, c’est l’άργυροταμίας[86]. Dans quelques villes d’Orient, ce titre était aussi porté par un fonctionnaire municipal, qu’on a assimilé à ces curatores pecuniæ publicæ ou kalendarii dont il est fait mention assez fréquemment dans les textes occidentaux[87]. Ces derniers avaient la gestion des créances de la cité ; ils prêtaient les fonds disponibles, touchaient les intérêts échus, assuraient les rentrées, et poursuivaient les débiteurs insolvables[88]. Si l’άργυροταμίας Άσίας ne différait en rien des agents financiers qui dans les villes étaient désignés de même[89], il faudrait en conclure que l’Asie avait une caisse et une caisse riche, qu’elle possédait des biens provenant de donations ou de legs, et qu’elle faisait valoir ses capitaux. Il va sans dire que dans toutes ces matières la décision suprême était réservée à l’assemblée. C’était elle qui fixait les recettes, qui votait les dépenses, qui vérifiait les comptes, qui donnait, enfin, quittance aux employés[90]. Le litre de judex arcæ prouve peut-être que le contentieux, pour tout ce qui avait trait à la répartition de la taxe, était jugé par un délégué du concilium. Quant aux malversations et aux autres délits commis par les agents fiscaux de la province dans l’exercice de leurs attributions, nous ne savons s’ils ressortissaient au tribunal du gouverneur ou à l’assemblée. La seconde opinion paraîtra sans doute plus probable, si l’on réfléchit : 1° que dans les cités les magistrats municipaux étaient justiciables des autorités locales[91] ; 2° que les simples collèges avaient le droit de condamner leurs administrateurs à l’amende[92]. |