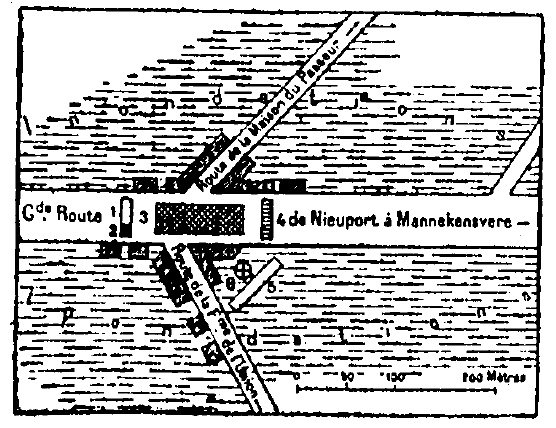SAINT-GEORGES ET NIEUPORT
SAINT-GEORGES
— IV — UNE PROGRESSION MÉTHODIQUE.
|
Seule une progression lente, méthodique, pouvait maintenant nous rendre maîtres de Saint-Georges, et cette progression devait se faire surtout par la grande route et le long de l’Yser. La compagnie Martinie resta cependant en cantonnement d’alerte jusqu'au 18 décembre dans la ferme Klein-Noordhuyst, derrière la digue du canal de Noord-Vaart. Qu’y avait-il de l'autre côté de cette digue, dans l’espèce de botte dessinée par le canal de l’Yser ? L'ennemi occupait-il les trois ou quatre fermes dont les toits rouges luisaient çà et là sur l’eau grise ? Il était intéressant de le savoir. Une reconnaissance, sous les ordres de l’enseigne de Blic, remonta la berge sud du canal et s’avança dans la direction des fermes Terstyle et Violette, placées dans le talon de la botte. C’était un marin peu banal que ce de Blic, qui achevait son noviciat chez les Jésuites au moment où la guerre éclata. Il avait repris immédiatement du service et était entré à la brigade en même temps que son ami et collègue de noviciat, le père Poisson. Enseignes de réserve tous deux, ils avaient reçu le baptême du feu le même jour, à Melle, qui fut la préface de Dixmude, et rien, à la vérité, sauf la retenue de leur verbe et le crucifix qu’ils tiraient parfois de leur poche pour le baiser, n'eût trahi dans ces officiers, d’un allant et d’une bravoure extraordinaires, les congréganistes qu’ils étaient devenus. La caserne sans doute n’est pas si loin du cloître et, dans tout soldat, il y a l’étoffe d’un moine. Mais, plus encore que la vie militaire, la vie de l’officier de marine, son resserrement, ses longues réclusions, ses veilles solitaires, sa stricte discipline, rappellent les conditions mêmes de la vie religieuse. Rien ne ressemble plus à la cellule d’un trappiste que la cabine d’un marin. Toutes deux tiennent dans quelques pieds carrés et toutes deux baignent dans l’infini. Le passage d’un de Blic dans les ordres s’était fait aussi naturellement que sa rentrée dans les cadres. Il n’avait rien eu à changer dans ses dispositions intérieures et, extérieurement, la présence d’un galon ou deux sur la .manche ne changeait pas grand'chose non plus à une tenue dont la couleur austère restait la même chez le congréganiste et chez l’officier. Mais nos hommes, peu sujets à s’étonner pourtant, n'en revenaient pas de trouver chez un curé tant de bonne humeur, de fantaisie et de bravoure. Ils ne savaient pas combien, pour certaines âmes, vivre dans le voisinage de la mort, avoir à toutes les minutes son frôlement et comme le vent de l’éternité sur la figure, c'est, suivant l’expression d’un autre prêtre-soldat, l'abbé Chavoleau[1], une joie qui rend fades toutes les joies. Coiffé d’un béret de marin, le mousquet au poing, il arrivait à de Blic de partir seul en patrouille, de s’offrir pour les reconnaissances les plus aventurées. Blessé dans une de ces reconnaissances, à Dixmude, le 26 octobre, il était revenu à la brigade à peine guéri. Et il y avait repris sa vie de Comanche. Mais on n’était plus ici à Dixmude et, dans ces plaines inondées, les reconnaissances ne pouvaient se faire que par bateau. Justement nous avions là nos doris, échouées dans les roseaux, sur les bords du marais. Leur faire passer la digue du Noord-Vaart et les lancer de l’autre côté du canal dans le shoore n’était pas d’une exécution bien difficile. De Blic, la veille de sa mort, était allé ainsi en doris, avec le quartier-maître Quinquis et cinq hommes, reconnaître la Ferme-aux-Canards. Le 17, il monta une autre expédition dans le sud vers les fermes Terstyle et Violette. L’expédition, cette fois, n’était composée que de quatre hommes : de Blic et les fusiliers Prieul, Younou et Cordier. La première ferme était vide. La doris reprit sa marche silencieuse vers la seconde — la ferme Violette. Elle put accoster la clytte et les hommes, après l’avoir cachée dans les roseaux, se mirent à ramper vers les bâtiments, de Blic en tête. A 100 mètres de la ferme, une rafale s'abattit sur eux : de Blic avait été tué sur le coup ; Cordier agonisait ; Younou, blessé, fut fait prisonnier, croit-on. Seul Prieul, quoique blessé lui-même à l'épaule, put se dissimuler derrière une souche. Il y resta jusqu’à la nuit et, tantôt en rampant, tantôt à la nage, parvint à rejoindre derrière le canal une de nos sections d’avant-poste. Ce fut par lui qu’on apprit la mort de l’enseigne, confirmée deux jours plus tard, dit Claude Prieur, par la capture en cet endroit d’un sous-officier boche qui déclara avoir assisté aux obsèques sur place d’un officier français habillé en marin[2]. Le lendemain ordre arrivait à la 4e compagnie de rentrer à Nieuport : une section belge devait nous relever à Klein-Noordhuyst. La nouvelle tactique adoptée pair le colonel Hennocque, le système de progression lente qui avait prévalu pour l’attaque sur la manière brusquée des premiers jours, exigeait que nos compagnies pussent se relayer sur la chaussée de Saint-Georges et le long de l’Yser. Peut- être eût-il été plus sage d’écouter dès cette époque les suggestions de l’enseigne de Blic et d’essayer d’occuper les fermes Terstyle et Violette avant que l’ennemi ne les eût organisées : l’échec des Belges, chargés de l’en déloger lors de l’attaque du 9 mai[3], ne nous eût pas obligés, sous les feux convergents qu’il dirigeait sur nous de ces fermes et de la rive droite de l’Yser, à lâcher l’important ouvrage de l'Union dont le lieutenant de vaisseau Béra venait de s’emparer. Pour l’instant, il est vrai, les fermes Terstyle et Violette n’avaient pour nous qu’un intérêt de second plan et toute l'attention était accaparée par Saint-Georges. Les quatre compagnies composant le bataillon devaient assurer en même temps la garde de la berge nord de l’Yser jusqu’à la maison F... incluse. Nous continuions cependant à nous tenir en liaison avec les chasseurs cyclistes, établis le long de la berge sud du canal où ils progressaient en même temps que nous. Pour cette progression, si délicate sur la mince langue de terre qui était tout notre champ d’opérations, on employait la méthode suivante : une patrouille allait poser pendant la nuit un réseau de fils de fer en avant de la position choisie ; puis elle se coulait le long des bas côtés de la route et y faisait le guet, tandis qu’à quelques mètres derrière et sous sa protection immédiate, des hommes creusaient hâtivement la nouvelle tranchée. Rude besogne, car on ne travaillait pas ici dans la glaise, mais dans une chaussée empierrée, fortement damée et qu’il fallait attaquer au pic. Cela n’allait pas sans quelque tapage et le travail était fréquemment interrompu par des volées de mitraille qui obligeaient les hommes à se défiler. La tranchée terminée, on la couvrait, on l’occupait, et, par des boyaux creusés le long des bas côtés, on la reliait aux tranchées subséquentes. Mais ce dernier travail, pourtant très dur, dit le lieutenant de vaisseau L..., fut à peu près inutile, car, sur la route, dans le terrain surélevé de la chaussée, on arrivait bien à creuser une tranchée de profondeur suffisante, mais, sur les bas côtés, qui étaient au même niveau que l’inondation, on trouvait l’eau à 40 centimètres de profondeur. En sorte que ces boyaux, qui coûtèrent beaucoup de peine à nos hommes et aux soldats du génie qui venaient toutes les nuits leur donner un coup de main, ne procuraient qu’une protection extrêmement précaire et devenaient, d’autre part, très vite impraticables. Si lente que fût cette manière de procéder, nous avancions cependant, le plus souvent sans pertes, et chaque jour nous rapprochait un peu plus de Saint- Georges. Non que l’ennemi demeurât inactif. Nieuport, derrière nous, bombardé par du gros calibre, achevait de s’effondrer. Nous y avions nos cantonnements et l’ennemi le savait. Mais il recherchait surtout les Cinq-Ponts où s’abritaient nos canonnières et qui étaient le point de rayonnement, la charnière des voies menant à Saint-Georges, à Nieuwendamme et à Lombaertzyde. Comme on craignait une rupture des communications, les ponts les plus menacés avaient été doublés par des ouvrages en liège. Les relèves purent ainsi s’effectuer régulièrement et notre progression ne souffrit aucun arrêt. En même temps que sur la route de Saint-Georges, elle se poursuivait du même train lent, mais continu, sur la berge sud et la berge nord de l’Yser. Sur la première de ces berges cependant, où les chasseurs tenaient un boyau dont l’extrémité était aux mains des Allemands, il fallait, pour gagner du terrain, pied à pied, tout le mordant et la ténacité de cette troupe incomparable, On ne dormait guère de part et d’autre dans ce boyau. C’était, dit le lieutenant de vaisseau L..., une lutte sans répit ni trêve, dans laquelle les adversaires n’étaient parfois séparés que par quelques mètres et des barricades en sacs à terre qui avançaient ou reculaient tour à tour. Mais les chasseurs dominaient nettement, et le boyau tout entier finit par leur rester, avec un redan qui se trouvait à la bifurcation du chemin de halage et du chemin de Saint-Georges. Entre la Maison du Passeur et eux, il n'y avait plus que la largeur d’une chaussée. Sur la berge nord de l’Yser, où opérait une de nos flanc-gardes, la compagnie Riou avait poussé son avance dès le premier jour, on s’en souvient, jusqu’à la ferme F..., où elle avait organisé un petit poste. Mais, en retrait de ce petit poste, une route partait de l’Yser et montait perpendiculairement à travers les terres inondées vers le vieux fort de Nieuwendamme occupé par l’ennemi. A supposer qu’il voulût prendre l’offensive, rien ne l'empêchait de nous tourner par cette route, de tomber sur notre flanc et de nous cerner dans la boucle de Saint-Georges. Il convenait donc de mettre en état de défense le carrefour de la berge nord et de cette route : une tranchée fut creusée en avant, une autre au carrefour même et une troisième devant la ferme F... Ce ne fut qu’après avoir pris ces précautions que la compagnie se remit en mouvement, employant pour avancer la méthode qui avait donné de si bons résultats sur la route de Saint-Georges. Quatre tranchées, disent les rapports, furent ainsi creusées sur la berge nord et une cinquième sur la route de Nieuwendamme, par le travers de la ferme Groote-Noord, lorsqu’on eut acquis la certitude que cette ferme n’était pas occupée par les Allemands. Mais, sur la berge nord, l’ennemi avait fortifié la ferme Versteck, placée de l’autre côté du canal, en face de la Maison du Passeur. Lignes d’eau, murs crénelés, réseau de barbelé, rien n'y manquait, pas même les mitrailleuses. Elles ne purent briser l’élan de nos hommes et, le jour même où la compagnie de chasseurs arriva devant la Maison du Passeur, la compagnie Huon de Kermadec, qui avait remplacé aux tranchées la compagnie Riou, enleva brillamment le ferme Versteck, qualifiée à juste titre par l'Officiel de position importante. Et, en effet, si cette position était restée à l'ennemi, non seulement la progression de la 2e compagnie sur la berge nord eût été arrêtée, mais les chasseurs eux-mêmes, pris d’écharpe, n’auraient pu bouger de leur redan. Couverts du côté du canal, ils s’élancèrent : le 27 décembre au matin, après une lutte acharnée, la Maison du Passeur était à eux et l’ennemi voyait tomber son principal réduit de flanquement sur l’Yser[4]. Nos marins, qui appuyaient l’attaque avec une section de
mitrailleuses, pouvaient revendiquer leur petite part dans ce succès. La
maison n’avait pas été emportée du premier coup. Une palissade de sacs à
terre nous séparait des Allemands, qui y épaulaient leur résistance. Mais,
parmi nos mitrailleurs, se trouvait un jeune marin, presque un enfant,
puisqu’il ne devait avoir dix-sept ans que le 22 mars de l’année suivante,
Yvon Nicolas. Solide et râblé, comme le sont ces mousses de la côte bretonne,
Yvon avait obtenu son brevet de fusilier le I er août 1914, à la veille de la
guerre. Et sans doute il n’était pas une exception dans la brigade. Il y
avait peut-être parmi ces Marie-Louise de la mer des marins encore plus
jeunes que lui : il n’y en avait pas de plus allant. C’était le type même de
la demoiselle au pompon rouge. La guerre
l’avait à peine bronzé : vétéran de Melle et de Dixmude, il portait dans ses
yeux clairs toute l’ingénuité de sa race et aussi son esprit d’aventure, la
tranquille audace héritée d’une longue lignée de coureurs d’océans. Et ce fut
cet Éliacin qui brisa la résistance allemande. Comment, malgré un feu nourri qui balayait la route et
arrêtait toute progression, Yvon réussit à hisser sa
mitrailleuse sur les sacs à terre qui le séparaient des Allemands,
comment il détruisit la plus grande partie de
ceux-ci, mit les autres en fuite, permettant
ainsi à un peloton de chasseurs cyclistes de pénétrer dans une maison, point
d’appui de la droite ennemie et qui n’était autre que la Maison du
Passeur, — sa citation le dit, mais elle n’évoque qu’imparfaitement la scène
et l’espèce de terreur sacrée où elle plongea la garnison. Il est certain
qu’Achille, sur le mur de sa tranchée, ne dut pas causer plus d’effroi à la
soldatesque troyenne que cet éphèbe aux yeux bleus apparaissant soudain aux
Allemands et braquant sur eux le canon de sa mitrailleuse. Derrière lui,
leurs muscles tendus pour l’attaque, les chasseurs avaient bondi. La charge
sonnait. La vague passa, emportant tout. Ce fut superbe,
dit le lieutenant de vaisseau Le Page qui, dans la même journée, allait
donner un pendant à ce beau fait d’armes en enlevant la première tranchée
ennemie de Saint-Georges[5]. C’était, en effet, la 3e compagnie qui, par suite du hasard des relèves, occupait à ce moment les tranchées avancées de la route. A la guerre comme ailleurs, et peut-être plus qu’ailleurs, celui qui sème n’est pas toujours celui qui récolte. Il en devait être autrement cette fois et la conquête de Saint-Georges, qui était réservée au capitaine Le Page, allait couronner deux semaines d’efforts méthodiques au cours desquelles ce fils d’un vieil instituteur breton, rompu aux fortes disciplines paternelles, avait révélé l’esprit ordonné, le coup d’œil et le sang-froid d’un vrai chef. Rien ne lui échappait. Très ménager de la vie de ses hommes, il s’entourait de renseignements, multipliait les patrouilles et les reconnaissances. Il était la vérification vivante du mot de Joffre que la guerre de tranchées est surtout une guerre de capitaines. Mais, de ce ruban de chaussée allongé entre deux lagunes impraticables, l'œil le plus attentif ne pouvait à peu près rien saisir des défenses ennemies. On les devinait formidables. Saint-Georges est le seul village du shoore. Massées à la croisée de trois routes, ses maisons formaient un bloc imposant autour d’une église trapue et découronnée. Notre artillerie bombardait bien le village, mais au hasard, faute d’indications précises sur les organismes de la défense. On savait seulement que cette défense était assurée par le 3e bataillon du régiment de marins, débarqué récemment au Kursaal d’Ostende. Les prévisions de l’État-Major s’étaient donc réalisées en partie : la lutte s’engageait entre des hommes de même formation et d’égal courage, marins contre marins, et, sur ces plaines inondées, sur ce shoore vaseux où Saint-Georges s’embossait au bout de sa jetée, c’était comme une scène d’abordage qui s’apprêtait. Mais, jusqu’à nouvel ordre, l’avantage de la position, malgré son immobilité, restait au vaisseau, qui nous dominait de toutes parts et n’offrait aucune prise visible à nos grappins. La situation aurait pu se prolonger assez longtemps, si le hasard n’était venu à notre aide de la façon la plus inattendue. Le 24 décembre au matin, la 3e compagnie venait de relever aux tranchées de la route la 1re compagnie du capitaine Riou. Dans la nuit, une patrouille de cette compagnie avait visité une maison que l’on voyait à droite, presque à l’entrée du village, et l’avait reconnue, disent les rapports, comme n’étant pas occupée par l’ennemi. Le commandant de Jonquières fit donner l’ordre à la 3e compagnie d’occuper cette maison dès son arrivée aux tranchées. Mais le capitaine Le Page voulut s’assurer au préalable qu’elle était toujours vide, car c’est assez l’habitude des Allemands de dégarnir momentanément certains postes avancés qu'ils réoccupent en force quelques heures après, et il l’envoya donc reconnaître par deux volontaires. Il faisait encore nuit et le temps était brumeux. Les deux hommes arrivent près du village, à la fourche de la grande route et de la levée de terre qui mène à la ferme de l’Union. Mais là, trompés par l’obscurité, au lieu de tourner par cette levée pour reconnaître la maison, ils continuent à suivre la route, et, sans se laisser arrêter par les obstacles de toutes sortes accumulés sur leur passage : tranchée inachevée avec caisson boulonné pour mitrailleuse, trou de loup de 25 mètres de long, sur 2 mètres de profondeur, barricade de sacs à terre et de madriers, ils poussent leur exploration jusqu’au cimetière, où ils découvrent tout un nouveau système de tranchées. A ce moment l’ennemi les aperçoit, mais leur bonne étoile les sert jusqu’au bout. L’un des deux hommes seulement, le fusilier breveté Roland, est blessé ; encore peut-il regagner nos lignes où on l’évacue aussitôt vers l’ambulance. Mais l’autre n’est pas touché. C’est un marin nommé Laplanche, patrouilleur émérite s’il en est, car dans les courtes minutes où il a fait le tour de Saint-Georges, il a pris mieux qu'une idée des défenses du village et il en peut donner le détail à son chef avec une précision qui ne laisse rien à désirer. La suite des événements permit de vérifier l'exactitude de sa description. Les défenses de Saint-Georges étaient constituées comme suit :
1. — Tranchée
inachevée de couverture avec, dans le coin sud a, un caisson boulonné
extrêmement solide pour loger une mitrailleuse. 3. — Trou de forme ovale
creusé sur toute la largeur de la route avec, au fond, piquets pointus et
fils de fer barbelés. — 4. Barricade en sacs à terre. — 3. Tranchées dans le
cimetière. — 6. Église. Le capitaine Le Page s’était empressé de communiquer ce schéma au commandant de Jonquières, qui, après en avoir pris connaissance, avait donné l’ordre au capitaine d’enlever la tranchée allemande de couverture. Il ne fallait pas attendre que l’ennemi eût achevé son organisation, et tel était bien aussi l’avis du capitaine. Mais il fit observer que l'inondation l’empêchait d’attaquer autrement que par la route et que, sur la route, il ne pouvait mettre en ligne qu’une dizaine de marins. Or, les Allemands, fortement retranchés à la barricade et dans le cimetière, tenaient nos tranchées sous une fusillade presque ininterrompue, qui eût fauché inévitablement, avec le concours de leurs mitrailleuses, les vagues d'hommes successives envoyées à l'assaut. En conséquence, le capitaine de la 3e compagnie, avant de passer à l’attaque, croyait devoir solliciter l'appui de la batterie du capitaine Boueil et demandait qu’on donnât l’ordre à cette batterie d’ouvrir le feu sur la barricade et le cimetière, objectifs précis qu’on avait toute chance d’atteindre, grâce aux renseignements apportés par le fusilier Laplanche. Jusque-là, notre tir s’égarait sur le village et frappait au hasard. Cette fois les Allemands ne pourraient recourir à leur méthode habituelle, consistant à se terrer pendant le bombardement pour regarnir ensuite les points bombardés ; le tir les frapperait dans leurs tranchées mêmes. Ce fut, en effet, ce qui arriva. Affolés par la précision de notre feu, les Allemands se replièrent en désordre vers l’église. Le second maître Cévaer n’eut qu'à faire passer les hommes de notre tranchée avancée dans la tranchée allemande de couverture, qu’ils retournèrent et organisèrent aussitôt sous sa direction. En même temps, une escouade, appelée de la levée de terre, venait garnir notre ancienne tranchée de première ligne. Tout cela se fit comme à la manœuvre et au coup de sifflet des maîtres, sans nous coûter un seul homme. |