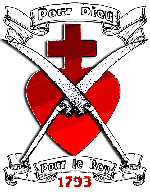LA CHOUANNERIE
BLANCS CONTRE BLEUS (1790-1800)
CHAPITRE XIII. — LA DEUXIÈME PACIFICATION.
|
AYANT achevé son récit du débarquement de Quiberon, énigme de discordes, de mensonges et d’intrigues..., dédale de conjectures odieuses et de contradictions impossibles, et montré — ce qu'ont vérifié après lui les autres historiens — que tout avait travaillé à la ruine de l’entreprise, et ses promoteurs et ses chefs, et les Anglais, et les princes et leurs agents publics et leurs agents secrets, l’honnête Pitre-Chevalier, écrivait : A l’expédition de Quiberon finira notre Histoire de la Révolution dans l’Ouest... Sans doute estimait-il sa tâche terminée. Et il est vrai que, pour la République, le grand danger était passé, mais non tout danger. Après Quiberon, la Vendée demeure et, chez les Chouans, Scépeaux, Boisguy, Frotté, Rochecot, La Vieuville, un peu plus tard Cadoudal, Guillemot, Sol de Grisolles, etc., sont toujours ou seront bientôt en armes. C’est à peine si les premiers ont eu connaissance du désastre, tant la partie était bizarrement engagée et les liens relâchés ou inexistants entre les divers éléments de l’insurrection. Il en résulte que l’échec de Puisaye n’a eu qu’un retentissement modéré sur ces lointains combattants devant lesquels Hoche, obligé de faire flèche de tout bois, n’a pu maintenir qu’un simple rideau de troupes et dont l’audace s’en est notablement accrue. Dans l’armée de Scépeaux, composée de 14.000 jeunes gens fort lestes et vigoureux (d’Andigné) et où étaient entrés avec des commandements les deux Turpin, Châtillon, d’Avoisne, d’Andigné lui-même, qui n’était encore que le chevalier de Sainte-Gemmes, et ce Bourmont qui, après avoir abandonné l’Empereur à la veille de Waterloo, devait prendre Alger et mourir maréchal de France, l'opération la plus retentissante avait été l’enlèvement de Segré par Ménard, dit Sans-Peur, et le chevalier de Turpin : toute la garnison fut passée par les armes. — Mais, chez Boiguy, les coups de main succédaient aux coups de main et souvent l’un n’attendait pas l’autre : Pontbriand, Boishamon, Bouteville, les deux Châlus, le vieux Couësbouc, presque septuagénaire et conservant dans la chasse aux Bleus sa carabine, sa casquette à visière et ses procédés d’ancien chasseur de loups, se multipliaient sous ce chef adolescent, d’un allant extraordinaire au point de prendre les Bleus à la course, moins pour les occire que pour les enrôler dans ses bandes, quand il leur avait trouvé quelque mérite, et dont la férocité semble avoir été une invention de ses adversaires : s’il n’a pu se disculper complètement de l’incendie du Tremblaye où une partie de la garnison républicaine périt grillée dans le clocher, on le voit témoigner d’une sévérité implacable envers des Chouans qui, au combat de La Piochais, où périt son frère Guy, avaient détourné vers un chemin creux la berline de deux jeunes filles de condition, Mlles Fesselier et Cholé, qu’ils fusillèrent après les avoir dévalisées. Et il reste que la prise de Saint-James, de Romsey, de Rémon, les combats de Juvigné et de la Pellerine comptent parmi les plus brillants faits d’armes de l’insurrection haut-bretonne. Dans l’armée de Frotté aussi, la dernière à se mettre en campagne comme elle sera la dernière à déposer les armes, les gains étaient sensibles et, à l’instigation de ce chef hardi, au nez court, même un peu cassé, mais au front ouvert, aux cheveux bruns tombant en boucles sur les épaules, aux yeux noirs, grands et pleins de feu, qu’on voyait tantôt à pied, tantôt sur un petit cheval bocain, vêtu de son éternel dolman de hussard gris, un pistolet et un poignard passés dans sa ceinture à la matelote et la tête coiffée, sur un mouchoir d’indienne, d’un tricorne à plumet noir et à cocarde blanche, l’insurrection, limitée d'abord à l’Avranchin et au district de Vire, avait gagné peu à peu la Seine : Pontorson cerné, Villedieu, Granville, Mortain menacés, Avranches coupée de toute communication, c’est, avec vingt petits combats qui sont autant de victoires, le bilan des premiers mois du soulèvement. Heureux effets de la bonne organisation donnée par Frotté à ses troupes réparties en 21 divisions, selon Bruslard, sous des chefs comme Mandat, Moulin, Saint-Paul, Marquerye, La Roque-Cahan, d’Oilliamson, d'Aché, le comte de Ruays, Godefroy de Boisjugan, Louvet de Monceaux, Bruslard lui-même et quelques autres moins notoires sortis de la rude matrice campagnarde ou importés de l’émigration par la voie maritime. Il appelle ses hommes les Chasseurs du Roi et, dans ce nom, il enveloppe indifféremment les volontaires chouans et les déserteurs des troupes républicaines ; puis, trouvant certains inconvénients à cet amalgame, il compose une brigade spéciale de déserteurs, dont le premier noyau fut le peloton de vingt-sept dragons embauchés à Rouen en septembre 1795, et qui, constituée ainsi en une sorte de légion étrangère de la Chouannerie, se pique d’émulation et fait merveille à côté des Chouans réguliers. Le déserteur passe même quelquefois en crânerie le Chouan : tel ce Graindorge qui, pris par les Bleus et condamné à mort, répond a un sergent qui lui propose un verre d’eau-de-vie pour se donner du cœur : — Un royaliste doit mourir de sang-froid. Dans le trajet il avise un des soldats de l’escorte : Grenadier, prête-moi ta pipe ; arrivé sur le lieu de l’exécution, il refuse de se laisser bander les yeux ; il demande comme unique grâce de mourir debout ; on le lui accorde et il tombe après avoir crié : Vive le roi ! et commandé lui-même le feu. Pour consacrer son souvenir, Frotté donne à sa compagnie le nom de guerre qu’il portait : la Grenade. Une autre création heureuse du général normand fut ce corps des Chevaliers de la Couronne, où il n’avait voulu enrôler que des gentilshommes de seize à vingt ans, héros imberbes, plus avides qu’aucun de se distinguer à cet âge où la passion de la gloire n’est pas altérée par la crainte de la mort. Ensuite sans doute, et après cette brillante entrée de jeu, la roue tourne, la fortune se montre moins fidèle. C’est que Hoche n’est plus loin. Rochecot, qui, dans une province voisine, le Maine, a pris la direction du mouvement, en prévient Frotté le 18 mars : L’état actuel de Charette a permis aux républicains de faire refluer partie de leurs troupes sur d’autres pays insurgés ; c’est surtout au vôtre et au mien qu’ils en veulent en ce moment. Sur la lisière même du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine, dans les districts gallots des Côtes-du- Nord, sauf autour de Saint-Brieuc où Le Veneur de La Roche n’avait pu réorganiser l’ancienne division de Boishardy, et dans le district breton- nant de Rostrenen, la Chouannerie, quelques mois après Quiberon, avait repris vie et confiance. Mais, assagie par l’expérience, elle ne travaillait plus qu’en petites bandes. Manœuvrée par des risque-tout comme La Vieuville, Saint-Régent, Legris-Duval, Carfort, du Cheyla, les frères Colas de La Baronnais, Stévenot, dit Richard, fils d’un corroyeur de Reims qui se faisait passer pour bâtard de Louis XV et marchait au feu, comme La Tour d’Auvergne, le sabre sous l’aisselle, cette poussière d’armée n’en était pas moins à peu près maîtresse du haut-pays ; elle faisait la loi, dit l’abbé Pommeret, dans soixante-huit paroisses du département. Peu d’actions importantes, bien que, le 17 janvier, les faubourgs de Dinan soient envahis et qu’en avril Guingamp n’évite le sac que de justesse. Dans la pluralité des cas, c’est l’habituel déroulement d’attaques de courriers et de convois, de pillages de caisses publiques, d’assassinats de prêtres jureurs et de fonctionnaires trop zélés, comme ce Le Roux Chef-du-Bois, ancien président du tribunal criminel, qui avait fait condamner à Lannion et guillotiner à Tréguier — peut-être par dépit d’amoureux évincé — la citoyenne Taupin, femme du valet de chambre de Mgr Le Mintier, convaincue d’avoir recélé deux prêtres réfractaires : Le Roux tombera sous les coups du mari revenu tout exprès de l’émigration pour ces sanglantes représailles ; la tradition veut que le ciel se soit chargé de la vengeance des deux prêtres et que le paysan de Brélévenez qui les dénonça ait été frappé jusqu’à la troisième génération dans sa postérité dont tous les membres, sauf un, naissaient idiots et fournirent à Joseph Conrad le sujet de son dramatique récit. Reste le Morbihan. La situation — et au début seulement — n’est vraiment différente que là, dans cet hinterland de Quiberon tenu à merci par Lemoine, le bourreau des émigrés, et où, avec ses colonnes mobiles, il multiplie les battues et les rafles ; là, l’insurrection, traquée, est bien obligée de se terrer provisoirement, de se contenter d’attentats isolés, d’exécutions furtives, comme celle de l’ancien carme Cassac, espion et jureur, ou celle du général républicain d’Esneval, ci-devant passé aux révolutionnaires et prévenu d’avoir épousé par force une Lantivy dont il fut d’ailleurs copieusement pleuré. Ce provisoire dure assez peu et l'on est tout surpris de voir le Conseil royaliste du département, dès le 22 octobre et sans même attendre l’avènement du Directoire, ordonner la reprise immédiate de l’insurrection. La Convention va mourir, une ère de sang est close. La France commence à respirer, — sauf dans l’Ouest, bien entendu, où c’est toujours le régime de l’état de siège. Mais Hoche, esprit méthodique, qui aborde les difficultés l’une après l’autre, ayant écrasé les royaux à Quiberon, remet à demain de faire subir le même sort aux Chouans et court, avec toutes ses forces, écraser la Vendée chez elle. Il n’a laissé sur place que le minimum de contingents nécessaire à maintenir l'ordre et l’occasion paraît bonne au Conseil royaliste où siège et qu’inspire le fameux abbé de Boutouillic, ancien vicaire général de Mgr Amelot. Ainsi furent décidées les affaires de Poublaye, du pont de Brovel, d’Elven, de Sarzeau, de Colpo, du Maigrit, de Locminé-Bignan qui ne tournèrent pas toutes à l'avantage des intéressés : à Elven notamment, Cadoudal, le 4 novembre 1795, toujours à cheval et drapé dans son grand manteau bleu, s’est heurté à la résistance victorieuse d'un bataillon de ces grenadiers de l’Ain qualifiés par le commissaire Dénouai, pour leur propension chapardeuse, de torrent dévastateur et qui tenaient comme roc sur leurs positions défensives ; l'émigré d'Andlar, en approchant une botte de paille enflammée de la caserne où ils étaient retranchés, fut tué d’un coup de fusil à quelques pas de Cadoudal, magnifique de sang-froid sous les balles, mais inapte à conduire un siège. Six mois plus tard, la Vendée jugulée, le tour des Chouans venu et Lemoine parti vers une autre destination, Quantin, qui l'a remplacé à la tête des forces du département, s’il est moins féroce, ne se montre pas moins pressant. Le 21 germinal (10 avril), il a donné à Hoche, en tournée d’inspection à Vannes, sa parole que le 5 messidor (23 juin), il n’existerait pas un seul Chouan dans le Morbihan. Promesse aventurée, mais qu’il fait tout au monde pour tenir — et qu’il tiendra. En attendant, Sol de Grisolles alerte sa division dans l’espoir de surprendre le généralissime qui rentre à Rennes par Locminé et Loudéac. Quantin, méfiant, a par bonheur pris ses précautions : Hoche en est quitte au Pont-du-Loch pour quelques salves inoffensives. Mais le lendemain (30 germinal-19 avril), sur la lisière des landes du Mené, l’attentat d'un frénétique, Lantivy du Rest, ancien lieutenant de Trousser, congédié par ses troupes qui le trouvaient trop dur vis-à-vis des Bleus (Le Falher) et qui veut mourir dans un coup d’éclat, ne rate que par la maladresse du tireur. Lantivy, comme un bon disciple de Jean-Jacques, s’est assis sur un talus, les pieds pendants, le nez dans un livre, mais sa carabine dans l’herbe à portée de sa main. Hoche envoie reconnaître par deux chasseurs ce liseur solitaire qui, le voyant arrêté, saisit ce moment pour l’ajuster et ne réussit qu’à fracasser l’épaule d’un des cavaliers de l’escorte : les chasseurs détachés vers lui le sabrèrent si rageusement que, suivant une tradition, on dut rouler ses morceaux dans un drap pour les emporter au cimetière. Quelques autres tentatives, sur Muzillac notamment par Sol de Grisolles et Mercier La Vendée, ne tournent pas plus avantageusement pour les bandes morbihannaises qu’achèvent de décourager leurs défaites caractérisées de Gueltas, de Silfiac et de Malbrand. Quantin est décidément homme de parole et les Chouans commencent à s’en apercevoir. On connaissait avant lui les cantonnements et les réquisitions, mais on ne s’en était pas servi avec cette maîtrise, on n’avait pas donné au système cette extension : grâce aux troupes fraîches que ne cesse de lui envoyer Hoche, qui peut faire sans risque le généreux depuis qu’il est débarrassé de tout souci du côté de Stofflet et de Charette, Quantin a jeté sur le pays un réseau si serré de postes et d’avant-postes que passer au travers est à peu près impossible : tantôt l’un, tantôt l’autre y reste, hier le chevalier de Montmuran, aujourd'hui le courrier de Cadoudal. Vraie toile d’araignée dont les Chouans sont les mouches : qui n'y laisse pas sa vie et quelquefois son honneur, comme le comte de Vaugiraud, y laisse au moins ses dépêches, comme le chevalier de La Garde. Tous les plans des conjurés sont éventés, connus, déjoués. Qu’arrive-il donc ? D’où viennent les mauvais regards que se lancent ces chefs qu’on nous disait si unis ? Et sont-ce là les effets de cette autorité prestigieuse que les historiens attribuaient à Cadoudal ? J’ai semé parmi eux l’ivraie de la méfiance, écrit Quantin au ministre de la Guerre le 21 prairial. Et Cadoudal confirme : Nous étions entourés de traîtres, d’espions... tous les moyens furent employés auprès de nos soldats. Le plus opérant fut la réquisition. C’est une chose d’ordonner qu’on enlèvera les bestiaux, les fourrages, les grains d’une ferme, qu'on frappera les communes d’une taxe, d’un emprunt forcé, et c’en est une autre, dans les pays insurgés, de pourvoir à l’exécution de cet ordre. Quantin l’avait appris à ses dépens en plusieurs occasions et, le 10 mars, au Maigrit, où il avait laissé sur le carreau soixante de ses hommes. Mais maintenant, avec les forces dont il dispose, la réquisition n’est qu’un jeu, et les soldats-paysans de Cadoudal, de Guillemot, de Grisolles, de Silz, de Roquefeuil, de Franque ville, etc., doivent assister, en se rongeant les poings au déménagement de leurs étables et de leurs granges. Bien pis : Quantin menace d’incarcérer leurs parents, leurs amis. Mon camarade, écrit-il le 13 floréal (2 mai) à son adjoint Auguste Mermet, il faut que tous les bestiaux, que tous les chevaux et que tous les riches et notables des communes imperturbablement rebelles de Bignan, de Saint-Jean-Brévelay, de Plumelec, Saint-Aubin, Callac et Saint-Allouestre soient enlevés de suite et conduits à Pontivy ou à Locminé ou à Josselin et de préférence à Vannes. Indépendamment de cela il faut que chacune de ces communes, qui depuis 91 n’ont rien payé, vous comptent chacune 25.000 francs, monnaie métallique, somme que vous consignerez à titre de dépôt seulement dans les caisses des payeurs. De préférence, néanmoins, mon cher ami, frappez vigoureusement et même rigoureusement les pères, mères et tuteurs de Chouans et les riches égoïstes des campagnes qui ne peuvent être des nôtres. Faites-les tous incarcérer et, en sus des amendes prononcées, exigez, pour chacun d’eux, 10 fusils tant de munitions qu’anglais et 200 cartouches à balles de poudre fine. Divisés, mécontents, suspects à eux-mêmes et à leurs troupes, que les chefs morbihannais regrettent aujourd’hui l’organisation démagogique qu’ils se sont donnée, les ferments de discorde qu’ils ont introduits parmi eux en rejetant Puisaye, en ne lui faisant grâce de la vie qu'à condition de porter ailleurs ses intrigues ! Les voilà qui viennent à jubé, Georges au premier rang, et qui, par un message du 27 avril, antérieur même à l’ordre de réquisition générale de Quantin, le supplient de reprendre sa place à leur tête ; ils jurent que l’expérience du passé leur servira, qu’ils sacrifieront tout désormais à la réussite de la cause commune. Et cependant ils ne font point mystère à leur correspondant du triste état où cette cause est réduite et, avec elle, la petite armée chouanne, noyée, submergée sous le débordement des forces républicaines. Dans les postes où, il y a deux mois, il n’y avait que 100 hommes, on en compte jusqu’à 1.000. D’après les rapports des autres armées, il paraît qu’elles se trouvent toutes dans le même cas. Nous craignons bien qu’un jour la Bretagne ne subisse le sort de l’armée de Charette. On se bat encore pourtant ; on expédie çà et là, par habitude, un maire, un jureur, un suspect ; on essaie de surprendre une colonne mobile et le plus souvent on est rossé et l’on n’a rien empêché, ni les réquisitions, ni les arrestations, ni les occupations. Guillemot lui-même, le roi de Bignan, connaît cette honte suprême de voir la capitale de son royaume occupée par 200 Bleus aux ordres du citoyen Bosquet et de n’oser intervenir. Sur quoi il se décide et, avec Mercier La Vendée, général en second, d'Allègre, Trécesson et du Chélas, divisionnaires, il adresse par billet sa soumission à Mermet. On est au 8 juin ; dès la fin de floréal, du Bot cadet s’était soumis, et Mercier, d’Allègre, le 12 prairial (31 mai), en plus de Roquefeuil, avaient ouvert les pourparlers avec Quantin ; le 17, le 20, les négociations continuent ; le 24 Hoche est à Vannes et y reçoit Cadoudal, Mercier, du Chélas, Guillemot Sans-Pouce, ainsi nommé d’une infirmité de sa main gauche qui sert à le distinguer du roi de Bignan, et deux autres chefs chouans non identifiés. Le P. Le Falher, a qui l'on doit ce relevé méticuleux et si précieux des successives redditions morbihannaises, croit que c’est dans cette entrevue que le général en chef détermina les clauses du traité, entendons par là que c’est dans cette entrevue qu’il fit connaître ses conditions aux rebelles, car elles ne comportaient point de discussion, sauf peut-être sur des points de détail, étant les mêmes pour tous, fort douces en outre et allant jusqu’à la limite des concessions permises. Cadoudal les accepta le 26 prairial (14 juin) ; d’Allègre et Saint-Romain le 30 (18 juin) ; Trécesson, La Nougarède et Silz le 3 messidor (21 juin) ; du Chélas et du Bouays le 5 (23 juin). Ce même jour, qui était la date fixée par Quantin, tout était fini et, suivant sa parole, il n’y avait plus un seul Chouan en armes dans le Morbihan. Mais il y en avait encore dans les autres départements insurgés, parce que Hoche ne voulait pas recommencer la Mabilais et, à une conférence générale, toujours dangereuse, préférait le système des tractations particulières. Quand donc, le 12 messidor suivant (30 juin), Georges écrit au recteur de Berric, Guillaume Jégoux, pour ramener à une vue plus nette de la situation ses peu accommodants paroissiens : Il nous reste, pour tout, le Morbihan... Il n’y a plus d’espoir raisonnable, c’est, quoi qu’on ait dit, le besoin de se justifier près d’une fraction intransigeante de ses troupes plus que la démoralisation, le désespoir, qui lui dictent ces lignes inexactes. Car le Morbihan a traité le second, avant la Normandie, la Haute- Bretagne et le Maine. Frotté est plus en droit que Cadoudal d’écrire à ses soldats : Nous seuls restons pour soutenir une guerre aussi juste que légitime. Cadoudal semble avoir été fortement impressionné par la reddition inopinée de Scépeaux qui, dans sa hâte de traiter, ne voulut même pas attendre la réponse de Puisaye, près duquel il avait détaché Châtillon et d’Andigné : dès le 14 mai, le chef de l’Anjou chouan acceptait les conditions de Hoche. Les raisons qui l’avaient conduit à renoncer étaient sensiblement les mêmes que celles qui décideront Cadoudal et ses divisionnaires : l’afflux des troupes républicaines, les réquisitions, les amendes, les incarcérations. En sus, la crainte de manquer de pain et déjà la disette de vin et d’eau-de-vie. Le licenciement, de toute façon, s’imposait, selon d’Andigné. Soit, mais en plein accord avec les autres chefs. Le parti royaliste est un, rappelait justement Puisaye à Scépeaux, comme le roi pour lequel il combat. Une portion ne peut traiter sans l’autre. Vaines admonestations. La capitulation de Scépeaux entraîna, déclencha automatiquement celle de Cadoudal, car la reddition presque concomitante de trois ou quatre petits divisionnaires de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine, d’Escarboville, Sévère de La Bourdonnaye, etc., n’aurait point eu d’influence sur les Morbihannais. Tant y a qu’en traitant le 14 juin Cadoudal distançait de deux jours Apuril, le divisionnaire de Mordelles, qui ne traita que le 16 avec Travot, et, de plusieurs jours. Frotté, Boisguy et Pontbriand, dont le dernier ne se rendit que le 30 juin à Spithal. Presque tous sans doute étaient à bout de souffle, mais Frotté surtout : le 19 février dans la nuit, quand avec ses Chouans, la chemise passée pardessus leur pantalon pour se reconnaître dans l’obscurité, il se jetait sur Fougères, mal gardée, il ne s’attendait pas en être refoulé si vite par une garnison que les roulements de la générale avaient alertée en quelques minutes ; moins heureux encore, le 31 mars, devant Tinchebray qu’il essaye d’incendier, ne pouvant réduire sa garnison, inférieure des deux tiers à sa troupe, mais soutenue, portée par la population et les femmes elles-mêmes qui rafraîchissent à grands seaux d’eau les couvertures mouillées sous lesquelles se battent les 250 hommes du lieutenant Valentin, il perd dans cette affaire une centaine des siens, dont vingt officiers. Et cela ne l’empêche pas peu après, avec l’héroïque Mandat, qui l’a rejoint dans la forêt de Saint-Jean, de s’embusquer à Préaux, sur la route de Domfront, de tomber sur le général Ta Rue et de lui enlever son convoi. Il est tenace et il sait se retourner : ce sont ses vertus principales. Ta Ferté-Macé, Couterne, bourgs fortifiés, lui résistent ; Alençon échappe à son lieutenant Médavy : il se rabat sur Fiers ; il combine avec Boisguy un coup sur les postes républicains de la côte pour assurer un débarquement anglais d’armes et de munitions ; Mandat est encore vainqueur au Grand-Celland (i er juin), où un millier de Bleus s’affrontent à autant de Chouans et succombent après une lutte sanglante de huit heures. L’affaire du Pas (15 juin), menée par Frotté en personne, fut son chant du cygne. Il ne tenait plus ses hommes ; chaque jour quelqu’une de leurs bandes se rendait ; il les voyait se détacher de lui comme les feuilles de l’arbre touché par l'automne. Les causes qui avaient agi ailleurs ne pouvaient manquer d’agir ici, mais avec des effets variés. Alors que dans le Morbihan les paroles étaient peu opérantes, le verbe pacificateur de Hoche, ses appels au désarmement, à la réconciliation, dont il marchait partout précédé, reprenaient céans tout leur empire. En Vendée même, Stofflet, Charette, étaient moins tombés sous les balles de ses grenadiers que sous l’action énervante de ses proclamations qui faisaient glisser le fusil des mains. Que ne promettait-il ou ne laissait-il espérer aux insurgés qui se rendraient ? Pas seulement l'amnistie, mais encore la liberté du culte, la remise des taxes arriérées, jusqu’à un régime de faveur pour les jeunes gens de la réquisition auxquels le travail des champs serait compté comme un temps de service aux frontières... Les administrations départementales et municipales trouvent bien excessives ces concessions, grognent, dénoncent dans Hoche un nouveau Cromwell : il n’en a cure. L’obstination de Frotté, son caractère chevaleresque, peut-être aussi certain souvenir d’une entrevue où les deux hommes avaient sympathisé sur plus d’un point, inclineront Hoche à faire ce qu’il n’avait pas fait pour Scépeaux ni pour Cadoudal, à prendre les devants et à lui offrir par le général Dumesny une trêve et une conférence. Celle-ci se tiendrait au château de Couteme, berceau de la famille de Frotté et où il avait passé dans sa jeunesse tant de jours heureux ; Dumesny s’y rendrait seul, avec un adjudant ; connaissant ses principes, le général ne voulait rien lui proposer qui pût toucher à son honneur et, malgré toutes ces précautions de style, Frotté ne put aller jusqu’au bout de sa lecture et s’évanouit comme une petite maîtresse. Incapable de supporter la pensée d’une capitulation, lui qui avait refusé sa signature au traité de la Mabilais, et se rendant compte cependant de l’impossibilité de toute résistance, il chargea le vicomte de Chambray, président du Conseil de l’armée normande, de suivre à sa place les négociations et s’embarqua pour l’Angleterre avec son frère et Marquerye. Il n’avait rien signé, cette fois encore, rien demandé, rien promis pour lui-même, et il eût donc été parfaitement libre de ne considérer cette paix que comme une trêve, un moyen de se préparer à reprendre la guerre avec plus d’avantage, si, par deux lettres au général Dumesny et à ses propres troupes, il n’avait engagé la signature de celles-ci. Sophismes et contradictions de
l’esprit de parti, ne peut s’empêcher de remarquer à ce propos son biographe
et panégyriste habituel Fouis de La Sicotière. Cet homme qui, par un
sentiment de délicatesse, au risque d'être pris et fusillé au coin d’une
haie, refusait sa signature à un traité jugé nécessaire par la plupart de ses
camarades et dont il était le premier à leur conseiller l’acceptation,
n’éprouvait, en apparence, aucun scrupule à avouer que ce traité n’était
qu’un leurre, à y compromettre l’honneur de ces braves gens dont le sien
était pourtant solidaire. C'est Cormartin, le jésuite Cormartin, qui avait mis à la mode dans les traités cette casuistique funeste, cette pratique des restrictions mentales dont les émigrés ne se sont qu’ incomplètement justifiés en arguant qu’il y avait encore moins de sûreté dans la parole de leurs adversaires, et Frotté, par ailleurs si noble, si généreux, était affligé d’un véritable impétigo scripturaire qui lui faisait prendre la plume à tout propos. Au demeurant et en la circonstance on lui préfère Rochecot licenciant ses troupes sans recourir à l’encrier et disparaissant comme il était venu, ou même un Puisaye, abandonné de Boisguy, dont il est l’hôte et qui le déteste, ne conservant plus pour sa sauvegarde qu’un petit peloton d’émigrés formés en Compagnie des Chevaliers catholiques sous les ordres successifs de Péan de Saint-Gilles et du vicomte de Chapdelaine et continuant avec cette poignée de don Quichotte sa guerre à la République. Le maudit Puisaye ! s’écrie Hoche. A celui-là il ne daigne ou peut-être n’ose-t-il pas parler d’amnistie ou de capitulation. Il connaît la puissance d’illusion du personnage et son orgueil incommensurable qui tient tête aux princes et va jusqu'à lui faire s’écrier dans le moment où tout craque, où le sol cède sous ses pieds : — Je puis me faire duc de Bretagne quand je voudrai. J’ai 200.000 partisans à ma disposition. L’homme qui parle avec cette superbe pourra se résoudre lui aussi à passer le détroit, non en vaincu et après avoir mis bas les armes, mais pour attiser la haine anglaise, la décider à un nouvel effort. Il connaît la Révolution ; il la sait incapable d’une politique de modération suivie. Lt les événements lui donneront raison : assez large envers les hommes, plus chiche envers les chefs, l’amnistie n’est en trop d’endroits qu’un mot vain. Hoche a beau s’interposer : les directoires départementaux, les administrations locales saisissent tous les prétextes pour remettre la main sur ceux en qui leur haine ou leur peur n’a pas cessé de voir des ennemis. Chambray est arrêté à Rouen, Moulin à Mortain, Jean Jan à Baud, Silz à Arzal, Scépeaux à Nantes, Billaud à la Ferté-Macé, Mandat — qui, blessé, n’a pu suivre son chef — à Caen, Boisguy au Boisguy d’où il est jeté à la tour Grainetière, la plus mal famée du donjon de Saumur. On guillotine tous les jours des prêtres à Vannes, écrivait un peu auparavant Hoche au directoire. Tous les jours aussi les vieilles femmes et les jeunes garçons viennent tremper leurs mouchoirs dans le sang de ces malheureux, et bientôt ces monuments d’horreur servent de drapeaux aux fanatiques habitants des campagnes. On ne guillotine plus, la paix signée, mais on fusille encore quand l’occasion s'en présente et au mois d'août 96, Videlo constate que les prêtres sont obligés de se cacher aujourd’hui comme auparavant ; ce qu’ils ont de mieux, ajoute-t-il, c’est que, les Républicains ne courant pas tant les campagnes, ils peuvent voir de temps en temps le soleil. Les choses en viennent là que Cochon de Lapparent, le nouveau ministre de l’Intérieur, est obligé de rappeler aux administrateurs l’article de la loi du 7 vendémiaire par lequel les membres du clergé ne sont plus astreints au serment, mais à une simple déclaration : encore conseille-t-il de ne pas les y assujettir trop sévèrement pour ne pas troubler de nouveau la tranquillité publique. Autant en emporte le vent. L’armée elle-même n’observe pas partout les conditions du traité : elle pille, vicie, incendie ; elle n’est, en un trop grand nombre de corps, qu’un ramassis de scélérats qui inspirent au généralissime le dégoût de son métier et aux insurgés le légitime regret d’avoir fait leur soumission. Mais Hoche, de son côté, n’échappait que par miracle à une tentative d’assassinat, et le pistolet, si maladroitement braqué contre lui, à Rennes, à la sortie du théâtre, le 16 octobre 1796, par l’ouvrier Moriau, avait été chargé par une main royaliste. — Malheureux ! as-tu une femme, des enfants ? demande Hoche à son assassin qu’il a fait venir dans sa chambre pour l’interroger en dehors des commissions publiques. Et comme Moriau, sanglotant, avoue que la faim seule l’a poussé au crime, qu’il a vendu son bras pour un écu, Hoche le congédie en lui remettant vingt-cinq louis pour sa famille. Le grand soldat qui achève de s'imposer à notre admiration par ce geste cornélien n’a pas encore vingt-huit ans : les ombres qui gâtaient un peu jusqu’ici cette belle figure se sont estompées, effacées ; il est à ce point de la courbe où l’ambitieux à fond d’honnête homme peut sans danger pour son ascension découvrir le monde moral, les plaines austères de la conscience. Peu content de pardonner à ses ennemis personnels, il intervient pour les ennemis de l’État ; il ne reste plus neutre entre eux et les complices de l'atroce Tallien, comme au lendemain de Quiberon ; il n’est plus le Ponce-Pilate soucieux d’abord de ne pas se compromettre, et il parle ferme et net au nom de l'humanité et de l’intérêt supérieur du pays. Le 1er messidor an IV, il écrivait à sa femme : Tu peux assurer que la guerre des Chouans est finie, ainsi que celle de la Vendée. Peut-être la Chouannerie lui a-t-elle paru plus difficile à réduire que la Vendée, au point qu’il a un moment désespéré d’en venir à bout. Puisaye, avec ses adresses, son sens de l’intrigue, lui faisait plus peur que Stofflet et Charette avec tout leur génie militaire. Pour en terminer avec cette guerre affolante contre un ennemi insaisissable, où chaque talus dissimule un combattant, où de chaque souche de chêne, de chaque coin de champ ou de rue peut partir un coup de fusil ou de pistolet mortel, il ne recule devant aucune concession d’amour-propre ; il prête l’oreille aux suggestions de la cousine même de Scépeaux, la vicomtesse Turpin de Crissé, une royaliste, mais clairvoyante, qui de son château écarté d’Angrie, se rend compte que ces luttes fratricides sont sans aboutissement et qui a travaillé déjà une première fois à la pacification de l’Anjou : Après maintes allées et venues, dit Mathilde Alanic, la délicate négociatrice trouve le généralissime aussi désireux qu'elle de voir s’établir la concorde ; elle éprouve dans les entrevues suivantes, jusqu’à l’extrême limite, la générosité de l’adversaire ; enhardie par ces concessions qu’on eût pu croire les dernières, elle ose en demander et en obtient de nouvelles : ouverture des prisons, sauf-conduits pour les émigrés qu’elle aura le droit d’hospitaliser en attendant de quitter la France. Dans sa reconnaissance, son émerveillement de cette largeur d’esprit accordée à tant de magnanimité, elle s’écrie : — Général, si vous ne voulez pas faire roi Louis XVIII, que ne vous faites-vous roi vous- même ? L’ingénuité d’une telle question eût bien excité la verve de ce La Vieuville qui commandait entre Dinan et Saint-Malo la plus importante division des Côtes-du-Nord et qui, pour avoir eu Hoche sous ses ordres, croyait pouvoir conserver avec le général en chef des armées de l’Océan le même ton supérieur qu’avec le sergent aux gardes-françaises. La Vieuville venait de tomber dans une embuscade en quittant Puisaye ; son cadavre gisait quelque part dans la forêt de Villequartier : Hoche songeait que les La Vieuville se comptaient par centaines chez les émigrés, que le préjugé du sang l’emporterait toujours chez eux, qu’une Turpin de Crissé était l'exception et qu’aussi bien, ayant pacifié la France et lui-même, il connaissait la plus haute des royautés, il pouvait répéter après Auguste : Je suis maître de moi comme de l’univers.... Entraîné hier encore dans le courant d’athéisme universel, il entend aujourd’hui que l’enfant qui va naître de sa chère Adélaïde suive un culte, pratique une religion ; il voit là une sauvegarde et un réconfort, la satisfaction d’un besoin de l’âme trop méconnu et qu’il commente à sa jeune femme dans une langue touchante de gaucherie ; au Directoire il demande qu’on ne revienne pas sur la question du serment, première cause des maux qui ont désolé ces malheureuses contrées ; à Rennes, le 29 mai, pour la fête des Victoires, il invoque publiquement l’Eternel et lui fait hommage de celle qu’il a remportée, de la paix équitable qui l’a couronnée. En vertu des dispositions générales de cette paix, tous
les combattants, officiers ou soldats des armées insurgées qui avaient fait
leur soumission étaient amnistiés, les jeunes gens de la réquisition mis en
congé définitif, les déserteurs réintégrés dans leur ancien corps, les
prêtres réfractaires laissés ou remis en liberté. La dictature militaire
prenait fin du même coup et, avec elle, l’odieux régime des réquisitions et
des charrois obligatoires. Seuls les émigrés restaient des émigrés : la
patrie les rejetait à l’exil, mais les munissait de sauf-conduits pour le
voyage. En somme, comme l’observait d’Andigné aux têtes chaudes de sa
compagnie, tous les avantages de cette paix étaient pour les hommes, puisque les
émigrés étaient tenus à quitter la France et que leurs propriétés restaient
sous le séquestre. Ici, comme à Berric, les plus obstinés ne sont pas
les chefs. Le cliquetis sec des chiens de fusil armés et désarmés au cours de l’orageuse explication témoignait des sentiments divers par lesquels passait l’auditoire, ébranlé, mais non convaincu. Le caractère démocratique de l’insurrection s’affirmait une fois de plus. L’estimable gentilhomme ne disait pourtant que la stricte vérité, et les émigrés, dans ces conventions, n’avaient rien stipulé, demandé aucune faveur pour eux-mêmes. Tant de désintéressement doit bien leur être compté par l’Histoire, si facilement et quelquefois si justement sévère pour eux sur nombre d'autres points. |